- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton

Max Jacob (1876-1944), "Le Cornet à dés" (1917) - Jean Cocteau (1889-1963), "Plain-Chant" (1923), "Thomas l'Imposteur" (1923), "les Enfants terribles" (1929) - Raymond Radiguet (1903-1923), "Le Diable au corps" (1923) - .....
Last Update: 11/11/2016

La littérature comme jeu et façon de vivre, la vie et la littérature se contaminant l'un l'autre dans une même illustration de la pensée et de l'exercice de cette pensée dans l'existence - "Pour Max Jacob (1876-1944), pour Jean Giraudoux (1882-1944) et pour Jean Cocteau (né en 1889), la littérature est essentiellement un Jeu, et une façon de vivre en se jouant, une fête, une fantaisie - sarcastique, désinvolte ou souriante, une activité tout artificielle, puisque les problèmes de la vie sont tenus à l'écart, mais aussi un engagement essentiel, puisqu'elle est à elle seule une façon de répondre totalement à la vie.
L'importance de Max Jacob, par exemple, ne s'explique pas seulement par la qualité de son œuvre, mais par le personnage qu'il incarna; la contamination subtile de l'œuvre et de la vie emprunta les voies les plus diverses, mais fut maintenue jusqu'au bout, de la bohème un peu satanique au dépouillement religieux des dernières années : l'influence de Max Jacob sur les écrivains et les peintres qui le fréquentaient fut considérable. Écrivain étonnamment doué, il laisse une œuvre très neuve d'accent et de vision, très diverse puisqu'elle va du récit ("Le Terrain Bouchabaile", 1923) aux poèmes du "Laboratoire central" (1921), aux proses du "Cornet à Dés" (1917), aux prières des "Méditations religieuses" (1948). Une fantaisie étincelante, une cocasserie incomparable dissimulent un pouvoir étrangement corrosif; l'ingénuité rend un son grinçant; les Jeux les plus frivoles - coq-à-l'âne, calembour, contrepèterie - se donnent libre cours et l'on s'émerveille autant que l'on s'amuse, pour s'Inquiéter bientôt de l'écho sardonique d'un rire qui semblait fraîcheur et enjouement. Entre la grâce la plus exquise et la subtilité la plus desséchante, entre la sincérité et la parodie, l'œuvre se déchire - comme l'homme s'est déchiré.
Il y a de cela aussi chez Jean Cocteau et la silhouette mondaine du grand couturier des lettres françaises semble parfois répondre à la bohème pittoresque de Max Jacob. Même contamination de l'œuvre et de la vie, même affectation ou, du moins, même équivoque sincérité, un jeu analogue avec les mots, les choses, les êtres et soi-même. Jeu mené par une main très sûre et très prestigieuse, d'ailleurs, et assez envoûtant pour nous dérober le sentiment des conditions suspectes dans lesquelles il opère parfois : les strophes célèbres de "Plain-Chant", où les ruptures les plus modernes sont associées à la prosodie de Malherbe, où l'ingéniosité la plus experte a pour fin d'éveiller le sentiment le plus vrai, sont à la fois une étonnante réussite et un tour de prestidigitation assez inquiétant. Étroitement liée au moderne, à quelques-uns de ses aspects profonds et aussi à ses modes les plus éphémères et les plus irritantes, l'œuvre de Cocteau tente de lui soumettre le prestige des plus vieilles mythologies : mais la réussite elle-même est minée par l'impression d'artifice qu'elle suggère. Les mythes de Cocteau, son fantastique, son surréalisme donnent souvent le sentiment d'un bric-à-brac somptueux mais hétéroclite et clinquant. Cependant, des récits comme "Thomas l'Imposteur" (1923) et "Les Enfants terribles" (1929) prennent place parmi les expressions les plus pures et les plus saisissantes du désespoir moderne et, sous tant de bariolages d'Arlequin, Il y a parfois dans la poésie de Cocteau comme une nudité incomparable : "Le Discours du grand Sommeil", "L'Ange Heurtebise" nous introduisent par instants dans une sorte de silence soyeux, de vide cristallin où s'approche ce qu'il y a de plus précieux et impalpable dans la poésie."
(de l'incomparable Gaëtan Picon, Panorama de la nouvelle littérature française, 1960, Gallimard) & (Portrait de Max Jacob, Pierre De Belay, 1933, musée des Beaux-Arts de Quimper)


Max Jacob (1876-1944)
Fils d'un antiquaire juif, Max Jacob naquit à Quimper puis vécut à Paris, où il fréquentera Apollinaire, devint l'ami de Picasso et exerça toutes sortes de métiers : il fut tour à tour employé de commerce, balayeur, mais aussi peintre de talent et critique d'art. En 1909, le Christ lui apparaît : cette vision le fait passer par les émotions les plus intenses et entraîne sa conversion (1914).
De 1921 à 1928, il se retire à Saint-Benoit-sur-Loire. Il est arrêté par les nazis et interné au camp de Drancy, où il meurt en 1944.
Son oeuvre est marquée par une surprenante dualité, fantaisie et mysticisme : "Oeuvres burlesques et Mystiques de Frère Matorel" (1912), "Le Cornet à dés" (poèmes en prose, 1917), "La Défense de Tartuffe" (1919), le "Laboratoire central" (1921), "Les Pénitents en maillots roses" (1925). Max Jacob révèle parfois une angoisse si profonde que l'on peut penser que son humour proche de la mystification est un moyen de défense contre l'incompréhension du monde.

"Sous les caps du passé, océan sans rivage
Je contemple un amour emporté par les vents
Les troupeaux fugitifs en la nuit de mon âge
Disparaissent. Mes yeux sont les lampes du temps.
Terres mémoriales, mes îles fortunées!
Seigneurial délice, majestueux repos!
Les rapides chevaux de mes vertes années
N'ont pas lassé mon coeur du bruit de leurs sabots.
J'ai tissé, j'ai tissé de vents et de paroles
Un voile au long col gris tenu par les péchés
De mon dernier portail il cache l'Acropole
Et courbe vers le sol un casque empanaché.
As-tu faim de la terre? Rêves-tu de royaumes?
Changerais-tu de peau, de pays, de couleur?"

"Le Cornet à dés" (1917)
Recueil de poèmes en prose, - genre que le XXe siècle a tant aimé et genre qui convenait parfaitement à la liberté de ton de Max Jacob - rédigé entre 1904 et 1910, et publié en 1917. A un moment où André Breton et ses amis découvrent les "Illuminations", Max Jacob porte sur l`œuvre de Rimbaud de sérieuses critiques, qui ne lui seront pas pardonnées ("Le poème est un objet construit et non la devanture d'un bijoutier. Rimbaud, c'est la devanture du bijoutier, ce n'est pas le bijou : le poème en prose est un bijou"). Dans un poème en prose, le pittoresque du décor ou l'intérêt du sujet sont secondaires, seuls importent "l'accord des mots, des images et leur appel mutuel et constant". Max Jacob se plaît aussi à la surprise et à la diversité des tons et ses poèmes portent pour titres des indications de genre ("Poème sentimental", "Poème dans un goût qui n'est pas le mien"), des lieux communs moraux ("Craindre le pire") ou sont de discrets indices biographiques ("La Rue Ravignan"). Il ne fait pas du poème le lieu d'une évocation sentimentale ou la relation d'un événement, mais un objet verbal. Le poème défait les associations traditionnelles, et les regroupe avec le minimum de motivation, les changements de perspective sont fréquents, les effets de juxtaposition, les métamorphoses rapides donnent le sentiment que les mots naissent des mots ...
LA RUE RAVIGNAN
"ON ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve", disait le philosophe Héraclite. Pourtant, ce sont toujours les mêmes qui remontent! Aux mêmes heures, ils passent gais ou tristes. Vous tous, passants de la rue Ravignan, je vous ai donné les noms des défunts de l'Histoire! Voici Agamemnon! voici Mme Hanska! Ulysse est un laitier! Patrocle est au bas de la rue qu'un Pharaon est près de moi. Castor et Pollux sont les dames du cinquième. Mais toi, vieux chiffonnier, toi qui, au féerique matin, viens enlever les débris encore vivants quand j'éteins ma bonne grosse lampe, toi que je ne connais pas, mystérieux et pauvre chiffonnier, toi, chiffonnier, je t'ai nommé d'un nom célèbre et noble, je t'ai nommé Dostoïevsky.
POÈME
QUAND le bateau fut arrivé aux îles de l'Océan lndien, on s'aperçut qu'on n'avait pas de cartes. Il fallut descendre! Ce fut alors qu'on connut qui était à bord : il y avait cet homme sanguinaire qui donne du tabac à sa femme et le lui reprend. Les îles étaient semées partout. En haut de la falaise, on aperçut de petits nègres avec des chapeaux melon : "Ils auront peut-être des cartes!" Nous primes le chemin de la falaise : c'était une échelle de corde; le long de l'échelle, il y avait peut-être des cartes! des cartes même japonaises! nous montions toujours. Enfin, quand il n'y eut plus d'échelons (des cancres en ivoire, quelque part), il fallut monter avec le poignet. Mon frère l'Africain s'en acquitta très bien, quant à moi, je découvris des échelons où il n'y en avait pas. Arrivés en haut, nous sommes sur un mur; mon frère saute. Moi, je suis à la fenêtre! jamais je ne pourrai me décider à sauter : c'est un mur de planches rouges : « Fais le tour », me crie mon frère l'Africain. Il n'y a plus ni étages, ni passagers, ni bateau, ni petit nègre; il y a le tour qu'il faut faire. Quel tour? c'est décourageant.
ENCORE FANTOMAS
ILS étaient aussi gourmets que gourmés, le monsieur et la dame. La première fois que le chef des cuisines vint, un bonnet à la main, leur dire : "Excusez-moi, est-ce que Monsieur et Madame sont contents ?" on lui répondit : "Nous vous le ferons savoir par le maître d'hôtel!" La seconde fois, ils ne répondirent pas. La troisième fois, ils songèrent à le mettre dehors, mais ils ne purent s'y résoudre, car c'était un chef unique. La quatrième fois (mon Dieu, ils habitaient aux portes de Paris, ils étaient seuls toujours, ils s'ennuyaient tant!), la quatrième fois, ils commencèrent : "La sauce aux câpres est épatante, mais le canapé de la perdrix était un peu dur." On en arriva à parler sport, politique, religion. C'est ce que voulait le chef des cuisines, qui n'était autre que Fantomas.
GENRE BIOGRAPHIQUE
DÉJA, à l'âge de trois ans, l'auteur de ces lignes était remarquable : il avait fait le portrait de sa concierge en passe-boule, couleur terre cuite, au moment où celle-ci, les yeux pleins de larmes, plumait un poulet. Le poulet projetait un cou platonique. Or, ce n'était, ce passe-boule, qu'un passe-temps. En somme, il est remarquable qu'il n'a pas été remarqué : remarquable, mais non regrettable, car s'il avait été remarqué, il ne serait pas devenu remarquable; il aurait été arrêté dans sa carrière, ce qui eût été regrettable. Il est remarquable qu'il eût été regretté et regrettable qu'il eût été remarqué. Le poulet du passe-boule était une oie.

"La Défense de Tartuffe" (1919)
Volume de poèmes et de prose dédié à Juan Gris qui se veut autobiographie spirituelle de Max Jacob et journal poétique de sa conversion. L'ouvrage se partage en quatre parties, "L'Antithèse", qui porte sur la vie du vieil homme, "La Révolution", qui célèbre l'apparition du 22 septembre 1909 - "Ma chair est tombée par terre ! J'ai été déshabillé par la foudre ! Oh ! impérissable seconde" -, "La Décadence ou mystique et pécheur", qui rappelle la division fondamentale de la vie de l'auteur entre gravité et facétie, enfin "La Vie dévote", qui évoque l'ouvrage de saint François de Sales, ce dernier jouant un rôle fondamental dans la conduite religieuse de Jacob. Le titre de sa défense, face à ceux qui doutent de la vérité de sa foi, assimile l'auteur à Tartufe pour se présenter en hypocrite par humilité, acceptant de se penser sous le masque qu'on lui impose. Le journal même de ses faiblesses constituera sa défense, par l'aveu, et la reconnaissance de ses fautes. Mais comme la révélation n'a de sens que par la vie qui l'accomplit, la dernière partie du livre débouche naturellement sur l'établissement d'une règle de vie chrétienne. Dans son Art poétique, Max Jacob écrit de son œuvre : "J'ai voulu recréer la vie de la Terre dans l'atmosphère du Ciel", et telle est la structure de son œuvre, replacer les gestes, et les comportements dans l'univers spirituel. L'apparition a révélé à Max Jacob qu'il est un lieu de conflit entre la dispersion et la foi, la bassesse et la grandeur, et fait de lui un témoin, un narrateur...

"Le Laboratoire central" (1921)
Recueil qui introduit le lecteur dans le laboratoire poétique de Max Jacob et trace de lui un portrait de pécheur et de repentant : l'image du Christ qui a présidé à sa conversion lui a montré qu'il n'y a nulle séparation entre le sacré et le profane, , que tout élément quotidien est indice spirituel. Une première partie nous entraîne dans les différents genres littéraires, une seconde est variation sur de grands thèmes, la troisième joue de la métamorphose tandis que la quatrième se déploie religieusement...
MILLE REGRETS
J'AI retrouvé Quimper où sont nés mes quinze premiers ans
Et je n'ai pas retrouvé mes larmes.
Jadis quand j'approchais les pauvres faubourgs blancs
Je pleurais jusqu'à me voiler les arbres.
Cette fois tout est laid, l'arbre est maigre et nain vert
Je viens en étranger parmi des pierres
Mes amis de Paris que j'aime, à qui je dois
D'avoir su faire des livres gâtent les bois
En entraînant ailleurs loin des pins maigres ma pensée
Heureuse et triste aussi d'être entraînée
Plutôt je suis de marbre et rien ne rentre. C'est l'amour
De l'art qui m'a fait moi-même si lourd
Que je ne pleure plus quand je traverse mon pays
Je suis un inconnu : j'ai peur d'être haï
Ces gens nouveaux qui m'ignorent, je crois qu'ils me haïssent
Et je n'ai plus d'amour pour eux : c'est un supplice.

Jean Cocteau par lui-même, si proche des surréalistes mais tant fidèle à la tradition classique, rupture avec l'humanité ordinaire, incertitude tant de l'itinéraire que du but, irruption du mystère, communication magique avec la mort, risques et chances de la découverte de l'invisible, confrontation des images mêlant sources et traditions, ...
"Accidents du mystère et fautes de calculs
Célestes, j'ai profité d'eux, je l'avoue.
Toute ma poésie est là: Je décalque
L'invisible (invisible à vous).
J'ai dit: "Inutile de crier, haut les mains!"
Au crime déguisé en costume inhumain;
J'ai donné le contour à des charmes informes;
Des ruses de la mort la trahison m'informe ;
J'ai fait voir en versant mon encre bleue en eux,
Des fantômes soudain devenus arbres bleus.
Dire que l'entreprise est simple ou sans danger
Serait fou. Déranger les anges !
Découvrir le hasard apprenant à tricher
Et des statues en train d'essayer de marcher.
Sur le belvédère des villes que l'on voit
Vides, et d'où l'on ne distingue plus que les voix
Des coqs, les écoles, les trompes d'automobíle,
(Ces bruits étant les seuls qui montent d'une ville)
J'ai entendu descendre des faubourgs du ciel,
Étonnantes rumeurs, cris d'une autre Marseille."
(Opéra, 1925-1927).

Jean Cocteau (1889-1963)
Acteur de tous les avant-gardes artistiques, on a reproché à Cocteau sa facilité. Derrière l’univers féerique, ses personnages sont en quête d’eux-mêmes...
Né à Maison-Laffitte, Jean Cocteau prit place dans une famille bourgeoise, entouré de son père, rentier, de sa mère et de leur deux autres enfants. Il passa son enfance au grès des réceptions musicales que donna son grand-père. Ce dernier, d'une grande culture artistique, n'avait de cesse d'initier le petit cancre de la famille à la musique. Cette période probatoire influencera considérablement sa perception créatrice tout au long de sa vie. Elle s'affirmera notamment dans la formation, par Cocteau lui-même, du Groupe des Six (Arthur Honegger, Germaine Tailleferre, Georges Auric, Louis Durey, Darius Milhaud et Francis Poulenc). Mais son père Georges Cocteau se suicide dans son lit . Jean n'a alors que 9 ans, la mort, le suicide et le sang vont à tout jamais préfigurer ses oeuvres (''Le Sang d'un Poète'', ''L'Aigle à Deux Têtes'', ''Le Testament d'Orphée''...). Le tragique restera l'une des préoccupations majeures du poète, une exorcisation jamais comblée. Sa mère élèvera donc seule cet être difficile qui refuse de grandir, trouvant dans les états pathologique un moyen de se faire choyer. Aidée par une gouvernante allemande, Cocteau découvrit, très tôt, le monde du spectacle et de l'illusion. En 1908, Cocteau, alors âgé de 19 ans, fera la connaissance du tragédien Edouard de Max. Ce dernier, fasciné par l'écriture de Jean, décida d'organiser une lecture de ses poèmes au Théâtre Fémina, sur les Champs-Elysées. Dorénavant Jean Cocteau ne voudra fréquenter que les grands : Catulle Mendès, Marcel Proust, la Comtesse de Noailles, les Rostand... Il se promènera dans les rues de Paris, affichant un style très provoquant. Cocteau est devenu un dandy...

Cocteau se tourne vers les dadaïstes, avec lesquels il organise des spectacles de choc (Parade, 1917 ; le Bœuf sur le toit, 1920 ; les Mariés de la tour Eiffel, 1924). Mais il devient suspect pour être de toutes les avant-gardes, l'instabilité le brûle. Du feu d'artifice de la prime jeunesse (Plain-Chant, 1923) aux interrogations de la maturité (Allégorie, 1941 ; la Crucifixion, 1946 ; Clair-Obscur, 1955 ; Requiem, 1962), c'est une même «difficulté d'être». Comme il le dit, s'il saute sans cesse d'une branche à l'autre, c'est toujours dans le même arbre. Il publie des romans (le Potomak, 1919), dont la poésie n'est jamais exclue. Le Grand Écart (1923), Thomas l'Imposteur (1923) et les Enfants terribles (1929) lui assurent la notoriété. Le théâtre (la Machine infernale, 1932 ; les Parents terribles, 1938 ; la Machine à écrire, 1941 ; l'Aigle à deux têtes, 1946) et le cinéma (le Sang d'un poète, 1930 ; l'Éternel Retour, 1944 ; la Belle et la Bête, 1946 ; Orphée, 1949 ; le Testament d'Orphée, 1959) lui vaudront la gloire.

"Plain-Chant" (1923)
Poème en trois parties, Radiguet venait alors d'enseigner à Cocteau la nécessité de refuser la mode et l'avant-garde. Cocteau explique qu'il chante de vingt façons pour éviter de l'habitude "l'éloge et les nobles glaçons", puis abandonne l`essentiel de Ia première partie de son poème à l'ange en "armure de neige" qui I'habite et l'utilise comme instrument. La deuxième partie chante l'amour, la mort et le sommeil ("Rien ne m`effraye plus que la fausse accalmie D'un visage qui dort..."), la troisième dit la volonté cruelle des muses qui plient le poète à leurs ordres et le vident de sa vie sans lui laisser autre chose que cette page écrite...
J'ai, pour tromper du temps la mal-sonnante horloge,
Chanté de vingt façons.
Ainsi de l'habitude évitai-je l'éloge,
Et les nobles glaçons.
C'est peu que l'habitude une gloire couronne
Lorsqu'elle a vieux le chef;
Il faut qu'un long amour souvent le cœur étonne
A force d'être bref.
Alors, jeune toujours, libre de récompenses,
Et son livre à la main,
On devine les jeux, les manœuvres, les danses,
Qui formeront demain.
Voilà pourquoi la mort également m'effraye,
Et me fait les yeux doux ;
C'est qu'une grande voix murmure à mon oreille :
Pense à mon rendez-vous;
Laisse partir ces gens, laisse fermer la porte,
Laisse perdre le vin,
Laisse mettre au sépulcre une dépouille morte;
Je suis ton nom divin.
Je veux tout oublier, et cet ange cornu
Comme le vieux Moïse,
Qui de moi se sachant le visage inconnu
A coups de front me brise.
Mêlons dans notre lit nos jambes et nos bras,
D'un si tendre mélange,
Que ne puisse, voulant m'arracher de mes draps,,
S'y reconnaître l'ange.
Formons étroitement, en haut de ce tortil,
D'un baiser, une rose;
Et l'ange, à ce baiser parfumé, puisse-t-il,
Avoir l'âme déclose.
Le cœur indifférent à ce que je serai,
Aux gloires du poème,
Je vivrai, libre enfin, par toi seule serré,
Et te serrant de même,
Alors profondément devenus à nous deux
Une seule machine
A maints têtes et bras, ainsi que sont les dieux
Dans les temples de Chine.
Je n'aime pas dormir quand ta figure habite,
La nuit, contre mon cou ;
Car je pense à la mort laquelle vient si vite
Nous endormir beaucoup.
Je mourrai, tu vivras et c'est ce qui m'éveille !
Est-il une autre peur ?
Un jour ne plus entendre auprès de mon oreille
Ton haleine et ton cœur.
Quoi, ce timide oiseau, replié par le songe
Déserterait son nid,
Son nid d'où notre corps à deux têtes s'allonge
Par quatre pieds fini.
Puisse durer toujours une si grande joie
Qui cesse le matin,
Et dont l'ange chargé de construire ma voie
Allège mon destin.
Léger, je suis léger sous cette tête lourde
Qui semble de mon bloc,
Et reste en mon abri, muette, aveugle, sourde,
Malgré le chant du coq.
Cette tête coupée, allée en d'autres mondes,
Où règne une autre loi,
Plongeant dans le sommeil des racines profondes
Loin de moi, près de moi.
Ah I je voudrais, gardant ton profil sur ma gorge,
Par ta bouche qui dort
Entendre de tes seins la délicate forge.
Souffler jusqu'à ma mort.
Mauvaise compagne, espèce de morte,
De quels corridors,
De quels corridors pousses-tu la porte,
Dès que tu t'endors ?
Je te vois quitter ta figure close,
Bien fermée à clé,
Ne laissant ici plus la moindre chose,
Que ton chef bouclé.
Je baise ta joue et serre tes membres,
Mais tu sors de toi,
Sans faire de bruit, comme d'une chambre,
On sort par le toit.
Lit d'amour, faites halte. Et, sous cette ombre haute,
Reposons-nous : parlons; laissons là-bas au bout,
Nos pieds sages, chevaux endormis côte à côte,
Et quelquefois mettant l'un sur l'autre le cou.
Rien ne m'effraye plus que la fausse accalmie
D'un visage qui dort ;
Ton rêve est une Egypte et toi c'est la momie
Avec son masque d'or.
Où ton regard va-t-il sous cette riche empreinte
D'une reine qui meurt, _
Lorsque la nuit d'amour t'a défaite et repeinte
Comme un noir embaumeur ?
Abandonne, ô ma reine, ô mon canard sauvage,
Les siècles et les mers ;
Reviens flotter dessus, regagne ton visage
Qui s'enfonce à l'envers.
Notre entrelacs d'amour à des lettres ressemble,
Sur un arbre se mélangeant ;
Et, sur ce lit, nos corps s'entortillent ensemble,
Comme à ton nom le nom de Jean.
Croiriez-vous point, ô mer, reconnaître votre œuvre
Et les monstres de vos haras,
Si vous sentiez bouger cette amoureuse pieuvre
Faite de jambes et de bras.
Mais le nœud dénoué ne laisse que du vide ;
Et tu prends le cheval aux crins,
Le cheval du sommeil, qui. d'un sabot rapide,
Te dépose aux bords que je crains.
Je ne veux plus souffrir du songe qui me trouble,
Et vaincrai mon souci,
Car aimes-tu quelqu'un en existence double,
Tu le trompes ici.
Trompons ce bienheureux pour qui tu te contractes
Dans ton sommeil profond;
Au contraire, il m'est doux de me livrer aux actes
Que tes chimères font.
L'autre te croit à lui. Mon baiser te réveille.
Et il te cherche en vain,
En ces lieux, où par quelque infernale merveille,
Ta présence lui vint.
Il nous faut dépêcher, ne perdons pas de temps,
Ne nous imposons point de repos ni de jeûne.
Dans quelques jours d'ici tu seras encore jeune.
Je ne le serai plus. Je viens d'avoir trente ans.
Je peinais, je hissais et j'oubliais la pente.
Il faut me retenir au lieu de me pousser ;
Le cœur déroule vite un ruban de passé,
Toi de chiffre dix-neuf, et moi de chiffre trente.
Que ce maudit ruban peut me faire du mal !
Qu'il attende qu'autant le tien de ton cœur sorte
Et côte à côte alors, sentirions de la sorte,
Diminuer moins fort le peloton fatal.
Hélas ! vais-je à présent me plaindre dans ces stances,
Et voir, près de Charon,
La mort, indifférente à telles circonstances,
Qui la décideront.
Elle vit. Elle attend. Ce n'est pas dans son rôle,
De choisir notre port.
Ce détail est pour elle un simple coup d'épaule
Que lui donne le sort.
Bien ne sert de prier cette vieille statue,
De savoir ses desseins `;
Car ce n'est pas la mort elle-même qui tue.
Elle a ses assassins.
(...)
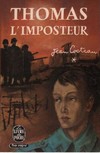
"Thomas l'Imposteur" (1923)
Dans ce roman, Jean Cocteau avait pour objet de peindre tant l`intraitable exigence de la jeunesse que le porte-à-faux auquel est condamné le poète vis-à-vis du monde réel. La limpidité de son style fera merveille dans cette fable où le mensonge n`est que l'un des avatars de la transparence, celle du rêve et de la poésie, que le monde brise mais qui l`éclairent. Alors que Paris en guerre se vide de ses habitants, Mme de Bormes se félicite de pouvoir demeurer dans la capitale menacée par l'Occupation. Elle doit veiller sur sa fille Henriette qui y est hospitalisée. Cette femme, pour qui la guerre est un vaste théâtre, ne peut se résoudre "à vivre en marge de ce qui a lieu" et va s'employer à soigner les blessés. Mais personne ne prendra son entreprise au sérieux jusqu'à l`arrivée, dans son hôpital civil, d`un jeune sous-officier, qui se prétend le neveu du général Fontenoy. En réalité, Guillaume Thomas est un imposteur. ll est simplement né à Fontenoy. Orphelin, vivant à Paris auprès d`une tante dévote, c`est par réaction qu`il a très tôt appris à connaître les délices du mensonge. Dans cette époque bouleversée, ce jeune homme de seize ans, qui dit en avoir dix-neuf, endosse l`uniforme d'un de ses camarades pour jouer au soldat. Prenant son rôle au sérieux, le héros va compléter ses accessoires de jeu par un galon et une ascendance illustre. Guillaume dupe sans malice ; la peau dans laquelle il vit le surclasse en lui donnant l`occasion de servir les plans désintéressés de Mme de Bormes. Le nom de Fontenoy ouvre toutes les portes, y compris celles du drame. N'ayant jamais à observer la prudence qui perd les coquins, il roule sans risque aucun civils et militaires. Henriette, rétablie, ne le laisse pas indifférent, mais l`aimer l'obligerait à redevenir lui-même. Il réussit à aller servir dans les tranchées, mais des lors que le jeu rencontre la réalité, Thomas est obligé d'aller jusqu`au bout du jeu, inexorablement. Volontaire pour reconnaître les lignes ennemies, Thomas vit la dernière phase de son aventure, celle où le jeu se transforme en drame. Atteint mortellement à la poitrine, il s`écroule, "Je suis perdu si je ne fais pas semblant d`être mort." Et l`auteur de conclure : "Mais en lui, la fiction et la réalité ne formaient qu`un. Guillaume Thomas était mort."

1929 – "Les Enfants terribles"
Les Enfants terribles inspirés certainement par les souvenirs de son adolescence à Maisons-Laffitte où Cocteau est né, montrent comment s’entrecroisent les thèmes favoris du poète romancier, toujours partagé entre la provocation des situations, la tension paroxystique du drame psychologique et un formalisme classique. Roman de l’adolescence, plus précisément de l’âge ingrat, Les Enfants terribles mettent en scène trois personnages de garçons, Gérard, Paul et Dargelos, figure de chef de bande, liés les uns aux autres, comme dans l’Andromaque de Racine, par un amour circulaire (Gérard aime Paul qui aime Dargelos), et deux figures de « filles » : Élizabeth, la sœur de Paul, et Agathe, une amie d’Élisabeth. Le récit s’ouvre sur la scène, célèbre par sa violente charge poétique, qui, dans la cour du collège, voit Paul recevoir en plein cœur une boule de neige lancée par Dargelos : « Un coup le frappe en pleine poitrine. Un coup sombre. Un coup de poing de marbre. Un coup de poing de statue. Sa tête se vide. Il devine Dargelos sur une espèce d’estrade, le bras retombé, stupide, dans un éclairage surnaturel. »
On retrouve dans Les Enfants terribles les thèmes de prédilection de Cocteau : homosexualité, mensonge, drogue, inceste, qui servent à créer un univers interdit aux adultes, marqué par la transgression et la révolte, porté par une exigence d’absolu et de pureté empruntée aux grands mythes de la tragédie grecque.
Jean Cocteau, homme de tous les genres et de tous les arts, nous enseigne que la poésie ne doit rien ignorer de ce qui nous entoure, de ce qui nous concerne, de ce qui nous angoisse ou nous submerge...
Plain-Chant, Je n'aime pas dormir..
Je n'aime pas dormir quand ta figure habite
La nuit, contre mon cou;
Car je pense à la mort, laquelle vient si vite
Nous endormir beaucoup.
Je mourrai, tu vivras et c'est ce qui m'éveille!
Est-il une autre peur?
Un jour, ne plus entendre auprès de mon oreille
Ton haleine et ton coeur.
Quoi, ce timide oiseau, replié par le songe
Déserterait son nid,
Son nid d'où notre corps à deux têtes s'allonge
Par quatre pieds fini.
Puisse durer toujours une si grande joie
Qui cesse le matin,
Et dont l'ange chargé de construire ma voie,
Allège mon destin.
Léger, je suis léger sous cette tête lourde
Qui semble de mon bloc,
Et reste en mon abri, muette, aveugle, sourde,
Malgré le chant du coq.
Cette tête coupée, allée en d'autres mondes,
Où règne une autre loi,
Plongeant dans le sommeil des racines profondes
Loin de moi, près de toi.

"Les Mariés de la Tour Eiffel" (1923)
Pièce de Jean Cocteau représentée pour la première fois par la Compagnie des ballets suédois de Rolf de Mare, le 18 juin l921, au théâtre des Champs-Elysées, et publiée en 1923., avec des musiques de scène de Georges Auric, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre, Arthur Honegger. Le Groupe des Six se trouvait donc collaborer à ce spectacle. La scène est située au premier étage de la tour Eiffel. Deux acteurs, déguisés en phonographes, commentent la pièce et récitent les rôles de tous les personnages. ll n`y a pas d`action mais une succession de courtes scènes bouffonnes. Un coup de fusil. une dépêche qui tombe, morte, l'apparition de la Noce, une noce bourgeoise, avec tous ses clichés, discours du général, passage d`un cycliste-mirage, d`un chasseur poursuivant une autruche. Un immense appareil de photo sert de porte d`entrée et de sortie, cependant que le photographe tire des tableaux de la Noce. Un enfant jaillit de l'appareil, massacre la Noce, qui se relève puis fuit devant un lion, lequel va déglutir le général sous une table. Paraît un marchand qui vend la Noce a un collectionneur, etc., jusqu`au cri final du directeur de la tour Eiffel, "On ferme! On ferme !". Ici, écrira Cocteau, j'ai renoncé "au système. J`allume tout, je souligne tout. Vide du dimanche, bétail humain, expressions toutes faites, dissociations d'idées en chair et en os, férocité de l`enfance, poésie et miracle de la vie quotidienne".
On cite toujours la même phrase, annonçant "Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l`organisateur". Une pièce dans la veine surréaliste ouverte au théâtre par "Les Mamelles de Tirésias" d`Apollinaire (1917) et le théâtre dada, aimable bouffonnerie, loin des chefs d'oeuvre du grand dramaturge surréaliste qu'est Roger Vitrac (1899-1952), avec "Victor, ou les Enfants au pouvoir" (1928), le "Coup de Trafalgar" (1930) ou le "Sabre de mon père" (1950)..

Jean Cocteau écrit en 1916-1918 (publiés en 1924), la substance de ses poèmes "Discours du grand sommeil", simple, directe, "Je n'entre pas en toi /Je ne sors pas de toi. / Je somnole intérieur", il y parle de la guerre, de son horreur froide...
"J’ai une grande nouvelle triste à t’annoncer : je suis mort. Je peux te parler ce matin, parce que tu somnoles, que tu es malade, que tu as la fièvre. Chez nous, la vitesse est beaucoup plus importante que chez vous. Je ne parle pas de la vitesse qui se déplace d’un point à un autre, mais de la vitesse qui ne bouge pas, de la vitesse elle-même. Une hélice est encore visible, elle miroite ; si on y met la main, elle coupe. Nous, on ne nous voit pas, on ne nous entend pas on peut nous traverser sans se faire mal. Notre vitesse est si forte qu’elle nous situe à un point de silence et de monotonie. Je te rencontre parce que je n’ai pas toute ma vitesse et que la fièvre te donne une vitesse immobile rare chez les vivants. Je te parle, je te touche. C’est bon, le relief ! Je garde encore un souvenir de mon relief. J’étais une eau qui avait la forme d’une bouteille et qui jugeait tout d’après cette forme. Chacun de nous est une bouteille qui imprime une forme différente à la même eau. Maintenant, retourné au lac, je collabore à sa transparence. Je suis Nous. Vous êtes Je.
Les vivants et les morts sont près et loin les uns des autres comme le côté pile et le côté face d’un sou, les quatre images d’un jeu de cubes. Un même ruban de clichés déroule nos actes. Mais vous, un mur coupe le rayon et vous délivre. On vous voit bouger dans vos paysages. Notre rayon à nous traverse les murs. Rien ne l’arrête. Nous vivons épanouis dans le vide.
Je me promenais dans les lignes. C’était le petit jour. Ils ont dû m’apercevoir par une malchance, un intervalle, une mauvaise plantation du décor. J’ai dû me trouver à découvert stupide comme le rouge-gorge qui continue à faire sa toilette sur une branche pendant qu’un gamin épaule sa carabine. J’arrangeais ma cravate, je me disais qu’il allait falloir répondre à des lettres. Tout à coup, je me suis senti seul au monde, avec une nausée que j’avais déjà eue dans un manège de la foire du Trône. L’axe des courbes vous y décapite, vous laisse le corps sans âme, la tête à l’envers et loin, loin un petit groupe resté sur la terre au fond d’atroces miroirs déformants.
Je n’étais ni debout, ni couché, ni assis, plutôt répandu, mais capable de distinguer, ailleurs, contre les sacs, mon corps comme un costume ôté la veille. Surtout que j’avais souvent remarqué à Paris, dans ma chambre, au petit jour, cet air fusillé d’une chemise.
J’avais cet air- là de vieux costume, de chemise par terre , de lapin mort, sans l’avoir, puisque ce n’était pas moi, comme la chambre à laquelle on pense et la même chambre dans laquelle on se trouve. .Alors, j’eus conscience d’être la fausse chambre et d’avoir franchi par mégarde une limite autour de laquelle les vivants, sans lâcher prise, arrangent leurs jeux dangereux.
Avais-je lâché prise ? Je me sentais sorti de la ronde, débarqué en somme, et seul survivant du naufrage. Où étaient les autres ? Je te parle de tout ça, mais sur le moment, je ne pouvais les situer, ni toi, ni moi, ni personne.
Une des premières surprises de l’aventure consiste à se sentir déplié. La vie ne vous montre qu’une petite surface d’une feuille pliée un grand nombre de fois sur elle- même. Les actes les plus factices, les plus capricieux, les plus fous des vivants s’inscrivent sur cette surface infime. Intérieurement, mathématiquement, la symétrie s’organise. La mort seule déplie la feuille et son décor nous procure une beauté, un ennui mortels
Constater cela me suppose sorti du système. Il est donc anormal que je constate. Je ne constaterai plus dans quelques temps Ce temps représentera-t-il chez vous une seconde ou plusieurs siècles ? Bientôt, je ne comprendrai plus ce que je suis, je ne me souviendrai plus de ce que j’étais, je ne viendrai plus parmi vous. Ah, solitude ! Nageur noyé, déjà je fonds ! Déjà, je suis écume ! Tu sais, j’ai peine à trouver des mots qui répondent aux choses que j ‘éprouve. Aucune puissance ne m’a défendu cet essai d’éclaircir les mystères, mais je me sens déjà un drôle de coupable car je suis déjà l’organisation que je dénonce. Et je ris moi-même, comme les affiliés se voyant trahis par un novice mal au courant de leurs secrets tellement j’ai de peine à expliquer ma pénombre.
Mais, du reste, ce que je te raconte n’est-il pas un simple reflet de ce que tu penses ? Je ne dis pas cela pour construire autour de toi un piège en glaces. Je m’exprime encore trop humainement pour ne pas me méfier de moi.
Ce qui m’étonne, c’est que je parle comme tes livres, que je sache si bien ce qu’ils contiennent. J’étais de ceux qui doutent. Tu ne me grondais pas. Tu ne m’expliquais pas. Tu me traitais comme un enfant, comme une femme. J’étais naïvement ton ennemi. Je te demande pardon. C’est pour te demander pardon que j’ai fait l’étrange effort d’apparaître. La poésie ressemble à la mort. Je connais son oeil bleu. Il donne la nausée. Cette nausée d’architecte toujours taquinant le vide, voilà le propre du poète. Le vrai poète est comme nous, invisible aux vivants. Seul ce privilège le distingue des autres. Il ne rêvasse , à nous pas ; il compte. Mais il avance sur un sable mouvant et, quelquefois, sa jambe enfonce jusqu’à nous.
Maintenant, je dénombre tes mécanismes. Je comprends ta pudeur que je confondais avec ma nuit.
Avec le public, j’ai souvent pris pour des ébauches tes pages discrètes comme les blocs de quartz où l’eau solide pense une forme dont un angle seul apparaît.
Et tes givres, tes décalcomanies, ce mot de l’énigme écrit à l’encre sur une feuille pliée vite en deux que tu ouvres ne contenant plus qu’un catafalque. Et, dis-moi, lorsque les naufragés du Ville de St Nazaire racontent qu’ils virent tous, la nuit en pleine mer, un Casino avec des marches, des lampions, des massifs de lauriers roses ; la mer, la brume et la faim, ne firent-ils pas oeuvre de poète ? Voilà qui ne relève pas de cette hallucination individuelle que te reprochent tant les aveugles. Mais ces gens de la felouque étaient accordés par la souffrance Je ne souffrais pas avant de mourir. Maintenant, ma souffrance est celle d’un homme qui rêve qu’il souffre. Ce rêve est généralement provoqué par quelque douleur.
Tout cela s’apparente au tour dont je viens d’être victime .On dirait que c’est un vieux mort qui te parle. Il est si tôt que la relève ne m’a même pas encore trouvé. Je suis aussi auprès de ma mère. Je te vois dans ton lit et je me vois dans la pause d’un homme myope qui cherche son lorgnon sous un meuble. Je commence à me dissoudre. Pour que tu comprennes, il faudrait multiplier à l’infini le mensonge que fait une boulette qu’on roule avec le bout de ses doigts croisés l’un sur l’autre.
Je voudrais qu’on me dise depuis combien de temps je suis mort."
(Extrait du "Discours du Grand Sommeil ", Oeuvres complètes de Jean Cocteau aux éditions Marguerat)
"Opéra" (1927)
Recueil de poèmes à l'automatisme contrôlé, y figure celui de "L'Ange Heurtebise" aux quinze strophes énigmatiques. Cocteau expliquera dans son "Journal d'un inconnu" que ce poème est le dénouement d'une crise intérieure sans images et sans émotions représentatives, comme un peintre abstrait du langage ...
I
L'ANGE HEURTEBISE, sur les gradins
En moire de son aile,
Me bat, me rafraîchit la mémoire,
Le gredin, seul, immobile
Avec moi dans l'agate,
Que brise, âne, ton bât
Surnaturel.
II
L'ange Heurtebise, d'une brutalité
Incroyable, saute sur moi. De gràce
Ne saute pas si fort,
Garçon bestial, fleur de haute
Stature.
Je m'en suis alité. En voilà
Des façons. J'ai l'as : constate.
L`as-tu ?
III
L'ange Heurtebise me pousse ;
Et vous roi Jésus, miséricorde,
Me hissez, m'attirez jusqu'à l'angle
De vos genoux pointus ;
Plaisirs sans mélange. Pouce ! dénoue
La corde, je meurs.
IV
L'ange Heurtebise et l'ange
Cégeste tué à la guerre - quel nom
Inouï - jouent
Le rôle des épouvantails
Dont le geste non effraye
Les cerises du cerisier céleste,
Sous le vantail de l'église
Habitué au geste oui.
(...)

"La Machine infernale" (1934)
Pièce en quatre actes représentée pour la première fois le 10 avril 1934 au théâtre Louis-Jouvet (Comédie des Champs-Elysées) et publiée en 1934, un condensé de Sophocle qui réunit les grandes figures grecques (Œdipe, Jocaste, Antigone, Créon) et des thèmes connus d'avance, qui laisse dérouler envolées verbales et philosophiques entremêlées d'ironie et de surréalisme tant la variété du style est particulièrement disparate, l'anachronisme systématique. Quant aux dieux, ils sont représentés comme des machines infernales dont l'unique but est d`apporter le malheur aux hommes. Et sur le thème du destin, inexorablement chacun des héros n'a d'autre choix que de se mouler dans sa propre légende...
Près des remparts de Thèbes, devant les boîtes de nuit bruyantes, le roi Laïus vient d`être tué. Son fantôme essaie de prévenir la reine Jocaste du danger qui la menace. Malgré les efforts du spectre, le rendez-vous avec sa veuve ne peut se réaliser. Celle-ci rencontre un soldat qui a les traits de son fils Œdipe. En même temps, Œdipe, fuyant son pays natal pour empêcher l`oracle de s`accomplir, rencontre le Sphinx sous la forme d`une jeune fille; celle-ci, lasse de tuer, tombe amoureuse d`Œdipe. Pour sauver le héros, elle lui donne par avance la réponse à l'énigme, permettant à celui-ci de triompher de l`épreuve. Mais ce faisant, et sans le savoir, il noue son destin à celui de sa mère. Guidé par les dieux, Œdipe épouse Jocaste. De leur union naîtront deux garçons, Etéocle et Polynice, et deux filles, lsmène et Antigone. C'est alors que la peste décime Thèbes et que l`irréparable s'accompli en détruisant la machine infernale. Jocaste et Œdipe comprennent : elle se pend, il s`aveugle. Jocaste morte, réapparaît son fantôme qui est celui de la mère d`Œdipe et qui conduit son fils vers la gloire en s`incarnant dans Antigone...
Jean Cocteau dans son atelier : touche-à-tout du monde parisien d'avant-guerre, il travaille dans les années vingt à des ballets, dont celui d'Antigone (1922) pour lequel il collabora avec Picasso et Coco Chanel. Dix ans plus tard, il se tourne vers le cinéma avec des réalisations telles que "Le Sang d'un poète" (1930) et "La Belle et la Bête" (1946), considérée comme son chef d'oeuvre.....


"La Difficulté d'être" (1947)
"Je sens une difficulté d'être", c'est ce que répond Fontenelle, centenaire, lorsqu'il va mourir, et que son médecin lui demande : "Monsieur Fontenelle, que sentez-vous ?", mais Cocteau d'ajouter, "seulement la sienne est de la dernière heure, la mienne date de toujours". Cette difficulté, Cocteau n'en recherche pas le pourquoi. Alors retiré dans un hôtel à Morzine, malade - "la douleur me harcèle et je dois penser pour m'en distraire" -, il lance son esprit à la recherche de tout ce qui, passé ou présent, témoigne en lui de cette nécessité de toujours qui fut d'accepter l'inextricable et de "s'y soumettre au point qu'il s`en dégage un charme et que la brousse rejoigne par son innocence sauvage les attraits de la virginité." Ayant pris conscience de son âge et accepté de ne plus être jeune, le voici prospectant avec sérénité chaque souvenir qui lui impose un aveu de partage, de fidélité à une rencontre, que ce soit celle de Proust, de Gide, Radiguet, Satie, Diaghilev, Nijinski, Apollinaire, ou Picasso, Bérard, Genet, Colette. Ceci nous vaut des pages brillantes sur l'amitié, la lecture, la mort, les mots, la jeunesse, les mœurs, la responsabilité. Et à une jeunesse qui le prend pour exemple et l'oblige à marcher droit ("l'enfance sait ce qu'elle veut, elle veut sortir de l'enfance, le malaise débute lorsqu'elle en sort), Cocteau s`adresse sans ménagements pour lui déclarer qu'elle manque à son devoir, lequel est "d'être l'armée des grands aventures de l'esprit" et non de siffler l'audace ou de vivre dans une anarchie farceuse et de surface ...
De la ligne - "... Qu'on n'aille pas imaginer que la préoccupation qui me dirige soit d'ordre esthétique. Elle ne relève que de la ligne. Qu'est-ce que la ligne? C'est la vie. Une ligne doit vivre sur chaque point de son parcours de telle sorte que la présence de l'artiste s'impose
davantage que celle du modèle. La foule juge d'après la ligne du modèle sans comprendre qu'elle peut disparaître au bénéfice de celle du peintre, pourvu que sa ligne vive d'une vie propre. Par ligne j'entends la permanence de la personnalité.
Car la ligne existe au même titre chez Renoir, chez Seurat, chez Bonnard, chez ceux où elle semble se dissoudre dans la touche et la tâche, que chez Matisse ou que chez Picasso. Chez l'écrivain, la ligne prime le fond et la forme. Elle traverse les mots qu'il assemble. Elle fait une note continue que ne perçoivent ni l'oreille ni l'oeil. Elle est le style de l'âme, en quelque sorte, et si cette ligne cesse de vivre en soi, si elle ne dessine qu'une arabesque, l'âme est absente et l'écrit mort. C'est pourquoi je répète incessamment que le progrès moral d'un
artiste est le seul qui vaille - puisque cette ligne se débande dès que l'âme baisse son feu. Ne confondez pas progrès moral et morale. Le progrès moral ne consistant qu'à se roidir.
Protéger la ligne devient notre thérapeutique aussitôt que nous la sentons faible ou lorsqu'elle fourche comme un cheveu malade. On la reconnaît - sans même qu'elle signifie. Et si nos peintres dessinaient une croix sur une feuille, je saurais bien vous dire qui l'a faite. Et si j'entrouvre un livre, je la distingue avant de l'avoir ouvert.
De cette ligne révélatrice, les gens regardent ce qui la vêt. Plus elle est visible, moins ils la voient, habitués qu'ils sont à n'admirer que ce qui l'orne. Ils en arrivent à préférer Ronsard à Villon, Schumann à Schubert, Monet à Cézanne. Que peuvent-ils apprendre d'Erik Satie, chez lequel cette ligne adorable va nue? De Stravinsky dont l'unique recherche est de l'écorcher vive? Les draperies de Beethoven et de Wagner les enthousiasment. Ils n'en sont pas moins incapables de voir la ligne, pourtant fort grosse, autour de laquelle ces draperies s'enroulent.
Vous me direz qu'un homme n'exhibe pas son squelette, que ce serait le pire attentat contre la pudeur. Mais cette ligne n'est pas un squelette. Elle relève du regard, du timbre de voix, du geste, de la démarche, d'un ensemble qui compose la personnalité physique. Elle témoigne d'une force motrice sur la nature et sur le siège de laquelle les philosophes ne peuvent se mettre d'accord. .
Nous l'avons déjà devinée avant qu'une musique, une peinture, une statue, un poème, nous parlent. C'est elle qui nous émeut lorsqu'un artiste décide de rompre avec le monde visible et qu'il oblige ses formes à lui obéir. Car la musique, bien qu'elle paraisse ne pas être contrainte à la représentation, l'est dans la mesure où elle ressemble à ce que le compositeur se propose de dire. Nul art ne peut dire autant de sottises ni de platitudes. Et si le compositeur s'écarte des coutumes de l'oreille, il fâche le public à mêmes enseignes que le peintre ou que l'écrivain.
Chez le compositeur, un phénomène assez rare permet de voir la ligne fantôme autrement que par un sens supplémentaire. C'est lorsqu'elle s'incarne en une mélodie. Lorsqu'une mélodie en épouse le parcours au point de s'intégrer à elle.
Quand je composais Oedipus Rex avec Stravinsky, nous parcourûmes les Alpes-Maritimes. C'était en mars. Les amandiers fleurissaient sur les montagnes. Un soir que nous faisions halte dans une guinguette, nous comptâmes les quelques mélodies de Faust où Gounod se surclasse. Elles évoquent l'allure du rêve. Notre voisin de table se leva, se présenta. C'était le petit-fils du compositeur. Il nous raconta que Gounod rêvait ces mélodies de Faust et qu'il les notait au réveil. Ne dirait-on pas le prolongement des facultés qui nous permettent de voler en songe? C'est à cause d'elles que Mme J-M. Sert (dont il faudrait citer presque toutes les paroles) disait que dans Faust on est amoureux et que dans Tristan on fait l'amour.
Cette ligne idéale nous retrace la 'vie des chefs illustres. Elle accompagne leurs actes et les coud. Elle est, sans doute, la seule précision qui résiste aux fausses perspectives de l'Histoire. Elle saute aux yeux de l'âme avant que la mémoire s'en mêle.
Sans parler de Shakespeare, un Alexandre Dumas l'exploite toujours. Il l'entortille de sa fable et nous frappe d'une vérité plus roide que celle d'un bâton brisé dans l'eau du temps.
C'est aussi cette ligne que le graphologue sait extraire d'une écriture, quels quel soient les artifices qui la masquent. Plus elle se masque, plus elle se livre. Car les causes de l'artifice grossissent les pièces du procès.
Quoi qu'en pense une aimable marchande de livres qui m'accuse de laisser les autres prendre les risques et de planter le drapeau, ma ligne est de chocs et de risques. La dame verrait, à l'étude, que sa métaphore militaire est pour le moins suspecte. Si l'on ne monte à l'attaque, comment planter le drapeau? C'est justement la crainte de devenir moins apte à cette charge qui me conseillerait de fermer boutique. Encore me serait-il impossible, tant que j'aurai de bonnes jambes, de ne pas courir aux avant-postes, badauder sur ce qui s'y fait. Dans l'ensemble, une ligne de combat traverse mes ouvrages. S'il m'arrive de m'approprier les armes de l'adversaire, je les ai faites miennes dans la bataille. C'est au résultat qu'on les juge. Il n'avait qu'â mieux s'en servir.
De la marelle à l'affiche, je reconnais presque tous les motifs que Picasso adopte dans les différents quartiers qu'il habite. Ils jouent pour lui le rôle du motif des paysagistes, mais il les amalgame à domicile et les hausse à la dignité de servir.
Pendant la grande époque du cubisme, les peintres de Montparnasse se barricadaient par peur que Picasso ne leur emportât quelque graine et ne la fît s'épanouir dans son sol. J'ai assisté en 1916 à des conciliabules interminables devant une porte entrouverte, lorsqu'il me conduisait chez eux. Il nous fallait attendre qu'ils enfermassent d'abord, à clef, les toiles récentes. Ils se méfiaient également les uns des autres.
Cet état de siège alimentait les silences de la Rotonde et du Dôme. Je me souviens d'une semaine où chacun y chuchotait et se demandait qui avait cambriolé, chez Rivera, la formule pour peindre les arbres en pointillant du noir avec du vert.
Les cubistes ne se rendaient pas compte, grisés de petites trouvailles, qu'ils les devaient à Picasso ou à Braque, lesquels, en les orchestrant, n'eussent fait que reprendre leur bien. Ils n'avaient du reste as à se mettre en peine, puisque notre ligne assimile mal une forme étrangère et repousse ce qui la voilerait, comme on dit d'une roue.
Et, lorsque je parle de mes emprunts d'armes, je ne parle pas de mon écriture, mais d'escarmouches où une volte rapide me permet de tourner contre l'adversaire les armes qu'il dirigeait contre moi.
Je conseille donc aux jeunes d'adopter la méthode des jolies femmes et de soigner leur ligne, de préférer le maigre au gras. Et non de s'observer dans une glace, mais de s'observer tout court."

Raymond Radiguet (1903-1923)
"Raymond Radiguet est l'aîné d'une fratrie de six enfants dont le père est un caricaturiste apprécié. A quinze ans, il a déjà lu et apprécie Mme de Lafayette, Proust, Rimbaud, Mallarmé ou Lautréamont, et choisit d'abandonner ses études pour s'essayer dans le journalisme. Introduit par André Salmon, Raymond Radiguet s'impose aisément dans le Tout-Paris artistique du moment et rencontre Jean Cocteau, avec lequel il partagera désormais grande part de son temps. En 1919, alors qu'il collabore aux revues de Tristan Tzara et d'André Breton, il écrit avec Cocteau 'Paul et Virginie' et publie 'Les Joues en feu'. Puis, toujours encouragé par Cocteau, il écrit 'Le Diable au corps'. Ce roman qui paraît en 1923 chez Bernard Grasset, connaît immédiatement l'immense succès que l'on sait. Fortement impressionné, Radiguet ordonne un peu plus sérieusement sa vie de bohème et travaille à la rédaction du 'Bal du comte d'Orgel' , mais il est soudainement frappé par une fièvre typhoïde et meurt le 12 décembre 1923, à vingt ans. Préfacé par Cocteau, 'Le Bal du comte d'Orgel' paraît durant l'été 1924."

"Le Diable au corps"
En mars 1923 paraît "Le Diable au corps", qui faillit s'appeler La Tête la première. Radiguet avait noté dans ses brouillons: «Un amour restitue ses dix-huit ans à un quinquagénaire ; une déception quadruple l'âge du jouvenceau.» C'est le récit autobiographique de l'amour adultère entre le lycéen François et Marthe, dont le fiancé croupit dans les tranchées, et plus largement encore c'est la peinture d'une jeunesse tôt mûrie, entraînée plus vite et plus loin que ses aînés dans les « grandes vacances » de la guerre.
"Je m'étais juré de ne pas partir avant minuit pour être sûr que mes parents dormissent. J'essayai de lire. Mais comme dix heures sonnaient à la mairie, et que mes parents étaient couchés depuis quelque temps déjà, je ne pus attendre. Ils habitaient au premier étage, moi au rez-de-chaussée. Je n'avais pas mis mes bottines afin d'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'une main, tenant de l'autre ce panier fragile à cause des bouteilles, j'ouvris avec précaution une petite porte d'office. Il pleuvait. Tant mieux ! La pluie couvrirait le bruit. Apercevant que la lumière n'était pas encore éteinte dans la chambre de mes parents, je fus sur le point de me recoucher. Mais j'étais en route. Déjà la précaution des bottines était impossible ; à cause de la pluie je dus les remettre. Ensuite, il me fallait escalader le mur pour ne point ébranler la cloche de la grille. Je m'approchai du mur, contre lequel j'avais pris soin, après le dîner, de poser une chaise de jardin pour faciliter mon évasion. Ce mur était garni de tuiles à son faîte. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'y suspendais, l'une d'elles tomba.
Mon angoisse décupla le bruit de sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais le panier avec mes dents ; je tombai dans une flaque. Une longue minute, je restai debout, les yeux levés vers la fenêtre de mes parents, pour voir s'ils bougeaient, s'étant aperçus de quelque chose. La fenêtre resta vide. J'étais sauf !
Pour me rendre jusque chez Marthe, je suivis la Marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eût des buissons et où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle, gardant le pont de J...
J'hésitai longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachai tout de même mes victuailles. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clef qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres. Je traversai le petit jardin sur la pointe des pieds, puis montai les marches du perron. J'ôtai encore mes bottines avant de prendre l'escalier.
Marthe était si nerveuse ! Peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblai ; je ne trouvai pas le trou de la serrure. Enfin, je tournai la clef lentement, afin de ne réveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre le porteparapluies. Je craignais de prendre les sonnettes pour des commutateurs. J'allai à tâtons jusqu'à la chambre. Je m'arrêtai avec, encore, l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien si j'allais tout à coup apprendre qu'elle me trompe, et la trouver avec un homme ! J'ouvris. Je murmurai :
– Marthe ?
Elle répondit :
– Plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais bien pu ne venir que demain matin. Tu as donc ta permission huit jours plus tôt ?
Elle me prenait pour Jacques ! Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans huit jours ! J'allumai. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire : « C'est moi », et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassai dans le cou.
– Ta figure est toute mouillée. Essuie-toi donc.
Alors, elle se retourna et poussa un cri. D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude et, sans prendre la peine de s'expliquer ma présence nocturne :
– Mais mon pauvre chéri, tu vas prendre mal ! Déshabille toi vite.
Elle courut ranimer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit :
– Veux-tu que je t'aide ?
Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine, pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nu sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda : c'était fou de rester nu ; il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis, Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. « Il devait être de ma taille. » Un costume de Jacques ! Et je pensais à l'arrivée, fort possible, de ce soldat, puisque Marthe y avait cru.
J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre. Car, même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement :
– Non. Je veux te voir t'endormir.
À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et, ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis quatre mois, je disais l'aimer, et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvai avec le trouble de tout à l'heure, avant d'entrer chez Marthe. Mais comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutai de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi.
Mais la minute où nous nous désenlaçâmes, et ses yeux admirables, valaient bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnai même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osés jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartînt à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois, je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage.
En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme : la jalousie. J'en voulais à Marthe, parce que je comprenais, à son visage reconnaissant, tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps..."

Raymond Radiguet décrit dans son roman "Le bal du comte d'Orgel" les fastueuses soirées de Misia Godebska (1872-1950), l'une des femmes les plus courtisées de la Belle Époque.
Née à Saint-Pétersbourg dans une famille d'artistes, d'un père sculpteur d'origine polonaise et d'une mère musicienne, Misia fut modèle de Renoir, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard et Vallotton, élève du compositeur Gabriel Fauré, amie de Stravinsky, de Ravel, intime de Mallarmé, inspiratrice de Proust et de Cocteau. Elle incarne tour à tour, l'idéal de la Parisienne élégante, lectrice de La Revue blanche, devenue Madame Thadée Natanson en 1893, puis soutient avec ferveur les milieux artistiques d'avant-garde et les ballets de Serge de Diaghilev, après son remariage en 1908 avec le peintre d'origine catalane José Maria Sert. Ses dîners et ses soupers après spectacles sont courus du Tout-Paris et sa vie sentimentale a forgé sa légende au même titre que sa vie sociale. Plus tard, elle ne parviendra pas à surmonter l'abandon de Sert pour la jeune Roussadana Mdivani et mourra dans la solitude dépendante à la morphine.
