- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Pirandello
- Svevo
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Pirandello
- Svevo
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Luigi Pirandello (1867-1936), "Feu Mathias Pascal" (Il Fu Mattia Pascal, 1904), "Chacun sa vérité" (Cosi è se vi pare, 1916), "Six personnages en quête
d'auteur" (Sei personaggi in cerca d'autore, 1921), "On ne sait jamais tout" (Ciascuno a suo modo, 1924), "Ce soir on improvise" (Questa sera si recta a soggetto, 1930), "Les Cahiers de Séraphin
Gubbio, opérateur" (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 1925), "Uno, nessuno e centomila" (Un, personne et cent mille, 1926) - ...
Last Update: 11/11/2016

Décennies 1920, la littérature poursuit sa découverte de nouvelles formes et de nouveaux moyens d'expression, en reproduisant dans ses solutions narratives et dans ses mises en scène théâtrales la perte des points de repère, de l'ordre, de la logique...
Pirandello, par l’ensemble de ses pièces, a voulu révéler la tragédie de l’homme moderne : un être instable, condamné à chercher sa vérité dans un monde d’illusions. L’homme est fragmenté, contradictoire, incapable de se définir. La société impose des masques (moraux, sociaux, familiaux) qui emprisonnent la « vie ». Le théâtre, en révélant ses propres artifices, devient le miroir de cette crise de l’être.
Son théâtre — à la fois intellectuel, poétique et expérimental — transforme la scène en laboratoire philosophique, où l’on ne joue plus simplement un drame, mais la quête même du sens et de l’être. Pirandello voulait faire éclater les conventions scéniques : il introduit le métathéâtre, le doute, la rupture du quatrième mur.
Il inaugure ainsi le théâtre moderne, celui de ...
- Samuel Beckett (l'Absurde, "En attendant Godot", 1953, L’attente vaine révèle le vide de l’existence et la perte de sens du langage),
- Eugène Ionesco (La Dérision, "La Cantatrice chauve", 1950, parodie du dialogue bourgeois, l’incommunicabilité et la mécanique du langage),
- Jean Genet (La Transgression, "Les Bonnes", 1947, Jeu de rôles pervers entre maîtresse et servantes ; brouillage du vrai et du faux, du bien et du mal),
- Harold Pinter (la Menace, "The Birthday Party" (L’Anniversaire), 1958, l'Ambiguïté, la tension sourde, la violence latente, dialogue elliptique et silence dramatique) ...


Pirandello (1867-1936) cherche à déconstruire les illusions du théâtre réaliste et à révéler la crise de l’identité moderne. Son théâtre repose sur trois grands axes ...
- La relativité de la vérité : il n’existe pas une seule réalité, mais une multitude de points de vue subjectifs.
- La dualité entre vie et forme : la « vie » est mouvante, indéterminée ; la « forme » (sociale, morale, théâtrale) fige les êtres.
- La mise en abyme du théâtre : Pirandello fait du théâtre un instrument de réflexion sur lui-même — un espace où fiction et réalité se confondent.
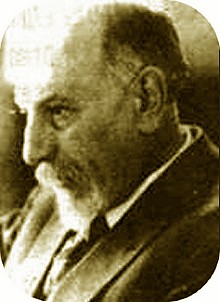
Luigi Pirandello (1867-1936)
Né à Girgenti (Agrigente, Sicile), Luigi Pirandello eut à affronter une crise qui bouleversa son patrimoine familial, puis celle de la démence de sa femme qui accabla sa vie conjugale. Il n'écrivait que sous l'emprise d'impulsions soudaines, mais s'astreignait ensuite dans la composition à une vigilante discipline, contraignant ses personnages à venir proclamer publiquement ce qui se cachait dans le secret de leur conscience ou de leur demeure ...
La pensée de Pirandello et ses thématiques sont complexes et difficiles à cerner ; on se heurte souvent à la tentation de l'enfermer dans des schémas simplistes. Le caractère problématique, l'analyse, le raisonnement, la proposition et la représentation du conflit sont des éléments constitutifs de son œuvre ample et variée (nouvelles, romans, pièces de théâtre).
Chez Pirandello ce sont les personnages qui deviennent les porte-parole de la réflexion philosophique, notamment au théâtre, où ils expriment la pensée de I'auteur.
Le problème de l'identité est un premier sujet de réflexion central, qui se développe autour du rapport entre la vie et la forme : la vie est un flux incessant et pour être dans ce monde il lui faut une forme, c'est-à-dire un masque, qui l'enferme dans un rôle figé et inauthentique.
Dans la plupart des œuvres de Pirandello, il y a un événement, un hasard en général, qui compromet ce masque et révèle le fond inquiétant de l'existence réelle. Dans "ll treno ha fischiato...", par exemple, un geste banal et quotidien devient inquiétant et sinistre ; c'est l'élément qui vient rompre la forme. Un point de vue différent, un écho ou une sensation peuvent rompre "l'illusion habituelle" (l'inganno consueto) de la perception des choses au quotidien. C'est ainsi que le personnage prend conscience de sa propre forme : soit il l'accepte avec douleur et critique avec lucidité la pantomime dans laquelle il est obligé de jouer, soit il se rebelle, parfois de façon définitive (à travers la folie ou l'autoexclusion de la société), parfois de façon salutaire (à travers des gestes absurdes ou des actes gratuits).
Retrouver toute la puissance de l'être authentique dans des actions apparemment folles. C'est dans cette dernière solution que l'on trouve l'aspect le plus original de Pirandello...
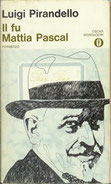
"Feu Mathias Pascal" (Il Fu Mattia Pascal, 1904) est une étape importante dans la réflexion de Pirandello sur ce thème : le protagoniste profite des circonstances pour abandonner un masque et une vie dans lesquels il ne se reconnaît pas, mais il n'est pas capable d'accepter jusqu'au bout la solution radicale d'une existence nouvelle et gérée librement ; il est tiraillé entre la tentation de retrouver des rapports familiers et sociaux et celle de fuir à nouveau, en se cachant derrière l'alibi de sa situation illégale. Même lorsque la seule solution qui lui semble envisageable est de reprendre sa première identité, il n'aura pas assez de volonté pour le faire et finira par accepter une condition de non-existence : il termine ses jours à la bibliothèque, en écrivant sa biographie qui constitue le présent roman...
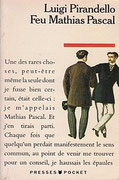
FEU MATHIAS PASCAL (II fu Mattia Pascall)
Le plus célèbre des romans de l`écrivain italien Luigi Pirandello. Ce Mathias, garçon timoré, vit en province; il abandonne le foyer conjugal, s`étant un jour pris de querelle avec sa femme et sa belle-mère. ll se rend à Monte-Carlo et gagne au jeu plusieurs dizaines de milliers de lires. En lisant les faits divers, il apprend qu`on le croit mort. (Il s`agit de la fausse identification du cadavre d`un désespéré, qui s`est jeté dans le puits de Mathias). Cette étrange situation lui suggère de faire croire à sa mort véritable et de tenter de commencer une vie nouvelle.
" ... Aussitôt je me mis à faire de moi un autre homme. Je n’avais que peu ou point à me louer de cet infortuné qu’ils avaient voulu à toute force faire finir misérablement dans le bief d’un moulin. Après toutes les sottises qu’il avait commises, il ne méritait peut-être pas un sort meilleur. À présent, j’aurais aimé que, non seulement extérieurement, mais au plus intime de l’être, il ne restât plus en moi aucune trace de lui. J’étais seul désormais, et je n’aurais pu être plus seul sur la terre, délivré dans le présent de tout lien, absolument maître de moi, soulagé du fardeau de mon passé et avec devant moi un avenir que je pourrais façonner à ma guise.
Le sentiment que mes vicissitudes passées m’avaient donné de la vie ne devait plus avoir pour moi désormais de raison d’être. Je devais me faire une nouvelle conception de l’existence, sans le moins du monde m’embarrasser de la désastreuse expérience de feu Mathias Pascal.
« Avant tout, me disais-je, j’aurai soin de ma liberté ; je la mènerai promener par des routes planes et toujours nouvelles, et jamais je ne lui ferai porter aucun vêtement alourdissant. Je fermerai les yeux et je passerai vite dès que le spectacle de la vie se présentera quelque part sous une forme désagréable. Je ferai en sorte de fréquenter de préférence les choses qu’on a coutume d’appeler inanimées, et j’irai à la recherche des belles vues, de sites pittoresques et d’endroits tranquilles. Je me donnerai peu à peu une nouvelle éducation ; je me transformerai avec un zèle patient et affectueux, de façon à pouvoir dire, à la fin, que je n’ai pas seulement vécu deux vies, mais que j’ai été deux hommes..."
Feu Mathias Pascal prend alors le nom d`Adrien Meis. Il s`installe à Rome dans quelque pension de famille, tenue par Anselme Paleari et sa fille Adrienne, mais dirigée en fait par un dangereux individu, Térence Papiano, veuf d`une seconde fille de Paleari. Dans la maison vivent deux autres personnages : Scipion, le frère de Terence, à demi épileptique, et voleur, ainsi que Silvia Caporale, professeur de musique, victime de Papiano, mais que le maître de céans, fanatique de spiritisme, estime pour ses éminentes qualités de médium.
Tels sont les personnages qui vont recréer autour de Mathias Pascal la vie de société qu`il avait pensé fuir à jamais. C'est dire que la vie quotidienne recommence, avec ses petits événements, ses aventures agréables ou désagréables, sans oublier l`humble amour dont la jeune Adrienne entoure le fugitif. Mathias est partagé entre la crainte de voir se découvrir sa situation équivoque et le besoin de se sentir vivre en se liant à ses semblables par un nouveau réseau d`intérêts et de sentiments. Il ne peut guère échapper à ce dilemme. C'est là le point culminant du roman, le plus authentiquement poétique.
Dans bien des pages, Pirandello a su admirablement dépeindre la figure timide et désolée d'un Mathias perdu dans sa solitude sans écho et guidé seulement par son inutile "petite lanterne" (c`est ainsi que l`auteur désigne toutes les facultés de l`homme). Cette solitude trouve son cadre dans la petite bourgeoisie citadine, étouffée par la gêne. les préjugés et les habitudes.
La fin du sera moins heureuse. Ici, l`imagination de Pirandello semble se tarir. On n`y voit plus qu`une sorte de jeu. Les dernières pages en sont considérées comme assez arides : Mathias ne peut s'affranchir de la nouvelle réalité qui l`entoure que par un nouveau décès. ll décide donc de tuer Adrien Meis et de retrouver sa véritable identité : Mathias Pascal. Nous entrons alors dans le domaine de la farce, une farce ingénieuse certes, mais qui détruit le thème que l'on peut juger comme si douloureusement humain de l`aventure de Mathias.
ll s'en retourne dans sa province et trouve sa femme remariée à un ancien prétendant et mère d`une fillette. Dès lors, il se voit contraint de demeurer feu Mathias Pascal. De temps à autre, il s'en ira visiter sa propre tombe, sujet de moquerie pour ses concitoyens.
En dépit de ses défauts, "Feu Mathias Pascal" est considéré comme indéniablement un des meilleurs romans italiens. ll fut, d`ailleurs très vite traduit dans toutes les langues européennes. (Trad. Calmann-Lévy. 1982).

Dans "Les Cahiers de Séraphin Gubbio, opérateur" (Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 1925), Pirandello approfondit la thématique du renoncement à la vie, qui se résume à un enregistrement passif des événements extérieurs et à une négation de l'authenticité totale et lucide - la fiction cinématographique y fait symboliquement allusion. Séraphin est réduit à sa condition mécanique d'opérateur, il n'est plus qu'une main qui tourne ("Si gira", "ça tourne" en italien) et il reporte dans ses cahiers son quotidien et l'événement traumatisant qui l'a privé de la parole. Cette perte de la parole fait allusion à la mort et à la mécanisation de l'art ; la machine qui sert aux prises de vue est un instrument de mystification de la réalité, tout en étant un emblème de la conscience critique de l'intellectuel dont le rôle est d'être un observateur détaché des choses. Certains personnages, comme le violoniste et la philosophe Simone Pau, parce qu'ils sont marginaux, semblent être les seuls points de repère dans une ville aliénée. C'est, pour nombre de critiques, le roman le plus moderne de Pirandello, mais aussi le plus négatif....
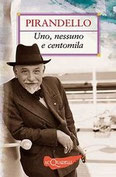
"Uno, nessuno e centomila" (Un, personne et cent mille, 1926)
Dans "Un, personne et cent mille" (1926), Pirandello analyse et dénonce de façon radicale les conventions sociales et l'impossibilité d'instaurer des rapports basés sur une communication authentique ; il s'ensuit une solution positive, vitaliste, qui peut sembler illusoire : le protagoniste Vitangelo Moscarda conclut que, pour sortir de la prison dans laquelle est confinée la vie, il ne suffit pas de changer les noms, parce que la vie est une constante évolution et que les noms représentent la mort. La seule façon de vivre chaque moment, c'est donc de vivre la vie d'instant en instant et de renaître sans cesse d'une manière différente...
ll peut parfois s'avérer surprenant d'être examiné de très près par un ami ou un parent, si celui-ci fait preuve de franchise en soulignant certaines de nos imperfections physiques mineures. Pour Moscarda, protagoniste du roman de Pirandello, le commentaire inattendu de sa femme au sujet de son nez, légèrement incliné vers la droite, provoque un changement sensationnel. L'image qu'il a de lui-même est en complète opposition avec celle de sa femme. ll réalise soudain qu'il vit avec un étranger dont il ne peut se séparer et que, pour les autres - femme, amis et connaissances -, il n'est pas du tout ce qu'il est pour lui-même. Il est obligé de cohabiter avec des milliers d'étrangers, les milliers de Moscarda que perçoivent les autres, inséparables de son identité et que, de façon dramatique, il ne connaitra jamais...
"(V. VIOLENCE ARBITRAIRE)
... Partout, un relent de moisi se mélangeait à l’âcre odeur des paperasses empilées sur les registres et à la sécheresse qu’exhalait le calorifère du rez-de-chaussée.
Oh ! la mélancolie désespérée des chaises de forme désuète, près des tables ! personne ne s’y asseyant, on les laissait là, déplacées, et ces pauvres sièges inutiles ressentaient certainement l’humiliation d’un tel abandon…
Que de fois, en entrant, j’avais eu envie de demander :
— Pourquoi ces chaises ? Pourquoi sont-elles condamnées à rester là, puisque personne ne s’en sert ?
Mais, je m’étais abstenu, non pour m’être avisé qu’en pareil lieu, l’apitoiement sur le sort des chaises semblerait à tout le monde surprenant, peut-être même cynique ; je m’étais, dis-je, abstenu, parce qu’une si infime préoccupation aurait paru extravagante à quiconque savait combien j’avais peu le souci des affaires.
Ce jour-là, en entrant, je trouvai les commis rassemblés dans la salle du fond ; de temps en temps ils riaient aux éclats : ils assistaient à une dispute entre Stefano Firbo, et un certain Turolla, le souffre-douleur de tous, et dont on raillait jusqu’aux vêtements.
La pauvre Turolla soutenait qu’une jaquette longue l’aurait fait paraître encore plus petit, lui qui l’était déjà tellement. Il disait vrai ; mais, – trapu, courtaud et solennel,—avec ses grandes moustaches de brigadier, il ne s’apercevait pas combien sa petite jaquette qtfi lui découvrait le derrière, le rendait ridicule de dos.
À présent, prêt aux larmes, mortifié, congestionné, fustigé par les rires de ses collègues, il levait un petit bras et se risquait à dire à Firbo :
— Oh, mon Dieu, comme vous prenez mal ce que je vous dis !
Firbo lui criait en plein visage, en le secouant furieusement par son bras levé :
— Mais qu’en sais-tu ? Que sais-tu ? Tu ne saurais même pas tracer un O avec le pied d’un verre !… Pourtant tu es rond comme lui !…
Je finis par apprendre de quoi il s’agissait : quelqu’un demandait un prêt à la banque, – présenté justement par Turella, qui se portait garant de sa probité, alors que Firbo en doutait. Un sursaut de révolte me souleva.
Gomme on ignorait la torture secrète de mon esprit, personne ne put en comprendre la raison, et l’assistance frémit quand, bousculant deux ou trois employés, je criai à Firbo : Et toi ? De quel droit veux-tu imposer ainsi ta façon de voir ?
Firbo interloqué se retourna pour me regarder, et, comme s’il n’en croyait pas ses yeux, en me voyant ainsi tout près de lui, il cria à son tour :
— Tu es fou ?
La fantaisie me prit, je ne sais trop pourquoi, de lui jeter à la face une riposte cinglante, qui pétrifia tout le monde :
— Oui, comme ta femme, que tu es obligé de tenir enfermée dans une maison d’aliénés.
Je le vis pâlir, et son visage se crispa. « Tu dis ? Je suis obligé ? »
Je haussai les épaules ; ennuyé de l’effarement général, et, en même temps, prenant conscience de l’inopportunité de mon intervention je répondis doucement : – Mais oui, tu le sais bien.
Et, comme si, après ces mots, j’avais été soudain, comment dire ? changé en pierre, je ne parvins plus à entendre ce que me criait Firbo, entre ses dents serrées, avant de sortir avec fureur.
Je me rappelle que je souriais pendant que Quantorzo, survenu au bruit de l’altercation, m’entraînait dans le petit bureau de la direction. Je souriais, pour prouver que la violence était inutile, et que l’incident était clos ; et pourtant je sentais qu’à ce moment, pendant que je souriais, j’aurais pu tuer quelqu’un, tellement l’attitude sévère et l’agitation de Quantorzo m’exaspéraient.
Je promenais mes regards autour de moi, dans le bureau directorial, ahuri de constater que l’étrange vertige qui m’avait gagné tout à coup, ne m’empêchait pas de remarquer les choses avec exactitude et lucidité, jusqu’à être presque tenté d’en rire ; et pendant que Quantorzo me réprimandait avec véhémence, je posai exprès quelques questions de curiosité puérile sur tel ou tel objet de la chambre. Pendant ce temps je songeais presque machinalement, que, dans son enfance, on avait fait à Stefano Firbo des pointes de feu dans le dos, et que, bien qu’on ne lui vit pas de bosse, toute sa.charpente osseuse était celle d’un bossu ; oui, juché sur des pattes d’oiseau, longues et grêles, élégant, certes, oui, oui ; un faux bossu élégant ; très réussi.
Tout en réfléchissant, il me parut évident que cet homme devait se servir de son intelligence peu commune, pour se venger de ceux à qui, dans leur enfance, on n’avait pas appliqué comme à lui des pointes de feu au dos.
Je pensais ces choses, je le répète, comme les aurait pensées en moi un autre, un autre devenu tout à coup étrangement froid et insouciant, moins pour me faire un écran de cette froideur, qu’afin de jouer un personnage derrière lequel il me fallait dissimuler encore tout ce qui m’apparaissait graduellement de l’effroyable vérité qui s’était en partie révélée à moi.
— Mais oui, tout est là, pensais-je ; dans cette tyrannie. Chacun veut imposer à autrui l’univers qu’il porte en lui, comme si cet univers était extérieur, comme si tout le monde devait en avoir une vision conforme à la sienne, et comme si les autres ne pouvaient être différents de l’image qu’il s’en fait.
Les faces stupides de ces employés se présentèrent de nouveau à mes yeux ; et je continuais à songer :
— Mais oui, mais oui. Quelle réalité la majorité des hommes réussissent-ils à établir en eux ? Misérable, faillible, incertaine. Et les tyrans en profitent. Ou plutôt, ils ont l’illusion d’en profiter, en imposant de gré ou de force à autrui, le sens et la valeur qu’ils s’assignent à eux-mêmes, aux autres et aux choses, de manière à que chacun voie et sente, pense et parle, à leur façon.
Je me levai et m’approchai de la fenêtre avec un grand soulagement ; puis, je me tournai vers Quantorzo, qui, interrompu au point culminant de son discours, me regardait en ouvrant de grands yeux ; et, poursuivant la pensée qui me torturait, je lui dis :
— Mais quoi !… Mais quoi !… Ils s’illusionnent !
— Qui s’illusionne ?
— Ceux qui veulent dominer. M. Firbo, par exemple. Ils s’illusionnent parce qu’à la vérité, mon ami, ils ne réussissent pas à imposer autre chose que des mots. Des mots, comprends-tu ? des mots que chacun comprend et répète à sa façon. Et c’est pourtant ainsi que se forme ce qu’on appelle l’opinion courante !… Et malheur à celui qui, un beau jour, se trouve étiqueté d’un de ces mots que chacun répète : par exemple « usurier » ; par exemple « fou » !… Dis-moi, comment demeurer calme, à la pensée que quelqu’un s’acharne à persuader les autres que tu es tel qu’il te voit, lui, à te graver dans l’esprit des autres conforme au jugement qu’il a émis ; et à empêcher que les autres te voient et te jugent de manière différente ?
J’avais à peine eu le temps de remarquer l’ébahissement de Quantorzo, que je revis Stéfano Firbo devant moi. Son regard m’apprit qu’en peu d’instants je m’en étais fait un ennemi, et aussitôt, je lui devins hostile à mon tour ..."
La relativité de la perception, thème favori de Pirandello, et la fragmentation de la réalité en segments incompréhensibles constituent le noyau philosophique de l'oeuvre. Étroitement liée à cela se trouve une réflexion sur le langage et l'impossibilité d'une communication objective et satisfaisante entre interlocuteurs, puisque chacun change les mots en leur donnant une signification propre. La tentative de Moscarda pour contrôler son propre moi est vaine, et le sacrífice de soi constitue sa seule porte de sortie, en commençant par son refus de regarder les miroirs.
Livre 1 : La Découverte et le Doute Initial
L'élément déclencheur : Vitangelo Moscarda, le narrateur, découvre grâce à sa femme que son nez penche légèrement. Cette observation anodine lui révèle soudain qu'il ne se voit pas comme les autres le voient.
La crise de l'identité unique : Il réalise qu'il n'est pas "un" (Uno) – l'image stable qu'il a de lui-même – mais qu'il existe une multitude d'images de lui ("cent mille") dans l'esprit des autres. C'est la naissance de sa "maladie".
Début de la déconstruction : Il commence à remettre en question tous les aspects de sa vie et de sa personnalité qu'il croyait fixes.
Livre 2 : L'Expérimentation et la Provocation
Moscarda devient acteur de sa propre démolition : Il décide de tester activement cette théorie en adoptant des comportements étranges et imprévisibles.
Il rend visite à son ami Stefano avec une étrange préoccupation pour la forme de ses oreilles, semant le trouble et l'incompréhension, et montre comment notre "moi" est une construction sociale, un personnage que nous jouons pour répondre aux attentes des autres.
Livres 3 et 4 : La Crise Financière et Sociale
L'identité est liée à l'argent : Moscarda comprend que son identité sociale de "banquier respectable" et "homme charitable" est indissociable de sa position économique.
Il entreprend de détruire délibérément cette réputation. Il s'engage dans une opération financière complexe qui semble ruiner une veuve, Anna Rosa, pour révéler au grand jour "l'usurier" que tout le monde voyait en lui sans oser le dire. Et refuse toute justification et assume le rôle du méchant que la société lui assigne en secret.
Livre 5 : La Révolte contre le Langage
Le langage comme prison : une partie plus philosophique. Moscarda étend sa réflexion au langage lui-même. Il affirme que les mots sont des conventions vides qui empêchent une vraie communication et figent la réalité mouvante.
Un exemple célèbre : La discussion sur le mot "cheval". Un "cheval" n'est pas la même chose pour un cavalier, un biologiste ou un artiste. Le mot crée une illusion de compréhension commune.
Livre 6 : La Ruine et l'Isolement
Le point de non-retour; les conséquences de ses actes l'encerclent. Sa femme le quitte, il est rejeté par la société, sa banque est en péril. Une foule se rassemble devant sa maison, le traitant de fou et le menaçant. Il est physiquement et socialement mis à l'écart. C'est la perte de tous les "rôles" : Il a réussi à se dépouiller de toutes les identités ("les cent mille") que les autres lui collaient à la peau.
Livre 7 : La Folie et l'Emprisonnement
L'apogée de la crise : Pris de panique face à la foule, il tire un coup de feu et blesse un homme. Il est interné dans un asile. L'asile comme métaphore, l'asile est le lieu ultime de celui que la société ne peut pas ou ne veut pas comprendre. C'est aussi le lieu où il est enfin "libre" des regards et des jugements du monde extérieur.
Livre 8 : La Libération et le "Personne"
L'état de "Personne" (Nessuno) : C'est la conclusion philosophique du roman. Libéré de l'asile et vivant dans un hospice de charité, Moscarda atteint l'état qu'il cherchait.
La fin des constructions : N'étant plus rien pour personne, il n'a plus à être "un" personnage. Il n'a plus de passé, plus de nom, plus de personnalité fixe.
La fusion avec le moment présent : Il vit dans l'instant, comme une chose parmi les choses, changeant à chaque moment. Il se compare à une feuille, à une pierre, à un ruisseau. Il n'est plus "quelqu'un", il est "personne", et dans ce néant, il trouve une paix paradoxale.
(IV. QUI NE CONCLUT PAS) - "... Anna Rosa devait être acquittée ; mais je crois que son acquittement doit être attribué en partie, à l’hilarité qui secoua la salle entière du tribunal, lorsqu’appelé à faire ma déposition, on me vit comparaître avec le bonnet, les sabots et la camisole bleue de l’hospice.
Je ne me regarde plus dans une glace, et il ne me vient même pas à l’idée de chercher à connaître mon visage, ni l’aspect que je peux présenter ; on me trouva bien changé sans doute, et bien comique, à en juger par la surprise et les rires qui saluèrent mon entrée. Néanmoins, tous continuèrent à m’appeler « Moscarda », bien que l’appellation de Moscarda eut certainement pour chacun une signification aussi variée qu’autrefois ; ils auraient vraiment pu épargner à ce pauvre disparu, barbu et souriant, en sabots et en camisole bleue, l’obligation pénible de se retourner encore à ce nom, comme si vraiment il lui appartenait.
Plus de nom. Aujourd’hui, plus aucun souvenir du nom d’hier ; ni demain, de celui d’aujourd’hui, puisque le nom détermine la chose ; puisque un nom est, en nous, le concept de toute chose placée hors de nous. Sans appellation, toute conception devient impossible, et la chose demeure en nous, comme aveugle, imprécise et confuse ; ce nom que j’ai porté parmi les hommes, que chacun le grave, épigraphe funéraire, sur l’image qu’il garde de moi, et qu’il la laisse en paix, à jamais. Un nom n’est qu’une épigraphe funéraire, il convient aux morts. À qui a conclu. Je suis vivant, et je ne conclus pas. La vie ne conclut pas. Et elle ignore les noms.
Cet arbre, respiration palpitante des feuilles nouvelles… Je suis cet arbre ; l’arbre, le nuage. Demain, je serai le livre ou le vent. Le livre que je lis, le vent que je bois. Extériorisé, vagabond.
L’hospice s’élève en pleine campagne, en un lieu riant ; je sors chaque matin, à la pointe du jour, parce qu’à présent je veux que mon esprit s’imprègne de la fraîcheur de l’aube, à l’heure où toutes les choses se dévoilent à peine et se souviennent encore des rigueurs de la nuit, avant que le soleil ne sèche leur haleine humide et ne les éblouisse.
Là-bas, ces nuages chargés d’eau, lourds poids de plomb massés sur les montagnes livides, font paraître plus large et plus claire, dans le grain de l’ombre encore nocturne, la verte étendue de ciel.
Et là, ces brins d’herbe, ployant sous l’eau, fraîcheur vive des berges ; et ce petit âne, resté au serein toute la nuit, qui à présent regarde avec ses yeux voilés et s’ébroue, dans ce silence si proche, qui peu à peu lui semble s’éloigner et s’emplir de la clarté environnante ; et la lumière inonde les campagnes engourdies et désertes.
Et ces charrettes, entre le noir des haies et la dégradation des murs, qui demeurent immobiles sur leurs ornières déchirées…
L’air est neuf. D’instant en instant, chaque chose se ranime pour apparaître. Je détourne les yeux de tout ce qui est appelé à s’immobiliser et à mourir. C’est à ce seul prix que je puis vivre désormais. Renaître d’instant, en instant. Empêcher en moi le travail de la pensée qui échafaude le néant des constructions vaines…
La ville est loin ; par moment, dans le calme du soir, le son des cloches m’arrive ; maintenant, je les entends, non plus en moi, mais hors de moi, sonner pour elles-mêmes ; peut-être est-cede joie qu’elles frémissent, entre les parois de leurs cavités bourdonnantes, sous le ciel bleu qu’illumine un soleil tiède encore, parmi les cris perçants des hirondelles, baignées des vents qui déferlent chargés de nuées, – hautes et pesantes dans leurs campaniles aériens. Penser à la mort, prier. Il est des âmes pour qui ce besoin existe encore, et les cloches se font leur voix. Pour moi, je ne l’éprouve plus car à chaque instant je meurs et renais, neuf et lavé de souvenirs ; dans mon intégrité et vivant, non plus en moi, mais en toutes les choses extérieures. "
Si l'on fait abstraction de la conclusion irrationnelle de "Un, personne et cent mille", les romans de Pirandello sont le fruit de théories esthétiques pour lesquelles I'œuvre d'art est une création individuelle qui se base sur un exercice critique.
Son "relativisme" reflète l'influence contemporaine des "philosophies de la vie" (Binet, Nietzsche, Dilthey, Simmel, Bergson), où l'image du "je" est toujours mobile et divisée. L'idée de la multiplicité des esprits (instinctif, moral, affectif, social) se trouve à la base de sa poétique, qu'il expose dans "L'Humour" (1908) : l'art de l'humour se trouve dans les contraires, il met à nu la décomposition du «je ››, sait exprimer à la fois l'aspect comique et l'aspect tragique d'une même apparence, le côté normal et le côté fou. Bien que ses romans aient un fort substrat philosophique, ils n'ont rien de traités abstraits. L'individu et les traumatismes qu'il traverse sont toujours plongés dans un contexte social analysé avec une finesse et une froideur presque impitoyables, tout en communiquant la douleur et l'oppression qui pèse sur eux. Le monde de la petite bourgeoisie de la capitale et de celle qui vient de Sicile sont des objets privilégiés de cette analyse ; c'est un monde stigmatisé dans son immobilisme...
LA SICILE ? L'attention au monde sicilien chez Pirandello vient de la littérature vériste, on le voit dans le roman "Les Vieux et les jeunes" (I vecchi e i giovani, 1909). On a souvent noté qu'il y a comme un "parcours de la Sicile" dans la littérature italienne qui part de "l viceré" (1954) de Federico De Roberto (1861-1927), passe par Pirandello et "Le Guépard" (1958) de Tomasi di Lampedusa (1896-1957), pour aboutir à Leonardo Sciascia (1921-1989) et à son analyse lucide des vices de cette société insulaire et de son immobilisme. D'un côté, il y a l'analyse historique qui se concentre sur le conflit générationnel et sur l'effondrement des valeurs du Risorgimento, de l'autre on assiste au démasquement humoristique des contradictions que l'on trouve dans les rapports sociaux, les idéologies, les comportements des individus sur une toile de fond symbolique, marquée par l'aridité et l'oppression...
LE THEATRE ? L'analyse la plus profonde et la plus systématique des labyrinthes de la personnalité et des fictions sociales se trouve dans les œuvres théâtrales de Pirandello, qu'il écrit à partir 1910, et qui lui valurent un succès international. Le théâtre lui permet d'approfondir parfaitement sa réflexion sur le rapport entre l'art et la vie, entre vie et forme. Dès ses romans, Pirandello avait proposé un "personnage sans auteur" qui essaie de vivre, une métaphore de la vie qu'il entendait réaliser. Ces problématiques sont détaillées dans sa célèbre trilogie théâtrale,
"Chacun sa vérité" (Cosi è se vi pare, 1916), "Six personnages en quête d'auteur" (Sei personaggi in cerca d'autore, 1921), "On ne sait jamais tout" (Ciascuno a suo modo, 1924), "Ce soir on improvise" (Questa sera si recta a soggetto, 1930). Des pièces innovantes et choquantes pour le public de l'époque ..

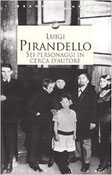
Dans "Six personnages en quête d'auteur", (Sei personaggi in cerca d'autore, 1921), considéré comme le chef d'œuvre théâtral de Pirandello, le thème de la communication est fondamental. Pendant que le directeur règle des détails avec les acteurs concernant leur pièce, six personnages font leur arrivée : il s'agit d'une famille entière, comprenant la mère, le père, la belle-fille, le fils, l'adolescent et la fillette (ces deux derniers rôles sont muets). Ils sont insatisfaits de l'interprétation des acteurs dans leur personnage. lls affirment que ce n'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu, que ce n'est pas de la fiction mais leur réalité. Par conséquent, les personnages et les acteurs se querellent à propos de ce qui est réalité et fiction et de la véracité de leur jeu. Les personnages finissent par jouer eux-mêmes leurs scènes devant la troupe, si bien qu'avec le temps, on croit que ce n'est plus fiction et que le drame est réel, ce qui trouble plusieurs acteurs et personnages. A la fin, l'adolescent et la fillette meurent ; est-ce de la fiction ou bien la réalité des personnages ? Au fond, plus personne ne détient la vérité...

1. L'Intrusion (Le Prologue)
Au milieu des répétitions d'une autre pièce de Pirandello, les Six Personnages, vêtus de noir et masqués, font une entrée spectaculaire et inexplicable dans le théâtre. Ils interrompent le travail des Comédiens et du Directeur. C'est le fondement même de la pièce. Ce moment brise immédiatement le "quatrième mur" et établit le conflit central : l'affrontement entre le monde "réel" mais factice des Comédiens et le monde "fictif" mais éternel des Personnages. Il pose la question : qui est le plus "réel", l'acteur qui joue ou le Personnage qui est ?
"En entrant dans la salle, les spectateurs trouveront le rideau levé et le plateau tel qu’il est de jour, sans portants ni décor, vide et dans une quasi-obscurité : cela pour qu’ils aient, dès le début, l’impression d’un spectacle non préparé.
Deux petits escaliers, l’un à droite et l’autre à gauche, font communiquer le plateau avec la salle. D’un côté, sur le plateau, le couvercle du trou du souffleur est rangé à proximité dudit trou. De l’autre côté, au premier plan, une table et un fauteuil dont le dossier est tourné vers le public, pour le Directeur-chef de troupe. Deux autres tables, l’une plus grande et l’autre plus petite, avec plusieurs chaises autour d’elles, ont été placées là, également au premier plan, afin d’être disponibles, si besoin est, pour la répétition. D’autres chaises, çà et là, à droite et à gauche, pour les Acteurs, et au fond, d’un côté, un piano qui est presque caché.
Une fois éteintes les lumières de la salle, on verra entrer par la porte du plateau le Chef machiniste en salopette bleue et une sacoche suspendue à la ceinture : prenant dans un coin, à l’arrière-plan, quelques planches, il les dispose sur le devant de la scène et se met à genoux pour les clouer. Au bruit des coups de marteau, le Régisseur, entrant par la porte des loges, accourt.
LE RÉGISSEUR. – Eh là ! Qu’est-ce que tu fabriques ?
LE CHEF MACHINISTE. – Ce que je fabrique ? Je cloue.
LE RÉGISSEUR. – À cette heure-ci ? (Consultant sa montre :) Il est déjà dix heures et demie. Le Patron va être là d’un instant à l’autre pour la répétition.
LE CHEF MACHINISTE. – Dites donc, moi aussi, il faudrait tout de même qu’on me laisse le temps de travailler !
LE RÉGISSEUR. – Tu l’auras, mais pas maintenant.
LE CHEF MACHINISTE. – Quand ça ?
LE RÉGISSEUR. – Quand ça ne sera plus l’heure de la répétition. Allons, allons emporte-moi tout ça, que je puisse planter le décor du deuxième acte du Jeu des rôles.
Le Chef machiniste, soupirant et grommelant, ramasse les planches et s’en va. Cependant, par la porte du plateau commencent à arriver les Acteurs, hommes et femmes, de la Troupe, d’abord un seul, puis un autre, puis deux à la fois, ad libitum : ils doivent être neuf ou dix, le nombre d’acteurs censés participer aux répétitions du Jeu des rôles, la pièce de Pirandello inscrite au tableau de service. En entrant, ils saluent le Régisseur et se saluent mutuellement, se souhaitant le bonjour. Certains d’entre eux se dirigent vers les loges ; d’autres, parmi lesquels le Souffleur qui aura le manuscrit roulé sous le bras, restent sur le plateau, attendant le Directeur pour commencer à répéter, et, pour meubler cette attente, assis en cercle ou debout, ils échangent quelques mots ; l’un allume une cigarette, un autre se plaint du rôle qui lui a été distribué, et un troisième lit à haute voix pour ses camarades des nouvelles contenues dans un petit journal de théâtre. Il sera bon qu’aussi bien les Actrices que les Acteurs portent des vêtements plutôt clairs et gais. À un certain moment, l’un des comédiens pourra se mettre au piano et attaquer un air de danse, et les plus jeunes Acteurs et Actrices se mettront à danser.
LE RÉGISSEUR, frappant dans ses mains pour les rappeler à l’ordre. – Allons, allons, finissez ! Voici le Patron !
Les conversations et la danse s’interrompent sur-le-champ. Les Acteurs se tournent pour regarder dans la salle, par la porte de laquelle on verra entrer le Directeur-chef de troupe, qui, coiffé d’un chapeau melon, sa canne sous le bras et un gros cigare aux lèvres, parcourt l’allée entre les fauteuils et, salué par les comédiens, monte sur le plateau par l’un des petits escaliers. Le Secrétaire lui tend le courrier : quelques journaux et un manuscrit arrivé par la poste.
LE DIRECTEUR. – Pas de lettres ?
LE SECRÉTAIRE. – Non. Tout le courrier est là.
LE DIRECTEUR, lui tendant le manuscrit. – Portez ça dans ma loge. (Puis, regardant autour de lui et s’adressant au Régisseur :) Dites donc, on n’y voit rien ici. Je vous en prie, faites donner un peu de lumière.
LE RÉGISSEUR – Tout de suite.
Il va donner des ordres en conséquence. Et, peu après, une vive lumière blanche illumine toute la partie droite du plateau, là où sont les Acteurs. Pendant ce temps, le Souffleur aura pris place dans son trou, allumé sa petite lampe et disposé le manuscrit devant lui.
LE DIRECTEUR, frappant dans ses mains. – Allons, allons, au travail ! (Au Régisseur :) Tout le monde est là ?
LE RÉGISSEUR. – Sauf Mlle…
Il nomme le Grand Premier Rôle féminin.
LE DIRECTEUR. – Comme d’habitude ! (Consultant sa montre :) Nous avons déjà dix minutes de retard. Faites-moi le plaisir de l’inscrire au tableau de service. Ça lui apprendra à arriver à l’heure aux répétitions.
Il n’a pas terminé son admonestation que l’on entend, venue du fond de la salle, la voix du Grand Premier Rôle féminin.
LE GRAND PREMIER RÔLE FÉMININ. – Non, non, je vous en prie ! Me voici ! Me voici !
Elle est tout entière vêtue de blanc, un époustouflant grand chapeau sur la tête et un joli petit chien dans les bras ; elle parcourt rapidement l’allée entre les fauteuils et gravit en grande hâte l’un des petits escaliers.
LE DIRECTEUR. – Vous avez juré de vous faire toujours attendre.
LE GRAND PREMIER RÔLE FÉMININ. – Excusez-moi. J’ai cherché de tous les côtés un taxi pour être là à l’heure ! Mais je vois que vous n’avez pas encore commencé. Et moi, je ne suis pas du début. (Puis appelant le Régisseur par son prénom et lui confiant le petit chien :) Soyez gentil, enfermez-le dans ma loge.
LE DIRECTEUR, bougonnant. – Et son petit chien par-dessus le marché ! Comme s’il n’y avait pas déjà assez de cabots ici. (Frappant de nouveau dans ses mains et s’adressant au Souffleur :) Allons, allons, le deuxième acte du Jeu des rôles. (S’asseyant dans son fauteuil :) Attention, mesdames et messieurs. Qui est du début de l’acte ?
Tous les Acteurs et Actrices évacuent le devant du plateau et vont s’asseoir d’un côté de celui-ci, tous à l’exception des trois comédiens qui sont du début et du Grand Premier Rôle féminin qui, ne prêtant pas attention à la question du Directeur, s’est assise devant l’une des deux tables.
LE DIRECTEUR, à la Vedette féminine. – Vous êtes donc de la première scène ?
LE GRAND PREMIER RÔLE FÉMININ. – Moi ? Mais non.
LE DIRECTEUR, agacé. – Eh bien, alors, allez-vous-en de là, bon sang !
Le Grand Premier Rôle féminin se lève et va s’asseoir près des autres Acteurs qui sont déjà installés à l’écart.
LE DIRECTEUR, au Souffleur. – Allez-y, allez-y !
LE SOUFFLEUR, lisant dans le manuscrit. – « Chez Leone Gala. Une bizarre salle à manger-bureau. »
LE DIRECTEUR, au Régisseur. – Nous mettrons le salon rouge.
LE RÉGISSEUR, notant sur une feuille de papier. – Le salon rouge. Entendu.
LE SOUFFLEUR, continuant de lire dans le manuscrit. – « Une table sur laquelle le couvert est mis et un bureau avec des livres et des papiers. Étagères de livres et vitrines contenant une luxueuse vaisselle. Porte au fond ouvrant sur la chambre à coucher de Leone. Porte latérale à gauche ouvrant sur la cuisine. La porte principale est à droite. »
LE DIRECTEUR, se levant et indiquant aux comédiens. – Alors, notez-le bien : par là, la porte principale. Par ici, la cuisine. (À l’Acteur qui doit interpréter le rôle de Socrate :) Vos entrées et vos sorties par là. (Au Régisseur :) La porte à tambour, vous la mettrez au fond, avec des tentures.
Il s’assied à nouveau.
LE RÉGISSEUR, notant. – Entendu.
LE SOUFFLEUR, reprenant sa lecture. – « Scène première. Leone Gala, Guido Venanzi et Filippo, dit Socrate. » (Au Directeur :) Il faut aussi que je lise les indications de mise en scène ? ..."
Pendant ce temps, le Concierge du théâtre est entré dans la salle, sa casquette galonnée sur la tête, et, parcourant l’allée entre les fauteuils, il s’est approché du plateau pour annoncer au Directeur-chef de troupe l’arrivée des Six Personnages, lesquels, entrés eux aussi dans la salle, l’ont suivi à une certaine distance, regardant autour d’eux, légèrement affolés et perplexes.
Celui qui voudrait tenter une traduction scénique de cette pièce devrait s’employer par tous les moyens à obtenir surtout comme effet que ces Six Personnages ne se confondent pas avec les Acteurs de la Troupe. Les places des uns et des autres, données dans les indications de mise en scène, quand ils monteront sur le plateau, serviront sans aucun doute à cette fin, de même qu’un éclairage de couleur différente grâce à des projecteurs appropriés. Mais le moyen le plus efficace et le plus idoine, que l’on suggère ici, serait l’utilisation de masques spéciaux pour les Personnages : des masques faits exprès d’une matière que la transpiration ne ramollisse pas et tels, malgré cela, qu’ils ne gênent pas les Acteurs qui devront les porter ; des masques travaillés et découpés de manière à laisser libres les yeux, les narines et la bouche. On pourra rendre ainsi jusqu’au sens profond de cette pièce. Effectivement, les Personnages ne devront pas apparaître comme des fantômes, mais comme des réalités créées, d’immuables constructions de l’imagination : et, donc, plus réels et plus consistants que le naturel changeant des Acteurs. Ces masques contribueront à donner l’impression de visages créés par l’art et figés immuablement chacun dans l’expression de son sentiment fondamental qui est le remords pour le Père, la vengeance pour la Belle-fille, le mépris pour le Fils, et, pour la Mère, la douleur, avec des larmes de cire fixées dans le bleu des orbites et le long des joues comme on en voit sur les images sculptées et peintes de la Mater dolorosa des églises. Et il faudrait aussi que leurs vêtements soient d’une étoffe et d’une coupe spéciales, sans extravagance, avec des plis rigides et comme une consistance massive de statue : bref, que ces vêtements ne donnent pas l’impression d’être d’une étoffe que l’on pourrait acheter dans n’importe quel magasin de la ville et d’avoir été taillés et cousus dans n’importe quelle maison de couture.
Le Père doit avoir la cinquantaine : les tempes dégarnies, mais non pas chauve, le poil roux, avec d’épaisses petites moustaches s’enroulant presque autour d’une bouche encore fraîche, laquelle s’ouvre souvent pour un sourire hésitant et futile. Pâle, notamment en ce qui concerne son large front ; des yeux bleus, ovales, très brillants et vifs ; il portera un pantalon de couleur claire et un veston de couleur foncée ; parfois il sera mielleux et parfois il aura des éclats âpres et durs.
La Mère doit être comme atterrée et écrasée par un intolérable poids de honte et d’humiliation. Un épais crêpe de veuve la voilera, et elle doit être pauvrement vêtue de noir ; quand elle soulèvera son voile, elle laissera voir un visage non point maladif, mais comme fait de cire, et elle tiendra toujours les yeux baissés.
La Belle-fille, dix-huit ans, sera effrontée, presque impudente. Très belle, elle sera, elle aussi, en deuil, mais avec une élégance un peu voyante. Elle manifestera de l’agacement pour l’air timide, affligé et comme égaré de son jeune frère, un morne Adolescent de quatorze ans, vêtu de noir lui aussi, et, par contre, une vive tendresse pour sa petite sœur, une Fillette d’environ quatre ans, vêtue de blanc avec une ceinture de soie noire.
Le Fils, vingt-deux ans, grand, comme raidi dans une attitude de mépris contenu pour le Père et d’indifférence renfrognée pour la Mère, portera un manteau violet et une longue écharpe verte autour du cou.
LE CONCIERGE, sa casquette à la main. – Je vous demande pardon, monsieur le Directeur.
LE DIRECTEUR, vivement, rogue. – Qu’est-ce qu’il y a encore ?
LE CONCIERGE, timidement. – C’est ces messieurs dames qui vous demandent.
Du plateau, le Directeur et les Acteurs se tournent, étonnés, pour regarder dans la salle.
LE DIRECTEUR, de nouveau furieux. – Mais je suis en pleine répétition ! Et vous savez bien que pendant les répétitions personne ne doit entrer ! (Vers le fond de la salle :) Qui êtes-vous ? Qu’est-ce que vous voulez ?
LE PÈRE, s’avançant, suivi des autres jusqu’à l’un des petits escaliers. – Nous sommes à la recherche d’un auteur.
LE DIRECTEUR, mi-abasourdi, mi-furieux. – D’un auteur ? Quel auteur ?
LE PÈRE. – N’importe lequel, monsieur.
LE DIRECTEUR. – Mais il n’y a pas le moindre auteur ici, car nous n’avons pas la moindre pièce nouvelle en répétition.
LA BELLE-FILLE, avec une vivacité gaie, gravissant rapidement le petit escalier. – Alors, tant mieux, monsieur, tant mieux ! Nous allons pouvoir être votre pièce nouvelle.

2. Le Récit de la Scène de la Maison de Couture
Le Père et la Belle-Fille racontent, puis rejouent, la scène humiliante et scabreuse de leur rencontre dans la maison de couture de Madame Pace, où le Père, sans la reconnaître, a failli avoir des relations avec sa propre belle-fille.
C'est le noyau dramatique de la "pièce dans la pièce". Cette scène est cruciale car elle est indicible et irreprésentable pour les Comédiens, qui la jouent de manière grotesque et théâtrale, alors que pour les Personnages, c'est une douleur vive et immuable. Pirandello montre ici l'incapacité du théâtre traditionnel à capturer la vérité intérieure et la complexité morale.

3. L'Apparition de Madame Pace
La tenancière de la maison de couture, Madame Pace, apparaît comme par magie, provoquée par la "mise en scène" et le désir des Personnages. Elle est immédiatement reconnue par la Belle-Fille et le Père.
C'est un moment quasi-surnaturel qui confère aux Personnages un pouvoir créateur. Cela renforce l'idée qu'ils possèdent leur propre réalité et leur propre "drame" organique, indépendant de la volonté du Directeur. Le théâtre devient un lieu où la fiction s'impose à la réalité.

4. La Scène du Lacet Vert
Le Père prononce un long et passionné plaidoyer sur la nature des Personnages. Il explique qu'un Personnage est éternel et immuable, alors qu'un être humain est changeant et mortel. Il défend ses actions en invoquant la logique interne de son caractère ("On est quelqu'un... on est aussi un million d'êtres... en raison de toutes les possibilités d'être qui sont en nous").
C'est le cœur philosophique de la pièce. Pirandello, par la voix du Père, expose sa théorie de l'identité multiple et de la supériorité de l'art (le Personnage fixe) sur la vie (l'homme fluctuant). C'est un moment clé de la réflexion sur la relativité de la vérité et de la personnalité.

5. La Scène du "Jeu de la Vérité" et la Mort de l'Enfant
Alors que les Personnages rejouent une scène familiale dans le jardin, le jeune Garçon, muet et désespéré, assiste impuissant à la noyade de sa petite sœur (la Fillette) dans une fontaine. Horrifié, il se retire derrière un arbre et se suicide d'une balle de revolver.
C'est le point culminant tragique. Ce moment est d'une violence inouïe car il montre la fiction en train de "devenir réelle" sur scène. La mort n'est plus jouée ; elle arrive. Les Comédiens, paniqués, ne savent plus distinguer l'illusion de la réalité. C'est la preuve ultime que le drame des Personnages est incontrôlable et trop puissant pour la scène.

6. Le Dénouement et la Disparition - Après la mort du Garçon, la confusion est totale. Le Père s'enfuit en poussant un cri déchirant, la Belle-Fille s'enfuit en riant hystériquement, et les Personnages disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont arrivés. Il ne reste sur scène que les Comédiens et le Directeur, désemparés, qui concluent par la célèbre réplique : "De la fiction ? Mais, bon sang, faites-moi le plaisir de nous donner une bonne réalité à nous autres, et la fiction, alors, vous verrez ce qu'elle deviendra !"
C'est la fin et un échec complet de la représentation ...
Les Personnages, ayant vécu leur drame jusqu'à son terme, quittent le monde des hommes, laissant les "réels" dans un état de confusion et d'impuissance. La frontière entre réalité et fiction est définitivement brouillée, et le public est renvoyé à sa propre quête de sens dans un monde où la vérité est multiple et insaisissable.
En 1924, Pidandello adhère au fascisme et rencontre Mussolini. Personne n'est à l'abri des attraits du pouvoir, quelque soit sa nature. Mais il ne s'engagea jamais activement en politique. Son activité théâtrale internationale l'écartera peu à peu du régime fasciste, dont il supporte mal la suspicion et l'autoritarisme. C'est cependant avec l'appui de Mussolini qu'il fonde, en 1925, le Teatro d'arte di Roma....
Il rencontre Mussolini en 1923 et entretient avec lui des relations directes. En 1925, il est signataire du Manifesto des intellectuels fascistes rédigé par Giovanni Gentile, en opposition au Manifeste des intellectuels antifascistes de Benedetto Croce. Pirandello voit en Mussolini un "homme du destin", un leader fort capable de redonner à l'Italie son prestige et son ordre. Il espère aussi que le régime soutiendra la culture et le théâtre italien, lui offrant une plateforme et des moyens sans équivalent.
Le régime le soutient effectivement. En 1925, Pirandello fonde, avec des financements d'État, le Teatro d'Arte di Roma, qu'il dirige jusqu'en 1928. Cette compagnie lui permet de diffuser son répertoire théâtral en Italie et à l'étranger. Son soutien au régime lui vaut même d'être nommé membre de l'Académie d'Italie en 1929.
Pirandello n'a pas laissé de mémoires détaillés ou d'analyse réflexive profonde sur son engagement. Sa position se lit surtout dans ses actes et ses déclarations publiques, qui sont sans ambiguïté : il défend l'idée d'un art italien soutenu par l'État (nationalisme culturel) et capable de rayonner internationalement. Il voit dans le fascisme un moyen de réaliser ce projet, en rupture avec le système culturel libéral qu'il méprise.
Mais si son soutien semble sincère, il est aussi motivé par un intérêt pragmatique. Le Teatro d'Arte n'aurait pas pu exister sans les subsides de l'État fasciste. On peut y voir une forme de pacte : il obtient les moyens de sa création artistique en échange de sa loyauté politique.
Contrairement à d'autres intellectuels qui se sont éloignés du régime avec le temps (comme Gabriele D'Annunzio ou le même Gentile), Pirandello ne s'est jamais publiquement distancié du fascisme, même lors des épisodes les plus sombres comme les lois raciales de 1938 (promulguées après sa mort en 1936).
Et de fait, la critique a longtemps été divisée sur la manière d'interpréter cet engagement ...
De nombreux critiques, surtout dans l'immédiat après-guerre, ont cherché à "sauver" Pirandello en arguant que son œuvre, par son questionnement radical de la vérité, de l'identité et de l'autorité, est fondamentalement antifasciste dans son essence. Ils soulignent que les thèmes pirandelliens – la relativité de la réalité, la déconstruction du "Moi", la mise en cause des conventions sociales, la folie comme lucidité – sont aux antipodes de l'idéologie fasciste, qui prône l'unité, l'obéissance, la certitude et la force d'une vérité unique imposée par l'État. En somme, "l'artiste de la décomposition" ne pouvait pas être un vrai partisan de l'idéologie totalitaire de la "recomposition".
Une lecture plus récente et nuancée admet la contradiction. Les critiques reconnaissent que Pirandello a véritablement cru que le fascisme pouvait être un instrument de renouveau national et culturel. Ils voient dans son adhésion une forme de désespoir politique et une méfiance profonde envers la démocratie parlementaire, qu'il jugeait corrompue et inefficace. Son besoin d'ordre et sa fascination pour un homme providentiel (Mussolini) l'ont emporté sur la logique de son propre art. Cette approche accepte l'idée qu'un artiste peut créer une œuvre subversive tout en soutenant un régime autoritaire, par un aveuglement politique, un opportunisme ou une conviction profonde mais contradictoire.
Cet épisode a indéniablement nui à la réputation internationale de Pirandello après la guerre, surtout dans les pays anglo-saxons. Son œuvre a été temporairement éclipsée par la suspicion politique. En Italie même, la réhabilitation a été plus rapide, mais le débat n'est jamais complètement clos. Lors des commémorations, la question de son fascisme ressurgit immanquablement.
Aujourd'hui, la majorité des spécialistes séparent son œuvre de son engagement politique, tout en reconnaissant que ce dernier fait partie intégrante de sa biographie et ne peut être ignoré. On étudie son théâtre et ses romans pour leur puissance philosophique et littéraire, tout en contextualisant ses choix politiques dans l'Italie de l'entre-deux-guerres.

Gaspare Giudice, "Pirandello" (1963) est considérée comme la biographie de référence, elle aborde la question avec une grande objectivité et fournit une documentation précieuse sur les relations de Pirandello avec le régime. Grand spécialiste du théâtre italien, Alessandro d’Amico ("Pirandello. Una vita", Bulzoni, 1993) met l’accent sur l’évolution esthétique et philosophique. Une approche critique plus moderne que celle de Giudice, mais plus analytique et universitaire. "Pirandello o la stanza della tortura" (Einaudi, 1981), de Giovanni Macchia, se donne comme une lecture intellectuelle de sa vie et de son œuvre est considéré comme un des essais les plus fins sur la personnalité psychologique de Pirandello. En français, Jean-Paul Manganaro, "Pirandello" (Gallimard, coll. « Monographie », 1997) est publie dans une collection prestigieuse et relie Pirandello à la modernité européenne (Joyce, Proust, Freud)."Understanding Luigi Pirandello" (University of South Carolina Press, 1997), de Fiora A. Bassanese, est la Référence anglophone, claire et académique.
Et pour replacer le "cas Pirandello" dans le contexte plus large des relations entre les intellectuels italiens et le régime mussolinien, Ruth Ben-Ghiat, "Fascist Modernities: Italy, 1922-1945" (2001) est Le classique. Ben-Ghiat étudie comment les intellectuels et les artistes ont négocié leur place et leur créativité au sein du régime. Le chapitre sur Pirandello est fondamental pour comprendre comment il a tenté de concilier modernisme artistique et adhésion politique.
L'éminent historien du fascisme, Emilio Gentile, dans "La Voce e l'Impero. Politica e ideologia nel dramma pirandelliano" (in "La via italiana al totalitarismo", 1995) a analysé comment l'idéologie impériale et nationaliste du régime a trouvé un écho, parfois critique, dans le théâtre de Pirandello. Bien que centrée sur le Duce, la biographie monumentale "Mussolini" de Pierre Milza (1999)éclaire le contexte dans lequel évoluaient les intellectuels comme Pirandello et décrit la stratégie de séduction culturelle mise en place par le régime.

A la fin des années vingt, le théâtre de Pirandello se tourne vers de nouveaux horizons, il tente de recomposer les fractures de la réalité grâce aux vérités absolues, c'est la phase des mythes, comme l'auteur l'a lui-même définie ..
"La Nuova Colonia" (1926), "Lazzaro" (1928), "Les Géants de la montagne" (I giganti della montagna, 1936, inachevé).
Au centre de ce projet, il y a trois grands thèmes : l'organisation sociale, la religion et l'art. Ces trois œuvres se déroulent dans des mondes primitifs, exemplaires, absolus ; on ressent aussi une atmosphère surréelle et métaphysique, comme dans ses dernières nouvelles.
La pensée et l'œuvre de Pirandello se sont éloignées du panorama culturel italien, on y retrouve cependant un pessimisme total et profond, enraciné dans un certain matérialisme et dans une tradition culturelle sicilienne, immobiliste et conservatrice, qui l'éloignent de la politique. Il rencontra une incompréhension totale de la part du public italien et la reconnaissance de son talent vint plus significativement au niveau international : en 1934 il reçoit le prix Nobel et ses pièces - qui marquent un tournant dans le théâtre du XXe siècle - sont représentées depuis sans interruption, dans le monde entier ...

"Chacun sa vérité" (Così è (se vi pare), 1917)
Un village se déchire autour d’un mystère : une femme vit recluse, et personne ne sait si elle est folle, morte ou imaginaire. Vérité relative, impossibilité de connaître autrui, la réalité est multiple et insaisissable ; chacun possède « sa » vérité.
Peu de succès en ses début, celui-ci s'imposera, il est vrai que la pièce déstabilise le public avec son intrigue sans résolution. Le thème central est la relativité de la vérité et l'impossibilité d'atteindre une réalité objective.
"... LE PRÉFET. —Je vous ai fait appeler, mon cher Ponza, pour vous dire que, mes amis et moi... (Il s'interrompt en remarquant que M. Ponza, à ces premiers mots, témoigne d'un grand trouble et d'une vive agitation.) Avez-vous quelque chose à me dire?
PONZA. — Oui, monsieur le préfet, je demande aujourd'hui même mon changement.
LE PRÉFET. — Mais pourquoi donc? Il y a un instant encore, vous parliez avec moi si raisonnablement...
PONZA. •— Monsieur le préfet, je suis ici l'objet de vexations inouïes!
LE PRÉFET.—Mais non, voyons... n'exagérons rien...
AGAZZI. — Des vexations... J'entends que vous vous expliquiez, est-ce que c'est de ma part?
PONZA. — De la part de tout le monde, et voilà pourquoi je m'en vais! Je m'en vais, monsieur le préfet, parce que je ne puis tolérer l'inquisition acharnée, féroce, dont je suis victime dans ma vie privée! Elle finirait par compromettre, par ruiner irréparablement un acte de charité qui me coûte tant de douleur, tant de sacrifices ! Je vénère plus que ma propre mère cette pauvre vieille, et je me suis vu contraint, ici même, hier, à lui parler avec la violence la plus cruelle. Je viens de la trouver chez elle dans un tel état d'accablement et d'agitation...
AGAZZI. — C'est étrange! Avec nous, madame Frôla a toujours parlé très calmement. Vous parlez d'agitation, monsieur Ponza? C'est toujours vous qui nous en avez donné le spectacle et, en ce moment même...
PONZA. — C'est que vous ne savez pas ce que vous me faites souffrir!
LE PRÉFET. — Voyons, voyons... Calmez-vous, mon cher Ponza. Qu'y a-t-il? Je suis là! Et vous
savez avec quelle confiance et quelle sympathie je vous ai toujours écouté, n'est-il pas vrai?
PONZA. — Je vous demande pardon. Oui, vous, monsieur le préfet, et je vous en suis bien reconnaissant.
LE PRÉFET. — Alors, nous disions que vous vénériez comme une mère cette pauvre vieille? Si ces messieurs montrent tant de curiosité, c'est qu'ils s'intéressent eux aussi beaucoup à elle...
PONZA. — Mais ils vont la tuer, monsieur le préfet! Je le leur ai déjà dit plus de vingt fois!
LE PRÉFET. — Un peu de patience. Vous allez voir que tout sera fini dès que les choses auront été mises au clair! Il ne faut qu'un instant, une petite minute! Vous avez un moyen, le moyen le plus simple, le plus sûr de faire cesser tous les doutes de ces messieurs. Je ne parle pas de moi..., moi, je n'ai aucun doute.
PONZA. — Mais ils ne veulent me croire en aucune façon !
AGAZZI. — C'est tout à fait inexact. Quand vous êtes venu ici, après la première visite de votre belle-mère, nous raconter qu'elle était folle, nous vous avons cru. (Au préfet.) Mais comprends-tu, sa belle-mère est revenue tout de suite après...
LE PRÉFET. — Mais oui, mais oui, je sais, tu me l'as déjà raconté. (Il continue, en s'adressant à Ponza.) Oui, elle est venue donner précisément les raisons que vous cherchez vous-même à tenir en éveil chez elle. Il vous faut admettre qu'un doute angoissant peut naître dans l'esprit de ceux qui l'écoutent. En entendant parler votre belle-mère, ces messieurs estiment ne plus pouvoir ajouter foi en toute certitude à ce que vous affirmez. C'est clair, n'est-ce pas?
Et alors vous et votre belle-mère, disparaissez, demeurez un moment à l'écart! Vous êtes sûr de dire la vérité, comme j'en suis sûr moi-même. Vous ne pouvez, j'imagine, vous opposer à ce que cette vérité soit répétée ici par la seule personne qui, en dehors
de vous deux, est à même de la proclamer.
PONZA. — Qui donc?
LE PRÉFET. — Mais votre femme!
PONZA. — Ma femme? (Avec force et indignation.) Ah! ça non! Jamais, monsieur le préfet!
LE PRÉFET. — Et pourquoi, je vous prie?
PONZA. — Amener ma femme ici, pour donner satisfaction à des gens qui ne me croient pas?
LE PRÉFET, l'interrompant. — Non! Il s'agit de moi. Quelle difficulté y voyez-vous?
PONZA. — Mais, monsieur le préfet... Non! ma femme, non! Laissez ma femme où elle est! On n'a qu'à me croire!
LE PRÉFET. — Ah! mais pas du tout, je commence à me dire moi-même que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'on ne vous croie pas!
AGAZZI. — D'autant plus qu'il a cherché par tous les moyens (et il n'a pas craint, pour cela, de se montrer deux fois impoli envers ma femme et ma fille), il a cherché par tous les moyens à empêcher sa belle-mère de venir nous parler.
PONZA, éclatant, exaspéré. — Mais que voulez-vous de moi, au nom du Ciel? Il ne vous suffit pas de cette malheureuse, il vous faut encore ma femme? Monsieur le préfet, je ne supporterai pas cette violence! Ma femme ne sortira pas de chez moi! Je ne la jette aux pieds de personne! Il me suffit qu'elle ait confiance en moi ! Et d'ailleurs, je vais de ce pas
faire ma demande de changement!
LE PRÉFET. — Un moment! Tout d'abord, je ne tolère pas, monsieur Ponza, que vous preniez un ton pareil devant un de vos supérieurs, et devant moi-même qui vous ai toujours parlé avec la plus grande déférence. En second lieu, je vous répète que votre obstination à refuser une épreuve que je vous demande — moi-même, et non pas un autre — dans votre propre intérêt et où je ne vois rien de mal, me donne beaucoup à penser! Nous pouvions fort bien, moi et mon ami Agazzi, recevoir votre femme... ou, si vous préférez, aller jusque chez vous...
PONZA. — Vous prétendez me contraindre? ..."
L'Intrigue - Dans une petite ville de province italienne, un nouveau fonctionnaire, M. Ponza, arrive avec son épouse. Sa belle-mère, Mme Frola, vit séparément dans un autre immeuble. Cette situation banale devient rapidement un scandale pour la communauté, car les deux personnages donnent des versions totalement incompatibles de leur réalité :
La version de M. Ponza : celui-ci affirme que sa première femme (la fille de Mme Frola) est morte, et que Mme Frola, folle de chagrin, croit qu'elle est toujours en vie. Pour l'apaiser, il s'est remarié avec sa seconde femme (qu'il présente à tous) et laisse Mme Frola croire que c'est sa fille. La version de Mme Frola soutient au contraire que c'est M. Ponza qui a perdu la raison après une maladie. Il croit que sa femme (sa fille à elle) est morte et qu'il s'est remarié. Pour ne pas le contrarier et pouvoir continuer à voir sa fille, elle joue le jeu et fait semblant de croire que la femme actuelle de Ponza est sa seconde épouse. Les bourgeois de la ville, menés par le commissaire Agazzi, se transforment en "détectives de la vérité", obsédés par découvrir laquelle des deux versions est la bonne. Ils interrogent, espionnent et mettent la pression sur le couple et la belle-mère, sans succès.
À la fin, poussée à bout, l'épouse de M. Ponza (le personnage au cœur du mystère) apparaît, voilée. Sous la pression de la foule, elle déclare que pour elle, elle est à la fois la fille de Mme Frola et la seconde femme de M. Ponza. En d'autres termes, elle est celle que les autres croient qu'elle est. Elle affirme qu'ils ont tous raison dans leur version, car la vérité n'est que ce qu'on perçoit et ce à quoi on croit. Elle lève son voile, mais il est trop tard : la "vérité" sur son visage est devenue inaccessible et sans importance. La pièce se termine sur la réplique célèbre de Laudisi, le personnage sceptique qui sert de porte-parole à Pirandello : "Et maintenant, mesdames et messieurs, vous la connaissez, la vérité !" (sous-entendu, vous ne connaissez que vos propres préjugés).
Une critique féroce de la curiosité malsaine, du conformisme social et une démonstration brillante que la vérité n'est pas une, mais multiple et subjective, dépendante de la perception de chacun. C'est une pièce fondatrice du théâtre moderne qui remet en cause la notion même de réalité.
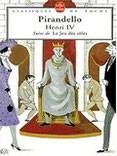
"Henri IV" (Enrico IV, 1922)
Un homme, après une chute de cheval, se croit empereur du Saint-Empire. Guéri, il décide de continuer à jouer ce rôle pour ne pas affronter la vacuité de la vie réelle.
Folie et lucidité, rôle et identité, vérité et illusion, le héros choisit la fiction comme refuge contre la douleur du réel — il devient conscient de sa propre illusion et s’y enferme volontairement.
Un immense succès critique et public. La pièce confirme Pirandello comme un des dramaturges majeurs d’Europe.

"L'Imbécile" ( L'Imiolé, 1922)
Qui sommes-nous vraiment ? Sommes-nous notre "moi" intérieur ou la somme des rôles que nous jouons pour les autres ? Une pièce profonde et complexe de Luigi Pirandello, moins connue que "Six personnages en quête d'auteur" ou "Chacun sa vérité", mais centrale dans la réflexion de l'auteur sur l'identité et le rôle social. La pièce met en évidence le conflit entre "vie" authentique et "forme" imposée par la société. Le titre, "L'Imbécile", ne se réfère pas à un manque d'intelligence, mais à l'incapacité ou au refus d'un personnage de jouer le rôle que les autres attendent de lui. Le personnage central est Vitangelo Moscarda, un homme riche qui mène une vie apparemment normale.
Un jour, un de ses associés, Stefano Firbo, lui rapporte une conversation blessante. Moscarda apprend que dans son dos, on le surnomme "le Grand-Singe" (il Gran Bertone), non seulement pour son apparence physique, mais aussi parce qu'on le considère comme un homme borné, défini uniquement par son rôle de prêteur et de mari.
Cette révélation le plonge dans une crise existentielle. Il réalise que les gens ne le voient pas tel qu'il est, mais à travers une image figée, un "rôle" qu'ils lui ont collé : Moscarda le riche, Moscarda le mari, Moscarda le créancier. Il comprend qu'il n'a pas d'identité propre en dehors de ces étiquettes.
Pour briser cette "forme" et retrouver son "moi" authentique, Moscarda décide de semer le chaos dans la perception que les autres ont de lui. Il entreprend des actions délibérément absurdes et destructrices,
- Il décide de ruiner ses affaires et de distribuer son argent, anéantissant ainsi son image d'homme riche et avare.
- Il provoque un scandale avec sa femme, Dida, en lui révélant un prétendu amour ancien pour une autre femme, afin de briser l'image du mari fidèle et prévisible.
- Il cherche à aider une famille pauvre, les Quaderni, dont il possède la maison, mais sa tentative maladroite et radicale tourne au désastre.
Au final, au lieu de le libérer, ses actions le conduisent à l'isolement et sont interprétées par tous comme la preuve de sa folie. En voulant détruire les "formes" qui l'emprisonnaient, il a perdu toute place dans la société. La pièce se termine sur son isolement total : sa femme le quitte, ses amis l'abandonnent, et il se retrouve seul, devenu véritablement "l'imbécile" aux yeux du monde.
Une révolution désespérée pour être "authentique" qui se brise contre le mur des conventions sociales, une tragédie moderne sur l'impossibilité d'échapper au regard d'autrui...

"Comme tu me veux" (Come tu mi vuoi, 1930)
Une femme sans mémoire, vivant à Berlin, retrouve son mari italien qui prétend qu’elle est sa femme disparue. Elle doute de son identité : est-elle vraiment cette femme ?
Identité incertaine, métamorphose, regard des autres, l’être humain n’existe que dans les « masques » qu’il porte pour autrui.
Une pièce bien accueilli, notamment grâce à l’interprétation de Marta Abba, muse et confidente de Pirandello (La relation entre Pirandello et Abba était intense et profonde, alimentant les spéculations: elle était sans doute amoureuse, mais surtout fondée sur une profonde compréhension artistique et intellectuelle. Pirandello lui a écrit plus de 500 lettres, qui constituent un témoignage extraordinaire sur sa pensée créative, ses doutes et son affection pour elle).
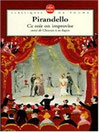
"Ce soir on improvise" (Questa sera si recita a soggetto, 1930)
Les acteurs d’une troupe refusent de suivre le texte du metteur en scène et improvisent. Bientôt, le jeu dégénère, les passions réelles prennent le dessus. Théâtre dans le théâtre, liberté artistique, perte de contrôle de la fiction, un prolongement de "Six personnages en quête d’auteur" : Pirandello y pousse plus loin la confusion entre réalité et représentation.
Le succès fut considérable sur le plan intellectuel, mais le public resta parfois dérouté par sa structure éclatée.
" ... Je suis navré du désordre momentané dont le public a pu se rendre compte derrière le rideau avant la représentation, et je vous prie de m’en excuser; encore que, peut-être, si l’on voulait prendre et considérer cela comme un prologue involontaire...
- Le Spectateur des fauteuils d’orchestre, l’interrompant, très satisfait : Ah, très bien ! Je l’avais bien dit!
- Doktor Hinkfuss, avec une froide dureté : Monsieur a quelque chose à faire observer?
- Le Spectateur des fauteuils d’orchestre : Non, rien ! Je suis content de l’avoir deviné.
- Doktor Hinkfuss : D’avoir deviné quoi?
- Le Spectateur des fauteuils d’orchestre : Que ces bruits faisaient partie du spectacle.
- Doktor Hinkfuss : Ah, oui? Vraiment? Vous avez pensé que ces bruits étaient de la comédie? Et précisément ce soir où je me suis proposé de jouer cartes sur table ! Détrompez-vous, cher monsieur. J’ai dit prologue involontaire et, j’ajoute, pas tout à fait déplacé, peut-être, pour le spectacle insolite auquel vous allez assister. Je vous prie de ne pas m’interrompre.
Voyez, mesdames et messieurs. (Il tire de sous son bras le petit rouleau.) Dans ce petit rouleau de quelques pages, j’ai tout ce dont j’ai besoin. Presque rien. Une brève nouvelle, ou guère plus, à peine dialoguée par-ci par-là par un auteur qui ne vous est pas inconnu.
- Des spectateurs dans la salle : Son nom ! Son nom !
- Un spectateur de la galerie : Qui est-ce ?
- Doktor hinkfuss : Je vous en prie, mesdames et messieurs, je vous en prie. Je ne me suis pas du tout proposé de convoquer les spectateurs à un débat public. Je veux bien répondre de ce que j’ai fait; mais je ne puis admettre que vous m’en demandiez compte durant la représentation.
- Le Spectateur des fauteuils d’orchestre : Elle n’est pas encore commencée.
- Doktor hinkfuss : Si, monsieur, elle est commencée. Et celui qui a le moins le droit de ne pas le croire, c’est bien vous qui, au début, avez pris ces bruits pour le commencement du spectacle. La représentation est conunencée, puisque, moi, je suis là devant vous.
- Le Spectateur âgé, de sa loge, congestionné : Je croyais, moi, que c’était pour nous présenter vos excuses pour le scandale inouï que sont ces bruits. Du reste, je vous signale que je ne suis pas venu pour entendre de vous une conférence.
- Doktor Hinkfuss : Il n’est pas question de conférence ! Pourquoi osez-vous croire et crier aussi fort que je suis là pour vous faire entendre une conférence ?
(Le spectateur âgé, fort indigné par cette apostrophe, se lève brusquement et sort de sa loge en grommelant.)
Oh, vous pouvez vous en aller, vous savez ! Personne ne vous retient. Je suis là, mesdames et messieurs, uniquement pour vous préparer à tout cet insolite auquel vous allez assister ce soir. Je pense mériter votre attention. Vous voulez savoir qui est l’auteur de cette brève nouvelle? Je pourrais très bien vous le dire.
- Des spectateurs dans la salle ; Mais, si ! dites-le ! dites-le !
- Doktor Hinkfuss : Eh bien, voilà, je le dis : Pirandello.
- Des cris dans la salle : Ouh ! Ouh !...
Le Spectateur de la galerie, d'une voix très forte, dominant les cris : Et qui c’est, celui-là?
De nombreux spectateurs, à l’orchestre, dans les loges et au parterre, se mettent à rire.
- Doktor Hinkfuss, riant un peu, lui aussi : Eh oui, toujours lui; incorrigiblement! Mais, si deux fois déjà il a fait le coup à deux de mes collègues, en envoyant à l’un, la première fois, six personnages égarés, en quête d’auteur, qui ont provoqué une révolution sur la scène et ont fait perdre la tête à tout le monde, et en présentant traîtreusement, la seconde fois, une pièce à
clé, à cause de laquelle mon collègue a vu son spectacle faire un four auprès du public tout entier révolté ; cette fois-ci il n’y a pas de danger qu’il fasse à nouveau le coup avec moi. Soyez tranquilles. Je l’ai éliminé. Son nom ne figure même pas sur les affiches, et aussi parce qu’il aurait été injuste, de ma part, de le rendre responsable, si peu que ce soit, du spectacle de ce
soir. Le seul responsable, c’est moi.
J’ai pris une de ses nouvelles, comme j’aurais pu prendre celle d’un autre. J’ai préféré prendre l’une des siennes, parce que, parmi tous les auteurs dramatiques, il est peut-être le seul qui ait paru comprendre que l’œuvre de l’auteur est terminée au moment même où il a fini d’en écrire le dernier mot. Il répondra de cette œuvre comme sienne devant le public des lecteurs et devant la critique littéraire. Il ne peut ni ne doit en répondre devant le public des spectateurs ni devant messieurs les critiques dramatiques, qui jugent en venant voir au théâtre.
- Des voix, dans la salle : Ah, il ne peut pas ? C’est la meilleure !
- Doktor Hinkfuss : Non, mesdames et messieurs. Car, au théâtre, l’œuvre de l’écrivain n’existe plus.
- Le Spectateur de la galerie : Et qu’est-ce qu’il y a, alors?
- Doktor Hinkfuss : La création scénique que j’en aurai fait, moi, et qui est de moi seul. Je prie à nouveau le public de ne pas m’interrompre. Et je vous préviens (car j’ai vu sourire certains de ces messieurs les critiques) que c’est là ma conviction. Ces messieurs les critiques sont parfaitement libres de ne pas en tenir compte et de continuer de s’en prendre injustement à l’écrivain, lequel, toutefois, ils le reconnaîtront, aura tout de même le droit de sourire de leurs
critiques comme eux le font maintenant de la conviction qui est la mienne ; cela, au cas, naturellement, où leurs critiques seraient défavorables ; car, dans le cas contraire, c’est l’auteur qui serait injuste en prenant pour lui les éloges qui me reviennent à moi.
Ma conviction est fondée sur de solides raisons.
L’œuvre de l’auteur? voilà, elle est là. (Il montre le petit rouleau de papier.) Et qu’est-ce que j’en fais, moi? J’en fais le matériau de ma création scénique et je m’en sers, comme je me sers du talent des acteurs que j’ai choisis pour jouer les rôles selon l’interprétation que moi j’en aurai donné; et comme je me sers des décorateurs, à qui je commande de faire les plans des décors ou de les peindre ; et comme je me sers des machinistes qui montent les décors ; et des électriciens qui les éclairent ; comme de tous, qui suivent les directives, les idées, les indications qui auront été données par moi.
Dans un autre théâtre, avec d’autres acteurs et d’autres décors, avec un autre dispositif scénique et d’autres éclairages, la création scénique, vous me l’accorderez, sera certainement différente. Et vous ne croyez pas que cela prouve bien que ce qu’on juge au théâtre, ce n’est jamais l’œuvre de l’écrivain (laquelle, en son texte, est unique), mais telle ou telle création scénique qu’on en a tiré, toutes différentes l’une de l’autre ; que les créations scéniques sont légion, tandis que l’œuvre est une ? Pour juger le texte, il faudrait le connaître ; et, au théâtre, il est impossible de le connaître, à travers une interprétation qui, donnée par tels acteurs sera une chose et, donnée par tels autres acteurs, sera forcément autre chose. Pour qu’il n’y ait pas de différence, il faudrait que l’œuvre puisse se produire toute seule, non plus avec les acteurs, mais avec ses personnages mêmes, qui, par miracle, prendraient un corps et une voix. Dans un tel cas, oui, l’œuvre de l’auteur pourrait être directement jugée au théâtre.
Mais un tel miracle est-il jamais possible ? On n’a jamais vu cela, jusqu’ici.
Et alors, mesdames et messieurs, il y a ce que, en y mettant plus ou moins de lui-même, s’ingénie à réaliser chaque soir, avec ses acteurs, le metteur en scène. Pas d’autre possibilité..."
Comédie en trois actes représentée en 1930 et qui appartient à la trilogie que Pirandello a appelée "Du théâtre dans le théâtre", et qui présente tous les conflits possibles entre les divers éléments d'un spectacle : auteur, directeur, personnages et spectateurs. A cette trilogie sur l'essence du drame áppartiennent "Six personnages en quête d 'auteur" et "On ne sait jamais tout". Ici, nous ne trouvons pas les personnages en opposition avec les acteurs ni les spectateurs en face des acteurs comme dans les deux autres parties de la trilogie, mais bien les acteurs ligués contre le metteur en scène.
Dans l'œuvre complète de Pirandello, cette comédie se détache par sa fougue et par les dialogues prestigieux propres à l'écrivain sicilien.
Hinkfuss, le metteur en scène, monte un spectacle tiré d'une nouvelle de Pirandello : "Adieu, Léonore". Le thème en est la jalousie. Le metteur en scène peu soucieux de respecter l'esprit de l'œuvre ne songe qu'à défendre sa création. Il rabaisse le drame dans une mise en scène d'un goût extravagant. Les acteurs, à qui l'on dicte un jeu de scène bien défini, refusent de jouer comme des marionnettes; ils prétendent s'inspirer du texte, se laisser guider par la passion. Le conflit entre les acteurs et le metteur en scène reste latent et toujours contenu ; il ne s'exprime qu'à travers une longue (trop longue) diatribe dirigée contre la mise en scène du XXe siècle, ce qui permet à Pirandello des effets scéniques sensationnels.
Ce n'est que lorsque les acteurs sont laissés à eux-mêmes que le drame reprend et éclate : Rico Verri a épousé Mommina, une des quatre sœurs qui logeaient trop aimablement les officiers cantonnés dans le pays. Mais à peine l'a-t-il épousée, qu'il est jaloux d'un passé dont il ne peut se rendre maître. Il enferme sa femme, lui interdit de se faire belle et même de se coiffer : il espère ainsi tuer l'image de celle qui ne fut que trop courtisée chez son père. Une des sœurs, devenue actrice, revient au pays pour jouer dans "La Force du destin". Quant à Mommina, elle n'est plus aujourd'hui qu`un pauvre déchet humain. Le souvenir de sa jeunesse lui revient : quand elle allait au théâtre avec ses sœurs, elle était alors jeune et belle. Le passé ressuscite pendant que se déroule l'opéra.
C'est un des procédés les plus suggestifs de Pirandello ; en effet en même temps que l'héroïne raconte aux enfants l'histoire de l'opéra, c`est toute l`histoire de sa jeunesse qu'elle évoque, et elle leur chante "Adieu, Léonore". Mais quand l'actrice qui représente Mommina arrive au moment le plus douloureux de sa vie, elle tombe à la renverse, tuée par la puissance même de son interprétation. Le metteur en scène intervient alors pour affirmer, triomphant, sa propre conception du spectacle purement spectaculaire. (Trad. Gallimard, 1954 et dans La Pléiade, t. II, 1985).
"... Pour enlever à ce que je dis toute apparence de paradoxe, je vous invite à considérer qu’une œuvre d’art est à jamais fixée dans une forme immuable qui représente la délivrance de l’auteur dans le travail d’enfantement qu’est toute création; la paix parfaite que l’on atteint au terme de tous les tourments de ce travail d’enfantement.
Bien.
Croyez-vous, mesdames et messieurs, qu’il puisse encore y avoir de la vie là où plus rien ne bouge? là où tout repose dans une paix parfaite? La vie doit obéir à deux nécessités qui, étant donné qu’elles sont opposées entre elles, ne lui permettent ni de se fixer définitivement ni de toujours se transformer.
Si la vie se transformait toujours, elle ne se fixerait jamais; et si elle se fixait définitivement elle ne se transformerait plus. Et la vie, il faut qu’elle se fixe et qu’elle se transforme.
L’auteur se fait des illusions lorsqu’il croit avoir trouvé la délivrance et atteint la paix en fixant pour toujours son œuvre d’art dans une forme immuable. Il a seulement fini de vivre cette œuvre qui est la sienne. La délivrance et la paix, il faut avoir fini de vivre pour y parvenir.
Et tous ceux qui ont trouvé et atteint la délivrance et la paix se bercent de cette pitoyable illusion : croire qu’ils sont encore vivants; alors qu’en réalité ils sont à tel point morts qu’ils ne se rendent même plus compte de la puanteur de leur propre cadavre.
Si une œuvre d’art survit, c’est seulement parce que nous pouvons encore l’arracher à la fixité de sa forme ; transformer au-dedans de nous cette forme qui est sienne en mouvement vital ; et alors, la vie, c’est nous qui la lui donnons; différente d’une fois à l’autre, et diverse de l’un à l’autre d’entre nous; une foule de vies, et non une seule; comme on peut le déduire des sempiternelles discussions qui ont lieu à ce propos et qui naissent du fait que l’on ne veut précisément pas croire ceci : que c’est nous qui donnons cette vie; si bien qu’il n’est absolument pas possible que la vie que je donne, moi, soit la même que celle qui vient d’un autre. Je vous prie de m’excuser, mesdames et messieurs, pour le long détour que j’ai dû faire pour en venir à cela, qui est le point auquel je voulais arriver.
Quelqu’un pourrait me demander :
«Mais qui vous a dit, à vous, que l’art doive être la vie ?
La vie, il est vrai, doit obéir aux deux nécessités opposées dont vous avez parlé, et c’est pour cette raison qu’elle n’est pas de l’art; de même que l’art n’est pas la vie justement parce qu’il réussit à se libérer de ces nécessités opposées et qu’il se fixe pour toujours dans l’immutabilité de sa forme. Et c’est bien pour cela que l’art est le domaine de la création accomplie, tandis que la vie est, conformément à ce qu’elle doit être, en formation, en une formation infiniment variée et continuellement changeante.
Chacun de nous essaie de se créer lui-même et de créer sa propre vie grâce aux mêmes facultés de l’esprit que celles avec lesquelles l’auteur crée son œuvre d’art. Et, de fait, ceux qui sont le plus richement dotés de ces facultés et qui savent le mieux les utiliser réussissent à atteindre une condition supérieure et à la fixer le plus durablement.
Mais il ne s’agira jamais d’une véritable création, avant tout parce qu’elle est destinée à périr et à passer avec nous dans le temps; ensuite parce que, comme elle vise un but à atteindre, elle ne sera jamais libre; et enfin parce que, du fait qu’elle est exposée à tous les hasards imprévus et imprévisibles, à tous les obstacles que lui opposent les autres, elle risque constamment d’être contrariée, déviée, déformée. En un certain sens, l’art venge la vie, car sa création est une création véritable dans la mesure où elle est libérée du temps, des hasards et des obstacles, sans autre fin qu’elle-même. »
Oui, mesdames et messieurs, moi, je réponds : il en est bien ainsi. ..."
On parle de "pirandellisme" pour désigner l’ensemble des thèmes, des procédés et des obsessions caractéristiques du théâtre de Pirandello : la crise de l’identité, la relativité de la vérité, la frontière floue entre réalité et illusion, le théâtre dans le théâtre, la mise en abyme de la création artistique.
Ce style a eu un tel succès qu’il est devenu presque une étiquette, une « formule » qu’on a associée à son nom. Or, Pirandello lui-même a fini par se sentir enfermé dans ce système
"Ce soir on improvise" illustre, a-t-on dit, parfaitement à quel point le "pirandellisme" a étouffé Pirandello, transformant son art en système, en formule, et l'on a vu cette pièce comme une tentative (consciente) désespérée de briser la forme devenue tyrannique. Le metteur en scène Hinkfuss, figure autoritaire, impose une structure, tandis que les acteurs se révoltent pour retrouver la vie et la vérité, exactement comme Pirandello lutte contre la rigidité de son propre système artistique. Mais en cherchant à s’en libérer, il reproduira encore et toujours les mêmes thèmes ...

Pirandello,"Novelle"
Lorsque Pirandello décide de rassembler toutes les nouvelles qu'il a déjà publiées et toutes celles encore à venir sous le titre "Nouvelles pour une année" (Novelle per un anno), il a l'ambition d'une oeuvre unique et monumentale, qui, telles les Mille et une Nuits, n'aurait ni début ni fin. Aux éditions Gallimard (l'excellente collection Quarto) seront publiées pour la première fois, l'édition intégrale en français des 237 nouvelles - dont de nombreuses inédites - qu'il a écrites tout au long de sa vie, et jusqu'à la veille de sa mort (elles ont été publiées pour la plupart dans des journaux et revues entre 1884 et 1936, puis regroupées en volumes) ...
Pirandello a commencé par écrire des nouvelles bien avant de se consacrer pleinement au théâtre. Beaucoup de ses pièces les plus célèbres sont d'ailleurs des adaptations de ses propres nouvelles. La nouvelle était pour lui un terrain d'expérimentation pour ses thèmes de prédilection. C'est en effet dans ses Novelle qu'il a développé et affiné les grands thèmes qui caractérisent son œuvre : la relativité de la vérité, la fragmentation de l'identité, la folie, la contradiction entre l'« être » et le « paraître », et la critique de la société bourgeoise. La forme courte de la nouvelle convenait parfaitement à son art de la "chute" et de la révélation soudaine, qui ébranle la réalité perçue par le personnage et le lecteur.
Pirandello lui-même considérait ces deux activités comme complémentaires et essentielles. Il disait avoir en lui "deux diables, l'un dramatique et l'autre narratif" qui cohabitaient.
Parmi les 250 nouvelles, certaines se détachent par leur force, leur influence ou parce qu'elles sont devenues le point de départ de ses pièces les plus célèbres ..

"Il fu Mattia Pascal" (Feu Mathias Pascal)
C'est la plus célèbre de ses œuvres narratives, souvent considérée comme un roman mais d'abord parue en feuilleton. C'est un pilier de sa bibliographie. Mattia Pascal, un homme étouffé par sa vie, profite d'une erreur d'identification (on le croit mort noyé) pour recommencer sa vie sous un nouveau nom. Mais il découvre qu'une identité sociale ne se recrée pas si facilement. Il est piégé dans un non-espace, ni mort ni vraiment vivant. Cette nouvelle explore de façon géniale le thème de l'identité sociale et de l'impossibilité d'échapper à son passé...

"La carriola" (La Brouette)
C'est un chef-d'œuvre de la forme courte, souvent cité comme l'exemple parfait de la technique pirandellienne. Un homme d'affaires sérieux se retrouve, lors d'une réception mondaine, à devoir imiter une brouette pour amuser les enfants. Cette humiliation publique lui révèle soudain le fossé entre son "moi" social et son "moi" intérieur, le plongeant dans une crise existentielle. C'est la quintessence du dédoublement de la personnalité et de la critique de l'hypocrisie bourgeoise.
"Quand il y a quelqu’un, je ne la regarde jamais, mais je sens qu’elle me regarde, me regarde, me regarde sans me lâcher un instant des yeux. Je voudrais lui faire comprendre en tête-à-tête que ce n’est rien, qu’il n’y a pas à s’en faire, qu’il m’était impossible de me permettre avec d’autres cet acte fort bref qui à ses yeux n’a aucune importance alors que c’est tout pour moi. Je l’accomplis chaque jour au moment favorable dans le plus grand secret avec une joie effrayante parce que j’y savoure, tout tremblant, la volupté d’une divine et consciente folie qui pendant un instant me libère et me venge de tout.
Je devais avoir l’assurance (que je ne pouvais, me semble-t-il, obtenir qu’avec elle) que cet acte ne serait pas découvert. Car s’il l’était, les dommages qui en découleraient, et pas seulement pour moi, seraient incalculables. Je serais un homme fini. Peut-être qu’on m’attraperait, qu’on me ligoterait, qu’on me traînerait dans un asile de fous. Tout cela avec des visages atterrés.
La terreur qui s’emparerait de chacun si mon acte était découvert, eh bien je la fis maintenant dans les yeux de ma victime.
À moi sont confiés la vie, l’honneur, la liberté, les biens d’une foule innombrable de gens qui m’assiègent du matin au soir pour tirer de moi travail, conseils, assistance. D’autres devoirs très élevés, publics et privés, pèsent encore sur mes épaules : j’ai femme et enfants qui souvent ne se conduisent pas comme ils devraient et qui ont donc besoin d’être continuellement réfrénés par ma sévère autorité, par l’exemple constant de mon inflexible et irréprochable obéissance à chacune de mes obligations, toutes plus sérieuses les unes que les autres, de père, de mari, de citoyen, de professeur de droit, d’avocat. Horreur donc, si l’on découvrait mon secret !
Ma victime est incapable de parler, voilà qui est vrai. Toutefois, depuis quelques jours, je ne me sens plus en sécurité. Je suis abattu et inquiet. Car s’il est vrai qu’elle ne peut pas parler, elle me regarde, me regarde avec de tels yeux et dans ces yeux la terreur se lit si clairement que je crains que d’un moment à l’autre quelqu’un puisse s’en apercevoir et être incité à en chercher la raison.
Je serais, je le répète, un homme fini. La valeur de l’acte que j’accomplis ne peut être estimée et appréciée que d’un très petit nombre : ceux à qui la vie se serait révélée d’un coup comme elle s’est révélée à moi.
Le dire et le faire comprendre n’est pas chose facile. Je vais m’y essayer.
Il y a quinze jours, je revenais de Pérouse où je m’étais rendu pour des affaires intéressant ma profession.
Une de mes obligations les plus lourdes est celle de ne pas prêter attention à la fatigue qui m’écrase, au poids énorme de tous les devoirs qui me sont et qu’on m’a imposés, et de ne point me laisser aller, fût-ce si peu que ce soit, au besoin d’un rien de distraction que mon esprit surmené réclame de temps en temps. L’unique distraction que je puisse m’accorder quand je me sens par trop vaincu par la fatigue que m’occasionne une affaire dont je m’occupe depuis longtemps est de m’attaquer à une autre.
C’est pourquoi j’avais emporté en train, dans une serviette de cuir, quelques récents papiers à étudier. À une première difficulté rencontrée en cours de lecture, j’avais levé les yeux et les avais tournés vers la fenêtre du compartiment. Je regardais dehors mais je ne voyais rien : cette difficulté m’absorbait.
À dire vrai, je ne pourrais dire que je ne voyais rien. Les yeux voyaient. Ils voyaient et peut-être jouissaient-ils pour eux seuls de la campagne ombrienne pleine de grâce et de suavité. Mais moi, c’est certain, je ne prêtais aucune attention à ce que les yeux voyaient.
À ceci près que peu à peu commença à diminuer en moi l’attention que je prêtais à la difficulté qui m’occupait sans que pour autant se révèle davantage à moi le spectacle de la campagne qui défilait pourtant sous mes yeux, limpide, léger, reposant.
Je ne pensais pas à ce que je voyais et je ne pensai plus à rien : je restai pour un temps incalculable comme en un étrange et vague état de suspens, pourtant clair et paisible. Aéré. Mon esprit s’était comme séparé des sens à une distance infinie où il percevait à peine, on ne sait comment, avec une sensation de délice qui ne lui semblait pas être la sienne, le fourmillement d’une vie différente, autre que la sienne, mais qui aurait pu être la sienne, ni ici ni maintenant mais là-bas, à cette distance infinie ; vie perdue dans le passé qui avait peut-être été la sienne, il ne savait ni comment ni quand, dont le souvenir l’effleurait de son souffle, un souvenir indistinct moins d’actions et de décors que presque de désirs aussitôt disparus qu’apparus ; avec la douleur de ne pas être, angoissante, vaine et pourtant pénible, cette douleur même des fleurs, peut-être, qui n’ont pas pu éclore : bref, le fourmillement d’une vie qui était offerte à vivre là, très loin, où elle se signalait par des éclairs de lumière et des palpitations ; mais elle n’était pas née et en elle l’esprit alors, ah oui, se serait retrouvée entièrement et pleinement, pas seulement pour jouir mais pour souffrir aussi, mais de souffrances qui vous appartiennent en propre.
Peu à peu mes yeux se fermèrent sans que j’y prenne garde et peut-être ai-je poursuivi dans le sommeil le rêve de cette vie qui n’était pas née. Je dis peut-être parce que quand je me réveillai déjà presque à destination tout courbaturé, la bouche amère, âcre et sèche, je me retrouvai d’un coup dans un tout autre état d’âme, la vie me donnant une atroce sensation d’étouffement, en proie à un morne abrutissement de plomb où l’aspect des choses les plus quotidiennes m’apparut comme vidé de tout sens bien qu’à mes yeux d’une pesanteur cruelle, insupportable.
C’est dans cet état que je descendis du train à la gare, montai dans mon automobile qui m’attendait à la sortie et pris le chemin de la maison.
Eh bien, cela eut lieu dans l’escalier, cela eut lieu sur le palier, devant ma porte.
Je vis soudain devant cette porte sombre, couleur de bronze, avec la plaque de cuivre ovale portant gravé mon nom précédé de mes titres et suivi de mes attributions scientifiques et professionnelles, je vis donc soudain comme de l’extérieur ma propre personne et ma vie mais sans me reconnaître ni la reconnaître pour mienne.
Effroyablement soudaine, la certitude s’imposa à moi que l’homme qui se tenait devant cette porte, sa serviette de cuir sous le bras, qui habitait là dans cet appartement, ce n’était pas moi, n’avait jamais été moi...."

"Il treno ha fischiato..." (Le train a sifflé...)
Une des plus émouvantes et poétiques. Elle montre que l'évasion par l'imagination peut être un salut face à l'aliénation. Un modeste comptable, écrasé par une vie monotone et des soucis familiaux, est au bord de la folie. Un soir, en entendant le sifflet d'un train, il s'évade par la pensée vers des paysages lointains. Cette brève évasion mentale lui permet de retrouver un équilibre et de supporter sa condition. C'est une illustration du pouvoir salvateur de l'imaginaire.
"Il délirait. Début de fièvre cérébrale, avaient dit les médecins. Et c’est ce que répétaient ses camarades de bureau revenant à deux ou trois de l’hospice où ils étaient allés le voir. Ils semblaient éprouver un plaisir tout particulier à annoncer cette nouvelle en usant de ces termes scientifiques tout frais recueillis de la bouche des médecins à tel collègue retardataire rencontré sur le chemin :
— Folie furieuse ! Folie furieuse !
— Encéphalite.
— Inflammation de la membrane.
— Fièvre cérébrale.
Ils voulaient paraître désolés. Mais au fond, quel contentement, ne fût-ce qu’à l’idée du devoir accompli, sortis qu’ils étaient, crevant de santé, de ce triste hospice sous le gai ciel d’azur de cette matinée d’hiver.
— Il va mourir ? Devenir fou ?
— Bah !
— Mourir non, ça n’a pas l’air…
— Mais que dit-il ? Que dit-il ?
— Toujours la même chose. Il délire…
— Pauvre Belluca !
Il ne venait à l’esprit de personne qu’étant donné les conditions exceptionnelles dans lesquelles ce malheureux vivait depuis tant d’années, son cas pouvait être aussi le plus naturel des cas et que tout ce qu’il disait, qu’on prenait pour du délire, un symptôme de folie furieuse, pouvait être également la très simple explication de ce plus naturel des cas.
Certes, le fait que la veille au soir Belluca avait violemment tenu tête à son chef de bureau et que, durement rappelé à l’ordre, il s’en était fallu de peu qu’il lui tombât sur le paletot renforçait la supposition qu’il s’agissait ni plus ni moins d’une aliénation mentale.
Car on ne pouvait imaginer homme plus paisible et soumis, plus méthodique et patient que Belluca.
Circonscrit, oui, voilà le mot. Qui l’avait ainsi défini ? Un de ses collègues de bureau. Circonscrit, pauvre Belluca, entre les étroites limites de son aride besogne de comptable, sans autre mémoire que comptes ouverts, parties simples, parties doubles et ristournes, défalcations, prélèvements, enregistrements, écritures, comptes courants, grand livre, paperasseries et j’en passe. Fichier ambulant ou, pour mieux dire, âne chargé d’ans qui, affligé de grandes œillères, tire la charrette sans piper mot du même pas, sur la même route, éternellement.
Eh bien ce vieil âne plus de cent fois avait connu le fouet et le bâton sans pitié, comme ça pour rire, pour le plaisir de se rendre compte s’il était possible de lui faire prendre un peu la mouche ou tout au moins dresser un peu ses oreilles rabattues, sinon faire mine de lever le pied pour décocher quelque ruade. Peine perdue ! Coups de fouet non mérités et cruels mauvais traitements, il avait tout accepté, tranquillement, sans un soupir, perpétuellement, comme s’il se fût agi de son lot ou mieux encore comme s’il n’avait plus rien senti, habitué qu’il était à supporter depuis des années les continuelles et solennelles bastonnades du destin.
Inconcevable vraiment donc ce mouvement de révolte en lui, sinon comme premier effet d’une subite aliénation mentale.
D’autant plus que la veille au soir, la remontrance était proprement justifiée et le chef proprement en droit de la lui avoir infligée. C’est d’ailleurs avec un drôle d’air, insolite et tout nouveau que déjà dès le matin Belluca s’était présenté et que – chose vraiment énorme, comparable, comment dire ? à l’écroulement d’une montagne – il était arrivé plus d’une demi-heure en retard. On eût dit que son visage s’était tout à coup élargi. Que les œillères tout à coup lui étaient tombées des yeux, lui révélant alentour, soudain mis à découvert, le spectacle de la vie. On eût dit que tout à coup ses oreilles s’étaient débouchées dans lesquelles pour la première fois s’engouffraient des voix, des sons jusqu’ici jamais entendus.
C’est ainsi que le visage hilare, d’une hilarité incertaine et ahurie, il s’était présenté au bureau. Et de toute la journée il n’avait strictement rien fait. Entré chez lui vers le soir et ayant tout examiné, les papiers et les registres :
— Eh bien alors ? avait demandé le chef. Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? Belluca l’avait regardé le sourire aux lèvres, presque d’un air insolent, les mains ouvertes.
— Mais qu’est-ce que cela signifie ? s’était exclamé le chef, s’approchant, l’attrapant par une épaule, le secouant. Hé, Belluca !
— Rien, avait répondu Belluca toujours avec ce sourire mi-insolent mi-imbécile. Le train, monsieur le Chevalier.
— Le train ? Quel train ?
— Il a sifflé...."

"La patente" (La Licence)
Elle a été adaptée en une pièce en un acte très puissante. Elle est représentative de l'ironie tragique de Pirandello. Un homme, Rosso Chiarchiaro, est considéré par tous comme un "jeteur de sort". Plutôt que de lutter contre cette réputation, il décide de l'assumer et demande à l'État une "licence" officielle d'ensorceleur, afin de monnayer cette malédiction. Cette nouvelle dénonce l'absurdité des préjugés et la manière dont la société impose des rôles.
Avec quelles inflexions de voix, quels mouvements d’yeux et de mains le juge D’Andrea, courbé comme quelqu’un qui soutiendrait avec résignation un poids insupportable sur ses épaules, avait coutume de répéter : « Ah ! mon enfant ! » à quiconque lui lançait plaisamment une observation sur sa façon de vivre saugrenue.
"Il n’était pas encore vieux ; une quarantaine d’années à peine ; mais que de choses étranges et presque invraisemblables, quels monstrueux croisements de races, quels mystérieux labeurs séculaires ne fallait-il pas imaginer pour aboutir à une explication approximative du produit humain qui s’appelait le juge D’Andrea !
Et l’on avait l’impression qu’à part sa pauvre et humble histoire familiale si commune, il avait des notions certaines sur ces croisements monstrueux de races d’où lui venait cette tignasse crépue de nègre sur un visage chafouin de Blanc ; et qu’il était au courant de ces mystérieux labeurs séculaires sans fin qui lui avaient accumulé sur un vaste front protubérant ce brouillis de rides en privant presque de la vue ses petits yeux couleur de plomb, puis en tordant sa maigre, sa misérable petite stature.
Ainsi bancal, une hanche plus haute que l’autre, il marchait de biais comme les chiens. Pourtant, moralement parlant, personne ne savait marcher plus droit que lui. Tout le monde était d’accord là-dessus.
Quant à voir, il n’avait guère pu voir beaucoup de choses, le juge D’Andrea, mais il avait beaucoup pensé, et quand les pensées sont le plus tristes, c’est-à-dire la nuit.
Le juge D’Andrea était incapable de dormir.
Il passait presque toutes ses nuits à la fenêtre en brossant d’une main ses cheveux rêches et drus de nègre, les yeux levés vers les étoiles, paisibles et claires, les unes comme des filons de lumière, les autres scintillantes et piquantes ; il mettait les plus vives en rapports idéaux de figures géométriques, de triangles et de carrés et, fermant à moitié les paupières derrière ses lunettes, il saisissait entre ses cils la lumière d’une de ces étoiles, puis entre son œil et l’étoile il établissait un lien, un fil lumineux extrêmement ténu, le long duquel il encourageait son âme à se promener, telle une petite araignée égarée.
Penser ainsi de nuit ne convient guère à la santé. La solennité mystérieuse qu’acquièrent les pensées provoque presque toujours, surtout chez certaines gens qui gardent en eux une certitude sur laquelle ils ne peuvent pas se reposer – la certitude de ne rien pouvoir savoir, et ne sachant rien, de ne croire à rien –, quelque rhume sérieux. Un rhume d’âme, cela s’entend.
Et quand le jour montait, il semblait presque grotesque et atroce au juge D’Andrea d’être obligé de se rendre à son bureau de juge d’instruction pour administrer – pour autant qu’il lui en revenait – la justice à ces pauvres petits hommes si féroces...."

"Ciaula scopre la luna" (Ciaula découvre la lune)
C'est une nouvelle tardive, souvent considérée comme un petit joyau pour son passage du réalisme au symbolisme et son aspect quasi-initiatique. Ciaula, un ouvrier illettré et simple d'esprit qui travaille dans une mine de soufre, vit dans la peur du noir. Un soir, en sortant de la mine, il découvre pour la première fois la pleine lune qui illumine la nuit. Cette beauté soudaine transforme sa peur en émerveillement. C'est une allégorie sur la découverte de la beauté, de l'art et de l'émerveillement qui peuvent transcender une condition misérable.
"Les piqueurs, ce soir-là, voulaient cesser de travailler avant d’avoir fini d’extraire toutes les caisses de soufre nécessaires pour charger le four le lendemain. Cacciagallina, le contremaître, se mit en colère contre eux, revolver au poing, devant la sortie de la mine, pour les empêcher de s’en aller.
— Par le corps… par le sang… En arrière tout le monde, tout le monde en bas dans la galerie à suer du sang jusqu’à l’aube ou je tire.
— Boum ! fit quelqu’un au fond du puits.
Et plusieurs autres en écho : Boum ! Et avec des rires, des jurons, des huées, ils s’élancèrent en avant et à coups de coudes et d’épaules se frayèrent tous un passage sauf un. Qui ? Le père Scarda, bien sûr, ce pauvre borgne avec qui Cacciagallina pouvait faire le matamore tout son saoul. Jésus, quelle panique ! Il lui tomba dessus pire qu’un lion, l’attrapa par-devant et comme s’il avait tenu tous les autres entre ses pattes, il lui hurla en plein visage, en le secouant d’importance :
— En arrière tout le monde, canailles ! Tout le monde en bas dans la galerie ou je fais un massacre !
Le père Scarda se laissa tranquillement secouer. Ce cher et honnête contremaître, il fallait qu’il se paie une crise et rien n’était plus naturel qu’elle éclatât sur lui, le vieux, qui pouvait sans se regimber lui en offrir l’occasion. Du reste, lui aussi de son côté avait sous ses ordres quelqu’un de plus faible sur qui se rattraper plus tard : Ciàula, son galibot.
Les autres… voyez par là, ils dévalaient le petit chemin qui conduisait à Comitini. Ils riaient et ils criaient :
— Oui vas-y, tiens-le bien celui-là, Cacciagalli ! C’est lui qui va te le remplir, le four pour demain.
— Ils sont jeunes ! soupira le père Scarda avec un pâle sourire d’indulgence à l’adresse de Cacciagallina.
Et toujours entre les pattes de l’autre, il pencha la tête d’un côté, allongea de l’autre côté sa lèvre inférieure et resta un moment ainsi, comme en attente.
Était-ce une grimace pour Cacciagallina ? Ou se moquait-il de la jeunesse de ses camarades ?
À vrai dire cette gaieté, ces velléités de crânerie juvénile détonnaient avec l’aspect des lieux. Sur ces dures faces quasi éteintes par la nuit crue des galeries souterraines, dans ces corps épuisés par la fatigue quotidienne, dans ces vêtements déchirés se reflétait la livide désolation de ces terres sans le moindre brin d’herbe, trouées de soufrières comme autant de fourmilières.
Mais non : immobile dans son étrange attitude, le père Scarda ne se moquait pas d’eux ni n’adressait une grimace à Cacciagallina. C’était là son truc habituel pour amener tout doucement et non sans effort dans sa bouche la grosse larme qui de temps en temps lui coulait de l’autre œil, le bon.
Il avait pris goût à cette saveur salée et il n’en manquait pas une.
Presque rien ; une goutte de loin en loin. Mais enseveli du matin au soir à plus de deux cents mètres sous terre le pic en main qui, à chaque coup, lui arrachait de la poitrine comme un râle de rage, le père Scarda avait toujours la bouche sèche et cette larme, pour sa bouche, était ce qu’aurait été une pincée de « râpé » pour son nez.
Un plaisir et un repos.
Quand il se sentait l’œil plein, il posait son pic un instant et regardant la flammèche rouge et fumeuse de la lanterne fichée dans le roc qui allumait dans les ténèbres de cet antre infernal un éclat de soufre ici et là ou l’acier de la barre à mine ou de la pioche, il penchait la tête de côté, tordait la lèvre inférieure et attendait que la larme coulât, lente, dans le sillon qu’avaient creusé les précédentes.
Aux autres la tabagie ou le vin : à lui le vice de cette larme.
Cette larme d’ailleurs, c’était la glande lacrymale malade et non l’envie de pleurer qui la provoquait ; mais des larmes qui étaient de vrais pleurs, il en avait bu aussi, le père Scarda, quand quatre ans plus tôt, son unique fils était mort à la suite de l’explosion d’une mine, lui laissant sept orphelins et sa belle-fille à entretenir. De temps en temps, il lui en venait une plus salée que les autres ; il la reconnaissait aussitôt et alors remuait la tête et murmurait un nom :
— Calicchio…
À cause de cette mort de Calicchio et aussi de l’œil perdu à la suite de l’explosion de la mine, on le gardait encore à la soufrière. Il y travaillait plus et mieux qu’un jeune, mais chaque samedi soir, la paie lui était versée et, à dire la vérité, lui-même la prenait comme une charité qu’on lui aurait faite ; au point qu’en l’empochant, il disait à voix basse, presque honteux :
— Que Dieu vous le rende.
Puisque, selon la règle, il devait se persuader qu’un homme de son âge ne pouvait plus être qu’un bon à rien.
Quand Cacciagallina finalement le lâcha pour courir après les autres et en engager quelques-uns, en y mettant toutes les formes, à passer la nuit au travail, le père Scarda le pria d’envoyer au moins chez lui l’un de ceux qui rentraient au village pour avertir qu’il restait à la soufrière et que par conséquent il ne fallait pas l’attendre ni s’inquiéter à son sujet. Puis il se tourna de droite et de gauche pour appeler son galibot, lequel avait plus de trente ans (il aurait pu tout aussi bien en avoir soixante ou soixante-dix, idiot comme il était) et il poussa le cri pour l’appeler qu’on utilise avec les corneilles apprivoisées..."
