- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

André Gide (1869-1951), "Les Nourritures terrestres" (1897), "L'Immoraliste" (1902), "La Porte étroite" (1909), "Corydon" (1911), "Les Caves du Vatican " (1914), "La Symphonie pastorale" (1919), "Si le Grain ne meurt" (1924), "Les Faux-Monnayeurs" (1925), "Journal" (1889-1939), "Thésée" (1946) - ....
Last Update: 12/11/2016

Gide aurait écrit pour s'éprouver! Contemporain de Proust, au moins par sa date de naissance, né dans une famille de bourgeoisie protestante très aisée, André Gide a tout d'abord été profondément marqué par son éducation dont le précoce veuvage de sa mère (1880) avait encore renforcé l'austérité. Il en gardera toute sa vie l'empreinte : connaissance de la Bible, intérêt porté aux mystères du cœur par la pratique de l'examen de conscience, sens hypertrophié du scrupule. Mais Gide s'est vite révolté contre la morale puritaine. Après une brève apparition dans le monde des lettres dont "Paludes" (1895) fera la satire, il découvre à l'occasion d'un voyage en Afrique du Nord nécessité par son état de santé, la joie de vivre dans une heureuse liberté sexuelle. "Les Nourritures terrestres" (1897) expriment avec un enthousiasme lyrique les bonheurs de l'évasion et de la délivrance...
"Je m'attends à vous, nourritures !...
Satisfactions! je vous cherche.
Vous êtes belles comme les aurores d'été
Sources plus délicates au soir, délicieuses à midi; eaux du petit matin glacées ; souffles au bord des flots ; golfes encombrés de mâtures ; tiédeur des rives cadencées..."
Ce "manuel de délivrance", comme l'appellera son auteur, se propose d'enseigner la ferveur, une façon de brûler ardemment, d'être docile à ses désirs et attentif à tout ce qui peut les aviver. Cet hédonisme, malgré la violence de son affirmation, n'est pas vulgaire. Son but ultime est de permettre l'épanouissement total d'un individu dans sa spécificité. Gide adresse à son disciple cette dernière injonction : "Ne t'attache en toi qu'à ce que tu sens qui n'est nulle part ailleurs qu'en toi-même, et crée de toi, impatiemment ou patiemment, ah! le plus irremplaçable des êtres".
C'est dans la même perspective d'émancipation qu'il faut situer "L'Immoraliste" (1902), le premier roman de Gide, en partie autobiographique, qui raconte non sans cynisme l'aventure d'un personnage qui finit par sacrifier la santé de sa femme à son égoïsme. Un peu plus tard la parabole du "Retour de l'enfant prodigue" (1907) exprimera sous une affabulation évangélique la même volonté d'aviver sa soif pour la satisfaire plus délicieusement.
Par souci de contraste et surtout parce que les deux tendances coexistaient en lui, Gide, après "L'lmmoraliste", publie "La Porte étroite" (1909), roman dominé par la figure d'Alissa qui par souci de sainteté refuse les satisfactions même légitimes de l'amour humain. C'est une œuvre austère et prenante, d'un classicisme empreint de sobriété, tout comme "La Symphonie pastorale" (1919) roman de la sincérité scrupuleuse, victime de ses propres illusions. Mais l'œuvre la plus originale de Gide, "Les Faux-Monnayeurs" (1926) s'engage dans d'autres chemins. Un des personnages principaux du roman est un romancier, Edouard, qui écrit lui-même un roman et dont le Journal commente à l'intérieur du roman dont il est un personnage, le roman dont il est l'auteur, et qui porte le même titre. Gide ajoute, de son côté, à son roman des Faux-Monnayeurs un "Journal des Faux-Monnayeurs", où lui aussi se regarde écrire. Ce jeu de glaces vertigineux, cette "mise en abîme", issu en partie de l'œuvre de Proust, sera très prisé et pratiqué par les modernes.
Puis les intempérances de la jeunesse de Gide s'estompent dans une société qui s'est considérablement libéralisée. « Être de dialogue » comme il se définit lui-même, préférant l'amour de la vérité au besoin de certitude, d'une curiosité inépuisable, il a toujours tenté "d'assumer le plus possible d'humanité". C'est sa personne attachante qui fait le prix de son "Journal", peut-être sa plus grande œuvre, en qui on a voulu voir les "Essais" du XXe siècle. C'est ainsi que l'ancien immoraliste est devenu une référence morale, cautionnée par le Prix Nobel en 1947....
"Il me paraît que chacun de mes livres n'a point tant été le produit d'une disposition intérieure nouvelle, que sa cause tout au contraire, et la provocation première de cette disposition d'âme et d'esprit dans laquelle je devais me maintenir pour en mener à bien l'élaboration. Je voudrais exprimer cela d'une manière plus simple : que le livre, sitôt conçu, dispose de moi tout entier, et que, pour lui, tout en moi, jusqu'au plus profond de moi s'instrumente. Je n'ai plus d'autre personnalité que celle qui convient à cette œuvre - objective ? subjective ? Ces mots perdent ici leur sens ; car s'il m'arrive de peindre d'après moi... c'est que d'abord j'ai commencé par devenir celui-là même que je voulais portraiturer." (Journal)
"Les Nourritures terrestres" furent publiées en 1897, "La Soirée avec M.Teste" en 1896, Gide et Valéry, écrit Gaëtan Picon, ont tous deux exercé sur la littérature française une "dictature d'égale durée". Mais bien que Valéry se montre infiniment supérieur quant à l'agilité de son style et à son extraordinaire humanité, c'est bien Gide qui imprime à l'époque sa marque décisive : "nous lui devons l'exemple d'une libération morale sans laquelle la littérature actuelle (celle des années 60) ne serait pas ce qu'elle est" : "à la vie comme à l'oeuvre, Gide demande la possibilité d'une jouissance sans limites..."
Les livres d'André Gide ont commencé par être des confessions de divers états d'âme. Plus tard, dans la forme du roman qu'il adoptera il se dérobe davantage, mais son âme ne s'en révèle pas moins. Il suit passionnément et logiquement tous les appels de sa sensibilité et de son intelligence, tous les méandres de son esprit complexe, tous les détours de son cœur multiple, Les problèmes psychiques qu'il aborde, il les pousse jusqu'au bout de la logique. A ce terme, le cas contraire lui apparait et le développement d'un problème nouveau commence dans un autre livre avec la même sincérité et la même passion. Ainsi, ayant écrit "L'Immoraliste" où il nous montre un être qui s'affranchit totalement des lois morales, il se trouve plus tard amené à écrire "la Porte Etroite" où une femme pour s'élever jusqu'à la perfection dans les cadres de cette loi morale, va jusqu'au renoncement de son amour. On pourrait suivre ainsi dans l'œuvre d'André Gide le fil continu d'une pensée logique avec ses réactions et ses conflits. Mais ces idées qui s acheminent ou se contrarient, qui dérivent l'une de l'autre, prêtes à rebondir vers d'autres appels, ne sont pas seulement de froides spéculations de l'esprit. Une grande passion les anime; une souffrance sincère les vivifie. Tout, dans l'œuvre de Gide, est ordonné, précis, mesuré mais tout y vibre continuellement d'une fièvre intérieure et d'une ardeur toujours noble et sans répit. Et pour André Malraux, qui prend alors l'ascendance parmi les littérateurs les plus engagés en 1930, Gide fut le "contemporain capital" de tous les êtres humains nés à la vie intellectuelle entre 1920 et 1935 ...
Reprenons Gaëtan Picon (1960): "Fermé à toute métaphysique religieuse (s'il est ouvert aux valeurs morales du christianisme), dépourvu du sens de l'au-delà comme du sens moderne du néant et de I'absurde (qui n'est sans doute que le reflux de la vague religieuse), Gide affirme la position classique de l'humanisme : limitée à l'horizon terrestre, la vie humaine possède un sens suffisant. « Rien que la terre » :ces mots, qui ouvrent un espace sans limites, ne sont pas une mélancolique restriction. L'homme est fait pour le bonheur, et tout est concerté pour devenir entre ses mains un instrument de jouissance.
Mais on ne se débarrassera pas de Gide en le traitant d'hédoniste : il met la sensation à sa place. Car c'est la jouissance de l'homme total qu'il revendique: sensualité et intelligence, corps et esprit, égoisme et altruísme, affirmation et effacement. Aussi n'est-il de vie digne de l'homme que dans la recherche et le progrès - et dans un mouvement perpétuel qui jamais ne s'enlise dans ses propres victoires. Donner l'image de ce que peut devenir l'homme sans aucun secours de la grâce, mais avec l'usage total de ses moyens d'homme : telle est la leçon d'André Gide."

André Gide (1869-1951)
Gide a vécu avec intensité une vie sans histoire, du moins sans événement accidentel. Et les rumeurs de sa chair vont décider seules des remous de son œuvre. Vie et œuvre sont indissociables, il s'est sans cesse appliqué à l'examen de soi, construisant une oeuvre au travers de laquelle il se libère de tous les interdits physiques et moraux, mais sans pouvoir abolir sa soif de communion spirituelle.
Fils unique, André Gide grandit dans une atmosphère ouatée, où la réflexion intellectuelle alterne avec les lectures bibliques. Mais très tôt la chair le tient : « Je ne puis dire si quelqu'un m'enseigna ou comment je découvris le plaisir, aussi loin que ma mémoire remonte en arrière, il est là. » À huit ans, il est renvoyé de l'École alsacienne pour « mauvaises habitudes ». Le conflit est noué : d'un côté le devoir, les principes, la pureté ; de l'autre le plaisir clandestin ressenti comme un péché. Dans ce sombre univers, survient l'« angélique intervention que je vais dire pour me disputer au malin », celle de Madeleine Rondeaux. Gide, réfugié sur les bords du lac d'Annecy, écrit en 1890 les Cahiers d'André Walter, héros chaste et pur, qui aime sa cousine Emmanuelle, mais résiste victorieusement aux assauts de la chair. La création artistique apparaît alors comme un exutoire à cette lutte sourde que se livrent en lui la foi et le plaisir.
Soudain, en 1893, il fuit Paris et sa mère, s'embarque avec le peintre Paul Albert Laurens pour l'Afrique du Nord, où, durant deux années, il va apprendre à dépouiller le vieil homme. Pourtant, en Algérie, Gide tombe malade et se croit atteint de tuberculose, au bord de la tombe ; mais la résurrection n'en est que plus éclatante : « Vivre, je veux vivre ! » (L'Immoraliste.) Aucune morale, aucune censure ne vient voiler la ténébreuse beauté des jeunes Arabes. Dans cette jubilation du cœur et du corps, Gide commence les "Nourritures terrestres", hymne à la joie, communion avec la nature dans le panthéisme. Au cours d'un second voyage (1894), il rencontre Oscar Wilde, qui l'entraîne vers de nouveaux dérèglements.
De retour à Paris, Mme Gide meurt subitement le 31 mai 1895 et il épouse le 8 octobre, dans le petit temple d'Étretat, Madeleine Rondeaux. Alors commence une vie de tensions entre exigences contraires. Chaque livre fournira un exorcisme momentané à une tentation : "Les Nourritures terrestres" (1897), "L'Immoraliste" (1902), "La porte étroite" (1909). Il atteint la notoriété avec "Les Caves du Vatican" (1914) et son entrée à la NRF. La "Symphonie pastorale" (1919) le libère de "sa dernière dette avec le passé", et pour la première fois se raconte sans fard dans "Si le grain ne meurt" (1920) et "Corydon" (1924).

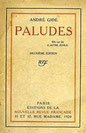
1895 - "Paludes"
C'est l`une des premières œuvres de l'écrivain André Gide : il y fait, avec une impitoyable lucidité, le bilan de ce personnage qu'il fut quelque temps, et qu'il eût continué d'être s'il ne s`était déterminé à rompre et à tenter l`aventure spirituelle des "Nourritures terrestres".
Le personnage principal du livre est un homme de lettres, qui parle de lui-même comme on a accoutumé de le faire dans un journal intime. Il passe ses jours en colloques avec une femme d'esprit, qui lui a voué une pathétique amitié amoureuse, en visites et en discussions avec des hommes de lettres et des intellectuels, et en démêlés de bon ton avec des amis qui ne le comprennent pas et dont il craint d'ailleurs d`être compris. Il lui vient alors à l`esprit l'idée d'écrire un récit, qui s`intitulera "Paludes", la vie d`un personnage languissant, confiné dans une maison solitaire près d'un étang et abandonné à sa fantaisie morbide ...
HUBERT - Mardi.
VERS cinq heures le temps fraîchit; je fermai mes fenêtres et je me remis à écrire.
A six heures entra mon grand ami Hubert; il revenait du manège.
Il dit : "Tiens! tu travailles ?"
Je répondis : "J'écris "Paludes".
- Qu'est-ce que c'est ? - Un livre.
- Pour moi? - Non.
- Trop savant ? ... - Ennuyeux.
- Pourquoi l'écrire alors? - Sinon qui l'écrirait?
- Encore des confessions? - Presque pas.
- Qoi donc? - Assieds-toi.
Et quand il fut assis :
"J'ai lu dans Virgile deux vers :
Et tibi magna satis quamvis lapis omnia nudus
Limosoque palus obducat pascua junco.
"Je traduis : - c'est un berger qui parle à un autre; il lui dit que son champ est plein de pierres et de marécages sans doute, mais assez bon pour lui; et qu'il est très heureux de s'en satisfaire. - Quand on ne peut pas changer de champ, nulle pensée ne saurait être plus sage, diras-tu ? ... " Hubert ne dit rien. Je repris : "Paludes c'est spécialement l'histoire de qui ne peut pas voyager; - dans Virgile il s'appelle Tityre; - Paludes, c'est l'histoire d'un homme qui, possédant le champ de Tityre, ne s'efforce pas d'en sortir, mais au contraire s'en contente; voilà... Je raconte : - Le premier jour, il constate qu'il s'en contente, et songe à qu'y faire?
Le second jour, un voilier passant, il tue au matin quatre macreuses ou sarcelles et vers le soir en mange deux qu'il a fait cuire sur un maigre feu de broussailles. Le troisième jour, il se distrait à se construire une hutte de grands roseaux. Le quatrième jour, il mange les deux dernières macreuses. Le cinquième jour, il défait sa hutte et s'ingénie pour une maison plus savante. Le sixième }our...
- Assez! dit Hubert, - j'ai compris; - cher ami, tu peux écrire." Il partit.
La nuit était close. Je rangeai mes papiers. Je ne dînai point; je sortis; vers huit heures j'entrai chez Angèle.
Angèle était à table encore, achevant de manger quelques fruits; je m'assis auprès d'elle et commençai de lui peler une orange. On apporta des confitures et, lorsque nous fûmes de nouveau seuls :
" Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?" dit Angèle, en me préparant une tartine.
Je ne me souvenais d'aucun acte et je répondis : "Rien", inconsidérément, puis aussitôt, craignant des digressions psychologiques, je songeai à la visite et m'écriai : "Mon grand ami Hubert est venu me voir à six heures.
- Il sort d'ici ", reprit Angèle; puis resoulevant à son propos d'anciennes querelles : "Lui du moins fait quelque chose, dit-elle; il s'occupe."
J'avais dit que je n'avais rien fait; je m'irritai : "Quoi? Qu'est-ce qu'il fait ? " demandai-je... Elle partit : "Des masses de choses... D'abord lui monte à cheval... et puis vous savez bien : il est membre de quatre compagnies industrielles; il dirige avec son beau-frère une autre compagnie d'assurances contre la grêle : - je viens de souscrire. Il suit des cours de biologie populaire et fait des lectures publiques tous les mardis soir. Il sait assez de médecine pour se rendre utile dans des accidents. - Hubert fait beaucoup de bien : cinq familles indigentes lui doivent de subsister encore; il place des ouvriers qui manquent d'ouvrage chez des patrons qui manquaient d'ouvriers. Il envoie des enfants chétifs à la campagne, où il y a des établissements. Il a fondé un atelier de rempaillage pour occuper de jeunes aveugles. - Enfin, les dimanches, il chasse. - Et vous! vous, qu'est-ce que vous faites ?
- Moi! répondis-je un peu gêné, - j'écris Paludes.
- Paludes ? qu'est-ce que c'est? " dit-elle.
Nous avions fini de manger, j'attendis d'être dans le salon pour reprendre.
Quand nous fûmes tous deux assis au coin du feu :
" Paludes, commençai-je, - c'est l'histoire d'un célibataire dans une tour entourée de marais.
- Ah! fit-elle.
- Il s'appelle Tityre.
- Un vilain nom.
- Du tout, repartis-je, - c'est dans Virgile. Et puis je ne sais pas inventer.
- Pourquoi célibataire?
- Oh!... pour plus de simplicité.
- C'est tout?
- Non; je raconte ce qu'il fait.
- Et qu'est-ce qu'il fait ?
- Il regarde les marécages...
- Pourquoi écrivez-vous ? reprit-elle après un silence.
- Moi ? - je ne sais pas, - probablement que c'est pour agir.
- Vous me lirez ça, dit Angèle.
- Quand vous voudrez. J'en ai précisément quatre ou cinq feuillets dans ma poche; et les en sortant aussitôt, je lui lus, avec toute l'atonie désirable :
JOURNAL DE TITYRE ou PALUDES
De ma fenêtre j'aperçois, quand je relève un peu la tête, un jardin que je n'ai pas encore bien regardé ; à droite, un bois qui perd ses feuilles ; au delà du jardin, la plaine ; à gauche un étang dont je reparlerai.
Le jardin, naguère, était planté de passe-roses et d'ancolies, mais mon incurie a laissé les plantes croître à l'aventure; à cause de l'étang voisin, les joncs et les mousses ont tout envahi ; les sentiers ont disparu sous l'herbe ; il ne reste plus, où je puisse marcher, que la grande allée qui mène de ma chambre à la plaine, et que j'ai prise un jour lorsque je fus me promener. Au soir, les bêtes du bois la traversent pour aller boire l 'eau de l 'étang ; à cause du crépuscule, je ne distingue que des formes grises, et comme ensuite la nuit est close, je ne les vois jamais remonter.
- Moi, ça m'aurait fait peur, dit Angèle; - mais continuez, - c'est très bien écrit."
J'étais très contracté par l'effort de cette lecture :
"Oh! c'est à peu près tout, lui dis-je; le reste n'est pas achevé.
- Des notes, s'écria-t-elle - ô lisez-les ! c'est le plus amusant; on y voit ce que l'auteur veut dire bien mieux qu'il ne l'écrira dans la suite" ....
A peine les gens qu`il connaît viennent-ils à entendre parler de ce projet, qu`ils en demandent aussitôt des nouvelles, en dissertent entre eux avec une facile et mondaine importunité, et priant l`auteur de bien vouloir leur communiquer quelques fragments de son œuvre. Trop faible pour refuser, l'écrivain cède à leur requête.
Mais lorsqu'il cherche à faire comprendre la véritable signification qu'il entend donner à son oeuvre, personne ne veut plus I`écouter. On retrouvera dans "Si le grain ne meurt" des descriptions et une satire des milieux littéraires qui valent celles de "Paludes". Les écoles prises à partie sont celles du Parnasse, qui touchait alors à sa fin, et celle du symbolisme.
".. Un air presque tiède soufflait; au-dessus de l'eau, de frêles gramens se penchaient que firent ployer des insectes. Une poussée germinative disjoignait les marges de pierres; un peu d'eau s'enfuyait, humectait les racines. Des mousses, jusqu'au fond descendues, faisaient une profondeur avec l'ombre : des algues glauques retenaient des bulles d'air pour la respiration des larves. Un hydrophile vint à passer. Je ne pus retenir une pensée poétique
et, sortant un nouveau feuillet de ma poche, j'écrivis :
"Títyre sourít".
Après quoi j'eus faim et, réservant l'étude des potamogétons pour un autre jour, je cherchai sur le quai le restaurant dont m'avait parlé Pierre. Je pensais être seul. J'y rencontrai Léon, qui me parla d'Edgar. Après midi je visitai quelques littérateurs. Vers cinq heures commença de tomber une petite averse; je rentrai; j'écrivis les définitions de vingt vocables de l'école et trouvai pour le mot "blastoderme" jusqu'à huit épithètes nouvelles.
J'étais un peu las vers le soir et, après mon dîner, je m'en fus coucher chez Angèle. Je dis chez et non avec elle, n'ayant jamais fait avec elle que de petits simulacres anodins.
Elle était seule. Comme j'entrai elle jouait avec exactitude une sonatine de Mozart sur un piano fraîchement accordé. Il était déjà tard, et l'on n'entendait pas d'autre bruit. Elle avait allumé toutes les bougies des candélabres et mis une robe à petits carreaux.
"Angèle, dis-je en entrant, nous devrions tâcher de varier un peu notre existence! Allez-vous me demander encore ce que je viens de faire aujourd'hui ?"
Elle ne comprit sans doute pas bien l'amertume de ma phrase, car aussitôt elle me demanda : "Eh bien, qu'avez-vous fait aujourd'hui ?"
Alors et malgré moi, je répondis : "J'ai vu mon grand ami Hubert.
- Il sort d'ici, reprit Angèle.
- Mais ne pourrez-vous donc, chère Angèle, jamais nous recevoir ensemble ? m'écriai-je.
- Il n'y tient peut-être pas tant que ça, dit-elle. Enfin, si vous, vous y tenez beaucoup, venez dîner chez moi vendredi soir, il y sera : vous nous lirez des vers... A propos, demain soir; vous ai-je invité? je reçois quelques littérateurs; vous en serez. - On se réunit à neuf heures.
- J'en ai vu plusieurs aujourd'hui, répondis-je, parlant des littérateurs. - J'aime ces existences tranquilles. Ils travaillent toujours et pourtant on ne les dérange jamais; il semble, lorsqu'on va les voir, que ce n'était que pour vous qu'ils travaillent et qu'ils préfèrent vous parler. Leurs amabilités sont charmantes; ils les composent à loisir. J'aime ces gens dont la vie est occupée sans cesse mais peut être occupée avec nous. Et comme ils ne font rien qui vaille on n'a pas de remords de leur prendre leur temps. Mais à propos : J'ai vu Tityre.
- Le célibataire ?
- Oui - mais dans la réalité il est marié, _ père
de uatre enfants. Il s'appelle Richard... ne me dites pas qu”il sort d'ici, vous ne le connaissez pas."
Angèle, un peu froissée, me dit alors : "Vous voyez bien qu'elle n'était pas vraie, votre histoire!
- Pourquoi, pas vraie? - parce qu'ils sont six au lieu d'un! J'ai fait Tityre seul, pour concentrer cette monotonie; c'est un procédé artistique; vous ne voudriez pourtant pas que je les fasse pêcher tous les six à la ligne?
- Je suis tellement sûre que dans la réalité ils ont des occupations différentes!
- Si je les décrivais, elles paraîtraient trop différentes; les événements racontés ne conservent pas entre eux les valeurs qu'ils avaient dans la vie. Pour rester vrai on est obligé d'arranger. L'important c'est que j'indique l'émotion qu'ils me donnent.
- Mais si cette émotion est fausse ?
- L'émotion, chère amie, n'est jamais fausse; n'avez-vous donc point lu parfois que l'erreur vient à partir du jugement? Mais pourquoi raconter six fois? mais puisque l'impression qu'ils donnent est la même précisément, six fois... Voulez-vous savoir ce qu'ils font - dans la réalité?
_ Parlez, dit Angèle; vous avez l'air exaspéré.
- Du tout, criai-je... Le père fait des écritures; la mère tient la maison; un grand garçon donne des leçons chez les autres; un autre en reçoit; la première fille boite; la dernière, trop petite, ne fait rien. - Il y a aussi la cuisinière ... La femme s'appelle Ursule ... Et remarquez que tous, ils font la même chose exactement tous les jours !!!
- Peut-être qu'ils sont pauvres, dit Angèle.
- Nécessairement! Mais comprenez-vous Paludes? ...."

1893-1897 - Reprenons les biographies littéraires de Gide et cette fameuse "péripétie essentielle entre deux phases étrangement enchaînées" : "A vingt-quatre ans André Gide s'embarque pour la Tunisie (octobre 1893). Accompagnant son ami le peintre P. A. Laurens, il y arrive malade et croyant sa vie menacée, chaste et plein de l'effroi du péché, fidèle au pur amour qui depuis longtemps le lie à Madeleine, sa "sœur" tout autant que sa fiancée. Deux ans après, en 1895, il revient d'Afrique du Nord guéri, brûlant de vivre, libéré des interdits physiques et moraux, révélé à lui-même par les ardentes surprises des oasis. Il se trouve transformé par la certitude qu'il est fait pour tous les désirs el d'abord pour le plus inavouable aux yeux du monde; désormais il ne pourra plus nier ni contenir cette part de son êtres. Mais, en même temps, il ne peut pas non plus abolir sa soif de communion spirituelle, sa Vocation de dévouement et, peut-être, son besoin de refuge contre lui-même. Peu après la mort de sa mère, il épouse le 8 octobre 1895 Madeleine Rondeaux qui, partageant son illusion, accepte la gageure d'un mariage blanc. Cependant, dès le voyage ou il entraîne sa compagne sur les lieux mêmes de sa révélation africaine, la contradiction éclate entre les deux exigences qu'il porte en lui. Il croit trouver la solution dans un étrange partage qui, réservant au mariage le pur commerce des âmes, accorde au plaisir une place à ses yeux tout aussi légitime. Il n'en sent pas moins le poids de la société, le contrôle de sa conscience puritaine et le muet reproche d'une présence douloureuse : dès lors commence son existence "d'immoraliste" tourmentés par tous les problèmes de la vie morale.."
"Ne souhaite pas, Nathanaël, trouver Dieu ailleurs que partout.
Chaque créature indique Dieu, aucune ne la révèle.
Dès que notre regard s'arrête à elle, chaque créature nous détourne de Dieu.
Tandis que d'autres publient ou travaillent, j'ai passé trois années de voyage à oublier au contraire tout ce j'avais appris par la tête. Cette désinstruction fut lente et difficile; elle me fut plus utile que toutes les instructions imposées par les hommes, et vraiment le commencement d'une éducation.
Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie; mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose - passionnément.
- Je châtiais allègrement ma chair, éprouvant plus de volonté dans le châtiment que dans la faute - tant je me grisais d'orgueil à ne pas pécher simplement...."

1897 - Les nourritures terrestres
Publiées après une lente élaboration, "Les Nourritures terrestres" chantent, sur le mode lyrique et sensuel, la libération que Gide a connue pendant son premier séjour en Tunisie. Tout goûter et tout connaître devient un devoir, et l'ouvrage mêle notes de voyages, fragments de journal intime, rondes et ballades, dictionnaire poétique, dialogues fictionnels. La ferveur enseignée à Nathanaël est différente de l'amour : elle est abandon à toute occasion de savourer les paysages, les êtres, les attentes. Toutes les contraintes religieuses longtemps supportées sont abolies au profit d'un évangile charnel qui n'impose pas moins une éthique particulière. Passée presque inaperçue au moment de sa publication, cette œuvre est sans doute celle dont on a retenu le plus de formules jugées exprimées toute l'attitude d'un Gide devant la vie : "Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur... Une existence pathétique, Nathanaël, plutôt que la tranquillité... Il faut, Nathanaël, que tu brûles en toi tous les livres... jusqu'où mon désir peut s'étendre, là j 'irai... Nathanaël, je ne crois plus au péché... Nathanaël, je t'enseignerai que toutes choses sont divinement naturelles... Nathanaël, ne distingue pas Dieu de ton bonheur.." et surtout la plus célèbre d'entre toutes : "Familles, je vous hais, foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur"...
(II) "NOURRITURES.
Je m'attends à vous, nourritures!
Ma faim ne se posera pas à mi-route;
Elle ne se taira que satisfaite;
Des morales n'en sauraient venir à bout
Et de privations je n'ai jamais pu nourrir que mon âme.
Satisfactions! je vous cherche.
Vous êtes belles comme les aurores d'été.
Sources plus délicates au soir, délicieuses à midi; eaux du petit matin glacées; souffles au bord des flots; golfes encombrés de mâtures; tiédeur des rives cadencées...
Oh! S'il est encore des routes vers la plaine; les touffeurs de midi; les breuvages des champs, et pour la nuit le creux des meules;
s'il est des routes vers l'Orient; des sillages sur les mers aimées; des jardins à Mossoul; des danses à Touggourt; des chants de pâtre en Helvétie;
s'il est des routes vers le Nord; des foires à Nijni; des traîneaux soulevant la neige; des lacs gelés; certes, Nathanaël; ne s'ennuieront pas nos désirs.
Des bateaux sont venus dans nos ports apporter les fruits mûrs de plages ignorées.
Déchargez des de leur faix un peu vite, que nous puissions enfin y goûter.
Nourritures!
Je m'attends à vous, nourritures!
Satisfactions, je vous cherche;
Vous êtes belles comme les rires de l'été..
Je sais que je n'ai pas un désir
Qui n'ait sa réponse apprêtée.
Chacune de mes faims attend sa récompense.
Nourritures !
Je m'attends à vous, nourritures!
Par tout l'espace je vous cherche,
Satisfactions de tous mes désirs.
Ce que j'ai connu de plus beau sur la terre,
Ah! Nathanaël! c'est ma faim.
Elle a toujours été fidèle
A tout ce qui toujours l'attendait.
Est-ce de vin que se grise le rossignol ?
L'aigle, de lait ? ou non point de genièvre les grives ?
L'aigle se grise de son vol. Le rossignol s'enivre des nuits d'été. La plaine tremble de chaleur. Nathanaël, que toute émotion sache te devenir une ivresse. Si ce que tu manges ne te grise pas, c'est que tu n'avais pas assez faim.
Chaque action parfaite s'accompagne de volupté.
A cela tu connais que tu devais la faire. Je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré.
Car si c'était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. La joie que l'on y trouve est signe de l'appropriation du travail et la sincérité de mon plaisir, Nathanaël, m'est le plus important des guides.
Je sais ce que mon corps peut désirer de volupté chaque jour et ce que ma tête en supporte. Et puis commencera mon sommeil. Terre et ciel ne me valent plus rien au delà."
(...)
(III) "Nathanaël, je te parlerai des attentes. J’ai vu la plaine, pendant l’été, attendre ; attendre un peu de pluie. La poussière des routes était devenue trop légère et chaque souffle la soulevait. Ce n’était même plus un désir ; c’était une appréhension. La terre se gerçait de sécheresse comme pour plus d’accueil de l’eau. Les parfums des fleurs de la lande devenaient presque intolérables. Sous le soleil tout se pâmait. Nous allions chaque après-midi nous reposer sous la terrasse, abrités un peu de l’extraordinaire éclat du jour. C’était le temps où les arbres à cônes, chargés de pollen, agitent aisément leurs branches pour répandre au loin leur fécondation. Le ciel s’était chargé d’orage et toute la nature attendait. L’instant était d’une solennité trop oppressante, car tous les oiseaux s’étaient tus. Il monta de la terre un souffle si brûlant que l’on sentit tout défaillir ; le pollen des conifères sortit comme une fumée d’or des branches. – Puis il plut.
J’ai vu le ciel frémir de l’attente de l’aube. Une à une les étoiles se fanaient. Les prés étaient inondés de rosée ; l’air n’avait que des caresses glaciales. Il sembla quelque temps que l’indistincte vie voulût s’attarder au sommeil, et ma tête encore lassée s’emplissait de torpeur. Je montai jusqu’à la lisière du bois ; je m’assis ; chaque bête reprit son travail et sa joie dans la certitude que le jour va venir, et le mystère de la vie recommença de s’ébruiter par chaque échancrure des feuilles. – Puis le jour vint.
J’ai vu d’autres aurores encore. – J’ai vu l’attente de la nuit… Nathanaël, que chaque attente, en toi, ne soit même pas un désir, mais simplement une disposition à l’accueil. Attends tout ce qui vient à toi ; mais ne désire que ce qui vient à toi. Ne dé- sire que ce que tu as. Comprends qu’à chaque instant du jour tu peux posséder Dieu dans sa totalité. Que ton désir soit de l’amour, et que ta possession soit amoureuse. Car qu’est-ce qu’un désir qui n’est pas efficace ?
Eh quoi ! Nathanaël, tu possèdes Dieu et tu ne t’en étais pas aperçu ! Posséder Dieu, c’est le voir ; mais on ne le regarde pas. Au détour d’aucun sentier, Balaam, n’as-tu vu Dieu, devant qui s’arrêtait ton âne ? parce que toi tu te l’imaginais autrement. Nathanaël, il n’y a que Dieu que l’on ne puisse pas attendre. Attendre Dieu, Nathanaël, c’est ne comprendre pas que tu le possèdes déjà. Ne distingue pas Dieu du bonheur et place tout ton bonheur dans l’instant.
J’ai porté tout mon bien en moi, comme les femmes de l’Orient pâle, sur elles, leur complète fortune. À chaque petit instant de ma vie, j’ai pu sentir en moi la totalité de mon bien. Il était fait, non par l’addition de beaucoup de choses particulières, mais par mon unique adoration. J’ai constamment tenu tout mon bien en tout mon pouvoir.
Regarde le soir comme si le jour y devait mourir ; et le matin comme si toute chose y naissait.
Que ta vision soit à chaque instant nouvelle. Le sage est celui qui s’étonne de tout.
Toute ta fatigue de tête vient, ô Nathanaël, de la diversité de tes biens. Tu ne sais même pas lequel entre tous tu préfères et tu ne comprends pas que l’unique bien c’est la vie. Le plus petit instant de vie est plus fort que la mort, et la nie. La mort n’est que la permission d’autres vies, pour que tout soit sans cesse renouvelé ; afin qu’aucune forme de vie ne détienne cela plus de temps qu’il ne lui en faut pour se dire. Heureux l’instant où ta parole retentit. Tout le reste du temps, écoute ; mais quand tu parles, n’écoute plus. Il faut, Nathanaël, que tu brûles en toi tous les livres... "
(Livre VII)
Lettre à Nathanaël.
Tu n'imagines pas, Nathanaël, ce que peut devenir enfin cet abreuvement de lumière ; et la sensuelle extase que donne cette persistante chaleur... Une branche d'olivier dans le ciel ; le ciel au-dessus des collines ; un chant de flûte à la porte d'un café... Alger semblait si chaude et pleine de fêtes que j ai voulu la quitter pour trois jours ; — mais à Blidah, où je me réfugiais, j'ai trouvé les orangers tout en fleurs...
Je sors dès le matin ; je me promène ; je ne regarde rien et vois tout ; une symphonie merveilleuse se forme et s'organise en moi des sensations inécoutées. L'heure passe ; mon émoi s'alentit, comme la marche du soleil moins verticale se fait plus lente. Puis je choisis, être ou chose, de quoi m'éprendre, — mais je le veux mouvant, car mon émotion, sitôt fixée, n'est plus vivante. Il me semble alors à chaque instant nouveau n'avoir encore rien vu, rien goûté.
Je m'éperds dans une désordonnée poursuite de choses fuyantes. — Je courus hier au haut des collines qui dominent Blidah, pour voir un peu plus longtemps le soleil ; pour voir se coucher le soleil et les nuages ardents colorer les terrasses blanches ; je surprends l'ombre et le silence sous les arbres ; je rôde dans la clarté de la lune ; j'ai la sensation souvent de nager, tant l'air lumineux et chaud m'enveloppe et mollement me soulève.
... — Je crois que la route que je suis est ma route, et que je la suis comme il faut. Je garde l'habitude d'une vaste confiance qu'on appellerait de la foi, si elle était assermentée."
Biskra.
"Des femmes attendaient sur le pas des portes ; derrière elles un escalier droit grimpait. Elles étaient assises, là, sur le pas des portes, graves, peintes comme des idoles, coiffées d'un diadème de pièces de monnaie. La nuit, cette rue s'animait. Au haut des escaliers brûlaient des lampes ; chaque femme restait assise dans cette niche de lumière que la cage de l'escalier lui faisait ; leur visage restait dans l'ombre sous l'or du diadème qui brillait; et chacune semblait m'attendra, m'attendre spécialement ; pour monter on ajoutait une
piécette d'or au diadème ; en passant, la courtisane éteignait les lampes ; on entrait dans son étroit appartement ; on buvait du café dans de petites tasses; puis on forniquait sur des espèces de divans bas..."
Publiée en 1897, au Mercure de France, LES NOURRITURES TERRESTRES, la plus célèbre des oeuvres d'André Gide passa longtemps inaperçu - "en dix ans, il s`en vendit tout juste cinq cents exemplaires", nous dit-il dans la préface de l`édition de 1927. Et sans doute s`étonnera-t-on plus tard de l'extraordinaire influence qu`elle exerça, principalement sur les
jeunes esprits. pendant une cinquantaine d`années, ll semble que les choses se soient passées comme si l`on avait suivi à la lettre l`injonction finale que Gide fait à son lecteur idéal : "Nathanaël, à présent, jette mon livre. Emancipe-t'en. Quitte-moi."
Divisées en huit livres, une courte introduction, un "hymne" et un envoi, c'est une œuvre didactique au cours de laquelle Gide apprend au lecteur non seulement à se séparer de son livre, mais à se désinstruire. à se délivrer de certaines conduites morales et intellectuelles, afin qu'il puisse mieux "connaître" et le monde et lui-même, grâce à l`expérience vécue et à une forme de sensualisme qui n`exclut pas la générosité, un émerveillement panthéistique qui porte tout autant effort personnel et don total de soi : "Que mon livre t`enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, - puis à tout le reste plus qu'à toi."
Gide prend donc appui sur un jeune homme qu`il "n'a pas encore rencontré", qu`il nomme bibliquement Nathanaël (on rappelle l'enfance protestante de l'écrivain), et sur un maître imaginaire, Ménalque; mais c'est bien Gide le héros principal de son livre. Donnant aux "Nourritures" une forme poétique, proche des textes orientaux (on sait ce que doit Gide à l'Afrique du Nord), on retrouve bien des passages dans son Journal, son autobiographie - Si le grain ne meurt -, ou des œuvres comme "L`Immoraliste" ou "Amyntas".
PREFACE DE 1927 - En présentant de nouveau son livre au public en 1927, Gide, dans sa préface. précisera la portée de son oeuvre et sa motivation : une oeuvre de convalescent, "de quelqu'un qui a été malade. Il y a, dans son lyrisme même, l'excès de celui qui embrasse la vie comme quelque chose qu'il a failli perdre", une étape dans sa vie et qu'on ne l'emprisonne pas dans son oeuvre, une oeuvre écrite "à un moment où la littérature sentait furieusement le factice et le renfermé; où il me paraissait urgent de la faire à nouveau toucher terre et poser simplement sur le sol son pied nu". Une mise au point qui se poursuit, "J'écrivais ce livre au moment où, par le mariage, je venais de fixer ma vie", 'J'ajoute que je prétendais ne pas m'arrêter à cde livre", "l'on me juge d'ordinaire d'après ce livre de jeunesse", c'est tout Gide un peu surpris du succès tardif mais éclatant des "Nourritures" et effrayé des interprétations plus ou moins outrées qu`on lui donnait et qui lui faisaient perdre tout son sens : "certains ne savent voir dans ce livre, ou ne consentent à y voir, qu'une glorification du désir et des instincts. Il me semble que c'est une vue un peu courte. Pour moi, lorsque je le rouvre, c'est plus encore une apologie du dénuement, que j'y vois..."
AMYNTAS - "Je vivais dans la perpétuelle attente, délicieuse, de n'importe quel avenir" - C`est au cycle des "Nourritures terrestres" que l'on rattache un certain nombre d'œuvres brèves, groupées et publiées en 1906 sous le titre d' "Amyntas", un recueil qui comprend par ordre chronologique : "Feuilles de route" (mars-avril 1896), "Mopsus" (avril 1899), "De Biskra à Touggourt" (décembre 1900), enfin "Le Renoncement au voyage" (1903-1904), autant de textes en prose qui servent de lien entre "Les Nourritures terrestres" et "L'lmmoraliste".
"Feuilles de route" est composé sur des notes prises pendant un voyage qu`il effectua en 1895-1896 en Italie et en Afrique du Nord, "Florence. Naples et Syracuse" et "Tunis et le Sahara". "Mopsus" prolonge les rêveries poétiques des Nourritures, court poème en prose de douze strophes. Le "Renoncement au voyage" rassemble des souvenirs de son second séjour en Afrique du Nord et sur la trame du récit frémit l'appel mystique au voyage : "Par ces chaudes journées, je songe à l`essor des nomades : ah ! pouvoir à la fois demeurer ici, fuir ailleurs ! ah l s'évaporer, se défaire, et qu`un souffle d`azur. où je serais dissous, voyageât !..."
"O désir ! que de nuits je n'ai pu dormir, tant je me penchais sur un rêve qui me remplaçait le sommeil ! Oh ! s'il est des brumes au soir, des sons de flûte sous les palmes, de blancs vêtements dans les profondeurs des sentiers, de l'ombre douce auprès de l'ardente lumière... j'irai!...
- Petite lampe de terre et d'huile ! le vent de la nuit tourmente ta flamme ; - fenêtre disparue ; simple embrasure de ciel ; nuit calme sur les toits ; la lune.
On entend, dans le fond des rues délivrées, parfois un omnibus rouler, une voiture ; et tout au loin, quittant la ville, les trains siffler, les trains fuir - la grande ville attendre le réveil...
Ombre du balcon sur le plancher de la chambre, vacillement de la flamme sur la page blanche du livre. Respiration.
- La lune est à présent cachée ; le jardin devant moi semble un bassin de verdure... Sanglot ; lèvres serrées ; convictions trop grandes ; angoisses de la pensée. Que dirai-je ? choses véritables. - AUTRUI - importance de sa vie ; lui parler..."
"Les Nouvelles Nourritures" - Trente-huit ans plus tard, en 1935, André Gide écrivait" Les Nouvelles Nourritures", oeuvre de l'homme qui entre dans la vieillesse, avec tout ce que cela comporte de nostalgie à l`égard sa ferveur des premiers jours. Mais la curiosité, la soif des choses nouvelles, l`appétit de connaître ne sont point taris. L`appel à la liberté s'accompagnent ici du désir passionné de voir tous les hommes heureux : "Mon bonheur est d'augmenter celui des autres. J`ai besoin du bonheur de tous pour être heureux." L`expérience du communisme que Gide fit à cette
époque - et qui s`achèvera avec la publication du "Retour de l'U.R.S.S." - n`est pas étrangère à ce souci d`universalité : "Camarade, n`accepte pas la vie telle que te la proposent les hommes [...] Du jour où tu commenceras à comprendre que le responsable de presque tous les maux de la vie. ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes, tu ne prendras plus ton parti de ces maux."

1902 – L’immoraliste
Ce récit, peu connu alors, est construit autour de la confession que Michel fait à ses amis, une nuit, dans le désert. Érudit peu concerné par la chair, celui-ci a jadis épousé, sans réel amour, une femme dévouée, Marceline, qui éprouve pour lui des sentiments plus vifs. Au cours de leur voyage de noces en Afrique du Nord, il tombe gravement malade et lutte contre la mort à Biskra, en Algérie. La contemplation des jeunes garçons pleins de santé lui redonne le goût de la vie et il met toute sa volonté à guérir. Le convalescent est bientôt un homme neuf, attentif à son corps, au monde présent et sensuel qui l'entoure. Dans un premier temps, en partie par reconnaissance pour les soins qu’elle lui a prodigués, Michel entoure Marceline d’affection et le couple file en Italie le parfait amour. Puis ils rentrent en France pour vivre en Normandie et à Paris, où Michel obtient une chaire au collège de France. Il rencontre alors Ménalque, dont la philosophie, proche de ce qui est devenue la sienne, lui procure à la fois exaltation et irritation. Marceline, enceinte, fait une fausse couche et demeure maladive. Au lieu de lui laisser le temps de guérir en Suisse, où ils se sont installés, Michel, l’entraîne dans une fuite en avant qui les ramène à Biskra, avant un dernier voyage vers Touggourt. Là, Marceline meurt, d’épuisement, de délaissement et d’amertume. Michel y mène une vie désoeuvrée, avant de demander à ses amis de l’en arracher. La fiction permet à Gide d'éclairer plus librement les profondeurs obscures de ce que fut sa re-naissance en Afrique en 1893.
".. Marceline, cependant, qui voyait, avec joie ma santé enfin revenir, commençait depuis quelques jours à me parler des merveilleux vergers de l’oasis. Elle aimait le grand air et la marche. La liberté que lui valait ma maladie lui permettait de longues courses dont elle revenait éblouie ; jusqu’alors elle n’en parlait guère, n’osant m’inciter à l’y suivre et craignant de me voir m’attrister au récit de plaisirs dont je n’aurais pu jouir déjà. Mais, à présent que j’allais mieux, elle comptait sur leur attrait pour achever de me remettre. Le goût que je reprenais à marcher et à regarder m’y portait.
Et dès le lendemain nous sortîmes ensemble. Elle me précéda dans un chemin bizarre et tel que dans aucun pays je n’en vis jamais de pareil. Entre deux assez hauts murs de terre, il circule comme indolemment ; les formes des jardins que ces hauts murs limitent, l’inclinent à loisir ; il se courbe ou brise sa ligne ; dès l’entrée, un détour nous perd ; on ne sait plus ni d’où l’on vient, ni où l’on va. L’eau fidèle de la rivière suit le sentier, longe un des murs ; les murs sont faits avec la terre même de la route, celle de l’oasis entière, une argile rosâtre ou gris tendre, que l’eau rend un peu plus foncée, que le soleil ardent craquelle et qui durcit à la chaleur, mais qui mollit dès la première averse et forme alors un sol plastique où les pieds nus restent inscrits. Par-dessus les murs, des palmiers.
À notre approche, des tourterelles y volèrent. Marceline me regardait. J’oubliais ma fatigue et ma gêne. Je marchais dans une sorte d’extase, d’allégresse silencieuse, d’exaltation des sens et de la chair. À ce moment, des souffles légers s’élevèrent ; toutes les palmes s’agitèrent et nous vîmes les palmiers les plus hauts s’incliner ; puis l’air entier redevint calme, et j’entendis distinctement, derrière le mur, un chant de flûte. Une brèche au mur ; nous entrâmes. C’était un lieu plein d’ombre et de lumière ; tranquille, et qui semblait comme à l’abri du temps ; plein de silences et de frémissements, bruit léger de l’eau qui s’écoule, abreuve les palmiers, et d’arbre en arbre fuit, appel discret des tourterelles, chant de flûte dont un enfant jouait. Il gardait un troupeau de chèvres ; il était assis, presque nu, sur le tronc d’un palmier abattu ; il ne se troubla pas à notre approche, ne s’enfuit pas, ne cessa qu’un instant de jouer. Je m’aperçus, durant ce court silence, qu’une autre flûte au loin répondait. Nous avançâmes encore un peu, puis : – Inutile d’aller plus loin, dit Marceline ; ces vergers se ressemblent tous ; à peine, au bout de l’oasis deviennent-ils un peu plus vastes…
Elle étendit le châle à terre : – Repose-toi. Combien de temps nous y restâmes ? je ne sais plus ; qu’importait l’heure ? Marceline était près de moi ; je m’étendis, posai sur ses genoux ma tête. Le chant de flûte coulait encore, cessait par instants, reprenait ; le bruit de l’eau… Par instants une chèvre bêlait. Je fermai les yeux ; je sentis se poser sur mon front la main fraîche de Marceline ; je sentais le soleil ardent doucement tamisé par les palmes ; je ne pensais à rien ; qu’importait la pensée ? je sentais extraordinairement. Et par instants, un bruit nouveau ; j’ouvrais les yeux ; c’était le vent léger dans les palmes ; il ne descendait pas jusqu’à nous, n’agitait que les palmes hautes…
Le lendemain matin, dans ce même jardin, je revins avec Marceline ; le soir du même jour, j’y allai seul. Le chevrier qui jouait de la flûte était là. Je m’approchai de lui, lui parlai. Il se nommait Lossif, n’avait que douze ans, était beau. Il me dit le nom de ses chèvres, me dit que les canaux s’appellent séghias ; toutes ne coulent pas tous les jours, m’apprit-il ; l’eau, sagement et parcimonieusement répartie, satisfait à la soif des plantes, puis leur est aussitôt retirée. Au pied de chacun des palmiers, un étroit bassin est creusé qui tient l’eau pour abreuver l’arbre ; un ingénieux système d’écluses que l’enfant, en les faisant jouer, m’expliqua, maîtrise l’eau, l’amène où la soif est trop grande.
Le jour suivant, je vis un frère de Lossif : il était un peu plus âgé, moins beau ; il se nommait Lachmi. À l’aide de la sorte d’échelle que fait le long du fût la cicatrice des anciennes palmes coupées, il grimpa tout au haut d’un palmier étêté ; puis descendit agilement, laissant, sous son manteau flottant, voir une nudité dorée. Il rapportait du haut de l’arbre, dont on avait fauché la cime, une petite gourde de terre ; elle était appendue là- haut, près de la récente blessure, pour recueillir la sève du palmier dont on fait un vin doux qui plaît fort aux Arabes. Sur l’invite de Lachmi, j’y goûtai ; mais ce goût fade, âpre et sirupeux me déplut.
Les jours suivants, j’allai plus loin ; je vis d’autres jardins, d’autres bergers et d’autres chèvres. Ainsi que Marceline l’avait dit, ces jardins étaient tous pareils ; et pourtant chacun différait. Parfois Marceline m’accompagnait encore ; mais, plus souvent, dès l’entrée des vergers, je la quittais, lui persuadant que j’étais las, que je voulais m’asseoir, qu’elle ne devait pas m’attendre, car elle avait besoin de marcher plus ; de sorte qu’elle achevait sans moi la promenade. Je restais auprès des enfants.
Bientôt j’en connus un grand nombre ; je causais avec eux longuement ; j’apprenais leurs jeux, leur en indiquais d’autres, perdais au bouchon tous mes sous. Certains m’accompagnaient au loin (chaque jour j’allongeais mes marches), m’indiquaient, pour rentrer, un passage nouveau, se chargeaient de mon manteau et de mon châle quand parfois j’emportais les deux ; avant de les quitter, je leur distribuais des piécettes ; parfois ils me suivaient, toujours jouant, jusqu’à ma porte ; parfois enfin ils la passèrent.
Puis Marceline en amena de son côté. Elle amenait ceux de l’école, qu’elle encourageait au travail ; à la sortie des classes, les sages et les doux montaient ; ceux que moi j’amenais étaient autres ; mais des jeux les réunissaient. Nous eûmes soin d’avoir toujours prêts des sirops et des friandises. Bientôt d’autres vinrent d’eux-mêmes, même plus invités par nous. Je me souviens de chacun d’eux ; je les revois…"

Ménalque, personnage dont on devine seulement l'influence dans "Les Nourritures Terrestres", apparaît totalement dans "L'Immoraliste". Célibataire, il est celui qui maintient dans sa vie "l'état précaire" de disponibilité qui supprime toutes les attaches. Et les conversations de Michel avec Ménalque permettent de dévoiler sa propre pensée, Gide incarne en effet en Ménalque une partie de lui-même qui oppose sa hardiesse lucide aux résistances d'une conscience scrupuleuse. Ici, Michel, laissant seule Marceline proche d'accoucher, est venu s'entretenir avec Ménalque la nuit qui précède un départ lointain, et son ami lui rappelle que, marié, bientôt père, il a "choisi"...
"Des mille formes de la vie, chacun ne peut connaître qu'une. Envier le bonheur d'autrui, c'est folie; on ne saurait pas s'en servir. Le bonheur ne se veut pas tout fait, mais sur mesure. Je pars demain; je sais: j'ai tâché de tailler ce bonheur à ma taille... gardez le bonheur calme du foyer...
- C'est à ma taille aussi que j'avais taillé mon bonheur, m'écriai-je; mais j'ai grandi ; à présent mon bonheur me serre. Parfois, j'en suis presque étranglé...
- Bah! vous vous y ferez! dit Ménalque; puis il se campa devant moi, plongea son regard dans le mien, et, comme je ne trouvais rien à dire, il sourit un peu tristement: - On croit que l'on possède, et l'on est possédé, reprit-il.
- Versez-vous du chiraz , cher Michel; vous n'en goûterez pas souvent; et mangez de ces pâtes roses que les Persans prennent avec. Pour ce soir je veux boire avec vous, oublier que je pars demain, et causer comme si cette nuit était longue... (Ménalque parle de la philosophie et de la poésie grecques ; puis Michel reprend: ) - Pourquoi, dis-je, vous qui vivez votre sagesse, n'écrivez-vous pas vos mémoires? - ou simplement, repris-je en le voyant sourire, les souvenirs de vos voyages?
- Parce que je ne veux pas me souvenir, répondit-il. Je croirais, ce faisant, empêcher d'arriver l'avenir et faire empiéter le passé. C'est du parfait oubli d'hier que je crée la nouvelleté de chaque heure. Jamais, d'avoir été heureux, ne me suffit. Je ne crois pas aux choses mortes, et confonds n'être plus, avec n'avoir jamais été.
Je m'irritais enfin de ces paroles, qui précédaient trop ma pensée; j'eusse voulu tirer arrière, l'arrêter; mais je cherchais en vain à contredire ; et d'ailleurs m'irritais contre moi-même plus encore que contre Ménalque. Je restai donc silencieux. Lui, tantôt allant et venant à la façon d'un fauve en cage, tantôt se penchant vers le feu, tantôt se taisait longuement, puis tantôt, brusquement disait:
- Si encore nos médiocres cerveaux savaient bien embaumer les souvenirs! Mais ceux-ci se conservent mal; les plus délicats se dépouillent; les plus voluptueux pourrissent, les plus délicieux sont les plus dangereux dans la suite. Ce dont on se repent était délicieux d'abord.
De nouveau, long silence; et puis il reprenait:
- Regrets, remords, repentirs, ce sont joies de naguère, vues de dos. Je n'aime pas regarder en arrière, et j'abandonne au loin mon passé comme l'oiseau, pour s'envoler, quitte son ombre. Ah! Michel, toute joie nous attend toujours, mais veut toujours trouver la couche vide, être la seule, et qu'on arrive à elle comme un veuf. - Ah! Michel, toute joie est pareille à cette manne du désert qui se corrompt d'un jour à l'autre; elle est pareille à l'eau de la source Amélès qui, raconte Platon, ne se pouvait garder dans aucun vase... Que chaque instant emporte tout ce qu'il avait apporté.
Ménalque parla longtemps encore ; je ne puis rapporter ici toutes ses phrases ; beaucoup pourtant se gravèrent en moi, d'autant plus fortement que j'eusse désiré les oublier plus vite ; non qu'elles m'apprissent rien de bien neuf mais elles mettaient à nu brusquement ma pensée; une pensée que je couvrais de tant de voiles, que j'avais presque pu l'espérer étouffée. Ainsi s'écoula la veillée.
(L'Immoraliste, éditions Mercure de France).

En rentrant chez lui, le matin, Michel apprend qu'il ne sera pas père. Alors qu'il aspire à la vie la plus ardente, Marceline affaiblie ne lui apparaît plus que comme "une chose abîmée". Et lors d'un nouveau voyage de Michel et de Marceline dans les oasis algériennes, Gide (Michel) s'abandonne à la tentation de la vie la plus libre. A son retour, Marceline mourra dans ses bras "vers le petit matin". La page est étonnante de retenue...
"Par un dernier semblant de vertu, je reste jusqu'au soir près d'elle. Et soudain je me sens comme à bout de forces moi-même. O goût de cendre! O lassitude! Tristesse du surhumain effort! J'ose à peine la regarder; je sais trop que mes yeux, au lieu de chercher son regard, iront affreusement se fixer sur les trous noirs de ses narines; l'expression de son visage souffrant est atroce. Elle non plus ne me regarde pas. Je sens, comme si je la touchais, son angoisse. Elle tousse beaucoup ; puis s'endort. Par moments un frisson brusque la secoue. La nuit pourrait être mauvaise et, avant qu'il ne soit trop tard, je veux savoir à qui je pourrais m'adresser. Je sors. Devant la porte de l'hôtel, la place de Touggourt, les rues, l'atmosphère même sont étranges au point de me faire croire que ce n'est pas moi qui les vois. - Après quelques instants, je rentre. Marceline dort tranquillement. Je m'effrayais à tort; sur cette terre bizarre, on suppose un péril partout; c'est absurde. Et, suffisamment rassuré, je ressors.
Étrange animation nocturne sur la place; circulation silencieuse; glissement clandestin des burnous blancs. Le vent déchire par instant des lambeaux de musique étrange et les apporte je ne sais d'où. Quelqu'un vient à moi... C'est Moktir. Il m'attendait, dit-il, et pensait bien que je ressortirais. Il rit. Il connaît bien Touggourt, y vient souvent et sait où il m'emmène. Je me laisse entraîner par lui. Nous marchons dans la nuit; nous entrons dans un café maure; c'est de là que venait la musique. Des femmes arabes y dansent - si l'on peut appeler une danse ce monotone glissement..."

"Le Retour de I'enfant prodigue" (1909)
Ecrit par André Gide alors qu'il travaillait à son roman "La Porte étroite", la parabole du Retour de l'enfant prodigue est ici l'objet d'une interprétation très personnelle. L'enfant prodigue, qui a quitté la maison paternelle à la recherche de sa liberté, n'a pas trouvé le bonheur attendu et n'a même pas su entretenir l'exaltation qui aurait pu en tenir lieu et apaiser ainsi la soif de son âme. Il revient chez lui, misérable et repentant. L'accueil affectueux qu'il trouve auprès de son père le remplit d'émotion, mais tant d'indulgence suscite chez son frère aîné, le vertueux qui n'a jamais failli, d'amers commentaires. Après les réjouissances qui marqueront son retour, l'enfant prodigue aura, avec chacun des membres de sa famille, de graves entretiens au cours desquels son aventure sera considérée sous des angles différents. Chez son père, la tendresse et la compréhension prennent vite le pas sur les reproches : le vieillard admettra finalement que, pour se retrouver, il n'était pas absolument nécessaire que son fils regagnât le toit paternel; néanmoins, il conclura gravement : "Si tu t'es senti faible, tu as bien fait de revenir". Mais en revanche, le frère aîné se montre beaucoup plus sévère : lui seul se considère comme le véritable interprète de l'autorité paternelle et proclame qu'en dehors de la famille et dans l'esprit de révolte il n'y a point de salut. L'enfant prodigue sortira de cet entretien irrité et sceptique. Mais les marques d'affection qui lui seront prodiguées par sa mère finiront par l'apaiser; c`est à elle d'ailleurs qu'il avouera être revenu pour n'avoir pas trouvé de par le monde la liberté dont il avait rêvée; dénué de tout, il s`est vu contraint de "servir" de mauvais maîtres qui le maltraitaient, le nourrissant à peine; aussi a-t-il préféré venir se soumettre aux siens.
Mais lorsqu'en pleine nuit il ira trouver son frère cadet, qu'il n'avait qu'entrevu en arrivant, un retournement complet de situation se produit : le jeune garçon est à son tour résolu à partir; l'expérience malheureuse de son frère, loin de le décourager, ne fait que l'inciter davantage à tenter l'aventure, car il espère fermement se montrer plus heureux et plus fort que lui. Faut-il qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit "dehors" ?
"Tu m'as ouvert la route..."
".. - Le frère puîné. - Ne l'as-tu pas compris ? Ne m'encourages-tu pas toi-même à partir ?
- Le Prodigue - Je voudrais t'épargner le retour; mais en t'épargnant le départ.
- Non, non, ne me dis pas cela; non ce n'est pas cela que tu veux dire.
Toi aussi, n'est-ce pas, c'est comme un conquérant que tu partis.
- Et c'est ce qui me fit paraître plus dur le servage.
- Alors, pourquoi t'es-tu soumis ? Etais-tu si fatigué déjà ?
- Non, pas encore; mais j'ai douté.
- Que veux-tu dire ?
- Douté de tout, de moi; j'ai voulu m'arrêter, m'attacher enfin quelque part; le confort que me promettait ce maître m'a tenté... oui, je le sens bien à présent ; j'ai failli.
Le prodigue incline la tête et cache son regard dans ses mains.
- Mais d'abord ? `
- J'avais marché longtemps à travers la grande terre indomptée.
- Le désert ?
- Ce n'était pas toujours le désert.
- Qu'y cherchais-tu ?
- Je ne le comprends plus moi-même.
- Lève-toi de mon lit. Regarde, sur la table, à mon chevet, là, près de ce livre déchiré.
- Je vois une grenade ouverte.
- C'est le porcher qui me la rapporta l'autre soir, après n'être pas rentré de trois jours. -
- Oui, c'est une grenade sauvage.
- Je le sais ; elle est d'une âcreté presque affreuse; je sens pourtant que, si j'avais sufiisamment soif, j'y mordrais. -
- Ah ! je peux donc te le dire à présent : c'est cette soif que dans le désert je cherchais.
- Une soif dont seul ce fruit non sucré désaltère...
- Non; mais il fait aimer cette soif. `
- Tu sais où le cueillir ?
- C'est un petit verger abandonné, où l'on arrive avant le soir. Aucun mur ne le sépare plus du désert. Là coulait un ruisseau; quelques fruits demi-mûrs pendaient aux branches.
- Quels fruits ?
- Les mêmes que ceux de notre jardin; mais sauvages. Il avait fait très chaud tout le jour.
- Ecoute; sais-tu pourquoi je t'attendais ce soir? C'est avant la fin de la nuit que je pars. Cette nuit; cette nuit, dès qu'elle pâlira... J'ai ceint mes reins, j'ai gardé cette nuit mes sandales.
- Quoi ! ce que je n'ai pas pu faire, tu le feras ?...
- Tu m'as ouvert la route, et de penser à toi me soutiendra.
- A moi de t'admirer; à toi de m'oublier, au contraire. Qu'emportes-tu ?
- Tu sais bien que, puîné, je n'ai point part à l'héritage. Je pars sans rien.
- C'est mieux.
- Oue regardes-tu donc à la croisée ?
- Le jandin où sont couchés nos parents morts.
- Mon frère... (et l'enfant, qui s'est levé du lit, pose, autour du cou du prodigue, son bras qui se fait aussi doux que sa voix) - Pars avec moi.
- Laisse-moi! laisse-moi! Je reste à consoler notre mère. Sans moi tu seras plus vaillant. Il est temps à présent. Le ciel pâlit. Pars sans bruit. Allons! embrasse-moi, mon jeune frère: tu emportes tous mes espoirs. Sois fort; oublie-nous; oublie-moi. Puisses-tu ne pas revenir.... Descends doucement. Je tiens la lampe...
- Ah! donne-moi la main jusqu'à la porte.
- Prends garde aux marches du perron... "

1909 – La porte étroite
Le narrateur, Jérôme, chérit tendrement dès l'enfance sa cousine Alissa, bonne, vertueuse et d'une grande ferveur religieuse. Tous voient leur union d'un oeil favorable mais Alissa diffère le moment des fiançailles. Une telle attitude s'explique tout d'abord par le fait qu'Alissa a découvert que sa jeune soeur, Juliette, était amoureuse de Jérôme. Toutefois, même après le mariage, visiblement heureux, de Juliette avec un négociant, Alissa continue à éloigner d'elle Jérôme. Gide a voulu ici retracer "le drame d'une âme protestante en qui se jouât le drame essentiel du protestantisme." Jérôme et Alissa cherchent d'abord ensemble"leur félicité à côté du bonheur terrestre", puis Alissa, héroïque, marchera seule jusqu'à la mort.
".. Chaque beau soir d’été, après dîner, nous descendions dans « le bas jardin ». Nous sortions par la petite porte secrète et gagnions un banc de l’avenue d’où l’on domine un peu la contrée ; là, près du toit de chaume d’une marnière abandonnée, mon oncle, ma mère et Miss Ashburton s’asseyaient ; devant nous, la petite vallée s’emplissait de brume et le ciel se dorait au-dessus du bois plus lointain. Puis nous nous attardions au fond du jardin déjà sombre. Nous rentrions ; nous retrouvions au salon ma tante qui ne sortait presque jamais avec nous…
Pour nous, enfants, là se terminait la soirée ; mais bien souvent nous étions encore à lire dans nos chambres quand, plus tard, nous entendions monter nos parents. Presque toutes les heures du jour que nous ne passions pas au jardin, nous les passions dans « la salle d’étude », le bureau de mon oncle où l’on avait disposé des pupitres d’écoliers. Mon cousin Robert et moi, nous travaillions côte à côte ; derrière nous, Juliette et Alissa. Alissa a deux ans de plus, Juliette un an de moins que moi ; Robert est, de nous quatre, le plus jeune.
Ce ne sont pas mes premiers souvenirs que je prétends écrire ici, mais ceux-là seuls qui se rapportent à cette histoire. C’est vraiment l’année de la mort de mon père que je puis dire qu’elle commence. Peut-être ma sensibilité, surexcitée par notre deuil et, sinon par mon propre chagrin, du moins par la vue du chagrin de ma mère, me prédisposait-elle à de nouvelles émotions : j’étais précocement mûri ; lorsque, cette année, nous revînmes à Fongueusemare, Juliette et Robert m’en parurent d’autant plus jeunes, mais, en revoyant Alissa, je compris brusquement que tous deux nous avions cessé d’être enfants.
Oui, c’est bien l’année de la mort de mon père ; ce qui confirme ma mémoire, c’est une conversation de ma mère avec Miss Ashburton, sitôt après notre arrivée. J’étais inopinément entré dans la chambre où ma mère causait avec son amie ; il s’agissait de ma tante ; ma mère s’indignait qu’elle n’eût pas pris le deuil ou qu’elle l’eût déjà quitté. (Il m’est, à vrai dire, aussi impossible d’imaginer ma tante Bucolin en noir que ma mère en robe claire.) Ce jour de notre arrivée, autant qu’il m’en souvient, Lucile Bucolin portait une robe de mousseline. Miss Ashburton, conciliante comme toujours, s’efforçait de calmer ma mère ; elle arguait craintivement :
– Après tout, le blanc aussi est de deuil.
– Et vous appelez aussi « de deuil » ce châle rouge qu’elle a mis sur ses épaules ? Flora, vous me révoltez ! s’écriait ma mère.
Je ne voyais ma tante que durant les mois de vacances et sans doute la chaleur de l’été motivait ces corsages légers et largement ouverts que je lui ai toujours connus ; mais, plus encore que l’ardente couleur des écharpes que ma tante jetait sur ses épaules nues, ce décolletage scandalisait ma mère. Lucile Bucolin était très belle.
Un petit portrait d’elle que j’ai gardé me la montre telle qu’elle était alors, l’air si jeune qu’on l’eût prise pour la sœur aînée de ses filles, assise de côté, dans cette pose qui lui était coutumière : la tête inclinée sur la main gauche au petit doigt mièvrement replié vers la lèvre. Une résille à grosses mailles retient la masse de ses cheveux crêpelés à demi croulés sur la nuque ; dans l’échancrure du corsage pend, à un lâche collier de velours noir, un médaillon de mosaïque italienne. La ceinture de velours noir au large nœud flottant, le chapeau de paille souple à grands bords qu’au dossier de la chaise elle a suspendu par la bride, tout ajoute à son air enfantin. La main droite, tombante, tient un livre fermé. .."
L' ultime rencontre de Jérôme et d'Alissa, d'un Jérôme incapable de comprendre pourquoi, jadis presque fiancée à lui, Alissa s'est toujours refusée au mariage, appartient à ces célèbres scènes d'adieux qui constellent le roman français depuis "La Princesse de Clèves", "Le Lys dans la Vallée", "Dominique" ....
"Le soleil déclinant, que cachait depuis quelques instants un nuage, reparut au ras de l'horizon, presque en face de nous, envahissant d'un luxe frémissant les champs vides et comblant d'une profusion subite l'étroit vallon qui s'ouvrait à nos pieds; puis, disparut. Je demeurais, ébloui, sans rien dire; je sentais m'envelopper encore, me pénétrer, cette sorte d'extase dorée où mon ressentiment s'évaporait, et je n'entendais plus en moi que l'amour. Alissa, qui restait penchée, appuyée contre moi, se redressa; elle sortit de son corsage un menu paquet enveloppé de papier fin, fit mine de me le tendre, s'arrêta, semblant indécise, et comme je la regardais, surpris :
- Ecoute, Jérôme, c'est ma croix d'améthystes que j'ai là; depuis trois soirs je l'apporte parce que je voulais depuis longtemps te la donner.
- Que veux-tu que j'en fasse? fis-je assez brusquement. Que tu la gardes en souvenir de moi, pour ta fille. Quelle fille? m'écriai-je en regardant Alissa sans la comprendre.
- Écoute-moi bien calmement, je t'en prie; non, ne me regarde pas ainsi; ne me regarde pas ; déjà j'ai beaucoup de mal à te parler ; mais ceci, je veux absolument te le dire. Écoute, Jérôme, un jour, tu te marieras ?... Non, ne me réponds pas ; ne m'interromps pas, je t'en supplie. Je voudrais tout simplement que tu te souviennes que je t'aurai beaucoup aimé et... depuis longtemps déjà... depuis trois ans... j'ai pensé que cette petite croix que tu aimais, une fille de toi la porterait un jour, en souvenir de moi, oh ! sans savoir de qui... et peut-être pourrais-tu aussi lui donner... mon nom...
Elle s'arrêta, la voix étranglée; je m'écriai presque hostilement:
- Pourquoi ne pas la lui donner toi-même?
Elle essaya de parler encore. Ses lèvres tremblaient comme celles d'un enfant qui sanglote ; elle ne pleurait pas toutefois ; l'extraordinaire éclat de son regard inondait son visage d'une surhumaine, d'une angélique beauté.
- Alissa! qui donc épouserais-je ? Tu sais pourtant que je ne puis aimer que toi... et tout à coup, la serrant éperdument, presque brutalement dans mes bras, j'écrasai de baisers ses lèvres. Un instant comme abandonnée je la tins à demi renversée contre moi; je vis son regard se voiler; puis ses paupières se fermèrent, et d'une voix dont rien n'égalera pour moi la justesse et la mélodie:
- Aie pitié de nous, mon ami! Ah! n'abîme pas notre amour.
Peut-être, dit-elle encore : N'agis pas lâchement! ou peut-être me le dis-je moi-même, je ne sais plus, mais soudain, me jetant à genoux devant elle et l'enveloppant pieusement de mes bras:
- Si tu m'aimais ainsi, pourquoi m'as-tu toujours repoussé? Vois! j'attendais d'abord le mariage de Juliette; j'ai compris que tu attendisses
aussi son bonheur; elle est heureuse; c'est toi-même qui me l'as dit. J'ai cru longtemps que tu voulais continuer à vivre près de ton père; mais à présent nous voici tous deux seuls.
- Oh! ne regrettons pas le passé, murmura-t-elle. A présent j'ai tourné la page. - Il est temps encore, Alissa.
- Non, mon ami, il n'est plus temps. Il n'a plus été temps du jour où, par amour, nous avons entrevu l'un pour l'autre mieux que l'amour. Grâce à toi, mon rêve était monté si haut que tout contentement humain l'eût fait déchoir. ]'ai souvent réfléchi à ce qu'eût été notre vie l'un avec l'autre; dès qu'il n'eût plus été parfait, je n'aurais plus pu supporter... notre amour.
- Avais-tu réfléchi à ce que serait notre vie l'un sans l'autre?
- Non! jamais.
- A présent tu le vois! Depuis trois ans, j'erre péniblement... Le soir tombait.
- J'ai froid, dit-elle en se levant et s'enveloppant de son châle trop étroitement pour que je pusse reprendre son bras. Tu te souviens de ce
verset de l'Écriture, qui nous inquiétait et que nous craignions de ne pas bien comprendre: "Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis,
Dieu les ayant réservés pour quelque chose de meilleur..."
- Crois-tu toujours à ces paroles? - Il le faut bien.
Nous marchâmes quelques instants l'un près de l'autre, sans plus rien dire. Elle reprit:
- Imagines-tu cela, Jérôme: le meilleur! Et brusquement les larmes jaillirent de ses yeux, tandis qu'elle répétait encore: le meilleur!
Nous étions de nouveau parvenus à la petite porte du potager par où, tout à l'heure, je l'avais vue sortir. Elle se retourna vers moi:
- Adieu! fit-elle. Non, ne viens pas plus loin. Adieu, mon ami bien-aimé. C'est maintenant que va commencer... le meilleur.
Un instant elle me regarda, tout à la fois me retenant et m'écartant d'elle, les bras tendus et les mains sur mes épaules, les yeux emplis d'un indicible amour..."
(La Porte Étroite, éditions Gallimard).

1914 – Les Caves du Vatican
Gide entreprend ici plus un conte philosophique qu'un roman, et sous l'aspect d'une intrigue policière caricature les valeurs catholiques et bourgeoises. Des escrocs font courir le bruit que le Pape, enlevé par des francs-maçons, est retenu prisonnier dans les caves du Vatican, tandis qu'un usurpateur a pris sa place. Amédée Fleurissoire, un catholique français des plus grotesques, entreprend d'aller délivrer le pape. Parmi tous les personnages falots et insipides qui peuplent cette parodie, Gide distingue Lafcadio, un être qui s'est affranchi de toutes les contraintes morales et qui va, pour affirmer sa liberté, commettre un acte gratuit, jeter le malheureux Fleurissoire par la portière au cours d'un voyage en chemin de fer.
".. – Qui le verrait ? pensait Lafcadio. Là, tout près de ma main, sous ma main, cette double fermeture, que je peux faire jouer aisément ; cette porte qui, cédant tout à coup, le laisserait crouler en avant ; une petite poussée suffirait ; il tomberait dans la nuit comme une masse ; même on n’entendrait pas un cri... Et demain, en route pour les îles !... Qui le saurait ?
La cravate était mise, un petit noeud marin tout fait ; à présent Fleurissoire avait repris une manchette et l’assujettissait au poignet droit ; et, ce faisant, il examinait, au-dessus de la place où il était assis tout à l’heure, la photographie (une des quatre qui décoraient le compartiment) de quelque palais près de la mer.
– Un crime immotivé, continuait Lafcadio : quel embarras pour la police ! Au demeurant, sur ce sacré talus, n’importe qui peut, d’un compartiment voisin, remarquer qu’une portière s’ouvre, et voir l’ombre du Chinois cabrioler. Du moins les rideaux du couloir sont tirés... Ce n’est pas tant des événements que j’ai curiosité, que de moi-même. Tel se croit capable de tout, qui, devant que d’agir, recule... Qu’il y a loin, entre l’imagination et le fait !... Et pas plus le droit de reprendre son coup qu’aux échecs. Bah ! qui prévoirait tous les risques, le jeu perdrait tout intérêt !... Entre l’imagination d’un fait et... Tiens ! le talus cesse. Nous sommes sur un pont, je crois ; une rivière...
Sur le fond de la vitre, à présent noire, les reflets apparaissaient plus clairement, Fleurissoire se pencha pour rectifier la position de sa cravate.
– Là, sous la main, cette double fermeture – tandis qu’il est distrait et regarde au loin devant lui – joue, ma foi ! plus aisément encore qu’on eût cru. Si je puis compter jusqu’à douze, sans me presser, avant de voir dans la campagne quelque feu, le tapir est sauvé. Je commence : Une ; deux ; trois ; quatre ; (lentement ! lentement !) cinq ; six ; sept ; huit ; neuf... Dix, un feu...
Fleurissoire ne poussa pas un cri. Sous la poussée de Lafcadio et en face du gouffre brusquement ouvert devant lui, il fit pour se retenir un grand geste, sa main gauche agrippa le cadre lisse de la portière, tandis qu’à demi retourné il rejetait la droite en arrière par-dessus Lafcadio, envoyant rouler sous la banquette, à l’autre extrémité du wagon, la seconde manchette qu’il était au moment de passer.
Lafcadio sentit s’abattre sur la nuque une griffe affreuse, baissa la tête et donna une seconde poussée plus impatiente que la première ; les ongles lui raclèrent le col ; et Fleurissoire ne trouva plus où se raccrocher que le chapeau de castor qu’il saisit désespérément et qu’il emporta dans sa chute.
– À présent, du sang-froid, se dit Lafcadio. Ne claquons pas la portière : on pourrait entendre à côté.
Il tira la portière à lui, contre le vent, avec effort, puis la referma doucement..."

1919 – La Symphonie pastorale
Les récits de Gide sont ainsi marqués par l’ambiguïté entre morale bourgeoise et pulsions intérieures : ici, un pasteur recueille une jeune aveugle, Gertrude, et prend peu à peu conscience que son intérêt pour elle n’est pas seulement une conscience évangélique, mais bien l’expression d’un désir charnel. C'est alors que, tout comme Gide lui-même, il relit l'Evangile d'un oeil nouveau et s'autorise de se laisser entraîner dans la passion avec une mauvaise foi inconsciente. Le scandale et le désastre refermeront sur lui le piège du désir charnel et de la "libre interprétations des Ecritures".
".. La neige est tombée encore abondamment cette nuit. Les enfants sont ravis parce que bientôt, disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. Le fait est que ce matin la porte est bloquée et que l’on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m’étais assuré que le village avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute demeurer quelque temps isolés du reste de l’humanité. Ce n’est pas le premier hiver que la neige nous bloque, mais je ne me souviens pas d’avoir jamais vu son empêchement si épais. J’en profite pour continuer ce récit que je commençai hier.
J’ai dit que je ne m’étais point trop demandé, lorsque j’avais ramené cette infirme, quelle place elle allait pouvoir occuper dans la maison. Je connaissais le peu de résistance de ma femme ; je savais la place dont nous pouvions disposer et nos ressources, très limitées. J’avais agi, comme je le fais toujours, autant par disposition naturelle que par principes, sans nullement chercher à calculer la dépense où mon élan risquait de m’entraîner (ce qui m’a toujours paru anti évangélique). Mais autre chose est d’avoir à se reposer sur Dieu ou à se décharger sur autrui.
Il m’apparut bientôt que j’avais déposé sur les bras d’Amélie une lourde tache, si lourde que j’en demeurai d’abord confondu. Je l’avais aidée de mon mieux à couper les cheveux de la petite, ce que je voyais bien qu’elle ne faisait déjà qu’avec dé- goût. Mais quand il s’agit de la laver et de la nettoyer je dus laisser faire ma femme ; et je compris que les plus lourds et les plus désagréables soins m’échappaient. Au demeurant, Amélie n’éleva plus la moindre protestation. Il semblait qu’elle eût réfléchi pendant la nuit et pris son parti de cette charge nouvelle ; même elle y semblait prendre quelque plaisir et je la vis sourire après qu’elle eut achevé d’apprêter Gertrude. Un bonnet blanc couvrait la tête rase où j’avais appliqué de la pommade ; quelques anciens vêtements à Sarah et du linge propre remplacèrent les sordides haillons qu’Amélie venait de jeter au feu.
Ce nom de Gertrude fut choisi par Charlotte et accepté par nous tous aussitôt, dans l’ignorance du nom véritable que l’orpheline ne connaissait point elle-même et que je ne savais où retrouver. Elle devait être un peu plus jeune que Sarah, de sorte que les vêtements que celle-ci avait dû laisser depuis un an lui convenaient. Il me faut avouer ici la profonde déception où je me sentis sombrer les premiers jours. Certainement je m’étais fait tout un roman de l’éducation de Gertrude, et la réalité me forçait par trop d’en rabattre. L’expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue glaçait jusqu’à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour, auprès du feu, sur la défensive, et dès qu’elle entendait nos voix, surtout dès que l’on s’approchait d’elle, ses traits semblaient durcir ; ils ne cessaient d’être inexpressifs que pour marquer l’hostilité ; pour peu que l’on s’efforçât d’appeler son attention elle commençait à geindre, à grogner comme un animal.
Cette bouderie ne cédait qu’à l’approche du repas, que je lui servais moi-même, et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale des plus pénibles à observer. Et de même que l’amour répond à l’amour, je sentais un sentiment d’aversion m’envahir, devant le refus obstiné de cette âme. Oui, vraiment, j’avoue que les dix premiers jours j’en étais venu à désespérer, et même à me désintéresser d’elle au point que je regrettais mon élan premier et que j’eusse voulu ne l’avoir jamais emmenée.
Et il advenait ceci de piquant, c’est que, triomphante un peu devant ces sentiments que je ne pouvais pas bien lui cacher, Amélie prodiguait ses soins d’autant plus et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu’elle sentait que Gertrude me devenait à charge et que sa présence parmi nous me mortifiait.
J’en étais là, quand je reçus la visite de mon ami le docteur Martins, du Val Travers, au cours d’une de ses tournées de malades. Il s’intéressa beaucoup à ce que je lui dis de l’état de Gertrude, s’étonna grandement d’abord de ce qu’elle fût restée à ce point arriérée, n’étant somme toute qu’aveugle ; mais je lui expliquai qu’à son infirmité s’ajoutait la surdité de la vieille qui seule jusqu’alors avait pris soin d’elle, et qui ne lui parlait jamais, de sorte que la pauvre enfant était demeurée dans un état d’abandon total. Il me persuada que, dans ce cas, j’avais tort de désespérer ; mais que je ne m’y prenais pas bien.
– Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t’être assuré d’un terrain solide. Songe que tout est chaos dans cette âme et que même les premiers linéaments n’en sont pas encore arrêtés. Il s’agit, pour commencer, de lier en faisceau quelques sensations tactiles et gustatives et d’y attacher, à la manière d’une étiquette, un son, un mot, que tu lui rediras, à satiété, puis tâcheras d’obtenir qu’elle redise. « Surtout ne cherche pas d’aller trop vite ; occupe-toi d’elle à des heures régulières et jamais très longtemps de suite… "
LA SYMPHONIE PASTORALE, récit d'André Gide - Le pasteur d`un petit pays du Jura, âme délicate et sensible qui tend à la sainteté, tient son journal. ll recueille chez lui, au sein de sa propre famille, la petite Gertrude, une pauvre orpheline, aveugle de naissance. Le pasteur se voue passionnément à son éducation, et la guide sur la voie spirituelle. Mais en réalité, au fur et à mesure que l`enfant grandit, l'amour que lui porte son père adoptif perd de sa pureté. Le pasteur, aussi incapable de voir le mal en lui que chez les autres, ne s`aperçoit pas du sentiment qui naît en lui et qu'ont deviné sa femme et son fils Jacques. Jacques est lui aussi amoureux de Gertrude. Il s'efface après avoir provoqué le courroux de son père; mais une certaine tension subsiste entre eux deux, tension qu'accroissent des divergences religieuses. Ayant découvert que son fils le blâme, le pasteur reste déconcerté ; il voit enfin clair en lui-même, mais ne sait comment réagir en face des marques d'affection que lui prodigue Gertrude; et l`idée que la jeune fille pourra retrouver la vue après une opération ne fait qu'ajouter à son trouble.
L'opération réussit, et Gertrude revient au village. Mais avant d`arriver à la maison du pasteur, elle se jette dans la rivière, près du moulin. Elle ne survit à sa tentative de suicide que pour confesser au pasteur qu'elle a vu Jacques à l'hôpital, qu`il l'a convertie au catholicisme. Une fois que la vue lui a été rendue, elle s`est trouvée dans un monde à la fois beaucoup plus beau et beaucoup plus perverti que celui que lui avait décrit son maître. Elle a pris conscience des sentiments de celui-ci et de l'amour qu'elle portait à Jacques. Dès lors, la certitude l'a accablée qu'elle allait être le sujet d'un drame. Le journal s'achève par la nouvelle que Jacques va se faire moine.
Les récits de Gide ne sont pas de simples contes philosophiques menés avec une ironie rigoureuse : le mode de vie, la doctrine qui forme le ressort de chaque œuvre ont été ardemment expérimentés par l'auteur, comme une possibilité, comme une solution, comme une tentation à laquelle il s'abandonne. De sorte que les pages de cette Symphonie sont imprégnées de ferveur et pleines de découvertes. La poésie et la délicate atmosphère dans lesquelles baigne l'œuvre contribuent à l'enchantement du lecteur et ne tendent à s'évanouir que vers la fin, lorsque cette déconcertante histoire sombre dans le tragique.

1920-1924 – Si le Grain ne meurt
Si le grain ne meurt est l'autobiographie de l'écrivain français André Gide. Publié en 1924, ce récit recouvre la vie de Gide depuis sa première enfance à Paris jusqu'à ses fiançailles avec sa cousine Madeleine Rondeaux (appelée ici Emmanuèle) en 1895. Le livre se compose de deux parties. Dans la première, l'auteur raconte ses souvenirs d'enfance: ses précepteurs, sa fréquentation discontinue de l'Ecole alsacienne, sa famille, son amitié avec Pierre Louÿs, la naissance de sa vénération pour sa cousine, ses premières tentatives d'écriture. Dans la seconde partie, beaucoup plus courte, il retrace sa découverte du désir et de son penchant homosexuel, lors d'un voyage en Algérie. Certains épisodes pouvaient, au moment de la publication du livre, scandaliser le public pour leur propagation de la pédérastie et pour leurs représentations minutieuses de scènes de débauche. Gide fait le récit de l'échec total de sa vie conjugale avec Madeleine dans un autre récit autobiographique, écrit en 1938 peu après la mort de sa femme, publié en 1951 et intitulé Et nunc manet in te.
".. Les faits dont je dois à présent le récit, les mouvements de mon cœur et de ma pensée, je veux les présenter dans cette même lumière qui me les éclairait d’abord, et ne laisser point trop paraître le jugement que je portai sur eux par la suite. D’autant que ce jugement a plus d’une fois varié et que je regarde ma vie tour à tour d’un œil indulgent ou sévère suivant qu’il fait plus ou moins clair au-dedans de moi. Enfin, s’il m’est récemment apparu qu’un acteur important : le Diable, avait bien pu prendre part au drame, je raconterai néanmoins ce drame sans faire intervenir d’abord celui que je n’identifiai que longtemps plus tard. Par quels détours je fus mené, vers quel aveuglement de bonheur, c’est ce que je me propose de dire.
En ce temps de ma vingtième année, je commençai de me persuader qu’il ne pouvait m’advenir rien que d’heureux ; je conservai jusqu’à ces derniers mois cette confiance, et je tiens pour un des plus importants de ma vie l’événement qui m’en fit douter brusquement. Encore après le doute me ressaisis-je – tant est exigeante ma joie ; tant est forte en moi l’assurance que l’événement le plus malheureux en première apparence reste celui qui, bien considéré, peut aussi le mieux nous instruire, qu’il y a quelque profit dans le pire, qu’à quelque chose malheur est bon, et que si nous ne reconnaissons pas plus souvent le bonheur, c’est qu’il vient à nous avec un visage autre que celui que nous attendions.
Mais assurément j’anticipe, et vais gâcher tout mon récit si je donne pour acquis déjà l’état de joie, qu’à peine j’imaginais possible, qu’à peine, surtout, j’osais imaginer permis. Lorsque ensuite je fus mieux instruit, certes tout cela m’a paru plus facile ; j’ai pu sourire des immenses tourments que de petites difficultés me causaient, appeler par leur nom des velléités indistinctes encore et qui m’épouvantaient parce que je n’en discernais point le contour. En ce temps il me fallait tout découvrir, inventer à la fois et le tourment et le remède, et je ne sais lequel des deux m’apparaissait le plus monstrueux. Mon éducation puritaine m’avait ainsi formé, donnait telle importance à certaines choses, que je ne concevais point que les questions qui m’agitaient ne passionnassent point l’humanité tout entière et chacun en particulier. J’étais pareil à Prométhée qui s’étonnait qu’on pût vivre sans aigle et sans se laisser dévorer. Au demeurant, sans le savoir, j’aimais cet aigle ; mais avec lui je commençais de transiger. Oui, le problème pour moi restait le même, mais, en avançant dans la vie, je ne le considérais déjà plus si terrible, ni sous un angle aussi aigu. – Quel problème ? – Je serais bien en peine de le définir en quelques mots.
Mais, d’abord n’était-ce pas déjà beaucoup qu’il y eût problème ? – Le voici, réduit au plus simple : Au nom de quel Dieu, de quel idéal me défendez-vous de vivre selon ma nature ? Et cette nature, où entraînerait-elle, si simplement je la suivais ? – Jusqu’à présent j’avais accepté la morale du Christ, ou du moins certain puritanisme que l’on m’avait enseigné comme étant la morale du Christ. Pour m’efforcer de m’y soumettre, je n’avais obtenu qu’un profond désarroi de tout mon être. Je n’acceptais point de vivre sans règles, et les revendications de ma chair ne savaient se passer de l’assentiment de mon esprit. Ces revendications, si elles eussent été plus banales, je doute si mon trouble en eût été moins grand. Car il ne s’agissait point de ce que réclamait mon désir, aussi longtemps que je croyais lui devoir tout refuser.
Mais j’en vins alors à douter si Dieu même exigeait de telles contraintes ; s’il n’était pas impie de regimber sans cesse, et si ce n’était pas contre Lui ; si, dans cette lutte où je me divisais, je devais raisonnablement donner tort à l’autre. J’entrevis enfin que ce dualisme discordant pourrait peut-être bien se résoudre en une harmonie. Tout aussitôt il m’apparut que cette harmonie devait être mon but souverain, et de chercher à l’obtenir la sensible raison de ma vie. Quand en octobre 93, je m’embarquai pour l’Algérie, ce n’est point tant vers une terre nouvelle, mais bien vers cela, vers cette toison d’or, que me précipitait mon élan. J’étais résolu à partir ; mais j’avais longtemps hésité si je ne suivrais pas mon cousin Georges Pouchet, ainsi qu’il m’y invitait, dans une croisière scientifique en Islande ; et j’hésitais encore, lorsque Paul Laurens reçut, en prix de je ne sais plus quel concours, une bourse de voyage qui l’obligeait à un exil d’un an ; le choix qu’il fit de moi pour compagnon décida de ma destinée. Je partis donc avec mon ami ; sur le navire Argo, l’élite de la Grèce ne frémissait point d’un plus solennel enthousiasme. J’ai dit, je crois, que nous étions exactement de même âge ; nous avions même taille, même aspect, même démarche, mêmes goûts.
De sa fréquentation avec les élèves des beaux-arts, il avait rapporté un ton d’assurance un peu gouailleur qui cachait une grande retenue naturelle ; aussi l’habitude d’un tour funambulesque, qui faisait mon admiration et ma joie, mais aussi mon désespoir lorsque j’y comparais l’ankylose de mon esprit. Je fréquentais Paul moins souvent que Pierre Louis, peut- être ; mais il me semble que j’avais pour le premier une affection plus véritable et plus capable de développement. Pierre avait dans le caractère je ne sais quoi d’agressif, de romantique et de contrecarrant qui mouvementait à l’excès nos rapports.
Le caractère de Paul au contraire était tout souplesse ; il ondoyait avec le mien. À Paris je ne le voyais guère qu’en compagnie de son frère, qui, de tempérament plus entier et bien qu’un peu plus jeune, nous bousculait, de sorte qu’avec lui la conversation se faisait sommaire. Deux fois par semaine une leçon d’escrime que j’allais prendre chez eux, le soir, était prétexte à des lectures et des entretiens prolongés. Nous sentions, Paul et moi, notre amitié grandir et découvrions avec ravissement l’un dans l’autre toutes sortes de possibilités fraternelles. Nous en étions au même point de la vie ; pourtant il y avait entre nous cette différence, que son cœur était libre, le mien accaparé par mon amour ; mais ma résolution était prise de ne m’en laisser pas empêcher.
Après la publication de mes Cahiers, le refus de ma cousine ne m’avait point découragé peut-être, mais du moins m’avait forcé de reporter plus loin mon espoir ; aussi bien, je l’ai dit, mon amour demeurait-il quasi mystique ; et si le diable me dupait en me faisant considérer comme une injure l’idée d’y pouvoir mêler quoi que ce fût de charnel, c’est ce dont je ne pouvais encore me rendre compte ; toujours est-il que j’avais pris mon parti de dissocier le plaisir de l’amour ; et même il me paraissait que ce divorce était souhaitable, que le plaisir était ainsi plus pur, l’amour plus parfait, si le cœur et la chair ne s’entr’engageaient point. Oui, Paul et moi, nous étions résolus, quand nous partîmes…
Et si l’on me demande peut-être comment Paul, élevé moralement sans doute, mais selon une morale catholique et non puritaine, dans un milieu d’artistes et provoqué sans cesse par les rapins et les modèles, avait pu, passé vingt-trois ans, rester puceau – je répondrai que je raconte ici mon histoire et non point la sienne et qu’un tel cas est du reste beaucoup plus fréquent qu’on ne croit ; car le plus souvent il répugne à se laisser connaître. Timidité, pudeur, dégoût, fierté, sentimentalité mal comprise, effarouchement nerveux à la suite d’une maladroite expérience (c’était le cas de Paul, je crois) tout cela retient sur le seuil. Alors, c’est le doute, le trouble, le romantisme et la mélancolie ; de tout cela nous étions las ; de tout cela nous voulions sortir.
Mais ce qui nous dominait surtout, c’était l’horreur du particulier, du bizarre, du morbide, de l’anormal. Et dans les conversations que nous avions avant le départ, nous nous poussions, je me souviens, vers un idéal d’équilibre, de plénitude et de santé. Ce fut, je crois bien, ma première aspiration vers ce qu’on appelle aujourd’hui le « classicisme » ; à quel point il s’opposait à mon premier idéal chrétien, c’est ce que je ne saurais jamais assez dire ; et je le compris aussitôt si bien, que je me refusai d’emporter avec moi ma Bible. Ceci, qui peut-être n’a l’air de rien, était de la plus haute importance : jusqu’alors il ne s’était point passé de jour que je ne puisasse dans le saint livre mon aliment moral et mon conseil...."

Gide qui, dans L'Immoraliste et Les Faux-Monnayeurs, a peint tant d'adolescents complexes, dissimulés et instinctivement cruels, a pu faire sur lui-même l'observation de la perversité enfantine: aptitude à la comédie, remords impuissants à la pensée de l'inquiétude, mouvement de défense instinctif contre la perspicacité des adultes, sentiment de l'échec suivi d'un mouvement de haine enfantine, tout est ici révélateur d'une "météorologie intime" extrêmement compliquée. En même temps s'affirme le narrateur adulte dans son engagement de sincérité, dans la restitution de l'aveu pénible. Cette page peut être rapprochée de maintes pages semblables dans "les Confessions" de Rousseau ou dans "la Vie de Henri Brulard" de Stendhal...
"Voici, je crois, comment cela commença: Au premier jour qu'on me permit de me lever, un certain vertige faisait chanceler ma démarche, comme il est naturel après trois semaines de lit. Si ce vertige était un peu plus fort, pensai-je, puis-je imaginer ce qui se passerait? Oui, sans doute: ma tête, je la sentirais fuir en arrière; mes genoux fléchiraient (j'étais dans le petit couloir qui menait de ma chambre à celle de ma mère) et soudain je croulerais à la renverse. Oh! me disais-je, imiter ce qu'on imagine! Et tandis que j'imaginais, déjà je pressentais quelle détente, quel répit je goûterais à céder à l'invitation de mes nerfs. Un regard en arrière, pour m'assurer de l'endroit où ne pas me faire trop de mal en tombant...
Dans la pièce voisine, j'entendis un cri. C'était Marie; elle accourut. Je savais que ma mère était sortie; un reste de pudeur, ou de pitié, me retenait encore devant elle; mais je comptais qu'il lui serait tout rapporté. ,Après ce coup d'essai, presque étonné d'abord qu'il réussît, promptement enhardi, devenu plus habile et plus décidément inspiré, je hasardai d'autres mouvements, que tantôt j'inventais saccadés et brusques, que tantôt je prolongeais au contraire, répétais et rythmais en danses. ]'y devins fort expert et possédai bientôt un répertoire assez varié : celle-ci se sautait presque sur place ; cette autre nécessitait le peu d'espace de la fenêtre à mon lit, sur lequel, tout debout, à chaque retour, je me lançais: en tout trois bonds bien exactement réussis; et cela près d'une heure durant. Une autre enfin que j'exécutais couché, les couvertures rejetées, consistait en une série de ruades en hauteur, scandées comme celles des jongleurs japonais.
Maintes fois par la suite je me suis indigné contre moi-même, doutant où je pusse trouver le cœur, sous les yeux de ma mère, de mener cette comédie. Mais avouerai-je qu'aujourd'hui cette indignation ne me paraît pas bien fondée. Ces mouvements que je faisais, s'ils étaient conscients, n'étaient qu'à peu près volontaires. C'est-à-dire que, tout au plus, j'aurais pu les retenir un peu. Mais j'éprouvais le plus grand soulas à les faire. Ah! que de fois, longtemps ensuite, souffrant des nerfs, ai-je pu déplorer de n'être plus à un âge où quelques entrechats...
Dès les premières manifestations de ce mal bizarre, le docteur Leenhardt appelé avait pu rassurer ma mère: les nerfs, rien que les nerfs, disait-il; mais comme tout de même je continuais de gigoter, il jugea bon d'appeler à la rescousse deux confrères. La consultation eut lieu, je ne sais comment ni pourquoi, dans une chambre de l'hôtel Nevet. Ils étaient là, trois docteurs, Leenhardt, Theulon et Boissier; ce dernier, médecin de Lamalou-les-Bains, où il était question de m'envoyer. Ma mère assistait, silencieuse.
J'étais un peu tremblant du tour que prenait l'aventure; ces vieux Messieurs, dont deux à barbe blanche, me retournaient dans tous les sens, m'auscultaient, puis parlaient entre eux à voix basse. Allaient-ils me percer à jour? dire, l'un d'eux, M. Theulon à l'œil sévère:
- Une bonne fessée, Madame, voilà ce qui convient à cet enfant P...
Mais non; et plus ils m'examinent, plus semble les pénétrer le sentiment de l'authenticité de mon cas. Après tout, puis-je prétendre en savoir sur moi-même plus long que ces Messieurs? En croyant les tromper, c'est sans doute moi que je trompe.
La séance est finie.
]e me rhabille. Theulon paternellement se penche, veut m'aider; Boissier aussitôt l'arrête; je surprends de lui à Theulon un petit geste, un clin d'œil, et suis averti qu'un regard malicieux, fixé sur moi, m'observe, veut m'observer encore, alors que je ne me sache plus observé, qu`il épie le mouvement de mes doigts, ce regard, tandis que je reboutonne ma veste. - "Avec le petit vieux que voilà, s'il m'accompagne à Lamalou, il va falloir jouer serré", pensai-je, et, sans en avoir l'air, je lui servis quelques grimaces de supplément, du bout des doigts trébuchant dans les boutonnières.
Quelqu'un qui ne prenait pas au sérieux ma maladie, c'était mon oncle; et comme je ne savais pas encore qu'il ne prenait au sérieux les maladies de personne, j'étais vexé. J'étais extrêmement vexé, et résolus de vaincre cette indifférence en jouant gros. Ah! quel souvenir misérable! Comme je sauterais par-dessus, si j'acceptais de rien omettre! - Me voici dans l'antichambre de l'appartement, rue Salle-l'Évêque; mon oncle vient de sortir de sa bibliothèque et je sais qu'il va repasser; je me glisse sous une console, et, quand il revient, j'attends d'abord quelques instants, si peut-être il m'apercevra de lui-même, car l'antichambre est vaste et mon oncle va lentement; mais il tient à la main un journal qu”il lit tout en marchant; encore un peu et il va passer outre...
Je fais un mouvement; je pousse un gémissement; alors il s'arrête, soulève son lorgnon et, de par-dessus son journal:
- Tiens! Qu'est-ce que tu fais là?
Je me crispe, me contracte, me tords et, dans une espèce de sanglot que je voudrais irrésistible:
- Je souffre, dis-je.
Mais tout aussitôt j'eus la conscience du fiasco: mon oncle remit le lorgnon sur son nez, son nez dans son journal, rentra dans sa bibliothèque dont il referma la porte de l'air le plus quiet. O honte ! Que me restait-il à faire, que me relever, secouer la poussière de mes vêtements, et détester mon oncle; à quoi je m'appliquais de tout mon cœur
( Si le Grain ne meurt, éditions Gallimard).

Madeleine Rondeaux, à qui Gide fut tant attaché et qui devint sa femme, apparaît sous divers noms (Ellis, dans "le Voyage d'Urien" , Marceline, dans "L'Immoraliste", Alissa, dans "La Porte Étroite") et est l'Emmanuèle des "Cahiers d'André Walter" et garde ce nom dans "Si le Grain ne meurt". Pourquoi cet attachement? selon l'œuvre considérée, s'expriment le dévouement et le désir de protéger un être faible et blessé (la mère de Madeleine était une épouse assez frivole qui ridiculisa son mari). Ici Gide nous fait revivre l'instant où l'adolescent devine chez Madeleine l' "intolérable détresse" née d'un drame familial. Cette scène essentielle de sa vie, Gide en avait déjà fait le récit dans "La Porte Étroite" (1909), une première version qui semble plus proche de la réalité... Au Havre où il est en vacances, Gide revient le soir dans la maison de la rue de Lecat, mû par un instinctif besoin de surprendre, et, écrira-t-il, "ce soir-là, dit-il, mon goût du clandestin fut servi.."
"Dès le seuil, je flairai l'insolite. Contrairement à la coutume, la porte cochère n'était pas fermée, de sorte que je n'eus pas à sonner. Je me
glissais furtivement lorsque Alice, une peste femelle que ma tante avait à son service, surgit de derrière la porte du vestibule où, apparemment, elle était embusquée, et, de sa voix la moins douce:
- Eh quoi! c'est vous! Qu'est-ce que vous venez faire à présent?
Évidemment je n'étais pas celui qu'on attendait. Mais je passai sans lui répondre.
Au rez-de-chaussée se trouvait le bureau de mon oncle Émile, un morne petit bureau qui sentait le cigare, où il s'enfermait des demi-journées et où je crois que les soucis l'occupaient beaucoup plus que les affaires; il ressortait de là tout vieilli. Certainement il avait beaucoup vieilli ces derniers temps; je ne sais trop si j'aurais remarqué cela de moi-même, mais, après avoir entendu ma mère dire à ma tante Lucile: "Ce pauvre Émile a bien changé!" aussitôt m'était apparu le plissement douloureux de son front, l'expression inquiète et parfois harassée de son regard.
Mon oncle n'était pas à Rouen ce jour-là. Je montai sans bruit l'escalier sans lumière. Les chambres des enfants se trouvaient tout en haut; au-dessous, la chambre de ma tante et celle de mon oncle ; au premier, la salle à manger et le salon, devant lesquels je passai. Je m'apprêtais à franchir d'un bond le deuxième étage, mais la porte de la chambre de ma tante était grande ouverte; la chambre était très éclairée et répandait de la lumière sur le palier. Je ne jetai qu'un rapide coup d'œil; j'entrevis ma tante, étendue languissamment sur un sofa; auprès d'elle Suzanne et Louise, penchées, l'éventaient et lui faisaient, je crois, respirer des sels. Je ne vis pas Emmanuèle, ou, plus exactement, une sorte d'instinct m'avertit qu'elle ne pouvait pas être là. Par peur d'être aperçu et retenu, je passai vite. La chambre de ses sœurs, que je devais d'abord traverser, était obscure, ou du moins je n'avais pour me diriger que la clarté crépusculaire des deux fenêtres dont on n'avait pas encore fermé les rideaux. J'arrivai devant la porte de mon amie; je frappai doucement et, ne recevant pas de réponse, j'allais frapper encore, mais la porte céda, qui n'était pas close. Cette chambre était plus obscure encore ; le lit en occupait le fond; contre le lit je ne distinguai pas d'abord Emmanuèle, car elle était agenouillée. ]'allais me retirer, croyant la chambre vide, mais elle m'appela :
- Pourquoi viens-tu? Tu n'aurais pas dû revenir...
Elle ne s'était pas relevée. Je ne compris pas aussitôt qu'elle était triste. C'est en sentant ses larmes sur ma joue que tout à coup mes yeux s'ouvrirent. Il ne me plaît point de rapporter ici le détail de son angoisse, non plus que l'histoire de cet abominable secret qui la faisait souffrir, et dont à ce moment je ne pouvais du reste à peu près rien entrevoir. Je pense aujourd'hui que rien ne pouvait être plus cruel, pour une enfant qui n'était que pureté, qu'amour et que tendresse, que d'avoir à juger sa mère et à réprouver sa conduite; et ce qui renforçait le tourment, c'était de devoir garder pour elle seule, et cacher à son père qu'elle vénérait, ce secret qu'elle avait surpris je ne sais comment et qui l'avait meurtrie - ce secret dont on jasait en ville, dont riaient les bonnes et qui se jouait de l'innocence et de l'insouciance de ses deux sœurs. Non, de tout cela je ne devais rien comprendre que plus tard ; mais je sentais que, dans ce petit être que déjà je chérissais, habitait une grande, une intolérable détresse, un chagrin tel que je n'aurais pas trop de tout mon amour, toute ma vie, pour l'en guérir. Que dirais-je de plus ?... ]'avais erré jusqu'à ce jour à l'aventure; je découvrais soudain un nouvel orient à ma vie..."
(Si le Grain ne meurt, éditions Gallimard).
Dans "La Porte étroite" (1909), la scène comporte l' "objet" du délit,
".. La bonne qui m'a ouvert m'arrête:
- Ne montez pas, monsieur Jérôme l ne montez pas : madame a sa crise.
Mais je passe outre: - Ce n'est pas ma tante que je viens voir... La chambre d'Alissa est au troisième étage. Au premier, le salon et la salle à manger ; au second, la chambre de ma tante d'où jaillissent des voix. La porte est ouverte, devant laquelle il faut passer; un rais de lumière sort de la chambre et coupe le palier de l'escalier; par crainte d'être vu, j'hésite un instant, me dissimule, et, plein de stupeur, je vois ceci : au milieu de la chambre aux rideaux clos, mais où les bougies de deux candélabres répandent une clarté joyeuse, ma tante est couchée sur une chaise longue; à ses pieds, Robert et Juliette; derrière elle, un inconnu jeune homme en uniforme de lieutenant. - La présence de ces deux enfants m'apparaît aujourd'hui monstrueuse ; dans mon innocence d'alors, elle me rassura plutôt.
Ils regardent en riant l'inconnu qui répète d'une voix flûtée:
- Bucolin! Bucolin !... Si j'avais un mouton, sûrement je l'appellerais Bucolin.
Ma tante elle-même rit aux éclats. Je la vois tendre au jeune homme une cigarette qu'il allume et dont elle tire quelques bouffées. La cigarette tombe à terre. Lui s'élance pour la ramasser, feint de se prendre les pieds dans une écharpe, tombe à genoux devant ma tante...
A la faveur de ce ridicule jeu de scène, je me glisse sans être vu. Me voici devant la porte d'Alissa. J'attends un instant. Les rires et les éclats de voix montent de l'étage inférieur ; et peut-être ont-ils couvert le bruit que j'ai fait en frappant, car je n'entends pas de réponse. Je pousse la porte, qui cède silencieusement. La chambre est déjà si sombre que je ne distingue pas aussitôt Alissa; elle est au chevet de son lit, à genoux, tournant le dos à la croisée d'où tombe un jour mourant. Elle se retourne, sans se relever pourtant, quand j'approche; elle murmure:
- Oh ! Jérôme, pourquoi reviens-tu?
Je me baisse pour l'embrasser; son visage est noyé de larmes...
Cet instant décida de ma vie ; je ne puis encore aujourd'hui le remémorer sans angoisse. Sans doute je ne comprenais que bien imparfaitement la cause de la détresse d'Alissa, mais je sentais intensément que cette détresse était beaucoup trop forte pour cette petite âme palpitante, pour ce frêle corps tout secoué de sanglots..."
(La Porte Étroite, éditions Gallimard).

1925 – Les Faux-Monnayeurs
C'est la première oeuvre que Gide qualifia de Roman en faisant entrer plusieurs points de vue, les faits et gestes d'un petit groupe de collégiens, mais ne peut s'empêcher de privilégier un personnage, Bernard Profitendieu, qui s'est toujours senti mal à l'aise dans son milieu familial où règne un puritanisme inflexible. Oeuvre complexe, qualifiée de grand romain mais sans unité, et qui vaut par ce qu'elle renferme de confession, "Les Faux-Monnayeurs" vaudront à Gide un nouveau succès ....
"« C’est le moment de croire que j’entends des pas dans le corridor », se dit Bernard. Il releva la tête et prêta l’oreille. Mais non : son père et son frère aîné étaient retenus au Palais ; sa mère en visite ; sa sœur à un concert ; et quant au puîné, le petit Caloub, une pension le bouclait au sortir du lycée chaque jour. Bernard Profitendieu était resté à la maison pour potasser son bachot ; il n’avait plus devant lui que trois semaines.
La famille respectait sa solitude ; le démon pas. Bien que Bernard eût mis bas sa veste, il étouffait. Par la fenêtre ouverte sur la rue n’entrait rien que de la chaleur. Son front ruisselait. Une goutte de sueur coula le long de son nez, et s’en alla tomber sur une lettre qu’il tenait en main :
« Ça joue la larme, pensa-t-il. Mais mieux vaut suer que de pleurer. »
Oui, la date était péremptoire. Pas moyen de douter : c’est bien de lui, Bernard, qu’il s’agissait. La lettre était adressée à sa mère ; une lettre d’amour vieille de dix-sept ans ; non signée.
« Que signifie cette initiale ? Un V, qui peut aussi bien être un N… Sied-il d’interroger ma mère ?… Faisons crédit à son bon goût. Libre à moi d’imaginer que c’est un prince. La belle avance si j’apprends que je suis le fils d’un croquant ! Ne pas savoir qui est son père, c’est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. Toute recherche oblige. Ne retenons de ceci que la délivrance. N’approfondissons pas. Aussi bien j’en ai mon suffisant pour aujourd’hui. »
Bernard replia la lettre. Elle était de même format que les douze autres du paquet. Une faveur rose les attachait, qu’il n’avait pas eu à dénouer ; qu’il refit glisser pour ceinturer comme auparavant la liasse. Il remit la liasse dans le coffret et le coffret dans le tiroir de la console. Le tiroir n’était pas ouvert ; il avait livré son secret par en haut. Bernard rassujettit les lames disjointes du plafond de bois, que devait recouvrir une lourde plaque d’onyx.
Il fit doucement, précautionneusement, retomber celle-ci, replaça par-dessus deux candélabres de cristal et l’encombrante pendule qu’il venait de s’amuser à réparer. La pendule sonna quatre coups. Il l’avait remise à l’heure.
« Monsieur le juge d’instruction et Monsieur l’avocat son fils ne seront pas de retour avant six heures. J’ai le temps. Il faut que Monsieur le juge, en rentrant, trouve sur son bureau la belle lettre où je m’en vais lui signifier mon départ. Mais avant de l’écrire, je sens un immense besoin d’aérer un peu mes pensées – et d’aller retrouver mon cher Olivier, pour m’assurer, provisoirement du moins, d’un perchoir. Olivier, mon ami, le temps est venu pour moi de mettre ta complaisance à l’épreuve et pour toi de me montrer ce que tu vaux. Ce qu’il y avait de beau dans notre amitié, c’est que, jusqu’à présent, nous ne nous étions jamais servis l’un de l’autre. Bah ! un service amusant à rendre ne saurait être ennuyeux à demander. Le gênant, c’est qu’Olivier ne sera pas seul. Tant pis ! je saurai le prendre à part. Je veux l’épouvanter par mon calme. C’est dans l’extraordinaire que je me sens le plus naturel. »
La rue de T…, où Bernard Profitendieu avait vécu jusqu’à ce jour, est toute proche du jardin du Luxembourg. Là, près de la fontaine Médicis, dans cette allée qui la domine, avaient coutume de se retrouver, chaque mercredi entre quatre et six, quelques-uns de ses camarades. On causait art, philosophie, sports, politique et littérature.
Bernard avait marché très vite ; mais en passant la grille du jardin il aperçut Olivier Molinier et ralentit aussitôt son allure. L’assemblée ce jour-là était plus nombreuse que de coutume, sans doute à cause du beau temps. Quelques-uns s’y étaient adjoints que Bernard ne connaissait pas encore.
Chacun de ces jeunes gens, sitôt qu’il était devant les autres, jouait un personnage et perdait presque tout naturel. Olivier rougit en voyant approcher Bernard et, quittant assez brusquement une jeune femme avec laquelle il causait, s’éloigna. Bernard était son ami le plus intime, aussi Olivier prenait-il grand soin de ne paraître point le rechercher ; il feignait même parfois de ne pas le voir. Avant de le rejoindre, Bernard devait affronter plusieurs groupes, et, comme lui de même affectait de ne pas rechercher Olivier, il s’attardait. Quatre de ses camarades entouraient un petit barbu à pince-nez, sensiblement plus âgé qu’eux, qui tenait un livre. C’était Dhurmer.
« Qu’est-ce que tu veux, disait-il en s’adressant plus particulièrement à l’un des autres, mais manifestement heureux d’être écouté par tous. J’ai poussé jusqu’à la page trente sans trouver une seule couleur, un seul mot qui peigne. Il parle d’une femme ; je ne sais même pas si sa robe était rouge ou bleue. Moi, quand il n’y a pas de couleurs, c’est bien simple, je ne vois rien. »
– Et par besoin d’exagérer, d’autant plus qu’il se sentait moins pris au sérieux, il insistait : « Absolument rien. »
Bernard n’écoutait plus le discoureur ; il jugeait malséant de s’écarter trop vite, mais déjà prêtait l’oreille à d’autres qui se querellaient derrière lui et qu’Olivier avait rejoints après avoir laissé la jeune femme ; l’un de ceux-ci, assis sur un banc, lisait l’Action française..."
"LES FAUX-MONNAYEURS", d'André Gide, histoire, assez compliquée qui nous dévoile dans toute leur diversité les faits et gestes d'un petit groupe de garçons, collégiens ou étudiants. Bemard Profitendieu, fils d`un haut magistrat connu pour son intégrité, s`est toujours senti mal à l'aise dans son milieu 'familial où règne un puritanisme inflexible. Or, il découvre qu'il n'est pas le fils de ce dernier, qu'il n`est que le fruit d`une faute de sa mère, jalousement tenue secrète. C'est assez pour qu`il se révolte. Son ami Olivier Molinier subit, tout autant que lui, l'attirance de l`aventure, mais, étant plus timoré, il espère aide et conseil d'un oncle, Edouard, lequel est écrivain et lui manifeste un certain intérêt. Olivier a un frère aîné, Vincent, un médecin de grand avenir, mais pusillanime et ambitieux, qui ne songe, pour le quart d`heure, qu'à se débarrasser de l'amour de Laura Védel-Azaïs, - une jeune femme rencontrée dans un sanatorium et dont il est fatigué. ll aura ainsi toute latitude pour courtiser lady Lilian Griffith, créature fort élégante et des plus perverses. Par l'intermédiaire de son frère Vincent, Olivier fait la connaissance du comte de Passavant, homme de lettres vulgaire et de mœurs douteuses. Celui-ci est en train de fonder une revue et veut avoir, en plus de l'avis des jeunes gens, leur contribution effective. Enfin, Georges, le dernier frère d`Olivier, qui fréquente l`école Védel-Azaïs, passe encore pour un gamin. mais n'en a pas moins, lui aussi, une vie secrète.
Ces personnages et ceux qui forment leur entourage sont représentés avec précision et brièveté dans le journal intime d'Edouard, l'écrivain. Edouard se trouve nécessairement au centre de leurs activités multiples, étant à la fois l'oncle d'Olivier et une vieille connaissance de Passavant. Bien plus, il a fait ses études à la pension du vieil Azaïs et du pasteur Védel, son gendre, et il entretient des relations fraternelles avec les trois filles de ce dernier, Laura, Rachel et Sarah. C'est donc à Edouard que la malheureuse Laura, abandonnée par Vincent, demandera du secours, tandis que Bernard Profitendieu, qui a rompu avec sa
famille, se fait engager par lui comme secrétaire. L`écrivain réunit des matériaux pour un roman qui doit s'intituler Les Faux-Monnayeurs, titre allégorique et moral qui se trouve étrangement étayé par la découverte qu'il fait d'une bande de faux-monnayeurs, lesquels sont précisément en relation avec ses jeunes amis.
Mais cette bande n`est en fait qu'une sorte de société secrète d'étudiants dont fait partie Georges Molinier : la "Confrérie des hommes forts", et que la funeste influence d'un de ses membres, Strouvilhou, est en train de transformer en une véritable association de malfaiteurs.
Le vieil Azaïs, homme de grande vertu, résolument optimiste, est amené à découvrir, dans sa propre famille comme dans sa pension, les désordres les plus insoupçonnés et, les plus effrayants : l'aventure de Laura, le déshonneur de Sarah, une autre de ses petites-filles, enfin l'activité suspecte de ce cercle d'écoliers, laquelle débouche dans le crime avec le suicide "commandé" du pauvre petit Boris. Pendant ce temps, Vincent Molinier, parti pour l'Afrique avec lady Griffith, tue cette dernière et devient fou. Edouard protège Olivier et le soustrait à la mauvaise influence de Passavant. Quant à Bernard, la noblesse naturelle de son caractère se trouve particulièrement mise en évidence ; parti d'un état de révolte qui aurait dû le conduire aux pires excès, le jeune garçon saura tirer parti des aventures auxquelles il fut mêlé (il aime tour à tour Laura et Sarah de deux manières très différentes), pour trouver le fond véritable de son cœur, et se forger une morale solide et bien vivante. Vaincu par l'affection généreuse de son père putatif, le juge Profitendieu, Bernard consent à regagner la maison familiale.
De l'évolution du seul caractère de Bernard, il est possible de tirer l'enseignement moral que Gide a voulu inclure dans son livre, livre des plus riches en données contradictoires, et qui rassemble les idées les plus chères à l`auteur. Il y a tenté de faire entrer nombre de points de vue sur la vie, de manière à donner une vision aussi complète que possible. Il s`efforce de surprendre la réalité dans les aspects successifs de son devenir, en se référant continuellement à une vérité d'ordre spirituel (comme dans "Le Traité du Narcisse", qui est antérieur). ll ne laisse pas, non plus de défendre (dans les relations Edouard-Olivier) une certaine forme d`homosexualité qu'il juge des plus salutaires. Tant de complexité feront du roman un des livres les plus révélateurs de la littérature de l'après-guerre. Le Journal des Faux-Monnayeurs, que Gide publiera en 1926, expose les exigences d'ordre poétique et technique qui ont nourrit l'écrivain pendant l`élaboration de l`œuvre...
"Incidences", 1924 - "La génération dont je fais partie était casanière; elle ignorait beaucoup l'étranger, et loin de souffrir de cette ignorance, était prête à s’en glorifier. Trop facilement convaincue qu’elle n’ignorait que ce qui ne valait pas la peine d’être connu, elle trouvait dans cette ignorance même - une garantie de supériorité. Il me semble que la génération qui nous succède est plus curieuse; elle ne méconnaît point le plaisir et le profit de l’aventure; elle ne se sent plus, comme la nôtre, revenue de tout sans être allée nulle part. Elle comprend comme il faut l’histoire de la femme de Loth et qu’à reporter ses regards en arrière, à contempler sans cesse « la Terre et les Morts », on devient une statue de sel. Ce qu’elle cherche dans la tradition et dans l’étude du passé, c’est un élan...
Après tout, je ne suis pas bien sûr qu’elle soit ainsi, cette génération nouvelle; mais c’est ainsi que je la souhaite, ..."
Vers 1930, le retournement du public en faveur de Gide sera accompli, le gros de l'opinion littéraire a en effet découvert à la même époque Proust, Freud, D.H. Lawrence ....

"Voyage au Congo" (1927)
En 1926, Gide part pour l'Afrique noire et rapporte de ce long voyage deux livres qui seront un réquisitoire contre la colonisation et susciteront une commission d'enquête, "Voyage au Congo" et "Le Retour du Tchad", qui parut un an plus tard (1928), et qui décrit son voyage de retour (de février à mai 1926) effectué plus rapidement, par d'autres moyens de transport, à travers le Cameroun jusqu'à Douala. Ce récit, moins connu, insistera sur les us et coutumes des populations (maisons des Massaï, le sultan de Rei Bouba) et compte parmi les plus belles pages de l'écrivain. A cet ensemble, s'ajoute un long article publié dans La Revue de Paris en 1927, "La détresse de notre Afrique équatoriale", qui eut un grand retentissement.
Le VOYAGE AU CONGO est le récit du voyage effectué par Gide, de juillet 1925 à février 1926, à travers les possessions françaises de l`Afrique équatoriale. C'est un long itinéraire qui va de l`embouchure du Congo jusqu'au lac Tchad, retracé par l`écrivain avec une extrême simplicité et une acuité qui rappelle le style classique des grands voyageurs d`autrefois. Son attention s`est surtout portée sur les conditions de vie du Noir, et celles-ci sont décrites avec une telle sincérité et une telle objectivité que ce simple récit est devenu, par la force des choses, un réquisitoire contre les administrations locales et contre le régime barbare institué par les grandes compagnies commerciales. Son voyage provoquera un certain scandale mais qui, par la suite, amènera des réformes utiles ...

1937, "Retour de l'URSS"
Gide à partir de 1930 s'achemine vers des réflexions à dominante réformiste, il dénonce le capitalisme, proclame sa sympathie pour un Etat sans religion, sans classe, sans familles, annonce dans les pages de son journal intime qu'il est prêt à donner sa vie pour la victoire de l'URSS : mais le fameux voyage à Moscou va refroidir son enthousiasme, que peut l'écrivain défenseur d'une liberté bourgeoise face à Staline : il exhale ses rancoeurs dans "Retour de l'URSS" et dans "Retouches à mon retour de l'URSS" en 1937.
"RETOUR DE L'U.R.S.S aura un immense retentissement et apportait sa conclusion douloureuse à une aventure de six années. C'est que dès 1930, dans des fragments de son Journal (qui seront publiés en 1932), Gide avait marqué son évolution vers le communisme, une attitude qui n'est pas seulement intellectuelle puisqu'il s'engagera progressivement, participera ainsi à des congrès, ira à Berlin avec Malraux demander la libération du leader communiste Thaelmann, signera de multiples pétitions tandis que L'Humanité publie en feuilleton "Les Caves du Vatican". Mais il continue de défendre la nécessaire indépendance de l'écrivain. En 1936, invité par le gouvernement soviétique, il part en Russie avec quelques autres écrivains, Eugène Dabit, Louis Guilloux. Il a soixante-dix ans, arrive là-bas avec la foi du néophyte, mais la confrontation avec les mille détails de la réalité vient invalider l'espoir d'une société future, non sans amertume et ambiguïté : un "ressaisissement" de l'URSS est-il encore possible. Accusé par certains intellectuels de jouer un "double jeu", il complète son témoignage avec ses "Retouches au Retour de l'U.R.S.S." La crise fut d'autant plus difficile à surmonter que l'écrivain jusque-là oser affronter le politique et qu'il avait cru trouver dans le communisme la grande cause qu'il recherchait, "une terre où l'utopie était en passe de devenir réalité"....

En 1942, Gide rejoignait Tunis puis, de retour à Paris en 1945, ne publiera plus que "Thésée". En novembre 1947, il recevait le Prix Nobel de Littérature et devait disparaître le 19 février 1941...
