- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte

Mystery & Suspense - William Irish (1903-1968), "The Bride Wore Black " (1940), ), "The Black Curtain" (1941), "Rear Window" (1942), "Black Alibi" (1942), "I Married a Dead Man" (1948), "Phantom Lady" (1954) - - Nelson Algren (1909-1981), "Never Come Morning (1942), "The Man with the Golden Arm" (1949), "A Walk on the Wild Side" (1956) - Ross Macdonald (1915-1983), "Find the Woman " (1946), "The Moving Target" (1949), The "Drowning Pool" (1950) - In 1947, Spillane introduced the world to Mike Hammer in his first book, ‘I, the Jury’....
Last update : 02/02/2018
Le monde de Cornell Woolrich est à la fois plus froid et plus romantique que celui des écrivains catalogués « hard-boiled » tels que Dashiell Hammett, Raymond Chandler et James M. Cain. Comme ses contemporains, Woolrich savait piéger ses lecteurs dans un dédale de corruption, de compromissions et de sexes. Pourtant, dans la plupart de ses romans noirs, renommés pour la perfection de leur suspens, piégeant sous le ciel sombre d’un univers indifférent tant ses personnages, des plus ordinaires, que le lecteur lui--même, - "Woolrich projects a powerful atmosphere of fear, shock and violence, and usually his stories end with a whiplash of surprise", écrivait Ellery Queen -, ses plus grandes œuvres possèdent un petit chose de poétique ou de dramatique. Ses personnages entrent en scène le plus souvent déjà abîmés par leur existence passée, et ils seront amenés à lutter jusqu’à leur neuvième et dernière heure. Quant au lecteur, tenu en suspens, il peut toujours espérer, mais en vain, que le destin, que tout destin peut être maîtrisé.. Les six romans de la célèbre série noire de Cornell Woolrich, "The Bride Wore Black" (1940), "The Black Curtain" (1941), "Black Alibi" (1942), "The Black Angel" (1943), "The Black Path of Fear" (1944) et "Rendezvous in Black" (1948), sont considérés comme des incontournables parmi les romans policiers noirs de l’époque...
Parmi les 22 romans et plus de 200 nouvelles, publiés sous son propre nom ou sous les noms de plume « William Irish » et « George Hopley », les chefs-d’œuvre de Woolrich comprennent « The Night Reveals » (1936); « Three O’Clock » (1938); « The Bride Wore Black» (1940); « The Black Curtain» (1941); « Black Alibi» (1942); « Phantom Lady» (1942); « Rear Window » (1942); « The Black Angel» (1943); « The Black Path of Fear» (1944); « Deadline at Dawn» (1944); « Night Has a Thousand Eyes» (1945); « Waltz into Darkness» (1947); « I Married a Dead Man» (1948); « Rendezvous in Black» (1948); et « Too Nice a Day to Die » (1965). À l’apogée de sa carrière, au cours des années 1940, alors que les lecteurs français accédaient enfin aux traductions de « séries noires » de Woolrich, il s'est imposé parmi les thrillers américains qui nourrissaient cette extraordinaire catégorie du "film noir" que se partageait un large public via le cinéma, puis la radio, puis la télévision. En 1988, "Cornell Woolrich: First You Dream, Then You Die", publié par Mysterious Press, obtint le "Edgar Allan Poe Award from the Mystery Writers of America"...
C'est dans "A Walk on the Wild Side", un célèbre roman de 1956, que Nelson Algren nous fait part de ses "trois règles de vie" : "Never play cards with a man called Doc" (Ne jouez jamais aux cartes avec un homme appelé Doc), "Never eat at a place called Mom's' (Ne mangez jamais dans un endroit appelé Mom’s), "Never sleep with a woman whose troubles are worse than your own" (Ne couchez jamais avec une femme dont les problèmes sont pires que les vôtres), et note à propos de son livre que l'on peut fort justement se demander pourquoi les personnes totalement perdues peuvent se plus aisément se développer comme de véritables êtres humains que ceux qui n’ont jamais été perdus de toute leur vie" (why lost people sometimes develop into greater human beings than those who have never been lost in their whole lives).
C'est tout un autre monde qui s'installe entre 1947 et 1949 avec "The Neon Wilderness", sa célèbre collection de nouvelles, qui allait définitivement asseoir la place de Nelson Algren dans les lettres américaines, et "The Man with the Golden Arm" paraît en 1949 ..
A la même époque, Ross Macdonald, "Find the Woman " (1946), est d'un classicisme à toute épreuve, on y voit ici la distance entre hommes d'écriture blanche et noire ...
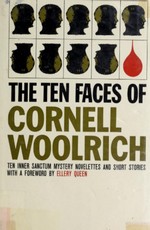

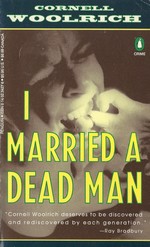
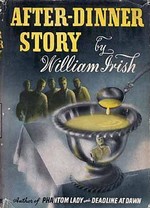
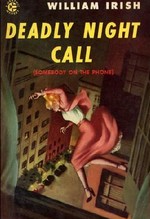


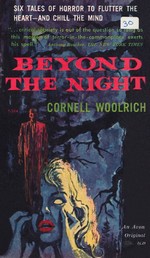



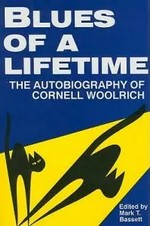

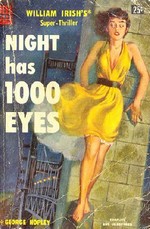

William Irish (1903-1968)
William Irish ou Cornell Woolrich, un maître du suspense - Cornell Woolrich, devenu William Irish en 1942, natif de New York, ses premiers romans,
influencés par Scott Fitzgerald, sont des succès. Mais, à partir de 1932, les éditeurs refusent ses œuvres. Il se lance alors dans la nouvelle «noire», et les fameux magazines pulps lui prennent
sa production. Solitaire, secret, malade, alcoolique, confiné dans sa chambre après la mort de sa mère avec laquelle il avait longtemps vécu, la gangrène aura raison de lui en 1968. Le jeune
Cornell aura passé sa prime enfance marquée par la désunion de ses parents - au Mexique. A l'âge de huit ans, une représentation de Madame Buterfly lui aurait, dit-on, révélé le sens de sa propre
mort. Cette obsession planera sur toute son œuvre. En 1918 Cornell retourne à New York et vit chez son grand-père maternel. En 1921 il entreprend des études à l'Université de Columbia. Il rêve de
devenir danseur de music-hall mais, à l'occasion d'une maladie qui le retient au lit, il découvre l'œuvre de Scott Fitzgerald, qui devient son modèle littéraire. Il publie son premier roman -
nullement policier - en 1926 : "Cover Charge". Il est désormais convaincu qu`il lui faut persévérer dans la littérature et publie alors une demi-douzaine de romans. Il quitte, à cette époque,
l'Université et donne régulièrement des short stories au magazine College Humor. Son deuxième roman, "Children of the Ritz", est acheté par Hollywood et Woolrich se rend en Californie pour y
travailler à son adaptation cinématographique. Après un mariage de courte durée - quelques liaisons homosexuelles semblent avoir été à l'origine du divorce -, Woolrich revient s`installer à New
York en 1929. A partir de cette date, il va vivre avec sa mère, Claire Woolrich, jusqu'à la mort de cette dernière, en 1957 : ils voyagent en Europe (France, Autriche, Espagne); le reste du temps
ils habitent des chambres d'hôtel à Manhattan.
C'est alors que Woolrich donne ses premiers récits policiers : "Death Sits in the Dentist's Chair" (La mort est assise dans le fauteuil du dentiste), dans
le magazine Detective Fiction Weekly, "The Kiss of the Cobra", dans le Dime Detective Weekly (1935): de 1935 à 1940, il il publiera plus d'une centaine de nouvelles.
En 1940 il signe son premier roman policier : "The Bride Wore Black" (La mariée était en noir). Suivront "The Black Curtain" (1941, Retour à Tillary
Street), "Black Alibi" (1942, Alibi Noir), "The Black Angel" (1943, Ange), "The Black Path of Fear" (1944, Une peur noire), "Rendez-vous in black" (1948, Rendez-vous en noir). Sous le nom de
William Irish, "Phantom Lady" (1942, Lady fantôme), "Deadline at Dawn" (1944, L'Heure blafarde), "Waltz into Darkness" (1947, La Sirène du Mississipi), "I Married a Dead Man" (1948, J'ai épousé
une ombre), et sous celui de George Hopley, "Night Has a Thousand Eyes" (1945, Les Yeux de la Nuit).
Mais le récit policier n'est pour lui qu'un cadre à l'intérieur duquel s'inscrivent ses obsessions et une vision de l'existence dominée par l'amour et la
mort, l'affectivité est omniprésente, et le personnage principal n'est ni policier, ni détective, mais un être que tout désigne comme coupable ou comme victime, acculé parfois au crime, et qui
nous entraîne dans les angoisses d'un quotidien qui peut s'avérer destructeur. Dès lors, William Irish va occuper, au même titre que Raymond Chandler, Dashiell Hammet, Ellery Queen. une place
prépondérante dans la littérature policière américaine. Ses livres seront adaptés à l'écran par les plus grands cinéastes dont Roy William Neill, "Black Angel" (1946), Maxwell Shane, "Fear in the
Night " (1947), John Farrow, "Night has a thousand eyes" (1948), Alfred Hitchcock, "Rear Window" (1955, Fenêtre sur cour), avec Grace Kelly et James Stewart, Maxwell Shane, "Nightmare" (1956),
avec Edward G. Robinson, François Truffaut, "La mariée était en noir" (1968) et "La sirène du Mississippi" (1969), Robin Davis, "J'ai épousé une ombre" (1983). Ses recueils de nouvelles sont
constellés de récits inoubliables : The Cornell Woolrich Omnibus, The Corpse Next Door, The Body Upstairs, The Body in Grant's Tomb, Walls That Hear You, If the Dead Could Talk,
...
A la mort de sa mère en 1957, plus reclus que jamais, Irish sombre dans l'alcoolisme, ne travaillant plus qu'à quelques nouvelles empreintes de désespoir.
L'une d'elles, qu'il avait à peine commencé d'écrire, porte un titre qui résume l'amère philosophie de son existence : "D'abord on rêve, et puis on meurt"...

"The Bride Wore Black" (1940, La mariée était en noir)
«Je vais éliminer cette femme de mes calculs et de mes suppositions aussi complètement que si elle n'existait pas. Elle me gêne. Elle est comme un nuage de
brume qui enveloppe toute l'affaire. J'ai l'intention de concentrer mes efforts sur les quatre hommes. Lorsque j'aurai découvert le point où leurs vies se sont rencontrées, la femme rentrera
immédiatement en scène, et je ne tarderai pas à découvrir le motif qui l'a fait agir.» - Personne ne savait qui était cette femme, d'où elle venait, ni pourquoi elle était entrée dans leur vie.
Tout ce qu'ils savaient vraiment d'elle, c'est qu'elle possédait une beauté terrifiante - et qu'à chaque fois qu'elle apparaissait, un homme mourait horriblement. Le roman d'une implacable
vengeance...
THE WOMAN
“JULIE, MY JULIE.” IT followed the woman down the four flights of the stairwell. It was the softest whisper, the strongest claim, that human lips can utter. It did not make her falter, lose a step. Her face was white when she came out into the daylight, that was all.
The girl waiting by the valise at the street entrance turned and looked at her almost incredulously as she joined her, as though wondering where she had found the fortitude to go through with it. The woman seemed to read her thoughts; she answered the unspoken question, “it was just as hard for me to say goodbye as for them, only I was used to it, they weren’t. I had so many long nights in which to steel myself. They only went through it once; I’ve had to go through it a thousand times.” And without any change of tone, she went on, “I’d better take a taxi. There’s one down there.”
The girl looked at her questioningly as it drew up.
“Yes, you can see me oʃ if you want. To the Grand Central Station, driver.”
She didn’t look back at the house, at the street they were leaving. She didn’t look out at the many other well-remembered streets that followed, that in their aggregate stood for her city, the place where she had always lived.
They had to wait a moment at the ticket window; there was somebody else before them. The girl stood helplessly by at her elbow. “Where are you going?”
“I don’t even know, even at this very moment. I haven’t thought about it until now.” She opened her handbag, separated the small roll of currency it contained into two unequal parts; retained the smaller in her hand. She moved up before the window, thrust it in.
“How far will this take me, at day-coach rates?”
“Chicago—with ninety cents change.”
“Then give me a one-way ticket.” She turned to the girl beside her. “Now you can go back and tell them that much, at least.”
“I won’t if you don’t want me to, Julie.”
“It doesn’t matter. What diʃerence does the name of a place make when you’re gone beyond recall?”
They sat for a while in the waiting room. Then presently they went below to the lower track level, stood for a moment by the coach doorway.
“Well kiss, as former childhood friends should.” Their lips met briefly. “There.”
“Julie, what can I say to you?”
“Just ‘goodbye.’ What else is there to say to anyone ever—in this life?”
“Julie, I only hope I see you someday soon.”
“You never will again.”
"- JULIE! Ma Julie!
La voix suivit la femme dans l'escalier jusqu'au bas des quatre étages. C'était le murmure le plus doux, l'appel le plus fort que des lèvres puissent
lancer. Cela ne la fit pas hésiter, ni rater une marche. Son visage était très pâle lorsqu'elle sortit dans la lumière du jour et rien de plus. La fillette qui attendait près de la valise, à la
porte d'entrée, se retourna et la regarda, presque incrédule tandis que Julie la rejoignait, l'air de se demander comment elle avait trouvé la force d'en finir. La femme parut lire dans ses
pensées ; elle répondit à la question silencieuse.
- C'est aussi dur pour moi que pour eux, de dire adieu, mais moi je m'étais faite à cette idée, pas eux. J'ai eu tant de longues nuits pour m'endurcir.
Eux, c'est la première fois que ça leur arrive. Moi, c'est la millième fois que je vis ces instants.
Et, sans changer de ton, elle poursuivit:
- Je vais prendre un taxi; il y en a un là-bas.
Comme la voiture approchait, la fillette la regarda d'un air interrogateur.
- Oui, tu peux m'accompagner si tu veux. A la gare de Grand Central, chauffeur.
Elle ne se retourna pas pour regarder la maison, ni la rue qu'elle quittait. Elle n'eut pas un regard pour les autres rues qu'elle connaissait si bien,
pour ce coin de la ville où elle avait toujours vécu. Elles durent attendre un peu devant le guichet où quelqu'un s'attardait. La petite fille, à côté d'elle, s'accrochait désespérément à son
bras.
- Où vas-tu ?
- Je ne sais pas. Je n'y ai même pas encore pensé.
Elle ouvrit son sac à main, partagea en deux paquets inégaux la mince liasse de billets qu'il contenait et garda la plus petite partie dans sa main.
Elle se pencha vers l'ouverture du guichet et posa l'argent sur la tablette. .
- Jusqu'où je peux aller avec ça?
- Chicago, et je vous rends quatre-vingt-dix cents.
- Alors un aller.
Elle se tourna vers la fillette.
- Tu peux retourner à la maison; tu pourras au moins leur raconter ça.
- Je ne dirai rien, si tu ne veux pas, Julie.
- Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça change, le nom d'un lieu, quand on part sans retour ?
Elles s'assirent un moment dans la salle d'attente. Puis elles descendirent l'escalier qui menait au quai, demeurèrent un instant côte à côte devant la
portière du Wagon.
- Embrassons-nous, comme de vraies petites amies d'enfance.
Leurs lèvres s'effleurèrent, vite. "Voilà."
- Julie, je ne sais quoi te dire.
- Dis-moi adieu. Que dit-on jamais d'autre, dans cette vie ?
- Julie, j'espère que je te reverrai un jour prochain.
- Tu ne me reverras plus jamais.
The station platform fell behind. The train swept through the long tunnel. Then it emerged into daylight again, to ride an elevated trestle flush with the upper stories of tenements, while the crosswise streets ticked by like picket openings in a fence.
It started to slow again, almost before it had got fully under way.
“Twanny-fith Street,” droned a conductor into the car. The woman who had gone away forever seized her valise, stood up and walked down the aisle as though this were the end of the trip instead of the beginning.
She was standing in the vestibule, in readiness, when it drew up. She got oʃ, walked along the platform to the exit, down the stairs to street level. She bought a paper at the waiting-room newsstand, sat down on one of the benches, opened the paper toward the back, to the classiɹed ads. She furled it to a convenient width, traced a ɹnger down the column under the heading Furnished Rooms.
The finger stopped almost at random, without much regard for the details offered by what it rested on. She dug her nail into the spongy paper, marking it. She tucked the newspaper under one arm, picked up her valise once more, walked outside to a taxi. “Take me to this address, here,” she said, and showed him the paper.
Le quai s'éloigna. Le train s'engouffra dans le long tunnel. Puis il émergea de nouveau à la lumière, s'élevant au sommet d'une rampe d'où l'on pouvait
voir les étages supérieurs des maisons, tandis que les rues transversales défilaient comme les jours d'une palissade. Le train ralentit brusquement; il avait à peine atteint sa vitesse
maximale.
- Vingt-cinquième rue, chantonna distraitement le contrôleur.
La femme qui s'en allait pour toujours se leva, prit sa valise et parcourut le couloir, comme si elle terminait son voyage au lieu de le commencer. Elle
était debout tout contre la porte de sortie, lorsque le convoi s'arrêta. Elle descendit, suivit le quai et prit l'escalier qui menait à la rue. Elle acheta un journal au kiosque de la salle
d'attente, s'assit sur un banc et consulta la page des petites annonces. Elle plia le journal en quatre; elle suivit de l'index la colonne intitulée : "Appartements meublés". Le doigt s'arrêta
presque au hasard, sans égard pour les détails particuliers de la rubrique. De l'ongle, la femme marqua le papier spongieux. Puis, prenant le journal sous son bras, elle reprit sa valise et
sortit de la gare. Elle héla un taxi.
- Conduisez-moi à cette adresse, dit-elle en montrant le journal au chauffeur.
La logeuse se tenait debout près de la porte ouverte de la chambre, attendant le verdict.
La femme se retourna:
- Oui, dit-elle, ça me convient. Je vais vous verser une quinzaine d'avance.
- Quel nom, s'il vous plaît?
Le regard de la femme se posa rapidement sur la valise, sur les initiales J. B., autrefois dorées et que l'on pouvait encore distinguer entre les deux
serrures.
- Joséphine Bailey, dit-elle.
- Voici votre reçu, miss Bailey. J'espère que vous vous plairez ici. La salle de bains est plus loin dans le couloir, à droite
après...
- Merci, merci, je trouverai.
Elle referma la porte et donna un tour de clef. Elle enleva son chapeau, son manteau, et défit sa valise - un si petit bagage, de ceux que l'on emporte
pour un aller et retour - ou pour la vie. Un cabinet de pharmacie en tôle peinte, éraflé de taches de rouille, était fixé au-dessus du lavabo. Elle l'ouvrit et se haussa sur la pointe des pieds
pour l'examiner, comme si elle cherchait quelque chose. Sur l'étagère supérieure, ainsi qu'elle l'espérait vaguement, elle trouva une lame de rasoir rouillée, abandonnée là depuis longtemps par
quelque locataire masculin. Elle la prit et revint vers la valise. Elle découpa un rectangle autour des initiales et arracha la couche supérieure du carton bouilli, faisant disparaître toute
trace des lettres. Puis elle sortit son linge, une chemise de nuit, un corsage, qu'elle rangea à mesure dans l'armoire, après avoir ôté les marques qui portaient aussi ses initiales. L'autre
femme ainsi éliminée, elle jeta la lame de rasoir dans la corbeille à papier et s'essuya le bout des doigts. Elle tira une photographie d'une pochette boutonnée sous le couvercle de la valise.
C'était le portrait d`un jeune homme. Il n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas d'une beauté frappante: des yeux, un nez, une bouche comme ceux de n'importe qui. Elle le regarda très
longtemps. Puis elle prit une boîte d'allumettes dans son sac et s`approcha du lavabo; elle enflamma un coin de la photo et attendit qu'elle fût réduite en cendres.
- Au revoir, dit-elle dans un souffle.
Elle ouvrit le robinet pour nettoyer la cuvette puis revint vers la valise. Il restait, sous la patte boutonnée, un petit carré de papier portant un nom
écrit au crayon. Elle avait mis beaucoup de temps pour se procurer ce nom. Elle fouilla encore et retira de la pochette quatre carrés de papier pareils au premier. Elle les prit tous ensemble.
Elle ne les brûla pas immédiatement...."
Truffaut est en pleine écriture de son livre-entretien avec Alfred Hitchcock lorsqu'il adapte "La mariée était en noir", qui sortira en 1968, avec Jeanne Moreau, Claude Rich, Michel Bouquet, Michael Lonsdale, Charles Denner ...

“Rear Window” (1942)
La nouvelle de Cornell Woolrich, « Rear Window », est apparue pour la première fois sous le titre « It Had To Be Murder » dans Dime Detective Magazine en 1942. Hal « Jeff » Jeffries est confiné dans son appartement de New York pour une jambe cassée, une situation vécue alors que la ville traverse une vague de chaleur accablante. Des fenêtres de son appartement donnent sur des immeubles situés dans non loin des siennes, et Jeff regarde régulièrement d'une de ses fenêtres un appartement voisin. Il finit ainsi par être persuadé qu’un de ses voisins a assassiné sa femme. Le célèbre film "Rear Window" d’Alfred Hitchcock de 1954, avec Grace Kelly et James Stewart, s'inspire directement de cette courte histoire....

"I Married a Dead Man" (1948, J'ai épousé une ombre)
Enceinte, abandonnée par un mari insaisissable, Helen Georgesson monte à bord d'un train qui va vers l'ouest. Dans ce train, elle rencontre et se lie
d'amitié avec Patrice Hazzard, une jeune femme aisée qui est également enceinte et qui s'apprête à rencontrer la famille de son mari, Hugh, pour la première fois. Au moment où Patrice laisse
Helen essayer son alliance, le train déraille, Patrice et son mari sont tués dans l'accident. Helen survit, et parce qu'elle porte l'alliance de Patrice, la famille de Hugh Hazzard, n'ayant
jamais vu de photo de la vraie Patrice, suppose qu'Helen est Patrice, et l'accueille donc dans leur famille. Helen est d'abord rongée par la culpabilité, mais elle se persuade qu'elle n'agit
ainsi que pour le bien de son enfant. Les choses se mettent en place à tel point que le frère de Hugh, Bill, et Helen commencent à s'éprendre l'un de l'autre. Mais le rêve commence à prendre une
toute autre tournure : Helen reçoit une série de lettres anonymes de quelqu'un qui est clairement au courant de sa véritable identité, et c'est l'ancien petit ami d'Helen, Steve Georgesson, qui
resurgit et transforme le rêve en cauchemar. Helen décide alors qu'elle n'a pas d'autre choix que de tuer Georgesson, mais lorsqu'elle se rend à son appartement, elle le trouve déjà abattu. Il
s'avère de plus que Bill est aussi présent sur les lieux et qu'il découvre le véritable visage d'Helen. Débute entre une méfiance réciproque qui va définitivement plomber leur
existence....
" The summer nights are so pleasant in Caulfield. They smell of heliotrope and jasmine, honeysuckle and clover. The stars are warm and friendly here, not cold and distant, as where I came from; they seem to hang lower over us, be closer to us. The breeze that stirs the curtains at the open windows is soft and gentle as a baby's kiss. And on it, if you listen, you can hear the rustling sound of the leafy trees turning over and going back to sleep again. The lamplight from within the houses falls upon the lawns outside and copperplates them in long swaths. There's the hush, the stillness of perfect peace and security. Oh, yes, the summer nights are pleasant in Caulfield.
But not for us.
The winter nights are too. The nights of fall, the nights of spring. Not for us, not for us. The house we live in is so pleasant in Caulfield. The blue-green tint of its lawn, that always seems so freshly watered no matter what the time of day. The sparkling, aerated pinwheels of the sprinklers always turning, steadily turning; if you look at them closely enough they form rainbows before your eyes. The clean, sharp curve of the driveway. The dazzling whiteness of the porch-supports in the sun. Indoors, the curving white symmetry of the bannister, as gracious as the dark and glossy stair it accompanies down from above. The satin finish of the rich old floors, bearing a telltale scent of wax and of lemon-oil if you stop to sniff. The lushness of pile carpeting. In almost every room, some favorite chair waiting to greet you like an old friend when you come back to spend a little time with it. People who come and see it say, "What more can there be? This is a home, as a home should be." Yes, the house we live in is so pleasant in Caulfield.
But not for us.
Our little boy, our Hugh, his and mine, it's such a joy to watch him growing up in Caulfield. In the house that will some day be his, in the town that will some day be his. To watch him take the first tottering steps that mean--now he can walk. To catch and cherish each newly minted word that fumblingly issues from his lips--that means, now he's added another, now he can talk.
But even that is not for us, somehow. Even that seems thefted, stolen, in some vague way I cannot say. Something we're not entitled to, something that isn't rightfully ours.
"Les nuits d'été sont si agréables à Caulfield. Elles sentent l'héliotrope et le jasmin, le trèfle et le chèvrefeuille. Les étoiles y sont amicales et
chaudes et non distantes et froides, comme dans le pays d'où je suis venue; elles semblent être suspendues plus bas au-dessus de nos têtes, elles ont l'air plus brillant, plus proche de nous. La
brise qui soulève les rideaux est douce et légère comme le baiser d'un bébé. Et l'on y perçoit en tendant l'oreille, le doux froissement des arbres feuillus qui remuent dans leur sommeil. Les
lumières de la maison tombent sur les pelouses et y tracent de longues allées parallèles. Sur toutes choses planent le calme et le silence de la sécurité, de la paix absolue. Oh, oui, les nuits
d`été sont agréables à Caulfield.
Mais pas pour nous.
Telles aussi sont les nuits d'hiver. Et les nuits de printemps, les nuits d'automne. Mais pas pour nous, pas pour nous. La maison que nous habitons est
si agréable à Caulfield. La teinte bleu-vert de ses pelouses qui, toujours, ont l'air fraîchement abreuvées, quelle que soit l'heure. Les soleils étincelants de ses arroseuses tournantes,
éternellement tournantes, qui forment des arcs-en-ciel devant vos yeux, si vous les regardez d'assez près. La courbe pure, aiguë, de la route carrossable. L'éblouissante blancheur ensoleillée des
piliers du porche. A l'intérieur, la courbe symétrique et blanche de la rampe, aussi gracieuse que l'escalier sombre et luisant qu'elle accompagne jusqu'au premier. Le poli satiné des vieux
planchers cossus, à l'odeur éloquente de cire et d'essence parfumée. L`épaisseur confortable des moquettes. Dans chaque pièce, quelque fauteuil favori prêt à vous accueillir comme un vieil ami,
lorsque vous revenez passer un moment avec lui... Les gens qui viennent et voient cela subissent le charme et disent : "Que pourrait-on désirer de plus ? Voilà un véritable foyer tel que
chaque foyer devrait être." Oui, la maison que nous habitons est si agréable à Caulfield.
Mais pas pour nous.
Notre petit garçon, notre Hugh - le sien et le mien - quelle joie de le regarder grandir à Caulfield. Dans la maison qui, un jour, sera la sienne, dans
la ville qui, un jour, sera la sienne. Le regarder faire ses premiers pas titubants qui signifient : "Maintenant, il sait marcher!" Recueillir et chérir chaque mot nouveau qui sort incertain de
ses lèvres, chaque mot nouveau qui signifie : "Il en a découvert un autre, maintenant il sait parler." Même cela n'est pas pour nous. Même cela nous semble volé, obtenu par fraude d'une manière
confuse que je ne saurais expliquer. C'est quelque chose à quoi nous n'avons pas droit, quelque chose qui n'est pas légitimement à nous. Je l'aime tant. C`est de Bill que je parle à présent, de
l'homme que j'aime. Et qui m`aime. Je sais que je l'aime, je sais qu'il m'aime, je n'en puis douter. Mais je ne puis douter non plus qu`un jour viendra, peut-être cette année, peut-être l'année
prochaine, où il fera brusquement ses valises, et s'en ira, et me laissera seule. Et cependant, il ne voudra pas partir. Et cependant, il m'aimera toujours, autant qu'à la minute où je prononce
ces mots. Ou s'il ne part pas, c'est moi qui partirai. Je prendrai ma valise et franchirai le seuil de la porte, pour ne plus jamais revenir. Et cependant, je n'aurai pas envie de partir. Je
laisserai ma maison derrière moi. Je laisserai mon bébé derrière moi, dans cette maison qui, un jour, sera la sienne, et je laisserai mon cœur derrière moi, avec l'homme auquel il appartient -
(Comment pourrais-je l'emporter avec moi ?) - mais je partirai pour ne plus jamais revenir. Nous avons lutte contre cette chose. Pied à pied, nous l'avons combattue, par tous les moyens
possibles. Nous l'avons repoussée mille fois, mais toujours elle est revenue, dans un regard, un mot, une pensée.
Elle est là.
A quoi bon lui dire : "Tu ne l`as pas fait. Tu me l'as affirmé, une fois. Et cette seule fois suffisait. Pas besoin de me le répéter maintenant. Je sais
que tu ne l'as pas fait. Oh, mon chéri, mon Bill, je sais que tu ne mens pas. Ni pour ce qui est de l'argent, ni pour ce qui est de l'honneur, ni en amour... " (Mais il ne s'agit pas d'argent, ni
d'honneur, ni d'amour. Il s'agit d'une chose à part. Il s'agit d'un assassinat.)
A quoi bon, puisque je ne le crois pas. Lorsqu'il parle, sur le moment même, je suis tentée de le croire. Mais un moment plus tard, ou une heure, ou un
jour, ou une semaine plus tard, je recommence à douter. A quoi bon, puisque nous ne vivons pas seulement dans le présent immédiat, puisque notre vie ne tient pas dans un seul moment. Viennent
d'autres moments, d'autres heures, d'autres semaines, et aussi, oh mon Dieu, d'autres années. Puisque chaque fois qu'íl en parle, je sais que ce n'était pas moi. C'est tout ce que je sais. Mais
je le sais bien. Trop bien. Je le sais. Et il ne reste que...
Et chaque fois que j'en parle, peut-être sait-il que ce n'était pas lui. (Mais moi comment le saurai-je ? Il n'a aucune possibilité de m'en convaincre.)
Et il le sait si bien, si bien. Alors il ne reste que...
Inutile, tout à fait inutile.
Un soir, il y a six mois, je me suis agenouillée devant lui, avec le petit entre nous, contre mes genoux. J 'ai posé ma main sur la tête du petit et je
lui ai juré à voix basse pour que l'enfant ne puisse comprendre :
- Sur mon enfant, Bill, je te jure sur la tête de mon enfant que je ne l'ai pas fait. Oh Bill, je ne l'ai pas fait...
Il m'a relevée, m`a tenue dans ses bras et m'a serrée contre lui.
- Je sais que tu ne l'as pas fait. Je le sais. Que puis-je te dire de plus ? Par quel moyen puis-je te le faire comprendre ? Là, pose ta tête contre mon
cœur, Patricia. Mon coeur te convaincra mieux que moi. Ecoute-le, Patricia, tu sens bien qu'il te croit?
Et pendant un instant, cet instant unique de notre amour, il me croit. Mais ensuite vient l'autre instant, l'instant inévitable. Et déjà il pense :
"Mais je sais que ce n'est pas moi. Je sais pertinemment que ce n'est pas moi. Et il ne reste que..." .
Et tandis que ses bras m'enlacent plus étroitement et que ses lèvres sèchent mes larmes, il ne me croit déjà plus. Je sais qu'il ne me croit plus. Il
n'y a pas d'issue. Nous sommes cernés, pris au piège. Chaque fois, le cercle se referme, et nous nous retrouvons à l'intérieur et nous ne pouvons nous en échapper..." (Trad. Minnie Danzas et
Gilles-Maurice Dumoulin, Gallimard)

"Phantom Lady" (1954, Lady Fantôme)
"The Hundred and and Fiftieth Day Before the Execution..." - Un homme est accusé d'avoir assassiné sa femme, condamné et sur le point d'être exécuté, ses
amis et un détective tentent prouver son alibi en recherchant une inconnue qu'il avait rencontrée dans u bar le soir du meurtre. Mais personne ne semble se souvenir les avoir vu ensemble. Le
roman sera adapté au cinéma en 1944 par Robert Siodmak sous le titre Les Mains qui tuent (Phantom Lady), avec Franchot Tone, Ella Raines et Alan Curtis...
"La nuit était jeune encore, et lui aussi. Mais la nuit était douce et il était furieux. Cela se voyait de loin, à son air renfrogné. Il était en proie
à une de ces colères rentrées, qui ne s'extériorisent pas, mais durent parfois pendant des heures. Et c'était vraiment dommage car, autour de lui, tout était à la joie. Une soirée de mai, à
l'heure des rendez-vous, l'heure où une moitié de la ville s'habille et se farde avec soin pour rejoindre l'autre moitié, qui lisse ses cheveux et regarnit son portefeuille. Et partout, dans les
restaurants, les bars, les halls d'hôtel, sous les horloges, au coin des rues, partout c'était la même antienne : "Me voici! Je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps?" "Que tu es belle! Où
allons-nous ?" . A l'ouest, le ciel lui-même semblait s'être fardé de rouge et avoir choisi deux étoiles plus brillantes que les autres pour servir de clips à sa robe bleu nuit. Les enseignes au
néon adressaient des clins d'œil aux passants, tout le monde allait quelque part; l'air qu'on respirait à cette heure-là était du champagne vaporisé, avec un rien de Chanel pour le singulariser.
et, si vous n'y preniez garde, il vous montait à la tête... à moins qu'il ne vous grisât le cœur. Indifférent à tout cela, il avançait avec sa mine renfrognée et, en le croisant, les gens se
demandaient ce qu'il pouvait bien avoir. Ça n'était sûrement pas sa santé qui le tracassait. Il suffisait de le voir pour s'en convaincre. Et la nonchalante élégance de ses vêtements disait
clairement qu'il comptait au nombre de ceux n'ayant point de soucis d'argent. Ce n'était pas son âge non plus, car il n'avait sûrement pas plus de trente ans. Et il aurait été fort bel homme,
s'il avait pris une expression un peu plus amène. Primitivement, il n'avait pas eu l'intention d'entrer là. Cela se vit à la façon dont il freina - c'était vraiment le mot - devant la porte du
bar. Peut-être n'y aurait-il même pas prêté attention si l'enseigne intermittente qui annonçait Anselmo's, au moment où il passait, n'avait brusquement inondé le trottoir de rouge géranium. Mais
il entra. Il se trouva dans une sorte de long couloir, bas de plafond. De chaque côté, il y avait des boxes minuscules, et sur le tout régnait un éclairage indirect, ambré, très reposant. Ça
n'était pas bien vaste et les clients y étaient rares. Il alla droit au comptoir en demi-cercle qui, adossé au mur du fond, faisait face à l'entrée. Il posa son léger pardessus sur un des
tabourets, le surmonta de son chapeau, et se percha sur le tabouret voisin sans regarder ni à droite ni à gauche. ll entrevit vaguement une veste blanche dans son rayon visuel tandis qu'une voix
disait:
- Bonsoir, monsieur.
- Scotch.
En s'asseyant, il avait dû, inconsciemment, repérer un bol de bretzels sur lequel il abattit sa main sans même regarder. Ses doigts rencontrèrent non
point la forme torturée d'un bretzel, mais quelque chose de lisse et de doux. Tournant la tête, il retira sa main qui s'était posée sur une autre main ayant eu le même geste que la sienne mais un
instant plus tôt.
- Excusez-moi. dit-il. Après vous.
Il avait de nouveau détoumé la tête, mais il se ravisa et lui accorda un deuxième regard. Après ça, il ne la quitta plus des yeux. Ce qu'elle avait de
frappant, c'était son chapeau. Il ressemblait à une citrouille, non seulement par sa taille et sa forme, mais aussi par sa couleur qui faisait presque mal aux yeux. Ce chapeau semblait éclairer
tout le bar, à la façon d'une lanterne japonaise. De son centre, très exactement, jaillissait une longue plume mince, qui faisait penser a une antenne. Il n'y avait pas une femme sur mille qui
aurait supporté cette couleur mais, elle, on pouvait même dire que ça lui seyait. Ainsi coiffée,. elle faisait un effet surprenant, mais élégant, pas ridicule. Pour le reste, elle était vêtue de
noir, si discrètement qu'on finissait par ne plus voir que son chapeau. Peut-être celui-ci était-il pour elle une sorte d'emblème, un symbole de libération ? Peut-être signifiait-il: "Quand j'ai
ce chapeau, prenez garde: je suis prête à toutes les audaces!" Pour l'instant elle se contentait de grignoter un bretzel, en feignant de ne pas remarquer l'examen attentif auquel il la
soumettait. Quand il quitta son tabouret pour se rapprocher, elle s'interrompit simplement de manger, en inclinant à peine la tête, comme pour lui faire comprendre : "Si vous voulez me parler, je
ne vous en empêcherai pas. Mais ce que je ferai ensuite dépendra de ce que vous avez à dire."
Ce qu'il lui dit fut net, simple, et direct :
- Avez-vous des projets pour la soirée ?
- Oui et non.
Ça n'était ni une rebuffade ni un encouragement, et aucun sourire n'accompagnait cette réponse. Une femme bien élevée, une femme comme il faut, de toute
évidence. Lui-même déclara courtoisement:
- Je n'ai pas l'intention de vous importuner. Si vous avez déjà un engagement pour la soirée, dites-le-moi.
- Vous ne m'importunez pour l'instant.
Elle lui signifiait clairement que sa décision était encore dans la balance. Il tourna les yeux vers la pendule qui surmontait les bouteilles, en face
d'eux..." (traduction Maurice B.Endrèbe, Presses de la Cité)...




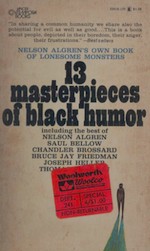
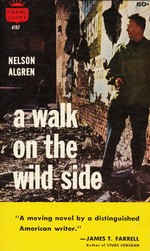
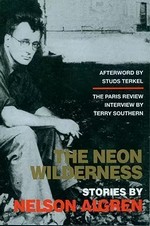
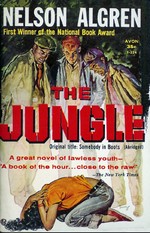

Nelson Algren (1909-1981)
Nelson Algren a écrit, «literature is made upon any occasion that a challenge is put to the legal apparatus by conscience in touch with humanity». Le monde d’Algren est truffé de phrases mémorables qu’il a apportées à l’usage courant, "walk on the wild side", "monkey on the back", "I knew I’d never make it to twenty-one anyway", "a neon wilderness"’, et ses romans peuvent se lire comme une histoire naturelle de l' "American underlife" : street corners, beerhalls, slum bedrooms, brothels, racetracks, police line-ups, prison cells, les coins de rue, les masures de bidonvilles, les bordels et les hippodromes, les files d’attente de la police et les cellules de prison deviennent des habitats quasi exotiques lorsqu’ils sont décrits par Algren, et ses histoires se déroulent de manière dramatique sous des lampes à arc et des ampoules de vingt watts (beneath arc lamps and twentywatt bulbs), dans des endroits «remplis de bruits et de rumeurs de bruits » (filling with noises and rumours of noises) ..
Il est né le 28 mars 1909 à Detroit et a vécu principalement à Chicago. Sa première courte fiction est publiée dans le magazine Story en 1933. En 1935, il publie son premier roman, "Someone in Boots". Au début de 1942, Algren met la touche finale à un deuxième roman et rejoint la guerre. En 1945, le roman "Never Come Morning" sera largement reconnu et se vendra à plus d’un million d’exemplaires. Jean-Paul Sartre a traduit l’édition française. En 1947 vint "The Neon Wilderness", sa célèbre collection de nouvelles qui allait définitivement asseoir sa place dans les lettres américaines. "The Man with the Golden Arm" paraît en 1949 et remporte le National Book Award 1950. Traduit en français par Boris Vian, ce roman noir raconte, non sans une certaine dose d'humour, comment Frankie Machine, un ancien G.I. devenu donneur de cartes dans un tripot, sombre peu à peu dans l'enfer de la drogue.
Puis vint "Chicago : City on the Make" (1951), un poème en prose et "A Walk on the Wild Side" (1956, La Rue chaude), probablement son plus grand roman : il dépeint les pérégrinations de Dove Linkhorn, un adolescent naïf et candide du Texas, qui échoue sur Perdito Street, la rue de la prostitution à La Nouvelle-Orléans.
Algren a également publié deux livres de voyage, "Who Lost an American?" et "Notes from a Sea Voyage". "The Last Carousel", un recueil de courts métrages de fiction et de non-fiction, est paru en 1973. Il est décédé le 9 mai 1981, quelques jours après sa nomination comme membre de l’American Academy and Institute of Arts and Letters. Son dernier roman, "The Devil’s Stocking", basé sur la vie d’Hurricane Carter, et "Nonconformity : Writing on Writing", un essai de 1952 sur l’art de l’écriture, ont été publiés à titre posthume en 1983 et 1996 respectivement.
L'un des meilleurs roman d'Algren devint célèbre grâce à son adaptation cinématographique (1955) dans laquelle Frank Sinatra jouait le rôle de l'antihéros, Frankie Machine, trafiquant drogué. Mais c'est sous-estimer un Algren tout autant que de ne voir en lui, grâce à une biographie de sa maîtresse, Simone de Beauvoir, que celui qui a permis à l'auteur du "Deuxième Sexe" d'atteindre l'orgasme pour la première fois. Le roman allie la curiosité qu'éveillent les crimes des romans de gare et de la presse à scandale au détails académiques d'une enquête sociologique: un mélange vendeur de luxure et de noblesse que le talent poétique constant de l'auteur place nettement au-dessus de ses nombreux rivaux dans ce domaine. Sa prose, où s'affrontent violemment divers registres et où sa voix poétique résonne encore aujourd'hui, est marquée de façon indélébile par l'influence de T. S. Eliot et de James Joyce.
Chicago est le sujet principal de l'œuvre d'Algren qui a saupoudré ses bars délabrés, ses asiles de nuit humides, ses réservoirs de stockage crasseux et ses trottoirs trempés d'un langage digne, exigeant, qu'il savait partager avec ses personnages principaux. Si le style d'Algren peut parfois se révéler ampoulé, Frankie Machine, Sparrow Saltskin, Sophie, Molly et tous les policiers fatigués de Chicago survivent dans la mémoire de ses nombreux lecteurs, leur intensité éloquente reste intacte, même lorsque ce lot de petits malfaiteurs est entraîné dans un engrenage sans fin né de la dépendance, de la violence et d'une inévitable misère...

"A Transatlantic Love Affair: Letters to Nelson Algren", written by Simone de Beauvoir (1999)
En 1947, Simone de Beauvoir rencontre à Chicago l’écrivain Nelson Algren, lauréat du prix Pulitzer. Une aventure passionnée s’ensuit, s’étendant sur vingt ans et quatre continents à une époque où un vol transatlantique dure vingt-quatre heures et où les appels téléphoniques à l’étranger sont un luxe. Cette histoire d’amour transatlantique rassemble plus de trois cents lettres d’amour écrites en anglais par de Beauvoir à Algren. Uniques parmi la correspondance prolifique de Beauvoir menée tout au long de sa vie, ces lettres impliquaient quelqu’un qui n’était pas du tout de son monde. De Beauvoir a été forcé d’expliquer à Algren tout ce qui se passait, son parcours, sa vie à Paris et la situation politique. Le résultat est un croisement entre un mémoire personnel et l’histoire intellectuelle d’un initié de la vie de la Rive gauche dans le Paris d’après-guerre, peuplé de personnalités comme Albert Camus, Truman Capote, Colette, Alberto Giacometti, Margaret Mead et Richard Wright. Écrites alors qu’elle travaillait sur Les Mandarins ...

"Never Come Morning" (1942, Le matin se fait attendre)
Peinture sans fard et sans concession du sous-prolétariat de Chicago, plus précisément de la misérable colonie polonaise du quartier nord-ouest. lci, la "loi commune" est la faim, la
violence et l`humiliation. La voie "honnête" et celle du "crime" aboutissent également au point où se broient les cœurs et les corps. Une seule loi, celle du milieu, la police n`étant qu`un gang qui touche redevance pour passer l'éponge sur les délits, mais se montre sans pitié pour qui n`a pas les moyens de l`acheter. Et l`argent, c`est ce qui fait toujours défaut aux jeunes héros du Matin se fait attendre. Le seul homme riche du quartier est le coiffeur Bonifacy, qui est aussi propriétaire de la maison close et touche un pourcentage sur toutes les "affaires" qui se font dans son secteur : matches de boxe, escroqueries ou vols. Le personnage central du roman est un costaud de dix-sept ans, Bruno Bicek, dit Bruno-le-Gaucher, ou encore, Bruno Biceps-le-Gaucher. C'est le meilleur joueur de base-ball de l`équipe des Guerriers du 26e District et un boxeur qui rêve d`arracher un jour le titre des poids lourds à Joe Louis. Cependant, Bruno est un faux dur. ll aime une adolescente, Steffi qui s`est donnée à lui, mais la laisse violer par ses compagnons et enfermer dans la "maison" du coiffeur par crainte du couteau de son rival, Kodadek. Dans sa honte, il se querelle avec un inconnu, un Grec, et le tue. Mais c'est pour une autre affaire, une attaque à main armée, qu`il est arrêté peu après. Alors, il connaît le passage à tabac et la vermine de la prison. Pourtant, lorsqu'il apprend que l'homme qui a été attaqué est encore vivant, il est confusément déçu. Lorsque, après plusieurs mois de prison, Bruno est remis en liberté, il devient rabatteur pour la "maison" du coiffeur, en attendant que son manager lui organise une rencontre. Mais Bonifacy s'est aperçu que Steffi aimait toujours Bicek et, le soir où le boxeur vient de remporter sa première victoire importante, il le fait dénoncer pour le meurtre du Grec. Tandis qu'on lui passe les menottes, Bruno dit : "J'ai toujours su que je passerais pas vingt ans". La longue nuit de la misère n`a pas de matin 'Trad. Gallimard, 1950).

"The Man with the Golden Arm" (1949)
Le héros du livre, Frankie Majcinek. est un produit du misérable quartier de Chicago où s`entasse la pègre d`origine polonaise. Le seul avantage dont le sort ait pourvu Frankie est un coup de poignet fort et souple : "l`homme au bras d`or" (ou "la Distribe") gagne sa vie comme donneur de cartes dans un tripot clandestin tout en rêvant de devenir batteur dans un orchestre de jazz. ll a une femme, Sophie, qui, depuis un accident de voiture, ne quitte plus un fauteuil d'infirme. En fait, Sophie, plus ou moins consciemment, simule la paralysie pour retenir auprès d'elle son mari. Frankie, qui conduisait en état d`ivresse, se tient pour responsable de l`accident et n`ose abandonner sa femme envers laquelle il éprouve un fort sentiment de culpabilité. Alors, le faux dur a recours à la drogue pour oublier un moment la tristesse de sa vie. Périodiquement, il se révolte contre la morphine. espère toujours s'en délivrer mais, progressivement en devient totalement dépendant. Un soir. pourtant. dans un mouvement d'orgueil blessé, il tue le trafiquant qui lui procure la drogue. Quelques mois plus tard, traqué par la police et épuisé par son vice, l'homme au bras d`or se pend. A travers le destin de "la Distribe", c'est celui de tous les enfants de Division Street qu`exprime le romancier : des destin d'êtres accablés par des forces impitoyables et dont les efforts pour s'en tirer restent désespérément vains, une collection de portraits pitoyables, le jeune Solly Saltskin, dit le Piaf ou le Voyou, qui sait tout "sauf comment on reste hors de tôle", le Rupin, l`ancien "camé", qui trafique la drogue, et son compère, l'aveugle Ducochon, la chaude Violette et Vieux Mari,son époux, Antek le Tôlier, patron du Cognedur, le bistrot où se réunit tout ce petit monde (Trad. par Boris Vian, Gallimard, 1956).
"The captain never drank. Yet, toward nightfall in that smoke-colored season between Indian summer and December’s first true snow, he would sometimes feel half drunken. He would hang his coat neatly over the back of his chair in the leaden station-house twilight, say he was beat from lack of sleep and lay his head across his arms upon the query-room desk. Yet it wasn’t work that wearied him so and his sleep was harassed by more than a smoke-colored rain. The city had filled him with the guilt of others; he was numbed by his charge sheet’s accusations. For twenty years, upon the same scarred desk, he had been recording larceny and arson, sodomy and simony, boosting, hijacking and shootings in sudden affray: blackmail and terrorism, incest and pauperism, embezzlement and horse theft, tampering and procuring, abduction and quackery, adultery and mackery. Till the finger of guilt, pointing so sternly for so long across the query-room blotter, had grown bored with it all at last and turned, capriciously, to touch the fibers of the dark gray muscle behind the captain’s light gray eyes. So that though by daylight he remained the pursuer there had come nights, this windless first week of December, when he had dreamed he was being pursued.
"Le capitaine ne buvait jamais. Pourtant, vers la tombée de la nuit, à cette saison couleur de fumée entre l'été indien et la première vraie neige de décembre, il se sentait parfois à moitié ivre. Dans le crépuscule plombé de la gare, il accrochait soigneusement son manteau sur le dossier de sa chaise, se disait fatigué par le manque de sommeil et posait sa tête en travers de ses bras sur le bureau de la salle des requêtes. Pourtant, ce n'était pas le travail qui le fatiguait tant et son sommeil était perturbé par plus qu'une pluie couleur de fumée. La ville l'avait rempli de la culpabilité des autres ; il était engourdi par les accusations de son acte d'accusation. Depuis vingt ans, sur le même bureau meurtri, il enregistrait les vols et les incendies, la sodomie et la simonie, les coups d'éclat, les détournements et les fusillades soudaines : le chantage et le terrorisme, l'inceste et le paupérisme, le détournement de fonds et le vol de chevaux, la falsification et le proxénétisme, l'enlèvement et le charlatanisme, l'adultère et le charlatanisme. Jusqu'à ce que le doigt de la culpabilité, pointé si sévèrement depuis si longtemps sur le buvard de la salle d'interrogatoire, se soit finalement lassé de tout cela et se soit tourné, capricieusement, pour toucher les fibres du muscle gris foncé derrière les yeux gris clair du capitaine. Ainsi, bien qu'à la lumière du jour il restait le poursuivant, il y avait eu des nuits, cette première semaine de décembre sans vent, où il avait rêvé qu'il était poursuivi.
Long ago some station-house stray had nicknamed him Record Head, to honor the retentiveness of his memory for forgotten misdemeanors. Now drawing close to the pension years, he was referred to as Captain Bednar only officially.
The pair of strays standing before him had already been filed, beside their prints, in both his records and his head.
‘Ain’t nothin’ on my record but drunk ’n fightin’,’ the smashnosed vet with the buffalo-colored eyes was reminding the captain. ‘All I do is deal, drink ’n fight.’
The captain studied the faded suntans above the army brogans. ‘What kind of discharge you get, Dealer?’
‘The right kind. And the Purple Heart.’
‘Who do you fight with?’
‘My wife, that’s all.’
‘Hell, that’s no crime.’
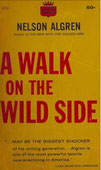
"A Walk on the Wild Side" (1956, La Rue chaude)
Le roman dépeint les pérégrinations de Dove Linkhorn, un adolescent naïf et candide du Texas, qui échoue sur Perdito Street, la rue de la prostitution à La Nouvelle-Orléans. On retrouve ici des éléments tout droits sortis du premier roman d’Algren," Someone in Boots", publié en 1935, d'une nouvelle, "The Face on the Barroom Floor", publiée dans American Mercury en 1947. On a pu lire ce roman comme la tentative désespérée d’un écrivain qui tente de se rassurer sur le fait qu’il puisse encore écrire, un écrivain comme F. Scott Fitzgerald qui s’est décrit dans "The Crack Up", chronique d’un auteur qui en vient à conclure qu'il n’a plus rien à écrire. "Thinking of Melville, thinking of Poe, thinking of Mark Twain and Vachel Lindsay, thinking of Jack London and Tom Wolfe, one begins to feel there is almost no way of becoming a creative writer in America without being a loser" : n'y-a-t-il aucun moyen de devenir un écrivain créatif en Amérique sans être un perdant?
Fitz n'avait pas de nom pour décrire ce qui l'avait rendu amer. Pourtant, il avait l'impression que chaque jour qui se levait le trompait pour se réveiller et que chaque soir le trompait pour s'endormir. Le sentiment d'avoir été trompé - d'avoir été trompé - c'était tout.
Personne ne savait pourquoi ni par qui. Tout ce que l'on savait, c'est que tout était perdu ..
" ‘HE’S JUST A pore lonesome wife-left feller,’ the more understanding said of Fitz Linkhorn, ‘losin’ his old lady is what crazied him.’
‘That man is so contrary,’ the less understanding said, ‘if you throwed him in the river he’d float upstream.’
For what had embittered him Fitz had no name. Yet he felt that every daybreak duped him into waking and every evening conned him into sleep. The feeling of having been cheated – of having been cheated – that was it. Nobody knew why nor by whom. But only that all was lost. Lost long ago, in some colder country. Lost anew by the generations since. He kept trying to wind his fingers about this feeling, at times like an ancestral hunger; again like some secret wound. It was there, if a man could get it out into the light, as palpable as the blood in his veins. Someone just behind him kept turning him against himself till his very strength was a weakness. Weaker men, full of worldly follies, did better than Linkhorn in the world. He saw with eyes enviously slowburning.
‘I ain’t a-playin’ the whore to no man,’ he would declare himself, though no one had so charged him. Six-foot-one of slack-muscled shambler, he came of a shambling race.
That gander-necked clan from which Calhoun and Jackson sprang. Jesse James’ and Jeff Davis’ people. Lincoln’s people. Forest solitaries spare and swart, left landless as ever in sandland and Hooverville now the time of the forests had passed.
Whites called them ‘white trash’ and Negroes ‘po’ buckra.’ Since the first rock had risen above the moving waters there had been not a single prince in Fitzbrian’s branch of the Linkhorn clan.
Fitz Linkhorn parvenait à peine à gagner sa vie en pompant des fosses d'aisance, mais sa vocation dévorante était de prêcher depuis les marches du palais de justice d'Arroyo, une petite ville de la vallée du Rio Grande, au Texas. Il dénonçait tous les péchés, sauf la boisson, car il s'enivrait le plus souvent possible. Fitz avait deux fils, Byron, qui était faible et malade, et Dove. Dove n'a pas reçu d'éducation car son père n'a pas voulu l'envoyer dans une école avec un directeur catholique. Au lieu de cela, il était censé aller au cinéma avec Byron pour apprendre la vie, mais Dove n'a jamais pu y aller, son frère n'ayant pas le prix d'un billet. Dove s'instruit auprès des clochards qui traînent le long des voies ferrées de Santa Fe, se racontant les villes, les hommes de loi, les prisons et les taureaux des chemins de fer qu'il faut éviter. Dove commence à fréquenter le salon de chili La Fe en Dios, situé dans les ruines de l'hôtel Crockett, de l'autre côté de la ville. C'est dans cet hôtel que Fitz avait rencontré la mère de ses fils. L'hôtel est fermé, mais le café, peu fréquenté, est tenu par Terasina Vidavarri, une femme méfiante qui a été violée par un soldat. Elle poursuit l'éducation de Dove en lui apprenant à lire à partir de deux livres. L'un des livres était un conte pour enfants, l'autre traitait de la façon d'écrire des lettres d'affaires. Dove et Terasina sont finalement devenus amants ; Dove a également violé Terasina à l'extérieur, près de la corde à linge.
There’s one advantage women have over men: they can go down to hell and come straight up again. An old song says so and it says just right. Yet it fails to allow for special cases like Dove Linkhorn’s.
Dove knew he’d been underground all right. The moment he stepped back onto the Canal Street side of the Southern Railway Station it seemed he had either come up out of somewhere or else the sky had risen an inch.
The city fathers, Do-Right Daddies and all of that, Shriners, Kiwanians, Legionaires, Knights of this and Knights of that, would admit with a laugh that New Orleans was hell. But that hell itself had been built spang in the center of town – this they never could admit. For panders and whores are a plain disgrace, and Do-Right Daddies are family men whose families are part of themselves like their backs.
But not many a daddy (do-right or do-wrong) is satisfied simply to own a back. He has to kick loose of home and fireside now and again. He has to ball with outlaws, play the fool on the door-rock, and have a handsome hustler call him by his first name in the presence of an out-of-town friend.
That makes daddy feel like a man again. Three shots of corn likker and the whole stuffed zoo – Moose, Elks, Woodmen, Lions, Thirty-Third Degree Owls and Forty-Fourth Degree Field Mice begin to conspire against the very laws they themselves have written.
Les femmes ont un avantage sur les hommes : elles peuvent descendre en enfer et en remonter. remonter tout droit. C'est ce que dit une vieille chanson, et elle le dit très bien. Pourtant, elle ne tient pas compte des cas particuliers comme celui de Dove Linkhorn.
Dove savait qu'il avait bien été sous terre. Dès qu'il a remis les pieds sur le côté de Canal Street de la gare ferroviaire du Sud, il lui a semblé qu'il était sorti de quelque part ou que le ciel s'était élevé d'un centimètre.
Les pères de la ville, les "Do-Right Daddies" et tout le reste, les Shriners, les Kiwaniens, les Légionnaires, les Chevaliers de ceci et les Chevaliers de cela, admettaient en riant que la Nouvelle-Orléans était un enfer. Mais cet enfer lui-même avait été construit en plein centre de la ville - cela, ils n'ont jamais pu l'admettre. Car les proxénètes et les putains sont une véritable honte, et les "Do-Right Daddies" sont des hommes de famille dont les familles font partie d'eux-mêmes comme leur dos.
Mais peu de papas (de droite ou de gauche) se contentent de posséder un dos. Il doit s'éloigner de temps en temps de son foyer et de son coin de feu. Il doit s'amuser avec des hors-la-loi, faire l'imbécile sur le rocher de la porte et se faire appeler par le prénom d'un bel arnaqueur en présence d'un ami de l'extérieur.
Cela redonne à papa le sentiment d'être un homme. Trois verres de corn likker et tout le zoo empaillé - orignaux, élans, hommes des bois, lions, hiboux du trente-troisième degré et souris des champs du quarante-quatrième degré - commence à conspirer contre les lois qu'ils ont eux-mêmes écrites...
Byron a volé dans le café, et Terasina a mis le crime sur le dos de Dove. Furieuse, elle le met à la porte et Dove quitte Arroyo à bord d'un train de marchandises. Dove prend en charge une jeune fille nommée Kitty Twist, fugueuse d'un foyer pour enfants, et lui sauve la vie alors qu'elle était sur le point de passer sous les roues d'un train. Lorsqu'ils tentent un cambriolage à Houston, Kitty se fait prendre. Dove s'enfuit à bord d'un train de marchandises en direction de la Nouvelle-Orléans.
L'une des premières choses qu'il voit à la Nouvelle-Orléans est un homme qui coupe les têtes des tortues destinées à être transformées en soupe de tortue et qui jette les corps dans un tas. Même avec les têtes coupées, les corps essayaient de grimper au sommet de la pile. Une tortue a réussi à atteindre le sommet de la pile avant de glisser vers le bas. C'est dans la ville portuaire, avec ses nombreuses influences et cultures différentes, que Dove a vécu ses aventures les plus intéressantes.
Il a travaillé comme peintre sur un bateau à vapeur (mais n'a rien peint), a dupé une prostituée qui essayait de le voler, a vendu des cafetières et des "certificats de beauté" (censés donner droit à un traitement dans un salon de beauté) tout en séduisant les femmes à qui il vendait, et, dans son escapade la plus mémorable, a travaillé dans une usine de préservatifs. Les préservatifs, appelés O-Daddies et portant des noms et des couleurs intéressants, étaient fabriqués dans une maison par une entreprise familiale, Velma and Rhino Gross.
Le séjour le plus long de Dove fut celui qu'il fit avec les gens qui habitaient les deux mondes jumeaux de la maison close d'Oliver Finnerty et du bar clandestin de Doc Dockery. Dans la maison close, il trouve, outre sa vieille amie Kitty Twist, devenue prostituée, Hallie Breedlove, une ancienne institutrice qui est la vedette de la bande de filles de Finnerty. Hallie est amoureuse d'Achilles Schmidt, un ancien homme fort de cirque dont les jambes ont été coupées par un train. Le haut du corps de Schmidt était encore puissant et chaque jour, il entrait dans le bar de Dockery avec l'air de quelqu'un qui pouvait battre n'importe qui, et il le pouvait. Le travail principal de Dove au Finnerty's était de s'accoupler avec les filles de l'endroit, qui faisaient semblant d'être des vierges en train de se faire déflorer, sous le regard des clients à travers les judas. Hallie, qui a conservé des vestiges de son ancienne vie d'enseignante, s'intéresse à l'esprit de Dove et l'aide à poursuivre son apprentissage de la lecture. La proximité de Dove avec Hallie a provoqué la colère d'Achilles, qui a agressé Dove dans le bar de Dockery. Schmidt bat Dove jusqu'à ce qu'il devienne aveugle, et une bande de personnes s'abat sur Schmidt et le tue. Dove réussit à retourner au Texas et au café Terasina....
L'œuvre de Nelson Algren fut adaptée au cinéma par deux fois ...
- "L'Homme au bras d'or" (The Man With the Golden Arm), réalisé par Otto Preminger en 1955, avec Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak, Arnold Stang and Darren McGavin.
- "Walk on the Wild Side", adapté pat John Fante et réalisé par Edward Dmytryk en 1962, avec Laurence Harvey, Capucine, Jane Fonda, Anne Baxter et Barbara Stanwyck.
- "Walk on the Wild Side" est aussi une chanson de Lou Reed figurant sur son second album solo, "Transformer" (1972), produit par David Bowie et Mick Ronson, et l'un des grands titres de la contre-culture américaine ..., "Holly came from Miami, F.L.A. / Hitch-hiked her way across the U.S.A. / Plucked her eyebrows on the way / Shaved her legs and then he was a she / She says, "Hey, babe / Take a walk on the wild side" / Said, "Hey, honey / Take a walk on the wild side" / Candy came from out on the Island / In the back room she was / ..."
