- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Jacques Cazotte (1720-1792), "Le Diable amoureux" (1772-1776) - Beaumarchais (1732-1798), "Le Mariage de Figaro" (1784) - Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), "Paul et Virginie" (1788) - Sébastien-Roch-Nicolas, dit Chamfort (1741-1794) - Louis Sébastien Mercier (1740-1814) - ...
Last update 10/10/2021

1776-1788 - "La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la parole intérieure", nous dit Rivarol. A la veille de cette Révolution qui les emportera vers d'autres rives, des romanciers, hommes de théâtre ou moralistes, des "hommes d'esprit" à l'ombre de quelques "grands personnages" qu'ils amusaient, écrivent, influencés pour la plupart par Rousseau et sans illusions sur le monde aristocratique qui bascule insensiblement, le calme avant une tempête que nul ne voit venir : sinon à parler de soi dans une solitude sociale absolue, sans référence et comme sans avenir, Jacques Cazotte (1720-1792), et "Le Diable amoureux" (1776), Chamfort (1741-1794), et ses "Pensées, Maximes et Anecdotes", Louis Sébastien Mercier (1740-1814), et ses "Tableau de Paris" (1781-1788), Beaumarchais (1732-1798) et "Le Mariage de Figaro" (1784), Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, et "Paul et Virginie" (1788), c'est ainsi que l'on glisse en cette fin du XVIIIe siècle de la vie en société vers l'individu....
La publication par Antoine Rivarol (1753-1801) de son "Petit almanach des grands hommes pour l'année 1788" dans lequel il attaque nombre d'écrivains en faveur, montre une humeur bien mordante sur le siècle présent. "Le public ! le public ! combien faut-il de sots pour faire un public ?", écrit Chamfort. "Il y a parmi les gens du monde certaines personnes qui doivent tout le bonheur de leur vie à leur réputation de gens d'esprit , et toute leur réputation à leur paresse. Toujours spectateurs et jamais auteurs, lisant sans cesse et décrivant jamais, censeurs de tout et dispensés de rien produire, ils deviennent des juges très-redoutables ; mais ils manquent un peu de générosité. C'est sans doute un terrible avantage que de n'avoir rien fait , mais il ne faut pas en abuser.
J'écoutais l'autre jour la conversation de trois ou quatre de ces personnes, qui, lasses de parler du siècle de Louis XIV et du siècle présent , de tenir la balance entre Corneille et Racine, entre Rousseau et Montesquieu, descendirent tout-à-coup de ces hauteurs et pénétrèrent dans les plus petits recoins de la république des lettres. On s'échauffa, et les auteurs dont on parlait devenant toujours plus imperceptibles, on finit par faire des paris. "Je gage, dit l'un ; que je pourrai vous citer tel ouvrage et tel écrivain dont vous n'avez jamais ouï parler. Je vous le rendrai bien , répondit l'autre ;" et en effet ces messieurs se mettant à disputer de petitesse et d'obscurité, on vit paraitre sur la scène une armée de Lilliputiens....
Pour moi, auditeur bénévole, frappé de la riche nomenclature de tant d'écrivains inconnus , je ne pus me défendre d'une réflexion que je communiquai à mes voisins , et qui, gagnant de proche en proche, fit bientôt changer l'état de la question. N'est-ce pas , leur disais-je , une chose bien étrange et bien humiliante pour l'espèce humaine , que cette manie des historiens , de ne citer qu'une douzaine tout au plus de grands écrivains, dans les siècles les plus brillants, tels que ceux d'Alexandre , d'Auguste , des Médicis, ou de Louis XIV ? N'est- ce pas donner à la nature je ne sais quel air d'avarice ou d'indigence? Le peuple, qui n'entend nommer que cinq ou six Grands Hommes par siècle , est tenté de croire que la providence n'est qu'une marâtre ; tandis que, si on proclamait le nom de tout ce qui écrit , on ne verrait plus dans elle qu'une mère inépuisable et tendre , toujours quitte envers nous , soit par la qualité , soit par la quantité ; et si j'écrivais l'histoire naturelle , croyez-vous que je ne citerais que les éléphants, les rhinocéros et les baleines ?
Non , Messieurs , je descendrais avec plaisir de ces colosses imposants aux plus petits animalcules ; et vous sentiriez s'accroître et s'attendrir votre admiration pour la nature, quand j'arriverais avec vous à cette foule innombrable de familles, de tribus, de nation , de républiques et d'empires, cachés sous un brin d'herbe. C'est donc faute d'avoir fait une si heureuse observation que l'Histoire de l'esprit humain n'offre , dans sa mesquine perspective , que d'arides déserts où s'élèvent à de grandes distances quelques bustes outragés par le temps, et consacrés par l'envie, qui les oppose sans cesse aux Grands Hommes naissants et les représente toujours isolés , comme si la nature n'avait pas fait croître autour d'Euripide , de Sophocle et d'Homère, princes de la tragédie et de l'Epopée, une foule de petits poètes , qui vivaient frugalement de la charade et du madrigal ; ainsi qu'elle fait monter la mousse et le lierre autour des chênes et des ormeaux; ou , comme dans l'Écriture-Sainte on voit après les grands prophètes paraître à leur tour les petits prophètes ? ..."

Jacques Cazotte (1720-1792)
Jacques Cazotte est une figure curieuse de l'histoire littéraire française. Il est surtout connu pour son roman, "Le Diable amoureux" (1776), considéré comme une oeuvre préfigurant les romans fantastiques de E.T. Hoffmann. Critique sévère de Jean-Jacques Rousseau, membre de la secte illuministe des Elus-Cohens, il verra dans la Révolution française une gigantesque incarnation de Satan. Ses convictions royalistes le rendent suspect au pouvoir révolutionnaire. Il sera guillotiné le 25 septembre 1792 (Portrait par Jean-Baptiste Perronneau, 1760-1765, National Gallery).
Fils de la bourgeoisie bourguignonne, il fit ses études chez les jésuites, à Dijon, apprit plusieurs langues étrangères, rejoint Paris en 1740, entre dans l'administration du ministère de la Marine : il fut ainsi envoyé dans diverses places maritimes puis à la Martinique, s'illustra en 1759 en repoussant une attaque anglaise contre le fort de Saint-Pierre, avant de se retirer, jouissant d'une belle fortune, et de s'installer dans un domaine dont il avait hérité près d'Épernay.
Il publia d'abord des contes de fées, parodiques et ironiques, la Patte de chat (1741, Conte Zinzimois), les Mille et Une Fadaises (1742). Il intervint dans la Querelle des bouffons en faveur de la musique française. Il s'inspira du Roland furieux de l'Arioste pour composer "Olivier", poème épique en 12 chants (1763), son premier grand ouvrage, puis organisa avec Jean-François Rameau la supercherie de la Nouvelle Raméide (1772) avant de revenir au conte avec le "Lord impromptu" (1767) et "le Diable amoureux" (1772). Cazotte fut attiré par l'illuminisme et se fit initier. Ses dernières œuvres, "Continuation des Mille et Une Nuits", sont marquées par ces tendances mystiques. Ses œuvres rassemblées de son vivant puis après sa mort sous le titre d'Œuvres badines et morales (1776, 1788, 1817) trouvèrent un lecteur de choix avec Gérard de Nerval...

1772-1776 – "Le Diable amoureux"
Un récit fantastique et un des petits chefs-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle, interprété souvent comme une oeuvre inspirée par l'illuminisme. Il s'agit du récit à la première personne les aventures d'un jeune officier espagnol, Alvare Maravillas, qui décide par forfanterie de convoquer le diable en compagnie de deux amis. Le diable lui apparait d'abord sous les traits d'un chameau, puis d'un épagneul et enfin sous les traits gracieux d'une jeune femme, Biondetta, qui entre dans sa vie et n'aura plus de cesse que de le séduire. Alvare, prudent, s'efforce de lui résister, mais elle paraît si fragile et si tendre qu'il en oublie son étrange et diabolique apparition. Sur le point de succomber une première fois, il n'est sauvé que par l'apparition d'une image de sa mère. Mais devenu fou d'amour, il décide enfin de présenter Biondetta à sa mère, dona Mencia, un modèle de piété, pour pouvoir l'épouser et qu'elle bénisse leur union....
"... L'homme fut un assemblage d'un peu de boue et d'eau. Pourquoi une femme ne seroit- elle pas faite de rosée, de vapeurs terrestres et de rayons de lumière, des débris d'un arc-en- ciel condensés? Où est le possible?... Où est l'impossible ? Le résultat de mes réflexions fut de me livrer encore plus à mon penchant, en crovant consulter ma raison. Je comblois Biondetta de prévenances, de caresses innocentes. Elle s'v prètoit avec une franchise qui m'enchantoit, avec cette pudeur naturelle qui agit sans être l'effet des réflexions ou de la crainte.
Un mois s'étoit passé dans des douceurs qui m'avoient enivré. Biondetta, entièrement rétablie pouvoit me suivre partout à la promenade. Je lui avois fait faire un déshabillé d'amazone: sous ce vêtement, sous un grand chapeau ombragé de plumes, elle attiroit tous les regards, et nous ne paroissions jamais que mon bonheur ne fît l'objet de l'envie de tous ces heureux citadins qui peuplent, pendant les beaux jours, les rivages enchantés de la Brenta ; les femmes même sembloient avoir renoncé à cette jalousie dont on les accuse, ou subjuguées par une supériorité dont elles ne pouvoient disconvenir, ou désarmées par un maintien qui annonçoit l'oubli de tous ses avantages.
Connu de tout le monde pour l'amant aimé d'un objet aussi ravissant, mon orgueil égaloit mon amour, et je m'élevois encore davantage quand je venois à me flatter sur le brillant de son origine. Je ne pouvois douter qu'elle ne possédât les connoissances les plus rares, et je supposois, avec raison, que son but étoit de m'en orner ; mais elle ne m'entretenoit que de choses ordinaires, et sembloit avoir perdu l'autre objet de vue. "Biondetta, lui dis-je, un soir que nous nous promenions sur la terrasse de mon jardin, lorsqu'un penchant trop flatteur pour moi vous décida à lier votre sort au mien, vous vous promettiez de m'en rendre digne, en me donnant des connoissances qui ne sont point réservées au commun des hommes. Vous parois-je maintenant indigne de vos soins ; un amour aussi tendre, aussi délicat que le vôtre, peut-il ne point désirer d'ennoblir son objet ?
— O, Alvare ! me répondit-elle, je suis femme depuis six mois, et ma passion, il me le semble, n'a pas duré un jour. Pardonnez si la plus douce des sensations enivre un cœur qui n'a jamais rien éprouvé. Je voudrois vous montrer à aimer comme moi ; et vous seriez, par ce sentiment seul, au dessus de tous vos semblables ; mais l'orgueil humain aspire à d'autres jouissances. L'inquiétude naturelle ne lui permet pas de saisir un bonheur, s'il n'en peut envisager un plus grand dans la perspective. Oui, je vous instruirai, Alvare. J'oubliois avec plaisir mon intérêt ; il le veut, puisque je dois retrouver ma grandeur dans la vôtre ; mais il ne suffit pas de me promettre d'être à moi, il faut que vous vous donniez, et sans réserve et pour toujours."
Nous étions assis sur un banc de gazon, sous un abri de chèvrefeuille au fond du jardin; je me jetai à ses genoux. « Chère Biondetta, lui dis-je, je vous jure une fidélité à toute épreuve.
— Non, disoit-elle, vous ne me connoissez pas, vous ne vous connoissez pas: il me faut un abandon absolu. Il peut seul me rassurer et me suffire. »....
En chemin, Biobetta multiplie les sortilèges et, s'étant arrêtés pour participer à une noce, et comme on les a pris pour mari et femme, ils se retrouvent dans la même chambre...
"... O mon Alvare! s'écrie Biondetta, j'ai triomphé : je suis le plus heureux de tous les êtres.»
Je n'avois pas la force de parler : j'éprouvois un trouble extraordinaire : je dirai plus; j'étois honteux, immobile. Elle se précipite à bas du lit : elle est à mes genoux : elle me déchausse. « Quoi, chère Biondetta ! m'écriai- je, quoi, vous vous abaissez... ?
— Ah! répond-elle, ingrat, je te servois lorsque tu n'étois que mon despote : laisse-moi servir mon amant. »
Je suis, dans un moment, débarrassé de mes hardes : mes cheveux, ramassés avec ordre, sont arrangés dans un filet qu'elle a trouvé dans sa poche. Sa force, son activité, son adresse ont triomphé de tous les obstacles que je voulois opposer. Elle fait avec la même promptitude sa petite toilette de nuit, éteint le flambeau qui nous éclairoit, et voilà les rideaux tirés.
Alors avec une voix à la douceur de laquelle la plus délicieuse musique ne sçauroit se comparer : « Ai-je fait, dit-elle, le bonheur de mon Alvare, comme il a fait le mien ? Mais non : je suis encore la seule heureuse ; il le sera, je le veux : je l'enivrerai de délices, je le remplirai de sciences, je l'éleverai au faîte des grandeurs. Voudras-tu, mon cœur, voudras-tu être la créature la plus privilégiée, te soumettre, avec moi, les hommes, les élémens, la nature entière?
— O ma chère Biondetta ! lui dis-je, quoiqu'en faisant un peu d'efl'ort sur moi-même, tu me suffis : tu remplis tous les vœux de mon cœur... — Non, non, répliqua-t-elle vivement, Biondetta ne doit pas te suffire : ce n'est pas là mon nom ; tu me l'avois donné : il me flattoit ; je le portois avec plaisir; mais il faut bien que tu sçaches qui je suis... Je suis le Diable, mon cher Alvare, je suis le Diable... »
En prononçant ce mot avec un accent d'une douceur enchanteresse, elle fermoit, plus qu'exactement, le passage aux réponses que j'aurois voulu lui faire. Dès que je pus rompre le silence : « Cesse, lui dis-je, ma chère Biondetta, ou qui que tu sois, de prononcer ce nom fatal et de me rappeler une erreur abjurée depuis longtems.
— Non, mon cher Alvare, non, ce n'étoit point une erreur ; j'ai dû te le faire croire, cher petit homme. Il falloit bien te tromper pour te rendre enfin raisonnable. Votre espèce échappe à la vérité : ce n'est qu'en vous aveuglant qu'on peut vous rendre heureux. Ah ! tu le seras beaucoup si tu veux l'être ! je prétends te combler. Tu conviens déjà que je ne suis pas aussi dégoûtant que l'on me fait noir. »
Ce badinage achevoit de me déconcerter. Je m'y refusois, et l'ivresse de mes sens aidoit à ma distraction volontaire. « Mais, réponds-moi donc, me disoit-elle: — Eh! que voulez-vous que je réponde?... — Ingrat, place la main sur ce cœur qui t'adore, que le tien s'anime, s'il est possible, de la plus légère des émotions qui sont si sensibles dans le mien. Laisse couler dans tes veines un peu de cette flamme délicieuse par qui les miennes sont embrasées ; adoucis, si tu le peux, le son de cette voix si propre à inspirer l'amour, et dont tu ne te sers que trop pour effrayer mon âme timide ; dis-moi, enfin, s'il t'est possible, mais aussi tendrement que je l'éprouve pour toi : Mon cher Béelzébuth, je t'adore... »
A ce nom fatal, quoique si tendrement prononcé, une frayeur mortelle me saisit ; l'étonnement, la stupeur, accablent mon âme : je la croirois anéantie si la voix sourde du remords ne crioit pas au fond de mon cœur. Cependant, la révolte de mes sens subsiste d'autant plus impérieusement qu'elle ne peut être réprimée par la raison. Elle me livre sans défense à mon ennemi : il en abuse et me rend aisément sa conquête.
Il ne me donne pas le tems de revenir à moi, de réfléchir sur la faute dont il est beaucoup plus l'auteur que le complice. « Nos affaires sont arrangées, me dit-il, sans altérer sensiblement ce ton de voix auquel il m'avoit habitué. Tu es venu me chercher : je t'ai suivi, servi, favorisé ; enfin, j'ai fait ce que tu as voulu. Je désirois ta possession, et il falloit, pour que j'y parvinsse, que tu me fisses un libre abandon de toi-même. Sans doute, je dois à quelques artifices la première complaisance ; quant à la seconde, je m'étois nommé: tu sçavois à qui tu te livrois, et ne sçaurois te prévaloir de ton ignorance. Désormais notre lien, Alvare, est indissoluble, mais pour cimenter notre société, il est important de nous mieux connoître. Comme je te sçais déjà presque par cœur, pour rendre nos avantages réciproques, je dois me montrer à toi tel que je suis. »
On ne me donne pas le tems de réfléchir sur cette harangue singulière : un coup de sifflet très-aigu part à côté de moi. A l'instant l'obscurité qui m'environne se dissipe : la corniche qui surmonte le lambris de la chambre s'est toute chargée de gros limaçons : leurs cornes, qu'ils font mouvoir vivement et en manière de bascule, sont devenues des jets de lumière phosphorique, dont l'éclat et l'effet redoublent par l'agitation et rallongement. Presque ébloui par cette illumination subite, je jette les yeux à côté de moi ; au lieu d'une figure ravissante, que vois-je ? O ciel ! c'est l'effroyable tête de chameau. Elle articule d'une voix de tonnerre ce ténébreux "Che vuoi" qui m'avoit tant épouvanté dans la grotte, part d'un éclat de rire humain plus effrayant encore, tire une langue démesurée...
Je me précipite : je me cache sous le lit, les veux fermés, la face contre terre. Je sentois battre mon cœur avec une force terrible : j'éprouvois un suffoquement comme si j'allois perdre la respiration. Je ne puis évaluer le tems que je comptois avoir passé dans cette inexprimable situation, quand je me sens tirer par le bras ; mon épouvante s'accroît : forcé néanmoins d'ouvrir les yeux, une lumière frappante les aveugle.
Ce n'étoit point celle des escargots, il n'y en avoit plus sur les corniches; mais le soleil me donnoit à-plomb sur le visage. On me tire encore par le bras : on redouble : je reconnois Marcos...."
Alvare se laisse entraîner mais, après une nouvelle apparition de la tête de chameau, sombre dans l'inconscience. Revenu à lui, il constate la disparition de la diabolique jeune fille. De retour chez sa mère, n'était-ce qu'un songe, se demande-t-il? Un Cazotte qui avec facilité sait parfaitement jeter le lecteur dans une atmosphère inquiétante et faite de soupçons permanents...

Beaumarchais (1732-1798)
Son portrait? impertinent, insolent, parvenu déplaisant, remuant, encombrant, l'homme vaut mieux sa réputation et Beaumarchais jugé par l'histoire littéraire et au-delà comme parfaitement représentatif de son temps, de cette période de fermentation sociale à la veille de 1789.C'est dans les Mémoires de l'affaire Goèzman, dans le Barbier de Séville, le Mariage de Figaro, dans les préfaces qui les accompagnent, dans la part active, déterminante qu'il prend aux luttes pour l'indépendance des Etats-Unis, en armant un navire de guerre, en fournissant aux insurgés des armes et des munitions, surtout en décidant Louis XVI à prendre parti pour la naissante république, que réside la gloire littéraire, artistique, de Beaumarchais, qui est la source même de son immortalité (Jean-Marc Nattier, Portrait de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1755, Bibliothèque-musée de la Comédie-Française).
Pierre-Augustin Caron naquit à Paris, rue Saint-Denis, fils d'horloger, puis horloger, musicien, chansonnier, dramaturge, auteur comique, homme de plaisir, homme de cour, homme d'affaires, financier, manufacturier, éditeur, armateur, fournisseur, agent secret, négociateur, publiciste, tribun par occasion, homme de paix par goût et cependant plaideur éternel, faisant comme Figaro tous les métiers, Beaumarchais a mis la main dans la plupart des événements, grands ou petits, qui ont précédé la Révolution. L'achat d'une charge de secrétaire du roi l'anoblit (1761), il se nomme maintenant M. De Beaumarchais, du nom d'une terre de sa première épouse, devient lieutenant-général des chasses aux bailliage et capitainerie de la Varenne du Louvre, organise l'exploitation de la forêt de Chinon.
Et presque au même instant on le voit, condamné au blâme, à la dégradation civique par le parlement Maupeou, décider le renversement de la magistrature qui l'a condamné, faire jouer le Barbier de Séville, correspondre secrètement de Londres avec Louis XVI et non encore réhabilité, dénué de crédit, ayant tous ses biens saisis, obtenir du roi lui-même un million avec lequel il commence et entraîne l'intervention de la France dans la querelle des États-Unis et de l'Angleterre.
Un peu plus loin, toujours composant des chansons, des comédies, des opéras, et toujours avec deux ou trois procès sur le corps, Beaumarchais fait le commerce dans les quatre parties du monde : il a quarante vaisseaux à lui sur les mers; il fait combattre sa marine avec les vaisseaux de l'État à la bataille de La Grenade, il fait décorer ses officiers, discute avec le roi les frais delà guerre et traite de puissance a puissance avec le congrès des Etats-Unis.
Assez fort pour tout cela, assez fort pour introduire Figaro au théâtre malgré Louis XVI, et pour imprimer la première édition générale de Voltaire, maigre le clergé et la magistrature, Beaumarchais n'a pas même assez de force pour se prendre au sérieux et se préserver, au milieu de sa plus grande splendeur, d'être arrêté un beau matin sans rime ni raison, et, à cinquante-trois ans, enfermé pendant quelques jours dans une maison de correction comme un jeune mauvais sujet; ce qui ne l'empêche pas de figurer à la même époque comme patron des gens de lettres auprès des ministres, d'avoir des rapports très suivis comme financier, et même à titre d'agent et de conseiller important, avec MM. de Sartines, de Maurepas, de Vergennes, de Necker, de Galonné, d'être courtisé par une foule de grands seigneurs qui lui empruntent de l'argent et oublient souvent de le rendre, de protéger même des princes auprès de l'archevêque de Paris et de contribuer puissamment, mais bien involontairement, à la destruction de la monarchie. Persécuté sous la république comme aristocrate, après avoir été emprisonné comme factieux sous la royauté, l'ex-agent de Louis XVI n'en devient pas moins, maigre lui, l'agent et le fournisseur du comité de salut public. Cette mission de fournisseur, qui devait le sauver, met sa vie en péril et porte le dernier coup à sa fortune.
Né pauvre, enrichi et ruiné deux ou trois fois, il voit tous ses biens au pillage, et, après avoir possédé 150 000 francs de rentes, proscrit, caché sous un faux nom dans un grenier de Hambourg, le vieux Beaumarchais en est réduit un instant à ce degré de misère, qu'il ménage, dit-il, une allumette, pour la faire servir deux fois. Rentré dans son pays à soixante-cinq ans, malade, sourd, mais toujours infatigable, Beaumarchais, en même temps qu'il se mêle avec une vivacité juvénile de toutes les affaires du moment, en même temps qu'il surveille la mise en scène de son dernier drame, "la Mère coupable, ou l'autre Tartuffe", en 1792, ramasse courageusement les débris de sa fortune, et recommence, un pied dans la tombe, tout le travail de sa vie, se débat au milieu d'une légion de créanciers, poursuit une légion de débiteurs, et meurt en plaidant à la fois contre la république française et contre la république des États-Unis...

Février 1775 - "Le Barbier de Séville", ou La Précaution inutile, comédie en 4 actes
Tandis que Beaumarchais se débat dans un procès contre le juge Goëzman, la Comédie-Française reçoit en 1773 la comédie du "Barbier de Séville", finalement créée en 1775. Le succès n'est pas immédiat. La pièce est coupée et ramenée de 5 à 4 actes, dès la seconde représentation. Une longue série de représentations victorieuses s'ouvre alors. Tout en méditant une suite à l'histoire de son Figaro, Beaumarchais prend la tête des auteurs dramatiques trop longtemps abusés par les Comédiens-Français, qui profitent de leur monopole pour ne pas rétribuer les auteurs comme il conviendrait....
"Me livrant à mon gai caractère, écrit Beaumarchais, j'ai tenté dans le Barbier de Séville, de ramener au théâtre l'ancienne et franche gaieté, en l'alliant avec le ton léger de notre plaisanterie actuelle". La pièce, une comédie d'intrigues riche de surprises et de rebondissement. Le jeune Comte Almaviva est épris de Rosine, pupille du médecin Bartholo qui la séquestre et compte bien l'épouser. Sous le nom de Lindor, Almaviva donne des sérénades à sa belle, mais voici qu'il rencontre Figaro, qui fut jadis à son service et s'est finalement établi comme barbier à Séville. Par bonheur, Figaro a ses entrées chez Bartholo : son esprit inventif cherche un moyen d'introduire Almaviva auprès de Rosine....
Les personnages...
LE COMTE ALMAVIVA, grand d'Espagne, amant inconnu de Rosine, parait, au premier acte, en veste et culotte de satin : il est enveloppé d'un grand manteau brun ou cape espagnole: chapeau noir rabattu avec un ruban de couleur autour de la forme. Au deuxième acte, habit uniforme de cavalier, avec des moustaches et des bottines. Au troisième, habillé en bachelier; cheveux ronds: grande fraise au cou; veste, bas et manteau d'abbé. Au quatrième acte, il est vêtu superbement à l'espagnole, avec un riche manteau: par-dessus tout, le large manteau brun dont il se tient enveloppé.
BARTHOLO, médecin, tuteur de Rosine: habit noir, court, boutonné; grande perruque; fraise et manchettes relevées: une ceinture noire: et, quand il veut sortir de chez lui, un long manteau écarlate.
ROSINE, jeune personne d'extraction noble et pupille de Rarlholo, habillée à l'espagnole.
FIGARO, barbier de Séville : en habit de major espagnol. La tête couverte d'un rescille ou filet; chapeau blanc, ruban de couleur autour de la forme; un fichu de soie attaché fort lâche à son cou: gilet et haut-de-chausses de satin, avec des boutons et boutonnières frangées d'argent; une grande ceinture de soie: les jarretières nouées avec des glands qui pendent sur chaque jambe; veste de couleur tranchante à grand revers de la couleur du gilet: bas blanc- et soulier- gris.
DON BAZILE, organiste, maître à chanter de Rosine : chapeau noir rabattu, soutanelle et long manteau, sans fraise ni manchettes.
LA JEUNESSE, vieux domestique de Bartholo.
L'ÉVEILLE, autre valet de Bartholo, garçon niais et endormi. Tous deux habillés en Galiciens; tous les cheveux dans la queue; gilet couleur de chamois; large ceinture de peau avec une boucle; culotte bleue et veste de même, dont les manches, ouvertes aux épaules pour le passage des bras, sont pendantes par derrière.
UN NOTAIRE.
UN ALCADE, homme de justice, avec une longue baguette blanche à la main.
PLUSIEURS ALGUAZILS et VALETS, avec des flambeaux.
La scène est à Séville, dans la rue, sous les fenêtres de Rosine, au premier acte et le reste de la pièce dans la maison du docteur Bartholo.
Acte I, scène 1
LE COMTE, seul, en grand manteau brun et chapeau rabattu. Il lire sa montre en se promenant.
- Le jour est moins avancé que je ne croyais. L'heure à laquelle elle a l'habitude de se montrer derrière sa jalousie est encore éloignée. N'importe; il vaut mieux arriver trop tôt que de manquer l'instant de la voir. Si quelque aimable de la cour pouvait me deviner à cent lieues de Madrid, arrêté tous les malins sous les fenêtres d'une femme à qui je n'ai jamais parlé, il me prendrait pour un Espagnol du temps d'Isabelle. — Pourquoi non? Chacun court après le bonheur. Il est pour moi dans le coeur de Rosine. — Mais quoi! suivre une femme à Séville. quand Madrid et la cour offrent de toutes parts des plaisirs si faciles! — Et c'est cela même que je fuis. Je suis las des conquêtes que l'intérêt, la convenance ou la vanité nous présentent sans cesse. Il est si doux d'être aimé pour soi-même! et si je pouvais m'assurer sous ce déguisement... Au diable l'importun!
Acte II, scène 15 - Rosine répond à l'amour de Lindor en lui écrivant une lettre qu'elle remet à Figaro. Un fourbe, don Bazile, maître à chanter de Rosine, révèle à Bartholo les projets d'Almaviva. Lindor-Almaviva se présente chez Bartholo, déguisé en soldat ; il parvient à glisser une lettre à Rosine, mais Bartholo s'en est aperçu et exige de voir la lettre; elle feint l'indignation et parle de s'enfuir ; sur quoi Bartholo va fermer la porte. Mettant à profit cet instant d'inattention, Rosine retourne la situation ...
ROSINE : Ah ciel ! que faire ?... Mettons vite à la place la lettre de mon cousin,
et donnons-lui beau jeu à la prendre. (Elle fait l'échange, et met la lettre du cousin dans sa pochette de façon qu'elle sorte un peu.)
BARTHOLO, revenant : Ah ! j'espère maintenant la voir.
ROSINE: De quel droit, s'il vous plaît?
BARTHOLO : Du droit le plus universellement reconnu, celui du plus fort.
ROSINE : On me tuera plutôt que de l'obtenir de moi.
BARTHOLO, frappant du pied : Madame ! Madame !...
ROSINE tombe sur un fauteuil et feint de se trouver mal : Ah l quelle indignité l...
BARTHOLO : Donnez cette lettre, ou craignez ma colère.
ROSINE : renversée : Malheureuse Rosine !
BARTHOLO: Qu'avez-vous donc?
ROSINE : Quel avenir affreux !
BARTHOLO : Rosine !
ROSINE : ]'étouffe de fureur !
BARTHOLO : Elle se trouve mal.
ROSINE: Je m'affaiblis, je meurs.
BARTHOLO lui tâte le pouls et dit à part : Dieux! la lettre! Lisons-la sans qu'elle en soit instruite. (Il continue à lui tâter le pouls, et prend la lettre, qu'il tâche de lire en se tournant un peu.)
ROSINE, toujours renversée : Infortunée ! ah !...
BARTHOLO lui quitte le bras, et dit à part : Quelle rage a-t-on d'apprendre ce qu'on craint toujours de savoir !
ROSINE : Ah ! pauvre Rosine !
BARTHOLO : L'usage des odeurs... produit ces affections spasmodiques.
(Il lit par derrière le fauteuil, en lui tâtant le pouls. Rosine se relève un peu, le regarde finement, fait un geste de tête, et se remet sans parler.)
BARTHOLO, à part : O ciel ! c'est la lettre de son cousin. Maudite inquiétude !
Comment l'apaiser maintenant? Qu'elle ignore au moins que je l'ai lue ! (Il fait semblant de la soutenir, et remet la lettre dans la pochette.)
ROSINE soupire : Ah !...
BARTHOLO: Eh bien! ce n'est rien, mon enfant; un petit mouvement de vapeurs, voilà tout; car ton pouls n'a seulement pas varié. (Il va prendre un flacon sur la console.)
ROSINE, à part : Il a remis la lettre! fort bien.
BARTHOLO : Ma chère Rosine, un peu de cette eau spiritueuse?
ROSINE : Je ne veux rien de vous : laissez-moi.
BARTHOLO : Je conviens que j'ai montré trop de vivacité sur ce billet.
ROSINE : Il s'agit bien du billet! C'est votre façon de demander les choses qui est révoltante.
BARTHOLO, à genoux : Pardon : j'ai bientôt senti tous mes torts ; et tu me vois à tes pieds, prêt à les réparer.
ROSINE : Oui, pardon! lorsque vous croyez que cette lettre ne vient pas de mon cousin.
BARTHOLO : Qu'elle soit d'un autre ou de lui, je ne veux aucun éclaircissement.
ROSINE, lui présentant la lettre: Vous voyez qu`avec de bonnes façons, on obtient tout de moi. Lisez-la.
BARTHOLO: Cet honnête procédé dissiperait mes soupçons, si j'étais assez malheureux pour en conserver.
ROSINE : Lisez-la donc, monsieur.
BARTHOLO se retire : A Dieu ne plaise que je te fasse une pareille injure !
ROSINE : Vous me contrariez de la refuser.
BARTHOLO : Reçois en réparation cette marque de ma parfaite confiance. Je vais voir la pauvre Marceline, que ce Figaro a, je ne sais pourquoi, saignée du pied ; n'y viens-tu pas aussi'?
ROSINE: — J'y monterai dans un moment.
BARTHOLO : — Puisque la paix est faite, mignonne, donne-moi ta main. Si tu pouvais m'aimer, comme tu serait heureuse!
ROSINE, baissant les yeux. — Si vous pouviez me plaire, ah! comme je vous aimerais!
BARTHOLO : — Je te plairai, je te plairai: quand je dis que je te plairai !...
(il sort).
SCÈNE XVI. — ROSINE le regarde aller.
Ah! Lindor ! Il dit qu'il me plaira!... Lisons cette lettre, qui a manqué de me causer tant de chagrin. (Elle lit et s'écrie :) Ha!... j'ai lu trop tard; il me recommande de tenir une querelle ouverte avec mon tuteur; j'en avais une si bonne! et je l'ai laissée échapper. En recevant la lettre, j'ai senti que je rougissais jusqu'aux yeux. Ah! mon tuteur a raison; je suis bien loin d'avoir cet usage du monde qui, me dit-il souvent, assure le maintien des femmes en toute occasion! Mais un homme injuste parviendrait à faire une rusée de l'innocence même.
ACTE III : Nouveau déguisement du Comte qui se présente cette fois comme le bachelier Alonzo, élève de Bazile: celui-ci serait malade et l'aurait chargé de le remplacer pour la leçon de musique de Rosine. Pour vaincre la méfiance de Bartholo, il doit inventer un mensonge
beaucoup plus compliqué : non, il n'est pas maître à chanter, mais doit passer pour tel aux yeux de Rosine ; c'est lui qui renseigne Bazile sur les faits et gestes du Comte Almaviva ; il produit une lettre de Rosine au Comte : Bartholo pourra s'en servir pour faire croire á sa pupille que le Comte la trahit. Dès lors Bartholo a toute confiance en Alonzo, mais il garde la lettre. Pendant la leçon de musique, les jeunes gens ne peuvent échapper un seul instant à la surveillance du tuteur qui ne sort même pas de la pièce pour se faire raser par Figaro. Soudain paraît Don Bazile...
La scène III est un vrai tour de force, puisque dès l'entrée de Bazile, la ruse savamment échafaudée par le Comte aurait du s'écrouler, il n'en sera rien, au contraire....
ROSINE, effrayée, à part : Don Bazile !...
LE COMTE, à part : Juste ciel !
FIGARO, à part : C'est le diable!
BARTHOLO va au-devant de lui .' Ah! Bazile, mon ami, soyez le bien rétabli. Votre accident n'a donc point eu de suites ? En vérité le seigneur Alonzo m'avait fort effrayé sur votre état ; demandez-lui, je partais pour vous aller voir, et s'il ne m'avait point retenu...
BAZILE, étonné : Le seigneur Alonzo?
FIGARO frappe du pied : Eh quoi! toujours des accrocs 2? Deux heures pour une méchante barbe... Chienne de pratique!
BAZILE, regardant tout le monde: Me ferez-vous bien le plaisir de me dire, messieurs...?
FIGARO : Vous lui parlerez quand je serai parti.
BAZILE : Mais encore faudrait-il...
LE COMTE: Il faudrait vous taire, Bazile. Croyez-vous apprendre à monsieur quelque chose qu'il ignore? Je lui ai raconté que vous m'aviez chargé de venir donner une leçon de musique à votre place.
BAZILE, plus étonné: La leçon de musique !... Alonzo !...
ROSINE, à part, à Bazíle . Eh ! taisez-vous.
BAZILE : Elle aussi !
LE COMTE, bas à Bartholo : Dites-lui donc tout bas que nous en sommes convenus.
BARTHOLO, à Bazile à part: N'allez pas nous démentir, Bazile, en disant qu'il n'est pas votre élève ; vous gâteriez tout.
BAZILE : Ah l ah !
BARTHOLO, haut: En vérité, Bazile, on n'a pas plus de talent que votre élève.
BAZILE, stupéfait : Que mon élève!... (Bas.) Je venais pour vous dire que le comte est déménagé.
BARTHOLO, bas : Je le sais, taisez-vous.
BAZILE, bas : Qui vous l'a dit?
BARTHOLO, bas: Lui, apparemment.
LE COMTE, bas: Moi, sans doute : écoutez seulement.
ROSINE, bas à Bazile : Est-il si difficile de vous taire?
FIGARO, bas à Bazile : Hum ! Grand escogriffe ! Il est sourd !
BAZILE, à part: Qui diable est-ce donc qu'on trompe ici? Tout le monde est dans le secret!
BARTHOLO, haut: Eh bien, Bazile, votre homme de loi ?
FIGARO : Vous avez toute la soirée pour parler de l'homme de loi.
BARTHOLO, à Bazile : Un mot: dites-moi seulement si vous êtes content de l'homme de loi?
BAZILE, effaré : De l'homme de loi?
LE COMTE, souriant : Vous ne l'avez pas vu, l'homme de loi?
BAZILE, impatiente : Eh! non, je ne l'ai pas vu, l'homme de loi.
LE COMTE, à Bartholo, à part: Voulez-vous donc qu'il s'explique ici devant elle? Renvoyez-le.
BARTHOLO, bas, au comte: Vous avez raison. ( A Bazile.) Mais quel mal vous a donc pris si subitement?
BAZILE, en colère : Je ne vous entends pas.
LE COMTE lui met à part une bourse dans la main : Oui, monsieur vous demande ce que vous venez faire ici, dans l'état d'indisposition où vous êtes ?
FIGARO : Il est pâle comme un mort !
BAZILE : Ah ! je comprends ...
LE COMTE: Allez vous coucher, mon cher Bazile: vous n'êtes pas bien, et vous nous faites mourir de frayeur. Allez vous coucher.
FIGARO: Il a la physionomie toute renversée. Allez vous coucher.
BARTHOLO : D'honneur, il sent la fièvre d'une lieue. Allez vous coucher.
ROSINE : Pourquoi êtes-vous donc sorti? On dit que cela se gagne. Allez vous coucher.
BAZILE, au dernier étonnement : Que j'aille me coucher !
TOUS LES ACTEURS ENSEMBLE : Eh ! sans doute.
BAZILE, les regardant tous: En effet, messieurs, je crois que je ne ferai pas mal de me retirer; je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire.
BARTHOLO : A demain, toujours, si vous êtes mieux.
LE COMTE : Bazile, Je serai chez vous de très bonne heure.
FIGARO : Croyez-moi, tenez-vous bien chaudement dans votre lit.
ROSINE : Bonsoir, monsieur Bazile.
BAZILE, à part: Diable emporte si j'y comprends rien! et sans cette bourse...
TOUS : Bonsoir, Bazile, bonsoir.
BAZILE, en s'en allant: Eh bien! bonsoir donc, bonsoir. (Ils l'accompagnent tous en riant.)
Le Comte parvient à glisser à l'oreille de Rosine : nous avons la clé de la jalousie, et nous serons ici à minuit. ACTE IV : Bazile a révélé à Bartholo qu'il ne connaissait pas le pseudo-Alonzo ; il lui conseille d'employer la calomnie pour vaincre la résistance de Rosine. Grâce à la lettre qu'il détient, le tuteur fait croire à Rosine que Lindor-Alonzo n'est qu'un émissaire du comte, et que celui-ci la trahit. Désespérée, la pauvre Rosine accepte d'épouser Bartholo et lui révèle que Lindor doit s'introduire chez elle cette nuit même. Le tuteur court chercher main-forte. Sur ce, escorte de Figaro, Lindor paraît à la fenêtre ; Rosine l'accable de reproches, mais il a tôt fait de dissiper le malentendu et de lui apprendre qu'il n'est autre que le comte Almaviva, et la jeune fille tombe dans ses bras. Arrivent Bazile et le notaire ; celui-ci unit le Comte et Rosine. Lorsque Bartholo revient avec la police, il est trop tard : sa pupille est devenue la comtesse Almaviva. Il en est réduit á s'écrier : Ah ! je me suis perdu faute de soins ! Faute de sens, réplique Figaro : quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit la "Précaution inutile"....
En 1775, alors qu'éclate l'insurrection des colonies anglaises d'Amérique et que Louis XVI et Vergennes hésitent à intervenir, Beaumarchais reçoit un million du gouvernement français, crée une société fictive de commerce et de navigation, et fait parvenir aux Américains armes et équipements. En 1776-1778, les deux sentences portées contre lui sont annulées par le nouveau Parlement, il est réhabilité. Il entreprend ensuite à Kehl l'édition monumentale des Œuvres de Voltaire (1783-1790), marquant une nouvelle victoire du parti des philosophes. Avec Le Mariage de Figaro, Beaumarchais atteint le sommet de sa carrière...
1784 - "Il est peut-être utile de dévoiler, écrit-il dans sa Préface au Mariage de Figaro, aux yeux de tous, ce double aspect des comédies; et j'aurai fait encore un bon usage de la mienne, si je parviens, en la scrutant, à fixer l'opinion publique sur ce qu'un doit entendre par ces mots : Qu'est-ce que LA DECENCE THEATRALE?
A force de nous montrer délicats, fins connaisseurs, el d'affecter, comme j'ai dit autre part, l'hypocrisie de la décence auprès du relâchement des mœurs, nous devenons des êtres nuls, incapables de s'amuser et de juger de ce qui leur convient : faut-il le dire enfin? des bégueules rassasiées qui ne savent plus ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles doivent aimer ou rejeter. Déjà ces mots si rebattus, "bon ton", "bonne compagnie", toujours ajustés au niveau de chaque insipide coterie, et dont la latitude est si grande qu'on ne sait où ils commencent et finissent, ont détruit la franche et vraie gaieté qui distinguait de tout autre le comique de notre nation.
Ajoutez-y le pédantesque abus de ces autres grands mots, "décence" et "bonnes mœurs", qui donnent un air si important, si supérieur, que nos jugeurs de comédies seraient désolés de n'avoir pas à les prononcer sur toutes les pièces de théâtre, et vous connaîtrez à peu près ce qui garrotte le génie, intimide tous les auteurs, et porte un coup mortel à la vigueur de l'intrigue, sans laquelle il n'y a pourtant que du bel esprit à la glace el des comédies de quatre jours.
Enfin, pour dernier mal, tous les états de la société sont parvenus à se soustraire à la censure dramatique : on ne pourrait mettre au théâtre les Plaideurs de Racine, sans entendre aujourd'hui les Dandins et les Brid'oisons, même des gens plus éclairés, s'écrier qu'il n'y a plus ni mœurs, ni respect pour les magistrats.
On ne ferait point le Turcaret, sans avoir à l'instant sur les bras fermes, sous-fermes, traites et gabelles, droits réunis, tailles, taillons, le trop-plein, le trop-bu, tous les impositeurs royaux. I1 est vrai qu'aujourd'hui Turcaret n'a plus de modèles. On l'offrirait sous d'autres traits; l'obstacle resterait le même.
On ne jouerait point les Fâcheux, les Marquis, les Emprunteurs de Molière, sans révolter à la fois la haute, la moyenne, la moderne et l'antique noblesse. Ses "Femmes savantes" irriteraient nos féminins bureaux d'esprit. Mais quel calculateur peut évaluer la force et la longueur du levier qu'il faudrait, de nos jours, pour élever jusqu'au théâtre l'œuvre sublime du "Tartufe"? Aussi l'auteur qui se compromet avec le public pour l'amuser ou pour l'instruire, au lieu d'intriguer à son choix son ouvrage, est-il obligé de tourniller dans des incidents impossibles, de persifler au lieu de rire, et de prendre ses modèles hors de la société, crainte de se trouver mille ennemis, dont il ne connaissait aucun en composant son triste drame.
J'ai donc réfléchi que si quelque homme courageux ne secouait pas toute cette poussière, bientôt l'ennui des pièces françaises porterait la nation au frivole opéra comique, et plus loin encore, aux boulevards, à ce ramas infect de tréteaux élevés à notre honte, où la décente liberté, bannie du théâtre français, se change en une licence effrénée; où la jeunesse va se nourrir de grossières inepties, et perdre, avec ses moeurs, le goût de la décence et des chefs d'oeuvre de nos maîtres. J'ai tenté d'êtres cet homme; et si je n'ai pas mis plus de talent à mes ouvrages, au moins mon intention s'est-elle manifestée dans tous..."

27 avril 1784 - "Le Mariage de Figaro", comédie en cinq actes
Succès de scandale, la censure et les réticences de Louis XVI, qui a senti ce qu'il y a de subversif dans cette comédie brillante, en retardent la création, et Le Mariage de Figaro sera joué sur un théâtre privé, chez M. de Vaudreuil. La longue résistance du roi ne fera que renforcer l'extrême portée satirique de la pièce : la première représentation publique prendra valeur d'un signe avant-coureur de la révolution. Figaro va désormais incarner le personnage populaire , frondeur, parisien, vif et sentimental, qui réclame un peu plus de justice sociale. La pièce est enfin créée, le 27 avril 1784, remportant le plus grand triomphe de toute l'histoire de la Comédie-Française, plus de cent représentations en quatre ans (dont 67 en 1784). Mais l'imprudence de Beaumarchais est légendaire, et le voici emprisonné pour quelques jours à Saint-Lazare (mars 1785) pour quelques mots mal interprétés...
Trois ans ont passé. Figaro, devenu concierge du château d'Aguas Frescas, va épouser Suzanne, camériste de la Comtesse. Mais le Comte, naguère si épris, délaisse maintenant sa femme et voudrait obtenir un rendez-vous de Suzanne, le jour même du mariage.
Acte I, scène I, FIGARO, SUZANNE.
Le théâtre représente une chambre à demi démeublée, un grand fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleur d'oranger, appelé «chapeau de la mariée».
FIGARO. - Dix-neuf pieds sur vingt-six.
Suzanne. — Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau : le trouves-tu mieux ainsi?
FIGARO lui prend les mains. — Sans comparaison, ma charmante. Oh! que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, est doux, le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux!...
SUZANNE se relire. — Que mesures-tu donc là, mon fils?
FIGARO. — Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que monseigneur nous donne aura bonne grâce Ici.
SUZANNE. — Dans cette chambre?
FIGARO. — II nous la cède.
SUZANNE. — Et moi, je n'en veux point.
FIGARO. — Pourquoi?
SUZANNE. — Je n'en veux point.
FIGARO. — Mais encore?
SUZANNE. — Elle me déplaît.
FIGARO. — On dit une raison.
SUZANNE. — Si je n'en veux pas dire?...
FIGARO. — Ob! quand elles sont sûres de nous!...
SUZANNE. — Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non?
FIGARO. — Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté; zeste! en deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? il n'a qu'à tinter du sien; crac! en trois sauts me voilà rendu!
SUZANNE. Fort bien! mais quand il aura tinté le matin pour te donner quelque bonne et longue commission, zeste! en deux pas il est à ma porte, el crac, en trois sauts...
FIGARO. — Qu'entendez-vous par ces paroles?
SUZANNE. — Il faudrait m'écouter tranquillement.
FIGARO. — Eh! qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu!
SUZANNE. — Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, M. le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme; c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c'est ce que le loyal Bazile, honnête agent de ses plaisir et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon.
FIGARO. — Bazile! ô mon mignon! si jamais volée de bois vert, appliquée sur une échine, a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un...
SUZANNE. — Tu croyais, bon garçon! que cette dot qu'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite?
FIGARO. — J'avais assez fait pour l'espérer.
SUZANNE. — Que les gens d'esprit sont bêtes!
FIGARO. — On le dit.
SUZANNE. — Mais c'est qu'on ne veut pas le croire.
FIGARO. — On a tort.
SUZANNE. — Apprends qu'il In destine à obtenir de moi, secrètement, certain quart d'heure, seul à seule, qu'un ancien droit de seigneur... Tu sais s'il était triste!
FIGARO. — Je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne t'eusse épousée dans ses domaines.
SUZANNE. — Eh bien! s'il l'a détruit, il s'en repent : et c'est de ta fiancée qu'il veut le racheter en secret aujourd'hui.
FIGARO, se frottant la tète. — Ma tète s'amollit de surprise et mon front fertilisé...
SUZANNE. — Ne le frotte donc pas!
FIGARO. — Quel danger?
SUZANNE, riant. — S'il venait un petit bouton, des gens superstitieux...
FIGARO. — Tu ris, friponne! Ah! s'il y avait moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège, et d'empocher son or!
SUZANNE. — De l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère.
FIGARO. — Ce n'est pas la honte qui me retient.
SUZANNE. — La crainte?
FIGARO. — Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien : car, d'entrer chez quelqu'un la nuit, de lui souffler sa femme et d'y recevoir cent coups de fouet pour la peine, il n'est rien de plus aisé; mille sots coquins l'ont fait. Mais... (On sonne de l'intérieur.)
SUZANNE. - Voilà madame éveillée ; elle m'a bien recommandé d'être la première à lui parler le matin de mes noces.
FIGARO. - Y a-t-il encore quelque chose là-dessous?
SUZANNE. — Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit Fi... Fi... Figaro, rêve à notre affaire.
FIGARO. — Pour m'ouvrir l'esprit, donne un petit baiser.
SUZANNE. — A mon amant aujourd'hui? Je t'en souhaite! Et qu'en dirait demain mon mari? (Figaro l'embrasse).
SUZANNE. — Eh bien ! eh bien !
FIGARO. - C'est que tu n'a pas d'idée de mon amour.
SUZANNE, se défripant. — Quand cesserez-vous, importun, de m'en parler du matin au soir?
FIGARO, mystérieusement, — Quand je pourrai te le prouver du soir jusqu'au matin. (On sonne une seconde fois.)
SUZANNE, de loin, les doigts unis sur la bouche. — Voilà Votre baiser, monsieur, je n'ai plus rien à vous.
FIGARO, court après elle. — Oh ! mais ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu.
Acte I - Suzanne apprend á Figaro les intentions du Comte. Un autre obstacle risque d'empêcher leur union : Marceline (la gouvernante de Bartholo dans le Barbier de Séville) a prêté de l'argent â Figaro moyennant promesse de mariage, or Figaro n'a pas de quoi payer sa dette, et Marceline désire vivement l'épouser. Autre élément de l'intrigue : Chérubin, petit page de 13 ou 14 ans, charmant et précoce, est épris en secret de sa marraine la Comtesse. Il raconte à Suzanne que le Comte le renvoie du château, lorsqu'Almaviva apparaît. Chérubin se dissimule derrière un fauteuil. Au terme d'un amusant jeu de cache-cache, le Comte le découvre : il est furieux que le page l'ait entendu faire Ia cour à Suzanne.
L'ACTE II s'ouvre sur une conversation entre la Comtesse et Suzanne. Le spectateur a assisté aux scènes que raconte la jeune fille (I, 7, 8 et 9), dont elle précise plutôt les détails, à la demande de sa maîtresse, car elle est censée lui en avoir déjà fait le récit. L'intérêt réside donc dans les réactions de la Comtesse, désolée et humiliée d'apprendre l'infidélité de son mari, émue et un peu troublée par l'amour que lui voue le page. "Agitée de deux sentiments contraires, nous dit l'auteur, elle ne doit montrer qu'une sensibilité réprimée..., rien surtout qui dégrade aux yeux du spectateur son caractère aimable et vertueux".
"Le théâtre représente une chambre à coucher superbe, un grand lit en alcôve, une estrade au-devant ; la porte pour entrer s'ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite, celle d'un cabinet, à la première coulisse à gauche. Une porte, dans le fond, va chez les femmes. Une fenêtre s'ouvre de l'autre côté".
LA COMTESSE se jette dans une bergère: Ferme la porte, Suzanne, et conte-moi tout dans le plus grand détail.
SUZANNE : Je n'ai rien caché à Madame.
LA COMTESSE : Quoi, Suzon, il voulait te séduire?
SUZANNE: Oh! que non! Monseigneur n'y met pas tant de façon avec sa servante ; il voulait m'acheter.
LA COMTESSE : Et le petit page était présent?
SUZANNE: C'est-à-dire, caché derrière le grand fauteuil. Il venait me prier de vous demander sa grâce.
LA COMTESSE : Hé pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? est-ce que je l'aurais refusé , Suzon.
SUZANNE : C'est ce que j`ai dit : mais ses regrets de partir, et surtout de quitter Madame ! Ah ! Suzon, qu'elle est noble et belle! mais qu'elle est imposante !
LA COMTESSE : Est-ce que j'ai cet air-là, Suzon? Moi qui l'ai toujours protégé.
SUZANNE : Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais, il s'est jeté dessus...
LA COMTESSE, souriant : Mon ruban ?... Quelle enfance !
SUZANNE : J'ai voulu le lui ôter ; Madame, c'était un lion ; ses yeux brillaient... "Tu ne l'auras qu'avec ma vie", disait-il en forçant sa petite voix douce et grêle.
LA COMTESSE, rêvant : Eh bien, Suzon ?
SUZANNE : Eh bien, Madame, est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par-ci ; je voudrais bien par l'autre; et parce qu'il n'oserait seulement baiser la robe de Madame, il voudrait toujours m'embrasser, moi.
LA COMTESSE, rêvant : Laissons... laissons ces folies ... Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire...?
SUZANNE : Que si je ne voulais pas l'entendre, il allait protéger Marceline.
LA COMTESSE, se lève et se promène en se servant fortement de l'éventail : Il ne m'aime plus du tout.
SUZANNE: Pourquoi tant de jalousie?
LA COMTESSE : Comme tous les maris, ma chère ! uniquement par orgueil. Ah ! je l'ai trop aimé ! je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour ; voilà mon seul tort envers lui; mais je n'entends pas que cet honnête aveu te nuise, et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider : viendra-t-il?
SUZANNE : Dès qu'il verra partir la chasse.
LA COMTESSE, se servant de l'éventail: Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait une chaleur ici !...
SUZANNE : C'est que Madame parle et marche avec action. (Elle va ouvrir la croisée du fond.)
LA COMTESSE rêvant longtemps : Sans cette constance à me fuir... Les hommes sont bien coupables !
SUZANNE crie de la fenêtre: Ah! voilà Monseigneur qui traverse à cheval le grand potager, suivi de Pédrille, avec deux, trois, quatre lévriers.
LA COMTESSE : Nous avons du temps devant nous. (Elle s'assied) On frappe, Suzon ?
SUZANNE court ouvrir en chantant: Ah! c'est mon Figaro! ah! c'est mon Figaro !
Chérubin n'est pas parti : Figaro a imaginé de lui faire revêtir des vêtements de Suzanne pour le substituer à celle-ci au rendez-vous du Comte! Suzanne et la Comtesse commencent à travestir le page qui chante à sa belle marraine une romance sentimentale. Mais on frappe à la porte, c'est le Comte. Il arrive, soupçonneux, alerté par un billet anonyme lui annonçant qu'il trouvera un homme chez la Comtesse : c'est une imprudence de Figaro qui a cru bon d'éveiller la jalousie d'Almaviva pour qu'il s'occupe un peu moins de Suzanne. Chérubin s'est enfermé dans un cabinet, mais il fait du bruit et le Comte l'entend. Pendant un instant les spectateurs tremblent pour la Comtesse : la comédie va-t-elle tourner au drame? Heureusement le Comte va chercher un outil pour enfoncer la porte du cabinet: pendant qu'il sort avec la Comtesse, Suzanne se substitue á Chérubin qui saute par la fenêtre. Mais la Comtesse, tentant vainement de calmer la fureur de son époux, lui avoue que Chérubin est dans le cabinet, elle lui tend même la clé. Le Comte ouvre... et trouve Suzanne! Il ne sait que penser : sa femme a-t-elle vraiment voulu, par un faux aveu, le punir de sa jalousie ? Mais elle ne paraît pas moins stupéfaite que lui. L'intrigue rebondit avec l'arrivée d'Antonio...
Acte II, 21 - Fâcheuse intervention que celle du jardinier, au moment où la partie qui se joue contre le Comte allait être gagnée ! Comment empêcher Antonio de parler? comment empêcher le Comte de l'écouter ? Figaro est d'abord embarrassé, puis il prend carrément l'offensive dès qu'il sait qu'Antonio n'a pas reconnu avec certitude l'homme qu'on a jeté par la fenêtre.
ANTONIO, demi-gris, tenant un pot de giroflées écrasées : Monseigneur! Monseigneur !
LE COMTE : Que me veux-tu, Antonio?
ANTONIO : Faites donc une fois griller les croisées qui donnent sur mes couches. On jette toutes sortes de choses par ces fenêtres, et tout à l'heure encore on vient d'en jeter un homme.
LE COMTE : Par ces fenêtres ?
ANTONIO : Regardez comme on arrange mes giroflées !
SUZANNE, bas à Figaro : Alerte, Figaro, alerte !
FIGARO : Monseigneur, il est gris dès le matin.
ANTONIO : Vous n'y êtes pas. C'est un petit reste d'hier. Voilà comme on fait des jugements... ténébreux.
LE COMTE, avec feu : Cet homme ! cet homme ! où est-il?
ANTONIO: Où il est?
LE COMTE: Oui.
ANTONIO : C'est ce que je dis. ll faut me le trouver déjà. Je suis votre domestique ; il n'y a que moi qui prends soin de votre jardin ; il y tombe un homme ; et vous sentez... que ma réputation en est effleurée.
SUZANNE, bas à Figaro : Détourne, détourne.
FIGARO: Tu boiras donc toujours?
ANTONIO: Ah! si je ne buvais pas, je deviendrais enragé.
LA COMTESSE : Mais en prendre ainsi sans besoin...
LE COMTE, vivement: Réponds-moi donc, ou je vais te chasser.
ANTONIO: Est-ce que je m'en irais?
LE COMTE: Comment donc?
ANTONIO, se touchant le front : Si vous n'avez pas assez de ça pour garder un bon domestique, je ne suis pas assez bête, moi, pour renvoyer un si bon maître.
LE COMTE le secoue avec colère : On a, dis-tu, jeté un homme par cette fenêtre?
ANTONIO : Oui, mon Excellence, tout à l'heure, en veste blanche, et qui s'est enfui, jarni, courant...
LE COMTE, impatienté : Après?
ANTONIO : J'ai bien voulu courir après, mais je me suis donné contre la grille une si fière gourde à la main, que je ne peux plus remuer ni pied ni patte de ce doigt-là. (Levant le doigt.)
LE COMTE : Au moins, tu reconnaîtrais l'homme?
ANTONIO : Oh ! que oui-dà l... si je l'avais vu, pourtant !
SUZANNE, bas à Figaro : Il ne l'a pas vu.
FIGARO : Voilà bien du train pour un pot de fleurs! Combien te faut-il, pleurard, avec ta giroflée? Il est inutile de chercher, Monseigneur: c'est moi qui ai sauté.
LE COMTE : Comment, c'est vous?
ANTONIO : Combien te faut-il, pleurard? Votre corps a donc bien grandi depuis ce temps-là? car je vous ai trouvé beaucoup plus moindre et plus fluet!
FIGARO : Certainement : quand on saute, on se pelotonne...
ANTONIO : M'est avis que c'était plutôt... qui dirait, le gringalet de page.
LE COMTE : Chérubin, tu veux dire?
FIGARO : Oui, revenu tout exprès avec son cheval de la porte de Séville, où peut-être il est déjà.
ANTONIO : Oh ! non, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça ; je n'ai pas vu sauter de cheval, car je le dirais de même.
LE COMTE : Quelle patience !
FIGARO: J'étais dans la chambre des femmes, en veste blanche: il fait un chaud ! ]'attendais là ma Suzette, quand j'ai ouï tout à coup la voix de Monseigneur et le grand bruit qui se faisait ; je ne sais quelle crainte m'a saisi à l'occasion de ce billet, et, s'il faut avouer ma bêtise, j'ai sauté sans réflexion sur les couches, où je me suis même un peu foulé le pied droit. ( Il frotte son pied.)
ANTONIO : Puisque c'est vous, il est juste de vous rendre ce brimborion de papier qui a coulé de votre veste en tombant.
Grâce à la complicité de Suzanne et de la Comtesse, Figaro parvient à résoudre l'énigme : ce brimborion de papier, c'est le brevet d'officier de Chérubin, qu'Almaviva a nommé capitaine dans sa Légion, pour se débarrasser de lui. Chérubin l'aurait remis á Figaro car il y manquait
un cachet. Le Comte sent qu'on se joue de lui, mais ne parvient pas à démêler la vérité. Va-t-il enfin ordonner le mariage de Figaro ? Non, car Marceline vient faire valoir ses droits. A la fin de l'Acte, la Comtesse, modifiant le projet primitif, décide de remplacer Suzanne au rendez-vous du Comte : mais surtout, que Figaro n'en soit pas informé : il voudrait mettre ici du sien.
ACTE III : Avant de juger l'affaire de Marceline, le Comte décide de sonder Figaro : de ses réponses dépendra l'issue du procès. La scène (III, 5) manque de vraisemblance, mais elle contient deux tirades célèbres, celle de God-dam, et la définition de la politique...
LE COMTE, radouci : J'avais... oui, j'avais quelque envie de t'emmener à Londres, courrier de dépêches ;... mais, toutes réflexions faites...
FIGARO : Monseigneur a changé d'avis?
LE COMTE : Premièrement, tu ne sais pas l'anglais.
FIGARO : Je sais God-dam.
LE COMTE : Je n'entends pas.
FIGARO : Je dis que je sais God-dam.
LE COMTE : Hé bien?
F IGARO : Diable l c'est une belle langue que l'anglais ; il en faut peu pour aller loin. Avec God-dam, en Angleterre, on ne manque de rien nulle part. - Voulez-vous tâter d'un bon poulet gras : entrez dans une taverne, et faites seulement ce geste au garçon (il tourne la broche), God-dam ! on vous apporte un pied de bœuf salé sans pain. C'est admirable ! Aimez-vous à boire un coup d'excellent bourgogne ou de clairet, rien que celui-ci (il débouche une bouteille). God-dam ! on vous sert un pot de bière, en bel étain, la mousse aux bords. Quelle satisfaction! Rencontrez-vous une de ces jolies personnes qui vont trottant menu, les yeux baissés, coudes en arrière, et tortillant un peu des hanches : mettez mignardement tous les doigts unis dans la bouche. Ah ! God-dam ! elle vous sangle un soufflet de crocheteur : preuve qu'elle entend. Les Anglais, à la vérité, ajoutent, par-ci par-là quelques autres mots en conversant ; mais il est bien aisé de voir que God-dam est le fond de la langue ; et si Monseigneur n'a pas d'autre motif de me laisser en Espagne...
LE COMTE, à part : Il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé.
FIGARO, à part : Il croit que je ne sais rien, travaillons-le un peu dans son genre.
LE COMTE : Quel motif avait la Comtesse, pour me jouer un pareil tour?
FIGARO : Ma foi, Monseigneur, vous le savez mieux que moi.
LE COMTE : Je la préviens sur tout et la comble de présents.
FIGARO: Vous lui donnez, mais vous êtes infidèle. Sait-on gré du superflu à qui nous prive du nécessaire?
LE COMTE : Autrefois tu me disais tout.
FIGARO: Et maintenant je ne vous cache rien.
LE COMTE : Combien la Comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association ?
FIGARO : Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du Docteur ? Tenez, Monseigneur, n'humilions pas l'homme qui nous sert bien, crainte d'en faire un mauvais valet.
LE COMTE : Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours du louche en ce que tu fais?
FIGARO: C'est qu'on en voit partout, quand on cherche des torts.
LE COMTE: Une réputation détestable!
FIGARO: Et si je vaux mieux qu'elle? Y a-t-il beaucoup de Seigneurs qui puissent en dire autant?
LE COMTE : Cent fois je t'ai vu marcher à la fortune, et jamais aller droit.
FIGARO : Comment voulez-vous? la foule est là ; chacun veut courir, on se presse, on pousse, on coudoie, on renverse, arrive qui peut ; le reste est écrasé. Aussi c'est fait ; pour moi, j'y renonce.
LE COMTE : A la fortune? ( A part) Voici du neuf.
FIGARO (A part) : A mon tour maintenant. (Haut.) Votre Excellence m'a gratifié de la conciergerie du château ; c'est un fort joli sort : à la vérité je ne serai pas le courrier étrenné des nouvelles intéressantes ; mais en revanche, heureux avec ma femme au fond de l'Andalousie...
LE COMTE: Qui t'empêcherait de l'emmener à Londres?
FIGARO: Il faudrait la quitter si souvent, que j'aurais bientôt du mariage par-dessus la tête.
LE COMTE: Avec du caractère et de l'esprit, tu pourrais un jour t'avancer dans les bureaux.
FIGARO : De l'esprit pour s'avancer? Monseigneur se rit du mien. Médiocre et rampant, et l'on arrive à tout.
LE COMTE : Il ne faudrait qu'étudier un peu sous moi la politique.
FIGARO: Je la sais.
LE COMTE : Comme l'anglais, le fond de la langue!
FIGARO : Oui, s'il y avait ici de quoi se vanter. Mais, feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore ; d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend ; surtout de pouvoir au-delà de ses forces ; avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point ; s'enfermer pour tailler des plumes, et paraître profond quand on n'est, comme on dit, que vide et creux ; jouer bien ou mal un personnage; répandre des espions et pensionner des
traîtres ; amollir des cachets ; intercepter des lettres; et tâcher d'ennoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets : voilà toute la politique, ou je meure !
LE COMTE: Eh! c'est l'intrigue que tu définis !
FIGARO : La politique, l'intrigue, volontiers ; mais comme je les crois un peu germaines, en fasse qui voudra. Taime mieux ma mie, ô gué ! comme dit la chanson du bon Roi.
LE COMTE, à part: Il veut rester. J'entends... Suzanne m'a trahi.
FIGARO, à part : Je l'enfile et le paye en sa monnaie.
LE COMTE: Ainsi, tu espères gagner ton procès contre Marceline?
FIGARO: Me feriez-vous un crime de refuser une vieille fille, quand Votre Excellence se permet de nous souffler toutes les jeunes?
LE COMTE, raillant: Au tribunal, le magistrat s'oublie et ne voit plus que l'ordonnance.
FIGARO: Indulgente aux grands, dure aux petits ...
LE COMTE : Crois-tu donc que je plaisante?
FIGARO: Eh! qui le sait, Monseigneur? Tempo è galant' uomo, dit l'italien; il dit toujours la vérité : c'est lui qui m'apprendra qui me veut du mal ou du bien.
LE COMTE, à part : Je vois qu'on lui a tout dit ; il épousera la duègne.
FIGARO, à part : Il a joué au fin avec moi ; qu'a-t-il appris?
A l'acte III, scène 15, scène du procès, on y découvre que Figaro est en fait le fils de Marceline et de Bartholo. L'acte IV est celui du spectacle accompagnant les noces de Figaro et de Suzanne, mais on a remis un billet doux au Comte et Figaro va se croire trahi par Suzanne. Le monologue de l'acte V, scène 3, montre un Figaro inattendu...
FIGARO, seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre :
O femme! femme! femme! créature faible et décevantel !... nul animal créé ne peut manquer à son instinct; le tien est-il donc de tromper ? ... Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse ; à l'instant qu'elle me donne sa parole ; au milieu même de la cérémonie... Il riait en lisant, le perfide ! et moi, comme un benêt ...! Non, Monsieur le Comte, vous ne l'aurez pas... vous ne l'aurez pas... Parce que vous êtes un grand Seigneur, vous vous croyez un grand génie !... Noblesse, fortune, un rang, des places: tout cela rend si fier! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus ; du reste, homme assez ordinaire! tandis que moi, morbleu! perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter .. On vient... c'est elle... ce n'est personne.
La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ! Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis repoussé ! J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie ; et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire! - Las d'attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre; me fussé-je miss une pierre au cou!
Je broche une comédie dans les mœurs du sérail ; auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule; à l'instant un envoyé... de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime Porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc : et voilà ma comédie flambée pour plaire aux princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l'omoplate en nous disant : "Chiens de chrétiens!" - Ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. - Mes joues creusaient, mon terme était échu ; je voyais de loin arriver l'affreux recors, la plume fichée dans sa perruque; en frémissant je m'évertue. Il s'élève une question sur la nature des richesses, et, comme il n'est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n'ayant pas un sou, j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net; sitôt je vois, du fond d'un fiacre, baisser pour moi le pont d'un château fort, à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté. (Il se lève.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! ]e lui dirais... que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours ; que, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. ( Il se rassied.)
Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il faut dîner quoiqu'on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, et demande à chacun de quoi il est question : on me dit que pendant ma retraite économique il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s'étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l'inspection de deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j'annonce un écrit périodique, et, croyant n'aller sur les brisées d'aucun autre, je le nomme journal inutile. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille ; on me supprime, et me voilà derechef sans emploi!
- Le désespoir m'allait saisir ; on pense à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre : il fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint. Il ne me restait plus qu'à voler ; je me fais banquier de pharaon : alors, bonnes gens ! je soupe en ville, et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. J'aurais bien pu me remonter ; je commençais même à comprendre que, pour gagner du bien, le savoir-faire vaut mieux que le savoir. Mais comme chacun pillait autour de moi en exigeant que je fusse honnête, il fallut bien périr encore. Pour le coup je quittais le monde, et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer, lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais; puis, laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent, et la honte au milieu du chemin, comme trop lourde à un piéton, je vais rasant de ville en ville, et je vis enfin sans souci. Un grand seigneur passe à Séville ; il me reconnaît, je le marie, et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse, il veut intercepter la mienne! lntrigue, orage à ce sujet. Prêt à tomber dans un abîme, au moment, d'épouser ma mère, mes parents m'arrivent à la file. (ll se lève en s'échauffant). On se débat, c'est vous, c'est lui, c'est moi, c'est toi; non, ce n'est pas nous: eh mais, qui donc ? (Il retombe assis.)
O bizarre suite d'événements! Comment cela m'est-il arrivé? Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Qui les a fixées sur ma tête ? Forcé de parcourir la route où je suis entré sans le savoir, comme j'en sortirai sans le vouloir, je l'ai jonchée d'autant de fleurs que ma gaieté me l'a permis : encore je dis ma gaieté, sans savoir si elle est à moi plus que le reste, ni même quel est ce moi dont je m'occupe : un assemblage informe de parties inconnues, puis un chétif être imbécile, un petit animal folâtre, un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre ; maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune! ambitieux par vanité, laborieux par nécessité, mais paresseux... avec délices ! orateur selon le danger, poète par délassement, musicien par occasion, amoureux par folles bouffées, j'ai tout vu, tout fait, tout usé. Puis l'illusion s'est détruite, et trop désabusé... Désabusé !... Suzon, Suzon, Suzon! que tu me donnes de tourments! - J'entends marcher... on vient. Voici l'instant de la crise."
Quiproquo en tout genre entre le Comte et Figaro, Suzanne, et la Comtesse qui ont échangé leurs vêtements, chacun tente de surprendre, de se confondre, de se punir, le dénouement est proche, celui de l'amour légitime...
FIGARO, avec une chaleur comique, à genoux: Ah! Madame, je vous adore. Examinez le temps, le lieu, les circonstances, et que le dépit supplée en vous aux grâces qui manquent à ma prière.
SUZANNE, à part: La main me brûle !
FIGARO, à part : Le cœur me bat.
SUZANNE: Mais, Monsieur, avez-vous songé...?
FIGARO : Oui, Madame; oui, j'ai songé.
SUZANNE: ...Que pour la colère et l'amour...
FIGARO : ...Tout ce qui se diffère est perdu. Votre main, Madame?
SUZANNE, de sa voix naturelle, et lui donnant un soufflet : La voilà.
FIGARO : Ah ! Demonio ! quel soufflet !
SUZANNE lui en donne un second : Quel soufflet! Et celui-ci?
FIGARO : Et qu'es aquo? de par le diable ! est-ce ici la journée des tapes ?
SUZANNE, le bat à chaque phrase: Ah! qu'es aquo? Suzanne : et voilà pour tes soupçons ; voilà pour tes vengeances et pour tes trahisons, tes expédients, tes injures et tes projets. C'est-il ça de l'amour? Dis donc comme ce matin.
FIGARO en se relevant: Santa Barbara! oui, c'est de l'amour. O bonheur! ô délices! ô cent fois heureux Figaro! Frappe, ma bien-aimée, sans te lasser. Mais quand tu m'auras diapré tout le corps de meurtrissures, regarde avec bonté, Suzon, l'homme le plus fortuné qui fut jamais battu par une femme.
SUZANNE: Le plus fortuné ! Bon fripon, vous n'en séduisiez pas moins la Comtesse, avec un si trompeur babil que, m'oubliant moi-même, en vérité, c'était pour elle que je cédais.
FIGARO : Ai-je pu me méprendre au son de ta jolie voix?
SUZANNE, en riant : Tu m'as reconnue? Ah! comme je m'en vengerai!
FIGARO : Bien rosser et garder rancune est aussi par trop féminin l Mais, dis-moi donc par quel bonheur je te vois là, quand je te croyais avec lui ; et comment cet habit, qui m'abusait, te montre enfin innocente...
SUZANNE : Eh! c'est toi qui es un innocent, de venir te prendre au piège apprêté pour un autre ! Est-ce notre faute, à nous, si voulant museler un renard, nous en attrapons deux?
FIGARO : Qui donc prend l'autre?
SUZANNE: Sa femme.
FIGARO : Sa femme?
SUZANNE: Sa femme.
FIGARO, follement : Ah ! Figaro, pends-toi ; tu n'as pas deviné celui-là ! Sa femme ? O douze ou quinze mille fois spirituelles femelles ! Ainsi les baisers de cette salle ?
SUZANNE : Ont été donnés à Madame.
FIGARO : Et celui du page?
SUZANNE, riant: A Monsieur.
FIGARO : Et tantôt, derrière le fauteuil?
SUZANNE : A personne.
FIGARO : En êtes-vous sûre?
SUZANNE, riant : Il pleut des soufflets, Figaro.
FIGARO : lui baise les mains .' Ce sont des bijoux que les tiens. Mais celui du
Comte était de bonne guerre.
SUZANNE: Allons, superbe! humilie-toi.
FIGARO fait tout ce qu'il annonce .' Cela est juste; à genoux, bien courbé,
prosterné, ventre à terre.
SUZANNE, en riant: Ah! ce pauvre Comte! quelle peine il s'est donnée...
FIGARO se relève sur ses genoux : .... Pour faire la conquête de sa femme !
En 1791 Beaumarchais révolutionnaire s'installe dans la superbe maison qu'il s'est fait construire près de la Bastille, veut servir la patrie en négociant l'achat de 6o.ooo fusils en Hollande et après mille péripéties, son affaire des fusils échoue (1792-1795). Tenu pour émigré quoiqu'il ait été chargé d'une mission à l'étranger, il se retrouve dans la misère relégué à Hambourg.
Beaumarchais connaît la misère à Hambourg. C'est la lente descente, tant au niveau des polémiques successives dans lesquelles il se lancera qu'à celui de sa veine littéraire, échec de son opéra, Tarare, échec de son drame, La Mère coupable (1792). En 1796, il peut enfin regagner Paris, vieilli, sourd, usé après cette vie mouvementée, et il meurt en 1799...

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814)
Le succès des "Études de la Nature" (1784) et de "Paul et Virginie"(1788) fut immense, tant en littérature que dans tous les domaines artistiques. L'écho le plus puissant qui fut donné à l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre émane, a-t-on dit, de l'œuvre de Chateaubriand, Paul et Virginie, comme Atala, est un roman exotique mettant en scène le thème de l'amour malheureux. Mais Bernardin de Saint-Pierre prolonge lui-même les intuitions d'un Jean-Jacques Rousseau : il a voulu, après "La Nouvelle Héloïse" qui est le roman de l'homme civilisé, donner dans "Paul et Virginie" le roman de l'homme naturel. Lui-même, dans l'avant-propos de ce livre, a défini en ces termes son intention : "J'ai désiré réunir à la beauté de la nature entre les tropiques la beauté morale d'une petite société. Je me suis proposé aussi d'y mettre en évidence plusieurs grandes vérités, entre autres celle-ci : que notre bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu." Et ce fut précisément une des raisons du succès de Paul et Virginie au XVIIIe siècle que d'avoir apporté un souffle de fraîcheur et de pureté à une société corrompue par l'abus des plaisirs et desséchée par l'excès de la vie intellectuelle. Bernardin de Saint-Pierre a encore été le continuateur de J .-J . Rousseau par ses descriptions pittoresques de la nature. Mais, tandis que Rousseau s'était contenté de dépeindre une nature toute proche et assez familière, Bernardin de Saint-Pierre a fait se dérouler son idylle de Paul et Virginie dans le cadre lointain de l`île de France. Et ainsi il a, sinon inauguré, du moins fait triompher dans notre littérature le roman exotique, qui devait prendre un très grand développement au XIXe siècle de Chateaubriand à Pierre Loti...
Natif du Havre, Bernardin de Saint-Pierre eut une existence inquiète et vagabonde, passant la plus grande partie de sa vie à voyager, en Amérique, en Hollande, en Russie, en Pologne, en Autriche, en Allemagne, à l'île de France, où il avait été envoyé en 1768 comme capitaine
ingénieur du roi. Revenu à Paris en 1771, instable et insatisfait des perspectives de carrière qui lui étaient faites, il multiplie les projets et se lie avec les philosophes, dont il ne tarde pas à se séparer, - il n'est pas fait pour les succès de salon et de coterie littéraire -, mais reste lié à Jean-Jacques Rousseau, dont il demeura le disciple. En 1773, il édite et attire l'attention de la société mondaine "Voyage à l'île de France", l'île Maurice où il consignait ses observations scientifiques aussi bien que ses méditations lyriques...

1784 - Les Etudes de la Nature, les Harmonies de la Nature...
"La puissance végétale, comme nous l'avons vu, reçoit toutes les qualités des puissances précédentes , par l’air et l’eau qu’elle s’approprie, par les couleurs et les formes de ses fleurs et de ses fruits, par des minéralisations même, dont quelques-unes sont connues, comme celles du fer, qu’on trouve dans toutes les cendres des végétaux. Elle y en ajoute un grand nombre d’autres, qu’elle doit principalement au soleil, telles que ses parfums et ses saveurs; mais elle diffère essentiellement des minéraux par les cinq facultés de la vie, qui sont l’organisation, la nutrition, l’amour, la génération et la mort. Les puissances élémentaires n’ont en partage qu’une existence permanente, différemment modifiée; mais la puissance végétale a une propre vie, dont le principal caractère est de pouvoir renaître et se propager...."
A partir de 1784, il publie les "Etudes de la nature", complétées à partir de 1796 par les "Harmonies de la Nature", avec pour objet essentiel de démontrer la perfection de la Nature, une nature organisée toute entière pour le bonheur de l'homme, souvent traitée d'une manière assez caricaturale : "les branches des arbres plient sous les fruits pour nous permettre de les cueillir plus aisément...". Les lois de la Nature se découvre par notre coeur et non par notre raison. Contre une philosophie des Lumières tendant au matérialisme et à l'athéisme, Bernardin de Saint-Pierre entend révéler la présence de Dieu partout dans la nature. D'une sensibilité que l'on a parfois qualifiée de "maladive", le fait rêver d'une cité idéale où l'on enseignera l'amour du genre humain. "Paul et Virginie", 4e partie des Etudes (1785), constituera une "application" de ces Etudes "au bonheur de deux familles malheureuses". Sous la Révolution, les gouvernements révolutionnaires, attentifs aux accents antiesclavagistes de l'œuvre, nommèrent Bernardin de Saint Pierre intendant du Jardin des Plantes (1792), puis, en l'an III, professeur de morale à l'École normale. Contre les vices de la civilisation et les dangers d'une réflexion uniquement rationnelle, son idéal resta l'innocence campagnarde et la régression idyllique dans des terres lointaines (l'île de Paul et Virginie, ou l'Inde de la Chaumière indienne en 1791), en contact immédiat avec la nature et Dieu...
Bernardin de Saint-Pierre consacra l'Étude XII à l'examen des sensations physiques et des "sentiments de l'âme", goût des spectacles et des bruits mélancoliques, volupté de la tristesse et des sensations étranges, sentiment de notre misère et de notre immortalité, mal de l'infini, plaisir de la solitude...
"La nature est si bonne qu'elle tourne à notre plaisir tous ses phénomènes...
Je prends, par exemple, du plaisir lorsqu'il pleut à verse, que je vois les vieux murs mousseux tout dégouttants d'eau, et que j'entends les murmures des vents qui se mêlent aux frémissements de la pluie. Ces bruits mélancoliques me jettent, pendant la nuit, dans un doux et profond sommeil... Je ne sais à quelle loi physique les philosophes peuvent rapporter les sensations de la mélancolie. Pour moi, je trouve que ce sont les affections de l'âme les plus voluptueuses. Cela vient, ce me semble, de ce qu'elle satisfait à la fois les deux puissances dont nous sommes formés, le corps et l'âme, le sentiment de notre misère et celui de notre excellence. Ainsi, par exemple, dans le mauvais temps, le sentiment de ma
misère humaine se tranquillise, en ce que je vois qu'il pleut, et que je suis à l'abri ; qu'il vente, et que je suis dans mon lit bien chaudement. Je jouis alors d'un bonheur négatif. Il s'y joint ensuite quelques-uns de ces attributs de la Divinité, dont les perceptions font tant de plaisir à notre âme, comme de l'infinité en étendue, par le murmure lointain des vents... Si je suis triste, et que je ne veuille pas étendre mon âme si loin, je goûte encore du plaisir à me laisser aller à la mélancolie que m'inspire le mauvais temps. Il me semble alors que la nature se conforme à ma situation, comme une tendre amie. Elle est, d'ailleurs, toujours si intéressante, sous quelque aspect qu'elle se montre, que quand il pleut, il me semble voir une belle femme qui pleure. Elle me paraît d'autant plus belle qu'elle me semble plus affligée... Il faut, pour jouir du mauvais temps, que notre âme voyage, et que notre corps se repose. C'est par l'harmonie de ces deux puissances de nous-mêmes que les plus terribles révolutions de la nature nous intéressent davantage que ses tableaux les plus riants...
PLAISIR DE LA RUINE. Le goût de la ruine est universel à tous les hommes. Nos voluptueux font construire des ruines artificielles dans leurs jardins ; les sauvages se plaisent à se reposer mélancoliquement sur le bord de la mer, surtout dans les tempêtes ;-ou dans le voisinage d'une cascade au milieu des rochers...
Lucrèce dit que ces sortes de goûts naissent du sentiment de notre sécurité, qui redouble à la vue du danger dont nous sommes à couvert. Nous aimons, dit-il, à voir des tempêtes, du rivage... Ce genre de plaisir naît du sentiment de notre misère, qui est, comme nous l'avons dit, un des instincts de notre mélancolie. Mais nous avons encore en nous un sentiment plus sublime qui nous fait aimer les ruines, indépendamment de tout effet pittoresque, et de toute idée de sécurité ; c'est celui de la Divinité, qui` se mêle toujours à nos affections mélancoliques, et qui en fait le plus grand charme... Les ruines occasionnées par le temps nous plaisent en nous jetant dans l'infini : elles nous portent à plusieurs siècles en arrière, et nous intéressent à proportion de leur antiquité... Les ruines, où la nature combat contre l'art des hommes, inspirent une douce mélancolie. Elle nous y montre la vanité de nos travaux et la perpétuité des siens... Une belle architecture donne toujours de belles ruines. Les plans de l'art s'allient alors avec la majesté de ceux de la nature. Je ne trouve rien qui ait un aspect plus imposant que les tours antiques et bien élevées que nos ancêtres bâtissaient sur le sommet des montagnes, pour découvrir de loin leurs, ennemis, et du couronnement desquelles sortent aujourd'hui de, grands arbres dont les vents agitent les cimes.
J'en ai vu d'autres dont les machicoulís et les créneaux, jadis meurtriers, étaient tout fleuris de lilas, dont les nuances d'un violet brillant et tendre formaient des oppositions charmantes avec les pierres de la tour, caverneuses et rembrunies. L'intérêt d'une ruine augmente quand il s'y joint quelque sentiment moral, par exemple quand ces tours dégradées ont été les asiles du brigandage.
PLAISIR DES TOMBEAUX. Mais il n'y a point de monuments plus intéressants que les tombeaux des hommes... La mélancolie voluptueuse qui en résulte naît, comme toutes. les sensations attrayantes, de l'harmonie de deux principes opposés, du sentiment de notre existence rapide et de celui de notre immortalité, qui se réunissent à la vue de la dernière habitation des hommes. Un tombeau est un monument placé sur les limites des deux mondes...
PLAISIR DE LA SOLITUDE. C'est encore la mélancolie qui rend la solitude si attrayante. La solitude flatte notre instinct animal, en nous offrant des abris d'autant plus tranquilles que les agitations de notre vie ont été plus grandes ; et elle étend notre instinct divin, en nous donnant des perspectives où les beautés naturelles et morales se présentent avec tous les attraits du sentiment."

1788 - "Paul et Virginie"
Cette production est le chef-d'œuvre de l'auteur, mais encore considéré comme l'un des chefs-d'œuvres de la langue française. Cette pastorale, d'une forme si neuve, fut inspirée, dit-on, à l'auteur par une anecdote recueillie à l'Île de France; mais cette anecdote n'offrait rien du charme que Bernardin a répandu dans son récit. C'est lui qui a créé les deux figures de Paul et de Virginie, qu'on n'oubliera jamais, qui a imaginé cette vie si simple et si pure, et qui, réalisant les rêves de la jeunesse, a peint le bonheur de la vertu et de l'innocence dans une pauvre famille, rejetée loin de l'Europe par l'infortune et par le préjugé.
L'innocence naturelle et dans la splendeur des paysages tropicaux, connaissent le bonheur que procurent la sensibilité et la tendresse. Mais un sentiment plus trouble s'abat soudain comme un " mal inconnu " sur Virginie. Madame de la Tour cède aux préjugés : jugeant l'amour des deux jeunes gens prématuré, et convaincue que l'argent est nécessaire au bonheur, elle envoie Virginie en France pour y parfaire son éducation et lui assurer l'héritage de sa grand-tante. Virginie s'embarque à contre-coeur, mais elle reste fidèle au souvenir de Paul et refuse un riche mariage de raison. Sa grand-tante la déshérite et la renvoie à l'île de France " dans la saison des ouragans ". L'idylle va s'achever en drame : sous les yeux de Paul, le vaisseau qui ramène Virginie, le Saint-Géran, est jeté par la tempête sur les rochers.
"... Vous autres Européens, dont l'esprit se remplit dès l'enfance de tant de préjugés contraires au bonheur, vous ne pouvez concevoir que la nature puisse donner tant de lumières et de plaisirs. Votre âme, circonscrite dans une petite sphère de connaissances humaines atteint bientôt le terme de ses jouissances artificielles : mais la nature et le coeur sont inépuisables. Paul et Virginie n'avaient ni horloges, ni almanachs, ni livres de chronologie d'histoire, et de philosophie. Les périodes de leur vie se réglaient sur celles de la nature. Ils connaissaient les heures par l'ombre des arbres ; les saisons, par les temps où ils donnent leurs fleurs ou leurs fruits; et les années, par le nombre de leurs récoltes. Ces douces images répandaient les plus grands charmes dans leurs conversations. « Il est temps de dîner disait Virginie à la famille, les ombres des bananiers sont à leurs pieds» ; ou bien : « La nuit s'approche, les tamarins ferment leurs feules. - Quand viendrez-vous nous voir ? lui disaient quelques amies du voisinage. - Aux cannes de sucre, répondait Virginie. - votre visite nous sera encore plus douce et plus agréable », reprenaient ces jeunes filles. Quand on l'interrogeait sur son âge et sur celui de Paul : « Mon frère, disait elle, est de l'âge du grand cocotier de la fontaine, et moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné douze fois leurs fruits, et les cannes vingt quatre fois leurs fleurs depuis que je suis au monde. » Leur vie semblait attachée à celle des arbres comme celle des hunes et des dryades : ils ne connaissaient d'autres époques historiques que celles de la vie de leurs mères, d'autre chronologie que celle de leurs vergers, et d'autre philosophie que de faire du bien à tout le monde, et de se résigner à la volonté de Dieu. Après tout qu'avaient besoin ces jeunes gens d'être riches et savants à notre manière ? Leurs besoins et leur ignorance ajoutaient encore à
leur félicité. Il n'y avait point de jour qu'ils ne se communiquassent quelques secours ou quelques lumières ; oui, des lumières ; et quand il s'y serait mêlé quelques erreurs, l'homme pur n'en a point de dangereuses à craindre. Ainsi croissaient ces deux enfants de la nature..."
Dans son Avant-Propos, Bernardin de Saint-Pierre explique ses intentions...
"J'ai tâché d'y peindre un sol et des végétaux différents de ceux de l'Europe... J'ai désiré réunir à la beauté de la nature, entre les tropiques, la beauté morale d'une petite société. Je me suis proposé aussi d'y mettre en évidence plusieurs grandes vérités, entre autres celle-ci, que notre bonheur consiste à vivre suivant la nature et la vertu".
On comprend le succès du roman auprès des disciples de Rousseau. Deux Françaises vivent côte à côte, dans le cadre magnifique de l'île de France (l'actuelle île Maurice), dans l'Océan Indien. Mme de la Tour, qui a une fille, Virginie, et son amie Marguerite, un fils nommé Paul. Ces deux adolescents grandissent ensemble, unis par une tendre affection. "Ainsi croissaient ces deux enfants de la nature. Aucun souci n'avait ridé leur front ; aucune intempérance n'avait corrompu leur sang ; aucune passion malheureuse n'avait dépravé leur cœur : l'amour, l'innocence, la piété développaient chaque jour la beauté de leur âme, en grâces ineffables, dans leurs traits, leurs attitudes et leurs mouvements..."
Mais, devinant que leurs enfants s'aiment sans s'en apercevoir encore, les deux mères décident de les marier lorsqu'ils en auront l'âge. Or, le gouverneur de l'île vient inviter Virginie à se rendre en France, auprès d'une tante qui veut lui donner une éducation mondaine et lui léguer sa fortune. Paul est accablé de douleur, et Virginie, la mort dans l'âme, obéit à sa mère. C'est la dernière entrevue de Paul et de Virginie :
"Cependant, l'heure du souper étant venue, on se mit à table, où chacun des convives, agité de passions différentes, mangea peu, et ne parla point. Virginie en sortit la première, et fut s'asseoir au lieu où nous sommes. Paul la suivit bientôt après, et vint se mettre auprès d'elle. L'un et l'autre gardèrent quelque temps un profond silence. Il faisait une de ces nuits délicieuses, si communes entre les tropiques, et dont le plus habile pinceau ne rendrait pas la beauté. La lune paraissait au milieu du firmament, entourée d'un rideau de nuages, que ses rayons dissipaient par degrés. Sa lumière se répandait insensiblement sur les montagnes de l'île et sur leurs pitons, qui brillaient d'un vert argenté. Les vents retenaient leurs haleines. On entendait dans les bois, au fond des vallées, au bout des rochers, de petits cris, de doux murmures d'oiseaux qui se caressaient dans leurs nids, réjouis par la clarté de la nuit et la tranquillité de l'air. Tous, jusqu'aux insectes, bruissaient sous l'herbe. Les étoiles étincelaient au ciel et se réfléchissaient au sein de la mer, qui répétait leurs images tremblantes. Virginie parcourait avec des regards distraits son vaste et sombre horizon, distingué du rivage de l'île par les feux rouges des pêcheurs. Elle aperçut à l'entrée du port une lumière et une ombre : c'était le fanal et le corps du vaisseau où elle devait s'embarquer pour l'Europe, et qui, prêt à mettre à la voile, attendait à l'ancre la fin du calme. A cette vue, elle se troubla, et détourna la tête pour que Paul ne la vît pas pleurer..."
Virginie s'engage solennellement auprès de Paul, "O mon ami, j'atteste les plaisirs de notre premier âge, tes maux, les miens, et tout ce qui doit lier à jamais deux infortunés, si je reste, de ne vivre que pour toi ; si je pars, de revenir un jour pour être à toi".
Alors qu'à Paris, dans la société corrompue du monde civilisé, Virginie aspire à retrouver la vie simple et heureuse de son île, Paul ne vit que dans la pensée de la jeune fille, et désespère de la voir revenir. Or, un soir de décembre, on apporte un message annonçant son arrivée sur le Saint-Géran. Malheureusement, en pleine nuit, le navire va se trouve pousser sur des récifs par une mer démontée. Virginie périra dans le naufrage et Paul ne survivra pas à son désespoir...
Le naufrage du Saint-Géran, l'épisode le plus dramatique de son roman, est écrit avec une saisissante vérité, la beauté et la sérénité de Virginie dans la mort serviront de modèle à Chateaubriand quand il décrira les derniers instants du sommeil d'Atala...
" Vers les neuf heures du matin on entendit du côté de la mer des bruits épouvantables, comme si des torrents d'eau, mêlés à des tonnerres, eussent roulé du haut des montagnes. Tout le monde s'écria : « voilà l'ouragan ! » et dans l'instant un tourbillon affreux de vent enleva la brume qui couvrait l'île d'Ambre et son canal. Le Saint-Géran parut alors à découvert avec son pont chargé de monde, ses vergues et ses mâts de hune amenés sur le tillac, son pavillon en berne, quatre câbles sur son avant, et un de retenue sur son amère. Il était mouillé entre l'île d'Ambre et la terre, en deçà de la ceinture de récifs qui entoure l'île de France, et qu'il avait franchie par un endroit où jamais vaisseau n'avait passé avant lui. Il présentait son avant aux flots qui venaient de la pleine mer, et à chaque lame d'eau qui s'engageait dans le canal, sa proue se soulevait tout entière, de sorte qu'on en voyait la carène en l'air ; mais dans ce mouvement sa poupe venant à plonger disparaissait à la vue jusqu'au couronnement, comme si elle eût été submergée.
Dans cette position où le vent et la mer le jetaient à terre, il lui était également impossible de s'en aller par où il était venu, ou, en coupant ses câbles, d'échouer sur le rivage, dont il était séparé par de hauts fonds semés de récifs. Chaque lame qui venait briser sur la côte s'avançait en mugissant jusqu'au fond des anses, et y jetait des galets à plus de cinquante pieds dans les terres ; puis, venant à se retirer, elle découvrait une grande partie du rivage, dont elle roulait les cailloux avec un bruit rauque et affreux. La mer soulevée par le vent, grossissait à chaque instant, et tout le canal compris entre cette île et l'île d'Ambre n'était qu'une vaste nappe d'écumes blanches, creusées de vagues noires et profondes. Ces écumes s'amassaient dans le fond des anses à plus de six pieds de hauteur et le vent, qui en balayait la surface, les portait par dessus l'escarpement du rivage à plus d'une demi-lieue dans les terres. À leurs flocons blancs et innombrables, qui étaient chassés horizontalement jusqu'au pied des montagnes, on eût dit d'une neige qui sortait de la mer L'horizon offrait tous les signes d'une longue tempête. La mer y paraissait confondue avec le ciel. Il s'en détachait sans cesse des nuages d'une forme horrible qui traversaient le zénith avec la vitesse des oiseaux, tandis que d'autres y paraissaient immobiles comme de grands rochers. On n'apercevait aucune partie azurée du firmament ; une lueur olivâtre et blafarde éclairait seule tous les objets de la terre, de la mer et des cieux.
Dans les balancements du vaisseau, ce qu'on craignait arriva. Les câbles de son avant rompirent, et comme il n'était plus retenu que par une seule aussière il fut jeté sur les rochers à une demi-encablure du rivage. Ce ne fut qu'un cri de douleur parmi nous. Paul allait s'élancer à la mer lorsque je le saisis par le bras : « Mon fils, lui dis-je, voulez-vous périr ? - Que j'aille à son secours, s'écria-t-il, ou que je meure ! » Comme le désespoir lui ôtait la raison, pour prévenir sa perte; Domingue et moi lui attachâmes à la ceinture une longue corde dont nous saisîmes l'une des extrémités. Paul alors s'avança vers le SaintGéran, tantôt nageant, tantôt marchant sur les récifs. Quelquefois, il avait l'espoir de l'aborder car la mer dans ses mouvements irréguliers, laissait le vaisseau presque à sec, de manière qu'on en eût pu faire le tour à pied ; mais bientôt après, revenant sur ses pas avec une nouvelle furie, elle le couvrait d'énormes voûtes d'eau qui soulevaient tout l'avant de sa carène, et rejetaient bien loin sur le rivage le malheureux Paul, les jambes en sang, la poitrine meurtrie, et à demi noyé.
À peine ce jeune homme avait-il repris l'usage de ses sens qu'il se relevait et retournait avec une nouvelle ardeur vers le vaisseau, que la mer cependant entrouvrait par d'horribles secousses. Tout l'équipage, désespérant alors de son salut, se précipitait en foule à la mer sur des vergues, des planches, des cages à poules, des tables, et des tonneaux. On vit alors un objet digne d'une éternelle pitié: une jeune demoiselle parut dans la galerie de la poupe du Saint-Géran, tendant les bras vers celui qui faisait tant d'efforts pour la joindre. C'était Virginie. Elle avait reconnu son amant à son intrépidité. La vue de cette aimable personne, exposée à un si terrible danger, nous remplit de douleur et de désespoir pour Virginie, d'un port noble et assuré, elle nous faisait signe de la main, comme nous disant un éternel adieu.
Tous les matelots s'étaient jetés à la mer Il n'en restait plus qu'un sur le pont, qui était tout nu et nerveux comme Hercule.
Il s'approcha de Virginie avec respect : nous le vîmes se jeter à ses genoux, et s'efforcer même de lui ôter ses habits ; mais elle, le repoussant avec dignité, détourna de lui sa vue. On entendit aussitôt ces cris redoublés des spectateurs : « Sauvez la, sauvez la ; ne la quittez pas ! » Mais dans ce moment une montagne d'eau d'une effroyable grandeur s'engouffra entre l'île d'Ambre et la côte, et s'avança en rugissant vers le vaisseau, qu'elle menaçait de ses flancs noirs et de ses sommets écumants. À cette terrible vue le matelot s'élança seul à la mer ; et Virginie, voyant la mort inévitable, posa une main sur ses habits, l'autre sur son coeur et levant en haut des yeux sereins, parut un ange qui prend son vol vers les cieux.
ô jour affreux ! hélas ! tout fut englouti. La lame jeta bien avant dans les terres une partie des spectateurs qu'un mouvement d'humanité avait portés à s'avancer vers Virginie, ainsi que le matelot qui l'avait voulu sauver à la nage. Cet homme, échappé à une mort presque certaine, s'agenouilla sur le sable, en disant : « ô mon Dieu ! Vous m'avez sauvé la vie : mais je l'aurais donnée de bon coeur pour cette digne demoiselle qui n'a jamais voulu se déshabiller comme moi. »
Domingue et moi nous retirâmes des flots le malheureux Paul sans connaissance, rendant le sang par la bouche et par les oreilles. Le gouverneur le fit mettre entre les mains des chirurgiens ; et nous cherchâmes de notre côté le long du rivage si la mer n'y apporterait point le corps de Virginie : mais le vent ayant tourné subitement, comme il arrive dans les ouragans, nous eûmes le chagrin de penser que nous ne poumons pas même rendre à cette fille infortunée les devoirs de la sépulture. Nous nous éloignâmes de ce lieu, accablés de consternation, tous l'esprit frappé d'une seule perte, dans un naufrage où un grand nombre de personnes avaient péri, la plupart doutant, d'après une fin aussi funeste d'une râle si vertueuse, qu'il existât une Providence ; car il y a des maux si terribles et si peu mérités, que l'espérance même du sage en est ébranlée.
Cependant on avait mis Paul, qui commençait à reprendre ses sens, dans une maison voisine, jusqu'à ce qu'il fût en état d'être transporté à son habitation. Pour moi, je m'en revins avec Domingue, afin de préparer la mère de Virginie et son amie à ce désastreux événement. Quand nous fûmes à l'entrée du vallon de la rivière des Lataniers, des Noirs nous dirent que la mer jetait beaucoup de débris du vaisseau dans la baie vis à vis. Nous y descendîmes ; et un des premiers objets que j'aperçus sur le rivage fut le corps de Virginie. Elle était à moitié couverte de sable, dans l'attitude où nous l'avions vue périr.
Ses traits n'étaient point sensiblement altérés. Ses yeux étaient fermés ; mais la sérénité était encore sur son front : seulement les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec les roses de la pudeur. Une de ses mains était sur ses habits, et l'autre, qu'elle
appuyait sur son coeur, était fortement fermée et roidie. J'en dégageai avec peine une petite boîte : mais quelle fut ma surprise lorsque je vis que c'était le portrait de Paul, qu'elle lui avait promis de ne jamais abandonner tant qu'elle vivrait ! À cette dernière marque de la
constance et de l'amour de cette fille infortunée je pleurai amèrement.
Pour Domingue, il se frappait la poitrine, et perçait l'air de ses cris douloureux. Nous portâmes le corps de Virginie dans une cabane de pêcheurs, où nous le donnâmes à garder à de pauvres femmes malabares, qui prirent soin de le laver. Pendant qu'elles s'occupaient de ce triste office nous montâmes en tremblant à l'habitation. Nous y trouvâmes Mme de la Tour et Marguerite en prières en attendant des nouvelles du vaisseau. Dès que Mme de la Tour m'aperçut elle s'écria : « Où est ma fille, ma chère fille, mon enfant ? » Ne pouvant douter de son malheur à mon silence et à mes larmes, elle fut saisie tout à coup d'étouffements et d'angoisses douloureuses ; sa voix ne faisait plus entendre que des soupirs et des sanglots.
Pour Marguerite, elle s'écria : « Où est mon fils ? Je ne vois point mon fils » ; et elle s'évanouit. Nous courûmes à elle ; et l'ayant fait revenir, je l'assurai que Paul était vivant, et que le gouverneur en faisait prendre soin. Elle ne reprit ses sens que pour s'occuper de son amie qui tombait de temps en temps dans de longs évanouissements. Mme de la Tour passa toute la nuit dans ces cruelles souffrances, et par leurs longues périodes j'ai jugé qu'aucune douleur n'était égale à la douleur maternelle. Quand elle recouvrait la connaissance elle tournait des regards fixes et mornes vers le ciel. En vain son amie et moi nous lui pressions les mains dans les nôtres, en vain nous l'appelions par les noms les plus tendres ; elle paraissait insensible à ces témoignages de notre ancienne affection, et il ne sortait de sa poitrine oppressée que de sourds gémissements..."

Sébastien-Roch-Nicolas, dit Chamfort (1741-1794)
Né en Auvergne, dans un village voisin de Clermont, orphelin qui se fit très tôt remarqué tant par son intelligence que par son impertinence, la médiocrité de ses premières oeuvres ne le fait pas renoncer à sa fascination pour la vie littéraire, il sait évoluer dans un monde où il faut briller pour s'imposer. De 1769 à 1770, son Éloge de Molière fut couronné par l'Académie française. Son seul grand "succès" littéraire fut sa tragédie de "Mustapha et Zéangir" (1770-1771) qu'il dédia à la jeune reine Marie-Antoinette et qui fut jouée au théâtre de la cour de Fontainebleau, puis à la Comédie-Française. En octobre 1774, il avait trente-cinq ans, et il arrivait aux faveurs de la cour et aux succès de salon sous le patronage de femmes influentes, comme la duchesse de Grammont , sœur du duc de Choiseul, la comtesse de Choiseul , les marquises d'Amblimont et de Koncée. Son Eloge de La Fontaine est couronné cette même année.
Ici s'ouvre la seconde phase de la vie de Chamfort, de 1775 à 1781 tout devait lui réussir. Il reçut pension, devint secrétaire du prince de Condé, puis de Madame Elisabeth, sœur du roi Louis XVI, pour être admis en 1781 à l'Académie Française. Par la suite, il se retira d’abord à Auteuil, auprès de Mme Helvétius, qui avait été sa bienfaitrice, puis alla s’établir avec elle à Etampes, unis par un étroit "rapport d’idées, de sentiment et de position".
Mais c'est un révolté, nourri de Rousseau, qui n'aime guère une aristocratie dominant une France où s'emploient à survivre "sept millions d'hommes qui demandent l'aumône, et douze millions hors d'état de la leur faire". Une haine de la bêtise, des grands, du «monde» ou de l'injustice sociale qui transparaît dans ses "Pensées, Maximes et Anecdotes", son grand ouvrage qu'il élaborait en secret et qui fut publié qu'après sa mort en 1795. Une oeuvre de moraliste traitant de la nature humaine sous un Ancien Régime finissant. Contre la haute société, il avait donné "Le Marchand de Smyrne", avait accueilli avec enthousiasme la Révolution, alors que pensionné par l'Ancien Régime, collaboré avec Mirabeau (Chamfort écrivit pour Mirabeau les Considérations sur l'ordre de Cincinnatus, et un fameux discours contre les académies que le grand tribun n'eut pas le temps de prononcer), combattu les Jacobins et composé ses "Tableaux de la Révolution". Attaché à l'esprit de la Révolution, il restait acerbe et libre de parole, jusqu'à mordre les grands chefs de la Terreur: il est arrêté, et meurt à 53 ans, en 1794, d'un suicide raté négligemment soigné par un médecin.
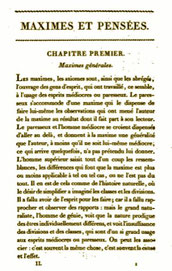
1780 - "Pensées, Maximes et Anecdotes"
Fragments posthumes - on en comptera plus de deux mille écrits entre 1779 et 1780 - publiés sous le titre de "Produits de la civilisation perfectionnée". Un extrait avait été édité en 1794 dans le journal La Décade philosophique.
"Ma vie entière est un tissu de contrastes apparens avec mes principes. Je n'aime point les princes, et je suis attaché à une princesse et à un prince. On me connoît des maximes républicaines, et plusieurs de mes amis sont revêtus de décorations monarchiques. J'aime la pauvreté volontaire, et je vis avec des gens riches. Je fuis les honneurs, et quelques-uns sont venus à moi. Les lettres sont presque ma seule consolation, et je ne vois point de beaux esprits et ne vais point à l'Académie. Ajoutez que je crois les illusions nécessaires à l'homme, et je vis sans illusions; que je crois les passions plus utiles que la raison, et je ne sais plus ce que c'est que les passions, etc.
Ce que j'ai appris, je ne le sais plus. Le peu que je sais encore, je l'ai deviné.
Un des grands malheurs de l'homme, c'est que ses bonnes qualités même lui sont quelquefois inutiles, et que l'art de s'en servir et de les bien gouverner n'est souvent qu'un fruit tardif de l'expérience.
L'indécision, l'anxiété, sont à l'esprit et à l'âme ce que la question est au corps.
Quand j'étois jeune, ayant les besoins des passions, et attiré par elles dans le monde, forcé de chercher dans la société et dans les plaisirs quelques distractions à des peines cruelles, on me préchoit l'amour de la retraite, du travail, et on m'assommoit de sermons pédantesques sur ce sujet. Arrivé à quarante ans, ayant perdu les passions qui rendent la société supportable, n'en voyant plus que la misère et la futilité, n'ayant plus besoin du monde pour échapper à des peines qui n'existoient plus, le goût de la retraite et du travail est devenu très-vif chez moi et a remplacé tout le reste ; j'ai cessé d'aller dans le monde : alors on n'a cessé de me tourmenter pour que j'y revinsse; j'ai été accusé d*être misanthrope, etc. Que conclure de cette bizarre différence? Le besoin que les hommes ont de tout blâmer.
La célébrité est le châtiment du mérite et la punition du talent. Le mien, quel qu'il soit, ne me paroît qu'un délateur, né pour troubler mon repos.
J'éprouve en le détruisant la joie de triompher d'un ennemi. Ce sentiment a triomphé chez moi de l'amour-propre même, et la vanité littéraire a péri dans la destruction de l'intérêt que je prenois aux hommes.
En renonçant au monde et à la fortune, j'ai trouvé le bonheur, le calme, la santé, même la richesse; et, en dépit du proverbe, je m'aperçois que qui quitte la partie la gagne.
Je suis honteux de l'opinion que vous avez de moi; je n'ai pas toujours été aussi Céladon que vous me voyez. Si je vous contois trois ou quatre traits de ma jeunesse, vous verriez que cela n'est pas trop honnête et que cela appartient à la meilleure compagnie.
L'espérance n'est qu'un charlatan qui nous trompe sans cesse, et, pour moi, le bonheur n'a commencé que lorsque je l'ai eu perdue. Je mettrois volontiers sur la porte du paradis le vers que Dante a mis sur celle de l'enfer : lasciate ogni speranza voi ch' entrale.
Je n'étudie que ce qui me plaît; je n'occupe mon esprit que des idées qui m'intéressent. Elles seront utiles ou inutiles, soit à moi, soit aux autres; le temps amènera ou n'amènera pas les circonstances qui me feront faire de mes acquisitions un emploi profitable. Dans tous les cas, j'aurai eu l'avantage inestimable de ne me pas contrarier et d'avoir obéi à ma pensée et à mon caractère.
J'ai détruit mes passions, à peu près comme un homme violent tue son cheval, ne pouvant le gouverner.
Les premiers sujets de chagrin m'ont servi de cuirasse contre les autres.
J'ai à me plaindre des choses très-certainement, et peut-être des hommes; mais je me tais sur ceux-ci, je ne me plains que des choses, et, si j'évite les hommes, c'est pour ne pas vivre avec ceux qui me font porter le poids des choses.
La fortune, pour arriver à moi, passera par les conditions que lui impose mon caractère.
Otez l'amour-propre de l'amour, il en reste trop peu de chose. Une fois purgé de vanité, c'est un convalescent affoibli qui peut à peine se traîner.
L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes.
Une femme d'esprit m'a dit un jour un mot qui pourroit bien être le secret de son sexe : c'est que toute femme, en prenant un amant, tient plus de compte de la manière dont les autres femmes voient cet homme que de la manière dont elle le voit elle-même.
Les conversations ressemblent aux voyages qu'on fait sur l'eau : on s'écarte de la terre sans presque le sentir, et l'on ne s'aperçoit qu'on a quitté le bord que quand on est déjà bien loin.
Il y auroit une manière plaisante de prouver qu'en France les philosophes sont les plus mauvais citoyens du monde. La preuve, la voici : c'est qu'ils ont imprimé une grande quantité de vérités importantes dans l'ordre politique et économique, et ont donné plusieurs conseils utiles consignés dans leurs livres. Ces conseils ont été suivis par presque tous les souverains de l'Europe, presque partout, hors en France : d'où il suit que, la prospérité des étrangers augmentant leur puissance, tandis que la France reste aux mêmes termes, con- serve ses abus, etc., elle finira par être dans l'état d'infériorité relativement aux autres puissances; et c'est évidemment la faute des philosophes. On sait, à ce sujet, la réponse du duc de Toscane à un François à propos des heureuses innovations faites par lui dans ses États : «Vous me louez trop à cet égard, disoit-il; j'ai pris toutes mes idées dans vos livres françois. »
La Société, le Monde.
Le genre humain, mauvais de sa nature, est devenu plus mauvais par la société. Chaque homme y porte les défauts 1e, de l'humanité, 2e, de l'individu, 3e, de la classe dont il fait partie dans l'ordre social. Ces défauts s'accroissent avec le temps, et chaque homme, en avançant en âge, blessé de tous ces travers d'autrui et malheureux par les siens mêmes, prend pour l'humanité un profond mépris qui ne peut tourner que contre l'une et l'autre.
La société n'est pas, comme on le croit d'ordinaire, le développement de la nature, mais bien sa décomposition et sa refonte entière : c'est un second édifice bâti avec les décombres du premier. On en retrouve les débris avec un plaisir mêlé de surprise : c'est celui qu'occasionne l'expression naïve d'un sentiment naturel qui échappe dans la société; il arrive même qu'il plaît davantage si la personne à laquelle il échappe est d'un rang plus élevé, c'est-à-dire plus loin de la nature. Il charme dans un roi , parce qu'un roi est dans l'extrémité opposée. C'est un débris d'ancienne architecture dorique ou corinthienne dans un édifice grossier et moderne
La société, ce qu'on appelle le monde, n'est que la lutte de mille petits intérêts opposés, une lutte éternelle de toutes les vanités qui se croisent, se choquent tour à tour, blessées, humiliées l'une par l'autre, qui expient le lendemain, dans le dégoût d'une défaite, le triomphe de la veille. Vivre soli- taire, ne point être froissé dans ce choc misérable où l'on attire un instant les yeux pour être écrasé l'instant d'après, c'est ce qu'on appelle n'être rien, n'avoir pas d'existence. Pauvre humanité !
Jamais le monde n'est connu par les livres. On l'a dit autrefois, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est la raison; la voici : c'est que cette connoissance est un résultat de mille observations fines dont l'amour- propre n'ose faire confidence à personne , pas même au meilleur ami. On craint de se montrer comme un homme occupé de petites choses, quoique ces petites choses soient très-importantes au succès des plus grandes affaires.
La plupart des hommes qui vivent dans le monde y vivent si étourdiment, pensent si peu, qu'ils ne connoissent pas ce monde qu'ils ont toujours sous les yeux.
Les fléaux physiques et les calamités de la na- ture humaine ont rendu la société nécessaire. La société a ajouté aux malheurs de la nature; les inconvéniens de la société ont amené la nécessité du gouvernement, et le gouvernement ajoute aux malheurs de la société. Voilà l'histoire de la nature humaine.
L'Anglois respecte la loi et repousse ou méprise l'autorité; le François, au contraire, respecte l'autorité et méprise la loi. Il faut lui enseigner à faire le contraire, et peut-être la chose est-elle impossible, vu l'ignorance dans laquelle on tient la nation, ignorance qu'il ne faut pas contester en jugeant d'après les lumières répandues dans les capitales.
« Moi, tout ; le reste, rien. » Voilà le despotisme, l'aristocratie et leurs partisans. « Moi, c'est un autre; un autre, c'est moi. » Voilà le régime populaire et ses partisans. Après cela, décidez.
Tout ce qui sort de la classe du peuple s'arme contre lui pour l'opprimer, depuis le milicien , le négociant devenu secrétaire du roi, le prédicateur sorti d'un village pour prêcher la soumission au pouvoir arbitraire, l'historiographe fils d'un bourgeois, etc. Ce sont les soldats de Cadmus : les premiers armés se tournent contre leurs frères et se précipitent sur eux...."

1767 - Discours - "Combien le génie des grands Écrivains influe sur l'esprit de leur siècle"
"Deux forces souveraines commandent à l'espèce humaine , et règlent partout les destinées : le pouvoir et le génie. Assis sur un trône, tenant d'une main le livre des lois, et de l'autre le glaive de la force, le pouvoir préside aux grandes révolutions; il subjugue les hommes par les hommes; il maîtrise par les forces qui lui sont confiées les forces qui lui résistent. Il dispose de la forme extérieure des sociétés qu'il varie à son gré. Les passions vulgaires environnent son trône et sont à ses ordres. Maître des biens et des personnes, il contient l'homme par ses besoins et par ses désirs; il l'enchaîne encore par l'horreur de sa destruction et par l'amour de sa tranquillité. Mais sa force n'a point de mesure fixe et constante: elle est asservie à mille hasards, à mille circonstances étrangères, qui peuvent ou la rendre immense ou la faire évanouir; après avoir surmonté les plus grands obstacles., elle se trouve quelquefois arrêtée parles plus petits : elle peut échouer contre une opinion, un préjugé, une mode. Le pouvoir peut employer tous les instrumens, tous les moyens actuellement existans; mais il n'en invente point de nouveaux et ne peut préparer l'avenir. Il rend au siècle suivant l'espèce humaine telle qu'il Ta reçue du siècle précédent, sans l'avoir perfectionnée. II est plus puissant pour l'avilir ou pour la détruire : encore commande-t-il en vain à qui ne veut plus obéir. Homme furieux, arrêtez ; ses droits sont sacrés! Mais que deviennent - ils dans le fait, au temps de ces révolutions fatales où les peuples, las de tyrannie et d'oppressions, reprennent dans ses mains leur force et leur volonté, tranchent leurs liens avec le fer, et redeviennent barbares, croyant se rendre libres?
L'action du génie est plus lente , mais plus forte et plus sûre; le mouvement qu'il a une fois imprimé ne meurt point avec lui ; il tend vers l'avenir et s'accélère par l'espace même qu'il parcourt; il subjugue l'homme pour l'ennoblir ; il dompte sa volonté par sa raison, par les plus nobles de ses passions et de ses facultés ; comme Dieu, il jouit de l'étonnant privilège de régner sur elle sans gêner sa force et sans lui ôter le sentiment précieux de sa liberté.
Comme son action n'a point de bornes dans sa durée, elle n'en a point dans la sphère de son étendue. Elément invisible, subtil , dont nul obstacle ne peut intercepter l'effet , il pénètre de l'homme à l'homme comme l'aimant pénètre les corps : il parcourt extérieurement toute l'espèce humaine, et change sans violence la direction des volontés. La cause de ce changement est souvent ignorée du pilote qui conduit le vaisseau ; mais elle est aperçue du philosophe qui l'observe.
Et comment les esprits pourroient-ils résister à l'influence du génie ? Nos sentimens , nos goûts , nos passions, nos vertus, nos vices mêmes lui offrent autant de chaînes par lesquelles il nous saisit et nous entraine à sa volonté. Ce penchant naturel et invisible pour tout ce qui est grand, extraordinaire et nouveau, nous appelle vers lui : l'ascendant nécessaire de l'esprit vaste sur l'esprit borné, de l'âme forte sur l'âme foible, tout nous entraine sous ses lois.
Cette souveraineté que l'homme de génie exerce sur la foule des hommes, n'est donc pas de notre institution : c'est une loi de la nature aussi ancienne que la loi du plus fort, souvent plus puissante et toujours plus respectable. En vain l'amour-propre se révolte contre une supériorité qui l'humilie! nous naissons les sujets du grand homme : c'est dans nos cœurs qu'il prend les titres de sa puissance.
Il ne manquoit plus au génie qu'un art ingénieux qui pût conserver et transmettre à tous les âges ce dépôt de son autorité, réfléchir dans le même instant les rayons de sa lumière devant toutes les âmes qui existent avec lui, et marquer d'une couleur durable la trace immense de son vol vers la vérité; cet art est né, et l'empire du génie sur les esprits est éternel.
Quand on jette sur l'univers un coup d'oeil superficiel, on n'aperçoit d'abord que les conquérants , les rois et les ministres du pouvoir : mais, si on laisse à la raison éblouie le temps de distinguer les objets ; si l'on remonte, à travers le mouvement de l'espèce humaine, jusqu'aux ressorts qui en sont le principe, bientôt l'on conçoit que chaque siècle emprunte sa force et son caractère d'un petit nombre d'hommes qu'on peut appeler les maîtres du genre humain , et qui n'ont que le génie et la pensée pour le gouverner...."
1788 - Lettre à Vaudreuil, du 13 décembre, à un aristocrate, futur émigré, protecteur de Chamfort, son seul ami ou presque...
"Je vois que vous vous souvenez de la Requête des filles sur le renvoi des évêques , et que vous voudriez donner un frère ou une sœur à cette bagatelle dont vous êtes le parrain ; mais je vous assure qu'il me seroit impossible de faire un ouvrage faisant sur un sujet aussi sérieux que celui dont il s'agit. Ce n'est pas le moment de prendre les crayons de Swift ou de Rabelais, lorsque nous touchons peut-être à des désastres et je pense qu'un écrivain qui jetteroit du ridicule sur tous les partis , seroit lapidé à frais communs. Je ne pourrois donc faire qu'un ouvrage sérieux , et de quoi serviroit-il ? S'il n'y en a pas encore qui présente sous tous les points de vue cette intéressante question , il en existe un grand nombre qui , par leur réunion , l'éclaircissent suffisamment. En effet, de quoi s'agit-il ? d'un procès entre vingt-quatre millions d'hommes et sept cent mille privilégiés.
J'entends dire que la haute noblesse forme des ligues , pousse des cris , etc. : c'est ici , je crois , qu'on peut accuser la maladresse de la plupart des écrivains qui ont manié cette question. Que n'ont-ils dit aux grands privilégiés : Vous croyez qu'on vous attaque personnellement, qu'on veut vous attaquer. Point du tout : une grande nation peut élever et voir au-dessus d'elle quelques familles distinguées , trois cents, quatre cents , plus ou moins ; elle peut rendre cet hommage à d'antiques services , à d'anciens noms, à des souvenirs ; mais , en conscience , peut-elle porter sept cent mille anobli qui, quant à l'impôt, quant à l'argent, sont aux mêmes droits que les Montmorenci et les plus anciens chevaliers français? Plaignez -vous de la fatalité qui fait marcher à votre suite cette épouvantable cohue ; mais ne brûlez pas la maison qui ne peut la loger ; ne sommes-nous pas accablés , anéantis sous cette même fatalité qui enfin a mis en péril ce que vous appelez vos droits et vos privilèges ? Ne voyez-vous pas qu'il faut nécessairement qu'un ordre de choses aussi monstrueux soit changé , ou que nous périssions tous également, clergé, noblesse, tiers-état? Je suis vraiment affligé qu'on n'ait point dit et répété partout cette observation. Elle eût ramené les esprits prévenus, elle eut désarmé l'amour- propre , elle eût intéressé l'orgueil aux succès de la raison , et peut-être eût-elle sauvé aux notables l'opprobre ineffaçable dont ils viennent de se couvrir à pure perte. Un autre avantage de cette réflexion, c'est qu'elle eût sur le-champ fait apprécier le moyen terme que quelques-uns proposent ridiculement , celui d'appeler, pour le seul consentement à l'impôt, le tiers-état, à l'égalité numérique, en ne l'admettant que pour un tiers seulement à délibérer sur les objets de législation générale? Qui est-ce qui me fait cette proposition ? est-ce un membre de l'ancienne chevalerie ? est-ce un secrétaire du roi , du grand collège , du petit collège , car tous ont le droit de parler ainsi?
Je réponds à ce dernier... Mais non , je ne réponds pas, vous sentez que j'aurois trop d'avantage. Permettre à un peuple de défendre son argent , et lui ravir le droit d'influer sur les lois qui doivent décider de son honneur et de sa vie , c'est une insulte , c'est une dérision. Non, cela ne sera point , cela ne sauroit être; la nation ne le souffrira pas, et , si elle le souffre, elle mérite tous les maux dont elle est menacée.
Mais on parle des dangers attachés à la trop grande, influence du tiers-état; on va même jusqu'à prononcer le mot de démocratie. La démocratie ! dans un pays où le peuple ne possède pas là plus petite portion du pouvoir exécutif! dans un pays où le plus mince suppôt de l'autorité ne trouve partout qu'obéissance et même trop souvent direction, où la puissance royale ne vient que de rencontrer des obstacles de la part des corps (dont presque tous les membres sont nobles ou anoblis) , où le luxe le plus effréné et la plus monstrueuse inégalité des richesses laisseront toujours d'homme à homme un trop grand intervalle ! Quel pays plus libre que l'Angleterre ? et en est-il un où la supériorité du rang soit plus marquée , plus respectée , quoique l'inférieur n'y soit pas écrasé impunément ? Que de faux prétextes, que d'ignorance , ou plutôt que de mauvaise foi ! Pourquoi ne pas dire nettement, comme quelques-uns ; Je ne veux pas payer ? Je vous conjure de ne pas juger des autres par vous-même. Je sais que , si vous aviez cinq ou six cent mille livres de rente en fonds de terre , vous seriez le premier à vous taxer fidèlement et rigoureusement ; mais vous vous rappelez l'offre généreuse faite par le clergé , pendant la première assemblée des notables , et l'indigne réclamation qu'il a faite ensuite en faveur de ses immunités. Vous voyez |e parlement feindre d'abandonner les siennes , et l'instant d'après se ménager les moyens de les conserver et même d'accroître son existence. Enfin , vous savez ce qui vient de se passer , et ce qui a' si bien mis en évidence le projet formel de maintenir les privilèges pécuniaires...."

Louis Sébastien Mercier (1740-1814)
"Assez d'autres ont peint avec complaisance les siècles passés, je me suis occupé de la génération actuelle et de la physionomie de mon siècle, parce qu'il est bien plus intéressant pour moi que l'histoire incertaine des Phéniciens et des Egyptiens. Ce qui m'environne a des droits particuliers à mon attention. Je dois vivre au milieu de mes semblables plutôt que de me promener dans Sparte, dans Rome et dans Athènes..." - Louis Sébastien Mercier, dramaturge, journaliste et romancier est né à Paris, en 1740. Il écrivait pour vivre et chercher sa voie dans tous les genres possibles. Après ses études, il enseigne à Bordeaux et compose ses premiers poèmes, les Héroïdes, des pièces de théâtre, L'Habitant de la Guadeloupe, L'Indigent, La Brouette du vinaigrier, Le Déserteur. En 1765, il est de retour à Paris et se décide à vivre de sa plume. En 1770, il publie "l'An 2240, rêve s'il en fut jamais", roman d'anticipation politique dans lequel Mercier s' amuse à sauter de cinq siècles en avant, décrivait une France nouvelle avec des institutions, des modes et des usages basés sur les réformes qu'il estimait indispensables de son temps. Le public ne comprit pas, semble-t-il, ce qu'il voulait lui dire, mais on l'encouragea. Il participera à la Révolution, la Convention le reçut comme député de Seine-et-Oise, mais n'osa suivre ses confrères dans leurs accusations lors du procès du roi. Ajouté son attitude d'être toujours opposé à la faveur de moment, il échappera de peu à la guillotine, en 1793. Il fut tout de même nommé membre de l'Institut et, en 1795, professeur d'histoire à l'Ecole Centrale, inaugurée par la Convention. Durant l'Empire il reste un fervent républicain. Tombé dans l'oubli, il meurt à Paris, en 1814.
Plus journaliste qu'écrivain, influencé par les idées des encyclopédistes et de Rousseau, attaché à la cause du peuple, on le fit précurseur du romantisme par son goût pour le symbolisme et pour l'histoire, par sa mélancolie, et par son amour des ruines. Et précurseur de Balzac par son réalisme psychologique et par ses descriptions sociales, dans son étonnant "Tableau de Paris", ouvrage de douze volumes publiés de 1781 à 1788 et qui le firent passer à la postérité. Mais il avait quelque défaut, dont celui d'être assez rétrograde et de contester les écrivains de renom : l'âne (Mercier) chargé de balais, pelles, plumeaux, soufflets (articles de Paris), poussant devant lui La Brouette du Vinaigrier et donnant des ruades à la Religion et aux Classiques fit la joie de quelques caricaturistes (La Harpe). En 1799-1800, il donnait le "Nouveau Paris".

1781-1788 - "Tableau de Paris"
Les deux premiers volumes qu'écrivit Sébastien Mercier parurent anonymement en 1781, révélant que, s'il y avait à prédire pour l'avenir ("l'An 2240, rêve s'il en fut jamais), il ne manquait pas de quoi censurer dans le présent. Le succès de cet ouvrage fut immense et, le nom de son auteur étant une énigme, chacun se faisait une tâche de le découvrir. Le gouvernement, d'ailleurs mis en cause, tâchait d'arriver à ce résultat. Impressions personnelles, anecdotes, croquis de moeurs, considérations politiques et sociales, aucune méthode, aucun ordre, un fatras indigeste pour certains, mais un témoignage pris sur le vif, au coin des rues : "Je vais parler de Paris, non de ses édifices, de ses temples, de ses monuments, de ses curiosités, etc. assez d'autres ont écrit là-dessus. Je parlerai des mœurs publiques et particulières, des idées régnantes, de la situation actuelle des esprits, de tout ce qui m'a frappé dans cet amas bizarre de coutumes folles ou raisonnables, mais toujours changeantes. Je parlerai encore de sa grandeur illimitée, de ses richesses monstrueuses, de son luxe scandaleux. Il pompe, il aspire l'argent et les hommes ; il absorbe et dévore les autres villes, quœrens quem devore..."
Se sentant menacé par les autorités, Mercier préféra se réfugier en Suisse et y continuer l'écriture de ses ouvrages. Les dix volumes qui suivirent, édités à Amsterdam de 1782 à 1789, obtinrent une vogue presque universelle. On les traduisit en quatre langues, si bien que Mercier put dire que pas un européen n'avait d'excuse pour ne pas le lire....
« Un homme à Paris, qui sait réfléchir, n' a pas besoin de sortir de l' enceinte de ses murs pour connoître les hommes des autres climats; il peut parvenir à la connoissance entiere du genre humain, en étudiant les individus qui fourmillent dans cette immense capitale. On y trouve des asiatiques couchés toute la journée sur des piles de carreaux, et des lapons qui végetent dans des cases étroites; des japonnois qui se font ouvrir le ventre à la moindre dispute; des esquimaux qui ignorent le tems où ils vivent; des negres qui ne sont pas noirs, et des quakers qui portent l' épée. On y rencontre les moeurs, les usages et le caractere des peuples les plus éloignés; le chymiste adorateur du feu; le curieux idolâtre, acheteur de statues; l' arabe vagabond, battant chaque jour les remparts, tandis que le hottentot et l' indien oisifs sont dans les boutiques, dans les rues, dans les cafés. Ici demeure un charitable persan qui donne des remedes aux pauvres; et sur le même pallier, un usurier antropophage. Enfin, les brachmanes, les faquirs dans leur exercice pénible et journalier n' y sont pas rares, ainsi que les groënlandois qui n' ont ni temples ni autels. Ce qu' on rapporte de l' antique et voluptueuse Babylone, se réalise tous les soirs dans un temple dédié à l' harmonie.
On a dit qu' il fallait respirer l' air de Paris, pour perfectionner un talent quelconque. Ceux qui n' ont point visité la capitale, en effet, ont rarement excellé dans leur art. L' air de Paris, si je ne me trompe, doit être un air particulier. Que de substances se fondent dans un si petit espace! Paris peut être considéré comme un large creuset, où les viandes, les fruits, les huiles, les vins, le poivre, la cannelle, le sucre, le café, les productions les plus lointaines viennent se mêlanger; et les estomacs sont les fourneaux qui décomposent ces ingrédiens. La partie la plus subtile doit s' exhaler et s' incorporer à l' air qu' on respire: que de fumée! Que de flammes! Quel torrent de vapeurs et d' exhalaisons! Comme le sol doit être profondément imbibé de tous les sels que la nature avait distribués dans les quatre parties du monde! Et comment de tous ces sucs rassemblés et concentrés dans les liqueurs qui coulent à grands flots dans toutes les maisons, qui remplissent des rues entieres (comme la rue des lombards), ne résulterait-il pas dans l' athmosphere des parties atténuées qui pinceroient la fibre là plutôt qu' ailleurs? Et de là naissent peut-être ce sentiment vif et léger qui distingue le parisien, cette étourderie, cette fleur d' esprit qui lui est particuliere. Ou si ce ne sont pas ces particules animées qui donnent à son cerveau ces vibrations qui enfantent la pensée, les yeux, perpétuellement frappés de ce nombre infini d' arts, de métiers, de travaux, d' occupations diverses, peuvent-ils s' empêcher de s' ouvrir de bonne heure, et de contempler dans un âge où ailleurs on ne contemple rien? Tous les sens sont interrogés à chaque instant; on brise, on lime, on polit, on façonne; les métaux sont tourmentés et prennent toutes sortes de formes. Le marteau infatigable, le creuset toujours embrasé, la lime mordante toujours en action, applatissent, fondent, déchirent les matieres, les combinent, les mêlent. L' esprit peut-il demeurer immobile et froid, tandis que, passant devant chaque boutique, il est stimulé, éveillé de sa léthargie par le cri de l' art qui modifie la nature? Partout la science vous appelle et vous dit, voyez. Le feu, l' eau, l' air travaillent dans les atteliers des forgerons, des tanneurs, des boulangers; le charbon, le soufre, le salpêtre font changer aux objets et de noms et de formes; et toutes ces diverses élaborations; ouvrages momentanés de l' intelligence humaine, font raisonner les têtes les plus stupides.
Trop impatient pour vous livrer à la pratique, voulez-vous voir la théorie? Les professeurs dans toutes les sciences sont montés dans les chaires et vous attendent; depuis celui qui disseque le corps humain à l' académie de chirurgie, jusqu' à celui qui analyse au college royal un vers de Virgile. Aimez-vous la morale? Les théatres offrent toutes les scenes de la vie humaine: êtes-vous disposé à saisir les miracles de l' harmonie? Au défaut de l' opéra, les cloches dans les airs éveillent les oreilles musicales: êtes-vous peintre? La livrée bigarrée du peuple, et la diversité des physionomies, et les modeles les plus rares, toujours subsistans, invitent vos pinceaux: êtes-vous frivoliste?
Admirez la main légère de cette marchande de modes, qui décore sérieusement une poupée, laquelle doit porter les modes du jour au fond du nord et jusques dans l' Amérique septentrionale: aimez-vous à spéculer sur le commerce? Voici un lapidaire qui vend dans une matinée pour cinquante mille écus de diamans, tandis que l' épicier son voisin vend pour cent écus par jour, en différens détails qui ne passent pas souvent trois à quatre sols; ils sont tous deux marchands, et leur degré d' utilité est bien différent. Non, il est impossible à quiconque a des yeux, de ne point réfléchir, malgré qu' il en ait. Le baptême qui coupe l' enterrement; le même prêtre qui vient d' exhorter un moribond, et qu' on appelle pour marier deux jeunes époux, tandis que le notaire a parlé de mort le jour même de leur tendre union; la prévoyance des loix pour deux coeurs amoureux qui ne prévoient rien; la subsistance des enfans assurée avant qu' ils soient nés; et la joie folâtre de l' assemblée au milieu des objets les plus sérieux; tout a droit d' intéresser l' observateur attentif.
Un carrosse vous arrête, sous peine d' être moulu sur le pavé; voici qu' un pauvre couvert de haillons tend la main à un équipage doré, où est enfoncé un homme épais qui, retranché derriere ses glaces, paroît aveugle et sourd; une apoplexie le menace, et dans dix jours il sera porté en terre, laissant deux ou trois millions à d' avides héritiers qui riront de son trépas, tandis qu' il refusoit de légers secours à l' infortuné qui l' imploroit d' une voix touchante.
Que de tableaux éloquens qui frappent l' oeil dans tous les coins des carrefours, et quelle galerie d' images, pleine de contrastes frappans pour qui sait voir et entendre! La prodigieuse conformation de huit cents mille hommes entassés et vivant sur le même point, parmi lesquels il y a deux cents mille gourmands ou gaspilleurs, conduit au premier raisonnement politique. Le duc ne paie pas le pain plus cher que le porte-faix qui en mange trois fois plus. Comment n' être pas étonné de cet ordre incroyable qui regne dans une si grande confusion de choses? Il laisse appercevoir ce que peuvent de sages loix, combien elles ont été lentes à se former, quelle machine compliquée et simple est cette police vigilante; et l' on découvre du même coup-d' oeil les moyens de la perfectionner sans gêner cette liberté honnête et précieuse, l' attribut le plus cher à tout citoyen. »
LE FAUBOURG SAINT-MARCEL
"C'est le quartier où habite la populace de Paris, la plus pauvre, la plus remuante et la plus indisciplinable. Il y a plus d'argent dans une seule maison du faubourg Saint- Honoré, que dans tout le faubourg Saint- Marcel, ou Saint-Marceau, pris collectivement.
C'est dans ces habitations éloignées du mouvement central de la ville, que se cachent les hommes ruinés, les misanthropes, les alchimistes, les maniaques, les rentiers bornés, et aussi quelques sages studieux, qui cherchent réellement la solitude, et qui veulent vivre absolument ignorés et séparés des quartiers bruyants des spectacles. Jamais personne n'ira les chercher à cette extrémité de la ville : si l'on fait un voyage dans ce pays-là, c'est par curiosité ; rien ne vous y appelle ; il n'y a pas un seul monument à y voir ; c'est un peuple qui n'a aucun rapport avec les Pari- siens, habitants polis des bords de la Seine.
Ce fut dans ce quartier que l'on dansa sur le cercueil du diacre Paris, et qu'on mangea de la terre de son tombeau, jusqu'à ce qu'on eût fermé le cimetière :
De par le roi, défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu
Les séditions et les mutineries ont leur origine cachée dans ce foyer de la misère obscure.
Les maisons n'y ont point d'autre horloge que le cours du soleil ; ce sont des hommes reculés de trois siècles par rapport aux arts et aux mœurs régnantes. Tous les débats particuliers y deviennent publics ; et une femme mécontente de son mari, plaide sa cause dans la rue, le cite au tribunal de la populace, attroupe tous les voisins, et récite la confession scandaleuse de son homme. Les discussions de toute nature finissent par de grands coups de poings ; et le soir on est raccommodé, quand l'un des deux a eu le visage couvert d'égratignures.
Là, tel homme enfoncé dans un galetas, se dérobe à la police et aux cent yeux de ses argus, à peu près comme un insecte imperceptible se dérobe aux forces réunies de l'optique. Une famille entière occupe une seule chambre, où l'on voit les quatre murailles, où les grabats sont sans rideaux, où les ustensiles de cuisine roulent avec les vases de nuit. Les meubles en totalité ne valent pas vingt écus ; et tous les trois mois les habitants changent de trou, parce qu'on les chasse faute de paiement du loyer. Ils errent ainsi, et promènent leurs misérables meubles d'asile en asile. On ne voit point de souliers dans ces demeures ; on n'entend le long des escaliers que le bruit des sabots. Les enfants y sont nus et couchent pêle-mêle.
C'est ce faubourg qui, le dimanche, peuple Vaugirard et ses nombreux cabarets ; car il faut que l'homme s'étourdisse sur ses maux : c'est lui surtout qui remplit le fameux salon des gueux. Là, dansent sans souliers et tournoyant sans cesse, des hommes et des femmes qui, au bout d'une heure, soulèvent tant de poussière qu'à la fin on ne les aperçoit plus.
Une rumeur épouvantable et confuse, une odeur infecte, tout vous éloigne de ce salon horriblement peuplé, et où dans des plaisirs faits pour elle, la populace boit un vin aussi désagréable que tout le reste.
Ce faubourg est entièrement désert les fêtes et les dimanches. Mais quand Vaugirard est plein, son peuple reflue au Petit-Gentilly, aux Porcherons et à la Courtille : on voit le lendemain, devant les boutiques des marchands de vin, les tonneaux vides et par douzaines. Ce peuple boit pour huit jours.
Il est, dans ce faubourg, plus méchant, plus inflammable, plus querelleur, et plus disposé à la mutinerie, que dans les autres quartiers. La police craint de pousser à bout cette populace ; on la ménage, parce qu'elle est capable de se porter aux plus grands excès."
