- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Malherbe (1555-1628) - Mathurin Régnier (1573-1613) - Honoré de Racan (1589-1670) - François Maynard (1582-1646) - Jean Ogier de Gombauld (1576-1666) - ...
Last update 10/10/2021

"D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir" (Boileau). Parler pour le plus grand nombre et pour imposer une autorité, c'est bien à l'ombre du pouvoir et de l'unité que se structure le langage, en France, 1559-1594, trente-cinq séparent la mort de Henri II de l'entrée de Henri IV à Paris, un mouvement s'amorce dont nous parlons encore, sans toujours le savoir. Ronsard en 1550, Malherbe en 1610, Victor Hugo en 1830 sont les premiers marqueurs de la poésie française jusqu'au début du XIXe siècle.
En l'année 1600, date de l'arrivée de Malherbe à Paris, deux poètes dominaient, Philippe Desportes (1546-1606), qui mettait la dernière main à ses Poésies chrestiennes, où il chantait la miséricorde infinie de Dieu (Fais rentrer dans le parc ta brebis égarée, Donne de l'eau vivante à ma bouche altérée. Chasse l'ombre de mort qui vole autour de moi), et de dix ans plus jeune, Jacques Davy du Perron (1556-1618), évêque d'Evreux dès 1591, à l'âge de trente-cinq ans, archevêque de Sens, grand aumônier du roi avant de recevoir l'office de cardinal en 1604, et qui joua un rôle déterminant dans la conversion d' Henri de Navarre au catholicisme. François de Malherbe mit trente ans pour parvenir de Caen au Louvre, en passant longuement par la Provence.
"Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, Fit sentir dans les vers une juste cadence, D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir, Et réduisit la muse aux règles du devoir" (Boileau, Art poétique, 1674). Il faut reconnaître que Ronsard et du Bellay dans leur effort constant pour élever leur langage poétique à la hauteur de la grecque et de la latine, enrichissaient sans mesure leur vocabulaire en y adjoignant tant les mots grecs et latins francisés que les vocables repris aux vieux siècles ou empruntés au patois des diverses provinces, courant le risque de concevoir des oeuvres au final inintelligibles pour le plus grand nombre. Le désir de Malherbe d'être compris de tout le monde et « de ne pas apprêter de viandes seulement pour les cuisiniers » lui fait proscrire la mythologie luxuriante de Ronsard, que seuls les « pédants » de collège pouvaient comprendre. Il veut qu'on s'en tienne aux légendes bien connues de tout « honnête homme », que toute personne de culture moyenne peut aisément se remémorer. Son goût du naturel lui fait détester les mièvreries prises de l'italien, « où elles ne valent pas plus qu'en français ». Dans l'ensemble touffu de la déjà vieille littérature française, Malherbe sait discerner ce qui semblait à conserver ou à rejeter d'une langue trop flottante, délaisser l'approximatif pour s'approprier le juste, le simple et le vrai...
La Langue française moderne s'élabore donc dans cette première moitié du XVIIe siècle, entre la Pléiade et le classicisme, dans un contexte de maturation intellectuelle où pour plaire il faut faire "vrai" et où le poète devient un courtisan : il faut d'abord penser ce qu'on écrit, c'est un tournant dans l'évolution de notre humanité. Descartes rejoindra à sa manière Malherbe...
La Langue française moderne s'élabore dans une période qui débute avec la mort d'Henri IV et la régence de Marie de Médicis. S'annoncent le règne de Louis XIII et la domination de Richelieu, la régence d'Anne d'Autriche et le pouvoir de Mazarin, combattu par la Fronde parlementaire puis par la Fronde des princes, mais nous sommes alors déjà à la moitié du siècle.
En ce début du XVIIe, s'expriment donc des écrivains semblant étrangers à l'élaboration du classicisme, mais puisqu'il faut définir des styles, on en est venu à les qualifier de "baroques", style multiforme jusque-là appliqué à l'architecture et aux arts plastiques. Avant le classicisme, le contraste est saisissant entre une pensée "subtile" et des images parfois trop recherchées. La vogue du baroque s'étend en France du dernier quart du XVIe siècle jusqu'à la fin du règne de Louis XIII, suscitée par des influences italiennes et espagnoles. C'est dans ce contexte que vont s'élaborer l'ordre et la régularité de ce que sera le classicisme, Malherbe régente la langue poétique et la versification, Guez de Balzac forge ce que l'on a appelé la prose oratoire et Vaugelas, la codification de la langue. C'est avec la création par Richelieu de l'Académie française en 1635 que l'art littéraire à la française est officiellement et historiquement consacré.
Dans un premier temps, en 1610, on assiste à l'épanouissement de quatre genres littéraires: la poésie, sous forme épique ou lyrique (Le Tasse, D'Aubigné, Malherbe, Régnier, Gongora) ; le roman pastoral sous sa forme d'itinéraire sentimental compliqué (l'Astrée, d'Honoré D'Urfé), d'aventures hasardeuses picaresques (les aventures du Picaro Guzman d'Alfarache de Mateo Aleman ou celles de Don Quichotte, de Cervantès) ; le théâtre, avec l'incroyable floraison des auteurs élisabéthains (Marlowe, Chapman, Tourneur) et l'œuvre de Shakespeare ; enfin les écrits moraux ou spirituels (Charron, saint François de Sales)...
(1616, Pourbus, Frans the Younger - Portrait of Four Members of the Paris Council - The Hermitage, St. Petersburg)

François de Malherbe (1555-1628)
"Les ouvrages communs vivent quelques années, Ce que Malherbe écrit dure éternellement", jugement d'un Malherbe sur lui-même, d'un Malherbe qui ouvre la littérature française de ce XVIIe siècle d'une manière paradoxale, l'homme, froid, rude, au don verbal indéniable ne croit ni à l'inspiration ni au lyrisme personnel, et décide, contre La Pléiade, d'épurer la langue, donc de l'appauvrir, et de soumettre l'expression à la pensée. "Un bon poète n'est pas plus utile à l'Etat qu'un bon joueur de quilles", écrira-t-il, "toute la gloire que nous pouvons espérer est qu'on dira que nous avons été deux excellents arrangeurs de syllabes", surenchérira Racan. Traditionnellement on note une évolution de Malherbe, du baroque et de sa "magnificence" à la "sobriété" du classique, des "Larmes de saint Pierre" (1587) à la "Paraphrase du Psaume CXLV" (1627).
François de Malherbe naquit à Caen en 1558; il était l'aîné d'une famille nombreuse de modeste noblesse de robe, d'inclination protestante. Après des études menées notamment à Bâle et à Heidelberg, en 1576, n`ayant de penchant ni pour la magistrature ni pour le protestantisme, il quitte sa famille, tente de se faire une position dans le monde en se cherchant un protecteur. Ce qui domine chez lui, dès la jeunesse, c'est une certaine humeur batailleuse, avec des fumées de gloire. On le verra bien quand il prendra la plume. Ses débuts furent extrêmement difficiles. Attaché tout d'abord à la personne d'Henri d'Angoulême, bâtard d'Henri II, qui gouvernait la Provence, Malherbe, en tant que secrétaire, le suivit dans son gouvernement. A la petite cour d`Aix, le jeune poète, qui avait déjà composé en 1575 les "Larmes sur la mort de Geneviève Rouxel" qu'il ne publia jamais, se livra aux exercices poétiques qu'il affectionnait. De cette époque datent "les Ombres de Damon" et quelques poèmes amoureux.
Aux ombres de Damon
L'Orne comme autrefois nous reverrait encore,
Ravis de ces pensers que le vulgaire ignore,
Egarer à l'écart nos pas et nos discours,
Et, couchés sur les fleurs comme étoiles semées,
Rendre en si doux ébat les heures consumées,
Que les soleils nous seraient courts.
Mais, ô loi rigoureuse à la race des hommes !
C'est un point arrêté que tout ce que nous sommes,
Issus de pères rois et de pères bergers,
La Parque également sous la tombe nous serre ;
Et les mieux établis au repos de la terre
N'y sont qu'hôtes et passagers.
Tout ce que la grandeur a de vains équipages,
D'habillements de pourpre, et de suite de pages,
Quand le terme est échu n'allonge point nos jours.
Il faut aller tout nus où le destin commande ;
Et de toutes douleurs la douleur la plus grande,
C'est qu'il faut laisser nos amours :
Amours qui, la plupart infidèles et feintes,
Font gloire de manquer à nos cendres éteintes,
Et qui, plus que l'honneur estimant les plaisirs,
Sous le masque trompeur de leurs visages blêmes,
Acte cligne du foudre ! en nos obsèques mêmes
Conçoivent de nouveaux désirs.
Elles savent assez alléguer Artémise,
Disputer du devoir et de la foi promise :
Mais tout ce beau langage est de si peu d'effet,
Qu'à peine en leur grand nombre une seule se treuve
De qui la foi survive, et qui fasse la preuve
Que ta Carinice te fait.
Depuis que tu n'es plus, la campagne déserte
A dessous deux hivers perdu sa robe verte,
Et deux fois le printemps l'a repeinte de fleurs,
Sans que d'aucun discours sa douleur se console,
Et que ni la raison ni le temps qui s'envole
Puisse faire tarir ses pleurs.
Le silence des nuits, l'horreur des cimetières,
De son contentement sont les seules matières ;
Tout ce qui plaît déplaît à son triste penser ;
Et si tous ses appas sont encore en sa face,
C'est que l'Amour y loge, et que rien qu'elle fasse
N'est capable de l'en chasser.
Malherbe épousa en 1581 Madeleine de Coriolis, fille d'un président au Parlement de Provence. déjà deux fois veuve, et dont il devait avoir quatre enfants dont aucun ne lui survécut. Il revint à Caen après l'assassinat de son protecteur et végéta bien des années. En 1587, Malherbe composait avec ses "Larmes de saint Pierre", imité certes de l'un des modèles favoris de Desportes, le contemporain italien Luigi Tansillo, mais une œuvre qui laissait entrevoir son génie à venir. Une oeuvre dédiée au roi Henri III, mais deux ans plus tard, le souverain périssait assassiné à son tour...
1587 - Les larmes de Saint Pierre
Ce n'est pas en mes vers qu'une amante abusée
Des appas enchanteurs d'un parjure Thésée,
Après l'honneur ravi de sa pudicité,
Laissée ingratement en un bord solitaire,
Fait de tous les assauts que la rage peut faire
Une fidèle preuve à l'infidélité.
Les ondes que j'épands d'une éternelle veine
Dans un courage saint ont leur sainte fontaine ;
Où l'amour de la terre et le soin de la chair
Aux fragiles pensers ayant ouvert la porte,
Une plus belle amour se rendit la plus forte,
Et le fit repentir aussitôt que pécher.
Henri, de qui les yeux et l'image sacrée
Font un visage d'or à cette âge ferrée,
Ne refuse à mes vœux un favorable appui ;
Et si pour ton autel ce n'est chose assez grande,
Pense qu'il est si grand, qu'il n'aurait point d'offrande
S'il n'en recevait point que d'égales à lui.
La foi qui fut au cœur d'où sortirent ces larmes
Est le premier essai de tes premières armes,
Pour qui tant d'ennemis à tes pieds abattus,
Pâles ombres d'enfer, poussière de la terre,
Ont connu ta fortune, et que l'art de la guerre
A moins d'enseignements que tu n'as de vertus.
De son nom de rocher, comme d'un bon augure,
Un éternel état l'Église se figure ;
Et croit, par le destin de tes justes combats,
Que ta main relevant son épaule courbée,
Un jour, qui n'est pas loin, elle verra tombée
La troupe qui l'assaut et la veut mettre bas.
Mais le coq a chanté pendant que je m'arrête
À l'ombre des lauriers qui t'embrassent la tête,
Et la source déjà commençant à s'ouvrir,
A lâché les ruisseaux qui font bruire leur trace,
Entre tant de malheurs estimant une grâce,
Qu'un Monarque si grand les regarde courir.
Ce miracle d'amour, ce courage invincible,
Qui n'espérait jamais une chose possible
Que rien finît sa foi que le même trépas,
De vaillant fait couard, de fidèle fait traître,
Aux portes de la peur abandonne son maître,
Et jure impudemment qu'il ne le connaît pas.
À peine la parole avait quitté sa bouche,
Qu'un regret aussi prompt en son âme le touche ;
Et mesurant sa faute à la peine d'autrui,
Voulant faire beaucoup, il ne peut davantage
Que soupirer tout bas, et se mettre au visage
Sur le feu de sa honte une cendre d'ennui.
Les arcs qui de plus près sa poitrine joignirent,
Les traits qui plus avant dans le sein l'atteignirent,
Ce fut quand du Sauveur il se vit regardé ;
Les yeux furent les arcs, les œillades les flèches
Qui percèrent son âme, et remplirent de brèches
Le rempart qu'il avait si lâchement gardé.
Cet assaut, comparable à l'éclat d'une foudre,
Pousse et jette d'un coup ses défenses en poudre ;
Ne laissant rien chez lui que le même penser
D'un homme qui, tout nu de glaive et de courage,
Voit de ses ennemis la menace et la rage,
Qui le fer en la main le viennent offenser.
Ces beaux yeux souverains qui traversent la terre
Mieux que les yeux mortels ne traversent le verre,
Et qui n'ont rien de clos à leur juste courroux,
Entrent victorieux en son âme étonnée,
Comme dans une place au pillage donnée,
Et lui font recevoir plus de morts que de coups.
....
"Beau ciel par qui mes jours sont troubles"
Stances pour M. le duc de Montpensier qui demandait en mariage Madame Catherine,
la princesse de Navarre, sœur d'Henri IV. 1591 ou 1592....
Beau ciel, par qui mes jours sont troubles ou sont calmes,
Seule terre où je prends mes cyprès et mes palmes,
Catherine, dont l'œil ne luit que pour les dieux
Punissez vos beautés plutôt que mon courage,
Si, trop haut s'élevant, il adore un visage
Adorable par force à quiconque a des yeux.
Je ne suis pas ensemble aveugle et téméraire,
Je connais bien l'erreur que l'amour m'a fait faire,
Cela seul ici-bas surpassait mon effort ;
Mais mon âme qu'à vous ne peut être asservie,
Les Destins n'ayant point établi pour ma vie
Hors de cet océan de naufrage et de port.
Beauté par qui les dieux, las de notre dommage,
Ont voulu réparer les défauts de notre âge,
Je mourrai dans vos feux, éteignez-les ou non,
Comme le fils d'Alcmène, en me brûlant moi-même ;
Il suffit qu'en mourant dans cette flamme extrême
Une gloire éternelle accompagne mon nom.
On ne doit point, sans sceptre, aspirer où j'aspire ;
C'est pourquoi, sans quitter les lois de votre empire,
Je veux de mon esprit tout espoir rejeter.
Qui cesse d'espérer, il cesse aussi de craindre ;
Et, sans atteindre au but où l'on ne peut atteindre,
Ce m'est assez d'honneur que j'y voulais monter.
Je maudis le bonheur où le ciel m'a fait naître,
Qui m'a fait désirer ce qu'il m'a fait connaître :
Il faut ou vous aimer, ou ne vous faut point voir.
L'astre qui luit aux grands, en vain à ma naissance
Épandit dessus moi tant d'heur et de puissance,
Si pour ce que je veux j'ai trop peu de pouvoir.
Mais il le faut vouloir, et vaut mieux se résoudre,
En aspirant au ciel, être frappé de foudre,
Qu'aux desseins de la terre assuré se ranger.
J'ai moins de repentir, plus je pense à ma faute,
Et la beauté des fruits d'une palme si haute
Me fait par le plaisir oublier le danger.
Malherbe compose ensuite une Consolation à Cléophon, qui modifiée deviendra Consolation à M. du Perrier (1598-99). De retour à Aix en 1595, il y publie ses premiers poèmes «nationaux », deux Ode sur la prise de Marseille par les troupes royales
(".. Cinq ans Marseille volée A son juste possesseur, Avoit langui désolée Aux mains de cet oppresseur. Enfin le temps l'a remise En sa première franchise ; Et les maux qu'elle enduroit Ont eu ce bien pour échange, Qu'elle a vu parmi la fange Fouler ce qu'elle adorait...").
Au Roi Henri Le Grand, Sur la réduction de Marseille à l'obéissance de ce roi, sous les ordres du duc de Guise, gouverneur de Provence. 1596....
Enfin, après tant d'années,
Voici l'heureuse saison,
Où nos misères bornées
Vont avoir leur guérison.
Les dieux, longs à se résoudre,
Ont fait un coup de leur foudre,
Qui montre aux ambitieux
Que les fureurs de la terre
Ne sont que paille et que verre
À la colère des cieux.
Peuples, à qui la tempête
A fait faire tant de vœux,
Quelles fleurs à cette fête
Couronneront vos cheveux ?
Quelle victime assez grande
Donnerez-vous pour offrande ?
Et quel Indique séjour
Une perle fera naître
D'assez de lustre pour être
La marque d'un si beau jour ?
Cet effroyable colosse,
Cazaux, l'appui des mutins,
A mis le pied dans la fosse
Que lui cavaient les destins.
Il est bas, le parricide :
Un Alcide, fils d'Alcide,
À qui la France a prêté
Son invincible génie,
A coupé sa tyrannie
D'un glaive de liberté.
Les aventures du monde
Vont d'un ordre mutuel,
Comme on voit au bord de l'onde
Un reflux perpétuel.
L'aise et l'ennui de la vie
Ont leur course entresuivie
Aussi naturellement
Que le chaud et la froidure ;
Et rien, afin que tout dure,
Ne dure éternellement.
Cinq ans Marseille, volée
À son juste possesseur,
Avait langui désolée
Aux mains de cet oppresseur.
Enfin le temps l'a remise
En sa première franchise ;
Et les maux qu'elle endurait
Ont eu ce bien pour échange,
Qu'elle a vu parmi la fange
Fouler ce qu'elle adorait.
Déjà tout le peuple more
À ce miracle entendu ;
À l'un et l'autre Bosphore
Le bruit en est répandu ;
Toutes les plaines le savent,
Que l'Inde et l'Euphrate lavent ;
Et déjà, pâle d'effroi,
Memphis se pense captive,
Voyant si près de sa rive
Un neveu de Godefroi. .....

En 1598, nouveau retour à Caen où Malherbe se lie étroitement avec Antoine de Montchrestien (1575-1621), poète bien connu pour ses duels successifs et auteur d'un Traité d'Economie politique au début des années 1620. En 1599, à la suite de la mort de sa fille enlevée par la peste, Malherbe regagne Aix et y restera de nouveau six ans. Il entre en relation avec Guillaume du Vair (1556-1621), président du Parlement de Provence et traducteur d'Epictète, et entreprend la traduction des Epîtres à Lucilius de Sénèque. C'est à cette époque que le nom de Malherbe commence à être connu via ses recueils collectifs publiés à Rouen (1597) et à Paris (1598, 1599, 1603).
La "Consolation à Monsieur Du Périer" (1599) avocat au Parlement d'Aix, révèle toute la pudeur extrême des sentiments, toute la profondeur de l'acceptation de la condition humaine qui semblent traverser tout le XVIIe siècle...
"Ta douleur, Du Périer, sera donc éternelle,
Et les tristes discours
Que te met en l'esprit l'amitié paternelle
L'augmenteront toujours?
Le malheur de ta fille au tombeau descendue
Par un commun trépas,
Est-ce quelque dédale où ta raison perdue
Ne se retrouve pas?
Je sais de quels appas son enfance était pleine
Et n'ai pas entrepris,
Injurieux ami, de soulager ta peine
Avecque son mépris.
Mais elle était du monde où les plus belles choses
Ont le pire destin,
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin.
Puis, quand ainsi serait que, selon ta prière,
Elle aurait obtenu
D'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière,
Qu'en fût-il advenu?
Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste
Elle eût eu plus d'accueil?
Ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste
Et les vers du cercueil? Non, non, mon Du Périer, aussitôt que la Parque
Ote l'âme du corps,
L'âge s'évanouit au deçà de la barque
Et ne suit point les morts.
Tithon n'a plus les ans qui le firent cigale,
Et Pluton, aujourd'hui,
Sans égard du passé, les mérites égale
D'Archémore et de lui.
Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes ;
Mais, sage à l'avenir,
Aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes
Eteins le souvenir.
C'est bien, je le confesse, une juste coutume,
Que le cœur affligé,
Par le canal des yeux vidant son amertume,
Cherche d'être allégé.
Même, quand il advient que la tombe sépare
Ce que nature a joint,
Celui qui ne s'émeut a l'âme d'un barbare
Ou n'en a du tout point.
Mais d'être inconsolable, et dedans sa mémoire
Enfermer un ennui,
N'est-ce pas se haïr pour acquérir la gloire
De bien aimer autrui ?...
La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles ;
On a beau la prier,
La cruelle qu'elle est se bouche les oreilles
Et nous laisse crier.
Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre
Est sujet à ses lois,
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N'en défend point nos rois."
C'est en 1600 que Malherbe, présenté par François du Périer, offre à la jeune reine Marie de Médicis, de passage à Aix,
une "Ode sur sa bíenvenue en France" ...
Peuples, qu'on mette sur la tête
Tout ce que la terre a de fleurs ;
Peuples, que cette belle fête
À jamais tarisse nos pleurs :
Qu'aux deux bouts du monde se voit
Luire le feu de notre joie ;
Et soient dans les coupes noyés
Les soucis de tous ces orages
Que pour nos rebelles courages
Les Dieux nous avaient envoyés.
À ce coup iront en fumée
Les vœux que faisaient nos mutins
En leur âme encore affamée
De massacres et de butins.
Nos doutes seront éclaircis ;
Et mentiront les prophéties
De tous ces visages pâlis
Dont le vain étude s'applique
À chercher l'an climactérique
De l'éternelle fleur de lis.
Aujourd'hui nous est amenée
Cette princesse que la foi
D'amour ensemble et d'hyménée
Destine au lit de notre roi.
La voici, la belle Marie,
Belle merveille d'Hétrurie,
Qui fait confesser au Soleil,
Quoi que l'âge passé raconte,
Que du ciel, depuis qu'il y monte,
Ne vint jamais rien de pareil.
Telle n'est point la Cythérée,
Quand, d'un nouveau feu s'allumant,
Elle sort pompeuse et parée
Pour la conquête d'un amant :
Telle ne luit en sa carrière
Des mois l'inégale courrière :
Et telle dessus l'horizon
L'Aurore au matin ne s'étale,
Quand les yeux mêmes de Céphale
En feraient la comparaison.
L'antique sceptre de sa race,
Où l'heure aux mérites est joint,
Lui met le respect en la face ;
Mais il ne l'enorgueillit point.
Nulle vanité ne la touche ;
Les grâces parlent par sa bouche ;
Et son front, témoin assuré
Qu'au vice elle est inaccessible,
Ne peut que d'un cœur insensible
Etre vu sans être adoré.
Quantesfois, lorsque sur les ondes
Ce nouveau miracle flottait,
Neptune en ses caves profondes
Plaignit-il le feu qu'il sentait !
Et quantesfois en sa pensée
De vives atteintes blessée,
Sans l'honneur de la royauté
Qui lui fit celer son martyre,
Eût-il voulu de son empire
Faire échange à cette beauté !
....

1605 - Mais Malherbe doit encore attendre et c'est enfin en 1605, par l'intermédiaire du cardinal Du Perron, qu'il est présenté au roi Henri IV qui le chargea de composer des vers sur son voyage en Limousin. Limoges était alors le centre des intrigues et des complots contre son autorité nouvelle. Malherbe semble avoir compris la gravité des circonstances...
Prière pour le Roy Henri le Grand allant en Limousin (stance)
"Un malheur inconnu glisse parmi les hommes, Qui les rend ennemis du repos où nous sommes" - Ce poème prend appui sur des idées simples et fortes : il proclame le courage, la vertu, la prudence et la grandeur du roi, la confiance en Dieu qui l'inspire, son espoir en des années pacifiques et fécondes. La composition en est logique et nette; après une prière à Dieu pour le roi dont tout dépend, puis un rappel des luttes qu'il a apaisées, Malherbe se laisse aller à de magnifiques rêves d'avenir. La forme est belle par la plénitude de la phrase et du vers dont le rythme soutenu donne véritablement l'impression d'un monde embelli et heureux.
Ô Dieu, dont les bontés, de nos larmes touchées,
Ont aux vaines fureurs les armes arrachées,
Et rangé l'insolence aux pieds de la raison ;
Puisqu'à rien d'imparfait ta louange n'aspire,
Achève ton ouvrage au bien de cet empire,
Et nous rends l'embonpoint comme la guérison !
Nous sommes sous un roi si vaillant et si sage,
Et qui si dignement a fait l'apprentissage
De toutes les vertus propres à commander,
Qu'il semble que cet heur nous impose silence,
Et qu'assurés par lui de toute violence
Nous n'avons plus sujet de te rien demander.
Certes quiconque a vu pleuvoir dessus nos têtes
Les funestes éclats des plus grandes tempêtes
Qu'excitèrent jamais deux contraires partis,
Et n'en voit aujourd'hui nulle marque paraître,
En ce miracle seul il peut assez connaître
Quelle force a la main qui nous a garantis.
Mais quoi ! de quelque soin qu'incessamment il veille,
Quelque gloire qu'il ait à nulle autre pareille,
Et quelque excès d'amour qu'il porte à notre bien,
Comme échapperons-nous en des nuits si profondes,
Parmi tant de rochers qui lui cachent les ondes,
Si ton entendement ne gouverne le sien ?
Un malheur inconnu glisse parmi les hommes,
Qui les rend ennemis du repos où nous sommes :
La plupart de leurs vœux tendent au changement ;
Et, comme s'ils vivaient des misères publiques,
Pour les renouveler ils font tant de pratiques,
Que qui n'a point de peur n'a point de jugement.
En ce fâcheux état ce qui nous réconforte,
C'est que la bonne cause est toujours la plus forte,
Et qu'un bras si puissant t'ayant pour son appui,
Quand la rébellion, plus qu'une hydre féconde,
Aurait pour le combattre assemblé tout le monde,
Tout le monde assemblé s'enfuirait devant lui.
Conforme donc, Seigneur, ta grâce à nos pensées :
Ôte-nous ces objets qui des choses passées
Ramènent à nos yeux le triste souvenir ;
Et comme sa valeur, maîtresse de l'orage,
À nous donner la paix a montré son courage,
Fais luire sa prudence à nous l'entretenir.
Il n'a point son espoir au nombre des armées,
Étant bien assuré que ces vaines fumées
N'ajoutent que de l'ombre à nos obscurités.
L'aide qu'il veut avoir, c'est que tu le conseilles ;
Si tu le fais, Seigneur, il fera des merveilles,
Et vaincra nos souhaits par nos prospérités.
Les fuites des méchants, tant soient-elles secrètes,
Quand il les poursuivra n'auront point de cachettes ;
Aux lieux les plus profonds ils seront éclairés :
II verra sans effet leur honte se produire,
Et rendra les desseins qu'ils feront pour lui nuire
Aussitôt confondus comme délibérés.
La rigueur de ses lois, après tant de licence,
Redonnera le cœur à la faible innocence
Que dedans la misère on faisait envieillir.
À ceux qui l'oppressaient il ôtera l'audace ;
Et, sans distinction de richesse ou de race,
Tous de peur de la peine auront peur de faillir.
La terreur de son nom rendra nos villes fortes ;
On n'en gardera plus ni les murs ni les portes ;
Les veilles cesseront au sommet de nos tours ;
Le fer, mieux employé, cultivera la terre ;
Et le peuple, qui tremble aux frayeurs de la guerre,
Si ce n'est pour danser n'aura plus de tambours.
Loin des mœurs de son siècle il bannira les vices,
L'oisive nonchalance et les molles délices,
Qui nous avaient portés jusqu'aux derniers hasards ;
Les vertus reviendront de palmes couronnées,
Et ses justes faveurs aux mérites données
Feront ressusciter l'excellence des arts.
La foi de ses aïeux, ton amour et ta crainte,
Dont il porte dans l'âme une éternelle empreinte,
D'actes de piété ne pourront l'assouvir ;
II étendra ta gloire autant que sa puissance,
Et, n'ayant rien si cher que ton obéissance,
Où tu le fais régner il te fera servir.
Tu nous rendras alors nos douces destinées ;
Nous ne reverrons plus ces fâcheuses années
Qui pour les plus heureux n'ont produit que des pleurs.
Toute sorte de biens comblera nos familles,
La moisson de nos champs lassera les faucilles,
Et les fruits passeront la promesse des fleurs.
La fin de tant d'ennuis dont nous fûmes la proie
Nous ravira les sens de merveille et de joie ;
Et, d'autant que le monde est ainsi composé
Qu'une bonne fortune en craint une mauvaise,
Ton pouvoir absolu, pour conserver notre aise,
Conservera celui qui nous l'aura causé.
Quand un roi fainéant, la vergogne des princes,
Laissant à ses flatteurs le soin de ses provinces,
Entre les voluptés indignement s'endort,
Quoique l'on dissimule on en fait peu d'estime ;
Et, si la vérité se peut dire sans crime,
C'est avecque plaisir qu'on survit à sa mort.
Mais ce roi, des bons rois l'éternel exemplaire
Qui de notre salut est l'ange tutélaire,
L'infaillible refuge et l'assuré secours,
Son extrême douceur ayant dompté l'envie,
De quels jours assez longs peut-il borner sa vie,
Que notre affection ne les juge trop courts ?
Nous voyons les esprits nés à la tyrannie,
Ennuyés de couver leur cruelle manie,
Tourner tous leurs conseils à notre affliction ;
Et lisons clairement dedans leur conscience
Que, s'ils tiennent la bride à leur impatience,
Nous n'en sommes tenus qu'à sa protection.
Qu'il vive donc, Seigneur, et qu'il nous fasse vivre !
Que de toutes ces peurs nos âmes il délivre,
Et, rendant l'univers de son heur étonné,
Ajoute chaque jour quelque nouvelle marque
Au nom qu'il s'est acquis du plus rare monarque
Que ta bonté propice ait jamais couronné !
Cependant son Dauphin d'une vitesse prompte
Des ans de sa jeunesse accomplira le compte ;
Et, suivant de l'honneur les aimables appas,
De faits si renommés ourdira son histoire,
Que ceux qui dedans l'ombre éternellement noire
Ignorent le soleil ne l'ignoreront pas.
Par sa fatale main qui vengera nos pertes
L'Espagne pleurera ses provinces désertes,
Ses châteaux abattus et ses camps déconfits ;
Et si de nos discordes l'infâme vitupère
A pu la dérober aux victoires du père,
Nous la verrons captive aux triomphes du fils.
Le poète de cinquante ans venait ainsi d'achever sa laborieuse montée jusqu'à la Cour, il devint rapidement poète officiel, s'installe à Paris et s'impose au monde littéraire comme un maître avisé et sûr de lui. Il ne sera ni le poète de l'amour ni celui de la nature, mais le chantre de la stabilité politique. Malgré les ennemis que sa cinglante sévérité lui attira, il poursuivit sa tâche avec la même ardeur et la même ténacité jusqu'à sa mort en 1628.
En 1605, Malherbe arrive donc à Paris en compagnie de deux grands parlementaires, Guillaume Du Vair et Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, est présenté au roi par Vauquelin des Yveteaux, confié au grand écuyer, M. de Bellegarde, qui lui donne une charge d'écuyer du roi. Il devient gentilhomme de la chambre et, intronisé poète de cour, il entend régner seul. Le voici magnifiant avec zèle les plus petits événements de la cour, naissance, mariage, victoire militaire ou succès diplomatique, et les moindres incidents survenus dans la santé des souverains. Pour écarter tous ses rivaux, il est de toutes les fêtes et se montre dans les cabinets du roi et de la reine, dans les hôtels de la reine Marguerite, de Condé, de Guise. On cite l'ode écrite sur l'attentat commis en 1605 contre Henri IV et l'ode sur la reddition de Sedan, le sonnet au roi, sur la naissance de son second fils, les stances, enfin, sur l'assassinat de Henri le Grand par Ravaillac....
(1606) Ode sur l'attentat commis commis en la personne de Henry le grand le 19 décembre 1605...
Que direz-vous, races futures,
Si quelquefois un vrai discours
Vous récite les aventures
De nos abominables jours ?
Lirez-vous sans rougir de honte
Que notre impiété surmonte
Les faits les plus audacieux
Et les plus dignes du tonnerre
Qui firent jamais à la terre
Sentir la colère des cieux ?
Ô que nos fortunes prospères
Ont un change bien apparent !
Ô que du siècle de nos pères
Le nôtre s'est fait différent !
La France devant ces orages
Pleine de mœurs et de courages
Qu'on ne pouvait assez louer,
S'est faite aujourd'hui si tragique
Qu'elle produit ce que l'Afrique
Aurait vergogne d'avouer.
Quelles preuves incomparables
Peut donner un prince de soi
Que les rois les plus adorables
N'en quittent l'honneur à mon roi ?
Quelle terre n'est parfumée
Des odeurs de la renommée ?
Et qui peut nier qu'après Dieu
Sa gloire, qui n'a point d'exemples,
N'ait mérité que dans nos temples
On lui donne le second lieu ?
Qui ne sait point qu'à sa vaillance
Il ne se peut rien ajouter ?
Qu'on reçoit de sa bienveillance
Tout ce qu'on en doit souhaiter ?
Et que si de cette couronne
Que sa tige illustre lui donne
Les lois ne l'eussent revêtu,
Nos peuples d'un juste suffrage
Ne pouvaient sans faire naufrage
Ne l'offrir point à sa vertu ?
Toutefois, ingrats que nous sommes,
Barbares et dénaturés,
Plus qu'en ce climat où les hommes
Par les hommes sont dévorés,
Toujours nous assaillons sa tête
De quelque nouvelle tempête,
Et d'un courage forcené
Rejetant son obéissance
Lui défendons la jouissance
Du repos qu'il nous a donné.
La main de cet esprit farouche
Qui, sorti des ombres d'enfer,
D'un coup sanglant frappa sa bouche
A peine avait laissé le fer,
Et voici qu'un autre perfide
Où la même audace réside,
Comme si détruire l'État
Tenait lieu de juste conquête,
De pareilles armes s'apprête
A faire un pareil attentat.
Ô soleil ô grand luminaire !
Si jadis l'horreur d'un festin
Fit que de ta route ordinaire
Tu reculas vers le matin,
Et d'un émerveillable change
Tu couchas aux rives du Gange,
D'où vient que ta sévérité
Moindre qu'en la faute d'Atrée
Ne punit point cette contrée
D'une éternelle obscurité ?
Non non, tu luis sur le coupable
Comme tu fais sur l'innocent :
Ta nature n'est point capable
Du trouble qu'une âme ressent ;
Tu dois ta flamme à tout le monde,
Et ton allure vagabonde
Comme une servile action
Qui dépend d'une autre puissance,
N'ayant aucune connaissance
N'a point aussi d'affection.
Mais o planète belle et claire
Je ne parle pas sagement ;
Le juste excès de ma colère
M'a fait perdre le jugement :
Ce traître, quelque frénésie
Qui travaillait sa fantaisie,
Eut encore assez de raison
Pour ne vouloir rien entreprendre,
Bel astre, qu'il n'eût vu descendre
Ta lumière sous l'horizon.
Au point qu'il écuma sa rage,
Le Dieu de Seine était dehors
A regarder croître l'ouvrage
Dont ce prince embellit ses bords ;
Il se reverra tout à l'heure
AU plus bas lieu de sa demeure ;
Et ses nymphes dessous les eaux,
Toutes sans voix et sans haleine,
Pour se cacher furent en peine
De trouver assez de roseaux.
....
Mais le roi lui commande bien des odes pour favoriser ses amours et pour parler en son nom à ses maîtresses, exprimant comme il peut les appel et les plaintes, les soupirs du "grand Alcandre" pour la cruelle " Oranthe," c'est-à-dire de Henri IV pour la belle Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, qui fuira à l'étranger les poursuites royales....
Le pâle avènement de Louis XIII, et son mariage avec Anne d'Autriche, l'inspireront beaucoup moins, en attendant Richelieu...
"Revenez, mes plaisirs, ma dame est revenue"
Pour Alcandre, au retour d'Oranthe à Fontainebleau. 1609.
Revenez, mes plaisirs, ma dame est revenue ;
Et les vœux que j'ai faits pour revoir ses beaux yeux.
Rendant par mes soupirs ma douleur reconnue,
Ont eu grâce des cieux.
Les voici de retour ces astres adorables
Où prend mon océan son flux et son reflux ;
Soucis, retirez-vous ; cherchez les misérables ;
Je ne vous connais plus.
Peut-on voir ce miracle où le soin de nature
A semé comme fleurs tant d'aimables appas,
Et ne confesser point qu'il n'est pire aventure
Que de ne la voir pas ?
Certes l'autre soleil d'une erreur vagabonde
Court inutilement par ses douze maisons ;
C'est elle, et non pas lui, qui fait sentir au monde
Le change des saisons.
Avecque sa beauté toutes beautés arrivent ;
Ces déserts sont jardins de l'un à l'autre bout ;
Tant l'extrême pouvoir des grâces qui la suivent
Les pénètre partout.
Ces bois en ont repris leur verdure nouvelle ;
L'orage en est cessé, l'air en est éclairci ;
Et même ces canaux ont leur course plus belle,
Depuis qu'elle est ici.
De moi, que les respects obligent au silence,
J'ai beau me contrefaire et beau dissimuler ;
Les douceurs où je nage ont une violence
Qui ne se peut celer.
Mais, ô rigueur du sort ! tandis que je m'arrête
A chatouiller mon âme en ce contentement,
Je ne m'aperçois pas que le destin m'apprête
Un autre partement.
Arrière ces pensers que la crainte m'envoie ;
Je ne sais que trop bien l'inconstance du sort :
Mais de m'ôter le goût d'une si chère joie,
C'est me donner la mort.
"Complices de ma servitude",
STANCES. Composées en Bourgogne. 1609.
Complices de ma servitude,
Pensers, où mon inquiétude
Trouve son repos désiré,
Mes fidèles amis et mes vrais secrétaires,
Ne m'abandonnez point en ces lieux solitaires ;
C'est pour l'amour de vous que j'y suis retiré.
Partout ailleurs je suis en crainte ;
Ma langue demeure contrainte ;
Si je parle, c'est à regret ;
Je pèse mes discours, je me trouble et m'étonne,
Tant j'ai peu d'assurance à la foi de personne :
Mais à vous je suis libre, et n'ai rien de secret.
Vous lisez bien en mon visage
Ce que je souffre en ce voyage
Dont le ciel m'a voulu punir ;
Et savez bien aussi que je ne vous demande,
Étant loin de ma dame, une grâce plus grande
Que d'aimer sa mémoire et m'en entretenir.
Dites-moi donc sans artifice,
Quand je lui vouais mon service,
Faillis-je en mon élection ?
N'est-ce pas un objet digne d'avoir un temple,
Et dont les qualités n'ont jamais eu d'exemple,
Comme il n'en fut jamais de mon affection ?
Au retour des saisons nouvelles,
Choisissez les fleurs les plus belles
De qui la campagne se peint ;
En trouverez-vous une où le soin de nature
Ait avecque tant d'art employé sa peinture,
Qu'elle soit comparable aux roses de son teint ?
Peut-on assez vanter l'ivoire
De son front, où sont en leur gloire
La douceur et la majesté ;
Ses yeux, moins à des yeux qu'à des soleils semblables ;
Et de ses beaux cheveux les noeuds inviolables,
D'où n'échappa jamais rien qu'elle ait arrêté ?
Ajoutez à tous ces miracles
Sa bouche de qui les oracles
Ont toujours de nouveaux trésors ;
Prenez garde à ses mœurs, considérez-la toute :
Ne m'avouerez-vous pas que vous êtes en doute
Ce qu'elle a plus parfait, ou l'esprit, ou le corps ?
Mon roi, par son rare mérite,
A fait que la terre est petite
Pour un nom si grand que le sien :
Mais si mes longs travaux faisaient cette conquête,
Quelques fameux lauriers qui lui couvrent la tête,
Il n'en aurait pas un qui fût égal au mien.
Aussi quoique l'on me propose
Que l'espérance m'en est close,
Et qu'on n'en peut rien obtenir ;
Puisqu'à si beau dessein mon désir me convie,
Son extrême rigueur me coûtera la vie,
Où mon extrême foi m'y fera parvenir.
Si les tigres les plus sauvages
Enfin apprivoisent leurs rages,
Flattés par un doux traitement ;
Par la même raison pourquoi n'est-il croyable
Qu'à la fin mes ennuis la rendront pitoyable,
Pourvu que je la serve à son contentement ?
Toute ma peur est que l'absence
Ne lui donne quelque licence
De tourner ailleurs ses appas ;
Et qu'étant, comme elle est, d'un sexe variable,
Ma foi, qu'en me voyant elle avait agréable,
Ne lui soit contemptible en ne me voyant pas.
Amour a cela de Neptune,
Que toujours à quelque infortune
Il se faut tenir préparé ;
Ses infidèles flots ne sont point sans orages,
Aux jours les plus sereins on y fait des naufrages,
Et même dans le port on est mal assuré.
Peut-être qu'à cette même heure
Que je languis, soupire et pleure,
De tristesse me consumant,
Elle, qui n'a souci de moi ni de mes larmes,
Étale ses beautés, fait montre de ses charmes,
Et met en ses filets quelque nouvel amant.
Tout beau, pensers mélancoliques,
Auteurs d'aventures tragiques,
De quoi m'osez-vous discourir ?
Impudents boute-feux de noise et de querelle,
Ne savez-vous pas bien que je brûle pour elle,
Et que me la blâmer c'est me faire mourir ?
Dites-moi qu'elle est sans reproche,
Que sa constance est une roche,
Que rien n'est égal à sa foi ;
Prêchez-moi ses vertus, contez-m'en des merveilles ;
C'est le seul entretien qui plaît à mes oreilles :
Mais pour en dire mal : n'approchez point de moi.
Grâce à l'orgueilleuse idée qu'il se fait de son œuvre et à sa conception même de la poésie, Malherbe oriente la littérature de son temps, mais il laisse aussi de beaux vers, exemples parfaits d'un art accordé au siècle qui, renonçant aux guerres civiles, politiques ou religieuses, s'est fixé un idéal d'ordre, d'unité et de grandeur. Ainsi sa doctrine et son exemple vont-ils dans le même sens que l'Académie française qui vient de se créer avec la protection de Richelieu, et dont les «Lettres patentes» du roi précisent qu'il faut rendre la langue française "trop négligée de ceux qui l'eussent pu rendre la plus parfaite des modernes... non seulement élégante mais capable de traiter tous les arts et toutes les sciences..."
Au Roi Henri Le Grand, (Pour le premier ballet de monseigneur le Dauphin, dansé au mois de janvier 1610.
Voici de ton État la plus grande merveille,
Ce fils où ta vertu reluit si vivement ;
Approche-toi, mon prince, et vois le mouvement
Qu'en ce jeune Dauphin la musique réveille.
Qui témoigna jamais une si juste oreille
À remarquer des tons le divers changement ?
Qui jamais à les suivre eut tant de jugement,
Ou mesura ses pas d'une grâce pareille ?
Les esprits de la cour s'attachant par les yeux
À voir en cet objet un chef-d'œuvre des cieux,
Disent tous que la France est moins qu'il ne mérite ;
Mais moi, que du futur Apollon avertit,
Je dis que sa grandeur n'aura point de limite,
Et que tout l'univers lui sera trop petit.
"Mon Roi, s'il est ainsi que des choses futures"
Au roi Henri Le Grand - 1607 ou 1608.
Mon roi, s'il est ainsi que des choses futures
L'école d'Apollon apprend la vérité,
Quel ordre merveilleux de belles aventures
Va combler de lauriers votre postérité !
Que vos jeunes lions vont amasser de proie,
Soit qu'aux rives du Tage ils portent leurs combats,
Soit que de l'Orient mettant l'empire bas
Ils veuillent rebâtir les murailles de Troie !
Ils seront malheureux seulement en un point :
C'est que, si leur courage à leur fortune joint
Avait assujetti l'un et l'autre hémisphère,
Votre gloire est si grande en la bouche de tous,
Que toujours on dira qu'ils ne pouvaient moins faire,
Puisqu'ils avaient l'honneur d'être sortis de vous.
En fait, quand Malherbe glorifie le roi, qui ramène l'ordre dans le pays tout entier, il satisfait encore son idéal de classement, d'organisation, d'unité réalisée pour le bien commun. Mais il a surtout, au suprême degré, le souci de la beauté de la forme et le désir de perfection; c'est là sa véritable noblesse et sa plus haute leçon : dans la symétrie souveraine des grandes odes, dans l'harmonie ineffable des strophes amoureuses, se détachent des vers d'une très pure harmonie, admirables de plénitude. Ses poèmes, publiés pour la plupart dans des recueils collectifs, ne furent réunis en volumes qu'après sa mort (les Oeuvres de François Malherbe, posthume, 1630).
Malherbe n'a pas composé d'art poétique, mais les traits essentiels de sa doctrine apparaissent dans ses poèmes et aussi dans son commentaire sévère mais détaillé des œuvres de Desportes. L'un de ses grands soucis est de réagir contre la surabondance et incohérence des images, défauts si fréquents au XVIe siècle. Lui use, et pour cause, d'un petit nombre de métaphores, qu'il suit consciencieusement jusqu'au bout dans une même strophe. Il est constamment guidé par la raison et la réflexion. Les comparaisons éclairant toujours l'idée sont plus expressives que brillantes; le plan est simple jusqu'à l'évidence. D'autre part, il sait accepter et même s'imposer avec joie une discipline cohérente : règles de la grammaire, usage reconnu des mots, genres littéraires, principes de versification - il les fixe lui-même si cela lui semble nécessaire.
"Enfin ma patience et les soins que j'ai pris"
Pour le comte de Charny, qui souhaitait en mariage Mademoiselle de Castille, qu'il épousa en 1620.
Enfin ma patience et les soins que j'ai pris
Ont, selon mes souhaits, adouci les esprits
Dont l'injuste rigueur si longtemps m'a fait plaindre.
Cessons de soupirer :
Grâce à mon destin, je n'ai plus rien à craindre,
Et puis tout espérer.
Soit qu'étant le soleil dont je suis enflammé
Le plus aimable objet qui jamais fut aimé,
On ne m'ait pu nier qu'il ne fut adorable,
Soit que d'un oppressé
Le droit bien reconnu soit toujours favorable,
Les Dieux m'ont exaucé.
Naguère que j'oyais la tempête souffler,
Que je voyais la vague en montagne s'enfler,
Et Neptune à mes cris faire la sourde oreille,
À-peu-près englouti,
Eussé-je osé prétendre à l'heureuse merveille
D'en être garanti ?
Contre mon jugement les orages cessés
Ont des calmes si doux en leur place laissés,
Qu'aujourd'hui ma fortune a l'empire de l'onde ;
Et je vois sur le bord
Un ange, dont la grâce est la gloire du monde,
Qui m'assure du port.
Certes c'est lâchement qu'un tas de médisants,
Imputant à l'Amour qu'il abuse nos ans,
De frivoles soupçons nos courages étonnent ;
Tous ceux à qui déplaît
L'agréable tourment que ses flammes nous donnent
Ne savent ce qu'il est.
S'il a de l'amertume à son commencement,
Pourvu qu'à mon exemple on souffre doucement,
Et qu'aux appas du change une âme ne s'envole,
On se peut assurer
Qu'il est maître équitable, et qu'enfin il console
Ceux qu'il a fait pleurer.
Malherbe fréquente les galeries du Louvre, l'Hôtel du Pré aux Clercs, les salons de Mme de Rambouillet et de Mme des Loges, se rend chez la Vicomtesse d'Aulchy, ou chez Madame de Thermes, où le mène son ami Racan, respectueux des pouvoirs et des croyances établis mais vivant en libertin. Mais surtout il se pose en chef d'école, rabrouant, tranchant, avec brutalité parfois, et sa poétique marque une profonde rupture avec la tradition de la Pléiade. Le voici s'attaquant de front à Philippe Desportes (1546-1606), poète respecté à la cour d'Henri III et disciple de Ronsard, qui publie en 1603 des Prières et méditations chrétienne....
L'épisode le plus significatif est connu : un jour, ayant accepté de dîner chez Desportes, il arrive en retard, quand le potage est déjà sur la table. Desportes, pour faire honneur à son hôte, n'en veut pas moins aller d'abord quérir, à son intention, un exemplaire de ses Poésies chrétiennes, qui viennent de paraître. Inutile, s'écrie Malherbe. Je les ai déjà lues; cela ne vaut pas que vous preniez la peine de remonter: votre potage vaut mieux que vos psaumes." Et il commence, tranquillement, à manger le potage. Mathurin Régnier, neveu du maître de la maison, était présent et saura venger son oncle dans sa fameuse satire à Rapin ("... Ils rampent bassement, faibles d'inventions, Et n'osent, peu hardis, tenter les fictions, Froids à l'imaginer : car s'ils font quelque chose, C'est proser de la rime et rimer de la prose, Que l'art lime et relime, et polit de façon Qu'elle rend à l'oreille un agréable son; Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase, Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrase, Affectent leur discours tout si relevé d'art, Et peignent leurs défauts de couleur et de fard..).
À la marquise de Rambouillet (1622)
Chère beauté que mon âme ravie
Comme son pôle va regardant,
Quel astre d'ire et d'envie
Quand vous naissiez marquait votre ascendant,
Que votre courage endurci,
Plus je le supplie, moins ait de merci ?
En tous climats, voire au fond de la Thrace,
Après les neiges et les glaçons,
Le beau temps reprend sa place,
Et les étés mûrissent les moissons :
Chaque saison y fait son cours ;
En vous seule on trouve qu'il gèle toujours.
J'ai beau me plaindre et vous conter mes peines,
Avec prières d'y compatir ;
J'ai beau m'épuiser les veines,
Et tout mon sang en larmes convertir ;
Un mal au deçà du trépas,
Tant soit-il extrême, ne vous émeut pas.
Je sais que c'est : vous êtes offensée,
Comme d'un crime hors de raison,
Que mon ardeur insensée
En trop haut lieu borne sa guérison ;
Et voudriez bien, pour la finir,
M'ôter l'espérance de rien obtenir.
Vous vous trompez : c'est aux faibles courages
Qui toujours portent la peur au sein
De succomber aux orages,
Et se lasser d'un pénible dessein.
De moi, plus je suis combattu,
Plus ma résistance montre sa vertu.
Loin de mon front soient ces palmes communes
Où tout le monde peut aspirer ;
Loin les vulgaires fortunes,
Où ce n'est qu'un, jouir et désirer.
Mon goût cherche l'empêchement ;
Quand j'aime sans peine, j'aime lâchement.
Je connais bien que dans ce labyrinthe
Le ciel injuste m'a réservé
Tout le fiel et tout l'absinthe
Dont un amant fut jamais abreuvé :
Mais je ne m'étonne de rien ;
Je suis à Rodanthe, je veux mourir sien.
Mais Malherbe s'est imposé et reçoit ses disciples favoris rue Croix-des-Petits-Champs et les oeuvres du maître sont publiées dans des recueils collectifs de 1607, 1609, 1615. Malherbe lance de perpétuels appels à la rigueur prosodique : le vocabulaire doit être pur de tout néologisme, de tout archaïsme, de toute ambiguïté – sa référence fameuse au langage des « crocheteurs du Port au Foin » signifie le choix de la langue de l'usage de la Cour et de la Ville ; la langue doit être claire et suivre fidèlement l'ordre de la génération des idées ; la versification doit obéir à des règles rigoureuses (il exclut l'hiatus, discipline la rime, fixe la césure). Et c'est ainsi que Malherbe atteint souvent (À la Reine mère du Roi, Consolation à Dupérier) à un mouvement ample, à une harmonie un peu oratoire, mais efficace...
La Vie de Malherbe écrite par Racan fourmille de détails sur l'attitude du poète au quotidien..
"Quand on lui demandait son avis de quelques vers français, il renvoyait ordinairement aux crocheteurs du port au foin, et disait que c'étaient ses maîtres pour le langage; ce qui peut-être a donné lieu à Régnier de dire : Comment ! il faudrait donc, pour faire une oeuvre grande, Qui de la calomnie et du temps se défende, Et qui nous donne rang parmi les bons auteurs, Parler comme à Saint-Jean parlent les crocheteurs!
Comme il récitait des vers à Racan, qu'il avait nouvellement faits, il lui en demanda son avis. Racan s'en excusa, disant qu'il ne les avait pas bien entendus, et qu'il en avait mangé la moitié. Malherbe, qui ne pouvait souffrir qu'on lui reprochât le défaut qu'il avait de bégayer, se sentant piqué des paroles de Racan, lui dit en colère : Morbleu! si vous me fâchez, je les mangerai tous; ils sont à moi, puisque je les ai faits; j'en puis faire ce que je voudrai.
Il ne voulait pas qu'on fit autrement des vers qu'en sa langue ordinaire; il soutenait que l'on ne saurait entendre la finesse des langues que l'on n'a apprises que par art; et, à ce propos, pour se moquer de ceux qui faisaient des vers latins, il disait que si Virgile et Horace revenaient au monde, ils donneraient le fouet à Bourbon et à Sirmond. Il disait souvent, et principalement quand on le reprenait de ne pas bien suivre, le sens des auteurs qu'il traduisait ou paraphrasait, qu'il n'apprêtait pas les viandes pour les cuisiniers : comme s'il eût voulu dire qu'il se souciait fort peu d'être loué des gens de lettres qui entendaient les livres qu'il avait traduits, pourvu qu'il le fût des gens de la cour; et c'était de cette même sorte que Racan se défendait de ses censures, en avouant qu'elles étaient fort justes; mais que les fautes dont il le reprenait n'étaient connues que de trois ou quatre personnes qui le hantaient, et qu'il faisait ses vers pour être lus dans le cabinet du roi et dans les ruelles, plutôt que dans sa chambre ou dans celle des autres savants en poésie.
Il avait pour ses écoliers les sieurs de Touvant, Coulomby, Maynard et Racan. Il jugeait d'eux fort diversement : il disait, en termes généraux, que Touvant faisait fort bien des vers, sans dire en quoi il excellait; que Coulomby avait bon esprit, mais qu'il n'avait point le génie à la poésie; que Maynard était celui de tous qui faisait les meilleurs vers, mais qu'il n'avait point de force; qu'il s'était adonné à un genre de poésie auquel il n'était pas propre, voulant parler de ses épigrammes, et qu'il ne réussirait pas, parce qu'il manquait de pointes. Pour Racan, qu'il avait de la force, mais qu'il ne travaillait pas assez ses vers; que le plus souvent, pour s'aider d'une bonne pensée, il prenait de trop grandes licences, et que de ces deux derniers on ferait un grand poète. Racan ayant dès sa plus tendre jeunesse fait connaissance avec Malherbe, il le respectait comme son père; et Malherbe, de son côté, vivait avec lui comme avec son fils; cela donna sujet à Racan, à son retour de Calais, où il fut porter les armes en sortant de page, de lui demander, en confidence, de quelle sorte il se devait gouverner dans le monde.
Il lui proposa quatre ou cinq sortes de vies qu'il pouvait faire. La première et la plus honorable était de suivre les armes; mais d'autant qu'il n'y avait point pour lors de guerre plus près qu'en Suède ou en Hongrie, il n'avait pas moyen de la chercher si loin, à moins que de vendre tout son bien pour s'équiper et pour fournir aux frais du voyage. La deuxième était de demeurer dans Paris, pour liquider ses affaires qui étaient fort brouillées; et celle-là lui plaisait le moins. La troisième était de se marier, dans l'espérance qu'il avait de trouver un bon parti, en vue de la succession de madame de Bellegarde, qui ne lui pouvait
manquer : sur quoi il disait que cette succession serait peut-être longue à venir, et que cependant, épousant une femme qui l'obligerait, il serait contraint d'en souffrir, en cas qu'elle fut de mauvaise humeur. Il proposait encore de se retirer aux champs; mais cela ne lui semblait pas séant à un homme de son âge et de sa condition. Sur toutes ces propositions faites par Racan, Malherbe, au lieu de répondre directement, commença par une fable..."
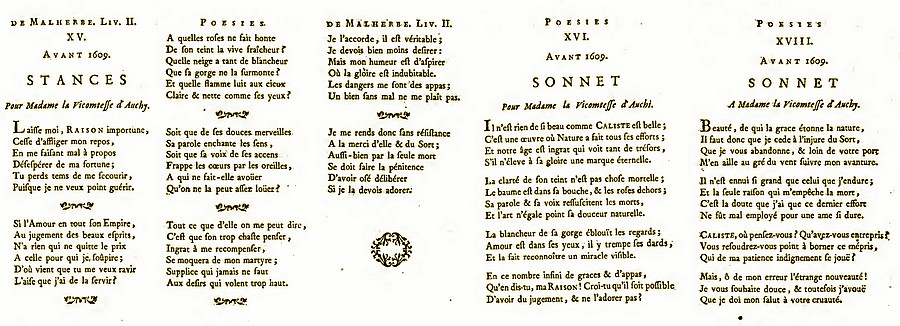
1608 - Charlotte Jouvenel des Ursins, vicomtesse d'Auchy (1570-1646), qui tint salon parisien rue des Vieux Augustins, vers 1605, et rival malheureux de celui de Madame de Rambouillet, fut la maîtresse de Malherbe : à plus de cinquante ans, il avait gardé "ces chaleurs de foie qu'ont les jeunes gens" et qu'il avait toujours "fort adonné aux femmes", tout en faisant d'un preuve d'un cynisme rare en la matière. Entre sa verve poétique et sensible et la réalité de ses sentiments, on devine à vrai dire indifférence et rusticité ...
"Il n'est rien de si beau ..."
Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle :
C'est une oeuvre où Nature a fait tous ses efforts :
Et notre âge est ingrat qui voit tant de trésors,
S'il n'élève à sa gloire une marque éternelle.
La clarté de son teint n'est pas chose mortelle :
Le baume est dans sa bouche, et les roses dehors :
Sa parole et sa voix ressuscitent les morts,
Et l'art n'égale point sa douceur naturelle.
La blancheur de sa gorge éblouit les regards :
Amour est en ses yeux, il y trempe ses dards,
Et la fait reconnaître un miracle visible.
En ce nombre infini de grâces, et d'appas,
Qu'en dis-tu ma raison ? crois-tu qu'il soit possible
D'avoir du jugement, et ne l'adorer pas ?
"Sur l'absence de la vicomtesse d'Auchy" (1608)
Quel astre malheureux ma fortune a bastie ?
À quelles dures loix m’a le Ciel attaché,
Que l’extréme regret ne m’ait point empeschê
De me laisser résoudre à ceste départie ?
Quelle sorte d’ennuis fut jamais ressentie
Egale au déplaisir dont j’ay l’esprit touché ?
Qui vit jamais coupable expier son peché
D’une douleur si forte et si peu divertie ?
On doute en quelle part est le funeste lieu
Que reserve aux damnés la justice de Dieu,
Et de beaucoup d’avis la dispute en est plaine.
Mais, sans estre savant et sans philosofer,
Amour en soit loiié, je n’en suis point en peine :
Où Caliste n’est point, c’est là qu’est mon enfer.
"Beauté de qui la grâce.." (À la vicomtesse d'Auchy) 1608.
Beauté de qui la grâce étonne la nature,
Il faut donc que je cède à l'injure du sort,
Que je vous abandonne, et loin de votre port
M'en aille au gré du vent suivre mon aventure.
Il n'est ennui si grand que celui que j'endure :
Et la seule raison qui m'empêche la mort,
C'est le doute que j'ai que ce dernier effort
Ne fût mal employé pour une âme si dure.
Caliste, où pensez-vous ? qu'avez-vous entrepris ?
Vous résoudrez-vous point à borner ce mépris,
Qui de ma patience indignement se joue ?
Mais, ô de mon erreur l'étrange nouveauté,
Je vous souhaite douce, et toutefois j'avoue
Que je dois mon salut à votre cruauté.
"Caliste, en cet exil j'ai l'âme.. "(À la vicomtesse d'Auchy) - 1608.
Caliste, en cet exil j'ai l'âme si gênée,
Qu'au tourment que je souffre il n'est rien de pareil ;
Et ne saurais ouïr ni raison ni conseil,
Tant je suis dépité contre ma destinée.
J'ai beau voir commencer et finir la journée,
En quelque part des cieux que luise le soleil ;
Si le plaisir me fuit, aussi fait le sommeil,
Et la douleur que j'ai n'est jamais terminée.
Toute la cour fait cas du séjour où je suis,
Et, pour y prendre goût, je fais ce que je puis ;
Mais j'y deviens plus sec plus j'y vois de verdure.
En ce piteux état si j'ai du réconfort,
C'est, ô rare beauté, que vous êtes si dure,
Qu'autant près comme loin je n'attends que la mort.
"Beauté, mon cher souci.."
Beauté, mon cher souci, de qui l'âme incertaine
A, comme l'Océan, son flux et son reflux,
Pensez de vous résoudre à soulager ma peine,
Ou je me résoudrai à ne la souffrir plus.
Vos yeux ont des appas que j'aime et que je prise,
Et qui peuvent beaucoup dessus ma liberté,
Mais pour me retenir, s'ils font cas de ma prise,
Il leur faut de l'amour autant que de beauté.
Quand je pense être au point que cela s'accomplisse,
Quelque excuse toujours en empêche l'effet ;
C'est la toile sans fin de la femme d'Ulysse,
Dont l'ouvrage du soir au matin se défait.
Madame, avisez-y, vous perdez votre gloire
De me l'avoir promis et vous rire de moi.
S'il ne vous en souvient, vous manquez de mémoire ;
Ou s'il vous en souvient, vous n'avez point de foi.
J'avais toujours fait compte, aimant chose si haute,
De ne m'en séparer qu'avec le trépas ;
S'il arrive autrement, ce sera votre faute,
De faire des serments et ne les tenir pas.




En 1610, à la mort de Henri IV, Marie de Médicis assure la régence au nom de son fils, Louis XIII, jusqu'au 28 septembre 1614, et c'est à cette époque que Malherbe connaît ses heures de gloire. Son "Ode sur les heureux succès de la Régence" à la gloire de la reine lui vaut pension et inspirera le peintre Pierre Paul Rubens (1577-1640). Marie de Médicis commandera en 1621 à ce dernier, pour les galeries du palais du Luxembourg, deux cycles narrant sa vie et celle d’Henri IV, son défunt mari. Marie de Médicis a toujours pris grand soin de façonner son image pour légitimer sa position politique. Le portraitiste anversois Frans II Pourbus dit le Jeune (1569-1622), peintre en 1600 à la cour du duc de Mantoue, et qui suivit ce dernier à Turin et en Lorraine, puis à Paris, est de ceux qui vont participer à la mise en image de Marie de Médicis, avec Pierre-Paul Rubens (1611, Pourbus, Frans the Younger, Portrait of Marie de Médicis, Galleria degli Uffizi, Florence - 1610, Pierre-Paul Rubens, Le cardinal de Joyeuse couronne Marie de Médicis)
1616, Ode, "A la reine mère du roi, sur les heureux succès de sa régence"
NYMPHE qui jamais ne sommeilles,
Et dont les messagers divers
En un moment sont aux oreilles
Des peuples de tout l'univers;
Vole vite, et de la contrée
Par où le jour fait son entrée
Jusqu'au rivage de Calis,
Conte sur la terre et sur l'onde,
Que l'honneur unique du monde.
C'est la Reine des fleurs de lis.
Quand son Henri, de qui la gloire
Fut une merveille à nos yeux.
Loin des hommes s'en alla boire
Le nectar avecque les Dieux,
En celte aventure effroyable
A qui ne semhloit-il croyable
Qu'on allait voir une saison,
Où nos brutales perfidies
Perdent naître des maladies
Qui n'auraient jamais guérison ?
Qui ne pensoit que les Furies
Viendraient des abîmes d'enfer.
En de nouvelles barbaries
Employer la flamme et le fer ?
Qu'un débordement de licence
Feroit souffrir à l'innocence
Toute sorte de cruautés?
Et que nos malheurs seraient pires
Que naguères sous les Busires
Que cet Hercule avoit domptés?
Toutefois depuis l'infortune
De cet abominable jour,
A peine la quatrième lune
Achève de faire son tour;
Et la France a les destinées
Pour elle tellement tournées
Contre les vents séditieux,
Qu'au lieu de craindre la tempête.
Il semble que jamais sa tête
Ne fut plus voisine des deux.
Au delà des bords de la Meuse
L'Allemagne a vu nos guerriers.
Par une conquête fameuse
Se couvrir le front de lauriers.
Tout a fléchi sous leur menace;
L'Aigle même leur a fait place;
Et les regardant approcher
Comme lions à qui tout cède.
N'a point eu de meilleur remède.
Que de fuir, et se cacher.
O Reine, qui pleine de charmes
Pour toute sorte d'accidents.
As borné le flux de nos larmes
1611 - Objet divin des âmes et des yeux, "A la reine mère du roi pendant sa régence"
Objet divin des âmes et des yeux,
Reine, le chef-d'oeuvre des cieux :
Quels doctes vers me feront avouer
Digne de te louer ?
Les monts fameux des vierges, que je sers
Ont-ils des fleurs en leurs déserts,
Qui s'efforçant d'embellir ta couleur,
Ne ternissent la leur ?
Le Thermodon a su seoir autrefois,
Des reines au trône des rois :
Mais que vit-il par qui soit débattu
Le prix à ta vertu ?
Certes nos lis, quoique bien cultivés,
Ne s'étaient jamais élevés
Au point heureux où les destins amis
Sous ta main les ont mis.
A leur odeur l'Anglais se relâchant,
Notre amitié va recherchant :
Et l'Espagnol, prodige merveilleux,
Cesse d'être orgueilleux.
De tous côtés nous regorgeons de biens :
Et qui voit l'aise où tu nous tiens,
De ce vieux siècle aux fables récité
Voit la félicité.
Quelque discord murmurant bassement
Nous fit peur au commencement :
Mais sans effet presque il s'évanouit,
Plutôt qu'on ne l'ouït.
Tu menaças l'orage paraissant :
Et tout soudain obéissant,
Il disparut comme flots courroucés,
Que Neptune a tancés.
Que puisses-tu, grand Soleil de nos jours,
Faire sans fin le même cours :
Le soin du Ciel te gardant aussi bien,
Que nous garde le tien.
Puisses-tu voir sous le bras de ton fils
Trébucher les murs de Memphis :
Et de Marseille au rivage de Tyr
Son empire aboutir.
Les voeux sont grands : mais avecque raison
Que ne peut l'ardente oraison :
Et sans flatter ne sers-tu pas les dieux,
Assez pour avoir mieux ?
À la Reine Marie de Médicis, Sur la mort de Mgr. le duc d'Orléans, son second fils (1611)
Consolez-vous, madame ; apaisez votre plainte :
La France, à qui vos yeux tiennent lieu de soleil,
Ne dormira jamais d'un paisible sommeil,
Tant que sur votre front la douleur sera peinte.
Rendez-vous à vous-même, assurez votre crainte,
Et de votre vertu recevez ce conseil,
Que souffrir sans murmure est le seul appareil
Qui peut guérir l'ennui dont vous êtes atteinte.
Le ciel, en qui votre âme a borné ses amours,
Etait bien obligé de vous donner des jours
Qui fussent sans orage et qui n'eussent point d'ombre ;
Mais ayant de vos fils les grands cœurs découverts,
N'a-t-il pas moins failli d'en ôter un du nombre,
Que d'en partager trois en un seul univers ?
En 1614, ce sont les débuts du règne personnel de Louis XIII mais aussi d'un relatif déclin de Malherbe, enfermé dans le système poétique qu'il a lui-même conçu. Il atteint soixante ans, la Cour s'éloigne de lui et sa situation financière devient quelque peu compliquée. Il publie tout de même en 1614 une longue épître de consolation à la princesse de Conti, se livre à des travaux érudits, donne, en 1616 et 1621, une traduction d'un fragment de Tite-Live, entreprend de traduire "Rodanthé et Dosiclès" du byzantin Théodore Prodomos (XIIe), "Argenis", ouvrage en vogue de l'anglais John Barclay (XVIIe).
En 1624, Richelieu est appelé pour la seconde fois au pouvoir et commence à prendre d'une façon à peu près absolue le gouvernement de l'État. Malherbe écrit à Racan: "Vous savez que mon humeur n'est ni de flatter, ni de mentir, mais je vous jure qu'il y a en cet homme quelque chose qui excède l'humanité, et que si notre vaisseau doit jamais vaincre la tempête, ce sera tandis que cette glorieuse main tiendra le gouvernail. Les autres pilotes peuvent me diminuer la peur, celui-ci me la fait ignorer." Malherbe a soixante et onze ans, délivré de tout souci matériel par une charge de Trésorier de Provence, écrit ses sonnets à Richelieu et à Louis XIII, et en 1626, la Paraphrase du Psaume CXLV...
À M. Le cardinal de Richelieu - Sonnet. 1624.
À ce coup nos frayeurs n'auront plus de raison,
Grande âme aux grands travaux sans repos adonnée
Puisque par vos conseils la France est gouvernée,
Tout ce qui la travaille aura sa guérison.
Tel que fut rajeuni le vieil âge d'Eson,
Telle cette princesse en vos mains résignée
Vaincra de ses destins la rigueur obstinée,
Et reprendra le teint de sa verte saison.
Le bon sens de mon roi m'a toujours fait prédire
Que les fruits de la paix combleraient son empire,
Et comme un demi-dieu le feraient adorer :
Mais voyant que le vôtre aujourd'hui le seconde,
Je ne lui promets pas ce qu'il doit espérer,
Si je ne lui promets la conquête du monde.
Pour M. le Cardinal de Richelieu
Peuples, Çà de l'encens ; peuples, çà des victimes
A ce grand cardinal grand chef-d'œuvre des cieux,
Qui n'a plus que la gloire, et n'est ambitieux
Que de faire mourir l'insolence des crimes.
A quoi sont employés tant de soins magnanimes
Où son esprit travaille et fait veiller ses yeux,
Qu'à tromper les complots de nos séditieux,
Et soumettre sa rage aux pouvoirs légitimes ?
Le mérite d'un homme, ou savant, ou guerrier,
Trouve sa récompense aux chapeaux de laurier,
Dont la vanité grecque a donné les exemples ;
Le sien, je l'ose dire, est si grand et si haut,
Que si, comme nos dieux, il n'a place en nos temples,
Tout ce qu'on lui peut faire est moins qu'il ne lui faut.
Les dernières années de Malherbe seront assombries par les incartades de son fils Marc-Antoine qui, ayant tué en duel son adversaire en 1624, sera condamné à mort puis, gracié, et périra par la suite dans un nouveau duel. Son père ne parviendra pas à faire exécuter la sentence condamnant son meurtrier. Malherbe le reprochera au roi dans sa Paraphrase du
psaume CXLV...
1627 - Paraphrase du Psaume CXLV
Inspiré des trois premiers versets du célèbre Psaume. Vanité des choses humaines, impuissance de tous les hommes, même les plus grands, devant la mort, tels sont les sentiments qui dominent cette page. Les images sont plus expressives que rares, mais les mots précis et forts prennent un relief saisissant grâce aux oppositions, au mouvement de la phrase, au rythme du vers, donnant à l'ensemble puissance et profondeur...
"N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde;
Sa lumière est un verre, et sa faveur une onde
Que toujours quelque vent empêche de calmer;
Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre :
C 'est Dieu qui nous fait vivre,
C'est Dieu qu'il faut aimer.
En vain, pour satisfaire à nos lâches envies,
Nous passons près des rois tout le temps de nos vies,
A souffrir des mépris, et ployer les genoux;
Ce qu'ils peuvent n'est rien; ils sont comme nous sommes,
Véritablement hommes,
Et meurent comme nous.
Ont-ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière
Que cette majesté si pompeuse et si fière,
Dont l'éclat orgueilleux étonnait l'univers;
Et dans ces grands tombeaux, où leurs âmes hautaínes
Font encore les vaines,
Ils sont mangés des vers.
Là se perdent ces noms de maîtres de la terre,
D'arbitres de la paix, de foudres de la guerre :
Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs,
Et tombent avec eux, d'une chute commune,
Tous ceux que leur fortune
Faisait leurs serviteurs."
Malherbe donne sa dernière oeuvre, l' "Ode à Louis XIII allant châtier la rébellion des Rochellois" ("Donc un nouveau labeur à tes armes s'apprête; Prends ta foudre, Louis et va comme un lion Donner le dernier coup à la dernière tête De la rébellion..") et meurt d'épuisement le 6 octobre 1628, douze jours avant la reddition de la place...
"Sur la Mort de son Fils"
Que mon fils ait perdu mortelle,
Ce fils qui fut si brave, et que j'aimai si fort,
Je ne l'impute point à l'injure du sort,
Puisque finir à l'homme est chose naturelle.
Mais que de deux marauds la surprise infidèle
Ait terminé ses jours d'une tragique mort,
En cela ma douleur n'a point de réconfort,
Et tous mes sentiments sont d'accord avec elle.
O mon Dieu, mon Sauveur, puisque, par la raison,
Le trouble de mon âme étant sans guérison,
Le voeu de la vengeance est un voeu légitime,
Fais que de ton appui je sois fortifié;
Ta justice t'en prie, et les auteurs du crime
Sont fils de ces bourreaux qui t'ont crucifié.
Ce n'est donc pas par le sens de la mesure ni par la discrétion des moyens qu'il s'est imposé. C'est par un sentiment singulier de l'équilibre des formes et une exigence de netteté poussés à l'extrême. Il construit ses phrases et ses strophes avec une rigueur inconnue avant lui. La combinaison des mètres et des rimes n'est pas pour lui un problème accessoire de l'art poétique, elle n'est pas davantage un jeu gratuit. Elle lui fournit le moyen d'affirmer sa pensée avec plus de force. C'est pour la même raison qu'il attache tant d'importance à la langue. Moderne, il écarte les mots et les tours qui, dans la poésie antérieure, ont vieilli. Il n'admet pas qu'une expression soit légitime pour cette seule raison qu'elle nous vient des Grecs et des Latins, mais la langue de la belle société, celle des salons, celle de Mme de Rambouillet. Cette doctrine très simple s'impose. Malherbe vit encore lorsqu'il est considéré comme le maître de la nouvelle poésie et de la langue française. Chapelain, Guez de Balzac, Vaugelas n'ont pas d'autre doctrine que la sienne. L'Académie française, fondée six ans après sa mort, a d'abord été le rassemblement de ses disciples...
ODE POUR LE ROY [LOUIS XIII] allant chastier la rebellion des rochelois et chasser les anglois qui, en leur faveur, estoient descendus en l’isle de ré - 1628...
Donc un nouveau labeur à tes armes s’appreste ;
Pren ta foudre, Loüis, et va, comm’ un lion,
Donner le dernier coup à la derniere teste
De la rebellion.
Fay choir en sacrifice au demon de la France
Les fronts trop élevez de ces ames d’enfer,
Et n’épargne contre eux, pour notre delivrance,
Ny le feu ny le fer.
Assez de leurs complots l’infidelle malice
A nourry le desordre et la sedition ;
Quitte le nom de Juste, ou fay voir ta justice
En leur punition.
Le centiéme decembre a les plaines ternies,
Et le centiéme avril les a peintes de fleurs,
Depuis que parmi nous leurs brutales manies
Ne causent que des pleurs.
Dans toutes les fureurs des siecles de tes peres,
Les monstres les plus noirs firent-ils jamais rien
Que l’inhumanité de ces coeurs de viperes
Ne renouvelle au tien ?
Par qui sont aujourd’huy tant de villes desertes,
Tant de grands bastimens en masures changez,
Et de tant de chardons les campagnes couvertes,
Que par ces enragez ?
Les sceptres devant eux n’ont point de privileges,
Les immortels eux-mesme en sont persecutez ;
Et c’est aux plus saints lieux que leurs mains sacrileges
Font plus d’impietez.
Marche, va les détruire, éteins-en la semence,
Et suy jusqu’à leur fin ton courroux genereux,
Sans jamais écouter ny pitié ny clemence
Qui te parle pour eux.
Ils ont beau vers le ciel leurs murailles accroistre,
Beau d’un soin assidu travailler à leurs forts,
Et creuser leurs fossez jusqu’à faire paroistre
Le jour entre les morts.
Laisse-les esperer, laisse-les entreprendre :
Il suffit que ta cause est la cause de Dieu,
Et qu’avecque ton bras ell’ a pour la deffendre
Les soings de Richelieu :
Richelieu, ce prelat de qui toute l’envie
Est de voir ta grandeur aux Indes se borner.
Et qui visiblement ne fait cas de sa vie
Que pour te la donner.
Rien que ton interest n’occupe sa pensée,
Nuls divertissemens ne l’appellent ailleurs ;
Et, de quelques bons yeux qu’on ait vanté Lyncée,
Il en a de meilleurs.
Son ame, toute grande, est une ame hardie,
Qui pratique si bien l’art de nous secourir
Que, pourveu qu’il soit creu, nous n’avons maladie
Qu’il ne sçache guerir.
Le Ciel, qui doit le bien selon qu’on le merite,
Si de ce grand oracle il ne t’eust assisté,
Par un autre present n’eust jamais esté quitte
Envers ta pieté.
Va, ne differe plus tes bonnes destinées ;
Mon Apollon t’asseure et t’engage sa foy
Qu’employant ce Typhis, syrtes et cyanées
Seront havres pour toy.
Certes, ou je me trompe, ou déja la Victoire
Qui son plus grand honneur de tes palmes attent,
Est aux bords de Charente en son habit de gloire,
Pour te rendre content.
Je la voy qui t’appelle, et qui semble te dire :
« Roy, le plus grand des rois, et qui m’es le plus cher,
Si tu veux que je t’aide à sauver ton empire,
Il est temps de marcher. »
Que sa façon est brave et sa mine asseurée !
Qu’elle a fait richement son armure étoffer !
Et qu’il se cognoist bien, à la voir si parée,
Que tu vas triompher !
Telle, en ce grand assaut où des fils de la Terre
La rage ambitieuse à leur honte parut,
Elle sauva, le ciel, et rua le tonnerre
Dont Briare mourut.
Déja de tous costez s’avançoient les approches ;
Icy courait Mimas, là Typhon se battoit,
Et là suoit Euryte à détacher les roches
Qu’Encelade jettoit.
A peine cette vierge eut l’affaire embrassée.
Qu’aussi-tost Jupiter, en son trosne remis,
Vit, selon son desir, la tempeste cessée,
Et n’eut plus d’ennemis.
Ces colosses d’orgueil furent tous mis en poudre,
Et tous couverts des monts qu’ils avoient arrachez ;
Phlegre, qui les receut, pût encore la foudre
Dont ils furent touchez.
L’exemple de leur race, à jamais abolie,
Devoit sous ta mercy tes rebelles ployer ;
Mais seroit-ce raison qu’une mesme folie
N’eust pas mesme loyer ?
Déja l’étonnement leur fait la couleur blesme,
Et ce lasche voisin qu’ils sont allé querir,
Miserable qu’il est, se condamne luy-mesme
A fuïr ou mourir.
Sa faute le remord : Megere le regarde,
Et luy porte l’esprit à ce vray sentiment,
Que d’une injuste offense il aura, quoy qu’il tarde,
Le juste chastiment.
Bien semble estre la mer une barre assez forte
Pour nous oster l’espoir qu’il puisse estre battu ;
Mais est-il rien de clos dont ne t’ouvre la porte
Ton heur et ta vertu ?
Neptune, importuné de ses voiles infames,
Comme tu paroistras au passage des flots,
Voudra que ses Tritons mettent la main aux rames,
Et soient tes matelots.
Là rendront tes guerriers tant de sortes de preuves,
Et d’une telle ardeur pousseront leurs efforts,
Que le sang estranger fera monter nos fleuves
Au-dessus de leurs bords.
Par cet exploit fatal en tous lieux va renaistre
La bonne opinion des courages françois ;
Et le monde croira, s’il doit avoir un maistre,
Qu’il faut que tu le sois.
Ô que, pour avoir part en si belle avanture,
Je me souhaiterais la fortune d’Eson,
Qui, vieil comme je suis, revint contre nature
En sa jeune saison !
De quel peril extreme est la guerre suivie,
Où je ne fisse voir que tout l’or du Levant
N’a rien que je compare aux honneurs d’une vie
Perdue en te servant ?
Toutes les autres morts n’ont merite ny marque :
Celle-ci porte seule un éclat radieux
Qui fait revivre l’homme, et le met de la barque
A la table des dieux.
Mais quoy ! tous les pensers dont les ames bien nées
Excitent leur valeur et flattent leur devoir,
Que sont-ce que regrets, quand le nombre d’années
Leur oste le pouvoir ?
Ceux à qui la chaleur ne bout plus dans les veines
En vain dans les combats ont des soins diligens ;
Mars est comme l’Amour : ses travaux et ses peines
Veulent de jeunes gens.
Je suis vaincu du temps, je cede à ses outrages ;
Mon esprit seulement, exempt de sa rigueur,
A de quoy témoigner en ses derniers ouvrages
Sa premiere vigueur.
Les puissantes faveurs dont Parnasse m’honore
Non loin de mon berceau commencerent leur cours ;
Je les posseday jeune, et les possede encore
A la fin de mes jours.
Ce que j’en ay receu, je veux te le produire ;
Tu verras mon adresse, et ton front, cette fois,
Sera ceint de rayons qu’on ne vit jamais luire
Sur la teste des rois.
Soit que de tes lauriers ma lyre s’entretienne,
Soit que de tes bontez je la face parler,
Quel rival assez vain pretendra que la sienne
Ait de quoy m’égaler ?
Le fameux Amphion, dont la voix nompareille,
Bastissant une ville, étonna l’univers,
Quelque bruit qu’il ait eu, n’a point fait de merveille
Que ne facent mes vers.
Par eux de tes beaux faits la terre sera pleine,
Et les peuples du Nil, qui les auront ouïs,
Donneront de l’encens, comme ceux de la Seine,
Aux autels de Louis.
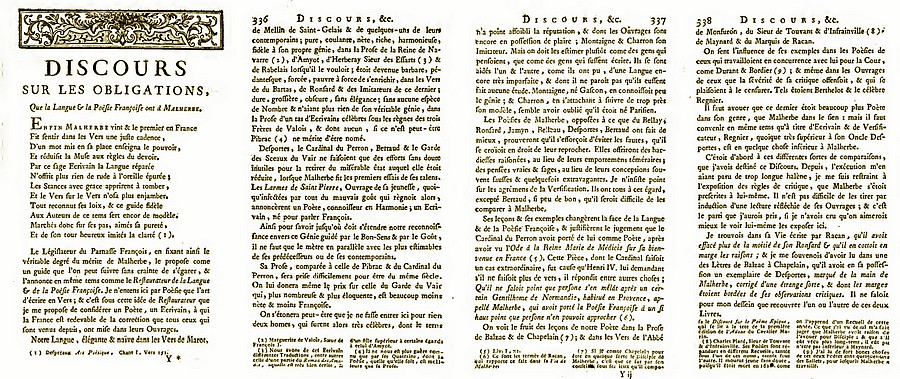

Mathurin Régnier (1573-1613)
Né à Chartres où son père tenait un jeu de paume, on découvre Mathurin Régnier tout d'abord au temps de Malherbe comme un poète satiriste et neveu du poète Desportes. Contre Malherbe, à qui il reproche son attitude à propos des Psaumes de son oncle, Régnier laisse "aller sa plume où se verve l'emporte", se créant une langue qui lui est propre. Latiniste cultivé, ayant lu Rabelais, Marot, plus que Ronsard, Montaigne, les poètes de la Pléiade, il entre en 1587, à quatorze ans, au service du cardinal François de Joyeuse. Regagnant la France, il rencontre Philippe de Béthune, ambassadeur d'Henri IV, avec lequel il repart en Italie. En 1606, la mort de son oncle Philippe Desportes, que Malherbe a tant combattu, Régnier devient chanoine de Chartres, charge qu'il échange contre d'autres bénéfices et s'empresse de mener joyeuse vie à Paris en compagnie de libertins comme Motin, le marquis de Cœuvres, Philippe Hurault de Chiverny, évêque de Chartres. Son oeuvre est peu abondante : quelques épîtres, élégies, odes, épigrammes; mais ses seize satires, imité de l'Italien Berni et des latins Horace et Juvénal, restent très vivantes par la vérité intense de l'observation de la petite société de Paris sous le règne d'Henri IV, l'originalité des idées, la verve et la fantaisie du conteur. En 1608 paraissent diverses Poésies, son "Discours au Roi" et dix premières "Satires", rééditées un an plus tard, avec l`adjonction du Souper ridicule et du Mauvais Gîte.
C'est ainsi qu'en 1608, il s'impose comme le poète officiel de la cour, en composant des Elégies amoureuses pour Henri IV (1608), en célébrant en 1610 l`entrée solennelle de Marie de Médicis à Paris, ou en écrivant pour le jeune Louis Xlll, "l'Hymne sur la Nativité de Notre Seigneur". Mais il meurt en 1613....
"Stances"
Quand sur moi je jette les yeux,
À trente ans me voyant tout vieux,
Mon cœur de frayeur diminue ;
Étant vieilli dans un moment,
Je ne puis dire seulement
Que ma jeunesse est devenue.
Du berceau courant au cercueil,
Le jour se dérobe à mon œil,
Mes sens troublés s’évanouissent.
Les hommes sont comme des fleurs,
Qui naissent et vivent en pleurs,
Et d’heure en heure se fanissent.
Leur âge, à l’instant écoulé,
Comme un trait qui s’est envolé,
Ne laisse après soi nulle marque ;
Et leur nom, si fameux ici,
Si-tôt qu’ils sont morts, meurt aussi,
Du pauvre autant que du monarque.
Naguère vert, sain et puissant,
Comme un aubépin florissant,
Mon printemps était délectable.
Les plaisirs logeaient en mon sein ;
Et lors était tout mon dessein
Du jeu d’amour et de la table.
Mais, las ! mon sort est bien tourné ;
Mon âge en un rien s’est borné ;
Faible languit mon espérance ;
En une nuit, à mon malheur,
De la joie et de la douleur
J’ai bien appris la différence !
La douleur aux traits vénéneux.
Comme d'un habit épineux,
Me ceint d'une horrible torture;
Mes beaux jours sont changés en nuits.
Et mon cœur, tout flétri d'ennuis,
N'attend plus que la sépulture.
Enivré de cent maux divers.
Je chancelle, et vais de travers,
Tant mon âme en regorge pleine ;
J'en ai l'esprit tout hébété.
Et si peu qui m'en est resté,
Encor me fait-il de la peine.
La mémoire du temps passé.
Que j'ai follement dépensé,
Epand du fiel en mes ulcères ;
Si peu que j'ai de jugement
Semble animer mon sentiment
Me rendant plus vif mes misères.
Ha ! pitoyable souvenir !
Enfin, que dois-je devenir ?
Où se réduira ma constance ?
Étant jà défailli de cœur,
Qui me don'ra de la vigueur
Pour durer en la pénitence ?
Qu'est-ce de moi ? faible est ma main;
Mon courage, hélas ! est humain;
Je ne suis de fer ni de pierre.
En mes maux montre-toi plus doux,
Seigneur ; aux traits de ton courroux,
Je suis plus fragile que verre.
Je ne suis a tes yeux, sinon
Qu'un fétu sans force et sans nom,
Qu'un hibou qui n'ose paraître,
Qu'un fantôme ici-bas errant,
Qu'une orde écume de torrent.
Qui semble fondre avant que naître :
Où toi, tu peux faire trembler
L'univers, et désassembler
Du firmament le riche ouvrage,
Tarir les flots audacieux.
Ou, les élevant jusqu'aux cieux.
Faire de la terre un naufrage.
Le soleil fléchit devant toi;
De toi les astres prennent loi;
Tout fait joug dessous ta parole;
Et cependant tu vas dardant
Dessus moi ton courroux ardent,
Qui ne suis qu'un bourrier qui vole.
Mais quoi ! si je suis imparfait,
Pour me défaire m'as-tu fait ?
Ne sois aux pécheurs si sévère :
Je suis homme, et toi Dieu clément !
Sois donc plus doux au châtiment.
Et punis les tiens comme père.
J'ai l'œil scellé d'un sceau de fer;
Et déjà les portes d'enfer
Semblent s'entr'ouvrir pour me prendre ;
Mais encore, par ta bonté,
Si tu m'as ôté la santé,
O Seigneur ! tu me la peux rendre.
Le tronc de branches dévêtu,
Par une secrète vertu
Se rendant fertile en sa perte,
De rejetons espère un jour
Ombrager les lieux d'alentour
Reprenant sa perruque verte :
Où l'homme, en la fosse couché,
Après que la mort l'a touché.
Le cœur est mort comme l'écorce.
Encor l'eau reverdit le bois;
Mais l'homme étant mort une fois.
Les pleurs, pour lui, n'ont plus de force.
Satire II - Dans cette satire, la plus ancienne de Régnier qui la composa à l'âge de vingt-six ans, l'auteur fait une peinture pittoresque et mordante des poètes misérables et sottement vaniteux qui ont perverti le bel art de Ronsard et de Desportes : il décrit leurs attitudes et imite leurs déclarations prétentieuses tout en exprimant une philosophie un peu désabusée...
"Or, laissant tout ceci, retourne à nos moutons,
Muse, et sans varier dis-nous quelques sornettes
De tes enfants bâtards, ces tiercelets de poètes,
Qui par les carrefours vont leurs vers grimaçants,
Qui par leurs actions font rire les passants,
Et quand la faim les point, se prenant sur le vôtre,
Comme les étourneaux ils s'affament l'un l'autre.
Cependant sans souliers, ceinture, ni cordon,
L'œil farouche et troublé, l'esprit à l'abandon,
Vous viennent accoster comme personnes ivres,
Et disent pour bonjour : "Monsieur, je fais des livres;
On les vend au Palais, et les doctes du temps,
A les lire amusés, n'ont d'autre passe-temps."
De là, sans vous laisser, importuns ils vous suivent,
Vous alourdent de vers, d'allégresse vous privent,
Vous parlent de fortune, et qu'il faut acquérir
Du crédit, de l'honneur, avant que de mourir;
Mais que, pour leur respect, l'ingrat siècle où nous sommes
Au prix de la vertu n'estime point les hommes;
Que Ronsard, Du Bellay, vivants ont eu du bien,
Et que c'est honte au roi de ne leur donner rien.
Puis, sans qu 'on les convie, ainsi que vénérables,
S'asseyent en prélats les premiers à vos tables,
Où le caquet leur manque, et, des dents discourant,
Semblent avoir des yeux regret au demeurant.
Or, la table levée, ils curent la mâchoire.
Après grâces-Dieu but, ils demandent à boire,
Vous font un sot discours, puis, au partir de là,
Vous disent : "Mais, monsieur, me donnez-vous cela?"
C'est toujours le refrain qu'ils font à leur ballade.
Pour moi, je n'en vois point que je n'en sois malade ;
J'en perds le sentiment, du corps tout mutilé,
Et durant quelques jours j'en demeure opilé.
Un autre, renfrogné, rêveur, mélancolique,
Grimaçant son discours, semble avoir la colique ;
Suant, crachant, toussant, pensant venir au point,
Parle si finement que l'on ne l'entend point.
Un autre, ambitieux, pour les vers qu'il compose,
Quelque bon bénéfice en l'esprit se propose ;
Et dessus un cheval comme un singe attaché,
Méditant un sonnet, médite un évêché.
Si quelqu'un, comme moi, leurs ouvrages n'estime,
Il est lourd, ignorant, il n'aime point la rime,
Diíficile, hargneux, de leur vertu jaloux,
Contraire en jugement au commun bruit de tous ;
Que leur gloire il dérobe avec ses artifices.
Les dames cependant se fondent en délices
Lisant leurs beaux écrits et de jour et de nuit,
Les ont au cabinet, sous le chevet du lit ;
Que portés à l'église ils valent des matines,
Tant, selon leurs discours, leurs œuvres sont divines.
Encore après cela ils sont enfants des cieux ;
Ils font journellement carousse avec les dieux :
Compagnons de Minerve, et confits en science,
Un chacun d'eux pense être une lumière en France."
Contre Malherbe et ses disciples, Régnier invoque le "naturel" et l'inspiration (Satire IX), "J'ai vécu, écrira-t-il, sans nul pensement, Me laissant aller doucement A la bonne loi naturelle" ...
"Cependant leur savoir ne s'étend seulement
Qu'à regratter un mot douteux au jugement,
Prendre garde qu'un qui ne heurte une diphtongue
Épier si des vers la rime est brève ou longue,
Ou bien si la voyelle à l'autre s'unissant,
Ne rend point à l'oreille un son trop languissant,
Et laissent sur le vert le noble de l'ouvrage.
Nul aiguillon divin n'élève leur courage;
Ils rampent bassement, faibles d'inventions,
Et n'osent, peu hardis, tenter les fictions,
Froids à l'imaginer : car, s'ils font quelque chose,
C'est proser de la rime et rimer de la prose,
Que l'art lime et relime, et polit de façon
Qu'elle rend à l'oreille un agréable son ;
Et voyant qu'un beau feu leur cervelle n'embrase,
Ils attífent leurs mots, enjolivent leur phrase,
Affectent leur discours tout si relevé d'art,
Et peignent leurs défauts de couleur et de fard.
Aussi je les compare à ces femmes jolies
Qui par les affiquets se rendent embellies,
Qui, gentes en habits et sades en façons,
Parmi leur point coupé tendent leurs hameçons,
Dont l'oeil rit mollement avec afféterie,
Et de qui le parler n'est rien que flatterie ;
De rubans piolés s'agencent proprement “,
Et toute leur beauté ne gît qu'en l'ornement;
Leur visage reluit de céruse et de peautre ;
Propres en leur coiffure, un poil ne passe l'autre.
Où ces divins esprits, hautains et relevés,
Qui des eaux d'Hélicon ont les sens abreuvés,
De verve et de fureur leur ouvrage étincelle,
De leurs vers tout divins la grâce est naturelle,
Et sont, comme l'on voit, la parfaite beauté,
Qui, contente de soi, laisse la nouveauté
Que l'art trouve au Palais ou dans le blanc d'Espagne.
Rien que le naturel sa grâce n'accompagne ;
Son front, lavé d'eau claire, éclate d'un beau teint ;
De roses et de lys la nature la peint;
Et, laissant là Mercure et toutes ses malices,
Les nonchalances sont ses plus grands artifices.
Or, Rapin, quant à moi, je n'ai point tant d'esprit.
Je vais le grand chemin que mon oncle m'apprit,
Laissant là ces docteurs, que les muses instruisent
En des arts tout nouveaux : et s'ils font, comme ils disent,
De ses fautes un livre aussi gros que le sien...."
La satire littéraire, source de liberté dans un monde étroit et obscur - Comment vivre à la Cour, si l'on veut rester simple et honnête, Du Bellay et d'Aubigné ont tant de fois dénoncé les intrigues et la noirceur d'un monde incontournable pour qui, sans pouvoir et sans charge mais doté de quelques talents, tente de survivre et de trouver fortune (Satire III)...
"Il est vrai; mais pourtant je ne suis point d'avis
De dégager mes jours pour les rendre asservis,
Et sous un nouvel astre aller, nouveau pilote,
Conduire en autre mer mon navire qui flotte
Entre l'espoir du bien et la peur du danger
De froisser mon attente en ce bord étranger.
Car, pour dire le vrai, c'est un pays étrange
Où, comme un vrai Protée, à toute heure on se change,
Où les lois, par respect sages humainement,
Confondent le loyer avec le châtiment;
Et pour un même fait, de même intelligence,
L'un est justicié, l'autre aura récompense.
Car selon l'intérêt, le crédit ou l'appui
Le crime se condamne et s'absout aujourd'hui.
Je le dis sans confondre en ces aigres remarques
La clémence du roi, le miroir des monarques,
Qui plus grand de vertu de cœur et de renom
S'est acquis de Clément et la gloire et le nom.
Or, quant à ton conseil qu'à la cour je m'engage
Je n'en ai pas l'esprit, non plus que le courage.
Il faut trop de savoir et de civilité,
Et, si j'ose en parler, trop de subtilité.
Ce n'est pas mon humeur : je suis mélancolique ;
Je ne suis point entrant, ma façon est rustique;
Et le surnom de bon me va-t-on reprochant,
D'autant que je n'ai pas l'esprit d'être méchant.
Et puis, je ne saurais me forcer ni me feindre;
Trop libre en volonté, je ne me puis contraindre.
Je ne saurais flatter, et ne sais point comment
Il faut se taire accort ou parler faussement,
Bénir les favoris de geste et de paroles
Parler de leurs aïeux au jour de Cérisoles,
Des hauts faits de leur race, et comme ils ont acquis
Ce titre, avec honneur, de ducs et de marquis.
Je n'ai point tant d'esprit pour tant de menterie.
Je ne puis m'adonner à la cajolerie;
Selon les accidents, les humeurs ou les jours,
Changer comme d'habits tous les mois de discours.
Suivant mon naturel, je hais tout artifice;
Je ne puis déguiser la vertu, ni le vice,
Offrir tout de la bouche, et, d'un propos menteur,
Dire : "Pardieu, monsieur, je vous suis serviteur ";
Pour cent bonadies s'arrêter en la rue,
Faire sur l'un des pieds en la salle la grue,
Entendre un marjollet qui dit avec mépris :
"Ainsi qu'ânes, ces gens sont tous vêtus de gris,
Ces autres verdelets aux perroquets ressemblent,
Et ceux-ci mal peignés devant les dames tremblent";
Puis au partir de là, comme tourne le vent,
Avecques un bonjour, amis comme devant.
Je n'entends point le cours du ciel ni des planètes;
Je ne sais deviner les affaires secrètes,
Connaître un bon visage, et juger si le coeur,
Contraire à ce qu'on voit, ne serait point moqueur."

Honoré de Racan (1589-1670)
Honorât de Bueil, marquis de Racan, né en 1589 au Château de la Roche-Racan, à l'extrémité de la Touraine, était le fils, tard venu, d'un vieux gentilhomme-soldat qui, après de brillants services, s'était retiré dans ses terres. Il perdit de bonne heure son père et sa mère, et, sans fortune, eût pu être fort embarrassé pour vivre, si Anne de Bueil, sa cousine germaine, n'avait épousé le grand écuyer de Henri IV, M de Bellegarde, qui devint le tuteur de l'enfant et le fit admettre, en 1606, parmi les pages de la chambre du roi. C'est là que, très jeune, il rencontra Malherbe, lui lut ses premiers vers et devint "son écolier". Poète, auteur des Bergeries (1625), qui le rendirent célèbre, des Psaumes Pénitentiaux, des Odes sacrées sur les Psaumes, Honorat de Bueil, seigneur de Racan, a laissé aussi des Mémoires sur la Vie de Malherbe. Boileau lui reconnaît plus de génie qu’à Malherbe, mais il le trouve trop négligé dans sa prosodie et trop porté à imiter ce dernier....
1625 - "Les Bergeries"
Les 3000 vers des "Bergeries" rendirent célèbre Racan, une pastorale en cinq actes dans le goût de l'Astrée qui sera jouée en 1619 à l'Hôtel de Bourgogne, à la Cour en 1624, et dont Catherine Chabot, marquise de Thermes est l'héroïne sous le nom de la vertueuse bergère Arthémise. Lui-même y figure sous les traits de l'infortuné berger Lucidas, tandis que M. de Thermes y est l'heureux Alcidor, berger comme les autres. C'est Henriette de France, la future reine d'Angleterre, qui incarnait le personnage principal. Dans la réalité, au contraire de la pièce, Alcidor mourra le premier, et Lucidas demandera la main d'Arthémise, qui la lui refusera : Mme de Thermes ne se soucie point de remplacer son brillant mari par ce soldat de bonne facture, certes, et poète, mais gauche, provincial, et qui sait mal se déclarer autrement que la plume à la main, il était en effet bègue. Il passera tout de même des jours heureux dans son château de La Roche-Racan et ne quittera pas la Touraine.
Les Bergeries - Alcidor
Que cette nuit est longue et fâcheuse à passer !
Que de sortes d'ennuis me viennent traverser !
Depuis qu'un bel objet a ma raison blessée,
Incessamment je vois des yeux de ma pensée
Cet aimable soleil auteur de mon amour,
Qui fait qu'incessamment je pense qu'il soit jour,
Je saute à bas du lit, je cours à la fenêtre,
J'ouvre et hausse la vue, et ne vois rien paraître,
Que l'ombre de la nuit, dont la noire pâleur
Peint les champs et les prés d'une même couleur :
Et cette obscurité, qui tout le monde enserre,
Ouvre autant d'yeux au ciel qu'elle en ferme en la terre.
Chacun jouit en paix du bien qu'elle produit,
Les coqs ne chantent point, je n'entends aucun bruit,
Sinon quelques zéphirs, qui le long de la plaine
Vont cajolant tout bas les nymphes de la Seine.
Maint fantôme hideux, couvert de corps sans corps,
Visite en liberté la demeure des morts.
Les troupeaux, que la faim a chassés des bocages,
À pas lents et craintifs entrent dans les gagnages.
Les funestes oiseaux, qui ne vont que la nuit,
Annoncent aux mortels le malheur qui les suit.
Les flambeaux éternels, qui font le tour du monde,
Percent à longs rayons le noir cristal de l'onde,
Et sont vus au travers si luisants et si beaux
Qu'il semble que le ciel soit dans le fond des eaux.
Ô nuit ! dont la longueur semble porter envie
Au seul contentement que possède ma vie :
Retire un peu tes feux, et permets que le jour
Vienne sur l'horizon éclairer à son tour,
Afin que ces beaux yeux pour qui mon coeur soupire
Sachent avant ma mort l'excès de mon martyre.
Les Bergeries - Lucidas
Et moi seul resterai-je en proie à la tristesse ?
Passerai-je sans fruit la fleur de ma jeunesse ?
Que me servent ces biens dont en toute saison
Le voisin envieux voit combler ma maison ?
Que me sert que mes blés soient l'honneur des campagnes ?
Que les vins à ruisseaux me coulent des montagnes ?
Ni que me sert de voir les meilleurs ménagers
Admirer mes jardins, mes parcs et mes vergers,
Où les arbres plantés d'une égale distance
Ne périssent jamais que dessous l'abondance ?
Ce n'est point en cela qu'est le contentement,
Tout se change ici bas de moment en moment,
Qui le pense trouver aux richesses du monde
Bâtit dessus le sable, ou grave dessus l'onde,
Ce n'est qu'un peu de vent que l'heur du genre humain,
Ce qu'on est aujourd'hui l'on ne l'est pas demain,
Rien n'est stable qu'au Ciel, le temps et la fortune
Règnent absolument au-dessous de la lune.
Ode bachique - "Mais que te sert-il que ta gloire..."
MAINTENANT que du Capricorne
Le temps mélancolique et morne
Tient au feu le monde assiégé,
Noyons notre ennui dans le verre,
Sans nous tourmenter de la guerre
Du tiers état et du clergé.
Je sais, Maynard, que les merveilles
Qui naissent de tes longues veilles
Vivront autant que l'univers ;
Mais que te sert-il que ta gloire
Se lise au temple de Mémoire
Quand tu seras mangé des vers?
Quitte cette inutile peine,
Buvons plutôt à longue haleine
De ce nectar délicieux,
Qui pour l'excellence précède
Celui même que Ganymède
Verse dans la coupe des dieux.
C'est lui qui fait que les années
Nous durent moins que des journées ;
C'est lui qui nous fait rajeunir,
Et qui bannit de nos pensées
Le regret des choses passées
Et la crainte de l'avenir.
Buvons, Maynard, à pleine tasse ;
L'âge insensiblement se passe.
Et nous mène à nos derniers jours;
L'on a beau faire des prières,
Les ans non plus que les rivières
Jamais ne rebroussent leur cours.
Le printemps vêtu de verdure
Chassera bientôt la froidure,
La mer a son flux et reflux;
Mais depuis que notre jeunesse
Quitte la place à la vieillesse,
Le temps ne la ramène plus.
Les lois de la mort sont fatales
Aussi bien aux maisons royales
Qu'aux taudis couverts de roseaux.
Tous nos jours sont sujets aux Parques ;
Ceux des bergers et des monarques
Sont coupés des mêmes ciseaux.
Leurs rigueurs, par qui tout s'efface,
Ravissent en bien peu d'espace
Ce qu'on a de mieux établi,
Et bientôt nous mèneront boire.
Au-delà de la rive noire.
Dans les eaux du fleuve d'oubli.
"La venue du Printemps"
À Monsieur de Termes, ode
Enfin, Termes, les ombrages
Reverdissent dans les bois,
L'hiver et tous ses orages
Sont en prison pour neuf mois ;
Enfin la neige et la glace
Font à la verdure place,
Enfin le beau temps reluit,
Et Philomèle, assurée
De la fureur de Térée,
Chante aux forêts jour et nuit.
Déjà les fleurs qui bourgeonnent
Rajeunissent les vergers,
Tous les échos ne résonnent
Que de chansons de bergers,
Les jeux, les ris, et la danse
Sont partout en abondance,
Les délices ont leur tour,
La tristesse se retire,
Et personne ne soupire
S'il ne soupire d'amour.
Les moissons dorent les plaines,
Le ciel est tout de saphirs,
Le murmure des fontaines
S'accorde au bruit des zéphirs,
Les foudres et les tempêtes
Ne grondent plus sur nos têtes,
Ni des vents séditieux
Les insolentes colères
Ne poussent plus les galères
Des abîmes dans les cieux.
Ces belles fleurs que Nature
Dans les campagnes produit
Brillent parmi la verdure
Comme des astres la nuit :
L'Aurore, qui dans son âme
Brûle d'une douce flamme,
Laissant au lit endormi
Son vieux mari, froid et pâle,
Désormais est matinale
Pour aller voir son ami.
Termes, de qui le mérite
Ne se peut trop estimer,
La belle saison invite
Chacun au plaisir d'aimer
La jeunesse de l'année
Soudain se voit terminée,
Après le chaud véhément
Revient l'extrême froidure,
Et rien au monde ne dure
Qu'un éternel changement.
Leurs courses entresuivies
Vont comme un flux et reflux,
Mais le printemps de nos vies
Passe et ne retourne plus,
Tout le soin des Destinées
Est de guider nos journées
Pas à pas vers le tombeau,
Et sans respecter personne,
Le Temps de sa faux moissonne
Ce que l'homme a de plus beau.
Tes louanges immortelles
Ni tes aimables appas
Qui te font chérir des belles
Ne t'en garantiront pas :
Crois-moi, tant que Dieu t'octroie
Cet âge comblé de joie
Qui s'enfuit de jour en jour,
Jouis du temps qu'il te donne,
Et ne crois pas en automne
Cueillir les fruits de l'amour.
Stances sur la Retraite
TIRCIS, il faut penser à faire la retraite ;
La course de nos jours est plus qu'à demi faite ;
L'âge insensiblement nous conduit à la mort ;
Nous avons assez vu sur la mer de ce monde
Errer au gré des flots notre nef vagabonde ;
Il est temps de jouir des délices du port.
Le bien de la fortune est un bien périssable ;
Quand on bâtit sur elle, on bâtit sur le sable ;
Plus on est élevé, plus on court de dangers ;
Les grands pins sont en butte aux coups de la tempête,
Et la rage des vents brise plutôt le faîte
Des maisons de nos rois que les toits des bergers.
O bienheureux celui qui peut de sa mémoire
Effacer pour jamais ce vain espoir de gloire,
Dont l'inutile soin traverse nos plaisirs,
Et qui, loin retiré de la foule importune,
Vivant dans sa maison, content de sa fortune,
A, selon son pouvoir, mesuré ses désirs !
II laboure le champ que labourait son père ;
Il ne s'informe point de ce qu'on délibère
Dans ces graves conseils d'affaires accablés ;
Il voit sans intérêt la mer grosse d'orages,
Et n'observe des vents les sinistres présages.
Que pour le soin qu'il a du salut de ses blés...
Il voit de toutes parts combler d'heur sa famille,
La javelle à plein poing tomber sous sa faucille.
Le vendangeur ployer sous le faix des paniers.
Et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes.
Les humides vallons et les grasses campagnes
S'efforcent à remplir sa cave et ses greniers.
Il suit aucune fois un cerf par les foulées,
Dans ces vieilles forêts du peuple reculées
Et qui même du jour ignorent le flambeau ;
Aucune fois des chiens il suit les voix confuses.
Et voit enfin le lièvre, après toutes ses ruses.
Du lieu de sa naissance en faire son tombeau.
Tantôt il se promène au long de ses fontaines.
De qui les petits flots font luire dans les plaines
L'argent de leurs ruisseaux parmi l'or des moissons ;
Tantôt il se repose, avecque les bergères.
Sur des lits naturels de mousse et de fougères.
Qui n'ont autres rideaux que l'ombre des buissons.
Il soupire en repos l'ennui de sa vieillesse.
Dans ce même foyer où sa tendre jeunesse
A vu dans le berceau ses bras emmaillottés :
Il tient par les moissons registre des années,
Et voit de temps en temps leurs courses enchaînées
Vieillir avecque lui les bois qu'il a plantés.
Il ne va point fouiller aux terres inconnues,
A la merci des vents et des ondes chenues,
Ce que nature avare a caché de trésors.
Et ne recherche point, pour honorer sa vie,
De plus illustre mort, ni plus digne d'envie.
Que de mourir au lit où ses pères sont morts...
S'il ne possède point ces maisons magnifiques.
Ces tours, ces chapiteaux, ces superbes portiques
Où la magnificence étale ses attraits.
Il jouit des beautés qu'ont les saisons nouvelles.
Il voit de la verdure et des fleurs naturelles.
Qu'en ces riches lambris l'on ne voit qu'en portraits.
Crois-moi, retirons-nous hors de la multitude,
Et vivons désormais loin de la servitude
De ces palais dorés où tout le monde accourt :
Sous un chêne élevé les arbrisseaux s'ennuient.
Et devant le soleil tous les astres s'enfuient,
De peur d'être obligés de lui faire la cour.
Après qu'on a suivi sans aucune assurance
Cette vaine faveur qui nous pait d'espérance,
L'envie en un moment tous nos desseins détruit;
Ce n'est qu'une fumée ; il n'est rien de si frêle ;
Sa plus belle moisson est sujette à la grêle.
Et souvent elle n'a que des fleurs pour du fruit.
Agréables déserts, séjour de l'innocence.
Où loin des vanités, de la magnificence,
Commence mon repos et finit mon tourment,
Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitude,
Si vous fûtes témoins de mon inquiétude,
Soyez-le désormais de mon contentement !

François Maynard (1582-1646)
Originaire de Toulouse, fils d'un conseiller au Parlement, arrivé à Paris en 1605 en qualité de secrétaire de Marguerite de Valois, épouse répudiée d'Henri IV, François Mainard rencontre Malherbe, dont il devint le disciple, avec Racan, renchérissant volontiers sur son purisme formel. Il fait ses débuts aux côtés du maître dans le "Parnasse des plus excellents poètes de ce temps". Mais en 1607, il fréquentait aussi Saint-Amant, Colletet et Théophile, en 1608 épousait Gaillarde de Boyer qui, grâce à sa dot, lui permit de s'installer au présidial d'Aurillac...
"A Alcippe"
ALCIPPE, reviens dans nos bois,
Tu n'as que trop suivi nos rois
Et l'infidèle espoir dont tu fais ton idole :
Quelque bonheur qui seconde tes vœux.
Ils n'arrêteront pas le temps qui toujours vole,
Et qui d'un triste blanc va peindre tes cheveux.
La cour méprise ton encens.
Ton rival monte et tu descends.
Et dans le cabinet le favori te joue.
Que t'a servi de fléchir les genoux
Devant un Dieu fragile et fait d'un peu de boue.
Qui souffre et qui vieillit pour mourir comme nous ?
Romps tes fers, bien qu'ils soient dorés.
Fuis les injustes adorés.
Et descends dans toi-même à l'exemple du sage.
Tu vois de près ta dernière saison :
Tout le monde connaît ton nom et ton visage,
Et tu n'es pas connu de ta propre raison.
Ne forme que des saints désirs,
Et te sépare des plaisirs
Dont la molle douceur te fait aimer la vie.
11 faut quitter le séjour des mortels,
Il faut quitter Philis, Amarante et Silvie,
A qui ta folle amour élève des autels.
Il faut quitter l'ameublement
Qui nous cache pompeusement
Sous de la toile d'or le plâtre de ta chambre.
Il faut quitter ces jardins toujours verts.
Que l'haleine des fleurs parfume de son ambre,
Et qui font des printemps au milieu des hivers.
C'est en vain que loin des hasards
Oïl courent les enfants de Mars,
Nous laissons reposer nos mains et nos courages
Et c'est en vain que la fureur des eaux.
Et l'insolent Borée, artisan des naufrages,
Font à l'abri du port retirer nos vaisseaux.
Nous avons beau nous ménager,
Et beau prévenir le danger,
La mort n'est pas un mal que le prudent évite ;
Il n'est raison, adresse, ni conseil.
Qui nous puisse exempter d'aller où le Cocyte
Arrose des pays inconnus au soleil.
Le cours de nos ans est borné;
Et quand notre heure aura sonné,
Cloton ne voudra plus grossir notre fusée.
C'est une loi, non pas un châtiment.
Que la nécessité qui nous est imposée
De servir de pâture aux vers du monument.
Résous-toi d'aller chez les morts;
Ni la race, ni les trésors,
Ne sauraient t'empêcher d'en augmenter le nombre.
Le potentat le plus grand de nos jours,
Ne sera rien qu'un nom, ne sera rien qu'une ombre.
Avant qu'un demi-siècle ait achevé son cours.
On n'est guère loin du matin
Qui doit terminer le destin
Des superbes tyrans du Danube et du Tage.
Ils font les dieux dans le monde chrétien;
Mais ils n'auront sur toi que le triste avantage
D'infecter un tombeau plus riche que le tien.
Et comment pourrions-nous durer ?
Le temps, qui doit tout dévorer.
Sur le fer et la pierre exerce son empire ;
Il abattra ces fermes bâtiments
Qui n'offrent a nos yeux que marbre et que porphyre,
Et qui jusqu'aux enfers portent leurs fondements.
On cherche en vain les belles tours
Où Paris cacha ses amours.
Et d'où ce fainéant vit tant de funérailles.
Rome n'a rien de son antique orgueil.
Et le vide enfermé de ses vieilles murailles
N'est qu'un affreux objet et qu'un vaste cercueil.
Mais tu dois avecque mépris
Regarder ces petits débris :
Le temps amènera la fin de toutes choses ;
Et ce beau ciel, ce lambris azuré,
Ce théâtre, où l'aurore épanche tant de roses.
Sera brûlé des feux dont il est éclairé.
Le grand astre qui l'embellit
Fera sa tombe de son lit;
L'air ne formera plus ni grêles, ni tonnerres ;
Et l'univers qui, dans son large tour,
Voit courir tant de mers et fleurir tant de terres,
Sans savoir où tomber, tombera quelque jour.
Très habile courtisan, Maynard arriva à être le mieux renté des disciples de Malherbe et à savoir mieux que son maître tirer profit des bénéfices et des « autres bienfaits" de Louis XIII.
Dans les années 1610-1630 il est à Paris, fréquente Gomberville, Boisrobert et Scarron, rencontre Richelieu et se voit récompenser de ses efforts en entrant à l'Académie française en 1632. En 1634, après un voyage à Rome, il perdait tout crédit mais ne cessa pour autant d'encenser les idoles du temps, en vain. Ses Œuvres complètes (1644) finirent par apporter une certaine gloire à un poète certes de renom. On estime qu'il a plus d'une fois dépassé son maître par son lyrisme et son imagination : "Le Philandre" (1613), ses Epigrammes, ses Odes, ses Poésies (1646). Mais à cette époque, le théâtre de Corneille et de Racine avaient pris la place du lyrisme dans la faveur du public...
Ode
HÉLÈNE, Oriane, Angélique,
Je ne suis plus de vos amants.
Loin de moi l'éclat magnifique
Des noms puisés dans les romans.
Ma passion, quoi qu'amour fasse,
Ne fera plus son paradis
Des beautés qui mettent leur race
Plus haut que celle d'Amadis.
Pour baiser la robe ou la jupe
Des femmes de bonne maison,
Il faut qu'une amoureuse dupe
Perde son bien et sa raison.
Il faut que toujours il se couvre
De superbes habillements.
Et qu'il aille chercher au Louvre
De la grâce et des compliments.
Vive Barbe, Alix et Nicolle,
Dont les simples naïvetés
Ne furent jamais à l'école
Des ruses et des vanités !
Une santé fraîche et robuste
Fait que toujours leur teint est net;
Et lorsque leur beauté s'ajuste,
La campagne est leur cabinet.
Sans donner ni bal, ni musique,
Sans emprunter chez les marchands,
Et sans débiter rhétorique,
Je plais aux Calistes des champs.
Leur âme n'est pas inhumaine
Pour tirer mes vœux en longueur ;
Jamais je n'ai perdu l'haleine
En courant après leur rigueur.
Adieu, pompeuses damoiselles
Que le fard cache aux yeux de tous,
Et qui ne fûtes jamais belles
Que d'un beau qui n'est pas à vous !
J'en veux aux femmes de village,
Je n'aime plus en autre part ;
La nature, en leur beau visage,
Fait la figue aux secrets de l'art.
Ode, Deux jours de ton entretien Valent deux siècles de vie...
CES antres et ces rochers,
Jeanne, qui te virent naitre,
Me sont plus beaux et plus chers
Que le palais de mon maître.
J'égale au plus beau des lieux
La province reculée
Que l'orient de tes yeux
A si doucement brûlée.
Tes vertus sont des trésors
Qui te remplissent de gloire.
On les chante sur les bords
Du Rhin, du Tibre et de Loire.
Ton esprit est merveilleux,
Le mien en fait son oracle,
Et notre âge est orgueilleux
D'avoir produit ce miracle.
Le soleil est un flambeau
Où moins de lumière abonde :
C'est le présent le plus beau
Que le ciel ait fait au monde.
Jeanne, tu parles si bien.
Que mon âme en est ravie :
Deux jours de ton entretien
Valent deux siècles de vie.
Tu m'as pris, et ton discours
Est le piège qui m'engage.
Le printemps n'a pas des jours
Si fleuris que ton langage...
Je pardonne â tes beautés
L'orgueil qui les rend si vaines;
Tes regards font nos étés,
Tes pieds font fleurir nos plaines.
Tu fais que dans nos vallons
On voit naître toutes choses,
Et défends aux aquilons
D'y faire tomber les roses.
Quoi que fassent les hivers,
Jamais la neige n'y dure,
Et les arbres
y sont verts
D'une éternelle verdure...
Souvent, pour se délasser,
La Cour me lit, et je pense
Qu'on ne voudra pas laisser
Ma vertu sans récompense ;
Mais je t'ai donné les vœux
D'une amour si peu commune,
Que pour un de tes cheveux
Je quitterais ma fortune.
Si la foi dont je te sers
Ne craignait d'être abusée,
J'userais dans ces déserts
Tout le fil de ma fusée...
Quand est-ce que tu prétends
De finis tes injustices ?
Il me semble qu'il est temps
De couronner mes services.
Ne crains pas que la raison
Désormais t'impute à blâme
De hâter la guérison
Des blessures de mon âme.
Ma vie a déjà passé
Ses plus belles matinées,
Et ton front est menacé
De l'injure des années.
Ne considère plus rien ;
Le devoir t'en sollicite.
Un feu grand comme le mien
N'est pas un petit mérite.
Laisse-toi vaincre à mes pleurs,
Et te ploie à mes demandes :
Tandis que l'on a des fleurs.
On doit faire des guirlandes.
Chanson, "Qui boit bien nargue la fortune..."
PÉGASE n'a point de mérite
Qui, dans les vers que je médite,
M'oblige à l'appeler divin,
Sinon que l'on me persuade
Que de sa fameuse ruade
Il naquit des sources de vin.
Mes désirs ne sont point esclaves
Des fontaines comme des caves;
L'eau m'incommode et me déplait.
Il lui faut déclarer la guerre.
Elle assassine dans le verre
Le bon Denys, tout dieu qu'il est.
Cà, qu'on me donne une bouteille
Pleine de ce vin qui réveille
Les esprits les plus languissants !
Le nectar lui cède la gloire.
Et les dieux pour en venir boire
Se travestissent en passants.
Je demande sur toutes choses,
Garçon, que les portes soient closes
A qui voudra parler à moi.
Loin d'ici factions et brigues !
Si la couronne a des intrigues,
Laissons-les au conseil du roi.
Mon ambitieuse espérance.
D'un des premiers honneurs de France
Ne demande pas le brevet.
Ma barque aura le vent en poupe,
Tant que le flacon et la coupe
Seront mes armes de chevet.
Quand un curieux me découvre
Les importants secrets du Louvre,
Je condamne son entretien.
De quelque façon qu'on gouverne,
Pourvu que j'aille à la taverne,
Il me semble que tout va bien...
Qui boit bien nargue la fortune,
Et des soins d'une âme commune
Jamais ne se trouve saisi.
Il rit au fort de sa disgrâce
Et son nez rouge fait qu'il passe
Pour philosophe en cramoisi...
Mon cœur est un cœur de femelle;
Mais dès que le fils de Sémèle
M'a suffisamment abreuvé.
Je crois qu'à mes faits héroïques
Le plus hardi preux des chroniques
Doit céder le haut du pavé.
Mon orgueil bruit comme un tonnerre,
Et n'est point de roi sur la terre
A qui je ne fasse un défi.
A la fierté de mon langage,
Il semble que j'ai mis en cage
Le Prêtre-Jean et le Sophi.
Devant les gens dont la censure
Veut qu'on boive avecque mesure
Je disparais comme un lutin.
J'aime à trinquer, la tasse pleine.
Et voudrais pouvoir, d'une haleine,
Humer Octobre et Saint Martin...
Dès que la mort impitoyable
Aura de sa main effroyable
Saisi ma vieillesse au collet,
Je veux qu'une vive peinture
Embellisse ma sépulture
De l'image d'un gobelet.
"Et je serais sans feu, si j'étais sans amour." - Epris de "Cloris" depuis quarante ans, qui lui préféra un mari plus aisé, il ne désespère pas à 62 ans, en 1644, de la séduire, devenue veuve, mais en vain (Strophes)...
"Cloris, que dans mon cœur j'ai si longtemps servie
Et que ma passion montre à tout l'univers,
Ne veux-tu pas changer le destin de ma vie,
Et donner de beaux jours à mes derniers hivers?
N'oppose plus ton deuil au bonheur où j'aspire.
Ton visage est-il fait pour demeurer voilé?
Sors de ta nuit funèbre, et permets que j'admire
Les divines clartés des yeux qui m'ont brûlé...
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis ta conquête :
Huit lustres ont suivi le jour que tu me pris,
Et j'ai fidèlement aimé ta belle tête
Sous des cheveux châtains et sous des cheveux gris.
C'est de tes jeunes yeux que mon ardeur est née,
C'est de leurs premiers traits que je fus abattu;
Mais tant que tu brûlas du flambeau d'hyménée,
Mon amour se cacha pour plaire à ta vertu.
Ie sais de quel respect il faut que je t'honore,
Et mes ressentiments ne l'ont point violé;
Si quelquefois j'ai dit le soin qui me dévore,
C'est à des confidents qui n'ont jamais parlé.
Pour adoucir l'aigreur des peines que j'endure,
Je me plains aux rochers, et demande conseil
A ces vieilles forêts, dont l'épaisse verdure
Fait de si belles nuits en dépit du soleil.
L'âme pleine d'amour et de mélancolie,
Et couché sur des fleurs ou sous des orangers,
J'ai montré ma blessure aux deux mers d'Italie
Et fait dire ton nom aux échos étrangers.
Ce fleuve impérieux à qui tout fit hommage,
Et dont Neptune même endura le mépris,
A su qu'en mon esprit j'adorais ton image
Au lieu de chercher Rome en ses vastes débris.
Cloris, la passion que mon cœur t'a jurée
Ne trouve point d'exemple aux siècles les plus vieux;
Amour et la nature admirent la durée
Du feu de mes désirs et du feu de tes yeux.
La beauté qui te suit depuis ton premier âge
Au déclin de tes jours ne te veut pas laisser,
Et le temps, orgueilleux d'avoir fait ton visage,
En conserve l'éclat et craint de l'effacer.
Regarde sans frayeur la fin de toutes choses,
Consulte le miroir avec des yeux contents :
On ne voit point tomber ni tes lis, ni tes roses,
Et l'hiver de ta vie est ton second printemps.
Pour moi, je cède aux ans, et ma tête chenue
M'apprend qu'il faut quitter les hommes et le jour ;
Mon sang se refroidit ; ma force diminue ;
Et je serais sans feu, si j'étais sans amour."
Sonnets - "Qu'il est doux d'être libre, et que la servitude Est honteuse à celui qui peut être son roi ! JE touche de mon pied le bord de l'autre monde..."
ROME qui sous tes pieds as vu toute la terre,
Ces deux fameux héros, ces deux grands conquérants
Qui dans la l'hessalie achevèrent leur guerre
Doivent être noircis du titre de tyrans.
Tu croyais que Pompée armait pour te défendre,
Et qu'il était l'appui de ta félicité :
Un même esprit poussait le beau-père et le gendre ;
Tous deux avaient armé contre ta liberté.
Si Jules fut tombé, Tautre, après sa victoire.
Par un nouveau triomphe eût abaissé ta gloire,
Et forcé tes consuls d'accompagner son char.
Je les blâme tous deux d'avoir tiré l'épée,
Bien que le Ciel ait pris le parti de César,
Et que Caton soit mort dans celui de Pompée.
ADIEU, Paris, adieu pour la dernière fois!
Je suis las d'encenser l'autel de la fortune,
Et brûle de revoir mes rochers et mes bois,
Où tout me satisfait, où rien ne m'importune.
Je n'y suis point touché de l'amour des trésors,
Je n'y demande pas d'augmenter mon partage :
Le bien qui m'est venu des pères dont je sors
Est petit pour la cour, mais grand pour le village.
Depuis que je connais que le siècle est gâté,
Et que le haut mérite est souvent maltraité,
Je ne trouve ma paix que dans la solitude.
Les heures de ma vie
y sont toutes à moi.
Qu'il est doux d'être libre, et que la servitude
Est honteuse à celui qui peut être son roi !
JE touche de mon pied le bord de l'autre monde ;
L'âge m'ôte le goût, la force et le sommeil ;
Et l'on verra bientôt naître du sein de l'onde
La première clarté de mon dernier soleil.
Muses, je m'en vais dire au fantôme d'Auguste
Que sa rare bonté n'a plus d'imitateurs;
Et que l'esprit des grands fait gloire d'être injuste
Aux belles passions de vos adorateurs.
Voulez-vous bien traiter ces fameux solitaires
A qui vos déités découvrent leurs mystères ?
Ne leur promettez plus des biens ni des emplois.
On met votre Science au rang des choses vaines ;
Et ceux qui veulent plaire aux favoris des rois
Arrachent vos lauriers et troublent vos fontaines.
DÉSERTS où j'ai vécu dans un calme si doux.
Pins qui d'un si beau vert couvrez mon ermitage,
La cour, depuis un an, me sépare de vous,
Mais elle ne saurait m' arrêter davantage.
La vertu la plus nette y fait des ennemis ;
Les palais y sont pleins d'orgueil et d'ignorance ;
Je suis las d'y souffrir, et honteux d'avoir mis
Dans ma tête chenue une vaine espérance.
Ridicule abusé, je cherche du soutien
Au pays de la fraude, où Ton ne trouve rien
Que des pièges dorés et des malheurs célèbres.
Je me veux dérober aux injures du sort
Et, sous l'aimable horreur de vos belles ténèbres,
Donner toute mon âme aux pensers de la mort.
1646 - "Mon âme, il faut partir" -
Mon âme, il faut partir. Ma vigueur est passée,
Mon dernier jour est dessus l’horizon.
Tu crains ta liberté. Quoi ! n’es-tu pas lassée
D’avoir souffert soixante ans de prison ?
Tes désordres sont grands ; tes vertus sont petites ;
Parmi tes maux on trouve peu de bien ;
Mais si le bon Jésus te donne ses mérites,
Espère tout et n’appréhende rien.
Mon âme, repens-toi d’avoir aimé le monde,
Et de mes yeux fais la source d’une onde
Qui touche de pitié le monarque des rois.
Que tu serais courageuse et ravie
Si j’avais soupiré, durant toute ma vie,
Dans le désert, sous l’ombre de la Croix !

Jean Ogier de Gombauld (1576-1666),
gentilhomme saintongeois de belles manières et de noble langage, vécut et mourut, à près de cent ans avec une illusion, celle d'avoir été silencieusement adoré par la reine Marie de Médicis.
Sonnets
Durant la belle nuit, dont mon âme ravie
Préférait les clartés à celles d'un beau jour.
J'écoutais murmurer, au milieu de la Cour,
Mille voix de louange et mille autres d'envie.
Je ne sais quelles morts plus douces que la vie,
Faisaient sentir aux cœurs les charmes de l'amour;
Et de mille beautés qui brûlaient à l'entour.
L'un tenait pour Caliste, et l'autre pour Sylvie.
Quand Philis vint montrer ses yeux armés de dards,
De tous les assistants attira les regards,
Et des autres objets effaça la mémoire.
Sa présence à l'instant fit sentir sa vertu,
Et mon cœur fut saisi d'une secrète gloire
De la voir triompher sans avoir combattu.
LE péché me surmonte, et ma peine est si grande,
Lorsque, malgré moi-même, il triomphe de moi.
Que, pour me retirer du gouffre où je me voi.
Je ne sais quel hommage il faut que je te rende.
Je voudrais bien t' offrir ce que ta loi commande.
Des prières, de vœux et des fruits de ma foi ;
Mais voyant que mon cœur n'est pas digne de toi,
Je fais de mon Sauveur mon éternelle offrande.
Reçois ton fils, ô Père ! et regarde la croix
Où, prêt de satisfaire à tout ce que je dois,
Il te fait de lui-même un sanglant sacrifice ;
Et puisqu'il a pour moi cet excès d'amitié,
Que d'être incessamment l'objet de ta justice,
Je serai, s'il te plaît, l'objet de ta pitié.
