- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Pierre Corneille (1606-1684), "Le Cid" (1636), "Horace" (1640), "Cinna" (1641) - Jean de Mairet (1604-1686) - Jean Rotrou (1609-1650) - Jean Chapelain (1595-1674) - Philippe Quinault (1635-1688) ...
Last update 10/10/2021
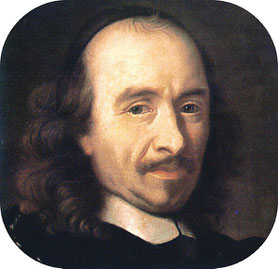
"..le spectateur peut concevoir avec facilité que si un roi, pour trop s'abandonner à l'ambition, à l'amour, à la haine, à la vengeance, tombe dans un malheur si grand qu'il lui fait pitié, à plus forte raison lui qui n'est qu'un homme du commun doit tenir la bride à de telles passions, de peur qu'elles ne l'abîment dans un pareil malheur. Outre que ce n'est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre. Celles des autres hommes y trouveraient place, s'il leur en arrivait d'assez illustres et d'assez extraordinaires pour la mériter, et que l'histoire prît assez de soin d'eux pour nous les apprendre.." - Corneille peint les hommes «tels qu'ils devraient être», c'est ainsi que le théâtre cornélien en ce tout début du XVIIe siècle, va entraîner le spectateur dans une expérience toute nouvelle, au-delà de nous-mêmes, entre raisonnable et admirable. Il ne s'agit pas de peindre l'être humain mais de représenter une certaine conception du héros dans un monde où ne s'imposent encore ni la raison ni la déraison, mais un au-delà possible de notre existence...
"Les grands sujets qui remuent fortement les passions, et en opposant l'impétuosité aux lois du devoir et aux tendresses de sang, doivent toujours aller au-delà du vraisemblable et ne trouveraient aucune croyance parmi les auditeurs, s'ils n'étaient soutenus ou par l'autorité de l'histoire qui persuade avec empire, ou par la préoccupation (préjugé favorable) de l'opinion commune qui nous donne ces mêmes auditeurs déjà tout persuadés." - Siècle de Corneille, Racine et Molière, en ce premier tiers du XVIIe siècle, le théâtre, plus que tout autre genre par trop individualiste, livre, essai, poésie, s'impose comme le média essentiel d'une collectivité sociale et culturelle qui se construit et se polit progressivement. C'est ici que se forge l'idéal classique, que la pensée se construit, s'expose et se partage collectivement. La représentation dramatique devient le mode d'expression favori de cette petite société d' "honnêtes gens" et de "mondains" qui vont prolonger une sociabilité, construite dans les cours et les salons, dans un théâtre qui, autour d'une pièce, d'une intrigue, d'une scène, d'acteurs, d'un public, d'un contexte, structure un cérémonial, établi des rites et réparti des rôles. Corneille forme, en ce début des années 1630, avec Boisrobert, Colletet, L'Estoile et Rotrou, cette fameuse société des cinq auteurs en charge de composer des pièces sur des idées du Cardinal Richelieu.
Mais Corneille, l'auteur dramatique qui a le plus méditer sur l'essence de son art (Discours, Examens) cherche encore sa voie, expérimente plusieurs genres, comédie héroïque, tragédie-ballet, jusqu'à ce que la structure même de la représentation dramatique débouche sur un véritable miracle en 1637 : le paisible bourgeois de province, si peu brillant et à l'existence d'une morne vertu, devient le poète absolu de la majesté romaine et de l'héroïsme. Un autre monde surgit et prend forme au-delà de cette société de conditions, celui de héros "ni tout à fait bon ni tout à fait méchant", celui des conflits entre l'impétuosité des passions, les lois du devoir et la "tendresse de sang" ... et le plus souvent c'est le devoir qui l'emporte : Corneille va peindre les êtres humains tels qu'ils devraient être, pour reprendre La Bruyère, et Racine, un peu plus tard, tels qu'ils sont. Mais c'est une vérité exemplaire qui s'expose, vécue collectivement le temps de la représentation, une vérité qui expose directement la conduite du pouvoir et des affaires de l'Etat, non pas les personnes et ceux qui incarnent l'autorité, mais la nature humaine telle que nous la livre l'histoire romaine (Horace, Cinna, Pompée) ou le mythe (Andromède, OEdipe). Et la querelle du Cid, qu'entretient l'Académie sur l'impulsion de Richelieu, mettra en évidence que désormais se forge une volonté politique qui entend mettre de l'ordre, tant dans l'art que dans les mœurs...

Qu'expose la tragédie? Un terrible destin oppose sans cesse les êtres humains, les partis, les nations : le politique noue ses grands conflits d'intérêts, d'ambitions, de jalousie; la raison d'État, l'honneur féodal, la grandeur romaine, l'autorité royale sont de puissants ressorts; l'amour se heurte aux rivalités de familles ou de patries; la mort est sans cesse présente : cinq combattants sur six succombent dans "Horace", le survivant tue sa propre sœur et réclame la mort. Il ne s'agit pas là d'un pathétique romanesque ou légendaire : le théâtre de Corneille nous présente le reflet d'un monde déchiré par la guerre, d'une société qui, après les guerres de religion, s'est jetée dans les folles aventures de la Fronde, d'une noblesse qui s'extermine en duels fratricides, malgré les édits royaux. L'Espagne déchirée par les rivalités des grands seigneurs et menacée par les Maures, la République romaine combattant pour un avenir grandiose, l'empire d'Auguste émergeant péniblement des guerres civiles, le christianisme qui s'affirme peu à peu par les sacrifices sanglants de ses martyrs, voilà les chapitres d'une épopée dramatique où tout est tension, conflit, lutte. Et de telles époques, de tels combats ne peuvent convenir qu'à des âmes peu communes, des individualités fortes que Corneille ne se lasse pas d'admirer et de peindre. Lucides, ses héros ont tôt fait de prendre un parti en pleine connaissance de cause; volontaires, ils conforment leur conduite à leur décision, quoi qu'il leur en coûte, qu'il s'agisse d'ailleurs d'honneur du nom, du salut et de la grandeur de la patrie, ou de profession de foi en Dieu. Ils mettent leur gloire à faire triompher leur liberté dans une difficile générosité. Il importe peu que leur Volonté les sépare de leurs amis, de leurs parents, de leurs concitoyens, de l'humanité dans son ensemble : ils acceptent d'avance l'incompréhension, la solitude morale; ils acceptent la mort, et la progression dramatique de la tragédie renouvelée par Corneille est faite pour de tels personnages ..
L'abondante production de Corneille (trente-trois pièces) explore plusieurs veines dramatiques. La comédie tout d'abord, avec des œuvres comme Mélite ou l'Illusion comique. C'est par elle qu'il se fit connaître en renouvelant un genre auparavant inexploité. La tragi-comédie : dans Le Cid se dévoile le goût de Corneille pour l'étude des conflits de sentiments humains, thème qui caractérisera toutes les tragédies du XVIIe siècle. Corneille emprunte la trame narrative tragique de l'amour rendu impossible pour des raisons d'honneur, mais en propose un dénouement heureux. La tragédie est le genre de prédilection de Corneille. Le thème du pouvoir ou de la faiblesse de la volonté de l'homme dans sa quête de la gloire est présent dans la plupart d'entre elles. Dans les scènes les plus intenses, le héros cornélien est face à un choix : laisser ses passions devenir maîtresses de sa raison, ou, au contraire, parvenir à s'imposer la conduite correspondant à son rang et à ses devoirs.
La tragédie "veut par son sujet une action illustre, extraordinaire, sérieuse". - Au XVIe siècle, la tragédie était principalement "conçue comme la peinture d'une illustre infortune", c'est le règne du "pathétique" et non pas encore de cette "émotion tragique" qui définira la tragédie classique du XVIIe. Alexandre Hardy est le premier auteur dramatique de métier, ses débuts datent de 1595, il composera plus de 600 pièces, des tragédies et des tragi-comédies dont seulement une trentaine nous sont parvenues; il sera l'auteur attitré de l'Hôtel de Bourgogne. Vers 1620-1634, la tragédie connaît une crise, la tragi-comédie, ou tragédie romanesque dont Rotrou est le spécialiste, et la pastorale, aux amours contrariés et de plus en plus complexes de bergers et de bergères, semblent s'imposer, privilégiant la fantaisie et l'invraisemblance : nous sommes il est vrai en plein baroque. C'est alors que Mairet, dans sa préface de Sylvanire" (1631), ayant étudié les Italiens, en vient à proposer l'établissement de règles, celle des trois unités, d'action, de temps et de lieu, tirées d'un passage de la Poétique d'Aristote, et de la bienséance. Mais c'est bien la vraisemblance et la raison que l'on entend désormais instituer dans l'écriture d'une tragédie qui, malgré les réticences de certains auteurs comme Corneille, permet un renouvellement considérable du genre : l'idéal classique va pousser, pour un temps, la tragédie à s'intérioriser, à gagner en intensité et en profondeur. Et l'on assiste ainsi , à la veille du Cid, à une multiplication de tragédies empruntées à l'histoire romaine, souvent austères, l' "Hercule mourant", de Rotrou (1633), la "Sophonisbe" de Mairet (1634), la "Mort de Mithridate" de La Calprenède (1635), la "Mort de César" de Scudéry (1636), la "Mariamne" de Tristan L'Hermite (1636), la "Lucrèce" de Du Ryer (1636). Corneille (1606-1684) ne doit pas éclipser des auteurs qui connurent aussi leur moment de gloire:
- Rotrou (1609-1650), un ami de Corneille, normand comme lui, auteur de comédies (Les Sosies, La Sœur), de tragi-comédies (Agésilan de Colchos, Laure persécutée) et des tragédies, dont "Saint Genest" (1646), tragédie chrétienne relatant le martyre du comédien Genest sous Dioclétien, et Venceslas (1647).
- Thomas Corneille (1625-1709), qui fut, au XVlle siècle, presque aussi illustre que son aîné Pierre Corneille, auteur d'une abondante production inspirée le plus souvent de son frère, de Racine et de Molière : "Ariane" (1672), "Le Comte d'Essex" (1678).
- Philippe Quinault (1635-1688), auteur de comédies, de tragi-comédies et de tragédie (Astrate ou L'Anneau Royal, 1663), raillée par Boileau, et qui trouva sa voie dans l'opéra, en collaboration avec Lulli.
Et 1635, c'est aussi l'année où un certain Richelieu met la haute main sur le secteur littéraire en France...

Corneille (1606-1684)
Pierre Corneille naquit à Rouen le 6 juin 1606 dans une famille de moyenne bourgeoisie, y fit des études brillantes et précoces, fut reçu avocat et acquit des charges royales qu'il garda jusqu'en 1650. Licencié en droit à dix-huit ans (1624), il fait pendant quatre ans un stage d'avocat au Parlement de Rouen, ville d`imprimeurs et de libraires, au début du siècle, et à la vie littéraire est fort active. Le jeune Corneille fréquente les salons littéraires et rime tôt des poèmes, selon la mode précieuse (sonnets galants, stances et madrigaux). Inspiré par Catherine Hue, dit-on, - le seul grand amour de sa vie et une immense déception -, il écrit dès 1625 une comédie, "Mélite" (ou les Fausses Lettres), dont le succès engage le célèbre acteur Mondory à la jouer a Paris (théâtre du Marais, 1629). En 1628, à 22 ans, son père lui achète dans le même temps l'office d'avocat du roi au siège des Eaux et Forêts et à l'Amirauté de France à Rouen. Mais jusqu'en 1636, il fait jouer sept autres pièces, des comédies d'intrigues parmi lesquelles "La Veuve" (1631), "Clitandre" (tragi-comédie, 1631), "La Galerie du Palais" (comédie), "La place Royale" (comédie), "Médée" (tragédie inspirée de Sénèque, 1635), "l'Illusion Comique" (1636), pièce complexe joignant à la comédie la tragédie et la farce. Tant de diversité montre la richesse et la variété de son génie.
La représentation du Cid en 1636 le situe d'emblée parmi les plus grands auteurs classiques de son temps, non seulement parce qu'elle donne lieu à des controverses passionnées sur sa "régularité" (la fameuse conformité aux règles des trois unités, de temps, de lieu, d'action, et à la bienséance) et fournit à Chapelain l'occasion de préciser les "sentiments de l'Académie", mais surtout parce que Corneille a su tirer du drame espagnol de Guilhem de Castro la première tragédie "classique", dont la psychologie et la morale forment le ressort dramatique et l'intérêt principal : son immense succès oriente toute l'évolution du théâtre français. L'histoire de Corneille se confond dès lors avec la succession de ses nombreuses pièces; nous ne savons pas grand chose de sa vie privée, mais tout nous laisse à penser qu'elle fut calme et banale. Après "le Cid", ce sont "Horace" (1640), "Cinna" (1640), "Polyeucte" (1642), trois drames où s'impose le désir ardent de la gloire et où triomphe la volonté. En 1643, il fait jouer "la Mort de Pompée" et revient brillamment à la comédie avec "le Menteur". En 1644, "Rodogune" obtient un grand succès.
Corneille entre à l'Académie en 1647. Ses tragédies deviennent de plus en plus complexes, mais sont très habilement construites; "Nicomède" (1651) est une véritable fresque historique et politique. Après l'échec de "Pertharite" (1652), Corneille abandonne la scène et se consacre pendant quelques années à une adaptation en vers de l'Imitation de Jésus-Christ qui sera publiée de 1652 à 1656. Il revient cependant au théâtre de 1659 à 1674, écrit alors onze pièces dont les meilleures semblent être "Sertorius", "Sophonisbe", "Attila", "Tite et Bérénice", "Suréna". Mais, malgré son prestige, malgré le pouvoir que lui confère sa renommée et le « clan » littéraire qui s'est formé autour de lui, peut-être à cause de l'originalité accrue de son tragique, Corneille voit les échecs se multiplier, au profit notamment du jeune Racine. Ses dix dernières années se passent dans une retraite pieuse, tandis que le public, qui avait peu apprécié ses dernières œuvres, s'intéresse de nouveau à ses grandes tragédies et les applaudit, en France comme à l'étranger. Il meurt le 1er octobre 1684...

"J'ai brûlé fort longtemps d'une amour assez grande, Et que jusqu'au tombeau je dois bien estimer, Puisque ce fut par là que j'appris à rimer." - "Quand Corneille, né en 1606, parvint à l'âge où la poésie et le théâtre durent commencer à l'occuper, Vers 1624, à voir les choses en gros, d'un peu loin, et comme il les vit d'abord du fond de sa province, trois grands noms de poètes, aujourd'hui fort inégalement célèbres, lui apparurent avant tous les autres, savoir : Ronsard, Malherbe et Théophile. Ronsard, mort depuis longtemps, mais encore en possession d'une renommée immense, et représentant la poésie du siècle expiré ; Malherbe vivant, mais déjà vieux, ouvrant la poésie du nouveau siècle, et placé à côté de Ronsard par ceux qui ne regardaient pas de si près aux détails des querelles littéraires; Théophile enfin, jeune, aventureux, ardent, et par l'éclat de ses débuts semblant promettre d'égaler ses devanciers dans un prochain avenir. Quant au théâtre, il était occupé depuis vingt ans par un seul homme, Alexandre Hardy, auteur de troupe, qui ne signait même pas ses pièces sur l'affiche, tant il était notoirement le poète dramatique par excellence. Sa dictature allait cesser, il est vrai; Théophile, par sa tragédie de Pyrame et Thisbé, y avait déjà porté coup; Mairet, Rotrou, Scudéry, étaient près d'arriver à la scène. Mais toutes ces réputations à peine naissantes, qui faisaient l'entretien précieux des ruelles à la mode, cette foule de beaux esprits de second et de troisième ordre, qui fourmillaient autour de Malherbe, au-dessous de Maynard et de Racan, étaient perdus pour le jeune Corneille, qui vivait à Rouen, et delà n'entendait que les grands éclats de la rumeur publique. Ronsard, Malherbe, Théophile et Hardy, composaient donc à peu près sa littérature moderne. Élevé d'ailleurs au collège des jésuites, il y avait puisé une connaissance suffisante de l'antiquité; mais les études du barreau, auquel on le destinait, et qui le menèrent jusqu'à sa vingt et unième année, en 1627, durent retarder le développement de ses goûts poétiques. Pourtant il devint amoureux; et, sans admettre ici l'anecdote invraisemblable racontée par Fontenelle, et surtout sa conclusion spirituellement ridicule, que c'est à cet amour qu'on doit le grand Corneille, il est certain. de l'aveu même de notre auteur, que cette première passion lui donna l'éveil et lui apprit à rimer...." (Sainte-Beuve, Portraits littéraires)

1625 - Corneille, "Mélite, ou les fausses lettres"
Pierre Corneille entre dans la carrière dramatique avec Mélite, une comédie en cinq actes et en vers écrite en 1625 et représentée pour la première fois en décembre 1629 au Jeu de paume de Berthaud par la troupe de Montdory (1594-1653). Cette pièce, totalement oubliée par la réputation du "Cid", rendit pourtant célèbre l'obscur débutant jusqu'à la Cour, et permit à la troupe de Montdory de s'installer définitivement à Paris malgré l'opposition de la Troupe royale de l'Hôtel de Bourgogne. C'est une "comédie" qui apporte alors une véritable révolution dans le paysage théâtral de cette première moitié du XVIIe. Corneille emprunte à la pastorale son schéma de relations entre les jeunes amoureux, leurs dialogues, les trahisons de leur coeur, leurs émotions sentimentales, le personnage de la jeune fille acquiert une épaisseur, le tout soutenu par un langage adapté, fondé le plus qu'il est possible sur la conversation naturelle.
Aux deux deux héros Mélite et Tircís, chacun hostile à l'amour, elle par indifférence et lui par légèreté, s'oppose Eraste, qui courtise Mélite en vain depuis deux ans et représente, lui, l'amour constant. Face à ce trio, un couple d'amoureux déjà formé, Cloris, sœur de Tircís, et Philandre. Eraste, pour convaincre Tircís que l`amour existe et qu`il peut être irrésistible, décide de lui montrer Melite. L`effet est immédiat, Tircís et Mélite tombent amoureux l`un de l`autre. Eraste, désespéré et jaloux, tente de les séparer en écrivant de fausses lettres que Melite aurait envoyées à Philandre : sa vengeance contre Tirsis réussit puisqu`il brise ainsi et son couple et celui que sa sœur Cloris formait avec Philandre. Tandis que Mélite tente en vain de convaincre Cloris de son innocence, on annonce la mort de Tircís : Mélite s'effondre et Eraste devient fou de douleur... Mais l'annonce n'était qu'une feinte pour éprouver les sentiments de Mélite...
Acte I, scène 2 - Eraste, Mélite, Tircis
ERASTE
De deux amis, madame, apaisez la querelle.
Un esclave d'amour le défend d'un rebelle,
Si toutefois un coeur qui n'a jamais aimé,
Fier et vain qu'il en est, peut être ainsi nommé.
Comme, dès le moment que je vous ai servie,
J'ai cru qu'il était seul la véritable vie,
Il n'est pas merveilleux que ce peu de rapport
Entre nos deux esprits sème quelque discord.
Je me suis donc piqué contre sa médisance
Avec tant de malheur, ou tant d'insuffisance,
Que des droits si sacrés et si pleins d'équité
N'ont pu se garantir de sa subtilité,
Et je l'amène ici, n'ayant plus que répondre,
Assuré que vos yeux le sauront mieux confondre.
MELITE
Vous deviez l'assurer plutôt qu'il trouverait,
En ce mépris d'amour, qui le seconderait.
TIRCIS
Si le coeur ne dédit ce que la bouche exprime,
Et ne fait de l'amour une plus haute estime,
Je plains les malheureux à qui vous en donnez,
Comme à d'étranges maux par leur sort destinés.
MELITE
Ce reproche sans cause avec raison m'étonne :
Je ne reçois d'amour et n'en donne à personne.
Les moyens de donner ce que je n'eus jamais ?
ERASTE
Ils vous sont trop aisés ; et par vous désormais
La nature pour moi montre son injustice
A pervertir son cours pour me faire un supplice.
MELITE
Supplice imaginaire, et qui sent son moqueur.
Eraste
Supplice qui déchire et mon âme et mon coeur.
MELITE
Il est rare qu'on porte avec si bon visage
L'âme et le coeur ensemble en si triste équipage.
ERASTE
Votre charmant aspect suspendant mes douleurs,
Mon visage du vôtre emprunte les couleurs.
MELITE
Faites mieux ; pour finir vos maux et votre flamme,
Empruntez tout d'un temps les froideurs de mon âme.
ERASTE
Vous voyant, les froideurs perdent tout leur pouvoir ;
Et vous n'en conservez que faute de vous voir.
MELITE
Eh quoi ! tous les miroirs ont−ils de fausses glaces ?
ERASTE
Penseriez−vous y voir la moindre de vos grâces ?
De si frêles sujets ne sauraient exprimer
Ce que l'amour aux coeurs peut lui seul imprimer ;
Et quand vous en voudrez croire leurs impuissances,
Cette légère idée et faible connaissance
Que vous aurez par eux de tant de raretés
Vous mettra hors de pair de toutes les beautés.
MELITE
Voilà trop vous tenir dans une complaisance
Que vous dussiez quitter, du moins en ma présence,
Et ne démentir pas le rapport de vos yeux,
Afin d'avoir sujet de m'entreprendre mieux.
ERASTE
Le rapport de mes yeux, aux dépens de mes larmes,
Ne m'a que trop appris le pouvoir de vos charmes.
TIRCIS
Sur peine d'être ingrate, il faut de votre part
Reconnaître les dons que le ciel vous départ.
ERASTE
Voyez que d'un second mon droit se fortifie.
MELITE
Voyez que son secours montre qu'il s'en défie.
TIRCIS
Je me range toujours d'avec la vérité.
MELITE
Si vous la voulez suivre, elle est de mon côté.
TIRCIS
Oui, sur votre visage, et non en vos paroles.
Mais cessez de chercher ces refuites frivoles ;
Et prenant désormais des sentiments plus doux,
Ne soyez plus de glace à qui brûle pour vous.
MELITE
Un ennemi d'amour me tenir ce langage !
Accordez votre bouche avec votre courage ;
Pratiquez vos conseils, ou ne m'en donnez pas.
TIRCIS
J'ai connu mon erreur auprès de vos appas.
Il vous l'avait bien dit.
ERASTE
Ainsi donc, par l'issue
Mon âme sur ce point n'a point été déçue ?
TIRCIS
Si tes feux en son coeur produisaient même effet,
Crois−moi, que ton bonheur serait bientôt parfait.
MELITE
Pour voir si peu de chose aussitôt vous dédire,
Me donne à vos dépens de beaux sujets de rire ;
Mais je pourrais bientôt à m'entendre flatter
Concevoir quelque orgueil qu'il vaut mieux éviter.
Excusez ma retraite.
ERASTE
Adieu, belle inhumaine,
De qui seule dépend, et ma joie, et ma peine.
MELITE
Plus sage à l'avenir, quittez ces vains propos,
Et laissez votre esprit et le mien en repos.
Acte I, scène 3 - Eraste, Tircis
ERASTE
Maintenant suis−je un fou ? mérité−je du blâme ?
Que dis−tu de l'objet ? que dis−tu de ma flamme ?
TIRCIS
Que veux−tu que j'en die ? Elle a je ne sais quoi
Qui ne peut consentir que l'on demeure à soi.
Mon coeur, jusqu'à présent à l'amour invincible,
Ne se maintient qu'à force aux termes d'insensible ;
Tout autre que Tircis mourrait pour la servir.
ERASTE
Confesse franchement qu'elle a su te ravir,
Et que tu ne veux pas prendre pour cette belle
Avec le nom d'amant le titre d'infidèle.
Rien que notre amitié ne t'en peut détourner ;
Mais ta muse du moins, facile à suborner,
Avec plaisir déjà prépare quelques veilles
A de puissants efforts pour de telles merveilles.
TIRCIS
En effet, ayant vu tant et de tels appas,
Que je ne rime point, je ne le promets pas.
ERASTE
Tes feux n'iront−ils point plus avant que la rime ?
TIRCIS
Si je brûle jamais, je veux brûler sans crime.
ERASTE
Mais si sans y penser tu te trouvais surpris ?
TIRCIS
Quitte pour décharger mon coeur dans mes écrits.
J'aime bien ces discours de plaintes et d'alarmes,
De soupirs, de sanglots, de tourments et de larmes ;
C'est de quoi fort souvent je bâtis ma chanson,
Mais j'en connais, sans plus, la cadence et le son.
Souffre qu'en un sonnet je m'efforce à dépeindre
Cet agréable feu que tu ne peux éteindre :
Tu le pourras donner comme venant de toi.
ERASTE
Ainsi ce coeur d'acier qui me tient sous sa loi,
Verra ma passion pour le moins en peinture.
Je doute néanmoins qu'en cette portraiture
Tu ne suives plutôt tes propres sentiments.
TIRCIS
Me prépare le ciel de nouveaux châtiments,
Si jamais un tel crime entre dans mon courage !
ERASTE
Adieu. Je suis content, j'ai ta parole en gage,
Et sais trop que l'honneur t'en fera souvenir.
TIRCIS, seul.
En matière d'amour rien n'oblige à tenir ;
Et les meilleurs amis, lorsque son feu les presse,
Font bientôt vanité d'oublier leur promesse.

1632 - "Clitandre, ou l'innocence délivrée"
Mélite ne déplut pas, mais on dit au jeune provincial qu'il n'y avait pas assez d'incidents faisant effet. Dans sa première tragi-comédie, Corneille va donc multiplier dans Clitandre les actions les plus spectaculaires et se flatte d'avoir "mis les accidents mêmes sur la scène" au lieu des "longs et ennuyeux récits", combats, viol et éborgnement, retournement de situations, une esthétique étonnante. Aimées l'une de Clitandre, l'autre de Pymante, les princesses Caliste et Dorise sont toutes deux éprises de Rosidor. Celui-ci rend à Caliste son amour, au grand dépit de Dorise qui, pour perdre sa rivale, l'entraîne dans la forêt, où elle médite de lui donner la mort. Pymante cependant, qui hait Rosidor, a chargé les domestiques de Clitandre d'assassiner son trop heureux rival. Rosidor, poursuivi dans la forêt par Pymante déguisé et ses complices, trouve Dorise qui s'apprête à plonger une épée dans le sein de Caliste, Se saisissant de l'épée, il tue un de ses agresseurs et met Pymante en déroute; puis, plein de rage contre Clitandre, qu'il croit l'auteur de l'agression, il rentre avec Caliste au palais. Dorise de son côté s'est enfuie et, n'osant retourner à la Cour, revêt les vêtements du mort; déguisée, elle erre dans les bois où elle rencontre Pymante qui la reconnaît. et dont elle repousse les assauts en l'éborgnant....
Acte IV, scène 1 - Pymante, Dorise
DORISE
Je te le dis encor, tu perds temps à me suivre ;
Souffre que de tes yeux ta pitié me délivre :
Tu redoubles mes maux par de tels entretiens.
PYMANTE
Prenez à votre tour quelque pitié des miens,
Madame, et tarissez ce déluge de larmes ;
Pour rappeler un mort ce sont de faibles armes ;
Et, quoi que vous conseille un inutile ennui,
Vos cris et vos sanglots ne vont point jusqu'à lui.
DORISE
Si mes sanglots ne vont où mon coeur les envoie,
Du moins par eux mon âme y trouvera la voie ;
S'il lui faut un passage afin de s'envoler,
Ils le lui vont ouvrir en le fermant à l'air.
Sus donc, sus, mes sanglots ! redoublez vos secousses :
Pour un tel désespoir vous les avez trop douces :
Faites pour m'étouffer de plus puissants efforts.
PYMANTE
Ne songez plus, madame, à rejoindre les morts ;
Pensez plutôt à ceux qui n'ont point d'autre envie
Que d'employer pour vous le reste de leur vie ;
Pensez plutôt à ceux dont le service offert
Accepté vous conserve, et refusé vous perd.
DORISE
Crois−tu donc, assassin, m'acquérir par ton crime ?
Qu'innocent méprisé, coupable je t'estime ?
A ce compte, tes feux n'ayant pu m'émouvoir,
Ta noire perfidie obtiendrait ce pouvoir ?
Je chérirais en toi la qualité de traître,
Et mon affection commencerait à naître
Lorsque tout l'univers a droit de te haïr ?
PYMANTE
Si j'oubliai l'honneur jusques à le trahir,
Si, pour vous posséder, mon esprit, tout de flamme,
N'a rien cru de honteux, n'a rien trouvé d'infâme,
Voyez par là, voyez l'excès de mon ardeur :
Par cet aveuglement jugez de sa grandeur.
DORISE
Non, non, ta lâcheté, que j'y vois trop certaine,
N'a servi qu'à donner des raisons à ma haine.
Ainsi ce que j'avais pour toi d'aversion
Vient maintenant d'ailleurs que d'inclination :
C'est la raison, c'est elle à présent qui me guide
Aux mépris que je fais des flammes d'un perfide.
PYMANTE
Je ne sache raison qui s'oppose à mes voeux,
Puisqu'ici la raison n'est que ce que je veux,
Et, ployant dessous moi, permet à mon envie
De recueillir les fruits de vous avoir servie.
Il me faut des faveurs malgré vos cruautés.
DORISE
Exécrable ! ainsi donc tes désirs effrontés
Voudraient sur ma faiblesse user de violence ?
PYMANTE
Je ris de vos refus, et sais trop la licence
Que me donne l'amour en cette occasion.
DORISE, lui crevant l'oeil de son aiguille.
Traître ! ce ne sera qu'à ta confusion.
PYMANTE, portant les mains à son oeil crevé.
Ah, cruelle !
DORISE
Ah, brigand !
PYMANTE
Ah, que viens−tu de faire ?
DORISE
De punir l'attentat d'un infâme corsaire.
PYMANTE, prenant son épée dans la caverne où il l'avait jetée au second acte.
Ton sang m'en répondra ; tu m'auras beau prier,
Tu mourras.
DORISE, à part.
Fuis, Dorise, et laisse−le crier.
Acte IV, scène 2
PYMANTE
Où s'est−elle cachée ? où l'emporte sa fuite ?
Où faut−il que ma rage adresse ma poursuite ?
La tigresse m'échappe, et, telle qu'un éclair,
En me frappant les yeux, elle se perd en l'air ;
Ou plutôt, l'un perdu, l'autre m'est inutile ;
L'un s'offusque du sang qui de l'autre distille.
Coule, coule, mon sang : en de si grands malheurs,
Tu dois avec raison me tenir lieu de pleurs :
Ne verser désormais que des larmes communes,
C'est pleurer lâchement de telles infortunes.
Je vois de tous côtés mon supplice approcher ;
N'osant me découvrir, je ne me puis cacher.
Mon forfait avorté se lit dans ma disgrâce,
Et ces gouttes de sang me font suivre à la trace.
Miraculeux effet ! Pour traître que je sois,
Mon sang l'est encor plus, et sert tout à la fois
De pleurs à ma douleur, d'indices à ma prise,
De peine à mon forfait, de vengeance à Dorise.
O toi qui, secondant son courage inhumain,
Loin d'orner ses cheveux, déshonores sa main,
Exécrable instrument de sa brutale rage,
Tu devais pour le moins respecter son image ;
Ce portrait accompli d'un chef−d'oeuvre des cieux,
Imprimé dans mon coeur, exprimé dans mes yeux,
Quoi que te commandât une âme si cruelle,
Devait être adoré de ta pointe rebelle.
Honteux restes d'amour qui brouillez mon cerveau !
Quoi ! puis−je en ma maîtresse adorer mon bourreau ?
Remettez−vous, mes sens ; rassure−toi, ma rage ;
Reviens, mais reviens seule animer mon courage ;
Tu n'as plus à débattre avec mes passions
L'empire souverain dessus mes actions ;
L'amour vient d'expirer, et ses flammes éteintes
Ne t'imposeront plus leurs infâmes contraintes.
Dorise ne tient plus dedans mon souvenir
Que ce qu'il faut de place à l'ardeur de punir :
Je n'ai plus rien en moi qui n'en veuille à sa vie.
Sus donc, qui me la rend ? Destins, si votre envie,
Si votre haine encor s'obstine à mes tourments,
Jusqu'à me réserver à d'autres châtiments,
Faites que je mérite, en trouvant l'inhumaine,
Par un nouveau forfait, une nouvelle peine,
Et ne me traitez pas avec tant de rigueur
Que mon feu ni mon fer ne touchent point son coeur.
Mais ma fureur se joue, et demi−languissante,
S'amuse au vain éclat d'une voix impuissante.
Recourons aux effets, cherchons de toutes parts ;
Prenons dorénavant pour guides les hasards.
Quiconque ne pourra me montrer la cruelle,
Que son sang aussitôt me réponde pour elle ;
Et ne suivant ainsi qu'une incertaine erreur,
Remplissons tous ces lieux de carnage et d'horreur.
(Une tempête survient.)
Mes menaces déjà font trembler tout le monde :
Le vent fuit d'épouvante, et le tonnerre en gronde ;
L'oeil du ciel s'en retire, et par un voile noir,
N'y pouvant résister, se défend d'en rien voir ;
Cent nuages épais se distillant en larmes,
A force de pitié, veulent m'ôter les armes,
La nature étonnée embrasse mon courroux,
Et veut m'offrir Dorise, ou devancer mes coups.
Tout est de mon parti : le ciel même n'envoie
Tant d'éclairs redoublés qu'afin que je la voie.
Quelques lieux où l'effroi porte ses pas errants,
Ils sont entrecoupés de mille gros torrents.
Que je serais heureux, si cet éclat de foudre,
Pour m'en faire raison, l'avait réduite en poudre !
Allons voir ce miracle, et désarmer nos mains,
Si le ciel a daigné prévenir nos desseins.
Destins, soyez enfin de mon intelligence,
Et vengez mon affront, ou souffrez ma vengeance !

1631 - "La Veuve, ou le Traître trahi", une comédie galante et réaliste qui va installer Corneille parmi les dramaturges de son temps, Scudéry, Du Ryer, Mairet, Rotrou. Il conte l'inclination d'une jeune et riche veuve, Clarice, pour une jeune homme, Philiste, qui n'ose déclarer sa flamme tant il se sait pauvre. Mais il ose enfin, et Clarice, dans des stances qui annoncent celles de Rodrigue (Le Cid, I,6) et de Polyeucte (IV,2), partage son allégresse et son amour avec ses "chers confidents":
Acte III, Scène 8 - Clarice, dans son jardin
Chers confidents de mes désirs,
Beaux lieux, secrets témoins de mon inquiétude,
Ce n'est plus avec des soupirs
Que je viens abuser de votre solitude ;
Mes tourments sont passés,
Mes voeux sont exaucés,
La joie aux maux succède :
Mon sort en ma faveur change sa dure loi,
Et pour dire en un mot le bien que je possède,
Mon Philiste est à moi.
En vain nos inégalités
M'avaient avantagée à mon désavantage.
L'amour confond nos qualités,
Et nous réduit tous deux sous un même esclavage.
L'aveugle outrecuidé
Se croirait mal guidé
Par l'aveugle fortune ;
Et son aveuglement par miracle fait voir
Que quand il nous saisit, l'autre nous importune,
Et n'a plus de pouvoir.
Cher Philiste, à présent tes yeux,
Que j'entendais si bien sans les vouloir entendre,
Et tes propos mystérieux,
Par leurs rusés détours n'ont plus rien à m'apprendre.
Notre libre entretien
Ne dissimule rien ;
Et ces respects farouches
N'exerçant plus sur nous de secrètes rigueurs,
L'amour est maintenant le maître de nos bouches
Ainsi que de nos coeurs.
Qu'il fait bon avoir enduré !
Que le plaisir se goûte au sortir des supplices !
Et qu'après avoir tant duré,
La peine qui n'est plus augmente nos délices !
Qu'un si doux souvenir
M'apprête à l'avenir
D'amoureuses tendresses !
Que mes malheurs finis auront de volupté !
Et que j'estimerai chèrement ces caresses
Qui m'auront tant coûté !
Mon heur me semble sans pareil ;
Depuis qu'en liberté notre amour m'en assure,
Je ne crois pas que le soleil...
Acte II, scène 4, on y trouve peut-être la plus jolie « déclaration » du monde...
PHILISTE.
Madame, excusez-moi, je sais mieux reconnaître
Mes défauts, et le peu que le ciel m'a fait naître.
CLARICE.
N'oublierez-vous jamais ces termes ravalés,
Pour vous priser de bouche autant que vous valez ?
Seriez-vous bien content qu'on crût ce que vous dites ?
Demeurez avec moi d'accord de vos mérites ;
Laissez-moi me flatter de cette vanité,
Que j'ai quelque pouvoir sur votre liberté,
Et qu'une humeur si froide, à toute autre invincible,
Ne perd qu'auprès de moi le titre d'insensible :
Une si douce erreur tâche à s'autoriser ;
Quel plaisir prenez-vous à m'en désabuser ?
PHILISTE.
Ce n'est point une erreur ; pardonnez-moi, madame,
Ce sont les mouvements les plus sains de mon âme.
Il est vrai, je vous aime, et mes feux indiscrets
Se donnent leur supplice en demeurant secrets.
Je reçois sans contrainte une ardeur téméraire ;
Mais si j'ose brûler, je sais aussi me taire ;
Et près de votre objet, mon unique vainqueur,
Je puis tout sur ma langue, et rien dessus mon coeur.
En vain j'avais appris que la seule espérance
Entretenait l'amour dans la persévérance :
J'aime sans espérer, et mon coeur enflammé
A pour but de vous plaire, et non pas d'être aimé.
L'amour devient servile, alors qu'il se dispense
À n'allumer ses feux que pour la récompense.
Ma flamme est toute pure, et sans rien présumer,
Je ne cherche en aimant que le seul bien d'aimer.
CLARICE.
Et celui d'être aimé, sans que tu le prétendes,
Préviendra tes désirs et tes justes demandes.
Ne déguisons plus rien, cher Philiste : il est temps
Qu'un aveu mutuel rende nos voeux contents.
Donnons-leur, je te prie, une entière assurance ;
Vengeons-nous à loisir de notre indifférence,
Vengeons-nous à loisir de toutes ces langueurs
Où sa fausse couleur avait réduit nos coeurs.
PHILISTE.
Vous me jouez, madame, et cette accorte feinte
Ne donne à mon amour qu'une railleuse atteinte.
CLARICE.
Quelle façon étrange ! En me voyant brûler,
Tu t'obstines encore à le dissimuler ;
Tu veux qu'encore un coup je me donne la honte
De te dire à quel point l'amour pour toi me dompte :
Tu le vois cependant avec pleine clarté,
Et veux douter encore de cette vérité ?
PHILISTE.
Oui, j'en doute, et l'excès du bonheur qui m'accable
Me surprend, me confond, me paraît incroyable.
Madame, est-il possible ? Et me puis-je assurer
D'un bien à quoi mes voeux n'oseraient aspirer ?

1634 - "La Place royale, ou l'Amoureux extravagant"
"La Galerie du Palais" puis "La Place royale", comédie représentée pour la première fois au théâtre du Marais entre août 1633 et mars 1634, innovent en déroulant l'intrigue dans un décor réel, familier pour le public, loin des schémas pastoraux sur lesquels étaient construites les quatre premières comédies. "La Place royale" étant peut-être l'exemple le plus abouti de la comédie cornélienne. Elle traite des rapports de l'amour et de la liberté, problématique qui n'est pas totalement étrangère à celle du héros cornélien dans les tragédies. Le héros Alidor souffre d'aimer car l'amour aliène sa liberté. Par son attitude, il en viendra à causer le malheur d'Angélique, son amante, qui entrera au couvent, puis le sien propre s'apercevant trop tardivement de sa folie...
Des caractères originaux surgissent ici, Phylis, enjouée, frivole, qui se plaît à traîner après elle de nombreux adorateurs et à les rendre jaloux l'un de l'autre, quitte à épouser joyeusement celui que le hasard des événements aura conduit jusqu'au mariage. Angélique est toute au contraire une pathétique figure d'amoureuse, en dehors d'Alidor, nul n'existe pour elle, et sa trahison la laissera désemparée. Enfin Alidor, qui aime sincèrement Angélique mais veut se dégager de cet amour partagé, afin de sauvegarder son indépendance morale: Angélique est trop belle pour lui et se sent enfermé dans un esclavage de sentiment qu'il juge déshonorant....
Acte II - Scène 4 - Angélique, Phylis
ANGELIQUE
Le croirais−tu, Phylis ? Alidor m'abandonne.
PHYLIS
Pourquoi non ? Je n'y vois rien du tout qui m'étonne,
Rien qui ne soit possible, et de plus fort commun.
La constance est un bien qu'on ne voit en pas un.
Tout change sous les cieux, mais partout bon remède.
ANGELIQUE
Le ciel n'en a point fait au mal qui me possède.
PHYLIS
Choisis de mes amants, sans t'affliger si fort,
Et n'appréhende pas de me faire grand tort ;
J'en pourrais, au besoin, fournir toute la ville,
Qu'il m'en demeurerait encor plus de deux mille.
ANGELIQUE
Tu me ferais mourir avec de tels propos ;
Ah ! laisse−moi plutôt soupirer en repos,
Ma soeur.
PHYLIS
Plût au bon Dieu que tu voulusses l'être !
ANGELIQUE
Eh quoi ! tu ris encor ! C'est bien faire paraître...
PHYLIS
Que je ne saurais voir d'un visage affligé
Ta cruauté punie, et mon frère vengé.
Après tout, je connais quelle est ta maladie :
Tu vois comme Alidor est plein de perfidie ;
Mais je mets dans deux jours ma tête à l'abandon
Au cas qu'un repentir n'obtienne son pardon.
ANGELIQUE
Après que cet ingrat me quitte pour Clarine ?
PHYLIS
De le garder longtemps elle n'a pas la mine ;
Et j'estime si peu ces nouvelles amours,
Que je te pleige encor son retour dans deux jours ;
Et lors ne pense pas, quoi que tu te proposes,
Que de tes volontés devant lui tu disposes.
Prépare tes dédains, arme−toi de rigueur,
Une larme, un soupir te percera le coeur ;
Et je serai ravie alors de voir vos flammes
Brûler mieux que devant, et rejoindre vos âmes.
Mais j'en crains un succès à ta confusion :
Qui change une fois change à toute occasion ;
Et nous verrons toujours, si Dieu le laisse vivre,
Un change, un repentir, un pardon, s'entre−suivre.
Ce dernier est souvent l'amorce d'un forfait,
Et l'on cesse de craindre un courroux sans effet.
ANGELIQUE
Sa faute a trop d'excès pour être rémissible,
Ma soeur ; je ne suis pas de la sorte insensible :
Et si je présumais que mon trop de bonté
Pût jamais se résoudre à cette lâcheté,
Qu'un si honteux pardon pût suivre cette offense,
J'en préviendrais le coup, m'en ôtant la puissance.
Adieu : dans la colère où je suis aujourd'hui,
J'accepterais plutôt un barbare que lui.
1634 - L'art d'apprivoiser les règles - Du temps de "Clitandre", Corneille se moquait des règles. Préface de Clitandre: « Je me donne la liberté de choquer les anciens d'autant mieux qu'ils ne sont pas en état de me répondre. » Mais à partir de "La Suivante", en 1634 (il est chez Richelieu) il devient à la fois, à l'égard des règles, très respectueux et très chicaneur. Dans "La Suivante" on y voit une demoiselle de compagnie chercher à supplanter sa maîtresse, semer la zizanie entre des amants, aboutir au malheur de tous, mais aussi au sien, et on y rencontre un vieillard amoureux, le premier dans Corneille, mais antipathique et odieux. Préface de la Suivante: "Les règles des anciens sont assez religieusement observées ici. Il n'y a qu'une action principale à quoi toutes les autres aboutissent; son lieu n'a pas plus d'étendue que celle du théâtre et le temps n'en est pas plus long que celui de la représentation, si vous en exceptez l'heure du dîner qui se passe entre le premier et le second acte. La liaison même des scènes, qui n'est qu'un embellissement et non pas un précepte, y est gardée et si vous prenez la peine de compter les vers vous n'en trouverez pas en un acte plus qu'en l'autre. Ce n'est pas que je me sois assujetti depuis aux mêmes rigueurs. J'aime à suivre les règles; mais, loin de me rendre leur esclave, je les élargis et resserre selon le besoin qu'en a mon sujet, et je romps même sans scrupule celle qui regarde la durée de l'action quand sa sévérité me semble absolument incompatible avec les beautés des événements que je décris. Savoir les règles et entendre le secret de les apprivoiser adroitement avec notre théâtre, ce sont deux sciences bien différentes, et peut-être que pour faire maintenant réussir une pièce ce n'est pas assez d'avoir étudié dans les livres d'Aristote et d'Horace..."
1635 - Jean de Mairet (1604-1686) remet en vogue la tragédie avec la "Sophonisbe", chef d'oeuvre de l'auteur et toute première observant la règle des trois unités. La tragédie fut jouée devant Louis XIII et obtint un tel succès que son auteur se vit accorder une pension de Richelieu. Mais le succès de Mairet s'estompa rapidement lorsque Corneille décida de s'essayer à la tragédie. Première tentative en 1635 avec "Médée", inspirée par les tragédies d'Euripide et de Sénèque, puis se tourne vers l'Espagne : c'est que depuis le XVIe siècle, à Rouen, une importante colonie espagnole y habite. Il tire le "Matamore" de L'Illusion comique" des "Rodomontades espagnoles" puis des "Enfances du Cid" de Guillen de Castro, Le Cid..

1635 - "La Médée"
La Médée en cinq actes de Pierre Corneille fut représentée à Paris en 1635, l'auteur hésitant entre pièce spectaculaire, fable et violence du drame. A Corinthe, où Médée et Jason se sont réfugiés après l'enlèvement de la Toison d`or, Jason, poussé par l'ambition, décide de s'unir à Créüse pour s`assurer la protection de son père Créon. roi de Thèbes. Médée va donc quitter son époux et son pays, mais se vengera. Créüse manifeste alors le désir de revêtir la robe de l`abandonnée; Jason consent à ce caprice. En vain, Médée lui rappelle tout ce qu`elle a fait pour lui : Jason lui ordonne de partir, sinon Créon n'épargnera ni sa vie ni celle de ses fils, Voyant cela, Médée répand les poisons les plus nocifs sur la robe que convoite Créüse. puis, par l'effet de sa magie, libère Egée, roi d`Athènes, prétendant à la main de Créüse, que Jason avait vaincu et fait prisonnier. Ayant mis le vêtement empoisonné, la nouvelle épouse meurt et le père de celle-ci, accouru pour la secourir, succombe lui aussi. Jason décide de les venger en immolant ses propres fils sur leur sépulture parce qu`ils ont été, en apportant la robe fatale, les instruments de mort de leur mère; mais elle l`a devancé en les tuant elle-même et, après l'avoir provoqué, elle s`élève d`un balcon dans les airs et disparaît dans un char tiré par deux dragons. Le malheureux se tue. Reste le "moi" de Médée et sa fameuse réplique, "Moi, dis-je, et c`est assez", par laquelle la magicienne affirme qu`elle ne trouve qu'en elle-même sa seule raison de vivre...
Acte I, Scène V - Médée, Nérine
MEDEE
Et bien ! Nérine, à quand, à quand cet hyménée ?
En ont−ils choisi l'heure ? en sais−tu la journée ?
N'en as−tu rien appris ? n'as−tu point vu Jason ?
N'appréhende−t−il rien après sa trahison ?
Croit−il qu'en cet affront je m'amuse à me plaindre ?
S'il cesse de m'aimer, qu'il commence à me craindre.
Il verra, le perfide, à quel comble d'horreur
De mes ressentiments peut monter la fureur.
NERINE
Modérez les bouillons de cette violence,
Et laissez déguiser vos douleurs au silence.
Quoi ! madame, est−ce ainsi qu'il faut dissimuler ?
Et faut−il perdre ainsi des menaces en l'air ?
Les plus ardents transports d'une haine connue
Ne sont qu'autant d'éclairs avortés dans la nue,
Qu'autant d'avis à ceux que vous voulez punir,
Pour repousser vos coups, ou pour les prévenir.
Qui peut sans s'émouvoir supporter une offense,
Peut mieux prendre à son point le temps de sa vengeance ;
Et sa feinte douceur, sous un appas mortel,
Mène insensiblement sa victime à l'autel.
MEDEE
Tu veux que je me taise et que je dissimule !
Nérine, porte ailleurs ce conseil ridicule ;
L'âme en est incapable en de moindres malheurs,
Et n'a point où cacher de pareilles douleurs.
Jason m'a fait trahir mon pays et mon père,
Et me laisse au milieu d'une terre étrangère,
Sans support, sans amis, sans retraite, sans bien,
La fable de son peuple et la haine du mien :
Nérine, après cela tu veux que je me taise !
Ne dois−je point encore en témoigner de l'aise,
De ce royal hymen souhaiter l'heureux jour,
Et forcer tous mes soins à servir son amour ?
NERINE
Madame, pensez mieux à l'éclat que vous faites.
Quelque juste qu'il soit, regardez où vous êtes ;
Considérez qu'à peine un esprit plus remis
Vous tient en sûreté parmi vos ennemis.
MEDEE
L'âme doit se roidir plus elle est menacée,
Et contre la fortune aller tête baissée,
La choquer hardiment, et sans craindre la mort
Se présenter de front à son plus rude effort.
Cette lâche ennemie a peur des grands courages,
Et sur ceux qu'elle abat redouble ses outrages.
NERINE
Que sert ce grand courage où l'on est sans pouvoir ?
MEDEE
Il trouve toujours lieu de se faire valoir.
NERINE
Forcez l'aveuglement dont vous êtes séduite,
Pour voir en quel état le sort vous a réduite.
Votre pays vous hait, votre époux est sans foi :
Dans un si grand revers que vous reste−t−il ?
MEDEE
Moi,
Moi, dis−je, et c'est assez.
NERINE
Quoi ! vous seule, madame ?
MEDEE
Oui, tu vois en moi seule et le fer et la flamme,
Et la terre, et la mer, et l'enfer, et les cieux,
Et le sceptre des rois, et le foudre des dieux.
NERINE
L'impétueuse ardeur d'un courage sensible
A vos ressentiments figure tout possible :
Mais il faut craindre un roi fort de tant de sujets.
MEDEE
Mon père, qui l'était, rompit−il mes projets ?
NERINE
Non ; mais il fut surpris, et Créon se défie.
Fuyez, qu'à ses soupçons il ne vous sacrifie.
MEDEE
Las ! je n'ai que trop fui ; cette infidélité
D'un juste châtiment punit ma lâcheté.
Si je n'eusse point fui pour la mort de Pélie,
Si j'eusse tenu bon dedans la Thessalie,
Il n'eût point vu Créuse, et cet objet nouveau
N'eût point de notre hymen étouffé le flambeau.
NERINE
Fuyez encor, de grâce.
MEDEE
Oui, je fuirai, Nérine ;
Mais, avant, de Créon on verra la ruine.
Je brave la fortune, et toute sa rigueur
En m'ôtant un mari ne m'ôte pas le coeur ;
Sois seulement fidèle, et sans te mettre en peine,
Laisse agir pleinement mon savoir et ma haine.
NERINE, seule.
Madame... Elle me quitte au lieu de m'écouter,
Ces violents transports la vont précipiter,
D'une trop juste ardeur l'inexorable envie
Lui fait abandonner le souci de sa vie.
Tâchons encore un coup d'en divertir le cours.
Apaiser sa fureur, c'est conserver ses jours.
1636 - "L'Illusion Comique"
"L'Illusion comique" et "Le Menteur" appartiennent au comique proprement dit (le personnage de Matamore, dans l'Illusion comique, est directement issu de la commedia dell'arte). En outre, elles relèvent pleinement de l'esthétique baroque, abordant les thèmes de la métamorphose et de l'illusion et présentant le monde comme un théâtre. "L'Illusion comique" joue plus particulièrement de l'ambivalence entre l'être et le paraître, entre la vie et le spectacle. Cette pièce est d'une nature composite, et Corneille lui-même, dans l'épître préliminaire, la décrit comme «un étrange monstre […]. Le premier acte n'est qu'un prologue, les trois suivants sont une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie». Toute l'originalité de l'oeuvre vient de sa structure singulière dite du "théâtre dans le théâtre", avec une variété de lieux rassemblée dans un lieu unique, une multiplicité d'actions dans une même histoire. L'expérience fut bien reçue du public. Au centre donc de "L'Illusion comique", une caricature d'héroïsme, le soldat fanfaron, Gascon Matamore, le pourfendeur de Mores. Inquiet du sort de son fils Clindor, qui a fui la maison paternelle, Pridamant vient consulter le magicien Alcandre qui lui révèle que le jeune homme est au service du capitan Matamore. Au centre, Isabelle, aimée de Clindor, convoitée par Matamore et promise à Adraste par son père...
L'Illusion comique, acte II, scène 2 - Matamore, Clindor
CLINDOR
Quoi ! monsieur, vous rêvez ! et cette âme hautaine,
Après tant de beaux faits, semble être encore en peine !
N'êtes−vous point lassé d'abattre des guerriers,
Et vous faut−il encor quelques nouveaux lauriers ?
MATAMORE
Il est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre
Lequel je dois des deux le premier mettre en poudre,
Du grand sophi de Perse, ou bien du grand mogor.
CLINDOR
Eh ! de grâce, monsieur, laissez−les vivre encor.
Qu'ajouterait leur perte à votre renommée ?
D'ailleurs, quand auriez−vous rassemblé votre armée ?
MATAMORE
Mon armée ? Ah ! poltron ! ah ! traître ! pour leur mort
Tu crois donc que ce bras ne soit pas assez fort ?
Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,
Défait les escadrons, et gagne les batailles.
Mon courage invaincu contre les empereurs
N'arme que la moitié de ses moindres fureurs ;
D'un seul commandement que je fais aux trois Parques,
Je dépeuple l'Etat des plus heureux monarques ;
Le foudre est mon canon, les Destins mes soldats :
Je couche d'un revers mille ennemis à bas.
D'un souffle je réduis leurs projets en fumée ;
Et tu m'oses parler cependant d'une armée !
Tu n'auras plus l'honneur de voir un second Mars ;
Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards,
Veillaque. Toutefois, je songe à ma maîtresse ;
Ce penser m'adoucit. Va, ma colère cesse,
Et ce petit archer qui dompte tous les dieux
Vient de chasser la mort qui logeait dans mes yeux.
Regarde, j'ai quitté cette effroyable mine
Qui massacre, détruit, brise, brûle, extermine ;
Et, pensant au bel oeil qui tient ma liberté,
Je ne suis plus qu'amour, que grâce, que beauté.
CLINDOR
O dieux ! en un moment que tout vous est possible !
Je vous vois aussi beau que vous étiez terrible,
Et ne crois point d'objet si ferme en sa rigueur,
Qu'il puisse constamment vous refuser son coeur.
MATAMORE
Je te le dis encor, ne sois plus en alarme :
Quand je veux, j'épouvante ; et quand je veux, je charme ;
Et, selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour
Les hommes de terreur, et les femmes d'amour.
Du temps que ma beauté m'était inséparable,
Leurs persécutions me rendaient misérable ;
Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer ;
Mille mouraient par jour à force de m'aimer :
J'avais des rendez−vous de toutes les princesses ;
Les reines à l'envi mendiaient mes caresses ;
Celle d'Ethiopie, et celle du Japon,
Dans leurs soupirs d'amour ne mêlaient que mon nom.
De passion pour moi deux sultanes troublèrent ;
Deux autres, pour me voir, du sérail s'échappèrent :
J'en fus mal quelque temps avec le Grand Seigneur.
CLINDOR
Son mécontentement n'allait qu'à votre honneur.
MATAMORE
Ces pratiques nuisaient à mes desseins de guerre,
Et pouvaient m'empêcher de conquérir la terre.
D'ailleurs, j'en devins las ; et pour les arrêter,
J'envoyai le Destin dire à son Jupiter
Qu'il trouvât un moyen qui fît cesser les flammes
Et l'importunité dont m'accablaient les dames :
Qu'autrement ma colère irait dedans les cieux
Le dégrader soudain de l'empire des dieux,
Et donnerait à Mars à gouverner sa foudre.
La frayeur qu'il en eut le fit bientôt résoudre :
Ce que je demandais fut prêt en un moment ;
Et depuis, je suis beau quand je veux seulement.
CLINDOR
Que j'aurais, sans cela, de poulets à vous rendre !
MATAMORE
De quelle que ce soit, garde−toi bien d'en prendre,
Sinon de... Tu m'entends ? Que dit−elle de moi ?
CLINDOR
Que vous êtes des coeurs et le charme et l'effroi ;
Et que si quelque effet peut suivre vos promesses,
Son sort est plus heureux que celui des déesses.
MATAMORE
Ecoute. En ce temps−là, dont tantôt je parlois,
Les déesses aussi se rangeaient sous mes lois ;
Et je te veux conter une étrange aventure
Qui jeta du désordre en toute la nature,
Mais désordre aussi grand qu'on en voie arriver.
Le Soleil fut un jour sans se pouvoir lever,
Et ce visible dieu, que tant de monde adore,
Pour marcher devant lui ne trouvait point d'Aurore :
On la cherchait partout, au lit du vieux Tithon,
Dans les bois de Céphale, au palais de Memnon ;
Et faute de trouver cette belle fourrière,
Le jour jusqu'à midi se passa sans lumière.
CLINDOR
Où pouvait être alors la reine des clartés ?
MATAMORE
Au milieu de ma chambre à m'offrir ses beautés :
Elle y perdit son temps, elle y perdit ses larmes ;
Mon coeur fut insensible à ses plus puissants charmes ;
Et tout ce qu'elle obtint pour son frivole amour
Fut un ordre précis d'aller rendre le jour.
CLINDOR
Cet étrange accident me revient en mémoire,
J'étais lors en Mexique, où j'en appris l'histoire
Et j'entendis conter que la Perse en courroux
De l'affront de son dieu murmurait contre vous.
MATAMORE
J'en ouïs quelque chose, et je l'eusse punie ;
Mais j'étais engagé dans la Transylvanie,
Où ses ambassadeurs, qui vinrent l'excuser,
A force de présents me surent apaiser.
CLINDOR
Que la clémence est belle en un si grand courage !
MATAMORE
Contemple, mon ami, contemple ce visage ;
Tu vois un abrégé de toutes les vertus.
D'un monde d'ennemis sous mes pieds abattus,
Dont la race est périe, et la terre déserte,
Pas un qu'à son orgueil n'a jamais dû sa perte :
Tous ceux qui font hommage à mes perfections
Conservent leurs Etats par leurs submissions.
En Europe, où les rois sont d'une humeur civile,
Je ne leur rase point de château ni de ville ;
Je les souffre régner ; mais, chez les Africains,
Partout où j'ai trouvé des rois un peu trop vains,
J'ai détruit les pays pour punir leurs monarques ;
Et leurs vastes déserts en sont de bonnes marques ;
Ces grands sables qu'à peine on passe sans horreur
Sont d'assez beaux effets de ma juste fureur.
CLINDOR
Revenons à l'amour : voici votre maîtresse.
MATAMORE
Ce diable de rival l'accompagne sans cesse.
CLINDOR
Où vous retirez−vous ?
MATAMORE
Ce fat n'est pas vaillant,
Mais il a quelque humeur qui le rend insolent.
Peut−être qu'orgueilleux d'être avec cette belle,
Il serait assez vain pour me faire querelle.
CLINDOR
Ce serait bien courir lui−même à son malheur.
MATAMORE
Lorsque j'ai ma beauté, je n'ai point de valeur.
CLINDOR
Cessez d'être charmant, et faites−vous terrible.
MATAMORE
Mais tu n'en prévois pas l'accident infaillible :
Je ne saurais me faire effroyable à demi ;
Je tuerais ma maîtresse avec mon ennemi.
Attendons en ce coin l'heure qui les sépare.
CLINDOR
Comme votre valeur, votre prudence est rare.
"Le Menteur", qui annonce Molière, imitée de "La Vérité suspecte" de l'espagnol Jean Ruiz de Alarcon, dont l'intrigue, comme son titre le laisse supposer, est fondée sur les mensonges du héros, est une pièce à rebondissements, où les personnages ne sont jamais confrontés à ceux à qui ils croient avoir affaire: ici, chacun trouve sa vérité en pensant la fuir. La pièce fut représentée en 1644 et Julien Bedeau, dit Jodelet, le plus fameux acteur comique du deuxième tiers du XVIIe siècle, incarnait le valet du jeune héros Dorante, Cliton. "La Suite du Menteur", donnée en , est inspirée d'une pièce de Lope de Vega, "Aimer sans savoir qui", mélange d'intrigue romanesque et de passages burlesques. Corneille, après la Suite du Menteur, ne revint jamais à la comédie si ce n'est pour collaborer avec Molière à" Psyché"...
"Le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes" - Corneille fait dans le même temps l'éloge du théâtre, celui-ci est devenu le délices des plus honnêtes gens et est même, pour les comédiens, un métier des plus lucratifs, ce qui prouve qu'il a bien changé:
A présent le théâtre
Est en un point si haut que chacun l'idolâtre,
Et ce que votre temps voyait avec mépris
Est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits,
L'entretien de Paris, le souhait des provinces,
Le divertissement le plus doux de nos princes,
Les délices du peuple et le plaisir des grands:
Il tient le premier rang parmi leurs passe-temps;
Et ceux dont nous voyons la sagesse profonde
Par ses illustres soins conserver tout le monde,
Trouvent dans les douceurs d'un spectacle si beau
De quoi se délasser d'un si pesant fardeau.
Même notre grand roi, ce foudre de la guerre,
Dont le nom se fait craindre aux deux bouts de la terre,
Le front ceint de lauriers, daigne bien quelquefois
Prêter l'œil et l'oreille au théâtre françois :
C'est là que le Parnasse étale ses merveilles;
Les plus rares esprits lui consacrent leurs veilles;
Et tous ceux qu'Apollon voit d'un meilleur regard
De leurs doctes travaux lui donnent quelque part."

1637 - "Le Cid"
En 1636, Le Cid rendit célèbre Pierre Corneille, et inaugure une série de chefs-d'œuvre tragiques, Horace, Cinna, Polyeucte (1640 à 1643), puis La Mort de Pompée et Rodogune (entre 1643 et 1646), Nicomède (1651). Pendant cette période, Corneille écrivit encore une comédie, Le Menteur, puis la Suite du Menteur, mais sa gloire est désormais celle d'un auteur tragique. Cette gloire et l'enthousiasme du public pour ses ouvrages et pour sa personne étaient immense. La fameuse querelle du Cid naquit sans doute de conflits d'intérêts divers et des jalousies aiguisées par le succès de la pièce, mais elle donna lieu à un débat intéressant qui nous renseigne a posteriori sur la formation de l'esthétique classique. En effet, ses ennemis reprochèrent à Corneille de n'avoir pas respecté tout ce qui constitue l'idéal classique au théâtre, notamment les règles de la vraisemblance et de la bienséance, celle des trois unités, ainsi que celle qui préconise la séparation distincte des tons et des genres.
Rodrigue (le "Cid" = "Seigneur") est le fils de don Diègue et l'amant de Chimène, elle-même fille du comte de Gormas, lequel a giflé don Diègue suite à une querelle qui les opposait sur la fonction de gouverneur du prince. Du fait de son grand âge, don Diègue ne peut se venger et demande à son fils de retrouver un honneur perdu...
Le Cid - Acte I, scène IV
DON DIÉGUE
ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers
Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ?
Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire,
Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire,
Tant de fois affermi le trône de son roi,
Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ?
ô cruel souvenir de ma gloire passée !
Oeuvre de tant de jours en un jour effacée !
Nouvelle dignité fatale à mon bonheur !
Précipice élevé d'où tombe mon honneur !
Faut-il de votre éclat voir triompher le comte,
Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ?
Comte, sois de mon prince à présent gouverneur ;
Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur ;
Et ton jaloux orgueil par cet affront insigne
Malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne.
Et toi, de mes exploits glorieux instrument,
Mais d'un corps tout de glace inutile ornement,
Fer jadis tant à craindre, et qui, dans cette offense,
M'as servi de parade, et non pas de défense,
Va, quitte désormais le dernier des humains,
Passe, pour me venger en de meilleures mains.
Le Cid - Acte I, scène 5
DON DIÈGUE
Rodrigue, as-tu du cœur ?
DON RODRIGUE
Tout autre que mon père
L'éprouverait sur l'heure.
DON DIÈGUE
Agréable colère !
Digne ressentiment à ma douleur bien doux !
Je reconnais mon sang à ce noble courroux ;
Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte.
Viens, mon fils, viens, mon sang, viens réparer ma honte ;
Viens me venger.
DON RODRIGUE
De quoi ?
DON DIÈGUE
D'un affront si cruel,
Qu'à l'honneur de tous deux il porte un coup mortel :
D'un soufflet. L'insolent en eût perdu la vie ;
Mais mon âge a trompé ma généreuse envie ;
Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir,
Je le remets au tien pour venger et punir.
Va contre un arrogant éprouver ton courage :
Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage ;
Meurs ou tue. Au surplus, pour ne te point flatter,
Je te donne à combattre un homme à redouter ;
Je l'ai vu, tout couvert de sang et de poussière,
Porter partout l'effroi dans une armée entière.
J'ai vu par sa valeur cent escadrons rompus ;
Et pour t'en dire encor quelque chose de plus,
Plus que brave soldat, plus que grand capitaine,
C'est...
DON RODRIGUE
De grâce, achevez.
DON DIÈGUE
Le père de Chimène.
DON RODRIGUE
Le...
DON DIÈGUE
Ne réplique point, je connais ton amour,
Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour ;
Plus l'offenseur est cher, et plus grande est l'offense.
Enfin tu sais l'affront, et tu tiens la vengeance :
Je ne te dis plus rien. Venge-moi, venge-toi ;
Montre-toi digne fils d'un père tel que moi.
Accablé des malheurs où le destin me range,
Je vais les déplorer. Va, cours, vole, et nous venge.
Acte II, scène 2 - "Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées La valeur n'attend point le nombre des années", un exemple parmi d'autres du fameux "sublime" que Corneille atteint dans ses formules d'une concision héroïques, des répliques qui se heurtent comme des épées et qui feront sa gloire ...
DON RODRIGUE
À moi, comte, deux mots.
LE COMTE
Parle.
DON RODRIGUE
ôte-moi d'un doute.
Connais-tu bien don Diègue ?
LE COMTE
Oui.
DON RODRIGUE
Parlons bas ; écoute.
Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu,
La vaillance et l'honneur de son temps ? le sais-tu ?
LE COMTE
Peut-être.
DON RODRIGUE
Cette ardeur que dans les yeux je porte,
Sais-tu que c'est son sang ? le sais-tu ?
LE COMTE
Que m'importe ?
DON RODRIGUE
À quatre pas d'ici je te le fais savoir.
LE COMTE
Jeune présomptueux!
DON RODRIGUE
Parle sans t'émouvoir.
Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années.
LE COMTE
Te mesurer à moi ! qui t'a rendu si vain,
Toi qu'on n'a jamais vu les armes à la main !
DON RODRIGUE
Mes pareils à deux fois ne se font point connaître,
Et pour leurs coups d'essai veulent des coups de maître.
LE COMTE
Sais-tu bien qui je suis ?
DON RODRIGUE
Oui ; tout autre que moi
Au seul bruit de ton nom pourrait trembler d'effroi.
Les palmes dont je vois ta tête si couverte
Semblent porter écrit le destin de ma perte.
J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur,
Mais j'aurai trop de force, ayant assez de coeur.
À qui venge son père il n'est rien d'impossible.
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible.
LE COMTE
Ce grand coeur qui paraît aux discours que tu tiens
Par tes yeux, chaque jour, se découvrait aux miens ;
Et croyant voir en toi l'honneur de la Castille,
Mon âme avec plaisir te destinait ma fille.
Je sais ta passion, et suis ravi de voir
Que tous ses mouvements cèdent à ton devoir ;
Qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime ;
Que ta haute vertu répond à mon estime ;
Et que, voulant pour gendre un cavalier parfait,
Je ne me trompais point au choix que j'avais fait.
Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse ;
J'admire ton courage, et je plains ta jeunesse.
Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal ;
Dispense ma valeur d'un combat inégal ;
Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire :
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
On te croirait toujours abattu sans effort ;
Et j'aurais seulement le regret de ta mort.
DON RODRIGUE
D'une indigne pitié ton audace est suivie :
Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter la vie !
LE COMTE
Retire-toi d'ici.
DON RODRIGUE
Marchons sans discourir.
LE COMTE
Es-tu si las de vivre ?
DON RODRIGUE
As-tu peur de mourir ?
LE COMTE
Viens, tu fais ton devoir et le fils dégénère
Qui survit un moment à l'honneur de son père.
Le Cid - Acte III, scène 4 - Rodrigue, après avoir tué en duel le père de sa fiancée Chimène, est revenu la voir. L'entrevue est surprenante et contraire à toutes les règles dites de bienséances, mais il s'agit de deux héros cornéliens d'une grandeur et d'une noblesse
exceptionnelles, Rodrigue assume pleinement son acte (Je le ferais encore si j'avais à le faire) et demande à mourir de la main de Chimène. Et Chimène ne saurait aimer un homme sans honneur et se plie, elle aussi, à la nécessité de devoir de demander sa mort. Les deux amants sont à la fois ardemment épris l'un de l'autre, et violemment opposés l'un à l'autre par leur devoir, mais le dialogue se transforme en un singulier et poétique duo d'amour...
DON RODRIGUE
Eh bien ! sans vous donner la peine de poursuivre,
Assurez-vous l'honneur de m'empêcher de vivre.
CHIMÉNE
Elvire, où sommes-nous, et qu'est-ce que je vois ?
Rodrigue en ma maison ! Rodrigue devant moi !
DON RODRIGUE
N'épargnez point mon sang ; goûtez, sans résistance,
La douceur de ma perte et de votre vengeance.
CHIMÉNE
Hélas !
DON RODRIGUE
Écoute-moi.
CHIMÉNE
Je me meurs.
DON RODRIGUE
Un moment.
CHIMÉNE
Va, laisse-moi mourir.
DON RODRIGUE
Quatre mots seulement ;
Après, ne me réponds qu'avec cette épée.
CHIMÉNE
Quoi ! du sang de mon père encore toute trempée !
DON RODRIGUE
Ma Chiméne...
CHIMÉNE
ôte-moi cet objet odieux,
Qui reproche ton crime et ta vie à mes yeux.
DON RODRIGUE
Regarde-le plutôt pour exciter ta haine,
Pour croître ta colère, et pour hâter ma peine.
CHIMÉNE
Il est teint de mon sang.
DON RODRIGUE
Plonge-le dans le mien,
Et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien.
CHIMÉNE
Ah ! quelle cruauté, qui tout en un jour tue Le père par le fer, la fille par la vue !
ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir :
Tu veux que je t'écoute, et tu me fais mourir !
DON RODRIGUE
Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie
De finir par tes mains ma déplorable vie ;
Car enfin n'attends pas de mon affection
Un lâche repentir d'une bonne action.
L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte
Déshonorait mon père, et me couvrait de honte.
Tu sais comme un soufflet touche un homme de coeur
J'avais part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur :
Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père ;
Je le ferais encore si j'avais à le faire.
Ce n'est pas qu'en effet, contre mon père et moi,
Ma flamme assez longtemps n'ait combattu pour toi :
Juge de son pouvoir : dans une telle offense
J'ai pu délibérer si j'en prendrais vengeance.
Réduit à te déplaire, ou souffrir un affront,
J'ai pensé qu'à son tour mon bras était trop prompt,
Je me suis accusé de trop de violence ;
Et ta beauté, sans doute, emportait la balance,
À moins que d'opposer à tes plus forts appas
Qu'un homme sans honneur ne te méritait pas ;
Que malgré cette part que j'avais en ton âme,
Qui m'aima généreux me haïrait infâme ;
Qu'écouter ton amour obéir à sa voix,
C'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix.
Je te le dis encore, et, quoique j'en soupire, _
Jusqu'au dernier soupir je veux bien le redire :
Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter
Pour effacer ma honte, et pour te mériter ;
Mais, quitte envers l'honneur et quitte envers mon père,
C'est maintenant à toi que je viens satisfaire :
C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois.
J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois.
Je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime ;
Je ne t'ai pas voulu dérober ta victime :
Immole avec courage au sang qu'il a perdu
Celui qui met sa gloire à l'avoir répandu.
CHIMÉNE
Ah ! Rodrigue ! il est vrai, quoique ton ennemie,
Je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie ;
Et, de quelque façon qu'éclatent mes douleurs,
Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs.
Je sais ce que l'honneur, après un tel outrage,
Demandait à l'ardeur d'un généreux courage :
Tu n'as fait le devoir que d'un homme de bien ;
Mais aussi, le faisant, tu m'as appris le mien.
Ta funeste valeur m'instruit par ta victoire ;
Elle a vengé ton père et soutenu ta gloire :
Même soin me regarde, et j'ai, pour m'affliger
Ma gloire à soutenir, et mon père à venger Hélas !
ton intérêt ici me désespère.
Si quelque autre malheur m'avait ravi mon père,
Mon âme aurait trouvé dans le bien de te voir
L'unique allégement qu'elle eût pu recevoir ;
Et contre ma douleur j'aurais senti des charmes,
Quand une main si chère eût essuyé mes larmes.
Mais il me faut te perdre après l'avoir perdu ;
Cet effort sur ma flamme à mon honneur est dû ;
Et cet affreux devoir dont l'ordre m'assassine,
Me force à travailler moi-même à ta ruine.
Car enfin n'attends pas de mon affection .
De lâches sentiments pour ta punition.
De quoi qu'en ta faveur notre amour m'entretienne,
Ma générosité doit répondre à la tienne :
Tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi ;
Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi.
DON RODRIGUE
Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne :
Il demande ma tête, et je te l'abandonne ;
Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt,
Le coup m'en sera doux, aussi bien que l'arrêt.
Attendre après mon crime une lente justice,
C'est reculer ta gloire autant que mon supplice.
Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau.
CHIMÉNE
Va, je suis ta partie, et non pas ton bourreau.
Si tu m'offres ta tête, est-ce à moi de la prendre ?
Je la dois attaquer mais tu dois la défendre ;
C'est d'un autre que toi qu'il me faut l'obtenir,
Et je dois te poursuivre, et non pas te punir.
DON RODRIGUE
De quoi qu'en ma faveur notre amour t'entretienne,
Ta générosité doit répondre à la mienne ;
Et pour venger un père emprunter d'autres bras,
Ma Chiméne, crois-moi, c'est n'y répondre pas :
Ma main seule du mien a su venger l'offense,
Ta main seule du tien doit prendre la vengeance.
CHIMÉNE
Cruel ! à quel propos sur ce point t'obstiner ?
Tu t'es vengé sans aide, et tu m'en veux donner !
Je suivrai ton exemple, et j'ai trop de courage
Pour souffrir qu'avec toi ma gloire se partage.
Mon père et mon honneur ne veulent rien devoir
Aux traits de ton amour ni de ton désespoir.
DON RODRIGUE
Rigoureux point d'honneur ! hélas ! quoi que je fasse,
Ne pourrai-je à la fin obtenir cette grâce ?
Au nom d'un père mort, ou de notre amitié,
Punis-moi par vengeance, ou du moins par pitié.
Ton malheureux amant aura bien moins de peine
À mourir par ta main qu'à vivre avec ta haine.
CHIMÉNE
Va, je ne te hais point.
DON RODRIGUE
Tu le dois.
CHIMÉNE
Je ne puis.
DON RODRIGUE
Crains-tu si peu le blâme, et si peu les faux bruits ?
Quand on saura mon crime, et que ta flamme dure,
Que ne publieront point l'envie et l'imposture !
Force-les au silence, et, sans plus discourir
Sauve ta renommée en me faisant mourir.
CHIMÉNE
Elle éclate bien mieux en te laissant la vie ;
Et je veux que la voix de la plus noire envie
Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis,
Sachant que je t'adore et que je te poursuis.
Va-t'en, ne montre plus à ma douleur extrême
Ce qu'il faut que je perde, encore que je l'aime.
Dans l'ombre de la nuit cache bien ton départ ;
Si l'on te voit sortir mon honneur court hasardon
La seule occasion qu'aura la médisance,
C'est de savoir qu'ici j'ai souffert ta présence :
Ne lui donne point lieu d'attaquer ma vertu.
DON RODRIGUE
Que je meure !
CHIMÉNE
Va-t'en.
DON RODRIGUE
À quoi te résous-tu ?
CHIMÉNE
Malgré des feux si beaux qui troublent ma colère,
Je ferai mon possible à bien venger mon père ;
Mais, malgré la rigueur d'un si cruel devoir
Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.
DON RODRIGUE
ô miracle d'amour !
CHIMÉNE
ô comble de misères !
DON RODRIGUE
Que de maux et de pleurs nous coûteront nos pères !
CHIMÉNE
Rodrigue, qui l'eût cru ?
DON RODRIGUE
Chimène, qui l'eût dit ?
CHIMÉNE
Que notre heur fût si proche, et sitôt se perdît ?
DON RODRIGUE
Et que si près du port, contre toute apparence,
Un orage si prompt brisât notre espérance ?
CHIMÉNE
Ah ! mortelles douleurs !
DON RODRIGUE
Ah ! regrets superflus !
CHIMÉNE
Va-t'en, encore un coup, je ne t'écoute plus.
DON RODRIGUE
Adieu ; je vais traîner une mourante vie,
Tant que par ta poursuite elle me soit ravie.
CHIMÉNE
Si j'en obtiens l'effet, je t'engage ma foi
De ne respirer pas un moment après toi.
Adieu ; sors, et surtout garde bien qu'on te voie.
ELVIRE
Madame, quelques maux que le ciel nous envoie...
CHIMÉNE
Ne m'importune plus, laisse-moi soupirer
Je cherche le silence et la nuit pour pleurer.
1637 - "Je ris du désespoir de tous mes envieux" - La publication quelque peu intempestive de "Excuse à Ariste" entretînt la fameuse querelle du Cid, sans doute la plus violente bataille de pamphlets de toute l'histoire du théâtre français. Il fallu l'intervention de Richelieu pour que la querelle prenne fin, en octobre 1637. Celui-ci chargeai l'Académie d`arbitrer le débat, et "Les Sentiments de I'Académie sur le Cid", rédigés en décembre par un Jean Chapelain (1595-1674) qui sut, malgré ses réserves, rendre toute sa puissance à la pièce. Mais la blessure fut pour Corneille suffisamment profonde pour ne plus rien écrire pendant deux années. En 1639, alors que sévit à Rouen et en Normandie la révolte des Va-Nu-Pieds soulevés contre le fisc et que Richelieu délègue en mission spéciale à Rouen pour la levée des tailles le père de Pascal, Corneille se remet au travail, ce fut "Horace", avec une dédicace à Richelieu d'une humiliante servilité, mais sans doute nécessaire...
Excuse à Ariste...
Ce n'est donc pas assez, et de la part des Muses,
Ariste, c'est en vers qu'il vous faut des excuses ;
Et la mienne pour vous n'en plaint pas la façon :
Cent vers lui coûtent moins que deux mots de chanson :
Son feu ne peut agir quand il faut qu'il s'applique
Sur les fantasques airs d'un rêveur de musique,
Et que pour donner lieu de paraître à sa voix,
De sa bigearre quinte il se fasse des lois ;
Qu'il ait sur chaque ton ses rimes ajustées,
Sur chaque tremblement ses syllabes comptées,
Et qu'une froide pointe à la fin d'un couplet
En dépit de Phébus donne à l'art un soufflet :
Enfin cette prison déplaît à son génie ;
Il ne peut rendre hommage à cette tyrannie ;
Il ne se leurre point d'animer de beaux chants,
Et veut pour se produire avoir la clef des champs.
C'est lorsqu'il court d'haleine, et qu'en plaine carrière,
Quittant souvent la terre en quittant la barrière,
Puis, d'un vol élevé se cachant dans les cieux,
Il rit du désespoir de tous ses envieux.
Ce trait est un peu vain, Ariste, je l'avoue ;
Mais faut−il s'étonner d'un poète qui se loue ?
Le Parnasse, autrefois dans la France adoré,
Faisait pour ses mignons un autre âge doré,
Notre fortune enflait du prix de nos caprices,
Et c'était une blanque à de bons bénéfices ;
Mais elle est épuisée, et les vers à présent
Aux meilleurs du métier n'apportant que du vent,
Chacun s'en donne à l'aise, et souvent se dispense
A prendre par ses mains toute sa récompense.
Nous nous aimons un peu, c'est notre faible à tous :
Le prix que nous valons, qui le sait mieux que nous ?
Et puis la mode en est, et la cour l'autorise.
Nous parlons de nous−même avec toute franchise ;
La fausse humilité ne met plus en crédit.
Je sais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.
Pour me faire admirer je ne fais point de ligue :
J'ai peu de voix pour moi, mais je les ai sans brigue ;
Et mon ambition, pour faire plus de bruit,
Ne les va point quêter de réduit en réduit ;
Mon travail sans appui monte sur le théâtre ;
Chacun en liberté l'y blâme ou l'idolâtre ;
Là, sans que mes amis prêchent leurs sentiments,
J'arrache quelquefois trop d'applaudissements ;
Là, content du succès que le mérite donne,
Par d'illustres avis je n'éblouis personne :
Je satisfais ensemble et peuple et courtisans,
Et mes vers en tous lieux sont mes seuls partisans ;
Par leur seule beauté ma plume est estimée :
Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée,
Et pense toutefois n'avoir point de rival
A qui je fasse tort en le traitant d'égal.
Mais insensiblement je baille ici le change,
Et mon esprit s'égare en sa propre louange ;
Sa douceur me séduit, je m'en laisse abuser,
Et me vante moi−même, au lieu de m'excuser...."
C'est le temps des grandes tragédies de Corneille des années 1640, Horace (1640), Cinna (1641), Polyeucte (1642) et Rodogune (1644). Corneille épouse Marie de Lampérière, fille du lieutenant civil et criminel des Andelys : elle avait onze ans de moins que lui et ils auront sept enfants échelonnés de 1642 à 1656. C'est aussi une époque de changement politique.
"Cinna" allait être publié lorsque survint la conspiration, puis l exécution de Cinq-Mars. La pièce ne sera imprimée qu'en janvier 1643, plus d'un mois après le décès de Richelieu, dont Corneille refusa tant de célébrer que de flétrir la mémoire. Mazarin lui succède, a besoin de soutien et dote à son tour Corneille d'une pension importante : des Remerciements en vers, font du cardinal l'égal des "plus grands Romains de l'Antiquité". Pierre Corneille devient ainsi un poète quasi officiel et l'Académie lui ouvre enfin les portes en 1648. Très naturellement respectueux du pouvoir, le poète reste, sous la Fronde, longtemps fidèle à Mazarin, va jusqu'à faire une apologie de son ministre dans une comédie héroïque de janvier 1650 (Don Sanche d'Aragon). Lorsque le duc et la duchesse de Longueville tentent de soulever la Normandie, Mazarin fait arrêter les princes (Condé, Conti et Longueville) et récompense ses soutiens ; Corneille devient procureur des Etats de Normandie...

1640 - "Horace"
Tragicomédie en cinq actes et en vers, jouée pour la première fois en 1639. Elle est inspirée du combat entre les Horaces et les Curiaces. La pièce, dédiée au cardinal de Richelieu, fut le second grand succès de Pierre Corneille. Écrite en réponse aux contradicteurs du Cid, la pièce met en scène un personnage encore plus audacieux que Chimène : Horace, qui tue sa sœur Camille et sacrifie son meilleur ami.
La pièce, dont l'action se situe à l'origine de Rome, commence dans une ambiance de paix et de bonheur: la famille romaine des Horace est unie à la famille albaine des Curiaces. Le jeune Horace est marié à Sabine, jeune fille albaine dont le frère Curiace est fiancé à Camille, sœur d'Horace. Mais la guerre fratricide qui éclate entre les deux villes rompt cette harmonie. Pour en finir, chaque ville désigne trois champions qui se battront en combat singulier pour décider qui devra l'emporter. Contre toute attente, le sort désigne les trois frères Horace pour Rome et les trois frères Curiace pour Albe. Horace, étonné, ne s'attendait pas à un tel honneur. Les amis se retrouvent ainsi face à face, avec des cas de conscience résolus différemment: alors qu'Horace est emporté par son devoir patriotique, Curiace se lamente sur son destin si cruel.
Acte II, scène V
CAMILLE
Iras-tu, Curiace, et ce funeste honneur
Te plaît-il aux dépens de tout notre bonheur ?
CURIACE
Hélas ! Je vois trop bien qu'il faut, quoi que je fasse,
Mourir, ou de douleur, ou de la main d'Horace.
Je vais comme au supplice à cet illustre emploi,
Je maudis mille fois l'état qu'on fait de moi,
Je hais cette valeur qui fait qu'Albe m'estime ;
Ma flamme au désespoir passe jusques au crime,
Elle se prend au ciel, et l'ose quereller ;
Je vous plains, je me plains ; mais il y faut aller.
CAMILLE
Non ; je te connais mieux, tu veux que je te prie
Et qu'ainsi mon pouvoir t'excuse à ta patrie.
Tu n'es que trop fameux par tes autres exploits :
Albe a reçu par eux tout ce que tu lui dois.
Autre n'a mieux que toi soutenu cette guerre ;
Autre de plus de morts n'a couvert notre terre :
Ton nom ne peut plus croître, il ne lui manque rien ;
Souffre qu'un autre ici puisse ennoblir le sien.
CURIACE
Que je souffre à mes yeux qu'on ceigne une autre tête
Des lauriers immortels que la gloire m'apprête,
Ou que tout mon pays reproche à ma vertu
Qu'il aurait triomphé si j'avais combattu,
Et que sous mon amour ma valeur endormie
Couronne tant d'exploits d'une telle infamie !
Non, Albe, après l'honneur que j'ai reçu de toi,
Tu ne succomberas ni vaincras que par moi ;
Tu m'as commis ton sort, je t'en rendrai bon conte,
Et vivrai sans reproche, ou périrai sans honte.
CAMILLE
Quoi ! Tu ne veux pas voir qu'ainsi tu me trahis !
CURIACE
Avant que d'être à vous, je suis à mon pays.
CAMILLE
Mais te priver pour lui toi-même d'un beau-frère,
Ta soeur de son mari !
CURIACE
Telle est notre misère :
Le choix d'Albe et de Rome ôte toute douceur
Aux noms jadis si doux de beau-frère et de soeur.
CAMILLE
Tu pourras donc, cruel, me présenter sa tête,
Et demander ma main pour prix de ta conquête !
CURIACE
Il n'y faut plus penser : en l'état où je suis,
Vous aimer sans espoir, c'est tout ce que je puis.
Vous en pleurez, Camille ?
CAMILLE
Il faut bien que je pleure :
Mon insensible amant ordonne que je meure ;
Et quand l'hymen pour nous allume son flambeau,
Il l'éteint de sa main pour m'ouvrir le tombeau.
Ce coeur impitoyable à ma perte s'obstine,
Et dit qu'il m'aime encore alors qu'il m'assassine.
CURIACE
Que les pleurs d'une amante ont de puissants discours,
Et qu'un bel oeil est fort avec un tel secours !
Que mon coeur s'attendrit à cette triste vue !
Ma constance contre elle à regret s'évertue.
N'attaquez plus ma gloire avec tant de douleurs,
Et laissez-moi sauver ma vertu de vos pleurs ;
Je sens qu'elle chancelle, et défend mal la place :
Plus je suis votre amant, moins je suis Curiace.
Faible d'avoir déjà combattu l'amitié,
Vaincrait-elle à la fois l'amour et la pitié ?
Allez, ne m'aimez plus, ne versez plus de larmes,
Ou j'oppose l'offense à de si fortes armes ;
Je me défendrai mieux contre votre courroux,
Et pour le mériter, je n'ai plus d'yeux pour vous :
Vengez-vous d'un ingrat, punissez un volage.
Vous ne vous montrez point sensible à cet outrage !
Je n'ai plus d'yeux pour vous, vous en avez pour moi !
En faut-il plus encor ? Je renonce à ma foi.
Rigoureuse vertu dont je suis la victime,
Ne peux-tu résister sans le secours d'un crime ?
CAMILLE
Ne fais point d'autre crime, et j'atteste les dieux
Qu'au lieu de t'en haïr, je t'en aimerai mieux ;
Oui, je te chérirai, tout ingrat et perfide,
Et cesse d'aspirer au nom de fratricide.
Pourquoi suis-je romaine, ou que n'es-tu romain ?
Je te préparerais des lauriers de ma main ;
Je t'encouragerais, au lieu de te distraire ;
Et je te traiterais comme j'ai fait mon frère.
Hélas ! J'étais aveugle en mes voeux aujourd'hui ;
J'en ai fait contre toi quand j'en ai fait pour lui.
Il revient : quel malheur, si l'amour de sa femme
Ne peut non plus sur lui que le mien sur ton âme !
Pendant le combat, deux Horace sont tués, le dernier doit affronter trois Curiaces blessés, qu'il va tuer un à un et remporter ainsi ce combat avec un enjeu si grand. Après avoir reçu les congratulations de tout Rome, Horace tue sa sœur qui lui reprochait le meurtre de son bien-aimé, alors que lui est lié à sa patrie. Le procès qui suit donne lieu à un vibrant plaidoyer du vieil Horace, qui défend l'honneur contre l'amour. Horace sera donc acquitté malgré le réquisitoire de Valère, qui était aussi amoureux de Camille, tout comme Curiace.
HORACE, acte IV, scène V - Dans cette scène de la tragédie de Pierre Corneille, jouée en 1640, Camille la Romaine crie sa haine pour son propre pays. En effet, son amant Curiace, du camp ennemi, vient d'être tué par son propre frère de Camille :
HORACE
Ma soeur, voici le bras qui venge nos deux frères,
Le bras qui rompt le cours de nos destins contraires,
Qui nous rend maîtres d'Albe ; enfin voici le bras
Qui seul fait aujourd'hui le sort de deux états ;
Vois ces marques d'honneur, ces témoins de ma gloire,
Et rends ce que tu dois à l'heur de ma victoire.
CAMILLE
Recevez donc mes pleurs, c'est ce que je lui dois.
HORACE
Rome n'en veut point voir après de tels exploits,
Et nos deux frères morts dans le malheur des armes
Sont trop payés de sang pour exiger des larmes :
Quand la perte est vengée, on n'a plus rien perdu.
CAMILLE
Puisqu'ils sont satisfaits par le sang épandu,
Je cesserai pour eux de paraître affligée,
Et j'oublierai leur mort que vous avez vengée ;
Mais qui me vengera de celle d'un amant,
Pour me faire oublier sa perte en un moment ?
HORACE
Que dis-tu, malheureuse ?
CAMILLE
Ô mon cher Curiace !
HORACE
Ô d'une indigne soeur insupportable audace !
D'un ennemi public dont je reviens vainqueur
Le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton coeur !
Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire !
Ta bouche la demande, et ton coeur la respire !
Suis moins ta passion, règle mieux tes désirs,
Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs ;
Tes flammes désormais doivent être étouffées ;
Bannis-les de ton âme, et songe à mes trophées :
Qu'ils soient dorénavant ton unique entretien.
CAMILLE
Donne-moi donc, barbare, un coeur comme le tien ;
Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme,
Rends-moi mon Curiace, ou laisse agir ma flamme :
Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort ;
Je l'adorais vivant, et je le pleure mort.
Ne cherche plus ta soeur où tu l'avais laissée ;
Tu ne revois en moi qu'une amante offensée,
Qui comme une furie attachée à tes pas,
Te veut incessamment reprocher son trépas.
Tigre altéré de sang, qui me défends les larmes,
Qui veux que dans sa mort je trouve encor des charmes,
Et que jusques au ciel élevant tes exploits,
Moi-même je le tue une seconde fois !
Puissent tant de malheurs accompagner ta vie,
Que tu tombes au point de me porter envie ;
Et toi, bientôt souiller par quelque lâcheté
Cette gloire si chère à ta brutalité !
HORACE
Ô ciel ! Qui vit jamais une pareille rage !
Crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage,
Que je souffre en mon sang ce mortel déshonneur ?
Aime, aime cette mort qui fait notre bonheur,
Et préfère du moins au souvenir d'un homme
Ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome.
CAMILLE
Rome, l'unique objet de mon ressentiment !
Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant !
Rome qui t'a vu naître, et que ton coeur adore !
Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore !
Puissent tous ses voisins ensemble conjurés
Saper ses fondements encor mal assurés !
Et si ce n'est assez de toute l'Italie,
Que l'orient contre elle à l'occident s'allie ;
Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour la détruire et les monts et les mers !
Qu'elle-même sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains déchire ses entrailles !
Que le courroux du ciel allumé par mes voeux
Fasse pleuvoir sur elle un déluge de feux !
Puissé-je de mes yeux y voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,
Voir le dernier Romain à son dernier soupir,
Moi seule en être cause, et mourir de plaisir !
HORACE
C'est trop, ma patience à la raison fait place ;
Va dedans les enfers plaindre ton Curiace.
CAMILLE
Ah ! Traître !
HORACE
Ainsi reçoive un châtiment soudain
Quiconque ose pleurer un ennemi romain !
Ainsi la passion patriotique aura fait taire chez Horace non seulement l'amour, - sa femme Sabine est originaire d'Albe -, et l'affection qu'il porte à ses beaux-frères, mais il va jusqu'à tuer sa soeur, coupable d'avoir souhaité la perte de Rome...
Acte V, scène 2
HORACE
À quoi bon me défendre ?
Vous savez l'action, vous la venez d'entendre ;
Ce que vous en croyez me doit être une loi.
Sire, on se défend mal contre l'avis d'un roi,
Et le plus innocent devient soudain coupable,
Quand aux yeux de son prince il paraît condamnable.
C'est crime qu'envers lui se vouloir excuser :
Notre sang est son bien, il en peut disposer ;
Et c'est à nous de croire, alors qu'il en dispose,
Qu'il ne s'en prive point sans une juste cause.
Sire, prononcez donc, je suis prêt d'obéir ;
D'autres aiment la vie, et je la dois haïr.
Je ne reproche point à l'ardeur de Valère
Qu'en amant de la soeur il accuse le frère :
Mes voeux avec les siens conspirent aujourd'hui ;
Il demande ma mort, je la veux comme lui.
Un seul point entre nous met cette différence,
Que mon honneur par là cherche son assurance,
Et qu'à ce même but nous voulons arriver,
Lui pour flétrir ma gloire, et moi pour la sauver.
Sire, c'est rarement qu'il s'offre une matière
À montrer d'un grand coeur la vertu toute entière.
Suivant l'occasion elle agit plus ou moins,
Et paraît forte ou faible aux yeux de ses témoins.
Le peuple, qui voit tout seulement par l'écorce,
S'attache à son effet pour juger de sa force ;
Il veut que ses dehors gardent un même cours,
Qu'ayant fait un miracle, elle en fasse toujours :
Après une action pleine, haute, éclatante,
Tout ce qui brille moins remplit mal son attente ;
Il veut qu'on soit égal en tout temps, en tous lieux ;
Il n'examine point si lors on pouvait mieux,
Ni que, s'il ne voit pas sans cesse une merveille,
L'occasion est moindre, et la vertu pareille :
Son injustice accable et détruit les grands noms ;
L'honneur des premiers faits se perd par les seconds ;
Et quand la renommée a passé l'ordinaire,
Si l'on n'en veut déchoir, il faut ne plus rien faire.
Je ne vanterai point les exploits de mon bras ;
Votre majesté, sire, a vu mes trois combats :
Il est bien malaisé qu'un pareil les seconde,
Qu'une autre occasion à celle-ci réponde,
Et que tout mon courage, après de si grands coups,
Parvienne à des succès qui n'aillent au-dessous ;
Si bien que pour laisser une illustre mémoire,
La mort seule aujourd'hui peut conserver ma gloire :
Encor la fallait-il sitôt que j'eus vaincu,
Puisque pour mon honneur j'ai déjà trop vécu.
Un homme tel que moi voit sa gloire ternie,
Quand il tombe en péril de quelque ignominie ;
Et ma main aurait su déjà m'en garantir ;
Mais sans votre congé mon sang n'ose sortir :
Comme il vous appartient, votre aveu doit se prendre ;
C'est vous le dérober qu'autrement le répandre.
Rome ne manque point de généreux guerriers ;
Assez d'autres sans moi soutiendront vos lauriers ;
Que votre majesté désormais m'en dispense ;
Et si ce que j'ai fait vaut quelque récompense,
Permettez, ô grand roi, que de ce bras vainqueur
Je m'immole à ma gloire, et non pas à ma soeur.

1642 - "Cinna"
Composée en alexandrins à rimes plates, Cinna est la première pièce importante de Corneille à respecter les règles du théâtre classique, alors en formation. Respect de l'unité de temps d'abord, puisqu'elle se déroule en une seule journée, de l'unité de lieu ensuite, puisqu'elle se passe intégralement dans le palais romain où se situent les deux appartements d'Auguste et d'Emilie, de l'unité d'action enfin, puisque la préparation de la conjuration implique l'ensemble des personnages, même si ces derniers évoluent individuellement dans des «sous-intrigues», jusqu'à la réconciliation finale. Dans l'ensemble de ses tragédies à thème antique, Corneille se montra extrêmement fidèle au modèle de l'Antiquité, notamment en conférant aux intrigues une véritable dimension politique, où l'histoire occupe toujours une place essentielle.
Cinna - Acte IV, scène 2
Auguste vient d'apprendre par Euphorbe, confident de Maxime, qu'un complot a été fomenté contre lui par Cinna et par Maxime lui-même. C'est Maxime qui a envoyé Euphorbe dénouer la conjuration, poussé par son dépit politique (Cinna semble avoir changé radicalement ses opinions) et par ses espoirs amoureux (il aime en secret Émilie)...
Ciel ! à qui voulez-vous désormais que je fie
Les secrets de mon âme et le soin de ma vie ?
Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis,
Si donnant des sujets il ôte les amis,
Si tel est le destin des grandeurs souveraines
Que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines,
Et si votre rigueur les condamne à chérir
Ceux que vous animez à les faire périr.
Pour elles rien n'est sûr ; qui peut tout doit tout craindre.
Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre.
Quoi ! Tu veux qu'on t'épargne, et n'as rien épargné !
Songe aux fleuves de sang où ton bras s'est baigné,
De combien ont rougi les champs de Macédoine,
Combien en a versé la défaite d'Antoine,
Combien celle de Sexte, et reçois tout d'un temps
Pérouse au sien noyée, et tous ses habitants.
Remets dans ton esprit, après tant de carnages,
De tes proscriptions les sanglantes images,
Où toi-même, des tiens devenu le bourreau,
Au sein de ton tuteur enfonça le couteau :
Et puis ose accuser le destin d'injustice
Quand tu vois que les tiens s'arment pour ton supplice,
Et que, par ton exemple à ta perte guidés,
Ils violent des droits que tu n'as pas gardés !
Leur trahison est juste, et le ciel l'autorise :
Quitte ta dignité comme tu l'as acquise ;
Rends un sang infidèle à l'infidélité,
Et souffre des ingrats après l'avoir été.
Mais que mon jugement au besoin m'abandonne !
Quelle fureur, Cinna, m'accuse et te pardonne,
Toi, dont la trahison me force à retenir
Ce pouvoir souverain dont tu me veux punir,
Me traite en criminel, et fait seul mon crime,
Relève pour l'abattre un trône illégitime,
Et, d'un zèle effronté couvrant son attentat,
S'oppose, pour me perdre, au bonheur de l'État ?
Donc jusqu'à l'oublier je pourrais me contraindre !
Tu vivrais en repos après m'avoir fait craindre !
Non, non, je me trahis moi-même d'y penser :
Qui pardonne aisément invite à l'offenser ;
Punissons l'assassin, proscrivons les complices.
Mais quoi ! toujours du sang, et toujours des supplices !
Ma cruauté se lasse, et ne peut s'arrêter ;
Je veux me faire craindre et ne fais qu'irriter.
Rome a pour ma ruine une hydre trop fertile :
Une tête coupée en fait renaître mille,
Et le sang répandu de mille conjurés
Rends mes jours plus maudits, et non plus assurés.
Octave, n'attends plus le coup d'un nouveau Brute ;
Meurs, et dérobe-lui la gloire de ta chute ;
Meurs ; tu ferais pour vivre un lâche et vain effort,
Si tant de gens de cœur font des vœux pour ta mort,
Et si tout ce que Rome a d'illustre jeunesse
Pour te faire périr tour à tour s'intéresse ;
Meurs, puisque c'est un mal que tu ne peux guérir ;
Meurs enfin, puisqu'il faut ou tout perdre, ou mourir.
La vie est peu de chose, et le peu qui t'en reste
Ne vaut pas l'acheter par un prix si funeste.
Meurs, mais quitte du moins la vie avec éclat,
Éteins-en le flambeau dans le sang de l'ingrat,
À toi-même en mourant immole ce perfide ;
Contentant ses désirs, punis son parricide ;
Fais un tourment pour lui de ton propre trépas,
En faisant qu'il le voie et n'en jouisse pas :
Mais jouissons plutôt nous-mêmes de sa peine ;
Et si Rome nous hait triomphons de sa haine.
Ô Romains ! ô vengeance ! ô pouvoir absolu !
Ô rigoureux combat d'un cœur irrésolu
Qui fuit en même temps tout ce qu'il se propose !
D'un prince malheureux ordonnez quelque chose.
Qui des deux dois-je suivre, et duquel m'éloigner ?
Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner.
On reconnaît à Corneille son inventivité à créer des rebondissements et des coups de théâtre, ainsi l'arrivée de Sévère que l'on croyait mort, dans Polyeucte, l'annonce de la victoire d'Horace après celle de sa fuite, l'épisode de la coupe fatale contenant le poison qu'Antochius doit boire, dans Rodogune, et dans Cinna, le revirement d'Auguste à la dernière scène....
(Acte V, scène 3)
AUGUSTE
Mais enfin le ciel m'aime, et ses bienfaits nouveaux
Ont enlevé Maxime à la fureur des eaux.
Approche, seul ami que j'éprouve fidèle.
MAXIME
Honorez moins, seigneur, une âme criminelle.
AUGUSTE
Ne parlons plus de crime après ton repentir,
Après que du péril tu m'as su garantir :
C'est à toi que je dois et le jour et l'empire.
MAXIME
De tous vos ennemis connaissez mieux le pire :
Si vous régnez encor, seigneur, si vous vivez,
C'est ma jalouse rage à qui vous le devez.
Un vertueux remords n'a point touché mon âme ;
Pour perdre mon rival j'ai découvert sa trame.
Euphorbe vous a feint que je m'étais noyé,
De crainte qu'après moi vous n'eussiez envoyé :
Je voulais avoir lieu d'abuser Émilie,
Effrayer son esprit, la tirer d'Italie,
Et pensais la résoudre à cet enlèvement
Sous l'espoir du retour pour venger son amant ;
Mais au lieu de goûter ces grossières amorces,
Sa vertu combattue a redoublé ses forces.
Elle a lu dans mon coeur ; vous savez le surplus,
Et je vous en ferais des récits superflus.
Vous voyez le succès de mon lâche artifice.
Si pourtant quelque grâce est due à mon indice,
Faites périr Euphorbe au milieu des tourments,
Et souffrez que je meure aux yeux de ces amants.
J'ai trahi mon ami, ma maîtresse, mon maître,
Ma gloire, mon pays, par l'avis de ce traître,
Et croirai toutefois mon bonheur infini,
Si je puis m'en punir après l'avoir puni.
AUGUSTE
En est-ce assez, ô ciel ! Et le sort, pour me nuire,
A-t-il quelqu'un des miens qu'il veuille encor séduire ?
Qu'il joigne à ses efforts le secours des enfers :
Je suis maître de moi comme de l'univers ;
Je le suis, je veux l'être. Ô siècles, ô mémoire,
Conservez à jamais ma dernière victoire !
Je triomphe aujourd'hui du plus juste courroux
De qui le souvenir puisse aller jusqu'à vous.
Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie :
Comme à mon ennemi je t'ai donné la vie,
Et malgré la fureur de ton lâche destin,
Je te la donne encor comme à mon assassin.
Commençons un combat qui montre par l'issue
Qui l'aura mieux de nous ou donnée ou reçue.
Tu trahis mes bienfaits, je les veux redoubler ;
Je t'en avais comblé, je t'en veux accabler :
Avec cette beauté que je t'avais donnée,
Reçois le consulat pour la prochaine année.
Aime Cinna, ma fille, en cet illustre rang,
Préfères-en la pourpre à celle de mon sang ;
Apprends sur mon exemple à vaincre ta colère :
Te rendant un époux, je te rends plus qu'un père.
EMILIE
Et je me rends, seigneur, à ces hautes bontés ;
Je recouvre la vue auprès de leurs clartés :
Je connais mon forfait, qui me semblait justice ;
Et, ce que n'avait pu la terreur du supplice,
Je sens naître en mon âme un repentir puissant,
Et mon coeur en secret me dit qu'il y consent.
Le ciel a résolu votre grandeur suprême ;
Et pour preuve, seigneur, je n'en veux que moi-même :
J'ose avec vanité me donner cet éclat,
Puisqu'il change mon coeur, qu'il veut changer l'état.
Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle ;
Elle est morte, et ce coeur devient sujet fidèle ;
Et prenant désormais cette haine en horreur,
L'ardeur de vous servir succède à sa fureur.
CINNA
Seigneur, que vous dirai-je après que nos offenses
Au lieu de châtiments trouvent des récompenses ?
Ô vertu sans exemple ! Ô clémence qui rend
Votre pouvoir plus juste, et mon crime plus grand !
AUGUSTE
Cesse d'en retarder un oubli magnanime ;
Et tous deux avec moi faites grâce à Maxime :
Il nous a trahis tous ; mais ce qu'il a commis
Vous conserve innocents, et me rend mes amis.
Reprends auprès de moi ta place accoutumée ;
Rentre dans ton crédit et dans ta renommée ;
Qu'Euphorbe de tous trois ait sa grâce à son tour ;
Et que demain l'hymen couronne leur amour.
Si tu l'aimes encor, ce sera ton supplice.
MAXIME
Je n'en murmure point, il a trop de justice ;
Et je suis plus confus, seigneur, de vos bontés
Que je ne suis jaloux du bien que vous m'ôtez.
CINNA
Souffrez que ma vertu dans mon coeur rappelée
Vous consacre une foi lâchement violée,
Mais si ferme à présent, si loin de chanceler,
Que la chute du ciel ne pourrait l'ébranler.
Puisse le grand moteur des belles destinées,
Pour prolonger vos jours, retrancher nos années ;
Et moi, par un bonheur dont chacun soit jaloux,
Perdre pour vous cent fois ce que je tiens de vous !
LIVIE
Ce n'est pas tout, seigneur : une céleste flamme
D'un rayon prophétique illumine mon âme.
Oyez ce que les dieux vous font savoir par moi ;
De votre heureux destin c'est l'immuable loi.
Après cette action vous n'avez rien à craindre :
On portera le joug désormais sans se plaindre ;
Et les plus indomptés, renversant leurs projets,
Mettront toute leur gloire à mourir vos sujets ;
Aucun lâche dessein, aucune ingrate envie
N'attaquera le cours d'une si belle vie ;
Jamais plus d'assassins ni de conspirateurs :
Vous avez trouvé l'art d'être maître des coeurs.
Rome, avec une joie et sensible et profonde,
Se démet en vos mains de l'empire du monde ;
Vos royales vertus lui vont trop enseigner
Que son bonheur consiste à vous faire régner :
D'une si longue erreur pleinement affranchie,
Elle n'a plus de voeux que pour la monarchie,
Vous prépare déjà des temples, des autels,
Et le ciel une place entre les immortels ;
Et la postérité, dans toutes les provinces,
Donnera votre exemple aux plus généreux princes.
AUGUSTE
J'en accepte l'augure, et j'ose l'espérer :
Ainsi toujours les dieux vous daignent inspirer !
Qu'on redouble demain les heureux sacrifices
Que nous leur offrirons sous de meilleurs auspices ;
Et que vos conjurés entendent publier
Qu'Auguste a tout appris, et veut tout oublier.

1643 - "Polyeucte"
La grandeur chrétienne confrontée à la grandeur romaine. Refusant de renoncer à la foi chrétienne, Polyeucte ira au sacrifice, entraînant la conversion de sa femme, Pauline, et de son beau-frère, Félix, et suscitant l'admiration du païen Sévère.
Acte II, scène 2, Sévère, que Pauline, la plus fidèle des épouses, chérissait la mémoire de Sévère qu'elle croyait mort et lorsque celui-ci paraît mais sans lui laisser le moindre espoir, elle avoue l'aimer encore alors que sa raison la fait accepter avec soumission la volonté de son père de la voir épouser Polyeucte. Et pourtant, elle passera finalement de l'amour de Sévère à celui de Polyeucte en découvrant la grandeur de ce dernier, sa dignité de chrétien animé par la grâce, qui, paradoxalement, va l'éloigner d'elle. Le conflit cornélien est extraordinaire de complexité. Polyeucte, de son côté, lutte contre son amour pour Pauline par fidélité à son devoir de chrétien, faire à Dieu le sacrifice de toutes les affections terrestres...
PAULINE
Oui, je l'aime, seigneur, et n'en fais point d'excuse ;
Que tout autre que moi vous flatte et vous abuse,
Pauline a l'âme noble, et parle à coeur ouvert :
Le bruit de votre mort n'est point ce qui vous perd.
Si le ciel en mon choix eût mis mon hyménée,
À vos seules vertus je me serais donnée,
Et toute la rigueur de votre premier sort
Contre votre mérite eût fait un vain effort.
Je découvrais en vous d'assez illustres marques
Pour vous préférer même aux plus heureux monarques ;
Mais puisque mon devoir m'imposait d'autres lois,
De quelque amant pour moi que mon père eût fait choix,
Quand à ce grand pouvoir que la valeur vous donne
Vous auriez ajouté l'éclat d'une couronne,
Quand je vous aurais vu, quand je l'aurais haï,
J'en aurais soupiré, mais j'aurais obéi,
Et sur mes passions ma raison souveraine
Eût blâmé mes soupirs et dissipé ma haine.
SEVERE
Que vous êtes heureuse, et qu'un peu de soupirs
Fait un aisé remède à tous vos déplaisirs !
Ainsi de vos désirs toujours reine absolue,
Les plus grands changements vous trouvent résolue ;
De la plus forte ardeur vous portez vos esprits
Jusqu'à l'indifférence et peut-être au mépris ;
Et votre fermeté fait succéder sans peine
La faveur au dédain, et l'amour à la haine.
Qu'un peu de votre humeur ou de votre vertu
Soulagerait les maux de ce coeur abattu !
Un soupir, une larme à regret épandue
M'aurait déjà guéri de vous avoir perdue ;
Ma raison pourrait tout sur l'amour affaibli,
Et de l'indifférence irait jusqu'à l'oubli ;
Et mon feu désormais se réglant sur le vôtre,
Je me tiendrais heureux entre les bras d'une autre.
Ô trop aimable objet, qui m'avez trop charmé,
Est-ce là comme on aime, et m'avez-vous aimé ?
PAULINE
Je vous l'ai trop fait voir, seigneur ; et si mon âme
Pouvait bien étouffer les restes de sa flamme,
Dieux, que j'éviterais de rigoureux tourments !
Ma raison, il est vrai, dompte mes sentiments ;
Mais quelque autorité que sur eux elle ait prise,
Elle n'y règne pas, elle les tyrannise ;
Et quoique le dehors soit sans émotion,
Le dedans n'est que trouble et que sédition.
Un je ne sais quel charme encor vers vous m'emporte ;
Votre mérite est grand, si ma raison est forte :
Je le vois encor tel qu'il alluma mes feux,
D'autant plus puissamment solliciter mes voeux,
Qu'il est environné de puissance et de gloire,
Qu'en tous lieux après vous il traîne la victoire,
Que j'en sais mieux le prix, et qu'il n'a point déçu
Le généreux espoir que j'en avais conçu.
Mais ce même devoir qui le vainquit dans Rome,
Et qui me range ici dessous les lois d'un homme,
Repousse encor si bien l'effort de tant d'appas,
Qu'il déchire mon âme et ne l'ébranle pas.
C'est cette vertu même, à nos désirs cruelle,
Que vous louiez alors en blasphémant contre elle :
Plaignez-vous-en encor ; mais louez sa rigueur,
Qui triomphe à la fois de vous et de mon coeur ;
Et voyez qu'un devoir moins ferme et moins sincère
N'aurait pas mérité l'amour du grand Sévère.
SEVERE
Ah ! Madame, excusez une aveugle douleur,
Qui ne connaît plus rien que l'excès du malheur :
Je nommais inconstance, et prenais pour un crime
De ce juste devoir l'effort le plus sublime.
De grâce, montrez moins à mes sens désolés
La grandeur de ma perte et ce que vous valez ;
Et cachant par pitié cette vertu si rare,
Qui redouble mes feux lorsqu'elle nous sépare,
Faites voir des défauts qui puissent à leur tour
Affaiblir ma douleur avecque mon amour.
PAULINE
Hélas ! Cette vertu, quoique enfin invincible,
Ne laisse que trop voir une âme trop sensible.
Ces pleurs en sont témoins, et ces lâches soupirs
Qu'arrachent de nos feux les cruels souvenirs :
Trop rigoureux effets d'une aimable présence
Contre qui mon devoir a trop peu de défense !
Mais si vous estimez ce vertueux devoir,
Conservez-m'en la gloire, et cessez de me voir.
Épargnez-moi des pleurs qui coulent à ma honte ;
Épargnez-moi des feux qu'à regret je surmonte ;
Enfin épargnez-moi ces tristes entretiens,
Qui ne font qu'irriter vos tourments et les miens.
SEVERE
Que je me prive ainsi du seul bien qui me reste !
PAULINE
Sauvez-vous d'une vue à tous les deux funeste.
SEVERE
Quel prix de mon amour ! Quel fruit de mes travaux !
PAULINE
C'est le remède seul qui peut guérir nos maux.
SEVERE
Je veux mourir des miens : aimez-en la mémoire.
PAULINE
Je veux guérir des miens : ils souilleraient ma gloire.
SEVERE
Ah ! Puisque votre gloire en prononce l'arrêt,
Il faut que ma douleur cède à son intérêt.
Est-il rien que sur moi cette gloire n'obtienne ?
Elle me rend les soins que je dois à la mienne.
Adieu : je vais chercher au milieu des combats
Cette immortalité que donne un beau trépas,
Et remplir dignement, par une mort pompeuse,
De mes premiers exploits l'attente avantageuse,
Si toutefois, après ce coup mortel du sort,
J'ai de la vie assez pour chercher une mort.
PAULINE
Et moi, dont votre vue augmente le supplice,
Je l'éviterai même en votre sacrifice ;
Et seule dans ma chambre enfermant mes regrets,
Je vais pour vous aux dieux faire des voeux secrets.
SEVERE
Puisse le juste ciel, content de ma ruine,
Combler d'heur et de jours Polyeucte et Pauline !
PAULINE
Puisse trouver Sévère, après tant de malheur,
Une félicité digne de sa valeur !
SEVERE
Il la trouvait en vous.
PAULINE
Je dépendais d'un père.
SEVERE
Ô devoir qui me perd et qui me désespère !
Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant.
PAULINE
Adieu, trop malheureux et trop parfait amant.
Scène 3, acte IV, l'héroïsme cornélien, deux sentiments s'affrontent, l'amour humain, dans ce qu'il a de plus délicat, et l'amour divin, dans son expression totale qui mène au sacrifice, deux personnages déchirés mais de volontés opposées, Corneille se montre un fin psychologue, Pauline sait que ses arguments ne sont pas des raisons, Polyeucte se sent en danger et assume une pensée qui mène à l'irréparable...
POLYEUCTE
Madame, quel dessein vous fait me demander ?
Est−ce pour me combattre ou pour me seconder ?
Cet effort généreux de votre amour parfaite
Vient−il à mon secours, vient−il à ma défaite ?
Apportez−vous ici la haine ou l'amitié,
Comme mon ennemie, ou ma chère moitié ?
PAULINE
Vous n'avez point ici d'ennemi que vous−même,
Seul vous vous haïssez, lorsque chacun vous aime,
Seul vous exécutez tout ce que j'ai rêvé :
Ne veuillez pas vous perdre, et vous êtes sauvé.
A quelque extrémité que votre crime passe,
Vous êtes innocent si vous vous faites grâce.
Daignez considérer le sang dont vous sortez,
Vos grandes actions, vos rares qualités ;
Chéri de tout le peuple, estimé chez le prince,
Gendre du gouverneur de toute la province,
Je ne vous compte à rien le nom de mon époux :
C'est un bonheur pour moi qui n'est pas grand pour vous.
Mais après vos exploits, après votre naissance,
Après votre pouvoir, voyez notre espérance,
Et n'abandonnez pas à la main d'un bourreau
Ce qu'à nos justes voeux promet un sort si beau.
POLYEUCTE
Je considère plus. Je sais mes avantages
Et l'espoir que sur eux forment les grands courages.
Ils n'aspirent enfin qu'à des biens passagers,
Que troublent les soucis, que suivent les dangers ;
La mort nous les ravit, la fortune s'en joue ;
Aujourd'hui dans le trône, et demain dans la boue,
Et leur plus haut éclat fait tant de mécontents
Que peu de vos Césars en ont joui longtemps.
J'ai de l'ambition, mais plus noble et plus belle ;
Cette grandeur périt, j'en veux une immortelle,
Un bonheur assuré, sans mesure et sans fin,
Au−dessus de l'envie, au−dessus du destin.
Est−ce trop l'acheter que d'une triste vie
Qui tantôt, qui soudain me peut être ravie,
Qui ne me fait jouir que d'un instant qui fuit,
Et ne peut m'assurer de celui qui le suit ?
PAULINE
Voilà de vos chrétiens les ridicules songes,
Voilà jusqu'à quel point vous charment leurs mensonges.
Tout votre sang est peu pour un bonheur si doux !
Mais, pour en disposer, ce sang est−il à vous ?
Vous n'avez pas la vie ainsi qu'un héritage ;
Le jour qui vous la donne en même temps l'engage,
Vous la devez au prince, au public, à l'Etat.
POLYEUCTE
Je la voudrais pour eux perdre dans un combat,
Je sais quel en est l'heur, et quelle en est la gloire.
Des aïeux de Décie on vante la mémoire,
Et ce nom, précieux encore à vos Romains,
Au bout de six cents ans lui met l'empire aux mains.
Je dois ma vie au peuple, au prince, à sa couronne,
Mais je la dois bien plus au Dieu qui me la donne.
Si mourir pour son prince est un illustre sort,
Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort !
PAULINE
Quel dieu !
POLYEUCTE
Tout beau, Pauline : il entend vos paroles,
Et ce n'est pas un dieu comme vos dieux frivoles,
Insensibles et sourds, impuissants, mutilés,
De bois, de marbre, ou d'or, comme vous les voulez,
C'est le Dieu des chrétiens, c'est le mien, c'est le vôtre,
Et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre.
PAULINE
Adorez−le dans l'âme, et n'en témoignez rien.
POLYEUCTE
Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien !
PAULINE
Ne feignez qu'un moment, laissez partir Sévère,
Et donnez lieu d'agir aux bontés de mon père.
POLYEUCTE
Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir :
Il m'ôte des périls que j'aurais pu courir,
Et, sans me laisser lieu de tourner en arrière,
Sa faveur me couronne entrant dans la carrière ;
Du premier coup de vent il me conduit au port,
Et, sortant du baptême, il m'envoie à la mort.
Si vous pouviez comprendre, et le peu qu'est la vie,
Et de quelles douceurs cette mort est suivie...
Mais que sert de parler de ces trésors cachés
A des esprits que Dieu n'a pas encor touchés ?
PAULINE
Cruel ! Car il est temps que ma douleur éclate,
Et qu'un juste reproche accable une âme ingrate,
Est−ce là ce beau feu ? Sont−ce là tes serments ?
Témoignes−tu pour moi les moindres sentiments ?
Je ne te parlais point de l'état déplorable
Où ta mort va laisser ta femme inconsolable :
Je croyais que l'amour t'en parlerait assez,
Et je ne voulais pas de sentiments forcés.
Mais cette amour si ferme et si bien méritée,
Que tu m'avais promise, et que je t'ai portée,
Quand tu me veux quitter, quand tu me fais mourir,
Te peut−elle arracher une larme, un soupir ?
Tu me quittes, ingrat, et le fais avec joie ;
Tu ne la caches pas, tu veux que je la voie,
Et ton coeur, insensible à ces tristes appas,
Se figure un bonheur où je ne serai pas !
C'est donc là le dégoût qu'apporte l'hyménée ?
Je te suis odieuse après m'être donnée !
POLYEUCTE
Hélas !
PAULINE
Que cet hélas a de peine à sortir !
Encor s'il commençait un heureux repentir,
Que, tout forcé qu'il est, j'y trouverais de charmes !
Mais courage, il s'émeut, je vois couler des larmes.
POLYEUCTE
J'en verse, et plût à Dieu qu'à force d'en verser
Ce coeur trop endurci se pût enfin percer !
Le déplorable état où je vous abandonne
Est bien digne des pleurs que mon amour vous donne,
Et si l'on peut au ciel sentir quelques douleurs,
J'y pleurerai pour vous l'excès de vos malheurs.
Mais si, dans ce séjour de gloire et de lumière,
Ce Dieu tout juste et bon peut souffrir ma prière,
S'il y daigne écouter un conjugal amour,
Sur votre aveuglement il répandra le jour.
Seigneur, de vos bontés il faut que je l'obtienne :
Elle a trop de vertus pour n'être pas chrétienne.
Avec trop de mérite il vous plus la former,
Pour ne vous pas connaître et ne vous pas aimer,
Pour vivre des enfers esclave infortunée,
Et sous leur triste joug mourir comme elle est née.
PAULINE
Que dis−tu, malheureux ? Qu'oses−tu souhaiter ?
POLYEUCTE
Ce que de tout mon sang je voudrais acheter.
PAULINE
Que plutôt...
POLYEUCTE
C'est en vain qu'on se met en défense :
Ce Dieu touche les coeurs lorsque moins on y pense.
Ce bienheureux moment n'est pas encor venu.
Il viendra, mais le temps ne m'en est pas connu.
PAULINE
Quittez cette chimère, et m'aimez.
POLYEUCTE
Je vous aime,
Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi−même.
PAULINE
Au nom de cet amour, ne m'abandonnez pas.
POLYEUCTE
Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas.
PAULINE
C'est peu de me quitter, tu veux donc me séduire ?
POLYEUCTE
C'est peu d'aller au ciel, je vous y veux conduire.
PAULINE
Imaginations !
POLYEUCTE
Célestes vérités !
PAULINE
Etrange aveuglement !
POLYEUCTE
Eternelles clartés !
PAULINE
Tu préfères la mort à l'amour de Pauline !
POLYEUCTE
Vous préférez le monde à la bonté divine !
PAULINE
Va, cruel, va mourir ; tu ne m'aimas jamais.
POLYEUCTE
Vivez heureuse au monde, et me laissez en paix.
PAULINE
Oui, je t'y vais laisser ; ne t'en mets plus en peine ;
Je vais...
La scène 3 de l'acte V est la dernière où nous pouvons voir et entendre Polyeucte qui va vers le martyre; c'est la dernière aussi où Pauline essaie de fléchir son mari et de le sauver d'une mort imminente. Il y a là face à. face trois personnages séparés par une incompréhension profonde : l'intensité dramatique de la situation les pousse peu à peu à révéler leurs sentiments vrais, à se montrer tels qu'ils sont. Pauline s'irrite de son impuissance à convaincre son mari, et finit par lui crier son amour. Félix supplie, fait appel à l'émotion, donne des arguments, et finit par menacer. Polyeucte, qui a renoncé à Pauline, va jusqu'à lui souhaiter d'être heureuse avec Sévère, son premier soupirant; cette attitude peut paraître inhumaine et surprenante; n'oublions pas cependant que nous assistons à l'ascension mystique du héros qui abandonne volontairement le monde terrestre pour acquérir la gloire du martyre et la béatitude céleste....
PAULINE
Qui de vous deux aujourd'hui m'assassine ?
Sont-ce tous deux ensemble, ou chacun à son tour ?
Ne pourrai-je fléchir la nature ou l'amour ?
FELIX
Parlez à votre époux.
POLYEUCTE
Vivez avec Sévère.
PAULINE
Tigre, assassine-moi du moins sans m'outrager.
POLYEUCTE
Mon amour, par pitié, cherche à vous soulager :
Il voit quelle douleur dans l'âme vous possède,
Et sait qu'un autre amour en est le seul remède.
Puisqu'un si grand mérite a pu vous enflammer,
Sa présence toujours a droit de vous charmer :
Vous l'aimiez, il vous aime, et sa gloire augmentée...
PAULINE
Que t'ai-je fait, cruel, pour être ainsi traitée,
Et pour me reprocher, au mépris de ma foi,
Un amour si puissant que j'ai vaincu pour toi ?
Vois, pour te faire vaincre un si fort adversaire,
Quels efforts à moi-même il a fallu me faire ;
Quels combats j'ai donnés pour te donner un coeur
Si justement acquis à son premier vainqueur ;
Et si l'ingratitude en ton coeur ne domine,
Fais quelque effort sur toi pour te rendre à Pauline :
Apprends d'elle à forcer ton propre sentiment ;
Prends sa vertu pour guide en ton aveuglement ;
Souffre que de toi-même elle obtienne ta vie,
Pour vivre sous tes lois à jamais asservie.
Si tu peux rejeter de si justes désirs,
Regarde au moins ses pleurs, écoute ses soupirs ;
Ne désespère pas une âme qui t'adore.
POLYEUCTE
Je vous l'ai déjà dit, et vous le dis encore,
Vivez avec Sévère, ou mourez avec moi.
Je ne méprise point vos pleurs ni votre foi ;
Mais de quoi que pour vous notre amour m'entretienne,
Je ne vous connais plus, si vous n'êtes chrétienne.
C'en est assez, Félix, reprenez ce courroux,
Et sur cet insolent vengez vos dieux et vous.
PAULINE
Ah ! Mon père, son crime à peine est pardonnable ;
Mais s'il est insensé, vous êtes raisonnable.
La nature est trop forte, et ses aimables traits
Imprimés dans le sang ne s'effacent jamais :
Un père est toujours père, et sur cette assurance
J'ose appuyer encore un reste d'espérance.
Jetez sur votre fille un regard paternel :
Ma mort suivra la mort de ce cher criminel ;
Et les dieux trouveront sa peine illégitime,
Puisqu'elle confondra l'innocence et le crime,
Et qu'elle changera, par ce redoublement,
En injuste rigueur un juste châtiment ;
Nos destins, par vos mains rendus inséparables,
Nous doivent rendre heureux ensemble, ou misérables ;
Et vous seriez cruel jusques au dernier point,
Si vous désunissiez ce que vous avez joint.
Un coeur à l'autre uni jamais ne se retire,
Et pour l'en séparer il faut qu'on le déchire.
Mais vous êtes sensible à mes justes douleurs,
Et d'un oeil paternel vous regardez mes pleurs.
FELIX
Oui, ma fille, il est vrai qu'un père est toujours père ;
Rien n'en peut effacer le sacré caractère :
Je porte un coeur sensible, et vous l'avez percé ;
Je me joins avec vous contre cet insensé.
Malheureux Polyeucte, es-tu seul insensible ?
Et veux-tu rendre seul ton crime irrémissible ?
Peux-tu voir tant de pleurs d'un oeil si détaché ?
Peux-tu voir tant d'amour sans en être touché ?
Ne reconnais-tu plus ni beau-père, ni femme,
Sans amitié pour l'un, et pour l'autre sans flamme ?
Pour reprendre les noms et de gendre et d'époux,
Veux-tu nous voir tous deux embrasser tes genoux ?
POLYEUCTE
Que tout cet artifice est de mauvaise grâce !
Après avoir deux fois essayé la menace,
Après m'avoir fait voir Néarque dans la mort,
Après avoir tenté l'amour et son effort,
Après m'avoir montré cette soif du baptême,
Pour opposer à Dieu l'intérêt de Dieu même,
Vous vous joignez ensemble ! Ah ! Ruses de l'enfer !
Faut-il tant de fois vaincre avant que triompher ?
Vos résolutions usent trop de remise :
Prenez la vôtre enfin, puisque la mienne est prise.
Je n'adore qu'un dieu, maître de l'univers,
Sous qui tremblent le ciel, la terre, et les enfers,
Un dieu qui, nous aimant d'une amour infinie,
Voulut mourir pour nous avec ignominie,
Et qui par un effort de cet excès d'amour,
Veut pour nous en victime être offert chaque jour.
Mais j'ai tort d'en parler à qui ne peut m'entendre.
Voyez l'aveugle erreur que vous osez défendre :
Des crimes les plus noirs vous souillez tous vos dieux ;
Vous n'en punissez point qui n'ait son maître aux cieux :
La prostitution, l'adultère, l'inceste,
Le vol, l'assassinat, et tout ce qu'on déteste,
C'est l'exemple qu'à suivre offrent vos immortels.
J'ai profané leur temple, et brisé leurs autels ;
Je le ferais encor, si j'avais à le faire,
Même aux yeux de Félix, même aux yeux de Sévère,
Même aux yeux du sénat, aux yeux de l'empereur.
FELIX
Enfin ma bonté cède à ma juste fureur :
Adore-les, ou meurs.
POLYEUCTE
Je suis chrétien.
FELIX
Impie !
Adore-les, te dis-je, ou renonce à la vie.
POLYEUCTE
Je suis chrétien.
FELIX
Tu l'es ? Ô coeur trop obstiné !
Soldats, exécutez l'ordre que j'ai donné.
PAULINE
Où le conduisez-vous ?
FELIX
À la mort.
POLYEUCTE
À la gloire.
Chère Pauline, adieu : conservez ma mémoire.
PAULINE
Je te suivrai partout, et mourrai si tu meurs.
POLYEUCTE.
Ne suivez point mes pas, ou quittez vos erreurs.
FELIX
Qu'on l'ôte de mes yeux, et que l'on m'obéisse :
Puisqu'il aime à périr, je consens qu'il périsse.

1645 - "Rodogune"
Avec "Rodogune" en 1644, et "Héraclius" en 1647, Corneille s'oriente vers le mélodrame, à l'action complexe, riche en péripéties et en coups de théâtre. Cléopâtre, reine de Syrie, a tué son mari Démétrius Nicanor, parce qu'il voulait la répudier pour épouser Rodogune, princesse des Parthes. Mais ses deux fils, Séleucus et Antiochus s'éprennent à leur tour de Rodogune., deux frères qui s'estiment mutuellement. Cléopâtre échafaude alors un plan, elle donnera le trône â celui qui aura sacrifié Rodogune à sa haine. Mais devant leur refus, Cléopâtre décide de les faire périr tous deux avant Rodogune ; après avoir frappé Séleucus, elle se dispose à empoisonner Antiochus...
Dans Rodogune, la passion effrénée du pouvoir étouffe chez Cléopâtre tout sentiment humain, ainsi qu'en témoigne ce monologue (Rodogune, V, 1). Et cependant, par un coup de théâtre surprenant, Antiochus et Rodogune seront sauvés. Au moment où Antiochus va boire le breuvage empoisonné préparé par sa mère, survient un personnage qui a recueilli les dernières paroles de Séleucus, des mots, ambigus, qui peuvent accuser aussi bien Rodogune que Cléopâtre. Antiochus est en proie â un doute affreux. Par un suprême effort pour le perdre, Cléopâtre boit la première et lui tend la coupe, mais les eflets du poison sont si prompts que le prince comprend à temps l'atroce vérité. Cléopâtre n'aura aucun élan de repentir; son seul souci au moment de mourir est de ne pas s'effondrer aux pieds de ceux qu'elle hait, et qui ont triomphé de sa haine. Expirante, elle quitte la scène, appuyée sur sa suivante, dans un dernier geste d'orgueil.
CLEOPÂTRE
Enfin, grâces aux dieux, j'ai moins d'un ennemi.
La mort de Séleucus m'a vengée à demi;
Son ombre, en attendant Rodogune et son frère,
Peut déjà de ma part les promettre à son père :
Ils te suivront de près, et j'ai tout préparé
Pour réunir bientôt ce que j'ai séparé..
O toi, qui n'attends plus que la cérémonie
Pour jeter à mes pieds ma rivale punie,
Et par qui deux amants vont d'un seul coup du sort
Recevoir Phyménée, et le trône, et la mort,
Poison, me sauras-tu rendre mon diadème?
Le fer m'a bien servie, en feras-tu de même?
Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu,
Ridicule retour d'une sotte vertu,
Tendresse dangereuse autant comme importune?
Je ne veux point pour fils l'époux de Rodogune,
Et ne vois plus en lui les restes de mon sang,
S'il m'arrache du trône et la met en mon rang.
Reste du sang ingrat d'un époux infidèle,
Héritier d'une flamme envers moi criminelle,
Aime mon ennemie et péris comme lui.
Pour la faire tomber j'abattrai son appui :
Aussi bien sous mes pas c'est creuser un abîme
Que retenir ma main sur la moitié du crime;
Et, te faisant mon roi, c'est trop me négliger
Que te laisser sur moi père et frère à venger.
Qui se venge à demi court lui-même à sa peine :
Il faut ou condamner ou couronner sa haine.
Dût le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux
De mon sang odieux arroser leurs tombeaux,
Dût le Parthe vengeur me trouver sans défense,
Dût le ciel égaler le supplice à l'offense,
Trône, à t'abandonner je ne puis consentir ;
Par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir;
Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange.
Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge!
]'en recevrai le coup d'un visage remis :
Il est doux de périr après ses ennemis
Et, de quelque rigueur que le destin me traite,
Je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette."

1647 - "Héraclius, empereur d'Orient"
Une tragédie fondée sur la complexité de l'intrigue, amorcée avec "Rodogune", écrite en une période troublée, la régence d'Anne d'Autriche appuyée sur Mazarin, où semble régner, plus qu'en aucune autre époque que put connaître Corneille, une ambiguïté des apparences et que seul l'héroïsme permet de traverser...
Phocas, empereur d'Orient, veut contraindre Pulchérie à épouser son fils Martian, mais elle est la fille de l'empereur Maurice, jadis détrône et assassiné par Phocas. Quant à Martian, il est en réalité Héraclius, fils de Maurice, donc frère de Pulchérie et l'héritier du trône. S'il est en vie, c'est grâce à Léontine qui l'avait sauvé de la mort en sacrifiant son fils et lui substituant Martian, que lui avait confié Phocas. Héraclius passe donc pour Martian, et le véritable Martian pour Léonce, fils de Léontine. De plus, Héraclius aime Eudoxe, fille de Léontine, tandis que Martian aime Pulchérie, sœur d'Héraclius. Voici Héraclius prêt à révéler son identité et à renverser Phocas. Dans la confusion de ses substitutions d'enfants, alors que Léontine recherche vengeance, la relation entre Phocas et celui qu'il croit être son fils, Héraclius, tourne à la tragédie jusqu'au meurtre de Phocas par Exupère...
Acte IV, scène 1 - Héraclius, Eudoxe.
HÉRACLIUS.
Vous avez grand sujet d'appréhender pour elle :
Phocas au dernier point la tiendra criminelle,
Et je le connais mal, ou, s'il la peut trouver,
Il n'est moyen humain qui puisse la sauver.
Je vous plains, chère Eudoxe, et non pas votre mère :
Elle a bien mérité ce qu'a fait Exupère ;
Il trahit justement qui voulait me trahir.
EUDOXE.
Vous croyez qu'à ce point elle ait pu vous haïr,
Vous pour qui son amour a forcé la nature ?
HÉRACLIUS.
Comment voulez-vous donc nommer son imposture ?
M'empêcher d'entreprendre et, par un faux rapport,
Confondre en Martian et mon nom et mon sort,
Abuser d'un billet que le hasard lui donne,
Attacher de sa main mes droits à sa personne,
Et le mettre en état, dessous sa bonne foi,
De régner en ma place, ou de périr pour moi,
Madame, est-ce en effet me rendre un grand service ?
EUDOXE.
Eût-elle démenti ce billet de Maurice ?
Et l'eût-elle pu faire, à moins que révéler
Ce que surtout alors il lui fallait celer ?
Quand Martian par là n'eût pas connu son père,
C'était vous hasarder sur la foi d'Exupère.
Elle en doutait, Seigneur, et, par l'événement,
Vous voyez que son zèle en doutait justement.
Sûre en soi des moyens de vous rendre l'empire,
Qu'à vous-même jamais elle n'a voulu dire,
Elle a sur Martian tourné le coup fatal
De l'épreuve d'un cœur qu'elle connaissait mal.
Seigneur, où seriez-vous sans ce nouveau service ?
HÉRACLIUS.
Qu'importe qui des deux on destine au supplice ?
Qu'importe, Martian, vu ce que je te dois,
Qui trahisse mon sort, d'Exupère ou de moi ?
Si l'on ne me découvre, il faut que je m'expose ;
Et l'un et l'autre enfin ne sont que même chose,
Sinon qu'étant trahi je mourrais malheureux,
Et que, m'offrant pour toi, je mourrai généreux.
EUDOXE.
Quoi ! pour désabuser une aveugle furie,
Rompre votre destin, et donner votre vie !
HÉRACLIUS.
Vous êtes plus aveugle encore en votre amour.
Périra-t-il pour moi quand je lui dois le jour ?
Et lorsque sous mon nom il se livre à sa perte,
Tiendrai-je sous le sien ma fortune couverte ?
S'il s'agissait ici de le faire empereur,
Je pourrais lui laisser mon nom et son erreur ;
Conniver : Négliger de punir les
fautes de ceux sur qui nous avons
l'inspection, l'autorité ; ou le souffrir,
et ne faire pas semblant de les voir
Mais conniver en lâche à ce nom qu'on me vole,
Quand son père à mes yeux au lieu de moi l'immole !
Souffrir qu'il se trahisse aux rigueurs de mon sort !
Vivre par son supplice, et régner par sa mort !
EUDOXE.
Ah ! ce n'est pas, Seigneur, ce que je vous demande :
De cette lâcheté l'infamie est trop grande.
Montrez-vous pour sauver ce héros du trépas,
Mais montrez-vous en maître, et ne vous perdez pas ;
Rallumez cette ardeur où s'opposait ma mère,
Garantissez le fils par la perte du père ;
Et, prenant à l'empire un chemin éclatant,
Montrez Héraclius au peuple qui l'attend.
HÉRACLIUS.
Il n'est plus temps, Madame, un autre a pris ma place.
Sa prison a rendu le peuple tout de glace.
Déjà préoccupé d'un autre Héraclius,
Dans l'effroi qui le trouble il ne me croira plus,
Et ne me regardant que comme un fils perfide,
Il aura de l'horreur de suivre un parricide.
Mais quand même il voudrait seconder mes desseins,
Le tyran tient déjà Martian en ses mains :
S'il voit qu'en sa faveur je marche à force ouverte,
Piqué de ma révolte, il hâtera sa perte,
Et croira qu'en m'ôtant l'espoir de le sauver
Il m'ôtera l'ardeur qui me fait soulever.
N'en parlons plus. En vain votre amour me retarde :
Le sort d'Héraclius tout entier me regarde ;
Soit qu'il faille régner, soit qu'il faille périr,
Au tombeau comme au trône on me verra courir.
Mais voici le tyran, et son traître Exupère.
Acte IV, Scène 3, Phocas, Héraclius, Martian, Exupère, Troupe de gardes.
HÉRACLIUS.
Je sais qu'en ma prière il aurait peu d'appui,
Et, loin de me donner une inutile peine,
Tout ce que je demande à votre juste haine,
C'est que de tels forfaits ne soient pas impunis :
Perdez Héraclius, et sauvez votre fils.
Voilà tout mon souhait et toute ma prière.
M'en refuserez-vous ?
PHOCAS.
Tu l'obtiendras entière ;
Ton salut en effet est douteux sans sa mort.
MARTIAN.
Ah, Prince ! J'y courais sans me plaindre du sort.
Son indigne rigueur n'est pas ce qui me touche ;
Mais en ouïr l'arrêt sortir de votre bouche !
Je vous ai mal connu jusques à mon trépas.
HÉRACLIUS.
Et même en ce moment tu ne me connais pas.
Écoute, père aveugle, et toi, prince crédule,
Ce que l'honneur défend que plus je dissimule.
Phocas, connais ton sang et tes vrais ennemis :
Je suis Héraclius, et Léonce est ton fils.
MARTIAN.
Seigneur, que dites-vous ?
HÉRACLIUS.
Que je ne puis plus taire
Que deux fois Léontine osa tromper ton père,
Et semant de nos noms un insensible abus,
Fit un faux Martian du jeune Héraclius.
PHOCAS.
Maurice te dément, lâche ! Tu n'as qu'à lire :
« Sous le nom de Léonce Héraclius respire » ;
Tu fais après cela des contes superflus.
HÉRACLIUS.
Si ce billet fut vrai, Seigneur, il ne l'est plus :
J'étais Léonce alors, et j'ai cessé de l'être
Quand Maurice immolé n'en a pu rien connaître.
S'il laissa par écrit ce qu'il avait pu voir,
Ce qui suivit sa mort fut hors de son pouvoir.
Vous portâtes soudain la guerre dans la Perse,
Où vous eûtes trois ans la fortune diverse ;
Cependant Léontine, étant dans le château
Reine de nos destins et de notre berceau,
Pour me rendre le rang qu'occupait votre race,
Prit Martian pour elle, et me mit en sa place ;
Ce zèle en ma faveur lui succéda si bien,
Que vous-même au retour vous n'en connûtes rien,
Et ces informes traits qu'à six mois a l'enfance
Ayant mis entre nous fort peu de différence,
Le faible souvenir en trois ans s'en perdit.
Vous prîtes aisément ce qu'elle vous rendit ;
Vous vécûmes tous deux sous le nom l'un de l'autre,
Il passa pour son fils, je passai pour le vôtre,
Et je ne jugeais pas ce chemin criminel
Pour remonter sans meurtre au trône paternel.
Mais voyant cette erreur fatale à cette vie
Sans qui déjà la mienne aurait été ravie,
Je me croirais, Seigneur, coupable infiniment,
Si je souffrais encore un tel aveuglement :
Je viens reprendre un nom qui seul a fait son crime ;
Conservez votre haine, et changez de victime.
Je ne demande rien que ce qui m'est promis :
Perdez Héraclius, et sauvez votre fils.
MARTIAN.
Admire de quel fils le ciel t'a fait le père,
Admire quel effort sa vertu vient de faire,
Tyran, et ne prends pas pour une vérité
Ce qu'invente pour moi sa générosité.
À Héraclius.
C'est trop, Prince, c'est trop pour ce petit service
Dont honora mon bras ma fortune propice :
Je vous sauvai la vie, et ne la perdis pas,
Et pour moi vous cherchez un assuré trépas !
Ah ! Si vous m'en devez quelque reconnaissance,
Prince, ne m'ôtez pas l'honneur de ma naissance ;
Avoir tant de pitié d'un sort si glorieux,
De crainte d'être ingrat, c'est m'être injurieux.
PHOCAS.
En quelque trouble me jette une telle dispute !
À quels nouveaux malheurs m'expose-t-elle en butte !
Lequel croire, Exupère, et lequel démentir ?
Tombé-je dans l'erreur, ou si j'en vais sortir ?
Si ce billet est vrai, le reste est vraisemblable.
EXUPÈRE.
Mais qui sait si ce reste est faux ou véritable ?
PHOCAS.
Léontine deux fois a pu tromper Phocas.
EXUPÈRE.
Elle a pu les changer, et ne les changer pas.
Et plus que vous, Seigneur, dedans l'inquiétude,
Je ne vois que du trouble et de l'incertitude.
HÉRACLIUS.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais qui je suis ;
Vous voyez quels effets en ont été produits :
Depuis plus de quatre ans vous voyez quelle adresse
J'apporte à rejeter l'hymen de la princesse,
Où sans doute aisément mon cœur eût consenti
Si Léontine alors ne m'en eût averti.
MARTIAN.
Léontine ?
HÉRACLIUS.
Elle-même.
MARTIAN.
Ah ! Ciel ! Quelle est sa ruse !
Martian aime Eudoxe, et sa mère l'abuse
Par l'horreur d'un hymen qu'il croit incestueux.
De ce prince à sa fille elle assure les vœux,
Et son ambition, adroite à le séduire,
Le plonge en une erreur dont elle attend l'empire.
Ce n'est que d'aujourd'hui que je sais qui je suis,
Mais de mon ignorance elle espérait ces fruits,
Et me tiendrait encor la vérité cachée,
Si tantôt ce billet ne l'en eût arrachée.
PHOCAS.
La méchante l'abuse aussi bien que Phocas.
EXUPÈRE.
Elle a pu l'abuser, et ne l'abuser pas.
PHOCAS.
Tu vois comme la fille a part au stratagème.
EXUPÈRE.
Et que la mère a pu l'abuser elle-même.
PHOCAS.
Que de penser divers ! Que de soucis flottants !
EXUPÈRE.
Je vous en tirerai, Seigneur, dans peu de temps.
PHOCAS.
Dis-moi, tout est-il prêt pour ce juste supplice ?
EXUPÈRE.
Oui, si nous connaissions le vrai fils de Maurice.
HÉRACLIUS.
Pouvez-vous en douter après ce que j'ai dit ?
MARTIAN.
Donnez-vous à l'erreur encor quelque crédit ?
HÉRACLIUS.
Ami, rends-moi mon nom : la faveur n'est pas grande ;
Ce n'est que pour mourir que je te le demande.
Reprends ce triste jour que tu m'as racheté,
Ou rends-moi cet honneur que tu m'as presque ôté.
MARTIAN.
Pourquoi, de mon tyran volontaire victime,
Précipiter vos jours pour me noircir d'un crime ?
Prince, qui que je sois, j'ai conspiré sa mort,
Et nos noms au dessein donnent un divers sort ;
Dedans Héraclius il a gloire solide,
Et dedans Martian il devient parricide.
Puisqu'il faut que je meure illustre, ou criminel,
Couvert ou de louange, ou d'opprobre éternel,
Ne souillez point ma mort, et ne veuillez pas faire
Du vengeur de l'empire un assassin d'un père.
HÉRACLIUS.
Mon nom seul est coupable, et, sans plus disputer,
Pour te faire innocent tu n'as qu'à le quitter ;
Il conspira lui seul, tu n'en es point complice.
Ce n'est qu'Héraclius qu'on envoie au supplice.
Sois son fils, tu vivras.
MARTIAN.
Si je l'avais été,
Seigneur, ce traître en vain m'aurait sollicité,
Et, lorsque contre vous il m'a fait entreprendre,
La nature en secret aurait su m'en défendre.
HÉRACLIUS.
Apprends donc qu'en secret mon cœur t'a prévenu.
J'ai voulu conspirer, mais on m'a retenu ;
Et dedans mon péril Léontine timide...
MARTIAN.
N'a pu voir Martian commettre un parricide.
HÉRACLIUS.
Toi que de Pulchérie elle a fait amoureux,
Juge sous les deux noms ton dessein et tes feux.
Elle a rendu pour toi l'un et l'autre funeste,
Martian parricide, Héraclius inceste,
Et n'eût pas eu pour moi d'horreur d'un grand forfait,
Puisque dans ta personne elle en pressait l'effet.
Mais elle m'empêchait de hasarder ma tête,
Espérant par ton bras me livrer ma conquête.
Ce favorable aveu, dont elle t'a séduit,
T'exposait aux périls pour m'en donner le fruit,
Et c'était ton succès qu'attendait sa prudence,
Pour découvrir au peuple ou cacher ma naissance.
PHOCAS.
Hélas ! Je ne puis voir qui des deux est mon fils,
Et je vois que tous deux ils sont mes ennemis.
En ce piteux état, quel conseil dois-je suivre ?
J'ai craint un ennemi, mon bonheur me le livre ;
Je sais que de mes mains il ne se peut sauver,
Je sais que je le vois, et ne puis le trouver.
La nature tremblante, incertaine, étonnée,
D'un nuage confus couvre sa destinée.
L'assassin sous cette ombre échappe à ma rigueur,
Et, présent à mes yeux, il se cache en mon cœur.
Martian ! À ce nom aucun ne veut répondre,
Et l'amour paternel ne sert qu'à me confondre.
Trop d'un Héraclius en mes mains est remis ;
Je tiens mon ennemi, mais je n'ai plus de fils.
Que veux-tu donc, nature, et que prétends-tu faire ?
Si je n'ai plus de fils, puis-je encore être père ?
De quoi parle à mon cœur ton murmure imparfait ?
Ne me dis rien du tout, ou parle tout à fait.
Qui que ce soit des deux que mon sang ait fait naître,
Ou laisse-moi le perdre, ou fais-le-moi connaître.
Ô toi, qui que tu sois, enfant dénaturé,
Et trop digne du sort que tu t'es procuré,
Mon trône est-il pour toi plus honteux qu'un supplice ?
Ô malheureux Phocas ! Ô trop heureux Maurice !
Tu recouvres deux fils pour mourir après toi,
Et je n'en puis trouver pour régner après moi !
Qu'aux honneurs de ta mort je dois porter envie,
Puisque mon propre fils les préfère à sa vie !
Les années 1650 sont assombries par la disgrâce que valut "Nicomède" à Pierre Corneille. Procureur des Etats de Normandie dans l'ombre de Mazarin, Corneille se laisse gagner par un courant général qui soutient les princes emprisonnés. Sa pièce, "Nicomède" (1651), connut un succès fracassant, mais apparut aussi comme un éloge à peine voilé du Grand Condé, qui était à la tête de la Fronde. C'est ainsi que, dès la fin des événements, Corneille fut privé de sa charge et de sa pension. Il s'éloigna alors de la création dramatique pour se consacrer à une traduction en vers de l'Imitation de Jésus-Christ (1656). Il ne revint au théâtre qu'en 1659 avec "Œdipe"....
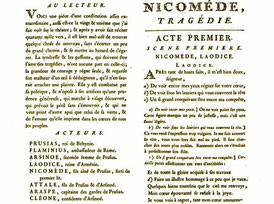
1651 - "Nicomède"
Corneille parvient enfin, après de nombreux tâtonnements, à mettre en scène la parfaite maîtrise de soi d'un héros stoïcien, et construit une tragédie qui n'est fondée que sur la seule grandeur d'âme de son héros. Il ne s'agit plus de nous partager en tant que spectateur entre l'appel de la grandeur et la tentation de la faiblesse, mais de nous laisser entraîner dans une admiration totale. Cette tragédie, c'est Nicomède. "La tendresse et les passions, qui doivent être l'âme des tragédies, n'ont aucune part en celle-ci : la grandeur de courage y règne seule et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en saurait arracher une plainte. Elle y est combattue par la politique et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse, qui marche à visage découvert, qui prévoit le péril sans s'émouvoir et qui ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu et de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples." (Examen de Nicomède.) Et Nicomède se montre si sûr de lui tout au long de la tragédie que jamais nous ne tremblons vraiment pour lui. "La fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous ordonne d`y produire par la représentation de leurs malheurs." (Examen de Nicomède.)
Nicomède, acte III, scène 2 - Flaminius, Laodice.
FLAMINIUS
Madame, enfin une vertu parfaite...
LAODICE
Suivez le roi, Seigneur, votre ambassade est faite ;
Et je vous dis encore, pour ne vous point flatter,
Qu'ici je ne la dois ni la veux écouter.
FLAMINIUS
Et je vous parle aussi, dans ce péril extrême,
Moins en ambassadeur qu'en homme qui vous aime,
Et qui touché du sort que vous vous préparez,
Tâche à rompre le cours des maux où vous courez.
J'ose donc comme ami vous dire en confidence
Qu'une vertu parfaite a besoin de prudence,
Et doit considérer, pour son propre intérêt,
Et les temps où l'on vit, et les lieux où l'on est.
La grandeur de courage en une âme royale
N'est sans cette vertu qu'une vertu brutale,
Que son mérite aveugle, et qu'un faux jour d'honneur
Jette en un tel divorce avec le vrai bonheur,
Qu'elle-même se livre à ce qu'elle doit craindre,
Ne se fait admirer que pour se faire plaindre,
Que pour nous pouvoir dire, après un grand soupir :
"J'avais droit de régner, et n'ai su m'en servir. "
Vous irritez un roi dont vous voyez l'armée
Nombreuse, obéissante, à vaincre accoutumée ;
Vous êtes en ses mains, vous vivez dans sa cour.
LAODICE
Je ne sais si l'honneur eut jamais un faux jour,
Seigneur ; mais je veux bien vous répondre en amie.
Ma prudence n'est pas tout à fait endormie ;
Et sans examiner par quel destin jaloux
La grandeur de courage est si mal avec vous,
Je veux vous faire voir que celle que j'étale
N'est pas tant qu'il vous semble une vertu brutale ;
Que si j'ai droit au trône, elle s'en veut servir,
Et sait bien repousser qui me le veut ravir.
Je vois sur la frontière une puissante armée,
Comme vous l'avez dit, à vaincre accoutumée ;
Mais par quelle conduite, et sous quel général ?
Le roi, s'il s'en fait fort, pourrait s'en trouver mal ;
Et s'il voulait passer de son pays au nôtre,
Je lui conseillerais de s'assurer d'une autre.
Mais je vis dans sa cour, je suis dans ses états,
Et j'ai peu de raison de ne le craindre pas.
Seigneur, dans sa cour même, et hors de l'Arménie,
La vertu trouve appui contre la tyrannie.
Tout son peuple a des yeux pour voir quel attentat
Font sur le bien public les maximes d'état :
Il connaît Nicomède, il connaît sa marâtre,
Il en sait, il en voit la haine opiniâtre ;
Il voit la servitude où le roi s'est soumis,
Et connaît d'autant mieux les dangereux amis.
Pour moi, que vous croyez au bord du précipice,
Bien loin de mépriser Attale par caprice,
J'évite les mépris qu'il recevrait de moi,
S'il tenait de ma main la qualité de roi.
Je le regarderais comme une âme commune,
Comme un homme mieux né pour une autre fortune,
Plus mon sujet qu'époux, et le noeud conjugal
Ne le tirerait pas de ce rang inégal.
Mon peuple à mon exemple en ferait peu d'estime.
Ce serait trop, Seigneur, pour un coeur magnanime :
Mon refus lui fait grâce, et malgré ses désirs,
J'épargne à sa vertu d'éternels déplaisirs.
FLAMINIUS
Si vous me dites vrai, vous êtes ici reine :
Sur l'armée et la cour je vous vois souveraine ;
Le roi n'est qu'une idée, et n'a de son pouvoir
870 Que ce que par pitié vous lui laissez avoir.
Quoi ? Même vous allez jusques à faire grâce !
Après cela, madame, excusez mon audace ;
Souffrez que Rome enfin vous parle par ma voix :
Recevoir ambassade est encore de vos droits ;
Ou si ce nom vous choque ailleurs qu'en Arménie,
Comme simple Romain souffrez que je vous die
Qu'être allié de Rome, et s'en faire un appui,
C'est l'unique moyen de régner aujourd'hui ;
Que c'est par là qu'on tient ses voisins en contrainte,
Ses peuples en repos, ses ennemis en crainte ;
Qu'un prince est dans son trône à jamais affermi
Quand il est honoré du nom de son ami ;
Qu'Attale avec ce titre est plus roi, plus monarque
Que tous ceux dont le front ose en porter la marque ;
Et qu'enfin...
LAODICE
Il suffit ; je vois bien ce que c'est :
Tous les rois ne sont rois qu'autant comme il vous plaît ;
Mais si de leurs états Rome à son gré dispose,
Certes pour son Attale elle fait peu de chose ;
Et qui tient en sa main tant de quoi lui donner
À mendier pour lui devrait moins s'obstiner.
Pour un prince si cher sa réserve m'étonne ;
Que ne me l'offre-t-elle avec une couronne ?
C'est trop m'importuner en faveur d'un sujet,
Moi qui tiendrais un roi pour un indigne objet,
S'il venait par votre ordre, et si votre alliance
Souillait entre ses mains la suprême puissance.
Ce sont des sentiments que je ne puis trahir :
Je ne veux point de rois qui sachent obéir ;
Et puisque vous voyez mon âme toute entière,
Seigneur, ne perdez plus menace ni prière.
FLAMINIUS
Puis-je ne pas vous plaindre en cet aveuglement ?
Madame, encore un coup, pensez-y mûrement :
Songez mieux ce qu'est Rome et ce qu'elle peut faire ;
Et si vous vous aimez, craignez de lui déplaire.
Carthage étant détruite, Antiochus défait,
Rien de nos volontés ne peut troubler l'effet :
Tout fléchit sur la terre, et tout tremble sur l'onde ;
Et Rome est aujourd'hui la maîtresse du monde.
LAODICE
La maîtresse du monde ! Ah ! Vous me feriez peur,
S'il ne s'en fallait pas l'Arménie et mon coeur,
Si le grand Annibal n'avait qui lui succède,
S'il ne revivait pas au prince Nicomède,
Et s'il n'avait laissé dans de si dignes mains
L'infaillible secret de vaincre les Romains.
Un si vaillant disciple aura bien le courage
D'en mettre jusqu'au bout les leçons en usage :
L'Asie en fait l'épreuve, où trois sceptres conquis
Font voir en quelle école il en a tant appris.
Ce sont des coups d'essai, mais si grands que peut-être
Le Capitole a droit d'en craindre un coup de maître,
Et qu'il ne puisse un jour...
FLAMINIUS
Ce jour est encore loin,
Madame, et quelques-uns vous diront, au besoin,
Quels dieux du haut en bas renversent les profanes,
Et que même au sortir de Trébie et de Cannes,
Son ombre épouvanta votre grand Annibal.
Mais le voici, ce bras à Rome si fatal.
Dans "Nicomède", comme dans "Suréna", on a souvent noté que dans ces deux pièces apparaît le plus nettement la confrontation de deux humanités, l'humanité héroïque, incarnée par le couple Nicomède-Laodice, et la médiocre humanité, qu'illustre l'odieuse reine Arsinoé et le lamentable roi Prusias. Ainsi, sous la pression de sa seconde femme Arsinoé et de l'ambassadeur romain Flaminius, Prusias, roi de Bithinie, enntend contraindre son fils Nicomède, né d'un premier lit, à renoncer à la main de Laodice, reine d'Arménie, en faveur d'Attale son demi-frère, fils de Prusias et d'Arsinoé. Mais insensible tant à la colère de son père qu'aux calomnies d'Arsinoé, qui l'accuse de conspiration, Nicomède ne sacrifiera ni le trône ni son amour. Prusias ne peut rien contre les droits, la valeur et la popularité de Nicomède. Il va même jusqu'à tenter, en vain, de ranimer chez Prusias le sentiment de la grandeur royale...
Nicomède, acte IV, scène 3 - Prusias, Nicomède, Araspe...
PRUSIAS
Nicomède, en deux mots, ce désordre me fâche.
Quoi qu'on t'ose imputer, je ne te crois point lâche,
Mais donnons quelque chose à Rome, qui se plaint,
Et tâchons d'assurer la Reine, qui te craint.
J'ai tendresse pour toi, j'ai passion pour elle;
Et je ne veux pas voir cette haine éternelle,
Ni que des sentiments que j'aime à voir durer
Ne règnent dans mon cœur que pour le déchirer.
J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature,
Etre père et mari dans cette conjoncture...
NICOMÈDE
Seigneur, voulez-vous bien vous en fier à moi?
Ne soyez l'un ni l'autre.
PRUSIAS
Et que dois-je être?
NICOMÈDE
Roi.
Reprenez hautement ce noble caractère
Un véritable roi n'est ni mari ni père;
Il regarde son trône, et rien de plus. Régnez,
Rome vous craindra plus que vous ne la craignez.
Malgré cette puissance et si vaste et si grande,
Vous pouvez déjà voir comme elle m'appréhende,
Combien en me perdant elle espère gagner,
Parce qu'elle prévoit que je saurai régner.
PRUSIAS
Je règne donc, ingrat! puisque tu me l'ordonnes :
Choisis, ou Laodice, ou mes quatre couronnes.
Ton roi fait ce partage entre ton frère et toi;
Je ne suis plus ton père, obéis à ton roi.
NICOMÈDE
Si vous étiez aussi le roi de Laodice
Pour l'offrir à mon choix avec quelque justice,
Je vous demanderais le loisir d'y penser;
Mais enfin, pour vous plaire et ne pas l'offenser,
J'obéirai, Seigneur, sans repliques frivoles,
A vos intentions, et non à vos paroles.
A ce frère si cher transportez tous mes droits,
Et laissez Laodice en liberté du choix.
Voilà quel est le mien.
PRUSIAS
Quelle bassesse d'âme,
Quelle fureur t'aveugle en faveur d'une femme?
Tu la préfères, lâche! à ces prix glorieux
Que ta valeur unit au bien de tes aïeux!
Après cette infamie es-tu digne de vivre ?
NICOMÈNE
Je crois que votre exemple est glorieux à suivre :
Ne préférez-vous pas une femme à ce fils
Par qui tous ces Etats aux vôtres sont unis?
PRUSIAS
Me vois-tu renoncer pour elle au diadème?
NICOMÈDE
Me voyez-vous pour l'autre y renoncer moi-même?
Que cédé-je à mon frère en cédant vos Etats?
Ai-je droit d'y prétendre avant votre trépas?
Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire,
Mais un monarque enfin comme un autre homme expire;
Et vos peuples alors, ayant besoin d'un roi,
Voudront choisir peut-être entre ce prince et moi.
Seigneur, nous n'avons pas si grande ressemblance
Qu'il faille de bons yeux pour y voir différence;
Et ce vieux droit d'aînesse est souvent si puissant
Que pour remplir un trône il rappelle un absent.
Que si leurs sentiments se règlent sur les vôtres,
Sous le joug de vos lois j'en ai bien rangé d'autres ;
Et dussent vos Romains en être encor jaloux,
Je ferai bien pour moi ce que j'ai fait pour vous."
1658-1662, une tranche de vie mondaine...
Après un long silence, Corneille travaille en 1656 à une pièce à machine, "La Toison d'or", pour un marquis de Sourdéac, riche seigneur normand, puis tombe, sous l'emprise de son frère, Thomas, dans l'orbite de Fouquet, le nouveau grand dispensateur de commandes et de pensions. Il écrit pour lui "OEdipe" (1659), vite oublié, le triomphe de "La Toison d'or" à Paris (1660-1661), et la fréquentation des belles précieuses de Rouen et de Paris...
C'est en 1658 que Molière, à la tête de sa troupe de comédiens de campagne, vint à Rouen. Il y avait dans cette compagnie une comédienne très séduisante nommée, du nom de son mari, la Du Parc, et de son nom à elle, marquise de Gorla. Elle fit des ravages dans les cœurs rouennais comme elle -en devait faire plus tard à Paris. Thomas Corneille, de dix-neuf ans moins âgé que son frère, le fut. Pierre Corneille, âgé de cinquante-deux ans, le fut, sans compter que Molière lui-même n'était pas insensible aux charmes de sa pensionnaire. Corneille fut, évidemment, très profondément atteint. On ne peut pas, sans doute, attribuer à son sentiment pour la marquise toutes les pièces galantes que Corneille écrivit dans ce temps, cependant il est probable que c'est à cette dame que Corneille parlait ainsi : "Allez, belle marquise, allez en d'autres lieux Semer les doux périls qui naissent de vos yeux. Vous trouverez partout les âmes toutes prêtes A recevoir vos lois et grossir vos conquêtes; Et les cœurs à l'envi se jetant dans vos fers Ne feront point de vœux qui ne vous soient offerts; Mais ne pensez pas tant aux glorieuses peines De ces nouveaux captifs qui vont prendre vos chaînes, Que vous teniez vos soins tout à fait dispensés De faire un peu de grâce à ceux que vous laissez. Apprenez à leur noble et chère servitude L'art de vivre sans vous et sans inquiétude; Et si sans faire un crime on peut vous en prier, Marquise, apprenez-moi l'art de vous oublier. En vain de tout mon cœur la triste prévoyance A voulu faire essai des maux de votre absence..."
En 1660, Corneille publia trois "Discours sur l'art dramatique", tandis que commençait la parution de son Œuvre en recueils, chaque volume étant accompagné d'un «examen» des différentes pièces. Protégé par Fouquet, puis par Louis XIV, Corneille continua à se consacrer au théâtre, mais Racine avait désormais les faveurs du public.
"Discours de la tragédie et des moyens de la traiter selon le vraisemblable ou le nécessaire"
Le théâtre? C'est un monde qui s'établit et se construit dans notre monde sous l'impulsion d'un auteur, d'un texte, d'acteurs, d'une mise en scène, sous l'oeil et l'écoute de spectateurs collectivement réunis en un lieu. "L'auditeur attend l'acteur ; et bien que le théâtre représente la chambre ou le cabinet de celui qui parle, il ne peut toutefois s'y montrer qu'il ne vienne de derrière la tapisserie, et il n'est pas toujours aisé de rendre raison de ce qu'il vient de faire en ville avant que de rentrer chez lui, puisque même quelquefois il est vraisemblable qu'il n'en est pas sorti. Je n'ai vu personne se scandaliser de voir Emilie commencer Cinna sans dire pourquoi elle vient dans sa chambre : elle est présumée y être avant que la pièce commence, et ce n'est que la nécessité de la représentation qui la fait sortir de derrière le théâtre pour y venir. Ainsi je dispenserais volontiers de cette rigueur toutes les premières scènes de chaque acte, mais non pas les autres, parce qu'un acteur occupant une fois le théâtre, aucun n'y doit entrer qui n'ait sujet de parler à lui, ou du moins qui n'ait lieu de prendre l'occasion quand elle s'offre. Surtout lorsqu'un acteur entre deux fois dans un acte, soit dans la comédie, soit dans la tragédie, il doit absolument ou faire juger qu'il reviendra bientôt quand il sort la première fois, comme Horace dans le second acte et Julie dans le troisième de la même pièce, ou donner raison en rentrant pourquoi il revient sitôt." Et pourtant, "la tragédie bien faite" doit être " belle et capable de plaire sans le secours des comédiens, et hors de la représentation. Pour faciliter ce plaisir au lecteur, il ne faut non plus gêner son esprit que celui du spectateur, parce que l'effort qu'il est obligé de se faire pour la concevoir et se la représenter lui-même dans son esprit diminue la satisfaction qu'il en doit recevoir. Ainsi je serais d'avis que le poète prît grand soin de marquer à la marge les menues actions qui ne méritent pas qu'il en charge ses vers, et qui leur ôteraient même quelque chose de leur dignité, s'il se ravalait à les exprimer. Le comédien y supplée aisément sur le théâtre ; mais sur le livre on serait assez souvent réduit à deviner, et quelquefois même on pourrait deviner mal, à moins que d'être instruit par là de ces petites choses. J'avoue que ce n'est pas l'usage des anciens ; mais il faut m'avouer aussi que faute de l'avoir pratiqué, ils nous laissent beaucoup d'obscurités dans leurs poèmes, qu'il n'y a que les maîtres de l'art qui puissent développer ; encore ne sais−je s'ils en viennent à bout toutes les fois qu'ils se l'imaginent. Si nous nous assujettissions à suivre entièrement leur méthode, il ne faudrait mettre aucune distinction d'actes ni de scènes, non plus que les Grecs. Ce manque est souvent cause que je ne sais combien il y a d'actes dans leurs pièces, ni si à la fin d'un acte un acteur se retire pour laisser chanter le choeur, ou s'il demeure sans action cependant qu'il chante, parce que ni eux ni leurs interprètes n'ont daigné nous en donner un mot d'avis à la marge...."
1662-1664 - Les tragédies politiques. Corneille revient à l'histoire romaine avec "Sertorius" (1662), "Sophonisbe" (1663) et" Othon" (1664), des pièces où les intérêts d'Etat tiennent l'essentiel, mais qui n'ont plus l'intensité et les innovations des précédentes. "Agésilas" (1666) est un échec, "Attila" (1667) un demi-succès. Mais Corneille était féru de politique comme tout son temps. Deux auteurs semblent avoir eu une grande influence sur lui, Balzac et Machiavel qui étaient extrêmement lus de son temps, Balzac avec son "Prince" (1631), Machiavel avec son "Prince" et son "Discours sur la première décade de Tite Live". Aussi aimait-il mettre de la politique dans toutes ses pièces, jusque dans le Cid, mais dans Cinna, Sertorius, Nicomède, Sophonisbe, Othon, Attila...

1662 - "Sertorius"
Tragédie en cinq actes représentée à Paris le 25 février 1662 et tenue pour certains par l'une de ses meilleures créations. La pièce évoque l'époque des guerres civiles romaines au temps de Marius et de Sylla. Sertorius, ancien lieutenant de Marius, se révolte contre la tyrannie de Sylla avec l'aide des Lusitaniens à la tête desquels se trouve la reine Viriate. Sertorius aime Viriate, qui consentirait à l'épouser, mais se voit dans l'obligation de demander la main d'Aristie, la première femme de Pompée, que ce dernier a par ailleurs répudié, contraint d'épouser Emilie, belle-fille de Sylla. Sertorius se résout à offrir à Viriate l'un de ses lieutenants, Perpenna, par ailleurs amoureux d'elle (acte II, scène 2). La reine feint d'accepter l'offre Perpenna, mais en lui imposant de la débarrasser d'Aristie...
SERTORIUS.
Si donc je vous offrais pour époux un Romain?
VIRIATE.
Pourrais-je refuser un don de votre main?
SERTORIUS.
J'ose après cet aveu vous faire offre d'un homme
Digne d'être avoué de l'ancienne Rome.
Il en a la naissance, il en a le grand coeur,
Il est couvert de gloire, il est plein de valeur;
De toute votre Espagne il a gagné l'estime,
Libéral, intrépide, affable, magnanime
Enfin c'est Perpenna sur qui vous emportez...
VIRIATE.
J'attendais votre nom après ces qualités;
Les éloges brillants que vous daigniez y joindre
Ne me permettaient pas d'espérer rien de moindre;
Mais certes le détour est un peu surprenant.
Vous donnez une reine à votre lieutenant!
Si vos Romains ainsi choisissent des maîtresses,
A vos derniers tribuns il faudra des princesses.
SERTORIUS.
Madame...
VIRIATE.
Parlons net sur ce choix d'un époux.
Êtes-vous trop pour moi ? Suis-je trop peu pour vous ?
C'est m'offrir, et ce mot peut blesser les oreilles ;
Mais un pareil amour sied bien à mes pareilles ;
Et je veux bien, seigneur, qu'on sache désormais
Que j'ai d'assez bons yeux pour voir ce que je fais.
Je le dis donc tout haut, afin que l'on m'entende :
Je veux bien un Romain, mais je veux qu'il commande ;
Et ne trouverais pas vos rois à dédaigner,
N'était qu'ils savent mieux obéir que régner.
Mais si de leur puissance ils vous laissent l'arbitre,
Leur faiblesse du moins en conserve le titre :
Ainsi ce noble orgueil qui vous préfère à tous
En préfère le moindre à tout autre qu'à vous ;
Car enfin, pour remplir l'honneur de ma naissance,
Il me faudrait un roi de titre et de puissance ;
Mais comme il n'en est plus, je pense m'en devoir
Ou le pouvoir sans nom, ou le nom sans pouvoir.
SERTORIUS.
J'adore ce grand coeur qui rend ce qu'il doit rendre
Aux illustres aïeux dont on vous voit descendre.
À de moindres pensers son orgueil abaissé
Ne soutiendrait pas bien ce qu'ils vous ont laissé.
Mais puisque pour remplir la dignité royale
Votre haute naissance en demande une égale,
Perpenna parmi nous est le seul dont le sang
Ne mêlerait point d'ombre à la splendeur du rang :
Il descend de nos rois et de ceux d'Étrurie.
Pour moi, qu'un sang moins noble a transmis à la vie,
Je n'ose m'éblouir d'un peu de nom fameux
Jusqu'à déshonorer le trône par mes voeux.
Cessez de m'estimer jusqu'à lui faire injure ;
Je ne veux que le nom de votre créature :
Un si glorieux titre a de quoi me ravir ;
Il m'a fait triompher en voulant vous servir ;
Et malgré tout le peu que le ciel m'a fait naître...
VIRIATE.
Si vous prenez ce titre, agissez moins en maître,
Ou m'apprenez du moins, seigneur, par quelle loi
Vous n'osez m'accepter, et disposez de moi.
Accordez le respect que mon trône vous donne
Avec cet attentat sur ma propre personne.
Voir toute mon estime, et n'en pas mieux user,
C'en est un qu'aucun art ne saurait déguiser.
Ne m'honorez donc plus jusqu'à me faire injure :
Puisque vous le voulez, soyez ma créature ;
Et me laissant en reine ordonner de vos voeux,
Portez-les jusqu'à moi parce que je le veux.
Pour votre Perpenna, que sa haute naissance
N'affranchit point encor de votre obéissance,
Fût-il du sang des dieux aussi bien que des rois,
Ne lui promettez plus la gloire de mon choix.
Rome n'attache point le grade à la noblesse.
Votre grand Marius naquit dans la bassesse ;
Et c'est pourtant le seul que le peuple romain
Ait jusques à sept fois choisi pour souverain.
Ainsi pour estimer chacun à sa manière,
Au sang d'un Espagnol je ferais grâce entière ;
Mais parmi vos Romains je prends peu garde au sang,
Quand j'y vois la vertu prendre le plus haut rang.
Vous, si vous haïssez comme eux le nom de reine,
Regardez-moi, seigneur, comme dame romaine :
Le droit de bourgeoisie à nos peuples donné
Ne perd rien de son prix sur un front couronné.
Sous ce titre adoptif, étant ce que vous êtes,
Je pense bien valoir une de mes sujettes ;
Et si quelque Romaine a causé vos refus,
Je suis tout ce qu'elle est, et reine encor de plus.
Peut-être la pitié d'une illustre misère...
SERTORIUS.
Je vous entends, madame, et pour ne vous rien taire,
J'avouerai qu'Aristie...
VIRIATE.
Elle nous a tout dit :
Je sais ce qu'elle espère et ce qu'on vous écrit.
Sans y perdre de temps, ouvrez votre pensée.
Sertorius invite par suite Pompée à se joindre à lui et à lutter pour la liberté, contre Sylla, mais l'un et l'autre, bien que s'estimant, n'arrivent pas à s'accorder. L'Acte III, scène 1, longue de deux cent cinquante vers, est un modèle de discussion politique, face à une tyrannie illégitime, de quelle marge de manoeuvre dispose un exilé? Doit-on demeurer loyal à sa patrie malgré la présence d'un usurpateur et attendre quelques jours meilleurs?
...POMPÉE.
Je crois le bien remplir quand tout mon coeur s'applique
Aux soins de rétablir un jour la république ;
Mais vous jugez, seigneur, de l'âme par le bras ;
Et souvent l'un paraît ce que l'autre n'est pas.
Lorsque deux factions divisent un empire,
Chacun suit au hasard la meilleure ou la pire,
Suivant l'occasion ou la nécessité
Qui l'emporte vers l'un ou vers l'autre côté.
Le plus juste parti, difficile à connaître,
Nous laisse en liberté de nous choisir un maître ;
Mais quand ce choix est fait, on ne s'en dédit plus.
J'ai servi sous Sylla du temps de Marius,
Et servirai sous lui tant qu'un destin funeste
De nos divisions soutiendra quelque reste.
Comme je ne vois pas dans le fond de son coeur,
J'ignore quels projets peut former son bonheur :
S'il les pousse trop loin, moi-même je l'en blâme ;
Je lui prête mon bras sans engager mon âme ;
Je m'abandonne au cours de sa félicité,
Tandis que tous mes voeux sont pour la liberté ;
Et c'est ce qui me force à garder une place
Qu'usurperaient sans moi l'injustice et l'audace,
Afin que, Sylla mort, ce dangereux pouvoir
Ne tombe qu'en des mains qui sachent leur devoir.
Enfin je sais mon but, et vous savez le vôtre.
SERTORIUS.
Mais cependant, seigneur, vous servez comme un autre ;
Et nous, qui jugeons tout sur la foi de nos yeux,
Et laissons le dedans à pénétrer aux dieux,
Nous craignons votre exemple, et doutons si dans Rome
Il n'instruit point le peuple à prendre loi d'un homme ;
Et si votre valeur, sous le pouvoir d'autrui,
Ne sème point pour vous lorsqu'elle agit pour lui.
Comme je vous estime, il m'est aisé de croire
Que de la liberté vous feriez votre gloire,
Que votre âme en secret lui donne tous ses voeux ;
Mais si je m'en rapporte aux esprits soupçonneux,
Vous aidez aux Romains à faire essai d'un maître,
Sous ce flatteur espoir qu'un jour vous pourrez l'être.
La main qui les opprime, et que vous soutenez,
Les accoutume au joug que vous leur destinez ;
Et doutant s'ils voudront se faire à l'esclavage,
Aux périls de Sylla vous tâtez leur courage.
POMPÉE.
Le temps détrompera ceux qui parlent ainsi ;
Mais justifiera-t-il ce que l'on voit ici ?
Permettez qu'à mon tour je parle avec franchise ;
Votre exemple à la fois m'instruit et m'autorise :
Je juge, comme vous, sur la foi de mes yeux,
Et laisse le dedans à pénétrer aux dieux.
Ne vit-on pas ici sous les ordres d'un homme ?
N'y commandez-vous pas comme Sylla dans Rome ?
Du nom de dictateur, du nom de général,
Qu'importe, si des deux le pouvoir est égal ?
Les titres différents ne font rien à la chose :
Vous imposez des lois ainsi qu'il en impose ;
Et s'il est périlleux de s'en faire haïr,
Il ne serait pas sûr de vous désobéir.
Pour moi, si quelque jour je suis ce que vous êtes,
J'en userai peut-être alors comme vous faites :
Jusque-là...
SERTORIUS.
Vous pourriez en douter jusque-là,
Et me faire un peu moins ressembler à Sylla.
Si je commande ici, le sénat me l'ordonne ;
Mes ordres n'ont encore assassiné personne.
Je n'ai pour ennemis que ceux du bien commun ;
Je leur fais bonne guerre, et n'en proscris pas un.
C'est un asile ouvert que mon pouvoir suprême ;
Et si l'on m'obéit, ce n'est qu'autant qu'on m'aime.
POMPÉE.
Et votre empire en est d'autant plus dangereux,
Qu'il rend de vos vertus les peuples amoureux,
Qu'en assujettissant vous avez l'art de plaire,
Qu'on croit n'être en vos fers qu'esclave volontaire,
Et que la liberté trouvera peu de jour
À détruire un pouvoir que fait régner l'amour.
Ainsi parlent, seigneur, les âmes soupçonneuses ;
Mais n'examinons point ces questions fâcheuses,
Ni si c'est un sénat qu'un amas de bannis
Que cet asile ouvert sous vous a réunis.
Une seconde fois, n'est-il aucune voie
Par où je puisse à Rome emporter quelque joie ?
Elle serait extrême à trouver les moyens
De rendre un si grand homme à ses concitoyens.
Il est doux de revoir les murs de la patrie :
C'est elle par ma voix, seigneur, qui vous en prie ;
C'est Rome...
Lors d'une entrevue avec Aristie, Pompée, qui l'aime toujours, lui arrache la promesse de ne jamais se remarier, tandis que Viriate ne peut se résoudre à épouser Perpenna, malgré l'insistance du généreux Sertorius. C'est alors que se répand la nouvelle selon laquelle Sylla a abandonné le pouvoir et qu'Emilie est morte : Aristie peut donc retourner avec Pompée et Sertorius épouser Viriate. Mais Perpenna, jaloux de Sertorius, l`assassine : Pompée venge cette mort et accorde à la reine Viriate la paix et la liberté....
En 1663 est inauguré le mécénat royal et désormais pensionné par le roi, comme les principaux écrivains de l'époque, Corneille illustre désormais, en vers, les campagnes victorieuses du jeune roi... 1663 est aussi l'année de "Sophonisbe", l'héroïne carthaginoise des célèbres pages de Tite-Live dans son Histoire romaine, pages que reprend Corneille à leurs sources pour se distinguer du fondateur de la tragédie moderne, Mairet. La pièce symbolise un moment-clé pour Pierre Corneille : le public lui préfère l' "Astrate" de Philippe Quinault (1635-1688). Il est vrai que l'auteur un obtient en 1660 autant de succès mondains (acquiert une charge de valet de chambre ordinaire du roi et se voit accorder d'importantes gratifications) que littéraires, ayant su constamment exploiter l'évolution des goûts : il a fait jouer successivement des comédies inspirées du théâtre italien (La Comédie sans comédie) et du théâtre espagnol (Le Fantosme amoureux), puis des tragi-comédies dont Amalasonte (1657) et La Mort de Cyrus (1658), mêlant galanterie et héroïsme, jusqu'au jour où surgit Racine... 1665, année du succès d' "Alexandre", de Racine, puis triomphe d' "Andromaque" en 1667, qui éclipse "Attila" dans lequel Corneille avait voulu se surpasser. Comme après le Cid, Corneille se réfugie dans les pieuses traductions, et assiste, seul, à Britannicus...
1670 - "Tite et Bérénice", Racine vs. Corneille...
En 1670, Corneille et Racine se trouvèrent en rivalité directe lorsqu'ils donnèrent simultanément des pièces sur le même sujet antique. Racine triompha avec sa "Bérénice", face au "Tite et Bérénice" de Corneille, qui ne rencontra qu'un succès mitigé, dit-on. Mais la Bérénice de Racine, joué à l'Hôtel de Bourgogne, n'eut que neuf représentations de plus que la pièce de Corneille.
Cet évènement a surtout été l'occasion d'une comparaison suggestive entre les deux auteurs. L'idéal de Racine est "de faire quelque chose de rien" et dans la Première Préface de Britannicus, il oppose ainsi son art à celui de Corneille: "une action simple, chargée de peu de matière, telle que doit être une action qui se passe en un seul jour, et qui, s'avançant par degrés vers sa fin, n'est soutenue que par les intérêts, les sentiments et les passions des personnages". Corneille préfère quant à lui les intrigues complexes, quitte à étoffer la trame d'un Suétone en ajoutant au couple Tite-Bérénice un autre couple, Domitian-Domitie, au risque de surcharger sa pièce, mais nos auteurs ne partageaient pas les mêmes sources (Suétone pour l'un, Don Cassius pour l'autre) ni la même conception de la tragédie...
Racine - ACTE I - SCÈNE PREMIÈRE. Antiochus, Arsace.
ANTIOCHUS
Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux,
Je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux.
Souvent ce cabinet superbe et solitaire,
Des secrets de Titus est le dépositaire.
C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour,
Lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour.
De son appartement cette porte est prochaine,
Et cette autre conduit dans celui de la reine.
Va chez elle. Dis-lui qu'importun à regret,
J'ose lui demander un entretien secret.
ARSACE
Vous, Seigneur, importun ? Vous cet ami fidèle,
Qu'un soin si généreux intéresse pour elle ?
Vous, cet Antiochus, son amant autrefois ;
Vous, que l'Orient compte entre ses plus grands rois :
Quoi ! Déjà de Titus épouse en espérance,
Ce rang entre elle et vous met-il tant de distance ?
ANTIOCHUS
Va, dis-je, et sans vouloir te charger d'autres soins,
Vois si je puis bientôt lui parler sans témoins.
SCÈNE II.
ANTIOCHUS, seul.
Hé bien, Antiochus, es-tu toujours le même ?
Pourrai je sans trembler lui dire : je vous aime ?
Mais quoi ! Déjà je tremble, et mon coeur agité
Craint autant ce moment que je l'ai souhaité.
Bérénice autrefois m'ôta toute espérance.
Elle m'imposa même un éternel silence.
Je me suis tu cinq ans. Et jusques à ce jour
D'un voile d'amitié j'ai couvert mon amour.
Dois-je croire qu'au rang où Titus la destine,
Elle m'écoute mieux que dans la Palestine ?
Il l'épouse. Ai-je donc attendu ce moment
Pour me venir encor déclarer son amant ?
Quel fruit me reviendra d'un aveu téméraire ?
Ah ! Puisqu'il faut partir, partons sans lui déplaire.
Retirons-nous, sortons, et sans nous découvrir,
Allons loin de ses yeux l'oublier, ou mourir.
Hé quoi ! Souffrir toujours un tourment qu'elle ignore ?
Toujours verser des pleurs qu'il faut que je dévore ?
Quoi ? Même en la perdant redouter son courroux ?
Belle reine : et pourquoi vous offenseriez-vous ?
Viens-je vous demander que vous quittiez l'Empire ?
Que vous m'aimiez ? Hélas ! je ne viens que vous dire
Qu'après m'être longtemps flatté que mon rival
Trouverait à ses voeux quelque obstacle fatal ;
Aujourd'hui qu'il peut tout, que votre hymen s'avance,
Exemple infortuné d'une longue constance,
Après cinq ans d'amour, et d'espoir superflus,
Je pars, fidèle encor quand je n'espère plus.
Au lieu de s'offenser, elle pourra me plaindre.
Quoi qu'il en soit, parlons, c'est assez nous contraindre.
Et que peut craindre, hélas ! un amant sans espoir
Qui peut bien se résoudre à ne la jamais voir ?
Corneille - ACTE I - SCÈNE PREMIÈRE. Domitie, Plautine.
DOMITIE.
Laisse-moi mon chagrin, tout injuste qu'il est ;
Je le chasse, il revient, je l'étouffe, il renaît,
Et plus nous approchons de ce grand hyménée,
Plus en dépit de moi je m'en trouve gênée,
Il fait toute ma gloire, il fait tous mes désirs,
Ne devrait-il pas faire aussi tous mes plaisirs ?
Depuis plus de six mois la pompe s'en apprête,
Rome s'en fait d'avance en l'esprit une fête,
Et tandis qu'à l'envi tout l'Empire l'attend,
Mon coeur dans tout l'Empire est le seul mécontent.
PLAUTINE.
Que trouvez-vous, Madame, ou d'amer, ou de rude,
À voir qu'un tel bonheur n'ait plus d'incertitude,
Et quand dans quatre jours vous devez y monter,
Quel importun chagrin pouvez-vous écouter ?
Si vous n'en êtes pas tout à fait la maîtresse,
Du moins à l'Empereur cachez cette tristesse,
Le dangereux soupçon de n'être pas aimé
Peut le rendre à l'objet dont il fut trop charmé :
Avant qu'il vous aimât il aimait Bérénice,
Et s'il n'en put alors faire une impératrice,
À présent il est maître, et son père au tombeau
Ne peut plus le forcer d'éteindre un feu si beau.
DOMITIE.
C'est là ce qui me gêne, et l'image importune
Qui trouble les douceurs de toute ma fortune :
J'ambitionne et crains l'hymen d'un empereur
Dont j'ai lieu de douter si j'aurai tout le coeur.
Ce pompeux appareil où sans cesse il ajoute,
Recule chaque jour un noeud qui le dégoûte,
Il souffre chaque jour que le gouvernement
Vole ce qu'à me plaire il doit d'attachement,
Et ce qu'il en étale agit d'une manière
Qui ne m'assure point d'une âme tout entière.
Souvent même au milieu des offres de sa foi
Il semble tout à coup qu'il n'est pas avec moi,
Qu'il a quelque plus douce ou noble inquiétude ;
Son feu de sa raison est l'effet et l'étude,
Il s'en fait un plaisir bien moins qu'un embarras,
Et s'efforce à m'aimer, mais il ne m'aime pas.
PLAUTINE.
À cet effort pour vous qui pourrait le contraindre ?
Maître de l'univers, a-t-il un maître à craindre ?
DOMITIE.
J'ai quelques droits, Plautine, à l'empire romain,
Que le choix d'un époux peut mettre en bonne main :
Mon père avant le sien élu pour cet Empire
Préféra... Tu le sais, et c'est assez t'en dire :
C'est par cet intérêt qu'il m'apporte sa foi,
Mais pour le coeur, te dis-je, il n'est pas tout à moi.
PLAUTINE.
La chose est bien égale, il n'a pas tout le vôtre,
S'il aime un autre objet, vous en aimez un autre,
Et comme sa raison vous donne tous ses voeux,
Votre ardeur pour son sang fait pour lui tous vos feux.

1674 - "Suréna, général des Parthes
Corneille a soixante-huit ans. "Mon vrai crime est ma gloire, et non pas mon amour" - Le dernier sursaut de Corneille, son ultime chef d'oeuvre. Eurydice, fille du roi d'Arménie, doit, â la suite d'un traité, épouser Pacorus, fils d'Orode, roi des Parthes. Mais elle aime d'un amour partagé Suréna, général des Parthes vainqueur de Crassus le Romain. Cependant la gloire de Suréna porte ombrage à Orode, il hait son chef des armées qui pourtant est le seul à pouvoir soutenir son trône : ou Suréna épousera sa fille Mandane, permettant ainsi à Orode de s'assurer de sa loyauté, ou il périra. Dix-huit scènes, une intrigue qui s'achemine sans rebondissement vers une issue tragique et qui s'impose d'elle-même parce que nos deux héros refusent de choisir...
Acte III, scène 1 - Orode, Sillace.
SILLACE.
Je l'ai vu par votre ordre, et voulu par avance
Pénétrer le secret de son indifférence.
Il m'a paru, Seigneur, si froid, si retenu...
Mais vous en jugerez quand il sera venu.
Cependant je dirai que cette retenue
Sent une âme de trouble et d'ennuis prévenue ;
Que ce calme paraît assez prémédité
Pour ne répondre pas de sa tranquillité ;
Que cette indifférence a de l'inquiétude,
Et que cette froideur marque un peu trop d'étude.
ORODE.
Qu'un tel calme, Silllace, a droit d'inquiéter
Un roi qui lui doit tant, qu'il ne peut s'acquitter !
Un service au-dessus de toute récompense
À force d'obliger tient presque lieu d'offense :
Il reproche en secret tout ce qu'il a d'éclat,
Il livre tout un coeur au dépit d'être ingrat.
Le plus zélé déplaît, le plus utile gêne,
Et l'excès de son poids fait pencher vers la haine.
Suréna de l'exil lui seul m'a rappelé ;
Il m'a rendu lui seul ce qu'on m'avait volé,
Mon sceptre ; de Crassus il vient de me défaire :
Pour faire autant pour lui, quel don puis-je lui faire ?
Lui partager mon trône ? Il serait tout à lui,
S'il n'avait mieux aimé n'en être que l'appui.
Quand j'en pleurais la perte, il forçait des murailles ;
Quand j'invoquais mes dieux, il gagnait des batailles.
J'en frémis, j'en rougis, je m'en indigne, et crains
Qu'il n'ose quelque jour s'en payer par ses mains ;
Et dans tout ce qu'il a de nom et de fortune,
sa fortune me pèse, et son nom m'importune.
Qu'un monarque est heureux quand parmi ses sujets
Ses yeux n'ont point à voir de plus nobles objets,
Qu'au-dessus de sa gloire il n'y connaît personne,
Et qu'il est le plus digne enfin de sa couronne !
SILLACE.
Seigneur, pour vous tirer de ces perplexités,
La saine politique a deux extrémités.
Quoi qu'ait fait Suréna, quoi qu'il en faille attendre,
Ou faites-le périr, ou faites-en un gendre.
Puissant par sa fortune, et plus par son emploi,
S'il devient par l'hymen l'appui d'un autre roi,
Si dans les différends que le ciel vous peut faire,
Une femme l'entraîne au parti de son père,
Que vous servira lors, Seigneur, d'en murmurer ?
Il faut, il faut le perdre, ou vous en assurer :
Il n'est point de milieu.
ORODE.
Ma pensée est la vôtre ;
Mais s'il ne veut pas l'un, pourrai-je vouloir l'autre ?
Pour prix de ses hauts faits, et de m'avoir fait roi,
Son trépas... Ce mot seul me fait pâlir d'effroi ;
Ne m'en parlez jamais : que tout l'état périsse
Avant que jusque-là ma vertu se ternisse,
Avant que je défère à ces raisons d'état
Qui nommeraient justice un si lâche attentat !
SILLACE.
Mais pourquoi lui donner les Romains en partage,
Quand sa gloire, Seigneur, vous donnait tant d'ombrage ?
Pourquoi contre Artabase attacher vos emplois,
Et lui laisser matière à de plus grands exploits ?
ORODE.
L'événement, Sillace, a trompé mon attente.
Je voyais des Romains la valeur éclatante ;
Et croyant leur défaite impossible sans moi,
Pour me la préparer, je fondis sur ce roi :
Je crus qu'il ne pourrait à la fois se défendre
Des fureurs de la guerre et de l'offre d'un gendre ;
Et que par tant d'horreurs son peuple épouvanté
Lui ferait mieux goûter la douceur d'un traité ;
Tandis que Suréna, mis aux Romains en butte,
Les tiendrait en balance, ou craindrait pour sa chute,
Et me réserverait la gloire d'achever,
Ou de le voir tombant, et de le relever.
Je réussis à l'un, et conclus l'alliance ;
Mais Suréna vainqueur prévint mon espérance.
À peine d'Artabase eus-je signé la paix,
Que j'appris Crassus mort et les Romains défaits.
Ainsi d'une si haute et si prompte victoire
J'emporte tout le fruit, et lui toute la gloire,
Et beaucoup plus heureux que je n'aurais voulu,
Je me fais un malheur d'être trop absolu.
Je tiens toute l'Asie et l'Europe en alarmes,
Sans que rien s'en impute à l'effort de mes armes ;
Et quand tous mes voisins tremblent pour leurs états,
Je ne les fais trembler que par un autre bras.
J'en tremble enfin moi-même, et pour remède unique,
Je n'y vois qu'une basse et dure politique,
Si Mandane, l'objet des voeux de tant de rois,
Se doit voir d'un sujet le rebut ou le choix.
SILLACE.
Le rebut ! Vous craignez, Seigneur, qu'il la refuse ?
ORODE.
Et ne se peut-il pas qu'un autre amour l'amuse,
Et que rempli qu'il est d'une juste fierté,
Il n'écoute son coeur plus que ma volonté ?
Le voici ; laissez-nous.
Réduite par son devoir à subir une union qui lui fait horreur, Euridyce souhaiterait du moins ne pas voir Suréna épouser Mandane. Suréna décline l'offre du roi; il tente vainement de dissimuler sous des prétextes respectueux la véritable cause de son refus; son amour pour Eurydice est découvert. Dès lors sa perte est assurée s'il ne cède pas. Sa sœur Palmis tente en vain de le fléchir, mais le héros restera inébranlable, Suréna quitte la scène, et Palmis continue à supplier Eurydice d'intervenir. Cruellement déchirée, celle-ci cède enfin, mais on apprend â l'instant même que Surélia est tombé, percé de flèches, dès sa sortie du palais. A cette nouvelle, Eurydice s'écroule expirante entre les bras de sa suivante, tandis que Palmis crie son ardent désir de venger son frère...
Suréna, acte V, scène 3 - Eurydice, Suréna, Palmis.
PALMIS.
On dit qu'on vous exile à moins que d'épouser,
Seigneur, ce que le roi daigne vous proposer.
SURÉNA.
Non ; mais jusqu'à l'hymen que Pacorus souhaite,
Il m'ordonne chez moi quelques jours de retraite.
PALMIS.
Et vous partez ?
SURÉNA.
Je pars.
PALMIS.
Et malgré son courroux,
Vous avez sûreté d'aller jusque chez vous ?
Vous êtes à couvert des périls dont menace
Les gens de votre sorte une telle disgrâce,
Et s'il faut dire tout, sur de si longs chemins
Il n'est point de poisons, il n'est point d'assassins ?
SURÉNA.
Le roi n'a pas encore oublié mes services,
Pour commencer par moi de telles injustices :
Il est trop généreux pour perdre son appui.
PALMIS.
S'il l'est, tous vos jaloux le sont-ils comme lui ?
Est-il aucun flatteur, Seigneur, qui lui refuse
De lui prêter un crime et lui faire une excuse ?
En est-il que l'espoir d'en faire mieux sa cour
N'expose sans scrupule à ces courroux d'un jour,
Ces courroux qu'on affecte alors qu'on désavoue
De lâches coups d'état dont en l'âme on se loue,
Et qu'une absence élude, attendant le moment
Qui laisse évanouir ce faux ressentiment ?
SURÉNA.
Ces courroux affectés que l'artifice donne
Font souvent trop de bruit pour abuser personne.
Si ma mort plaît au roi, s'il la veut tôt ou tard,
J'aime mieux qu'elle soit un crime qu'un hasard ;
Qu'aucun ne l'attribue à cette loi commune
Qu'impose la nature et règle la fortune ;
Que son perfide auteur, bien qu'il cache sa main,
Devienne abominable à tout le genre humain ;
Et qu'il en naisse enfin des haines immortelles
Qui de tous ses sujets lui fassent des rebelles.
PALMIS.
Je veux que la vengeance aille à son plus haut point :
Les morts les mieux vengés ne ressuscitent point,
Et de tout l'univers la fureur éclatante
En consolerait mal et la soeur et l'amante.
SURÉNA.
Que faire donc, ma soeur ?
PALMIS.
Votre asile est ouvert.
SURÉNA.
Quel asile ?
PALMIS.
L'hymen qui vous vient d'être offert.
Vos jours en sûreté dans les bras de Mandane,
Sans plus rien craindre...
SURÉNA.
Et c'est ma soeur qui m'y condamne !
C'est elle qui m'ordonne avec tranquillité
Aux yeux de ma princesse une infidélité !
PALMIS.
Lorsque d'aucun espoir notre ardeur n'est suivie,
Doit-on être fidèle aux dépens de sa vie ?
Mais vous ne m'aidez point à le persuader,
Vous qui d'un seul regard pourriez tout décider ?
Madame, ses périls ont-ils de quoi vous plaire ?
EURYDICE.
Je crois faire beaucoup, madame, de me taire ;
Et tandis qu'à mes yeux vous donnez tout mon bien,
C'est tout ce que je puis que de ne dire rien.
Forcez-le, s'il se peut, au noeud que je déteste ;
Je vous laisse en parler, dispensez-moi du reste :
Je n'y mets point d'obstacle, et mon esprit confus...
C'est m'expliquer assez : n'exigez rien de plus.
SURÉNA.
Quoi ? Vous vous figurez que l'heureux nom de gendre,
Si ma perte est jurée, a de quoi m'en défendre,
Quand malgré la nature, en dépit de ses lois,
Le parricide a fait la moitié de nos rois,
Qu'un frère pour régner se baigne au sang d'un frère,
Qu'un fils impatient prévient la mort d'un père ?
Notre Orode lui-même, où serait-il sans moi ?
Mithradate pour lui montrait-il plus de foi ?
Croyez-vous Pacorus bien plus sûr de Phradate ?
J'en connais mal le coeur, si bientôt il n'éclate,
Et si de ce haut rang, que j'ai vu l'éblouir,
Son père et son aîné peuvent longtemps jouir.
Je n'aurai plus de bras alors pour leur défense ;
Car enfin mes refus ne font pas mon offense ;
Mon vrai crime est ma gloire, et non pas mon amour :
Je l'ai dit, avec elle il croîtra chaque jour ;
Plus je les servirai, plus je serai coupable ;
Et s'ils veulent ma mort, elle est inévitable.
Chaque instant que l'hymen pourrait la reculer
Ne les attacherait qu'à mieux dissimuler ;
Qu'à rendre, sous l'appas d'une amitié tranquille,
L'attentat plus secret, plus noir et plus facile.
Ainsi dans ce grand noeud chercher ma sûreté,
C'est inutilement faire une lâcheté,
Souiller en vain mon nom, et vouloir qu'on m'impute
D'avoir enseveli ma gloire sous ma chute.
Mais, dieux ! Se pourrait-il qu'ayant si bien servi,
Par l'ordre de mon roi le jour me fût ravi ?
Non, non : c'est d'un bon oeil qu'Orode me regarde ;
Vous le voyez, ma soeur, je n'ai pas même un garde :
Je suis libre.
PALMIS.
Et j'en crains d'autant plus son courroux :
S'il vous faisait garder, il répondrait de vous.
Mais pouvez-vous, Seigneur, rejoindre votre suite ?
Êtes-vous libre assez pour choisir une fuite ?
Garde-t-on chaque porte à moins d'un grand dessein ?
Pour en rompre l'effet, il ne faut qu'une main.
Par toute l'amitié que le sang doit attendre,
Par tout ce que l'amour a pour vous de plus tendre...
SURÉNA.
La tendresse n'est point de l'amour d'un héros :
Il est honteux pour lui d'écouter des sanglots ;
Et parmi la douceur des plus illustres flammes,
Un peu de dureté sied bien aux grandes âmes.
PALMIS.
Quoi ? Vous pourriez...
SURÉNA.
Adieu : le trouble où je vous vois
Me fait vous craindre plus que je ne crains le roi.
1676-1682 - Louis XIV fait jouer à Versailles en octobre 1676, Cinna, Horace, Pompée, Oedipe, Setorius et Rodogune et en 1682 paraît une nouvelle édition de son théâtre. Corneille rédige alors son remerciement au roi...
"Est-il vrai, grand monarque, et puis-je me vanter
Que tu prennes plaisir à me ressusciter,
Qu'au bout de quarante ans Cinna, Pompée, Horace
Reviennent à la mode et retrouvent leur place,
Et que l'heureux brillant de mes jeunes rivaux
N'ôte point leur vieux lustre à mes premiers travaux
Achève: les derniers n'ont rien qui dégénère,
Rien qui les fasse croire enfants d'un autre père:
Ce sont des malheureux étouffés au berceau,
Qu'un seul de tes regards tirerait du tombeau,.
On voit Sertorius, OEdipe et Rodogune
Rétablis par ton choix dans toute leur fortune;
Et ce choix montrerait qu'Othon et Suréna
Ne sont pas des cadets indignes de Cinna.
Sophonisbe à son tour, Attila, Pulchérie
Reprendraient pour te plaire une nouvelle vie;
Agésilas en foule aurait des spectateurs
Et Bérénice enfin trouverait des acteurs.
Le peuple, je l'avoue, et la cour les dégradent :
J'affaiblis, ou du moins ils se le persuadent;
Pour bien écrire encor j'ai trop longtemps écrit
Et les rides du front passent jusqu'à l'esprit;
Mais contre cet abus que j'aurais de suffrages,
Si tu donnais les tiens à mes derniers ouvrages!
Que de tant de bonté l'impérieuse loi
Ramènerait bientôt et peuple et cour vers moi!"
Mais le temps de Corneille est désormais compté, il versifie pour Molière une tragédie-ballet, "Psyché" (1671), où l'Amour apparaît à Psyché, - un amour qui a toujours été pour le dramaturge le seul sentiment digne d'être confronté à la gloire -, et ses deux dernières créations," Pulchérie" (1672) et "Suréna" (1674), furent des échecs qui le poussèrent à cesser son activité de dramaturge. Ses derniers vers, selon toute apparence, seront de 1680 et seront écrits à l'occasion du mariage du Dauphin : "Tant de peuples réduits à rentrer sous sa loi Sont autant de dépôts qu'il conserve pour toi; Et mes vers, à ses pas enchaînant la victoire, Préparaient pour ta tête un rayon de sa gloire..."
Il mourut à Paris le 1er octobre 1684, dans la petite maison de la rue d'Argenteuil qui disparut il y a quelques années, en même temps que la butte Saint-Roch, pour le percement de l'avenue de l'Opéra...
PSYCHE, l'amour naissant...
"A peine ie vous vois, que mes frayeurs cessées
Laissent évanouir l'image du trépas,
Et que ie sens couler dans mes veines glacées
Un je ne sais quel feu que je ne connais pas.
J'ai senti de l'estime et de la complaisance,
De l'amitié, de la reconnaissance ;
De la compassion les chagrins innocents
M'en ont fait sentir la puissance ;
Mais je n'ai point encor senti ce que je sens.
Je ne sais ce que c'est, mais je sais qu'il me charme,
Que je n'en conçois point d'alarme :
Plus j'ai les yeux sur vous, plus je m'en sens charmer.
Tout ce que j'ai senti n'agissait point de même,
Et je dirais que je vous aime,
Seigneur, si je savais ce que c'est que d'aimer.
Ne les détournez point, ces yeux qui m'empoisonnent,
Ces yeux tendres, ces yeux perçants, mais amoureux,
Qui semblent partager le trouble qu'ils me donnent.
Hélas! plus ils sont dangereux,
Plus ie me plais à m'attacher sur eux.
Par quel ordre du ciel, que ie ne puis comprendre,
Vous dis-je plus que je ne dois,
Moi de qui la pudeur devrait du moins attendre
Que vous m'expliquassiez le trouble où je vous vois?
Vous soupirez, Seigneur, ainsi que je soupire :
Vos sens comme les miens paraissent interdits.
C'est à moi de m'en taire, à vous de me le dire ;
Et cependant c'est moi qui vous le dis.
(Psyché, III, 3)
