- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

- August Strindberg (1849-1912), "La Chambre rouge" (Röda rummet, 1879), "Mademoiselle Julie" (Fröken Julie, 1888), "Le Songe" (1901) - Selma Lagerlöf (1858-1940) - Amalie Skram (1846-1905), "Les Gens de Hellemyr" (1887-1898) - .........
Last Update : 12/11/2016

August Strindberg (1849-1912) incarne la percée du moderne dans la littérature suédoise. Il écrivit sa pièce historique "Mäster Olof" (1872) alors qu'il était journaliste, une pièce qui fut rejetée par le théâtre national et jouée la première fois en 1890. "Mäster Olof" est maintenant vue comme la première pièce moderne suédoise. Strindberg se fit connaître grâce à son roman "Röda rummet" (La Chambre rouge, 1879), une satire du monde des arts à Stockholm, sur l'hypocrisie et la corruption, le premier roman suédois moderne influencés par des auteurs tels que Charles Dickens et Mark Twain. Strindberg enchaîna avec une courte histoire satirique, ""Le Nouveau pays" (1882) et un recueil de poésies, "Poésie en vers et en prose" (1883). Les attaques de ces œuvres contre l'establishment - institutions politique, bureaucratie, presse, monde des affaires, Église et élite culturelle - le rendirent si impopulaire qu'il préféra s'exiler, de 1883 à 1889.
On compare souvent les pièces des débuts de Strindberg - comme "Fröken Julie" (Mademoiselle Julie, 1888) - avec celles d'lbsen. Strindberg continua à évoluer et abandonna la "science" du théâtre naturaliste au profit des pièces symboliques et expressionnistes, avec, notamment, "Dödsdansen" (La Danse de mort, 1900), "Ett drömspel" (Le Songe, un jeu de rêves, 1901) et "Spöksonaten" (La Danse des spectres, 1907)...
En 1860, la Scandinavie occupe une place marginale dans la culture européenne, il faut attendre les années 1890, soit seulement trente ans plus tard, pour que des écrivains comme Henrik Ibsen (1828-1906) et Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), en Norvège, et August Strindberg (1849-1912), en Suède, influencent le cours de la littérature dans toute l'Europe. Cet épanouissement culturel s'étendra à la musique, avec Edvard Grieg (1843-1907) et Jean Sibelius (1865-1957), et aux arts visuels, Vilhelm Hammershoi (1864-1916), Edvard Munch (1863-1944) et Gustav Vigeland (1869-1943). La Révolution industrielle et ses conséquences, comme la croissance économique, l'urbanisation, l'émergence des classes moyennes et les problèmes sociaux, n'atteignirent les pays scandinaves que sur le tard. La Scandinavie fut également à la traîne sur le plan intellectuel et elle ne ressentit l'influence des philosophies politiques, telles que le libéralisme, l'utilitarisme, le socialisme et l'anarchisme, qu'à partir des années 1870. Mais alors que cette évolution politique et sociale s'était étendue sur des décennies partout en Europe, elle fut très rapide et brutale en Scandinavie. ll en fut de même en littérature, avec un passage intense et concentré du Romantisme inspiré par la tradition au Naturalisme à la fin du XIXe siècle...

August Strinberg (1849-1912)
Né à Stockholm, Strindberg est l'auteur d'une oeuvre autobiographique unique qui, de "Lui à Elle" (1875-1876) à "Seul" (1903), en passant par "Le Fils de la servante" (1886), ne comprend pas moins de douze ouvrages, mais tous composant une confession continue et une même obsession : nous rêvons sans cesse la Vie, nous idéalisons la Femme, mais ni la Vie ni la Femme ne se montrent à la hauteur de nos désirs de perfection et d'absolu. La masse, envieuse et vile, et le destin, si ironique, savent s'unir pour dissoudre la personnalité de notre être. Et plus encore, notre lucidité va croître à proportion de notre angoisse. D'où cette "lutte des cerveaux" qui s'achève inéluctablement en "assassinat psychique", en folie pour l'homme qui a entrepris d'échapper au mensonge commun.
C'est en France que Strindberg découvre le naturalisme et c'est en français qu'il fit le récit de ses plus douloureuses expériences (Le Playdoyer d'un fou, 1887; Inferno, 1897). Mais à la différence d'un Zola, Strindberg utilise la méthode naturaliste non pour exposer les vices de la société, mais disséquer les "fantômes du moi".

Strinberg a toujours eu une attirance pour l'occultisme et l'oeuvre d'un Emanuel Swedenborg (1688-1772), théologien et philosophe suédois qui à l'âge de cinquante-six ans entra dans une phase de visions mystiques. Pour Strindberg, le monde est fait de correspondances et d'appels qu'il faut interpréter si ,l'on veut que soient réunies les deux parts qui font l'être complet, le terrestre et le céleste, le féminin et le masculin. Et c'est la Femme, usant de la perfidie pour conforter un univers mesquin, qui donne à l'homme une existence qui n'est qu'un "Songe" (1902), où, pour échapper au mal de vivre, l'homme se dédouble, ou, comme dans "Sonate des spectres" (1907), la vie et la mort ne cessent d'échanger leurs signes. Et comme Ibsen pour ses personnages féminins, Hedda Gabler, femme frustrée d'idéal et d'amour, l'illustration de l'antagonisme entre le génie et les forces qui le persécutent, passe par la Femme.

Johan August Strindberg est né à Stockholm des amours d'Oskar Strindberg négociant, bon petit bourgeois malheureux en affaires, et d'une fille d'auberge, qui devint la gouvernante, puis la maîtresse d'Oskar qu'elle finira par épouser. L'année 1870 marque la découverte de Georg Brandes (et en particulier de ses commentaires sur Shakespeare), le grand éveilleur des consciences littéraires dans les pays nordiques. Strindberg rencontre, en 1875, Siri von Essen, femme du baron Wrangel, qu'il épouse en 1877, après l'avoir poussée au divorce. Le couple connaîtra quelques années heureuses que ponctue la publication d'un drame, "Le Mystère de la Guilde" (1879), et du roman "La Chambre rouge" (Röda rummet, 1879). Mais, dès 1880, les brouilles assombrissent la vie des époux Strindberg et dès 1882, dans "La Femme de sire Bengt" (Herr Bengts Hustru), se fait jour son trop célèbre antiféminisme : ils divorceront en 1897.
Le séjour en France est directement responsable du passage au naturalisme, qui ouvre une période d'une extrême créativité : Strindberg s'adonne pleinement à ce qu'on a dénommé le "radicalisme" scandinave, cette rage d'absolu, cette volonté de pousser théories et applications jusqu'en leurs derniers retranchements, cette propension dans l'écriture comme dans la vie à ne pouvoir s'affronter et prendre conscience que dans le paroxysme de la crise. Lorsqu'il atteint la quarantaine, il n'a pas encore achevé la quête passionnée et irritante de lui-même, il s'emporte contre les mesquineries d'une destinée contraire, et c'est dans le théâtre qu'il va exprimer ce mélange d'angoisse et de violence polémique : "Camarades" (Kamraterna, 1888, d'abord écrit en 1886 sous le titre de Maraudeurs), "Le Père" (Fadern, 1887), "Mademoiselle Julie" (1888, la plus jouée de ses pièces), "La Danse macabre, Créanciers" (Fordringsägare, 1888), "Paria" (1889), "La Plus Forte" (Den starkare, 1889), Simoun (1889). C'est alors le tournant décisif : s''inspirant de Darwin, il a toujours éprouvé que le creuset social comme la vie de couple n'est que lutte, avec Nietzsche, surgit le "surhomme", la traduction de son sentiment qu'il existe bien une aristocratie de l'esprit que le peuple hait instinctivement. Mais si, en 1879, son roman "La Chambre rouge" (Röda rummet) a pu lui donner une certaine notoriété, il va souffrir de l'incompréhension systématique dont fait preuve la critique dramatique, sa misogynie produit des articles outranciers, et se laisse tenter par l'occultisme, alors en plein réveil en France, rompt avec le naturalisme et se tourne vers le symbolisme. Multipliant les expériences alchimiques dans un grand dénuement matériel, sentimental et moral, il sombre dans le délire de la persécution et l'idée de suicide, dont "Inferno" (écrit en français en 1897, puis traduit en suédois) relate l'ampleur.

Le Fils de la servante (Tjensteqvinnans son, 1886-1887)
Récit autobiographique comprenant une série de souvenirs et d'esquisses décrivant l`atmosphère étroite et bornée dans laquelle Strindberg fut élevé à Stockholm, jusqu'à son inscription à l'université d'Uppsala en 1867. L`enfance et la jeunesse avaient été pour la plupart des romantiques l'âge idéal, au contraire de Strindberg qui, loin d'être un romantique, considèrera cette période de la vie humaine comme une phase préparatoire et d'une moindre valeur. Ces souvenirs ne sont donc nullement idéalisés et on y retrouve, dans les limites imposées par la fidélité envers le passé, les qualités d`observation incisive et amère qui constitueront l'originalité de "La Chambre rouge". Les principaux sujets de ce livre seront donc la famille et l'école. L`enseignement donné à cette époque dans les écoles suédoises avait un caractère surtout formaliste. et la discipline y gardait toute son antique rigueur. De là l'opposition de l`élève sensible et précoce, incapable de souffrir les coups de bâton et plus porté vers l'étude des langues modernes et des sciences naturelles que vers celle du latin. Il se plut donc davantage dans une école privée, où l'enseignement était plus compréhensif et plus moderne. Strindberg ne reconnaît pas avoir reçu à l`école d'impulsions décisives et estime avoir appris davantage grâce à ses propres lectures et à ses études individuelles ; mais, par la vie en commun avec les camarades, l'école contribua à le former socialement plus que ne le fit sa famille. Strindberg nous trace un portrait aux contours précis mais froids de son père, un homme aux manières distinguées dont les affaires n`allaient pas toujours très bien et qui avait fait une mésalliance que la société jugeait sans indulgence. Il nous décrit également sa mère qui, pendant sa jeunesse, avait été servante dans une pension, une femme bonne et douce qui conserva toujours ses habitudes simples. Ces portraits se détachent sur le fond grisâtre de la vie que la petite famille mène dans un des faubourgs de la capitale : les fils nécessairement confiés aux servantes, les économies et leur mesquinerie, le manque de compréhension et de sympathie entre parents et enfants. Ce côté mesquin de la vie familiale ne constitue cependant pas, aux yeux de l`auteur, une exception regrettable mais n'y voit que reflet de l'étroitesse de toute vie familiale et l'expression de l'insuffisance de la famille, une "auberge où l'on mange et dort pour rien". "Famille, ajoutera-t-il, tu es la maison de retraite des femmes qui aiment leurs aises, le bagne du père de famille et l`enfer des enfants!" ...
L'année 1870 marque la découverte de Georg Brandes (et en particulier de ses commentaires sur Shakespeare), le grand éveilleur des consciences littéraires dans les pays nordiques. Strindberg écrit alors des articles de critique d'art dans les Dagens Nyheter, manifeste un intérêt pour les milieux artistes, connaît un moment de passion pour la peinture. Puis Strindberg rencontre, en 1875, Siri von Essen, femme du baron Wrangel, il la pousse au divorce et l'épouse en 1877. Le couple connaîtra quelques années heureuses que ponctue la publication d'un drame, "Le Mystère de la Guilde" (1879), et du roman "La Chambre rouge" (Röda rummet,1879), où la satire de la société est tempérée par un solide humour. Mais, dès 1880, les brouilles assombrissent la vie des époux Strindberg, il est vrai que celui-ci se montre excessif et tient la femme tout à la fois pour une madone, un vampire, un esprit du mal, un ange égaré sur terre, une sensualité dévorante. Dès 1882, dans "La Femme de sire Bengt" (Herr Bengts Hustru), se fera jour le célèbre antiféminisme de l'auteur, puis dans son second recueil de nouvelles (1885) qui révèle par ailleurs, ainsi qu'on l'a souligné, le passage à un "radicalisme" ou une rage d'absolu, qui le l'entraîne à pousser théories et applications jusqu'en leurs derniers retranchements, attitude qui va désormais ponctuer, par soubresauts et dans tous les domaines, l'histoire des pays nordiques.
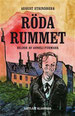
La Chambre rouge (Röda rummet, 1879)
Considéré comme le premier roman moderne suédois, proche d'un Dickens ou d'un Zola, la prose colorée de Strindberg suit un jeune idéaliste, Arvid Falk, qui aspire à devenir écrivain, rejoint un groupe d'artistes, mais se voit forcé de lutter contre ses propres tendances puritaines. Le réalisme vigoureux de ce roman eut pour effet de débarrasser la littérature suédoise de l'esprit et des formes exsangues du dernier romantisme ainsi que de l'imagerie conventionnelle et académique. Dès lors, Strindberg assuma une place de premier plan dans la culture de son pays. Avec quelques ouvrages du même auteur, "La Chambre rouge" doit être comptée parmi les manifestations les plus marquantes de la littérature moderne, par ce qu'elle a apporté d'âprement douloureux dans la représentation de la corruption des mœurs et des diverses fonctions sociales.
"Scènes de la vie d'artistes et de littérateurs" d'August Strindberg écrites en 1879 et publiées en 1886. Les personnages et les milieux de la société suédoise de l'époque y sont dessinés d'un trait particulièrement incisif. Silhouettes de la vie de bohème, commerçants usuriers, journalistes sans scrupules et sans conscience, femmes oisives, envieuses et vaniteuses s'occupant de bienfaisance, éditeurs ignorants et affairistes, prêtres rapaces, jeunes filles corrompues simulant l'amour; pesante oisiveté et somnolence de certains services publics, débats mesquins du Riksdag suédois, spéculations et tripotages parés d'idéaux sociaux et patriotiques, escroquerie organisée envers les travailleurs : tout ceci est dépeint avec une âpre vigueur, une impitoyable crudité qui constitue le caractère le plus marquant et en même temps les limites de Strindberg écrivain. Pour nombre de critiques, ces limites sont aisément décelables quand l`observation amère se mue en caricature sarcastique. Mais lorsque Strindberg se garde de tomber dans de semblables simplifications, lorsqu'il dépeint des êtres médiocres et hypocrites mais humains, comme Carl Nicolaus Falk, ou des situations misérables et douloureuses, comme l'enterrement de la petite-fille de Struve, l'écrivain nous donne la mesure de son talent.
Cette succession de récits s'intègre à une relation sur la vie d'un jeune homme généreux et idéaliste, Arvid Falk, qui, après avoir quitté son emploi pour se consacrer à la littérature, accumule d'amères expériences et, déçu, reprend sa vie de fonctionnaire, consacrant ses loisirs à la numismatique : un homme inoffensif et inerte comme une souche, du moins en apparence, même si le feu continue de couver sous la cendre.

Petit Catéchisme à l'usage de la classe inférieure (Lilla katekes för underklassen, 1886)
"- Qui a inventé le mariage ?
- La femme qui, de cette façon créa une nouvelle classe supérieure, en se dérobant au travail.
Insolentes, provocatrices, drôles, subversives ou désespérées, les réponses apportées aux multiples questions de morale ou de société posées dans ce Petit catéchisme cachent, sous leur allure parodique, l'homme contesté, l'écrivain controversé et l'époux tourmenté que fut Strindberg. Car cet opuscule violent, dont les affirmations sont parfois aussi stupéfiantes que contradictoires, reflète les idées de son temps auxquelles s'est heurté l'écrivain, les idéaux qui ont pu l'illuminer ou les persécutions dont il se croyait l'objet. Et reste un témoignage important sur le bouillonnement des idées de Strindberg pendant une période très mouvementée de sa vie." (Actes Sud)
"Qu'est-ce que la société? La société est une forme de vie communautaire qui permet à la classe supérieure de maintenir la classe inférieure sous sa domination. Voilà donc le secret de la société dévoilé au grand jour. Il est facile de comprendre que ce secret, une fois révélé, déclenche de terribles cris d'épouvante et de sempiternelles réfutations qui ne sont, en réalité, que des objections simplistes. Il est évident que la classe supérieure qui nous éduque et qui écrit des livres a, pour se défendre, tous les arguments à sa disposition. La classe supérieure ne prétend-elle pas que chaque membre de la classe inférieure peut s'élever "au rang de la classe supérieure" "par son travail"? C'est un mensonge! Le moyen dont on se sert le plus fréquemment pour atteindre ce rang est le vol plus ou moins légal. C'est le marchand qui a le plus de facilité pour "s'élever"..."

Les Gens de Hemsö (Hemsöborna, 1887-1912)
Mme Flod est une veuve aisée: elle engage un certain Carlsson pour gérer sa ferme sur une île de l'archipel de Stockholm. Etranger dans un milieu qu'il ne connaît pas, Carlsson n'inspire pas confiance aux gens du pays. Un affrontement s'ensuit pour le contrôle de la ferme avec Gusten, le fils héritier. Carlson est-il un insaisissable escroc, s'attaquant à une veuve solitaire, ou un homme honnête redonnant vie à une femme négligée?

Les Camarades (Marodörer, 1888)
"Maraudeurs" (1886), qui deviendra par la suite "les Camarades" (1888), marque l'évolution de Strindberg vers le naturalisme psychologique ; l'écrivain forme et développe sa nouvelle conception du théâtre, s'en tenant à l'esthétique et à la force dramatique. Le thème en est naturellement le féminisme ; il s'agit de la lutte entre deux époux, Axel et Bertha ; celle-ci compte faire du mariage une camaraderie et vit de « maraude », de ruse et d'intrigue.

Mademoiselle Julie (Fröken Julie, 1888)
Dans ce drame en un acte, véritable chef-d'œuvre du théâtre européen, qu'il analyse lui-même dans un avant-propos tout en exposant ses intentions dramatiques, on trouve à la fois la tension entre l'homme et la femme et la confrontation de deux classes sociales. Strindberg y est influencé par les idées de Nietzsche et de Darwin, sur la survivance du plus fort. Le drame met donc aux prises les instincts les plus élémentaires, et l'auteur reconnaît avoir donné à ses personnages des caractères impulsifs, portés tant à l`incohérence qu'à la contradiction. Pendant la nuit de la Saint-Jean, la fille du comte, absent, se donne au valet de chambre de son père ; elle est ensuite amenée à se suicider....
"MADEMOISELLE JULIE" est un drame se déroulant entre trois personnages, avec une action qui ne dure que le temps d'un spectacle assez bref. De ces trois personnages, il faut mettre à part la cuisinière Christine, dont le rôle est plus effacé : de sorte que tout le drame se joue entre la jeune comtesse Julie et son valet de chambre Jean. Pendant la nuit de la Saint-Jean, alors que le comte est absent et que le peuple se laisse aller à une joie exubérante, Mademoiselle Julie, qu'exaltent l'heure et les circonstances, invite son domestique à danser avec elle. Elle le provoque et, mi-impérieuse, mi-conquise, se donne à lui. C 'est là-dessus que s'achève la première partie. Dans la seconde, qui est plus longue, Jean révèle sa nature servile : il pense à profiter de l`avantage que Mademoiselle Julie lui a laissé prendre en devenant sa maîtresse, et s'avise qu'il est temps pour lui de réaliser un rêve longuement caressé : celui de devenir propriétaire d`un grand hôtel. Pour arriver à ses fins, il engage Julie à voler son père et à fuir. Julie se prend de haine pour cet être vil à qui elle se sent maintenant liée. Et, balançant entre la honte et le mépris, elle ne sait plus à quoi se résoudre. Les deux amants décident pourtant de fuir.
Mais Julie tient à emporter un oiseau favori que le domestique tue par bravade. Hors d'elle, la jeune fille se dresse en face de son amant, le menace, le défie, l'incite à la tuer. Dès lors, la tragédie va se précipiter. Le comte vient de rentrer. Jean doit reprendre son rôle de valet de chambre; Julie, qui n'a plus désormais aucune volonté, obéissant à une suggestion de Jean, prend le rasoir qu'il tient dans ses mains et sort, en laissant entendre qu'elle vient de trouver le dénouement qui convenait.

Au bord de la vaste mer (I Havsbandet, 1890)
Le roman retrace l'inquiétante dégradation d'un intellectuel, solitaire et orgueilleux, Axel Borg, inspecteur de pêche côtière, face à une populace médiocre, pêcheurs simples et terre à terre. Il séduit en parallèle une jeune femme, Maria, qui va dévoiler les sombres recoins de son esprit. Son ego se morcelle et plonge dans le désarroi lorsqu'il doit affronter les pressions des gens du pays et des environs.
Les critiques ont décelé dans ce roman des traces de l'esprit positiviste qui régnait à l'époque et de la doctrine nietzschéenne du surhomme. L'intendant Borg était, selon la propre expression de Strindberg, un prototype de cette humanité nouvelle qui se trouvait nécessairement en conflit avec l'humanité normale en dissolution. Le contrôle rationnel des passions, une sensibilité extrême et des manières raffinées distinguaient cet homme d'exception de la masse obtuse, insensible, soumise aux instincts. La ressemblance avec les héros des romans de D'Annunzio est évidente, mais, à l'encontre de ces esthètes
sensuels, le héros de Strindberg est un dilettante en expériences intellectuelles. Si malheureusement Borg semble être parfois, en dépit de la volonté de l'auteur, une caricature de l'intellectuel, Strindberg a en revanche puissamment rendu la tourbe humaine en conflit avec le personnage central : la femme sensuelle, vulgaire et cupide, dont Borg subit l'attrait, la mère de celle-ci, uniquement préoccupée de marier sa fille, le jeune assistant, qui voile son inexpérience sous une sentimentalité érotique, et tout autour de cette humanité dite inférieure, le monde extérieur, les éléments, la vie de la flore aquatique, les poissons et des oiseaux de la Baltique, décrite avec minutie ...
"AU BORD DE LA VASTE MER" retrace la vie d'un être intelligent et raffiné, que détruit le contact d'une humanité primitive et brutale. Descendant d'une famille anoblie, le jeune Borg a su très tôt dominer ses instincts et diriger rationnellement sa vie. Sensible à l'extrême, ne supportant ni grossièreté ni médiocrité, il est conduit par réaction à rechercher toujours le plus profond raffinement. Mais entouré d'une humanité "normale", abandonnée à ses instincts de veulerie et d'égoïsme, il se voit contraint d'affronter de pénibles épreuves, dont il sort finalement vaincu. Le poste d`assistant qu'il occupe à l'Académie des sciences lui attire la jalousie de ses confrères. Doué d'un esprit critique et inventif, la valeur de ses découvertes est universellement reconnue. Mais, voyant se multiplier les obstacles autour de lui, il quitte l'Académie et accepte un poste d'intendant dans une pêcherie de l'archipel de Stockholm.
Dénuée d'intelligence, superstitieuse, primitive et cruelle, la population de l'endroit lui fait un mauvais accueil. C'est alors qu'il se lie avec Marie, femme encore jeune et belle, mais cependant vulgaire, dont il fait sa fiancée en pensant la rapprocher de lui. Mais la jeune femme fait cause commune avec les autochtones, se détourne de lui et amorce des relations des plus tendres avec le jeune assistant de Borg. Celui-ci perd peu à peu toute raison de vivre, alors qu'une femme et un enfant auraient pu le rattacher à l'existence. Toujours plus solitaire, délaissant tout travail sérieux, il se perd en vaines songeries. Il en vient même à abandonner son poste d'intendant.
Le soir de Noël, exténué moralement et physiquement, en butte à la malveillance croissante de la population, il parvient à rassembler ses dernières forces et monte dans une barque. Il met enfin le cap sur une étoile de la constellation d'Hercule, pour une croisière sans retour sur la mer, "source et tombeau de toute vie" ...

Inferno (1897)
Également écrit et publié en français, c'est le récit que l'écrivain donne lui-même de ses douloureuses expériences psychiques qui l'ont mené au bord de la folie. Délire de la persécution, sentiment de culpabilité, heurts entre le rêve et la réalité, tout un bouillonnement de pensées l'ont agité dans cette période de crises, traversée de contradictions, d'angoisses et de souffrances. "«Tout ce que je touche me fait mal, et, enragé des supplices que je veux attribuer à des puissances inconnues qui me persécutent et entravent mes efforts depuis tant d'années, j'évite les hommes, néglige les réunions, décommande les invitations, et éloigne les amis. Il se fait autour de moi du silence et de la solitude : c'est le calme du désert, solennel, horrible, où par bravade je provoque l'inconnu, luttant corps à corps, âme à âme. J'ai prouvé la présence du carbone dans le soufre ; je vais y déceler l'hydrogène et l'oxygène, car il faut qu'ils y soient. Mes appareils ne suffisent plus, l'argent me manque, mes mains sont noires et sanglantes, noires comme la misère, sanglantes comme mon cœur. [...] Je me sens sublime, flottant sur la surface de quelque mer : j'ai levé l'ancre et je n'ai nulle voilure."
"INFERNO", récit autobiographique, écrit en français et publié en 1897, au cours duquel Strindberg nous décrit la terrible crise morale et spirituelle qu'il traversa au cours des années 1895-1897, au sortir de son second mariage. Son récit débute le jour où sa femme quitte Paris, où ils habitaient, et le laisse seul à ses recherches occultistes et chimiques. Strindberg prétendait démontrer, entre autres, que le soufre était un corps composé et espérait découvrir la méthode pour fabriquer de l'or. Il verse alors dans une véritable folie de la persécution, et se croit l'objet des complots de ses voisins, poursuivi par les attentats d'un ancien ami et rival, le Russe Popoffsky. Cependant des présages merveilleux l'encouragent et le guident. Les "puissances" finissent par le chasser de son hôtel. Il s'établit à la pension Orfila, mais y est encore en butte aux persécutions les plus mesquines. Enfin il est persuadé que, des chambres voisines, on essaie, avec des appareils électriques, de le tuer. Il change de nouveau de logement et s'installe près du Jardin des Plantes, mais ses mystérieux ennemis ont tôt fait de repérer son nouveau refuge. De nouveau obligé à fuir, il se rend à Dieppe où il ne reste que peu de temps, et repart enfin en Suède où il s'installe, à bout de forces, chez un ami médecin.
Bientôt Strindberg soupçonne son ami d'être jaloux de ses succès scientifiques, les "puissances" reviennent à la charge. Le voici fuyant en Autriche, près de la famille de sa -femme, qui a pris soin de sa petite fille. Dans les Alpes autrichiennes, il passe quelques jours heureux, et c'est avec une force nouvelle qu'il accueille les "puissances", qui viennent l'inquiéter à nouveau, et contre lesquelles il entre en lutte. Au cours de son séjour à Paris, le "hasard" lui avait mis entre les mains "Séraphita" de Balzac, qui lui révéla Swedenborg. Chez sa belle-mère il trouve de nouveaux éléments alimentant une conversion mystique, qui s'approche à un certain moment du catholicisme. Mais c'est surtout chez Swedenborg qu'il trouve du réconfort, et il reconnaît dans ses ouvrages la description exacte de ce qui lui est arrivé et l'explication de son drame. L`enfer est sur cette terre et l'être humain n'en est délivré que par la douleur que lui infligent sa propre méchanceté et celle des autres. Strindberg s'acheminer vers une foi, une religion toute personnelle, austère et dure, mais qui est tout de même une délivrance....

La Danse de mort (Dödsdansen, 1901)
Ce drame rejoint le théâtre naturaliste des années 1880 et reprend le thème du vampirisme, mais avec un élément de mystère et de surnaturel. C'est la lutte éternelle du couple : le capitaine et Alice, après vingt-cinq ans de mariage, se trouvent attachés l'un à l'autre par la haine qui naît de l'amour, ils n'existent que pour s'entre-déchirer et seule la mort pourra défaire ces liens. Acharnés sur leurs propres fantômes, c'est à leur déchéance réciproque qu'ils travaillent, au perfectionnement de leur haine, jusqu'au point où leur aventure malheureuse devient le symbole même du couple, tel que le concevait Strindberg dans sa métaphysique de la nature humaine : "Je crois que nous appartenons à une race maudite!" s'écrie Alice. "Depuis la chute du premier homme", lui répond sa victime, elle-même bourreau ..
"LA DANSE DE MORT", bien qu'écrite en 1900, c'est-à-dire après la crise d'Inferno et après des pièces telles que "Le Chemin de Damas", rejoint les pièces naturalistes des années 1887-1888 et plus particulièrement "Père". C'est en effet l'éternelle histoire du couple que Strindberg reprend une nouvelle fois, le couple tel qu'il l'avaít vécu, uni par la haine autant que par l'amour. La cruauté des deux personnages principaux, Alice et Edgar, ce dernier appelé "le capitaine", est moins mauvaise, plus profonde et plus douloureuse que la perfidie unilatérale de Laura dans "Père". Enchaînés l'un à l'autre, ils ne peuvent que se faire souffrir, rejetant l'un sur l'autre la faute de leurs insuccès. Ils sont deux "ratés" : le capitaine parce qu'il a manqué sa carrière et qu'il se voit enterré sur cette île où aucun avancement ne lui est accordé, Alice parce que son mariage a rompu une carrière d'actrice qu'elle espérait brillante et qu'elle imagine d'autant plus prestigieuse qu'elle s'en voit privée. Leur ménage est pourtant arrivé jusqu'aux noces d'argent et, quand le rideau se lève, ils sont las du combat et se contentent de se lancer les vieilles perfidies habituelles; la haine est devenue quotidienne, familière, les reproches et les insinuations ont je ne sais quoi de rituel ou de mécanique. Mais, vis-à-vis des étrangers, ils sont unis dans leur envie et leur fierté qui ont éloigné tous ceux qui les ont approchés et qui chassent de leur maison tous les domestiques.
L'arrivée de Kurt, cousin d'Alice, va réveiller cette vieille haine, secouer leurs habitudes et les mener au bord de la catastrophe. L'un et l'autre chercheront en lui un allié. Kurt est d'abord disposé à avoir quelque pitié d'Alice, car les façons protectrices du capitaine le rebutent. La situation se retourne cependant lorsque le capitaine, pour démontrer sa vigueur et sa bonne humeur, s'obstine à vouloir danser la "danse du sabre" et tombe évanoui. Cette soudaine défaillance physique fait du vantard une pauvre loque humaine qui a peur de la mort. La joie cynique d'Alice repousse Kurt dans le camp du capitaine, lequel commence lentement à s'emparer de lui, de ses affaires, de ses enfants. Ayant perdu, du fait de sa maladie cardiaque, toute vie propre, il essaie de s'annexer celle de Kurt : il est, comme le pensait Strindberg et comme le dit Alice, le "vampire".
Or le capitaine se remet, part en ville et revient en uniforme de gala, armé contre ses ennemis d'armes redoutables. A Alice, il annonce leur prochain divorce ; à Kurt, l'arrivée de son fils, qui se trouvera sous ses ordres à lui, Edgar. Cette profonde méchanceté provoque les réactions d'Alice qui se décide à dénoncer le capitaine pour détournement de fonds, et de Kurt qui se jette dans les bras d'Alice, dans une sorte de passion sauvage, enivré par cette atmosphère de haine et de cruauté.
Mais ce sursaut d'énergie du capitaine n'est qu'un feu sans lendemain; déjà le voici repris par la maladie et la hantise de la mort. S'il est encore capable d'une explosion de colère quand Alice lui jette à la figure qu'elle le trompe avec Kurt, il s'effondre pourtant aussitôt. Kurt s'enfuit, atterré par le piège où il se voit pris et par la contagion morale dont il se voit atteint. Alice et le capitaine restent seuls, leur vie retourne lentement au « normal ››, aux "souffrances éternelles". Il faut abolir le passé et continuer à vivre, conclut le capitaine.
La deuxième partie de "La Danse de mort", qui n'est presque jamais jouée, fut écrite par Strindberg à la fin de l'année 1900, peut-être pour fournir à sa première pièce un épilogue plus léger. Pourtant le capitaine, qui était déjà un ogre dans la première partie, est ici devenu un monstre qui ne se laisse plus arrêter par rien. Il poursuit Kurt de sa haine, le ruine, le brouille avec tous les habitants de l'île, lui enlève son fils Allan dont il gagne la confiance, tout en destinant d'ailleurs sa propre fille Judith, qui est aimée d'Allan, au vieux colonel du régiment. Il est en train de prendre revanche sur toute la ligne, quand son allié le plus sûr lui fait défaut : Judith refuse d'épouser le colonel et s'enfuit avec Allan. Le capitaine
est terrasse par une dernière attaque. Dans un ultime retour sur elle-même, Alice constate qu'elle a dû aimer cet homme autant qu'elle le haïssait. La partie la plus intéressante est ici l'intrigue amoureuse entre Allan et Judith, où déjà paraît cette lutte douloureuse et sans merci qui, selon Strindberg, doit inévitablement opposer l'homme à la femme.

Le Songe (Ett Drömspel, 1901)
Pour la critique, si "Le Songe", drame symbolique, est difficile à résumer, "on aura rarement, semble-t-il, poussé plus loin la représentation sur scène de notre univers intérieur". La fille d'Indra (souverain hindou du Ciel) a décidé de venir sur terre pour se rendre compte de l'état de la condition humaine. Elle se rend donc dans toutes sortes de milieux, notamment au sein d'un couple marié, assiste à bon nombre de scènes plus ou moins tirées de la vie quotidienne en essayant de comprendre, mais en vain.
Strindberg, qui est parvenu tout près du terme d'une carrière tumultueuse et d'une œuvre passablement disparate (La Chambre rouge, 1879 ; Mademoiselle Julie, 1888 ; La Danse de mort, 1900), après avoir expérimenté toutes les formes dramatiques à la mode, et dans une quête éperdue d'un sens à proposer à ses contemporains, en est venu à ce que l'on a convenu d'appeler un théâtre onirique : à défaut de donner une représentation intelligible de notre condition, il décide d'emprunter la démarche, les péripéties et les caractères propres au rêve, sa pièce ne s'intitule pas 'Le Songe", mais bien "Un jeu de rêve" (Ett drömspel). Pièce étrange donc sur l'idée que le rêve est préférable à la réalité et que le bien le plus précieux est celui qu'on n`obtient pas, et que l'être humain se fait toujours l'artisan de sa propre misère. L'intrigue est singulière : pour consoler l'humanité souffrante, la fille d`Indra, souverain du Ciel, décide un jour de venir sur la Terre. Trop de compassion la pousse à épouser un avocat qu`elle tient pour le plus malheureux des hommes. Mais l'expérience tourne mal et cruellement déçue, la fille d'Indra remonte au Ciel, pour adjurer son souverain d'avoir pitié du cœur de toutes ses créatures. Le drame s'achève par la vision de Jésus marchant sur les eaux. ...

Amalie Skram (1846-1905)
Amalie Skram se forgea une belle réputation dans la littérature norvégienne auprès des Quatre Grands, Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910), Henrik lbsen (1828-1906), Alexander Kielland (1849-1906) et Jonas Lie (1833-1908). Mais elle fut un auteur très controversée à son époque,
féministe à travers des romans explorant des thèmes tels que la sexualité féminine. Mais elle s'imposa et s'avéra être durablement l'un des plus éminents auteurs naturalistes de Norvège. Son chef-d'œuvre est la tétralogie "Les Gens de Hellemyr" (Hellemyrsfolket), publiée entre 1887 et 1898, qui décrit les fortunes d'une famille sur plusieurs générations. Elle écrivit également quatre romans sur l'institution du mariage, "Constance Ring" (Constance Ring, 1885), "Lucie" (Lucie, 1888), "Fru Ines" (Madame Ines, 1891) et "Forraadt" (Trahie, 1892). Ces oeuvres qui traitent du statut de la femme sexuellement soumise dans le mariage furent considérées comme extrêmement provocatrices à leur sortie.
"Les Gens de Hellemyr" (Hellemyrsfolket)
Cycle de quatre romans, intitulés respectivement "Sjur Gabriel", publié en 1887, "Deux amis" (To venner), en 1887, S. G. Myre, en 1890, et "Les Descendants" (Afkom), 1898. C'est l'histoire de trois familles dégénérées, héréditairement malheureuses. La misère, les maladies et l`ivrognerie en sont les thèmes dominants, tandis que la mort, conçue comme une expiation des péchés, revient sans cesse. La description de la ville de Bergen et de la vie à bord d`un navire est cependant faite avec une sérénité qui éclaircit un peu Fune atmosphère par ailleurs oppressante de l'œuvre. Dans "Les Descendants", la meilleure partie de la tétralogie, les personnages principaux sont des jeunes gens et des jeunes filles, encore étudiants. C'est en eux que viennent aboutir les destinées des familles décrites dans les volumes précédents. Le personnage principal est Séverin, le fils d'un petit commerçant, malheureux et malhonnête, et d'une femme sévère et méchante, objet de crainte et de haine pour ses enfants. ll rencontre, en un camarade d`école, un ami bon et sincère, et tombe amoureux de la sœur de celui-ci. Elle est belle et capricieuse, mais sans méchanceté. La sœur de Severin, Sophie, cède aux flatteries d`un lieutenant qui, en réalité, ne recherche qu`une bonne dot. Quand le père, qui a falsifié une traite, se trouve au bord de la ruine, Sophie accepte d`épouser un homme qu`elle n'aime pas; mais son sacrifice est inutile, car son riche mari refuse de donner le moindre secours à son beau-père. Tandis que le père se trouve en prison, Séverin travaille et lutte pour se libérer de la triste fatalité qui pèse sur sa famille. Un moment il pense émigrer en Amérique avec sa sœur cadette, mais ils n`ont pas d'argent pour payer le voyage. Ce désir le pousse à voler son ami en lui dérobant un jour qu`il le trouve endormi, une lettre qui contient la somme nécessaire au voyage. Quand son vol est découvert, Severin se suicide pour échapper à la honte, en se jetant dans la cour de la misérable maison qu`il habite...

Selma Lagerlöf (1858-1940)
En 1909, Selma Lagerlöf devient la première femme couronnée d'un prix Nobel de littérature. Née en 1858 à Marbacka (Suède), Selma Lagerlöf appartient à une vieille famille du Värmland, une de ces provinces excentriques, lointaines, isolées des métropoles culturelles de l’Europe, où la petite noblesse ne constituent qu’une mince couche sociale. . Elle confessera un jour que le cerveau de son enfance « était empli à déborder de fantômes et d'amours sauvages, de dames merveilleusement belles et de cavaliers épris d'aventures ». Le milieu où elle vécut était un peu aristocratique, à l'échelle du pays, et bien protestant. Mais son père, ruiné, devra vendre le domaine familial – et ce sera toute l'ambition, couronnée de succès, de Selma que de parvenir un jour à le racheter, à l'habiter. Institutrice à l'école de filles de Landskrona de 1885 à 1895, Selma voyage en Italie (1895), en Palestine et en Égypte (1899), et se consacre entièrement à la littérature. Pétrie des traditions et des légendes locales de la province montagneuse du Värmland, les "Liens invisibles" (Osynliga länkar, 1894), recueil de légendes et de contes, puis sa "Légende de Gösta berlin" est un retour aux récits traditionnels des vieux manoirs et des aventures romantiques. Pour Selma Lagerlöf, l'essentiel est invisible aux yeux. Son œuvre la plus célèbre, "Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson" lui est commandée pour enseigner la géographie de la Suède aux écoliers : un jeune garçon de quatorze ans, Nils, dur et égoïste, apprend les vertus de l’amour et du respect d’autrui en compagnie d’oies sauvages qui lui font survoler son pays. Son succès est tel que cela lui permettra de racheter en 1910 le domaine familial de Marbacka qui avait été vendu en 1887 et ce s'y installer jusqu'à sa mort.
