- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan

Swinging London - Angry young men - Kitchen Sink realism - Free Cinema - John Osborne (1929-1994) - Alan Sillitoe (1928-2010) - Keith Waterhouse
(1929-2009) - Lindsay Anderson (1923-1994) - Tony Richardson (1928-1991) - Karel Reisz (1926-2002) - John Braine (1922-1986) - Colin Maclnnes (1914-1976) - John Schlesinger (1926-2003) -
John Bratby (1928-1992)…
Last update : 2018/11/11

The Swinging London - La dénomination "Swinging London" apparaît en 1959, une nouvelle ère s'ouvre sur la planète Terre, Londres devient le centre d'un nouveau monde qui va donner sa spécificité "déjantée" aux années 1960. Dès 1955, Mary Quant , associée à la création de la mini-jupe qui libère une nouvelle féminité ("run and jump"), ouvre sa première boutique, le "Bazaar" de King's Road à Chelsea, la British Motor Corporation et Alec Issigonis sortent un modèle de voiture de taille réduite qui fait sensation, la "Mini", Richard Hamilton dresse en 1957 la liste des éléments caractéristiques du pop art, la publication de Lady Chatterley's Lover de DH Lawrence est autorisée en 1960. Mick Jagger, Julie Christie, Michael Caine (the 1960s broke class barriers, écrira-t-il), David Hockney et Vanessa Redgrave (“I can’t sing but I’m young, Can’t do a thing but I’m young"), les Beatles ("Love me do", 1962) et Cream ("Fresh Cream", 1966), Jean Shrimpton, photographiée en 1962 pour Vogue par David Bailey, Twiggy, qui sort de l'anonymat en 1966, sont les figures de proue d'un changement culturel centré sur la jeunesse, la première génération d'adolescents libérés de la conscription, la musique omniprésente, les attitudes plus ludiques, la mode, ses imprimés psychédéliques et ses couleurs vives, la façon d'être, la liberté juvénile contre l'autorité ... "Ancient elegance and new opulence are all tangled up in a dazzling blur of op and pop. The city is alive with birds (girls) and Beatles, buzzing with Mini cars and telly stars, pulsing with half a dozen separate veins of excitement." (Time magazine, April 1966). Symbole de la période dite "free love and women's liberation", la pilule, une combinaison des hormones œstrogène et progestatif, développée aux Etats-Unis dans les années 1950 par le biologiste américain Dr Gregory Pincus., déjà utilisée en 1960 par plus d'un millions d'Américaines, est introduite au Royaume-Uni en 1961 (pour les femmes mariées seulement jusqu'en 1967)....






Des cinéastes étrangers, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Michelangelo Antonioni et Roman Polanski, vont débarquer dans la capitale britannique, de "A Hard Day's Night" (1964, Richard Lester met en scène avec un style déjanté l'hystérie collective que les Beatles déclenchent partout) à "Blow-Up" (1966, le film emblématique, la musique des Yardbirds et Jimmy Page, la partition de Herbie Hancock, Vanessa Redgrave et le top model Veruschka, Jane Birkin, Sarah Miles, la mode, les soirées, les photographes, le "casual sexism"). Mais sous le "dazzling blur of op and pop", battent des pulsions de paranoïa, de folie et de violence, une profonde misogynie. "Répulsion", de Roman Polanski (1965)....

"Turn off your mind; relax and float downstream; it is not dying. Lay down all thought; surrender to the voice: it is shining. That you may see the meaning of within: it is being." - "Revolver" est en 1966 l'album qui engage les Beatles vers une toute nouvelle orientation, psychédélique, et révèle la diversité de leurs talents et de leurs expériences les plus illicites, un album de 35 minutes, eclipsé un temps par Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui a requis 300 heures de studio, les studios EMI qui deviennent un véritable laboratoire d'expérimentation musicale. La mélodie y est toujours présente, on y écoute 14 titres, "Taxman", "Eleanor Rigby" (George Martin y introduit le fameux double quatuor à cordes qui accompagne la voix de Paul McCartney), "I'm Only Sleeping" (Lennon et le premier solo de guitare inversé de l'histoire du rock), "Love You To" (un des trois morceaux de George Harrison), "Here There And Everywhere" , "Yellow Submarine", "She Said She Said" (Lennon), "Good Day Sunshine" (à l'optimisme communicatif), "And Your Bird Can Sing", "For No One", "Doctor Robert" (grand fournisseur de "pilules magiques"), "I Want To Tell You", "Got To Get You Into My Life" (McCartney), "Tomorrow Never Knows"(John Lennon s’inspire ici de Timothy Leary, chantre du LSD)...






"Suddenly people realised the working class wasn’t as thick as it looked and it had talent.." - Michael Caine, né Maurice Micklewhite en 1933 à Rotherhite, au sud de Londres, et dont l'accent cockney trahit son origine prolétaire, décide d'être acteur tout simplement, expliquera-t-il, je pensais que ce serait beaucoup mieux que de travailler dans une usine, ce que je faisais à l'époque: les scénaristes commençaient alors à écrire pour les gens de la classe ouvrière et cela a fait toute la différence. "Si tu avais un accent de cockney, tu jouerais le majordome. Mais John Osborne a écrit Look Back in Anger en 1956 et c'était, je crois, la première grande pièce de théâtre qui avait un héros ouvrier.." Et Michael Caine va endosser a contrario de son origine des personnages d'aristocrate guindé mais canaille, jouant un "snobbish, aristocratic officer" dans "Zulu" (1964, Cy Endfield ), un anti-James Bond, "bespectacled gourmet", l'agent Harry Palmer , dans "The Ipcress File" (Sidney J.Furie, 1965), et surtout le célibataire jouisseur d'Alfie le dragueur, "a tireless womaniser running out of steam" dans "Alfie" (1966, Lewis Gilbert)...




"Performance" (tourné en 1968, rendu visible en 1970)
Cast: James Fox (Chas), Mick Jagger (Turner), Anita Pallenberg (Pherber), Michèle Breton (Lucy), Johnny Shannon (Harry Flowers), Anthony Valentine (Joey
Maddocks)
Film devenu culte, plus que par le contexte de son tournage que par son contenu, un film dans lequel tout est expérimental et provoquant, de la réalisation
au décor (une pègre londonienne filmée sous des angles étranges, l'univers déjanté et psychadélique des pop-stars), bande sonore (Jack Nitzsche), casting, réalisé par Donald Cammell
(peintre et auteur du scénario, White of the Eye, Demon Seed) et Nicolas Roeg (chef opérateur, Don’t Look Now, The Man who Fell to Earth). L'histoire est celle de Chas (James Fox), un
gangster londonien, violent et ambitieux, que veut éliminer son chef de gang, Harry Flowers (Johnny Shannon), et qui se réfugie à Notting Hill dans la maison du légendaire Turner (Mick Jagger, le
leader des Rolling Stones, dans son premier film, apparaît au bout d'une vingtaine de minutes), rock star excentrique et sur le déclin qui se partage entre deux femmes, Pherber (Anita Pallenberg,
le "sixième Stones" si proche de Keith Richards et de l'héroïne) et Lucy (Michèle Breton). Les deux "artistes" vont partager leurs "compétences" respectives (violence/psychédélisme) et ce qui
peut les rapprocher, le sexe, Chas, le truand sadique et brutal, face à la jeunesse dite libérée et sans tabous de Mick Jagger et de ses deux compagnes, jusqu'à la perte d'identité dans un
véritable "psycho-sexual seething cauldron". Le tout se terminant dans un bain de sang...

"Angry young men" - "I suppose people of our generation aren't able to die for good causes any longer. We had all that done for us, in the thirties
and the forties, when we were still kids. ...There aren't any good, brave causes left. " - En 1956, en cette période d'après guerre, une part de la jeunesse anglaise, une jeunesse issue de
milieux modestes qui, grâce au système éducatif, est parvenue à atteindre une certaine position sociale, mais une position qui reste inconfortable, à la frontière d'une classe moyenne qui ne peut
que constater que les détenteurs de privilèges traditionnels occupent toujours les meilleurs emplois et menace toute ascension. Une jeunesse qui développe une certaine amertume face à des
gouvernants, qu'ils soient travaillistes ou conservateurs, qui ne font que maintenir le statu quo d'une société qui n'évolue pas. La division entre privilégiés et opprimés reste la règle, d'où,
via l'écriture, littéraire ou cinématographique, cette propension à vouloir détruire tout ce qui vous entoure pour éviter de se détruire de soi-même.
Certes la réaction est épidermique plus que véritablement étayée, le mal-être qui s'incarne est un malaise plus personnel qu'une remise en question sociale
plus large, reste un certain cynisme, des textes souvent désabusés qui parlent et nous entraînent dans une prise de distance qui n'est pas sans valeur. "You're hurt because everything is changed"
(Tu as mal parce que tout a changé), dit Alison à son père, dans "Look back in anger" de John Osborne, et Jimmy Porter, le mari d'Alison, "is hurt because everything is the same" (il a
mal parce que tout est pareil), "And neither of you can face it. Something's gone wrong somewhere, hasn'it?" (Et ni l'un ni l'autre vous n'arrivez à l'accepter. Il y a quelque chose qui ne tourne
plus rond, non?" (Acte II, scène 2).
En littérature, les auteurs référence qui s'imposent progressivement sont John Osborne (1929-1994, Look Back in Anger, 1956), Alan Sillitoe
(1928-2010, Saturday Night and Sunday Morning , 1958), Arnold Wesker (1932-2016, Chicken Soup with Barley, 1958), Shelagh Delaney (1938-2011), Stan Barstow (1928-2011, A Kind of
Loving, 1960), Bryan Forbes (1926-2013, The L-Shaped Room, 1962), John Braine (1922-1986, Room at the top), William Cooper (1910-2002, Scenes from Provincial Life, 1950), jusqu'à Kingsley Amis
(1922-1995) dont "Lucky Jim" (1954) constitue une extraordinaire satire de la société britannique : Jim Dixon, chargé de cours sur l' histoire médiévale, dans une petite université provinciale en
Angleterre, s'ennuie désespérément dans un univers clos et conventionnel dans lequel il tente malgré tout de survivre.
Au même moment Samuel Beckett produisait à l'Arts Theatre du West End londonien, le 3 août 1955, sa pièce "En attendant Godot". Harold Pinter, dès 1960,
avec "The Caretaker" (Le Gardien) puis 'A Night Out" (Une Soirée en ville) traduit parallèlement, avec des scénarios autant fait pour le théâtre que pour le cinéma, les bouleversements qui
s'emparent durant cette décennie des mass médias...

John Osborne (1929-1994)
Natif de Londres, de famille modeste (un artiste commercial, une barmaid), ayant vécu une adolescence et une existence agitées, souvent agressif dans sa vie
comme dans ses propos, John Osborne s'essaie au journalisme, devient acteur dans une troupe ambulante de théâtre puis se tourne vers l'écriture, sa première pièce, "The Devil Inside Him",
est écrite en 1950 avec son amie et mentor Stella Linden. En 1956 , "Look back Anger", pièce écrite en deux semaines, lui donne une certaine notoriété, le voici devenu le plus représentatif des
"angry young men", mettant en scène pour la première fois une génération de jeunes Britanniques qui n'a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Dans toutes ses pièces (Inadmissible Evidence,
Time present, West of Suez, Watch it come down), d'inspiration autobiographique, une vie assez mouvementée, pointent un cynisme rebelle, une volonté de faire table rase du passé, du moins de
tenter de le faire à une époque qui voit triompher la médiocrité et le conformisme, les échecs de l'individu... Suivront "Le Bonimenteur" (The Entertainer, 1957), le déclin du music-hall est ici
conté, via le personnage d'Archie Rice (joué par Laurence Olivier), comme la métaphore du déclin de la vitalité d'une nation, "Epitaph for George Dillon" (avec Anthony Creighton, 1958),
"The World of Paul Slickey" (1959), un journaliste dont la chronique portant sur les modes de vie des gens célèbres dévore sa propre existence, "Inadmissible Evidence" (1964), où le personnage de
William Maitland a coupé le cordon ombilical qui le relie à son créateur et tente d'exister par lui-même, considérée comme l'une de ses meilleures pièces...

"Look Back in Anger" (1956, La Paix du dimanche)
"You're hurt because everything is changed. Jimmy is hurt because everything is the same. And neither of you can face it. Something's gone wrong somewhere,
hasn't it?" - Pièce en trois actes, centrée sur le conventionnel et le vide de l'existence (vécue avec Pamela Lane dans un logement exigu à Derby), chacun des actes se déroulant un dimanche, jour
singulier où tout Anglais n'a pour seule activité que de rester assis dans son salon à lire les quelques kilos de journaux du week-end et à boire le thé. Jimmy Porter et sa femme Alison, Cliff
leur ami, appartiennent à cette petite bourgeoisie qui se sent exclue d'une société que domine cette bourgeoisie aisée qu'incarne le père d'Alison, colonel de l'armée des Indes en retraites : des
études effectuées dans des universités dénuées de tout prestige, un sentiment de déclassement et de position sociale qui ne s'exprime que le biais d'un comportement le plus souvent provocateur et
cynique : "if you've no world of your own, it's rather pleasant to regret the passing of someone else's..." (Act I).
La pièce fut créée au Royal Court Theatre le 8 mai 1956, par Tony Richardson avec Kenneth Haigh, Mary Ure et Alan Bates, sa version cinématographique en mai
1959 avec Richard Burton et Mary Ure dans les rôles principaux lui valut la consécration.....
Jimmy to Cliff, Act III, sc.I) - "There aren't any good, brave causes left. If the big bang does come, and we all get killed off, it won't be in aid of the old-fashioned, grand design. It'll just be for the Brave New-nothing-very-much-thank you" (Il n'y plus de belles et nobles causes. Si le big bang arrive, et nous tue tous, ce ne sera pas pour la défense d'un noble idéal à la vieille manière. Ce sera juste pour le Meilleur-des-pas-grand-chose-merci-bien).

Alan Sillitoe (1928-2010)
Dès le début de sa carrière littéraire, Alan Sillitoe, grand poète (Collected poems, 1993) et sans doute le plus engagé des "Angry Young Men", a trouvé en
Nottingham, ville dans laquelle sa famille vivait d'aides sociales et qu'il connaissait intimement, - un père chomeur, une mère sans profession, cinq enfants sans la moinde véritable perspective,
- , un catalyseur puissant, - les livres de la bibliothèque municipale aidant -, pour son imagination. A quatorze ans, il entre à l'usine Raleign, suit des cours de contrôleur aérien et sert en
Malaisie à la fin de la guerre. Démobilisé pour tuberculose, se liant à une jeune poétesse américaine Ruth Fainlight, il s'installe en 1953 à Majorque, une expatriation qui donne corps à son
personnage d'ouvrier de Nottingham, anarchiste et cynique, protagoniste de son premier roman, "Saturday Night and Sunday Morning", oeuvre qui lance sa carrière littéraire. "The Loneliness of the
Long-Distance Runner" (1959) est une longue nouvelle bien connue dans laquelle Colin Smith, pensionnaire d'une maison de redressement, trouve dans la course à pied le semblant de dignité qu'on
lui conteste. "Key to the Door" (Une clé pour la porte, 1961), considéré comme son meilleur roman, illustre avec son personnage, Brian Seaton, toutes les idées politiques et sociales que peuvent
se poser sa génération. "The Lost Flying Boat" (Les Aventuriers de l'Aldebaran, 1983) évoque le métier qu'il exerçait dans sa jeunesse, il fut opérateur de radio, et s'interroge sur la relation
du romancier avec le monde extérieur. Tout au long de son oeuvre, qui se poursuit avec le sombre Snowstop (1993), sa trilogie que composent The Death of William Posters (1965), A Tree on Fire
(1967), The Flame of Life (1974), et ses Nouvelles (The Ragman's Daughter, 1963, Collected Stories, 1995), Sillitoe sait parfaitement retranscrire les révoltes et combats intérieurs dans lesquels
s'engagent ses personnages pour maintenir tant leur liberté que leur dignité, ou plus encore tenter de s'évader vers de nouveaux horizons ...

"Saturday Night and Sunday Morning" (Samedi soir, dimanche matin, 1958)
"I’m a bloody billy-goat trying to screw the world, and no wonder I am, because it’s trying to do the same to me" - Sillitoe trace ici le portrait d'un
jeune ouvrier de 21 ans, Arthur Seaton, personnage frustre, primaire, libre de toute attache, ouvrier depuis l'âge de quinze ans et vivant encore chez ses parents par manque de moyens suffisants.
La semaine, le personnage est sous l'emprise abrutissante des travaux répétitifs de l'usine, des chaînes de montage à l'entretien des machines, le samedi le retrouve ivre mort, dégringolant les
escaliers du White Horse club après avoir ingurgité sept gins et onze pintes de bière, - "be drunk and be happy" -, et tombant dans les bras de Brenda, sa maîtresse et la femme d'un de ses
compagnons de travail. Arthur Seaton, au travers de ses prouesses sexuelles et de ses violences répétées, tente en vain d'échapper à sa vie routinière, à cette vie sans issue dont il ne parvient
pas à formuler la moindre conscience. Hostile par instinct au monde qui l'entoure, on retrouve ici une thématique propre à la littérature britannique, celle d'une classe ouvrière qui, en
Angleterre, va disparaître progressivement en étouffant sa fureur, mais aussi les éléments d'une prise conscience qui se fait politique...
"Juillet vint, puis août. Un ciel d'été tout bleu vers lequel montait en volutes noirâtres la fumée des cheminées d'usines s`étendit sur la ville
au-dessus des alignements de maisons des faubourgs de l'ouest, aux arrière-cours brûlées par le soleil, un soleil qui faisait
fondre le goudron dont les relents d'antiseptique se mariaient à ceux des poubelles que l'on tardait d'enlever, desséchait plus
encore la peinture craquelée des portes de devant, laissant se rouiller heurtoirs et boîtes aux lettres, et faisait flétrir les fleurs sur les
appuis des fenêtres.
Arthur, ruisselant de sueur devant son tour, travaillait à la même cadence accélérée qu'en hiver pour maintenir le graphique de ses gains au même
niveau. La vie se poursuivait avec de vagues réminiscences du chômage et des jours d'école d'autrefois, et une conscience plus floue encore de la mort à venir, une vie toute dans le temps
présent, ponctuée par des rencontres avec Brenda, certaines belles soirées où les rues étaient chaudes et bruyantes et où les nuages déménageaient à la cloche de bois au-dessus des toits. Ils
faisaient l'amour dans le petit salon ou dans sa chambre, en sentant l'océan des faubourgs s'endormir hors de leur minuscule esquif d'espoir et de bonheur clandestins. Une nuit, couché dans son
lit chez ses parents, les couvertures envoyées sur le plancher avant qu'il se soit endormi, Arthur entendit le couvercle d'une poubelle tomber bruyamment sur le pavé de l'arrière-cour, sans doute
bousculée par un chat en quête d'un repas nocturne. Il se rappela ce moment, quand il n'avait que six ans et que Fred l'emmenait par la main à la cantine populaire, où les titres des journaux
avaient fait entrer en lui le mot de guerre à force de le présenter à ses yeux innocents. Les heures les meilleures maintenant c'étaient celles où il faisait l'amour avec Brenda, où il aurait
voulu à jamais rester dans son lit, la tenant dans ses bras, allongé dans un exquis bien-être jusqu'au matin. Mais il ne pouvait dépasser minuit, autrement il eût risqué d`être surpris par Jack
rentrant frigorifié et grincheux de son travail de nuit.
Ça devait être agréable de vivre tout le temps avec une femme, pensait-il, et de coucher avec elle dans un lit qui vous appartenait à tous les deux,
dont personne ne pouvait vous évincer si l'on vous y découvrait.
L'avenir, cela voulait dire un tas de choses en puissance, des bonnes et des moins bonnes, telles que la venue de l'été (bonne), la période militaire en
fin d`août (une purge), la Foire de l'Oie en octobre (fameux !), la nuit des feux de joie (bonne, si vous ne vous y faisiez pas sauter), et enfin Noël... à Noël. Puis c'était la nouvelle année
qui vous entraînait, les yeux bandés, par la peau du cou, sur la crête vertigineuse d'une autre vague. Pour quelqu'un habitant la ville et travaillant en usine, il n'y avait que le calendrier
pour vous donner une idée du temps qui s`écoulait, car il était malaisé de suivre le changement des saisons. Alors que le printemps se fondait dans l`été et que l`automne se transformait en
hiver, Arthur n`avait un aperçu du passage des mois que lors des week-ends, le samedi ou le dimanche; quand il enfourchait sa bécane pour aller faire un tour dans la campagne, pour aller pêcher
au long du canal. Les longues soirées d'été, il s`asseyait sur le seuil de devant avec un canif et un morceau de bois, se taillant une imitation de poisson en guise de flotteur, une cigarette se
consumant inutilement sur la marche, à côté de lui, tandis qu'il inclinait l`ébauche du poisson à la lumière pour vérifier les proportions de la tête. du corps et de la
queue.
Plus tard, il le décorerait de dessins savants, gris et rouges, avec des yeux orange et un ventre bleuté œuf de cane, un poisson nouveau genre avec
lequel il espérait attirer vers son hameçon ses congénères véritables; ou encore, il s'installait sur la berge du canal en dessous de Hemlock Stone ou des collines de Bramcote, et jetait sa ligne
sur l'étroite bande d'eau placide, à demi recouverte par les feuilles des sureaux de la rive d'en face, les nuages blancs courant au-dessus des branches vertes. C'était un endroit calme et
reposant où passait peu de monde, dominé par une berge abrupte couverte de buissons, contre laquelle, en bordure du chemin de halage, il couchait sa bicyclette. On y oubliait la ville. Celle-ci
n'était pourtant qu`à quatre milles par-delà les collines, mais bien loin si l'on en évaluait la distance au silence et à la paix de cet endroit où il était assis, une cigarette entre les doigts,
surveillant son bouchon, tout près de la rive opposée où clapotaient des vaguelettes concentriques tandis que des moustiques d'eau patinaient avec grâce, tels de menus bateaux à rames, entre les
nénuphars aux larges feuilles. Dans la musette kaki de son temps de service militaire, il y avait des sandwiches, une Thermos de thé et une bouteille d'ale pour la fin de l'après-midi, qui lui
permettraient de tenir jusqu'à ce que l'ombre profonde s'obscurcît et se fit fraîche. Il attacherait alors ses cannes à pêche au cadre de sa bicyclette, et rentrerait à toutes pédales pour
ne pas se trouver pris par l'heure, qui avançait chaque jour, et l'obligerait d'allumer sa lanterne. Ainsi se passaient nombre de ses dimanches d'été, époque de l'année précieuse et multicolore
assombrie seulement par les après-midi ensommeillés à l'usine où il luttait pour maintenir son tour à une allure rapide, en bandant ses muscles contre le relâchement dont ils avaient tant le
désir. A part un rapide aperçu du ciel à midi et le soir, c'était là une vie de prison avec tout de même, une compensation : son travail lui ôtait tout souci quant à son prochain repas, sa
pinte de bière, ses cigarettes et son complet nouveau..." (traduction éditions du Seuil)

"The Loneliness of the Long-Distance Runner" (1959, La Solitude du coureur de fond)
Long monologue extraordinairement évocateur d'un jeune homme, Colin Smith, placé dans un centre d'éducation surveillée après un vol, qui ne trouve sa
liberté intérieure que dans sa course de fond quotidienne, un sentiment de liberté totale qu'il va ressentir au plus profond de son être lorsqu'il va perdre délibérément une prestigieuse
course de cross-country, en dépit de la pression des autorités : réussir serait trahir les siens…
"AS soon as I got to Borstal they made me a long-distance cross-country runner. I suppose they thought I was just the build for it because I was long and skinny for my age (and still am) and in any case I didn't mind it much, to tell you the truth, because running had always been
made much of in our family, especially running away from the police. I've always been a good runner, quick and with a big stride as
well, the only trouble being that no matter how fast I run, and I did a very fair lick even though I do say so myself, it
didn't stop me getting caught by the cops after that bakery job.
You might think it a bit rare, having long-distance crosscountry runners in Borstal, thinking that the first thing a long-distance cross-country runner would do when they set him loose at
them fields and woods would be to run as far away from the place as he could get on a bellyful of Borstal slumgullion— but you're
wrong, and I'll tell you why. The first thing is that them bastards over us aren't as daft as they most of the time look, and
for another thing I'm not so daft as I would look if I tried to make a break for it on my
longdistance running, because to abscond and then get caught is nothing but a mug's game, and I'm
not falling for it. Cunning is what counts in this life, and even that you've got to use in the
slyest way you can; I'm telling you straight: they're cunning, and I'm cunning. If only 'them'
and 'us' had the same ideas we'd get on like a house on fire, but they don't see eye to eye with us and we don't see eye to eye with them, so that's how it stands and how it will always stand.
The one fact is that all of us are cunning, and because of this there's no love lost between us. So the thing is that they know I
won't try to get away from them: they sit there like spiders in that crumbly manor house, perched like jumped-up jackdaws on the roof, watching out over the drives and fields like German generals from the tops of tanks.
And even when I jog-trot on behind a wood and they can't see me anymore they know my sweeping-brush head will bob along that hedge-top in an hour's time and that I'll report to the
bloke on the gate. Because when on a raw and frosty morning I get up at five o'clock and stand shivering my belly off on the stone
floor and all the rest still have another hour to snooze before the bells go, I slink downstairs through all the corridors to the
big outside door with a permit running-card in my fist, I feel like the first and last man on the world,
both at once, if you can believe what I'm trying to say. I feel like the first man because I've hardly got a stitch on and am sent against the frozen fields in a shimmy and shorts—even the first
poor bastard dropped on to the earth in midwinter knew how to make a suit of leaves, or how to skin a pterodactyl for a topcoat.
But there I am, frozen stiff, with Nothing to get me warm except a couple of hours' long-distance running before breakfast, not
even a slice of bread-and-sheepdip. They're training me up fine for the big sports day when all the pig-faced snotty-nosed dukes and ladies—who can't add two and two together and would mess
themselves like loonies if they didn't have slavies to beck-and-call— come and make speeches to us about sports being just the
thing to get us leading an honest life and keep our itching finger-ends off them shop locks and safe handles and hairgrips to
open
gas meters. They give us a bit of blue ribbon and a cup for a prize after we've shagged ourselves out running or jumping, like race horses, only we don't get so well looked-after as race
horses, that's the only thing...."






"Free Cinema" - Dès la fin des années cinquante s'épanouit en Angleterre un mouvement lancé par des auteurs de théâtre, romanciers et cinéastes qui
mettent en cause les institutions en exposant les difficultés et les frustrations des classes dites laborieuses. C'est une critique ouverte du gouvernement conservateur de l'époque qui prétend
que "rien n'est jamais allé aussi bien". Lindsay Anderson (1923-1994) lance le manifeste du "Free Cinema", le cinéma libre, et épingle les moeurs sportives avec "This Sporting Life" (1963) comme
le système éducatif avec "If" (1968). Karel Reísz fait ses premiers pas de réalisateur en 1956 avec "Momma Don't Allow", un court métrage cosigné par Tony Richardson, et produit les deux
premières oeuvres de Lindsay Anderson: il décrit la monotonie quotidienne des ouvriers dans "Saturday night and Sunday morning" (1960). Tony Richardson appelle les petites gens à la révolte avec
"The Loneliness of the Long Distance Runner" (1962) et "A Taste of Honey" (1961). Karel Reisz, Tony Richardson et Lindsay Anderson, tous trois réinventent le cinéma britannique, un cinéma plus
réaliste et critique...

Lindsay Anderson (1923-1994)
Karel Heisz et Lindsay Anderson fondent en 1947 le magazine "Sequence" et c'est en 1956, avec Tony Richardson et Lorenza Mazzetti qu'ils créent le "Free
Cinema" britannique. Ils se font l'écho artistique et intellectuel de la Nouvelle Vague française et du néoréalisme italien. À I'origine, il ne s'agit que de courts métrages documentaires,
la plupart tournés entre 1956 et 1959, notamment "Every Day Except Christmas" (1957), de Lindsay Anderson. Un souci pointilleux du réalisme social et psychologique va marquer tous les longs
métrages d'Anderson et de ses camarades Karel Reisz et Tony Richardson Les réalisateurs du Free Cinema manifestent un net penchant pour les récits qui mettent en scène la classe ouvrière et
tournent presque systématiquement leurs films sur site. Les premiers films de John Schlesinger se rattachent au mouvement, tout comme l'œuvre de Ken Loach.
Aussi, naturellement, lorsqu'au milieu des années cinquante, un mouvement de cinéastes britanniques attaque la profession enlisée dans le conformisme, Karel
Heisz, Tony Richardson et Lindsay Anderson s'associent aux "Angry young men", groupe d'auteurs qui parlent de la "vraie vie" et mettent en avant la responsabilité sociale de l'artiste, prône
l'importance du quotidien, et souhaite échapper aux impératifs commerciaux de l'industrie cinématographique. Son activité incessante de polémiste n'épargnant personne et sa filmographie sans
concession expliquent ses démêlés constants avec les producteurs…

"This Sporting Life" (1963, Lindsay Anderson)
Cast: Richard Harris (Frank Machin); Rachel Roberts (Mrs Margaret Hammond); Alan Badel (Weaver); William Hartnell (Johnson); Colin Blakely (Maurice
Braithwaite.
Lindsay Anderson tourne son premier long métrage en 1962, "This Sporting Life", sur un scénario de David Storey, avec Richard Harris dans le rôle d'un
mineur qui connaît une gloire éphémère comme joueur de rugby. A sa manière, le film rompt avec la morosité du courant artistique dit "Kitchen Sink", le personnage principal tente ici, à
travers un sport, le rugby, d'obtenir sa part de bonheur, un instant d'éternité, mais l'intention reste pessimiste, cet instant de bonheur ne peut s'inscrire dans la durée. Ce film évoque plus
les thèmes d'un Ingmar Bergman que ceux du réalisme social britannique tant il révèle l'impossibilité d'accès au bonheur et l'incapacité des gens à communiquer entre eux. Dans une mêlée de rugby,
Frank Meychin reçoit un coup de poing qui lui casse six dents. Conduit chez le dentiste, les souvenirs affluent. Simple ouvrier mineur, grossier, vaniteux, mal élevé, il était parvenu à ses fins,
se faire engager par l'équipe locale, s'illustrer comme joueur et séduire la veuve chez laquelle il loge, Mrs Margaret Hammond. Par sa brutalité, une agressivité bien utile sur un terrain de
rugby mais qui détruit ses rapports avec la femme profondément inhibée qu'il aime, il perdra toute chance de vivre enfin dans un certain confort. Mrs Hammond agonisera, frappée d'une hémorragie
cérébrale, et il retournera seul aux mêlées boueuses et aux railleries de la foule....

"If" (1968, Lindsay Anderson)
Avec Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick, Christine Noonan, Rupert Webster.
Violente critique de l'establishment qui prend pour cadre un collège anglais, le film, sur un scénario de David Sherwin et de John Howlett, inspiré
sans l'ombre d'un doute par le fameux "Zéro de conduite" de Jean Vigo (1933), suscite de vives polémiques et remporte la Palme d'or à Cannes. Au centre de l'intrigue, un collégien, Mick Travis,
en révolte ouverte contre la hiérarchie sociale d'une école élitiste. Malcolm McDowell, rendu célèbre en 1971 via "Orange mécanique" (A Clockwork Orange), de Stanley Kubrick, incarnera à la
perfection l'archétype d'une jeunesse en désarroi, mais d'une jeunesse qui, au bout du compte, n'entend pas au fond reconstruire le monde, l'échec est patent, mais jusqu'au bout il s'agira de se
livrer au plaisir total de la subversion, nous sommes proches d'un DH Lawrence…

Tony Richardson (1928-1991)
À ses débuts, Tony Richardson est le cinéaste le plus représentatif du nouveau cinéma britannique, réaliste, présentant des drames vécus par des gens
ordinaires, surnommé le Free Cinema, voir l'équivalent de la Nouvelle Vague française, mais à consonnance plus sociale, plus réaliste (British New Wave). Par la suite, il adaptera à l'écran des
œuvres littéraires. Il fait d'abord partie d'un groupe de dramaturges et cinéastes qui veulent imposer un cinéma réaliste et critique envers la société, avec Karel Reisz et John Osborne, et fonde
en 1958 Woodfall Films, pour laquelle il adapte à l'ecran deux pièces d'Osborne, "Look Back in Anger" (1959) et "The Entertainer" (1960). Puis Richardson mêle les techniques de la Nouvelle Vague
française aux siennes pour "A Taste of Honey" (1961) et "The Loneliness of the Long Distance Runner" (1962), sans doute ses meilleurs films. La consécration internationale lui viendra en 1963
avec "Tom Jones", qui sera considéré comme l'un des films les plus euphoriques et caustiques du cinéma britannique…

"Look Back in Anger" (Corps sauvages, 1959, Tony Richardson)
Adaptation de "Look Back in Anger", pièce de John Osborne, quelques trois années plus tard, avec Richard Burton (Jimmy Porter), Claire Bloom (Helena
Charles), Mary Ure (Alison Porter), exposant toute la méchanceté, le racisme et le ressentiment d'hommes frustres en colère : Jimmy Porter (Richard Burton) en est l'archétype, en échec
professionnel, il maltraite sa jeune femme enceinte (Mary Ure), et entame une liaison avec la meilleure amie de celle-ci (une Claire Bloom qui retrouve Richard Burton après L'Espion qui venait du
froid (1965) et dont la prestance et la diction bourgeoise vont accroître les complexes de Jimmy). Pourtant, avec le recul, le style reste classique, et c'est bien Richard Burton qui parvient à
lui seul à donner une incroyable tension psychologique dans ce grenier exigu où il vit avec sa femme, une femme de la haute bourgeoisie, perpétuellement soumise et apathique : la terrible vérité
est toute entière dans le fait que Jimmy est obsédé, humilié, par le fait d'appartenir à une classe sociale inférieure à celle de son épouse. La relation de Jimmy et de la vieille dame qu'il aime
comme une mère, Ma Tanner (Edith Evans), redonne au personnage principal un peu d'humanité…




"The Entertainer" (Le Cabotin, 1960, Tony Richardson)
Avec Laurence Olivier, Brenda De Banzie, Roger Livesey, Joan Plowright
Archie Rice, un artiste de music hall de second plan s'entête à vouloir se donner encore en spectacle alors que sa vie part en morceaux. Il s'accroche à une
jeune femme (Shirley Anne Field) dont les parents possèdent la fortune qui lui permettrait de rebondir et financer le type de spectacle qui attire, pour quelques temps encore, les foules du West
Yorkshire industriel, en particulier de Bradford et de Leeds, dans la station balnéaire de Morecambe…

"A Taste of Honey" (1961, Un Goût de miel, Tony Richardson)
Avec Robert Stephens (Peter Smith), Rita Tushingham (Jo), Dora Bryan (Helen), Murray Melvin (Geoffrey Ingham).
A partir d'une pièce de Shelagh Delaney, Tony Richardson filme le parcours de Jo, une jeune femme ouvrière (Rita Tushingham), alors qu'elle tente de se
libérer d'une mère omniprésente et dominatrice : Helen se soucie plus se trouver un nouvel amant que de s'occuper de sa fille. À la recherche d'une compagnie et d'un soutien, Jo connaît une brève
idylle, qui se termine à l'aube, avec un marin noir. Enceinte, abandonnée par sa mère qui s'est mariée, elle fait la rencontre de Geoffrey, un jeune homosexuel compréhensif. À travers
l'expérience qui s'ensuit, le film explore les questions de l'homosexualité, de la race, de la classe sociale, de la famille et de la grossesse chez les adolescentes. Malgré la multitude d'enjeux
sociaux, le film est marqué par la complexité de ses personnages et Jo apparaît comme un modèle de vérité et d'individualité en fonds de paysages industriels remarquablement
filmés...









"The Loneliness of the Long Distance Runner" (1962, La Solitude du coureur de fond)
Avec Michael Redgrave ( le directeur du centre), Tom Courtenay (Colin Smith), Alec McCowen (Brown), Frank Finlay (un employé).
Tom Courtenay s'est fait un nom dans ce film emblématique qui déroule une intrigue d'une grande intensité, l'histoire d'un adolescent, Colin Smith, envoyé
dans une maison de correction après avoir effectué un cambriolage, mais qui va prendre le prétexte d'une course de cross inter-écoles pour exprimer sa révolte. La force dramatique du film tient
dans le message particulièrement sombre du scénario d'Alan Sillitoe qui nous restitue l'état d'esprit d'une Grande-Bretagne sans concession sur les possibilités de sortir de sa condition
sociale…










"Mademoiselle" (1966, Tony Richardson)
Avec Jeanne Moreau (Mademoiselle), Ettore Manni (Manou), Umberto Orsini (Antonio), Keith Skinner (Bruno), Georges Aubert (René), Jean Gras (Roger), Jane
Beretta (Annette).
Le scénario fut imaginé au départ par Jean Genet et conduit par un Tony Richardson qui utilise des compositions photographiques fixes pour suivre la superbe
Jeanne Moreau, maîtresse d'école d'un petit village français de Corrèze, en qui bouillonnent de multiples passions refoulées qu'elle ne peut plus contenir quand surviennent, avec l'été, une
cohorte d'ouvriers italiens emmenée par le fringant Ettore Manni …

Karel Reisz (1926-2002)
Réfugié en Grande-Bretagne en 1938 après l'arrivée dans son pays des nazis, dont seront victimes ses parents, le jeune Karel Reisz devient pilote de chasse
dans la section tchèque de la RAF durant la Seconde Guerre mondiale. De retour à la vie civile, il étudie la chimie à Cambridge avant de devenir critique de cinéma. En 1949, au côté de Lindsay
Anderson et de Tony Richardson, mais d'un tempérament plus serein, plus modeste, il fonde la revue Sequence qui pose les bases du "Free Cinema" ("these films are free in the sense that their
statements are entirely personal"). Devenu en 1952 directeur des programmes de la cinémathèque de Londres, il publie l'année suivante un essai sur le montage qui fait encore référence aujourd'hui
"The technique of film editing". C'est avec son premier long métrage, "Saturday Night And Sunday Morning" (1960) que Reisz a connu un succès considérable. Ceci lui permettra de produire le
premier long métrage de Lindsay Anderson, "This Sporting Life" (1962), au moment où s'essouffle le Free Cinema et que s'impose son homologue français de la Nouvelle Vague...

"Saturday Night and Sunday Morning" (1960, Samedi soir et dimanche matin, Karel Reisz)
Avec Albert Finney (Arthur Seaton), Shirley Anne Field (Doreen Gratton), Rachel Roberts (Brenda), Hylda Baker (Tante Ada), Norman Rossington (Bert), Bryan
Pringle (Jack).
Karel Reisz dénonce avec ce premier long métrage la société de classes à travers la vie d'un ouvrier réfugié dans le sexe et l'alcool. Albert Finney campe
magnifiquement Arthur Scater, tourneur à Nottingham, bon ouvrier et intelligent, antihéros en rébellion, impulsif et imprévisible, qui, tout en jetant, "Don't let the bastards grind you down!",
ne s'investit que dans l'alcool et dans les filles : Brenda (Rachel Roberts), la femme du contremaître de l'équipe de nuit (qui ne tarde pas à se venger), et s'il a mis celle-ci enceinte,
il s'éprend entre-temps de Doreen (Shirley Anne Fíeld), rencontrée dans un pub, une toute autre jeune femme qui fait des projets, se voit dans une petite maison alignée comme les autres, avec une
vraie salle de bains…. le tout dans une superbe photographie de Freddie Francis....










"Night Must Fall" (1963, La Force des ténèbres, Karel Reisz)
Avec Albert Finney (Danny), Mona Washbourne (Mme Bramson), Susan Hampshire (Olivia), Sheila Hancock (Dora), Michael Medwin (Derek).
Reprise du thriller de Robert Montgomery de 1937, qui voit un jeune assassin, Danny (Albert Finney), parvenir à s'introduire dans une famille bourgeoise des
environs de Londres. Fiancé à la servante, il ne tarde pas à devenir l'amant de la fille, Olivia (Susan Hampshire), belle et névrosée, l'enfant chérie de la mère, paralysée et sénile, Mme Bramson
(Mona Washbourne). Jusqu'au moment, une nuit d'orage, où le fragile équilibre des faux-semblants se rompt: l'effondrement mental de Danny dans la scène finale, alors que la caméra s'éloigne de
lui, est particulièrement suggestive...

Keith Waterhouse (1929-2009)
Waterhouse vécut à Leeds une enfance difficile, quitté l'école à 14 ans pour travailler comme cordonnier, puis comme commis d'un entrepreneur de pompes
funèbres avant d'obtenir, en 1950, un emploi de reporter junior au Yorkshire Evening Post et de progressivement s'imposer comme journaliste à part entière. C'est avec "There Is a Happy Land"
(1957), et surtout avec la publication en 1959 de "Billy Liar" qu'il s'impose en littérature, un livre rapidement transformé en pièce de théâtre, puis en film. Avec Willis Hall, Waterhouse
écrivit plusieurs pièces de théâtre, dont "Celebration" (joué en 1961) et des scénarios, dont "Whistle Down the Wind" (1961), ainsi que plusieurs séries télévisées. Son amitié avec le chroniqueur
de magazine Jeffrey Bernard a abouti à la pièce "Jeffrey Bernard Is Unwell", qui a connu un énorme succès lors de sa création en 1989 avec Peter O'Toole dans le rôle
titre.
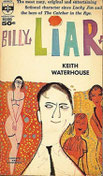
"Billy Liar" (1959)
Les personnages types de la littérature de la littérature dite "Angry young men" des années 1950, tels que Jimmy Porter (Look Back In Anger, John Osborne), Jim Dixon (Lucky Jim, Kingsley Amis), Joe Lampon (Room at the top, John Braine), Joe Lunn (Scenes from Provincial Life, William Cooper), cèdent le pas à un nouvel héros, Billy Fisher, - la vingtaine, qui vit chez ses parents à Stradhoughton, petite ville terne et ennuyeuse du Yorkshire. Il y est employé de pompes funèbres et décide de se prendre en main à sa façon, en se recréant un univers imaginaire où il peut être Premier ministre, amant, révolutionnaire et écrivain tout à la fois. Sa vie devient ainsi progressivement un nœud de mensonges, - Billy trompe tout le monde, ses parents, à qui il affirme avoir trouvé du travail, sa fiancée, à qui il promet mariage et fidélité, une amie qu'il proclame être sa soeur. Le roman entreprend de faire le récit de la journée où tout va progressivement s'écrouler : lorsqu'à la mort de sa grand-mère, qu'il a involontairement causée, l'occasion se présente de partir à Londres, de repartir et de recommencer à zéro avec Liz, la troisième de ses conquêtes, il hésite, tergiverse et, finalement, rate son train. Seul, relégué dans l'empire de son monde imaginaire, il regagne la maison familiale….





John Schlesinger (1926-2003)
Partagé entre Royaume-Uni et Etats-Unis, natif de Londres, dans un milieu intellectuel bourgeois, acteur de seconds rôles de 1953 à 1958, Schlesinger
tourne des courts métrages puis se lance avec son premier long métrage en 1962 dans la droite ligne du Free Cinema britannique intimiste, exposant des existences sans importance tentant
d'échapper à la grisaille du quotidien, avec un éclairage particulier sur l'identité sexuelle : "Un Amour pas comme les autres". C'est avec "Darling" (1965) délaisse le Free cinema pour les
décors de la Swinging London, puis enfin rejoint le mouvement du New Hollywood à la fin des années 1960 : il quitte le milieu bourgeois pour penser la marge de la société et un quotidien qui
sombre dans l'angoisse : "Macadam cowboy" (1968), tourné aux Etats-Unis, développe le thème de l'homosexualité, "Marathon man", un thriller sur d'anciens nazis vivant à New York (1976), "Le Jeu
du faucon" (1984), qui s'inspire du monde des services secrets, "Les Envoûtés" (1987), film fantastique qui décrit un New York gangrené par une secte vaudou, "Fenêtre sur Pacifique" (1990) qui
raconte l'histoire d'un couple de propriétaires confrontés à un locataire machiavélique...


"Billy Liar", adaptation cinématographique de John Schlesinger, en 1963, interprétée par Tom Cortenay, le coureur de fond de Richardson, et Julie Christie qui débute ainsi sa carrière cinématographique. La jeune britannique, née en 1940 dans la région d'Assam en Inde britannique, va devenir en peu de temps l'icône de la mode des Sixties sous l'impulsion du Vogue britannique et de Life Magazine en 1965. Son interprétation de Lara Antipova dans le "Doctor Zhivago" adapté par David Lean du livre de Boris Pasternak, lui vaudra la même année une célébrité mondiale….









"A Kind of loving", 1962, John Schlesinger
Cast: Ruth Porcher ([Mrs Parker]); Alan Bates (Victor 'Vic' Arthur Brown); June Ritchie (Ingrid Rothwell); Thora Hird (Mrs Rothwell); Bert Palmer (Mr
Brown)
Adapté d'un roman de Stan Barstow, le fim montre comment les individus, le plus souvent peu sympathiques, doivent négocier leurs désirs à une époque de
bouleversement social. Vic Brown, dessinateur dans une ville industrielle du Nord, qui aspire à sortir de sa condition, mais pleurnicheur égoïste et misogyne, commence à courtiser une dactylo,
Ingrid, une jeune femme dont les pensées ne vont pas plus loin que les péripéties des épisodes des séries TV telles que "Call Dr. Martin". L'attirance entre les deux protagonistes est purement
sexuelle et très rapidement l'ennui gagne Vic Brown. Mais, ayant mise enceinte sa compagne, Vic doit céder au mariage. La vie de couple, auquel vient s'adjoindre la mère d'Ingrid, s'avère
intolérable et quand Ingrid perd le bébé, Vic, confronté à un choix entre désirs et responsabilités, décide de partir…










"Darling", 1965, John Schlesinger
Cast: Dirk Bogarde (Robert Gold); Laurence Harvey (Miles Brand); Julie Christie (Diana Scott); José Luis De Vilallonga (Prince Cesare Della Romita); Roland
Curram (Malcolm); Basil Henson (Alec Prosser-Jones); Helen Lindsay (Felicity Prosser-Jones)
Diana Scott, devenue Princesse della Romita, célébrité internationale, raconte sa vie pour un magazine féminin. Sur fond de "fashionable London jet-set", de
bouleversement des moeurs (on y aborde la sexualité, la trahison, la bisexualité, l'infidélité, la différence d'âge, la grossesse et l'avortement), le film campe l'histoire d'une jeune femme
amorale qui sacrifie tout à la satisfaction de ses caprices, mais finit par se retrouver piégée dans un mariage sans amour. Mariée trop jeune à un homme insignifiant, Tony Bridges (Trevor Rowen),
Diana Scott s'attache à un journaliste de télévision cultivé, Robert Gold (Dirk Bogarde), qui quitte pour elle femme et enfants, mais s'avère trop absorbé par son métier, se laisse tenter par
Miles Brand (Laurence Harvey), homme d'affaires cynique, avec qui elle passe quelque temps avant de revenir à Robert qui ne veut plus d'elle, puis se lie à un photographe homosexuel, Malcolm
(Roland Curram), qui en fait la cover-girl la plus demandée, accepte enfin la demande en mariage du Prince della Romita, et abandonne tout espoir de reconquête de celui qui restera son plus grand
amour, Dirk Bogarde... Le film se termine non sans ironie avec l'histoire de sa vie sur la couverture du magazine IDEAL WOMAN, en vente dans les kiosques à journaux du coin à
Londres...
















"Kitchen Sink realism" (l'art de l'évier),
"from the studio to the kitchen", concerne dans un premier temps un groupe de peintres dont John Bratby (1928-1992) est la figure la plus emblématique, puis sera appliqué à une esthétique privilégiant l'ordinaire de notre existence (domestic scenes with stress on the banality of life) comme remède à un sentiment d'enlisement total de tout notre être ("Still Life with Chip Frier", 1954, "The Toilet", 1955, Tate, London). Le mouvement s'étend au théâtre (A Taste of Honey), romans, cinéma (Always Rains on Sunday, 1949, Robert Hamer; A Place to Go, 1963, Basil Dearden; Billy Liar, 1963, John Schlesinger; Alfie , 1966, Lewis Gilbert, avec Michael Caine; The Whisperers, 1967, Bryan Forbes) et télévision : il s'agit d'un réalisme social centré sur les conditions d'existence de la classe ouvrière britannique, logements locatifs exigus, alcoolisme endémique, loisirs mornes et violents, en fond de questions lancinates évoquant la classe, la race, les relations sexuelles. C'est David Sylvester qui, en 1954, utilise le terme de "Kitchen Sink realism" (Encounter, décembre 1954) pour décrire les travaux d'artistes tels que , John Bratby, Derrick Greaves (1927), Edward Middleditch (1923-1987), Jack Smith (1928-2011) qui nous conduisent de l'atelier à la cuisine : "An inventory which includes every kind of food and drink, every utensil and implement, the usual plain furniture and even the babies’ nappies on the line. Everything but the kitchen sink – the kitchen sink too" (un inventaire qui comprend tous les types d'aliments et de boissons, tous les ustensiles et ustensiles, les meubles habituels et même les couches pour bébés sur la ligne. Tout sauf l'évier de la cuisine, l'évier de la cuisine aussi) et ces cuisines sont des "kitchens in which ordinary people cooked ordinary food and doubtless lived their ordinary lives..."




"Room at the Top" (1959, Les Chemins de la haute ville, Jack Clayton)
Avec Laurence Harvey (Joe Lampton); Simone Signoret (Alice Aisgill); Heather Sears (Susan Brown); Donald Wolfit (Mr Brown); Ambrosine Phillpotts (Mrs
Brown)
"Room at the Top", inspiré d'un roman de John Braine (1922-1986) qui écrira une suite en 1962, "Life at the Top", est non seulement le premier film de la
Nouvelle Vague britannique, mais aussi, compte tenu de son succès commercial, la première oeuvre révélant les nouvelles attentes d'un public prêt à abandonner les comédies romantiques pour un
discours réaliste souvent très engagés socialement, ou attiré par la promesse d'une affiche X, "A Savage Story of Lust and Ambition". Pourtant le réalisateur n'est pas Tony Richardson, Karel
Reisz, Lindsay Anderson ou John Schlesinger, Jack Clayton, un vétéran de l'industrie avec plus de 20 ans d'expérience - même s'il n'avait alors que 37 ans. Yorkshire, début des années 1950. Joe
Lampton, un jeune homme ambitieux de la classe ouvrière, quitte Dufdon, la pauvre, pour Warnley, la riche, pour travailler pour le conseil municipal. Un collègue, Charles, chargé de s'occuper de
lui, l'emmène à une production théâtrale amateur. Joe y admire deux femmes, une française plus âgée, mariée, Alice Aisgill, et Susan Brown, la jeune fille d'un industriel local, qui répond plus à
ses ambitions, mais le voici affrontant les sarcasmes de la haute société et partagé, naviguant de l'une à l'autre au cours d'un scénario qui est sans aucun l'un des plus dévastateurs du
cinéma britannique de l'époque...

Colin Maclnnes (1914-1976)
Colin MacInnes est sans doute le premier écrivain à découvrir les nouveaux visages de Londres autour de la fin des années 1950, une ville adolescente qui de
vient multiculturelle. Natif de Londres, il a passé sa jeunesse en Australie, quitté l'armée en 1945, et devient le chroniqueur décadent des années 1950 à Notting Hill, un quartier agité et
instable qui abritait l'une des plus grandes communautés d'immigrants antillais du Royaume-Uni, et le théâtre d'émeutes raciales notoires en août 1958. Ouvertement homosexuel et totalement
iconoclaste, MacInnes se désespère de la Grande-Bretagne après les émeutes et de ces quelques quartiers de Londres totalement livrés à la misère, et c'est l'arrivée d'un groupe d'antillais, à
l'exotisme exubérant, "grinning and chattering", qui lui rend un peu d'espoir quant à l'avenir dans "City of Spades" (1958). Dans le roman suivant, "Absolute Beginners", c'est le monde si
particulier du "London teenager" qui est exprimé avec une précision dans ce qu'il a, aux yeux de l'auteur, de plus profond, le seul être vivant de cette planète Londres qui ne se soucie pas
des barrières de race, de couleur et de croyance...

"Absolute Beginners" (1959, Les Blancs-Becs, Colin Maclnnes)
Les blancs-becs, ce sont les teenagers britanniques, jeunes gens entre treize et vingt ans. Ils vivent dans les bas quartiers de Londres en compagnie
d'Africains, d'Antillais, d'Indiens. Épris de liberté, le narrateur, pour gagner sa vie, fait des travaux de photographie relevant de la pornographie. Une jeune vendeuse de maison de couture,
Suzette, l'aide à trouver des clients. Elle a une attirance très marquée pour les Noirs, ce qui ne l'empêche pas d'être amoureuse du narrateur, avec lequel elle se dispute, qu'elle quitte et
qu'elle retrouve. Elle se jettera dans ses bras la nuit où éclatent des émeutes raciales fomentées par les Teddy Boys. C'est le roman le plus célèbre de la trilogie de Londres de Colin Maclnnes
qui compte "City of Spades" (1958) et "Mr. Love and Justice" (1960). Le roman connut une seconde vie en 1986 via une comédie musicale de David Bowie...
"... Je réfléchissais à tout cela, en sortant du «Petit Naples» pour pénétrer dans Londres, du côté de Notting Hill Gate. En montant Portobello Road, je
dépassai une colonne de gosses, parmi lesquels je remarquai quelques métèques en herbe. Eh bien, à cet âge-là, on ne pense pas encore à la couleur de la peau, on se contente de se flanquer des
coups par-dessous et le seul ennemi commun est le prof. J 'étais maintenant dans Bayswater Road et je longeais des jardins qui s'étendaient sur plus de trois kilomètres (très jolis de jour, mais
malsains de nuit) et je continuais toujours à réfléchir en foulant le pavé de mes chaussures tressées à l'italienne.
Big Jill a peut-être raison. Je réfléchis trop, mais la vue de ces écoliers me rappelait l'homme qui m'avait justement appris à réfléchir : mon maître à
l'école communale, Mr. Barter. Je sais bien que ça fait ballot de dire qu'on a appris quelque chose en classe, mais pour moi c'est vrai. C'est à onze ans, sous les glorieux auspices des années
50, que je tombai sous la patte de Mr. Barter, un homme qui louchait. A cause du nombre d'écoles détruites dans ma petite enfance par les bombes (dont je me souviens à peine, tout au plus les V2
de la fin), il me fallait faire plus d'un kilomètre à pied, jusque dans Kilburn Park où ce Mr. Barter
officiait. Eh bien, j'espère que vous allez piger parce que c'est comme ça : le vieux Barter a été le seul prof (homme ou femme) de toutes les écoles
que j'ai fréquentées (il y a trois ans que je suis débarrassé de tout ce cirque) à me faire comprendre deux choses : les connaissances acquises ont une certaine valeur et ne vous sont pas
assenées comme une punition; et puis ces connaissances ne servent qu'à condition 'être pigées, c'est-à-dire intégrées à votre propre expérience. Barter nous racontait des tas de choses, par
exemple que Valparaiso était une grande ville du Chili, ou que X + Y égale je ne sais plus quoi, ou il nous faisait apprendre la liste des Henry ou des George, et il s'arrangeait pour donner
l'impression de ces élucubrations nous concernaient directement, nous autres les gosses, et avaient une valeur véritable. C'est lui aussi qui m'a donné le goût des livres, puisqu'il a réussi à me
faire comprendre que les bouquins n'étaient pas seulement des objets, mais un esprit qui s'ouvrait à la demande du lecteur; et de cette époque date mon habitude d'acheter - oui, acheter! - des
livres. Et quand je parle de bouquins, c'est des bouquins sérieux, du genre inconnu parmi; les jeunes de Harrow Road pour qui la littérature consiste en westerns et ouvrages
pornos.
En parlant de ce prof, et pour en finir avec les confessions à faire rougir, il faut bien que j'avoue quelle a été l'autre influence prédominante dans
ma vie : eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais j'ai été - pendant deux années entières -, oui j'ai été.. louveteau! Oui, parfaitement ! Moi l... Voilà comment ça s'est passé. C'était au
moment où j'ai commencé d'aller à l'école du dimanche. Ça, ça n'a pas duré parce que je n'ai pas tardé à m'en débarrasser, mais les
louveteaux, c'était différent, je ne sais pourquoi ça m'attirait. La première réunion, papa m'y avait traîné par la peau du cou, mais le louvetier - et je sais maintenant que c'était une vieille
tantouze - voulait que je vienne de mon propre gré et il me proposait de faire l'expérience pendant un mois. J 'acceptais naturellement, en me disant qu'un mois serait vite passé. Alors on a
commencé à me bourrer le crâne de toutes sortes de crétineries, dont je sentais l'inutilité même à cet âge tendre, comme d'allumer un feu avec deux allumettes seulement, alors que les allumettes sont la chose la moins chère du monde, ou de faire un garrot à un gars piqué pas une vipère, alors que ces
bestioles-là ne se promènent pas dans les rues de Londres, et puis surtout que si on est piqué à la tête ou à un autre endroit inaccessible aux garrots, ça ne sert à rien...Et voilà que, petit à
petit, à l'étonnement général, je devins un vrai tordu du louvetisme, parce que je trouvais dans ces réunions hebdomadaires qui avaient lieu au temple baptiste recouvert de tôle ondulée, j'y
trouvais - non, ne riez pas! - un esprit de famille, de groupe, des copains, est-ce que je sais moi, et je faisais partie du tas.
Ce vieux couillon de louvetier, complètement grotesque avec son short et son grand feutre, était sinoque, ou pis encore, mais il ne nous embêtait pas, nous autres les gosses, et il parvenait même
à nous faire la morale: incroyable, mais vrai. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que ça marquait : oui, parfaitement. Je peux dire
que mes seules notions morales sont celles inculquées par ce vieux dingo de chef et acceptées, je crois, parce qu'il nous donnait l'impression d'aimer sa bande de petits monstres aux genoux
sales, de s'intéresser à eux sans rien demander en retour. C'était le seul adulte de ma connaissance - mon père lui-même ne faisait pas exception - qui ne se targuait pas de sa qualité d'adulte
pour approcher les enfants et renonçait à la force pour les conquérir par la persuasion.
Ces considérations m'amènent jusqu'au présent et à la troisième étape de mon éducation : disons mes années d'enseignement supérieur, c'est-à-dire mes
jazz clubs. Le jazz, on peut en penser ce qu'on veut - et franchement ce que vous en pensez, ça m'est bien égal - mais c'est quelque chose de si merveilleux que les gens qui ne bichent pas
là-dessus, on ne peut éprouver pour eux que de la pitié. Moi, je ne prétends pas tout comprendre, dans le jazz, il y a des disques qui me coupent le sifflet. Mais ce qu'ii y a de sensass dans
l'univers du jazz, pour tous les gosses qui y pénètrent, c'est que là personne ne s'intéresse à votre milieu, votre race ou votre fortune, pas même à savoir si vous êtes fille ou garçon, ou un
peu des deux, tant que vous pigez bien l'esprit du club et que toutes ces conneries-là, vous vous en débarrassez avant d'entrer. Résultat : dans un jazz club, on rencontre de tout et sur un pied
d'égalité absolue ; de là, on peut vous aiguiller dans n'importe quelle direction - sociale, culturelle, sexuelle ou raciale - en fait, n'importe où vous manifeste: l'intention
d'aller.
Voilà pourquoi, lorsque je sentis que la belle aventure des jeunes tombait aux mains des usuriers et des montreurs de singes, je renonçai peu à peu aux
groupes de jeunes pour fréquenter plutôt les bars, les clubs et les concerts où se rassemblaíent les plus vieux parmi les fervents du jazz.
Mais ce soir-là, il fallait justement que je me rende dans une boite fréquentée par des jeunes pour voir deux de mes modèles : Dean Swift et Dédé la
Misère. Il faut bien reconnaître que malgré les conneries écrites au sujet de Soho, c'est pourtant un des plus
authentiques quartiers de.Londres. A Mayfair, ce ne sont que parvenus occupés à se glisser dans les pantoufles de l'ancienne haute société; à Belgravia,
comme je l'ai déjà dit, on a converti les palaces en appartements; quant à Chelsea; eh bien, vous n'avez qu'à observer autour de vous la prochaine fois que vous irez. Mais à Soho, tout est
bienconforme aux
descriptions : tous les vices s'y côtoient, on y voit des débits clandestins, des rois du baratin et des petits copains qui n'hésitent pas à s'attaquer
au couteau; oui, mais on y rencontre aussi de charmants vieux Italiens et Viennois qui pratiquent honnêtement leur métier, depuis je ne sais combien de George, peut-être George V et avant. Mieux
encore, bien que les blousons noirs fourmillent sur le trottoir; si on ne se mêle de rien, on se trouve bien plus en sécurité dans ce quartier que dans la respectable ceinture limitrophe de la
banlieue. Ce n'est pas à Soho que des fous sadiques jaillissent d'un buisson pour violer les passantes, mais dans les quartiers-dortoirs.
Le bistrot où je comptais bien trouver mes deux zèbres était de cette espèce très à la mode actuellement parmi les jeunes : le genre étable à cochons.
Je n'exagère rien, vous verrez. Le procédé est facile : on loue un emplacement, qui n'a rien de moins cher qu'un autre, puis on se dépêche d'arracher les linos et tout ce qu'il peut y avoir de
joli, on y fourre des planchers rugueuxet des tables de bois blanc, et puis on se garde bien de nettoyer les tasses et de balayer les mégots, les crachats et autres saletés. De préférence, on
s'éclaire à la bougie, ou - à la rigueur - avec ,des ampoules bleutées ne dépassant pas 40 W. Le juke-box n'est là que pour faire bien, car, dans ce genre d'endroit, on trouve naïf à présent de
passer des disques.
Cette boite où j'allais s'appelait "Chez *Nobody" et j'y trouvai aussitôt ceux que je cherchais : Dean Swift et Dédé la Misère, assis à des tables
différentes. Bien que tous deux de mes amis et même amis entre eux, ces deux-là ne se montrent pas ensemble en
public parce que Dean est unitoqué du jazz moderne, tandis que Dédé la Misère est une triste relique des traditions anciennes, puisqu'il admire encore
la cacophonie supposée authentique de La Nouvelle-Orléans, celle que pratiquent des ronds-de-cuir poussiéreux se considérant comme les héritiers mystiques des merveilleux créoles inventeurs - il
y a bien, bien longtemps - de tout le rite.
Les connaisseurs les repéreront facilement dans la foule, comme on distingue un marin ou un soldat par l'uniforme. Par exemple, Dédé la Misère avec ses
traditions : cheveux longs qui n'ont jamais connu la brosse, col blanc raide (plutôt crasseux), chemise rayée, cravate unie, veston court et très usagé (veste de cheval en tweed, héritée de
quelqu'un probablement), pantalons tuyau ,de poêle tout ce qu'il y a de plus collants, à larges rayures, pas de chaussettes, et - je vous demande un peu - des bottines à tige courte. Maintenant,
observons l'autre loustic, section moderne : coiffure d'étudiant, bien lisse, avec raie
impeccable sur le côté, chemise blanche (et propre) à l'italienne, avec un col rond, veston court à la romaine, très cintré à la taille, avec deux
petites fentes sur les côtés et trois boutons, pantalons sans revers et étroits, souliers, pointus et un imperméable très clair proprement plié près de lui, pour contraster avec le vieux pépin de
Dédé la Misère, enroulé en forme de saucisse.
Eh bien, une fois la comparaison faite, à vous de choisir! Je pourrais ajouter que les donzelles de ces messieurs - si elles étaient là - seraient
assorties à leur compagnon : pour celle de Dédé, des cheveux longs et malpropres avec une grande frange, peut-être des jeans et un tricot trop lâche ou bien une robe de couleur vive, jamais
jolie, jamais imprimée... l'ensemble de la toilette tendant à donner , une impression de négligé. Quant à la petite amie de Dean, elle porterait jupe courte, bas sans couture, chaussures pointues
à talons très hauts genre pique-choux, jupon de nylon empesé et froufroutant, blazer court et cheveux coupés. Visage pâle couleur cadavre de préférence, avec une touche de mauve et
beaucoup
de rimmel.
Je m'assis près de Dédé la Misère, qui mangeait un gâteau, plus négligé, froissé, malpropre que jamais, mais avec des yeux magnifiques, d'un brun
noisette, drôles et suppliants à la fois, sans pourtant que Dédé la Misère vous demande jamais quoique ce soit, car ses phrases les plus volubiles ne dépassent pas quatre
mots.
- Bonsoir Dédé, dis-je, j'ai eu un petit ennui. »
Il me gratifia df un regard froid, sourcils levés, mais l'air pas spécialement intéressé. ,
- Tu te rappelles les photos que j'ai prises de toi, personnifiant le poète Chatterton, avec ta poulette en muse dans une gaze de nylon
?
- Ouais?
- Ça va, le client n'a pas annulé la commande, mais j'ai développé les photos et ta poulette est trop floue.
- C'était voulu, non ?
- Elle devait être visible malgré tout sous la résille de nylon; elle a dû bouger, d'après moi.
- Alors, tu paies une deuxième pose ?
- D'ac. Mais pas avant d'avoir fourgué les photos à mon client.
- Pas versé d'arrhes? interrogea Dédé en se curant le nez.
- Non. Et si on veut notre galette, monsieur Dédé, il faut recommencer la pose. Peux-tu joindre ta partenaire ?
- Sais pas. Donne-moi un coup de fil ce soir.
Il se leva sans trahir ses sentiments, ce qui était vraiment héroïque pour un pilier du traditionalisme perdu parmi les blancs-becs, menant une vie de
clochard et de bohémien au milieu d'une ère de prospérité, fauché et peut-être même affamé, et pourtant il ne réclamait pas de flouze. S'il avait réclamé, j'en aurais craché, c'est sûr, mais, la
discussion, quand on a la poisse, c'est contraire à toute l'idéologie traditionaliste. En sortant, Dédé la Misère passa devant Dean qui leva la tête et lui lança d'un ton sifflant: "Fasciste!"
Mais Dédé fit celui qui n'entendait pas. Ces disciples du jazz moderne ont une façon de réprouver les réactionnaires !
Dean vint s'asseoir à ma table. Je dois avouer que je ne l'avais pas vu depuis plusieurs semaines, bien qu'il fût mon modèle préféré. Dean a une
spécialité curieuse : il pose toujours habillé et réussit cependant à donner une impression pornographique. Qu'on ne me demande pas comment il fait! Au studio, je prends la photo au moment précis
où il me
l'ordonne, bien que je ne voie rien de particulier dans sa pose. Et pourtant - ô miracle - la photo une fois développée est vraiment índécente. Les
photos de Dean se vendent comme des petits pains aux dames d'âge mûr affligées d'un surplus de poitrine et de temps à tuer. Même ma chère mère a été dûment impressionnée par les photos de Dean;
c'est qu'il a
l'air tellement disponible, ce gars-là! Elle m'a même demandé là faire sa connaissance mais Dean n'y tient pas, car il ne s'intéresse qu'à la
drogue.
S'il vous arrive d'avoir, comme moi, un ami adepte de la drogue, vous comprendez qu'il ne sert absolument à rien de discuter son vice. C'est aussi
inutile que de discuter de l'amour ou de la religion, parce que Dean - comme tous ses pareils, je suppose - est convaincu qu'il mène une "vie mystique" (c'est lui qui le dit). Quant au commun des
mortels, ceux qui ne se piquent pas, ils passent dans la vie, sans en goûter le moindre attrait. Dean affirme toujours que la vie ne vaut que par ses plaisirs. Je suis entièrement d'accord, mais
il me semble que ces plaisirs valent la peine d'être savourés en état de sobriété. Mais allez dire ça à Dean !...
La raison pour laquelle je ne l'avais pas vu depuis un moment, c'est qu'il était à l'ombre. Voilà une chose qui lui arrive souvent du fait qu'il pénètre
souvent par effraction dans les pharmacies; comme il souffre terriblement de ces périodes où il est isolé du monde et de ses ressources, il préfère que l'on n'y fasse pas allusion devant lui.
Cependant, par ailleurs,
il aime bien que l'on manifeste un certain plaisir à le revoir, la chose est donc plutôt délicate.
- Salut, grand chef, lui dis-je. Longtemps moi pas voir toi. Comment toi aller ?
Dean eut son sourire las et me répondit d'un ton mourant :
- Tu ne trouves pas cet endroit puant ?
- Sans aucun doute, mais fais-tu allusion à l'air ou à l'atmosphère?
- Les deux. Cette boîte n'a rien de civilisé, si ce n'est qu'on vous permet de vous asseoir, même quand on est fauché.
Dean laissa errer sur la faune adolescente de la boîte un regard de bourreau concentrationnaire. Il me faut expliquer que Dean, lui-même à peine sorti
de l'adolescence, a le visage creusé de deux rides profondes et qu'íl porte des lunettes à monture métallique, qu'íl retire pour nos séances de pose, et qui lui donnent un air solennel et aigri.
Rien qu'à son expression, je devinai qu'íl allait enfourcher son dada favori : l'horreur et abomination que lui inspiraient les jeunes. Je ne me trompais pas.
-Regarde ces microbes imberbes! s'exclama-t-il d'une voix sonore. Regarde-moi ces locataires de landaus en train de suçoter leurs mystérieux
complots!
Et, de fait, ces gamins penchés sur les tables avaient l'air de comploter la mort de leurs aînés! Je payai les consommations et je sortis dans les rues
de Soho, accompagné de Dean; même dans ce refuge de la mafia adulte, on devinait partout les signes de la révolution des adolescents, révolution qui n'avait rien de silencieux. Les vitrines des
magasins de musique arboraient des pochettes de disques, dont rien n'égale l'originalité; à l'intérieur, c'était
plein de gosses qui achetaient des guitares ou dépensaient des fortunes pour les airs à la mode. Dans les magasins de vêtements, les chemises d'hommes,
ou les soutiens-gorge voisinaient avec des photos de stars, et l'on y vendait toute la panoplie du Parfait Jeune à la mode. Les salons de coiffure où, moyennant une torture de quelques heures, on
vous fabrique de si belles ondulations... Les boutiques de produits de beauté, où des filles de dix-sept, quinze, ou même treize ans, trouvent de quoi prendre des airs blafards, mornes et
sophistiqués... Scooters et Isettas pétaradants, menés un train d'enfer par des gosses
qui, à peine quelques années auparavant, jouaient encore à la patinette sur le trottoir. Et partout, partout, des bars- minuscules, étirés en couloirs
ou installés dans des caves obscures, bourrés de gosses qui bourdonnent comme des abeilles dans une ruche,
attendant l'apparítion de l'éblouissante reine.
- Alors, tu vois ce que je veux dire..., grogne Dean.
Et les donzelles dans tous les coins, en cet après-midi d'été! Miséricorde, chaque année le type idéal de la pépée à la mode rajeunit sensiblement!
Toutes ces souris : on aurait dit des gamines qui jouaient à la dame, avec les robes du dimanche chípées à leur maman. Mais il s'agissait bien de jeu! Elles savaient ce qu'elles voulaient et
elles allaient droit au but, sur
leurs jolies jambes nerveuses, et leur but ce n'était pas des gamins comme elles, mais bel et bien des adultes à qui elles lançaient des œillades
pleines d'assurance et de fierté.
- Des nanas en herbe, proféra Dean.
- Comme tu dis!
Là-dessus, Dean s'arrêta net et tira sur ses yeux son espèce de casquette américaine rayée. - Tu sais, dit-il, ces jeunes. ne sont plus des êtres
humains doués de raison et de pensée, mais des papillons écervelés. Mieux encore œs papillons sont en train de devenir tous semblables par la forme et la couleur, ils butinent les mêmes fleurs,
dans les mêmes jardins et selon un ordre immuable..." (Trad. de l'anglais par Lola Tranec-Dubled, Gallimard).
