- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Cela
- Horkheimer - Adorno
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Mead - Benedict - Linton
- Wright
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Algren - Irish
- Montherlant
- Fallada
- Malaparte
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Voltaire (1694-1778) - Partie 1 - Les débuts de Voltaire sous la Régence (1715-1719) - "Lettres philosophiques" (1734) - Voltaire à Cirey, chez Mme du Châtelet (1734-1738) - Voltaire à Paris, la période la plus brillante de sa vie (1744-1750) - "Zadig ou la Destinée" (1747) - .......
Last update 10/10/2021

"Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire" (Voltaire, 1734) A partir de 1734, date de publication des "Considérations sur la grandeur des Romaíns et leur décadence" de Montesquieu et des "Lettres philosophiques" de Voltaire, la philosophie, sous ses différents aspects, historique, politique, métaphysique, scientifique, et même pratique, devient l'objet essentiel de la littérature : l'histoire des œuvres se confond avec l'histoire des idées et l'esprit critique se développe : "Laissez lire et laisser danser", écrit Voltaire... Son séjour en Angleterre de 1726 à 1729 témoigne des bienfaits de la liberté, tant du point de vue religieux et politique, que de littéraire et du philosophique, et de cette liberté résultent une amélioration de l'existence. Et si "les pensées des hommes sont devenues un objet important de commerce", il faut désormais laisser libre cours à cette circulation des idées, que le fond soit bon ou mauvais. L'homme de goût saura s'y retrouver, l'homme d'Etat n'a rien à en redire...
Voltaire est le représentant le plus complet du XVIIIe siècle, il l'a pratiquement rempli d'un bout à l'autre, de la Régence au seuil de la Révolution, il témoigne d'un appétit et d'un plaisir de vivre avec la génération de la Régence, utilise tous les genres littéraires pour exprimer ses contradictions entre désir de réformer la société, de combattre la sottise, l'intolérance et le fanatisme, et de s'abandonner à la vie mondaine. Quant à sa pensée, c'est une philosophie pratique et déiste (le monde serait inexplicable sans Dieu et sans fondement moral possible) mais qui n'a que mépris pour la métaphysique, une philosophie pratique qui croit que l'accumulation des efforts individuels permet d'améliorer la vie sociale. Une certaine résignation active l'emportera au bout du compte passé 1756 et le désastre de Lisbonne... Enfin, 1761, date de la publication de la Nouvelle Héloïse, ouvrira une autre époque, un esprit différent, Rousseau, Diderot, Beaumarchais, une autre conception du monde....
(1724, Nicolas de Largillière (1656–1746), portrait de Voltaire, Château de Versailles)

Voltaire (1694-1778)
François-Marie Arouet naquit à Paris le 21 novembre 1694; son père était notaire au Châtelet. Après ses études chez les jésuites, il s'introduisit tôt dans la société libertine du Temple, une Société de libertins qui se réunissaient chez le chevalier de Vendôme, grand prieur de l'Ordre des Templiers. Devenu clerc d'un procureur, il s'initie au droit et se lie avec Thieriot, l'ami de toute sa vie, mais ses écrits satiriques contre le poète La Motte, puis contre le Régent, le font exiler deux fois en province (1716). A peine rentré, il écrit contre le Régent une épigramme en latin et cette fois il est enfermé à la Bastille pour onze mois (1717-1718). Il y lit Homère et Virgile, termine sa tragédie d'œdipe et commence le poème de La Ligue. Sorti de prison, il prend le nom de Voltaire et devient célèbre à 24 ans grâce au succès d'OEdipe (1718) et de La Ligue (1723). Il hérite d'une jolie fortune et l'arrondit par d'habiles placements. On l'attire dans les salons où triomphent ses talents de poète mondain. En 1725, le voici à Fontainebleau, où il donne trois pièces de théâtre pour le mariage du roi. Faveurs, pensions, tout vient combler ses désirs. Mais le duc de Rohan, à qui Voltaire avait répondu avec impertinence, lui rappela, en le faisant bâtonner, qu'il n'était pas noble, il doit de nouveau être enfermé à la Bastille mais est autorisé à s'exiler en Angleterre (mai 1726)...
Ce séjour lui sera aussi agréable que profitable : il y découvrit la philosophie de Locke, les pièces de Shakespeare et aussi une liberté politique qu'il apprécia fort et qu'il louera dans ses Lettres Anglaises, publiées en 1734, cinq ans après son retour. La même année, il rencontre Mme du Châtelet avec laquelle il resta lié seize ans. Il voyage souvent, mais revient toujours chez elle, à Cirey, où il se livre à des expériences scientifiques, donne des représentations théâtrales et compose son essai sur le Siècle de Louis XIV.
En 1744, il est appelé a Versailles par son ami d'Argenson devenu ministre des Affaires étrangères. Historiographe du roi, il compose des poèmes divers et rédige "Zadig" (1747), les romans s'enchaînent, Babouc (1748), Micromégas (1752), Scarmentado (1756), Candide (1759), Jeannot et Colin (1764), l'Ingénu (1767), L'Homme aux quarante écus (1768), La Princesse de Babylone (1768). Mais son humeur satirique lui attire des hostilités.
En 1750, il part pour Berlin sur l'invitation pressante du roi de Prusse; il est fort bien accueilli à Potsdam et continue de travailler au Siècle de Louis XIV qui paraît en 1751. Mais il se brouille avec le roi et revient en France en 1753.
En mai 1755, il s'établit aux "Délices", dans la banlieue de Genève : il s'occupe de ses intérêts, embellit la propriété et y installe un théâtre. C'est alors qu'il publie l'Essai sur les mœurs (1756) et Candide (1759), et qu'il rédige de nombreux pamphlets et opuscules. Il se brouille bientôt avec Rousseau, mais aussi avec les Genevois, et achète en 1759 le château de Ferney pour y être "maître absolu" chez lui. Il a trouvé là une retraite sûre qui lui permet de passer rapidement de France en Suisse, sans pour autant dépendre de Genève : son activité y est intense. Il écrit le Traité sur la Tolérance (1763) et le Dictionnaire philosophique (1764), mène la lutte philosophique et critique sur tous les plans, lutte contre l'intolérance et les iniquités judiciaires (parmi beaucoup d'autres, l'affaire de l'Amiral Byng, de Calas (1762), de Sirven (1764), du chevalier de La Barre (1765), de Lally-Tollendal (1766), condamnés à tort), crible ses adversaires de sarcasmes, encourage ou supplie d'innombrables correspondants (on comptera plus de 10.000 lettres), mais aussi enrichit Ferney, améliorant dans sa région l'agriculture et l'industrie, donnant des réceptions brillantes et des représentations théâtrales où il joue lui-même. A quatre-vingt-quatre ans, il fait un voyage triomphal à Paris et meurt au cours du voyage, après avoir assisté au triomphe de sa pièce Irène à la Comédie-Française et appris la réhabilitation de Lally-Tollendal.
La diversité de l'œuvre - L'oeuvre de Voltaire est riche de contradictions apparentes, comme sa vie même. Il utilise tous les genres, la tragédie, l'histoire, l'épopée, l'épître, le pamphlet, l'article de dictionnaire; il se montre à. la fois désireux de réformer la société et charmé par la vie mondaine de son temps, philosophe au sens critique aigu et homme d'action et de combat, impitoyable avec ses adversaires et capable de générosité et de dévouement pour ceux qu'il aime. Il a su pourtant se donner peu à peu une unité interne, autour de quelques grandes lignes de force : l'humanisme, le désir de vérité, l'art de vivre. La croyance en un progrès réel de l'humanité, et le désir d'y contribuer, en créant une civilisation réellement humaniste sont un aspect essentiel de la pensée de Voltaire. Il ne conçoit pas ce progrès comme une marche en avant constante et régulière : les sottises des hommes sont nombreuses, la cruauté renaît sans cesse. L'homme n'est pas naturellement bon; il faut pourtant l'aimer et le rendre meilleur : l'humanisme voltairien unit la pensée optimiste de la Renaissance et la méfiance moraliste des classiques. Aussi peut-il prôner sans contradiction l'esprit chevaleresque du Moyen Age, admirer sincèrement le Grand Siècle, tout en gardant les yeux ouverts sur l'actualité, les découvertes scientifiques, la société mondaine, les arts, les spectacles.
Puisque le progrès de l'humanité n'est pas une nécessité matérielle et fatale, il faut sans cesse lutter contre les injustices, les ignorances, l'erreur. La recherche de la vérité est le souci majeur, la passion personnelle de Voltaire; pendant soixante ans, il a exercé un effort critique sans hésitations ni défaillances, lutté contre les préjugés scientifiques, les superstitions, les déformations stupides ou volontaires de la réalité historique, les erreurs judiciaires, la vanité des hommes et même celle des philosophes; la présomption n'est-elle pas une des formes de l'erreur?
En ce qui concerne les grands problèmes métaphysiques, au lieu de mettre de l'eau au moulin dans une polémique stérile qui engendre le fanatisme et l'intolérance, mieux vaut reconnaître l'insuffisance de notre esprit à percer le secret de sa nature, accepter notre condition fondamentale, et organiser notre vie le mieux qu'il nous est possible de le faire.
Cette acceptation que fait Voltaire n'est pas un renoncement : son humanisme est combatif et sa résignation active; il regrette aussi vigoureusement le jansénisme morose et décourageant qu'un épicurisme sans perspective généreuse ou altruiste. Il lutte contre les persécutions, la guerre, l'intolérance, les fanatismes de race et de religion, les abus de pouvoir, les violences de tout genre. Il ne néglige pas les problèmes matériels, gère fort bien sa richesse, pratique à Ferney une économie avisée, mettant en valeur tout le canton pour le meilleur profit des habitants et le sien propre. Il semble avoir découvert peu à peu un art de vivre : "paix, lucidité prospérité", où l'amitié, l'humour, la bonne humeur ont leur place, et dont le rayonnement illumine ses innombrables lettres..

1719 - En littérature, en France, Massillon, Petit Carême (1718), Dubos : Réflexions sur la poésie et la peinture (1719), La Motte, Fables (1719), Crébillon, Sémiramis (1717), Marivaux, Arlequin poli par l'Amour (1720), Montesquieu, Lettres persanes (1721), les Salons de la duchesse du Maine et de Mme de Lambert. En Angleterre, Daniel de Foé, Robinson Crusoé (1719). En peinture, survivance de Largillière et de Rigaud, mort de Watteau (1721), ses successeurs Lancret et Pater. En musique, Couperin, Rameau, Traité d'Harmonie, 1722).
Les débuts de Voltaire sous la Régence (1715-1719) - Œdipe (18 novembre 1718). - Le 1er septembre 1715, Louis XIV mourait, âgé de soixante-dix-sept ans. Sa disparition fut le signal d'une véritable effervescence des esprits et des moeurs. Dans cette orgie, les fêtes du Temple battaient leur plein el Voltaire y tenait joyeusement sa place. Parmi les nombreuses pièces satiriques lancées contre Je Régent, deux, petites pièces coururent sous le nom d'Arouet. On fit comprendre au duc d'Orléans la nécessité de sévir. Il se contenta d'éloigner le poète de Paris et il accorda à la demande du père que son fils lut exilé à Sully-sur-Loire, pour "corriger son imprudence et tempérer sa vivacité". Voltaire se retrouve en 1717 à nouveau incarcéré, mais à la Bastille, pour une satire qui n'était pas de lui, puis exilé à Châtenay le 11 avril 1718, jusqu'en octobre, dans les temps pour la représentation de sa première pièce, Oedipe, le 15 novembre, qui obtint un succès prodigieux avec quarante-cinq représentations consécutives. Les six ou sept années qui suivirent le succès d'Œdipe marquent le développement tranquille du talent et de la réputation de Voltaire. En 1719, il est encore dans un demi-exil à Sully-sur-Loire, comme en 1716. Le 15 février 1720, Voltaire fit représenter une nouvelle tragédie, Artémire, du nom de l'héroïne, princesse vertueuse persécutée par un mari cruel, le roi de Macédoine Cassandre, qu'elle n'aimait point. La pièce échoua. Madame, mère du Régent, ayant désiré voir la pièce, Voltaire la retoucha et Artémire fut jouée huit fois.

1722 - "Le Pour et le Contre", Epitre à Uranie", le "Poème de la Ligue" - "Aux superstitions j’arrache le bandeau ; Que j’expose a tes yeux le dangereux tableau Des mensonges sacrés dont la terre est remplie..." - Le 1er janvier 1722, le vieil Arouet, son père, mourait, à l'âge de soixante-douze ans. C'est l'aîné, Armand Arouet, qui succéda à son père, dans sa charge de payeur des épices de la Chambre des comptes...
C'est à cette époque qu'il composa pour une dame de ses amies "Le Pour et Contre", premier monument de son incrédulité. La pièce, connue sous le nom d' "Epitre à Uranie" ne fut publiée que plus tard et attribuée à Guillaume Chaulieu (1639-1720), poète en titre de la société du Temple et des derniers libertins dans l'ombre des Vendômes; un Chaulieu un auquel le jeune Arouet fut particulièrement sensible. Voltaire achève son poème sur Henri IV, qu'il avait commencé à la Bastille, et qui, corrigé, augmenté et publié, prendra pour titre "la Henriade"; mais ne pouvant espérer le publier en France, il gagne La Haye et Amsterdam, nous sommes en 1722, Voltaire admire cette ville de cinq cent mille habitants où il semble n'y avoir ni pauvre ni petit maître....
"Le Pour et Contre"
A MADAME...,.
Tü veux donc , belle Uranie ,
Qu’érigé par ton ordre en Lucrèce nouveau,
Devant toi d’une main hardie
Aux superstitions j’arrache le bandeau ;
Que j’expose a tes yeux le dangereux tableau
Des mensonges sacrés dont la terre est remplie,
Et que ma philosophie
T’apprenne a mépriser les horreurs du tombeau
Et les terreurs de l’autre vie.
Ne crois point qu’enivré des erreurs de mes sens,
De ma religion blasphémateur profane ,
Je veuille avec dépit, dans mes égaremens,
Détruire en libertin la loi qui les condamne.
Viens, pénètre avec moi d’un pas respectueux
Les profondeurs du sanctuaire
Du Dieu qu’on nous annonce et qu’on cache a nos yeux.
Je veux aimer ce Dieu, je cherche en lui mon père ;
On me montre un tyran que nous devons haïr.
Il créa des humains à lui-même semblables ,
Afin de les mieux avilir;
Il nous donna des cœurs coupables ,
Pour avoir droit de nous punir.
Il nous fit aimer le plaisir,
Pour nous mieux tourmenter par des maux effroyables
Qu’un miracle éternel empêche de finir.
Il venait de créer un homme a sou image ,
On l’en voit soudain repentir,
Comme si l’ouvrier n’avait pas dû sentir
Les défauts de son propre ouvrage !
Aveugle en ses bienfaits, aveugle en son courroux ,
A peine il nous fit naître, il va nous perdre tous!
Il ordonne a la mer de submerger le monde ,
Ce monde qu’en six jours il forma du néant.
Peut-être qu’on verra sa sagesse profonde
Faire un autre univers plus pur, plus innocent :
Non ; il tire de la poussière
Une race d’affreux brigands,
D’esclaves sans honneur, et de cruels tyrans,
Plus méchante que la première.
Que fera-t-il enfin , quels foudres dévorans
Vont sur ces malheureux lancer ses mains sévères ?
Va-t-il dans le chaos plonger les élémens ?
Écoutez, ô prodige ! ô tendresse ! ô mystères!
Il venait de noyer les pères ,
Il va mourir pour les enfans.
Il est un peuple obscur, imbécile, volage ,
Amateur insensé des superstitions ,
Vaincu par ses voisins. rampant dans l'esclavage ,
Et l éternel mépris des antres nations :
Le fils de Dieu , Dieu même , oubliant sa puissance ,
Se fait concitoyen de ce peuple odieux ;
Dans les flancs d'une Juive il vient prendre naissance;
Il rampe sous sa mère , il souffre sous ses veux
Les infirmités de l’enfance.
Long-temps vu ouvrier, le rabot a la main,
Ses beaux jours sont perdus dans ce lâche exercice ;
Il prêche enfin trois ans le peuple iduméen ,
Et périt du dernier supplice.
Son sang du moins, le sang d’un Dieu mourant pour nous
N'était-il pas d’un prix assez noble , assez rare,
Pour suffire à parer les coups
Que l’enfer jaloux nous prépare ?
Quoi ! Dieu voulut mourir pour le salut de tous,
Et son trépas est inutile !
Quoi! l’on me vantera sa clémence facile ,
Quand remontant an ciel il reprend son courroux ;
Quand sa main nous replonge aux éternels abîmes,
Et quand par sa fureur effaçant ses bienfaits ,
Ayant versé son sang pour expier nos crimes ,
Il nous punit de ceux que nous n’avons point faits !
Ce Dieu poursuit encore, aveugle en sa colère ,
Sur ses derniers enfans l’erreur d’un premier père ;
Il en demande compte a cent peuples divers
Assis dans la nuit du mensonge ;
Il punit au fond des enfers
L’ignorance invincible où lui-même il les plonge ,
Lui qui veut éclairer et sauver l’univers !
Amérique, vastes contrées,
Peuples que Dieu fit naître aux portes du soleil,
Vous, nations hyperborées,
Que l’erreur entretient dans un si long sommeil,
Serez-vous pour jamais a sa fureur livrées
Pour n’avoir pas su qu’autrefois
Dans un autre hémisphère , au fond de la Syrie }
Le fils d’un charpentier, enfanté par Marie ,
Renié par Céphas, expira sur la croix ?
Je ne reconnais point à cette indigne image
Le Dieu que je dois adorer :
Je croirais le déshonorer
Par une telle insulte et par un tel hommage.
Entends, Dieu que j’implore, entends du haut des cieux
Une voix plaintive et sincère.
Mon incrédulité ne doit pas te déplaire ;
Mon cœur est ouvert à tes yeux :
L’insensé te blasphème, et moi je te révère :
Je ne suis pas chrétien, mais c’est pour t’aimer mieux.
Cependant quel objet se présente à ma vue !
Le voila, c’est le Christ puissant et glorieux.
Auprès de lui dans une nue
L’étendard de sa mort, la croix brille a mes yeux.
Sous ses pieds triomphans la mort est abattue ;
Des portes de l’enfer il sort victorieux :
Son règne est annoncé par la voix des oracles ;
Son trône est cimenté par le sang des martyrs :
Tous les pas de ses saints sont autant de miracles ;
Il leur promet des biens plus grands que leurs désirs
Ses exemples sont saints, sa morale est divine ;
Il console en secret les cœurs qu’il illumine ;
Dans les plus grands malheurs il leur offre un appui
Et , si sur l’imposture il fonde sa doctrine,
C’est un bonheur encor d’être trompé par lui.
Entre ces deux portraits, incertaine Uranie ,
C’est à toi de chercher l’obscure vérité ,
A toi que la nature honora d’un génie
Qui seul égale ta beauté.
Songe que du Très-Haut la sagesse éternelle
A gravé de sa main dans le fond de ton cœur
La religion naturelle ;
Crois que de ton esprit la naïve candeur
Ne sera point l’objet de sa haine immortelle ;
Crois que devant son trône en tout temps, en tous lieux ,
Le cœur du juste est précieux ;
Crois qu’un bonze modeste, un dervis charitable,
Trouvent plutôt grâce à ses yeux
Qu’un janséniste impitoyable ,
Ou qu’un pontife ambitieux.
Et qu’importe en effet sous quel titre on l’implore?
Tout hommage est reçu ; mais aucun ne l’honore.
Un Dieu n’a pas besoin de nos soins assidus :
Si l’on peut l’offenser c’est par des injustices ;
Il nous juge sur nos vertus,
Et non pas sur nos sacrifices.
1726, l'Angleterre - Le 6 mars 1724, fut jouée la tragédie de "Marianne", sans succès. Le 5 septembre 1725, eut lieu à Fontainebleau le mariage du roi. Voltaire, qui venait de composer la comédie de l'Indiscret, dédiée à Mme de Prie, assista aux. fêtes de la cour et fit jouer Œdipe, Marianne, l'Indiscret devant la Reine. Le jeune auteur obtint une nouvelle pension de 1.500 livres et il touchait au but quand survint la malheureuse affaire de Rohan, son orgueil d'homme de lettres heurta celui, aristocratique, du chevalier de Rohan-Chabot qui le fit bastonné. Voltaire se retrouve de plus incarcéré à la Bastille, le 17 avril 1726 et la porte de la prison ne s'ouvrit que pour l'exil. Le 2 mai, par ordre du roi, le sieur de Condé vint prendre le prisonnier pour l'accompagner jusqu'à Calais, où il avait ordre de le voir s'embarquer.
Lorsqu'il s'embarque pour l'Angleterre en 1726, Voltaire, qui a grandi dans un milieu épris de Saint-Evremond, Bayle et Fontenelle, outre son talent de poète mondain et d'esprit satirique, ne semble préoccupé que de jouir de la vie (voir son Epître à Uranie, publiée seulement en 1732). A son retour, le poète de salon sera devenu le philosophe des Lettres Anglaises ou Lettres Philosophiques...
Le comte de Bolingbroke l'accueillit dans son domaine de Dawley (Middlessex) et le mit en relation avec des écrivains et des poètes comme Swift, John Gay et Pope. Ce dernier le reçut à Twickenham. Voltaire fut longtemps l'hôte à Wandsworth d'un riche marchand de Londres, Falkener. Le roi voulut l'indemniser d'une perte d'argent et lui envoya une somme de cent guinées. Les conversations de Bolingbroke, de Swift et d'autres libres penseurs eurent une grande influence sur le développement des idées de Voltaire. La lecture de Locke et de son Essai sur l'entendement fut pour lui une sorte d'initiation. Il aurait souhaité être présenté au réformateur de la physique, le grand Newton mais ne put qu'assister à ses funérailles, célébrées avec une pompe royale, à Westminster, en 1727. La manière dont l'Angleterre traitait ses grands hommes, la liberté qu'elle leur laissait, les honneurs qu'elle leur décernait faisaient à ses yeux un impressionnant contraste avec le régime de tracasserie et de persécution dont il avait lui-même souffert en France. Voltaire subit même dans une certaine mesure l'influence de Shakespeare: "Avec quel plaisir n'ai-je point vu à Londres votre tragédie de Jules César, qui depuis cent cinquante années, fait les délices
de votre, nation ! Je ne prétends pas assurément approuver les irrégularités barbares dont elle est remplie; il est seulement étonnant qu'il ne s'en trouve pas davantage dans un ouvrage composé dans un siècle d'ignorance, par un homme qui même ne savait pas le latin, et qui n'eut d'autre maître que son génie. Mais au milieu de tant de fautes grossières, avec quel ravissement je voyais Brutus, tenant encore un poignard teint du sang de César, assembler le peuple romain et lui parler ainsi du haut de la tribune aux harangues !... Peut être que les Français ne souffriraient pas que l'on fît paraître sur leurs théâtres un chœur composé d'artisans et de plébéiens romains, que le corps sanglant de César y fût exposé aux yeux du peuple..".
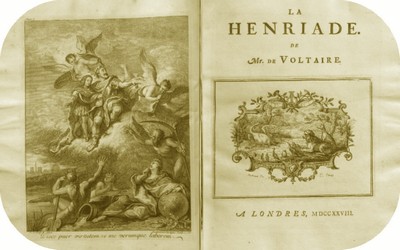
"La Henriade" - En 1728, Voltaire parvient à faire éditer son épopée, "La Henriade", grâce à une souscription menée à Londres. Remaniée, on y chante la sagesse du roi Henri IV qui met fin par son abjuration aux querelles religieuses de son temps, - "Je chante ce héros qui régna sur la France Et par droit de conquête, et par droit de naissance; Qui par de longs malheurs apprit à gouverner, Calma les factions, sut vaincre, et pardonner..." -. Henri III, roi de France, assiège Paris et lutte avec Henri de Bourbon, roi de Navarre, contre la Ligue. Le dernier des Valois envoie ce dernier demander de l'aide à la reine Elisabeth d'Angleterre et raconte à celle-ci toutes les horreurs de cette guerre religieuse, dont la Saint-Barthélémy et la mort de Coligny, l'arrogance du duc de Guise, la journée des barricades. Le chant V est consacré à Jacques Clément et à l'assassinat d'Henri III. La Discorde intervient et va aux Enfers chercher le Fanatisme, qui, empruntant les traits du duc de Guise, apparaît au jeune moine Clément, l'excite à venger l'Eglise sur le roi et lui donne une épée :" Le fanatique aveugle, et le chrétien sincère, Ont porté trop souvent le même caractère..". Le chant VII est une transposition de la descente d'Enée aux Enfers, Saint Louis envoie à Henri de Navarre le Sommeil et l'Espérance, puis il l'emmène en esprit dans le ciel, par-delà les soleils de l'univers visible, jusqu'au pied du trône de Dieu. Là sont rassemblés les hommes de toutes les races et de toutes les religions et Henri se demande un instant avec inquiétude comment Dieu peut traiter ceux qui n'ont pas connu la loi des chrétiens. Mais il se rassure en pensant que Dieu les juge seulement d'après la loi naturelle. L'Eternel, d'ailleurs, fait entendre sa voix pour défendre à Henri de Navarre de raisonner et de vouloir sonder les mystères. Le roi emporté dans l'espace, voit les portes de l'Enfer, auprès desquelles se tiennent tous les Vices. Vont ensuite défiler devant Henri tous les grands hommes du XVIIe.
Si l'épopée ne parvient pas à emporter l'adhésion des lecteurs français, on y trouve les sentiments profonds de tolérance de l'auteur et des vers sentencieux et philosophiques qui emportent par leur nouveauté. Henri IV, souverain éclairé, le siècle des Lumières s'annonce..
(Éloge d'Elisabeth et de l'Angleterre)
En voyant l'Angleterre, en secret il admire
Le changement heureux de ce puissant empire,
Où l'éternel abus de tant de sages lois
Fit longtemps le malheur et du peuple et des rois.
Sur ce sanglant théâtre où cent héros périrent,
Sur ce trône glissant dont cent rois descendirent,
Une femme, à ses pieds enchaînant les destins,
De l'éclat de son règne étonnait les humains.
C'était Elisabeth; elle dont la prudence
De l'Europe à son choix fit pencher la balance,
Et fit aimer son joug à l'Anglais indompté,
Qui ne peut ni servir, ni vivre en liberté.
Ses peuples sous son règne ont oublié leurs pertes;
De leurs troupeaux féconds leurs plaines sont couvertes,
Les guérets de leurs blés, les mers de leurs vaisseaux :
Ils sont craints sur la terre, ils sont rois sur les eaux;
Leur flotte impérieuse, asservissant Neptune,
Des bouts de l'univers appelle la fortune :
Londres, jadis barbare, est le centre des arts,
Le magasin du monde, el le temple de Mars.
Aux murs de Westminster on voit paraître ensemble
Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble,
Les députés du peuple, et les grands, et le roi,
Divisés d'intérêt, réunis par la loi;
Tous trois, membres sacrés de ce corps invincible,
Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible.
Heureux, lorsque le peuple, instruit de son devoir,
Respecte, autant qu'il doit, le souverain pouvoir!
Plus heureux, lorsqu'un roi, doux, juste et politique,
Respecte, autant qu'il doit, la liberté publique !
« Ah ! s'écria Bourbon, quand pourront les Français
Réunir, comme vous, la gloire avec la paix?
Quel exemple pour vous, monarques de la terre!
Une femme a fermé les portes de la guerre:
Et, renvoyant chez vous la discorde et l'horreur,
D'un peuple qui l'adore elle a fait le bonheur. »
(Ch. I, v. 293-328.)
1726-1728 - Si Voltaire n'était pas encore en état d'assimiler dans ces années la science et la philosophie anglaises, il fit tout de même l'expérience d'une civilisation, dont il sentit et voulut définir ce qu'il appellera l'esprit ou le génie ; il comprit l'importance pour la pensée et la littérature françaises de connaître ces Anglais, avec qui le Régent avait noué alliance ; et il réunit une masse de notations, d'idées, de questions, de problèmes, d'anecdotes, dont il ne cessera de tirer parti pendant tout le reste de son existence. Les "Lettres philosophiques, ou Lettres écrites de Londres sur les Anglais et autres sujets", conçues avant la fin de son séjour en Angleterre, parurent en anglais dès 1733, en français en 1734...
1728-1734 - De son retour en France (1728) à son installation en Lorraine, à Cirey (1734) chez Mme du Châtelet (Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, 1706-1749), Voltaire vécut quelques années tiraillé entre le monde et la retraite, le succès et les persécutions, la publication des œuvres achevées et la mise en chantier d'œuvres nouvelles ; il fit applaudir "Brutus" (décembre 1730) et "Zaïre" (août 1732), tragédie écrite en trois semaines qui obtint un immense succès, mais son "Histoire de Charles XII" fut saisie (janvier 1731), son "Temple du goût" souleva des protestations violentes (janvier 1733), ses "Lettres philosophiques", longuement revues et auxquelles il avait ajouté les remarques « Sur les Pensées de M. Pascal », furent brûlées, et l'auteur dut donc se réfugier en Lorraine pour échapper à une lettre de cachet (juin 1734)....

1731 - "Histoire de Charles XII"
Charles XII était mort en 1718. Voltaire, alors âgé de vingt-quatre ans, avait bien des fois entendu parler de celui qu'où appelait le « héros du Nord », et suivi avec curiosité le formidable duel de ce roi avec Pierre le Grand. La destinée de Charles XII est totalement dramatique : avec ses 9.000 Suédois, il bat 60.000 Russes à la bataille de Narva et parcourt en vainqueur les États de son adversaire; puis, battu à Pultava, se réfugie chez les Turcs, à Bender; qui enfin, après bien des aventures extraordinaires, après avoir subi un siège dans une maison et repoussé une armée avec quelques serviteurs, traverse toute l'Europe sous un déguisement et vient mourir mystérieusement au siège d'une ville obscure. Voltaire en fait un récit qui se lit comme un roman, mais avec le souci d'utiliser faits et documents, allant jusqu'à écrire à un grand nombre de personnages, comme le maréchal de Saxe, le roi Stanislas, la duchesse de Marlborough pour confronter les témoignages. Si l'Histoire de Charles XII, roi de Suède (1682-17I8), respecte la tradition des récits militaires, déjà s'annonce le "Siècle de Louis XIV" et le projet non plus de faire une histoire des rois, mais d'une nation, en incluant les moeurs, les institutions, les arts...
(Portrait de Charles XII)
"Ainsi périt, à l'âge de trente-six ans et demi, Charles XII, roi de Suède, après avoir éprouvé ce que la prospérité a de plus grand et ce que l'adversité a de plus cruel, sans avoir été annihilé par l'une, ni ébranlé un moment par l'autre. Presque toutes ses actions, jusqu'à celles de sa vie privée et unie, ont été bien loin au delà du vraisemblable. C'est peut-être le seul de tous les hommes, et jusqu'ici le seul de tous les rois, qui ait vécu sans faiblesses ; il a porté toutes les vertus des héros à un excès où elles sont aussi dangereuses que les vices opposés. Sa fermeté devenue opiniâtre, fit ses malheurs dans l'Ukraine et le retint cinq ans en Turquie; sa libéralité, dégénérant en profusion, a ruiné la Suède; son courage, poussé jusqu'à la témérité, a causé sa mort; sa justice a été quelquefois jusqu'à la cruauté; et, dans les dernières années, le maintien de son autorité approchait de la tyrannie. Ses grandes qualités, dont une seule eût pu immortaliser un autre prince, ont fait le malheur de son pays.
ll n'attaqua jamais personne ,mais il ne fut pas aussi prudent qu'implacable dans ses vengeances. ll a été le premier qui ait vu l'ambition d'être conquérant sans avoir l'envie d'agrandir ses Etats; il voulait gagner des empires pour les donner. Sa passion pour la gloire, pour la guerre et pour la vengeance, l'empêcha d'être bon politique, qualité sans laquelle on n'a jamais vu du conquérant. Avant la bataille et après la victoire, il n'avait que de la modestie ; après la défaite, que de la fermeté: dur pour les autres comme pour lui-même, comptant pour rien la peine et la vie de ses sujets, aussi bien que la sienne; homme unique plutôt que grand homme; admirable plutôt qu'à imiter. Sa vie doit apprendre aux rois combien un gouvernement pacifique et heureux est au-dessus de tant de gloire. (Voltaire, Charles XII, livre Vlll.)

1732 - "Zaïre", tragédie en cinq actes
"Zaïre" et "Mérope" (1743) sont les deux plus connues de la vingtaine de tragédies que Voltaire écrivit, "OEdipe" en 1718 étant celle qui marque son ascendant sur la tragédie du XVIIIe siècle , et "Zaïre" la plus célèbre : Voltaire avait tenté de retrouver dans cette dernière pièce toute la simplicité grecque; elle porte sur l'amour de Philoctète pour Jocaste et connut un grand succès. " Zaïre, écrit Voltaire, est la première pièce de théâtre dans laquelle j'aie osé m'abandonner à toute la sensibilité de mon cœur : c'est la seule tragédie tendre que j'aie faite. Je croyais, dans l'âge même des passions les plus vives, que l'amour n'était point fait pour le théâtre tragique. Je ne regardais cette faiblesse que comme un défaut charmant qui avilissait l'art des Sophocle. Les connaisseurs qui se plaisent plus à la douceur élégante de Racine qu'à la force de Corneille me paraissaient ressembler aux curieux qui préfèrent les nudités du Corrège au chaste et noble pinceau de Raphaël. Le public qui fréquente les spectacles est aujourd'hui plus que jamais dans le goût du Corrège. Il faut de la tendresse et du sentiment; c'est même ce que les acteurs jouent le mieux...."
Orosmane. soudan de Jérusalem. aime sa captive Zaïre. Le chevalier français Nérestan, parti depuis deux ans aux fins de se procurer la rançon de certains prisonniers, revient auprès du sultan qui généreusement rend la liberté à ses captifs, sauf à Zaïre qu`il veut épouser, et au vieux Lusignan, un descendant des princes de Jérusalem. Celui-ci, libéré grâce aux prières de
Zaïre, découvre que la belle esclave est sa fille et que Nérestan est son fils. Il se plaint douloureusement du sort fait à Zaïre qui va épouser un infidèle, et tente de la persuader de renoncer à cette union. L'amour et la religion se partagent le cœur de la jeune fille ; avant de s'engager définitivement, elle a une entrevue avec son frère. Orosmane les surprend et, dans un accès de jalousie, poignarde l'innocente Zaïre. Puis, prenant conscience de son erreur et se tue sur le corps de sa victime, après avoir ordonné la mise en liberté de tous les chrétiens. Parmi les morceaux de choix, la célèbre adjuration de Lusignan dont la puissance émotionnelle semble puisée aux sources de la conviction et de la ferveur. Outre le christianisme, on voit que le théâtre de Shakespeare a inspiré Voltaire, c'est au théâtre anglais, dit-il, qu`il doit «la hardiesse qu'il a pris de mettre sur la scène les noms de nos rois et de nos anciennes familles: l'action en effet prétend ressusciter l`histoire. elle se situe au temps de Saint Louis. Mais la dette de l`auteur s`étend plus loin et sans doute a-t-il puisé dans Othello quelques éléments de Zaïre...
Acte II, scène III
LUSIGNAN - Approchez, mes enfants.
NÉRESTAN - Moi, votre fils !
ZAÏRE - Seigneur !
LUSIGNAN - Heureux jour qui m'éclaire ! Ma fille, mon cher fils ! embrassez votre père.
CHATILLON - Que d'un bonheur si grand mon cœur se sent toucher !
LUSIGNAN
De vos bras, mes enfants, je ne puis m'arracher.
Je vous revois enfin, chère et triste famille,
Mon fils, digne héritier... vous... hélas ! vous, ma fille,
Dissipez mes soupçons, ôtez-moi cette horreur,
Ce trouble qui m'accable au comble du bonheur.
Toi qui seul as conduit sa fortune et la mienne,
Mon Dieu qui me la rends, me la rends-tu chrétienne ?
Tu pleures, malheureuse, et tu baisses les yeux !
Tu te tais ! je t'entends! ô crime! ô justes cieux !
ZAÏRE
Je ne puis vous tromper : sous les lois d'Orosmane...
Punissez votre fille. .. elle était musulmane»
LUSIGNAN
Que la foudre en éclats ne tombe que sur moi!
Ah! mon fils! à tes mots j'eusse expiré sans loi.
Mon Dieu! j'ai combattu soixante ans pour la gloire;
J'ai vu tomber ton temple et périr ta mémoire;
Dans un cachot affreux abandonné vingt ans,
Mes larmes t'imploraient pour mes tristes enfants :
El lorsque ma famille est par toi réunie,
Quand je trouve une fille, elle est ton ennemie !
Je suis bien malheureux... C'est ton père, c'est moi,
C'est ma seule prison qui t'a ravi ta foi.
Ma fille, tendre objet de mes dernières peines,
Songe au moins, songe au sang qui coule dans tes veines.
C'est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi,
C'est le sang des héros, défenseurs de ma loi;
C'est le sang des martyrs... O fille encor trop chère !
Connais-tu ton destin? sais-tu quelle est ta mère?
Sais-tu bien qu'à l'instant que son flanc mit au jour
Ce triste et dernier fruit d'un malheureux amour,
Je la vis massacrer par la main forcenée,
Par la main des brigands à qui tu t'es donnée!
Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux,
T'ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieux :
Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes,
Pour toi, pour l'univers, est mort en ces lieux mêmes ;
En ces lieux où mon bras le servit tant de fois,
En ces lieux où son sang te parle par ma voix.
Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres:
Tout annonce le Dieu qu'ont vengé tes ancêtres.
Tourne les yeux, sa tombe est près de ce palais;
C'est ici la montagne où, lavant nos forfaits,
Il voulut expirer sous les coups de l'impie ;
C'est là que de sa tombe il rappela sa vie.
Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu,
Tu n'y peux faire un pas, sans y trouver ton Dieu ;
Et tu n'y peux rester sans renier ton père,
Ton honneur qui te parle, et ton Dieu qui t'éclaire.
.le te vois dans mes bras, et pleurer, et frémir;
Sur ton front pâlissant Dieu met le repentir:
Je vois la vérité dans ton cœur descendue ;
Je retrouve ma fille après l'avoir perdue;
Et je reprends ma gloire et ma félicité
En dérobant mon sang à l'infidélité.
NERESTAN
Je revois donc ma sœur!... Et son âme...
ZAÏRE
Ah ! mon père ! Cher auteur de mes jours, parlez, que dois-je faire?
LUS1GNAN
M'ôter, par un seul mot, ma honte et mes ennuis,
Dire : « Je suis chrétienne. »
ZAÏRE
Oui... seigneur... je le suis.
LUSIGNAN
Dieu, reçois son aveu du sein de ton empire !
Epître dédicatoire à M. Falkener, négociant anglais (1733), suite à l'envoi de Zaïre...
"Vous êtes Anglais, mon cher ami, et je suis né en France ; mais ceux qui aiment les arts sont tous concitoyens. Les honnêtes gens qui pensent ont à peu près les mêmes principes, et ne composent qu'une république : ainsi il n'est pas plus étrange de voir aujourd'hui une tragédie française dédiée à un Anglais, ou à un Italien, que si un citoyen d'Ephèse ou d'Athènes avait autrefois adressé son ouvrage à un Grec d'une autre ville. Je vous offre donc cette tragédie comme à mon compatriote dans la littérature, et comme à mon ami intime.
Je jouis en même temps du plaisir de pouvoir dire à ma nation de quel œil les négociants sont regardés chez vous; quelle estime on sait avoir en Angleterre pour une profession qui fait la grandeur de l'État; et avec quelle supériorité quelques-uns d'entre vous représentent leur patrie dans le parlement, et sont au rang des législateurs.
Je sais bien que cette profession est méprisée de nos petits-maîtres ; mais vous savez aussi que nos petits-maîtres et les vôtres sont l'espèce la plus ridicule qui rampe avec orgueil sur la surface de la terre.
Une raison encore qui m'engage à m'entretenir de belles-lettres avec un Anglais plutôt qu'avec un autre, c'est votre heureuse liberté de penser ; elle en communique à mon esprit ; mes idées se trouvent plus hardies avec vous...."

1733 - "Le Temple du Goût"
"Tous les honnêtes gens qui pensent sont critiques, les malins sont satiriques, les pervers font des libelles; et ceux qui ont fait avec moi le Temple du Goût ne sont assurément ni malins ni méchants..." - Le Temple du Goût est réputé comme l'un des plus singuliers des ouvrages de Voltaire qui, sous une forme apaisée, dresse un ensemble de jugements sur les auteurs du dix-septième siècle. La plupart de ces arrêts sont ratifiés par la postérité, mais de bons esprits furent choqués des critiques qui toujours accompagnent et atténuent les éloges décernés même aux plus grands génies. La vivacité de ces critiques indisposa ses contemporains et lui valurent de nombreux ennemis. Bien avant les chapitres du Siècle de Louis XIV sur les Beaux-Arts, nous trouvons ici déjà les formules qu'il appliquera aux écrivains et artistes de l'époque précédente...
Sur la liberté qu'il convient de laisser aux écrivains (20 juin 1733. Lettre à un Premier Commis).
"Puisque vous êtes, monsieur, à portée de rendre service aux belles lettres, ne rognez pas de si près les ailes à nos écrivains, et ne faites pas des volailles de basse-cour de ceux qui, en prenant l'essor, pourraient devenir des aigles; une liberté honnête élève l'esprit, et l'esclavage le fait ramper. S'il y avait eu une inquisition littéraire à Rome, nous n'aurions aujourd'hui ni Horace, ni Juvénal, ni les œuvres philosophiques de Cicéron. Si Milton, Dryden, Pope et Locke n'avaient pas été libres, l'Angleterre n'aurait eu ni des poètes ni des philosophes : il y a je ne sais quoi de turc à proscrire l'imprimerie ; et c'est la proscrire que la trop gêner. Contentez-vous de réprimer sévèrement les libelles diffamatoires, parce que ce sont des crimes ; mais tandis qu'on débite hardiment des recueils de ces infâmes Calottes et tant d'autres productions qui méritent l'horreur et le mépris, souffrez au moins que Bayle entre en France, et que celui qui fait tant d'honneur à sa patrie n'y soit pas de contrebande.
Vous me dites que les magistrats qui régissent la douane de la littérature se plaignent qu'il y a trop de livres. C'est comme si le prévôt des marchands se plaignait qu'il y eût à Paris trop de denrées : en achète qui veut. Une immense bibliothèque ressemble à la ville de Paris, dans laquelle il y a près de huit cent mille hommes : vous ne vivez pas avec tout ce chaos ; vous y choisissez quelque société, et vous en changez. On traite les livres de même : on prend quelques amis dans la foule. Il y aura sept ou huit mille controversistes, quinze ou seize mille romans, que vous ne lirez point ; une foule de feuilles périodiques que vous jetterez au feu après les avoir lues. L'homme de goût ne lit que le bon, mais l'homme d'État permet le bon et le mauvais.
Les pensées des hommes sont devenues un objet important de commerce. Les libraires hollandais gagnent un million par an, parce que les Français ont eu de l'esprit. Un roman médiocre est, je le sais bien, parmi les livres ce qu'est dans le monde un sot qui veut avoir de l'imagination. On s'en moque, mais on le souffre. Ce roman fait vivre et l'auteur qui l'a composé, et le libraire qui le débite, et le fondeur, et l'imprimeur, et le papetier, et le colporteur, et le marchand de mauvais vin, à qui tous ceux-là portent leur argent. L'ouvrage amuse encore, deux ou trois heures, quelques femmes avec lesquelles il faut de la nouveauté en livres, comme en tout le reste. Ainsi, tout méprisable qu'il est, il a produit deux choses importantes : du profit et du plaisir.
Les spectacles méritent encore plus d'attention.
... Je regarde la tragédie et la comédie comme des leçons de vertu, de raison et de bienséance. Corneille, ancien Romain parmi les Français, a établi une école de grandeur d'âme ; et Molière a fondé celle de la vie civile. Les génies français formés par eux appellent du fond de l'Europe les étrangers qui viennent s'instruire chez nous et qui contribuent à l'abondance de Paris. Nos pauvres sont nourris du produit de ces ouvrages, qui nous soumettent jusqu'aux nations qui nous haïssent. Tout bien pesé, il faut être ennemi de sa patrie pour condamner nos spectacles. Un magistrat qui, parce qu'il a acheté cher un office de judicature, ose penser qu'il ne lui convient pas de voir Cinna, montre beaucoup de gravité et bien peu de goût.
Il y aura toujours dans notre nation polie de ces Ames qui tiendront du Goth et du Vandale; je ne connais pour vrais Français que ceux qui aiment les arts et les encouragent. Ce goût commence, il est vrai, à languir parmi nous ; nous sommes des sybarites. Nous jouissons des veilles des grands hommes qui ont travaillé pour nos plaisirs et pour ceux du siècle à venir, comme nous recevons les productions de la nature; on dirait qu'elles nous sont dues. Il n'y a que cent ans que nous mangions du gland; les Triptolèmes qui nous ont donné le froment le plus pur nous sont indifférents ; rien ne réveille cet esprit de nonchalance pour les grandes choses, qui se mêle toujours avec notre vivacité pour les petites.
Nous mettons tous les ans plus d'industrie et plus d'invention dans nos tabatières et dans nos colifichets que les Anglais n'en ont mis à se rendre les maîtres des mers, à faire monter l'eau par le moyen du feu et à calculer l'aberration de la lumière. Les anciens Romains élevaient des prodiges d'architecture pour faire combattre des bêtes : et nous n'avons pas su depuis un siècle bâtir seulement une salle passable pour y faire représenter les chefs- d'œuvre de l'esprit humain. Le centième de l'argent des cartes suffirait pour avoir des salles de spectacle plus belles que le théâtre de Pompée; mais quel homme dans Paris est animé de l'amour du bien public? On joue, on soupe, on médit, on fait de mauvaises chansons, et on s'endort dans la stupidité, pour recommencer le lendemain son cercle de légèreté et d'indifférence. Vous, monsieur, qui avez au moins une petite place dans laquelle vous êtes à portée de donner de bons conseils, tâchez de réveiller cette léthargie barbare, et faites, si vous pouvez, du bien aux lettres, qui en ont tant fait à la France."
1734? C'est en France, le temps de la lutte contre le jansénisme soutenu par les Parlements. En littérature, Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains (1734), Rollin, Histoire ancienne et Histoire romaine (1730-1738), l'abbé Prévost, Manon Lescaut (1735), Marivaux, Marianne (1731-1741), le Paysan parvenu (1735), le Jeu de l'Amour et du Hasard (1734); La Chaussée, le Préjugé à la mode (1735), l'abbé Desfontaines contre Voltaire, la mort de Mme de Lambert (1733), le Salon de Mme de Tencin. En peinture, Boucher, Van Loo, Coypel, Nattier. En musique, Rameau et ses Indes galantes (1735)....
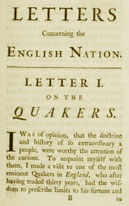
1734 - "Lettres philosophiques"
Il rédigea en anglais les "Letters Concerning the English Nation" (1733), où l'éloge des mœurs politiques anglaises était pour lui une façon de dénoncer les abus du despotisme monarchique français et le scandale de l'intolérance et de l'oppression qui régnaient dans la société française. Sur les vingt-quatre lettres que contenait l'ouvrage sous sa forme primitive, les sept premières roulaient sur la religion, les trois suivantes sur le régime politique de l'Angleterre. La lettre XI traitait de l'inoculation ou de l'insertion de la petite vérole. Puis venaient six lettres (XII-XVI1) sur la philosophie anglaise. Les sept dernières (XVIII-XXIV) avaient pour objet la littérature et la condition sociale des gens de lettres. Voltaire abordait tous ces sujets d'une main très légère, avec un parti pris d'ironie presque perpétuelle, tantôt aiguisée et malicieuse, tantôt dissimulée sous une apparence d'inoffensive naïveté. Il passait en revue les différents aspects des sectes protestantes : quakers, presbytériens, anglicans, antitrinitaires. Tout était pour lui matière à plaisanter; mais, tout en riant de ce qui pouvait étonner un Français dans les manifestations de la pensée religieuse à l'étranger, il ne manquait pas de faire à chaque instant des comparaisons avec le clergé français ou avec le catholicisme lui-même et l'on peut dire que c'était surtout eux qui étaient visés et atteints, par les traits en apparence dirigés contre les différentes sectes anglaises. En 1734, il traduisit et remania les Lettres anglaises pour les augmenter : elles furent publiées de nouveau, sous le titre de Lettres philosophiques. L'ouvrage devint un véritable manifeste des Lumières, parce qu'il traitait de la liberté politique et religieuse, célébrait la prospérité et le progrès comme les avancées de la science, parce qu'il exposait la doctrine du matérialisme de Locke, tout en affirmant (à propos d'une lecture des Pensées de Pascal) une foi optimiste en la nature humaine. Le livre fut condamné au feu par le Parlement comme "propre à inspirer le libertinage le plus dangereux pour la religion et la société civile", et Voltaire dut s'enfuir en Lorraine....
Les Lettres I à VII portent sur les religions en Angleterre. Sur les Quakers, leur histoire, leurs mœurs, leurs croyances, les lettres I à IV, les juge ridicule mais sympathique, par leur droiture, leur humilité, leur simplicité, leur tolérance, "point de christianisme sans une révélation immédiate", conception assez proche du déisme, qui élimine la théologie et rend inutile la hiérarchie ecclésiastique. Les Anglicans et Presbytériens, lettres V et VI, sont suspects d'ambitions temporelles ou d'une rigidité excessive. La Lettre VII porte Sur les Sociniens, ou Ariens, ou Anti- Trinitaires.
LETTRE I - Une visite à un quaker.
"J'ai cru que la doctrine et l'histoire d'un peuple si extraordinaire, méritaient la curiosité d'un homme raisonnable. Pour m'en instruire, j'allai trouver un des plus célèbres quakers d'Angleterre, qui, après avoir été trente ans dans le commerce, avait su mettre des bornes à sa fortune et à ses désirs, et s'était retiré dans une campagne auprès de Londres. Je fus le chercher dans sa retraite : c'était une maison petite, mais bien bâtie, pleine de propreté sans ornement. Le quaker était un vieillard frais qui n'avait jamais connu les passions ni l'intempérance ; je n'ai point vu eu ma vie d'air plus noble ni plus engageant que le sien. Il était vêtu, comme tons ceux de sa religion, d'un habit sans plis dans les côtés, et sans boutons sur les poches ni sur les manches, et portait un grand chapeau à bords rabattus comme nos ecclésiastiques. Il me reçut avec son chapeau sur la tête, et s'avança vers moi sans faire la moindre inclination de corps; mais il y avait plus de politesse dans l'air ouvert et humain de son visage qu'il n'y eu a dans l'usage de tirer une jambe derrière l'autre, et de porter à la main ce qui est fait pour couvrir la tête. «Ami, me dit-il, je sais que tu es étranger; si je puis t'être de quelque utilité, tu n'as qu'à parler. — Monsieur, lui dis-je, en me courbant le corps et en glissant un pied vers lui, selon notre coutume, je me flatte que ma juste curiosité ne vous déplaira pas, et que vous voudrez bien me faire l'honneur de m'instruire de votre religion. — Les gens de ton pays, me répondit-il, font trop de compliments et de révérences; mais je n'en ai encore vu aucun qui ait eu la même curiosité que toi. Entre, et dînons d'abord ensemble.» Je fis encore quelques mauvais compliments, parce qu'on ne se défait pas de ses habitudes tout d'un coup ; et après un repas sain et frugal, qui commença et finit par une prière à Dieu, je me mis à interroger mon homme..."
Les positions de Voltaire vont exprimées : déisme, condamnation des luttes religieuses, tolérance assurée pour la multiplicité des sectes, subordination des religions au gouvernement, garanties d'indépendance et de paix sociale. "S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, son despotisme serait à craindre ; s'il y en avait deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix heureuses" (VI)...
La Lettre VIII, Sur le Parlement, vante l'équilibre du régime anglais qui assure la paix religieuse et la liberté des citoyens....
".. Voici une différence plus essentielle entre Rome et l'Angleterre, qui met tout l'avantage du côté de la dernière : c'est que le fruit des guerres civiles de Rome a été l'esclavage, et celui des troubles d'Angleterre, la liberté. La nation anglaise est la seule de la terre qui soit parvenue à régler le pouvoir des rois en leur résistant, et qui d'efforts en efforts ait enfin établi ce gouvernement sage où le prince, tout-puissant pour faire du bien, a les mains liées pour faire le mal ; où les seigneurs sont grands sans insolence et sans vassaux, et où le peuple partage le gouvernement sans confusion.
La chambre des pairs et celle des communes sont les arbitres de la nation, le roi est le surarbitre. Cette balance manquait aux Romains: les grands et le peuple étaient toujours en division à Rome, sans qu'il y eût un pouvoir mitoyen qui pût les accorder. Le sénat de Rome, qui avait l'injuste et punissable orgueil de ne vouloir rien partager avec les plébéiens, ne connaissait d'autre secret, pour les éloigner du gouvernement, que de les occuper toujours dans les guerres étrangères. Ils regardaient le peuple comme une bête féroce qu'il fallait lâcher sur leurs voisins de peur qu'elle ne dévorât ses maîtres ; ainsi le plus grand défaut du gouvernement des Romains en fit des conquérants; c'est parce qu'ils étaient malheureux chez eux qu'ils devinrent les maîtres du monde, jusqu'à ce qu'enfin leurs divisions les rendirent esclaves.
Le gouvernement d'Angleterre n'est point fait pour un si grand éclat, ni pour une fin si funeste ; son but n'est point la brillante folie de faire des conquêtes, mais d'empêcher que ses voisins n'en fassent ; ce peuple n'est pas seulement jaloux de sa liberté, il l'est encore de celle des autres. Les Anglais étaient acharnés contre Louis XIV, uniquement parce qu'ils lui croyaient de l'ambition. Ils lui ont fait la guerre de gaieté de cœur, assurément sans aucun intérêt. Il en a coûté sans doute pour établir la liberté en Angleterre; c'est dans des mers de sang qu'on a noyé l'idole du pouvoir despotique ; mais les Anglais ne croient point avoir acheté trop cher leurs lois. Les autres nations n'ont pas eu moins de troubles, n'ont pas versé moins de sang qu'eux ; mais ce sang qu'elles ont répandu pour la cause de leur liberté n'a fait que cimenter leur servitude... Les Français pensent que le gouvernement de cette île est plus orageux que la mer qui l'environne, et cela est vrai ; mais c'est quand le roi commence la tempête, c'est quand il veut se rendre le maître du vaisseau dont il n'est que le premier pilote..."
La Lettre IX Sur le Gouvernement retrace l'évolution politique de l'Angleterre, tour à tour soumise à la tyrannie des barons, des évêques et du Pape : "Le Peuple, la plus nombreuse, la plus vertueuse même, et par conséquent la plus respectable partie des hommes, composée de ceux qui étudient les lois et les sciences, des négociants, des artisans, des laboureurs enfin, qui exercent la plus noble et la plus méprisée des professions, en un mot tout ce qui n'était point tyran ; le Peuple, dis-je, était regardé par eux comme des animaux au-dessous de l'homme... Le plus grand nombre des hommes était en Europe ce qu'ils sont encore en plusieurs endroits du Nord, serf d'un seigneur, espèce de bétail qu'on vend et qu'on achète avec la terre. Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il était horrible que le grand nombre semât et que le petit nombre recueillît ; et n'est-ce pas un bonheur pour le genre humain que l'autorité de ces petits brigands ait été éteinte en France par la puissance légitime de nos Rois, et en Angleterre par la puissance légitime des Rois et du Peuple?"
La Lettre X Sur le Commerce vante l'esprit pratique des Anglais qui doivent au commerce leur richesse et leur puissance politique. "Le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour ; de là s'est formée la grandeur de l'État. C'est le commerce qui a établi peu à peu les forces navales par qui les Anglais sont les maîtres des mers. Ils ont à présent près de deux cents vaisseaux de guerre. La postérité apprendra peut-être avec surprise qu'une petite île, qui n'a de soi-même qu'un peu de plomb, de l'étain, de la terre à foulon et de la laine grossière, est devenue par son commerce assez puissante pour envoyer, en 1723, trois flottes à la fois en trois extrémités du monde, l'une devant Gibraltar conquise et conservée par ses armes, l'autre à Portobello, pour ôter au roi d'Espagne la jouissance des trésors des Indes, et la troisième dans la mer Baltique, pour empêcher les puissances du Nord de se battre. Quand Louis XIV faisait trembler l'Italie, et que ses armées, déjà maîtresses de la Savoie et du Piémont, étaient prêtes de prendre Turin, il fallut que le prince Eugène marchât du fond de l'Allemagne au secours du duc de Savoie ; il n'avait point d'argent, sans quoi on ne prend ni ne défend les villes ; il eut recours à des marchands anglais: en une demi-heure de temps on lui prêta cinquante millions. Avec cela il délivra Turin, battit les Français, et écrivit à ceux qui avaient prêté cette somme ce petit billet : "Messieurs, j'ai reçu votre argent, et je me flatte de l'avoir employé à votre satisfaction".
Tout cela donne un juste orgueil à un marchand anglais et fait qu'il ose se comparer, non sans quelque raison, un citoyen romain. Aussi le cadet d'un pair du royaume ne dédaigne point le négoce. Milord Townshend, ministre d'État, a un frère qui se contente d'être marchand dans la Cité. Dans le temps que milord Oxford gouvernait l'Angleterre, son cadet était facteur à Alep, d'où il ne voulut pas revenir et où il est mort. Cette coutume, qui pourtant commence trop à se passer, paraît monstrueuse à des Allemands entêtés de leurs quartiers; ils ne sauraient concevoir que le fils d'un pair d`Angleterre ne soit qu'un riche et puissant bourgeois, au lieu qu'en Allemagne tout est prince ; on a vu jusqu'à trente altesses du même nom n'ayant pour tout bien que des armoiries et de l'orgueil.
En France est marquis qui veut ; et quiconque arrive à Paris du fond d'une province avec de l'argent à dépenser, et un nom en ac ou en ille, peut dire : "Un homme comme moi, un homme de ma qualité", et mépriser souverainement un négociant. Le négociant entend lui-même parler si souvent avec mépris de sa profession, qu'il est assez sot pour en rougir ; je ne sais pourtant lequel est le plus utile à un État, ou un seigneur bien poudré qui sait précisément à quelle heure le roi se lève, à quelle heure il se couche, et qui se donne des airs de grandeur en jouant le rôle d'esclave dans l'antichambre d'un ministre, ou un négociant qui enrichit son pays, donne de son cabinet des ordres à Surate et au Caire, et contribue au bonheur du monde".
La Lettre XI montre que, moins routiniers que les Français, les Anglais pratiquent avec succès l'inoculation de la petite vérole. La Lettre XII dresse un Eloge de Bacon, "le père de la philosophie expérimentale". Dans la Lettre XIII, Voltaire expose la philosophie de Locke qu'il place bien au-dessus de celle de Descartes. Locke a eu en effet le mérite de se détourner des systèmes métaphysiques pour s'en tenir à l'expérience , ne croyant que ce qu'il pouvait vérifier, ruinant la théorie cartésienne des idées innées et établissant "que toutes nos idées nous viennent des sens ". Et Voltaire admet avec Locke la possibilité de la nature matérielle de l'âme...
Les Lettres XIV à XVII sont consacrées à Newton, à son système de l'attraction, à ses découvertes en optique, au calcul infinitésimal. Voltaire estime Newton supérieur à Descartes, dont la méthode a mis cependant les savants «sur la voie de la vérité». Les Lettres XVIII à XXIV concernent la tragédie et la comédie, passionné de théâtre, il y parle de Shakespeare, qu'il admire mais qui le déconcerte, et de poètes, comme Pope. Et la Lettre XXIII rappelle "la considération qu'on doit aux gens de lettres", se souvient-il sans doute du refus par Louis XV de la dédicace de la Henriade, qui fut dédiée par la suite à la reine d*Angleterre, de l'insolence du chevalier de Rohan, de ses deux emprisonnements...
La Lettre XXV, "Remarques sur les Pensées de Pascal", mérite que l'on s' arrête, Voltaire s'attaquera toute sa vie à Pascal, lui reprochant d'égarer l'être humain dans la métaphysique et de le dégoûter de la vie terrestre. Pascal considérait que le "divertissement" nous détournait de la méditation, pour Voltaire "n'être point occupé et n'exister pas est la même chose pour l'homme" : "L'homme est né pour l'action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas". Pascal détourne l'homme de vivre «selon sa nature»...
"Je vous envoie les remarques critiques que j'ai faites depuis longtemps sur les Pensées de M. Pascal. Ne me comparez point ici, je vous prie, à Ezéchias qui voulut faire brûler tous les livres de Salomon. Je respecte le génie et l'éloquence de M. Pascal ; mais plus je les respecte, plus je suis persuadé qu'il aurait lui-même corrigé beaucoup de ces Pensées, qu'il avait jetées au hasard sur le papier pour les examiner ensuite : et c'est en admirant son génie que je combats quelques-unes de ses idées. Il me paraît qu'en général l'esprit dans lequel M. Pascal écrivit ces Pensées était de montrer l'homme dans un jour odieux ; il s'acharne à nous peindre tous méchants et malheureux ; il écrit contre la nature humaine à peu près comme il écrivait contre les jésuites. Il impute à l'essence de notre nature ce qui n'appartient qu'à certains hommes : il dit éloquemment des injures au genre humain. J'ose prendre le parti de l'humanité contre ce misanthrope sublime ; j'ose assurer que nous ne sommes ni si méchants ni si malheureux qu'il le dit. Je suis de plus très persuadé que s'il avait suivi, dans le livre qu'il méditait, le dessein qui paraît dans ses Pensées, il aurait fait un livre plein de paralogismes éloquents et de faussetés admirablement déduites. Je crois même que tous ces livres qu'on a faits depuis peu pour prouver la religion chrétienne, sont plus capables de scandaliser que d'édifier. Ces auteurs prétendent-ils en savoir plus que Jésus-Christ et ses apôtres? C'est vouloir soutenir un chêne en l'entourant de roseaux; on peut écarter ces roseaux inutiles sans craindre de faire tort à l'arbre.."
Toute interrogation relative à l'être humain et à sa condition semble ne pouvoir échapper à la question du péché originel, l'être humain ne saurait être approché sans évoquer le dogme de la chute originelle que Pascal prétend établir en raison. Un mystère n'est jamais une explication, et l'être humain ne peut-il être considéré comme ce qu'il est sans faire intervenir les notions de péché et de chute...
(III) "Est-ce raisonner que de dire: l'homme est inconcevable sans ce mystère inconcevable ? Pourquoi vouloir aller plus loin que l'Écriture? n'y a-t-il pas de la témérité à croire qu'elle a besoin d'appui, et que ces idées philosophiques peuvent lui en donner2? Qu'aurait répondu M. Pascal à un homme qui lui aurait dit : "Je sais que le mystère du péché originel est l'objet de ma foi et non de ma raison. ]e conçois fort bien sans ce mystère ce que c'est que l'homme... L'homme n'est point une énigme comme vous vous le figurez pour avoir le plaisir de la deviner. L'homme paraît être à sa place dans la nature, supérieur aux animaux, auxquels il est semblable par les organes ; inférieur à d'autres êtres, auxquels il ressemble probablement par la pensée. Il est comme tout ce que nous voyons, mêlé de mal et de bien, de plaisir et de peine. Il est pourvu de passions pour agir, et de raison pour gouverner ses actions. Si l'homme était parfait, il serait Dieu, et ces prétendues contrariétés que vous appelez contradictions sont les ingrédients nécessaires qui entrent dans le composé de l'homme, qui est ce qu'il doit être." Voilà ce que la raison peut dire ; ce n'est donc point la raison qui apprend aux hommes la chute de la nature humaine ; c'est la foi seule à laquelle il faut avoir recours...."
Voltaire cite alors une lettre de son ami Falkener qui ignore toute angoisse métaphysique : «En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, et ces contrariétés étonnantes qui se découvrent dans sa nature, en regardant tout l'univers muet, et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il est venu y faire, ce qu'il deviendra en mourant, rentre en effroi comme un homme qu'on aurait emporté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est et sans avoir aucun moyen d'en sortir ; et sur cela j'admire comment on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état..."
"Pour moi , quand je regarde Paris ou Londres, je ne vois aucune raison pour entrer dans ce désespoir dont parle M. Pascal ; je vois une ville qui ne ressemble en rien à une île déserte, mais peuplée, opulente, policée, et où les hommes sont heureux autant que la nature humaine le comporte. Quel est l'homme sage qui sera plein de désespoir parce qu'il ne sait pas la nature de sa pensée, parce qu'il ne connaît que quelques attributs de la matière, parce que Dieu ne lui a pas révélé ses secrets ? Il faudrait autant se désespérer de n'avoir pas quatre pieds et deux ailes. Pourquoi nous faire horreur de notre être? Notre existence n'est point si malheureuse qu'on veut nous le faire accroire. Regarder l'univers comme un cachot, et tous les hommes comme des criminels qu'on va exécuter, est l'idée d'un fanatique. Croire que le monde est un lieu de délices où l'on ne doit avoir que du plaisir, c'est la rêverie d'un sybarite. Penser que la terre, les hommes et les animaux sont ce qu'ils doivent être dans l'ordre de la Providence est, je crois, d'un homme sage.
(X) "S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui et non les créatures." ? Il faut aimer, et très tendrement, les créatures ; il faut aimer sa patrie, sa femme, son père, ses enfants; et il faut si bien les aimer que Dieu nous les fait aimer malgré nous. Les principes contraires ne sont propres qu'à faire de barbares raisonneurs..."

Retiré à Cirey, Voltaire s'adonna à l'étude et à l'écriture. Il y composa plusieurs pièces de théâtre, "Adélaïde Du Guesclin" (1734), une tragédie passionnée qui divise deux frères, "la Mort de Jules César" (1735), inspirée de Shakespeare, "Alzire ou les Américains" (1736), où nous sommes transportés au Pérou au XVIe siècle, "Mahomet" (1741), une forte peinture du fanatisme dans laquelle Mahomet fonde sa religion sur l'imposture pour établir sa tyrannie, en face de lui se dresse un noble adversaire. Zopire, le héros de la pièce, qui ne cesse de lutter contre l'usurpation et l'hypocrisie: il mourra martyr de la liberté et de la franchise. On y voit aussi "le malheureux Séide, qui croit servir Dieu en égorgeant son père". Puis "Mérope" (1743), qui, avec Zaïre, apparaît comme l'un des chefs-d'œuvre les moins contestés de Voltaire.
Cette période voit aussi un poème léger, épicurien et burlesque, à la gloire du bonheur terrestre, le Mondain (1736). Et Voltaire se passionne également pour des domaines de connaissances divers : les sciences, l'histoire, la philosophie, et écrivit ses Éléments de la philosophie de Newton (1738), ouvrage de vulgarisation qui contribua largement à la diffusion des idées nouvelles....
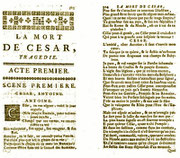
1735 - "La mort de César"
ACTE III. - Brutus reparaît devant les conjurés qui l'attendent. Son air abattu leur fait croire que la conjuration est découverte. II leur apprend qu'il est le fils de César et leur demande conseil. Cassius et ses amis répondent qu'il ne doit pas hésiter entre un homme et sa patrie. D'ailleurs, "En t'avouant pour fils, en est-il moins coupable? En es-tu moins Brutus ? en es-tu moins romain ? ...Né dans nos murs sacrés, nourri par Scipion, Elève de Pompée, adopté par Caton, Ami de Cassius, que veux-tu davantage? ...Caton forma tes mœurs, Caton seul est ton père ; Tu lui dois ta vertu, ton âme est toute à lui Brise l'indigne nœud que l'on t'offre aujourd'hui. Qu'à nos serments communs ta fermeté réponde: Et tu n'as de parents que les vengeurs du monde." Cependant Brutus est ébranlé. Il l'avoue, ses yeux ont pleuré. Il a hésité.
« Je vous dirai bien plus : sachez que je l'estime, Son grand cœur me séduit, an sein même du crime ; Et si sur les Romains quelqu'un pouvait régner, Il est le seul tyran que l'on dût épargner. » Il veut encore l'entretenir, et faire un dernier effort pour «L'attendrir, le changer, sauver l'Etat et lui. » Brutus obtient donc de César un moment d'audience. Il le supplie de rendre à Rome la liberté, lui citant l'exemple de Sylla; il lui promet de redevenir un fils pour lui, si lui-même redevient citoyen. Mais César oppose à ces raisons l'intérêt de Rome....
Acte III, scène IV. - CÉSAR, BRUTUS
CÉSAR
Rome demande un maître.
Un jour à tes dépens tu l'apprendras peut-être.
Tu vois nos citoyens plus puissants que des rois :
Nos mœurs changent, Brutus; il faut changer nos lois.
La liberté n'est plus que le droit de se nuire :
Rome, qui détruit tout, semble enfui se détruire.
Ce colosse effrayant, dont le inonde est foulé,
En pressant l'univers, est lui-même ébranlé.
Il penche vers sa chute, et contre la tempête,
Il demande mon bras pour soutenir sa tète.
Enfin depuis Sylla nos antiques vertus,
Les lois, Rome, l'État, sont des noms superflus.
Dans nos temps corrompus, pleins de guerres civiles,
Tu parles comme au temps des Dèces, des Émiles.
Caton t'a trop séduit, mon cher fils ; je prévoi
Que ta triste vertu perdra l'Etat et toi.
Fais céder, si tu peux, ta raison détrompée
Au vainqueur de Caton, au vainqueur de Pompée,
A ton père qui t'aime, et qui plaint ton erreur.
Sois mon fils en effet, Brutus ; rends-moi ton cœur,
Prends d'autres sentiments, ma bonté t'en conjure;
Ne force point ton âme à vaincre la nature.
Tu ne me réponds rien ? Tu détournes les yeux?
BRUTUS
Je ne le connais plus. Tonnez sur moi, grands dieux !
César...
CÉSAR
Quoi ! tu t'émeus? Ton âme est amollie? Ah ! mon fils...
BRUTUS
Sais-tu bien qu'il y va de ta vie?
Sais-tu que le Sénat n'a point de vrai Romain
Qui n'aspire en secret à te percer le sein?
Que le salut de Rome et que le tien le touche !
Ton génie alarmé te parle par ma bouche ;
Il me pousse, il me presse, il me jette à tes pieds.
(Il se jette à ses genoux.)
César, au nom des dieux, dans ton cœur oubliés ;
Au nom de tes vertus; de Rome et de toi-même.
— Dirai-je au nom d'un fils qui frémit et qui t'aime,
Qui te préfère au monde, et Rome seule à toi ? —
Ne me rebute pas !
CÉSAR
Malheureux, laisse-moi. Que me veux-tu?
BRUTUS
Crois-moi, ne sois point insensible.
CÉSAR
L'univers peut changer ; mon âme est inflexible.
BRUTUS
Voilà donc ta réponse?
CÉSAR
Oui, tout est résolu. Rome doit obéir, quand César a voulu.
BRUTUS, d'un air consterné.
Adieu, César !
CÉSAR
Eh quoi ! d'où viennent tes alarmes ?
Demeure encor, mon fils. Quoi ! tu verses des larmes !
Quoi ! Brutus peut pleurer ! Est-ce d'avoir un roi ?
Pleures-tu les Romains?
BRUTUS
Je ne pleure que loi. Adieu, te dis-je.
CÉSAR
O Rome ! ô rigueur héroïque ! Queue puis-je à ce point aimer ma république!
On vient prévenir César que le Sénat est assemblé et le tronc élevé. On n'attend plus que lui, mais les présages sont inquiétants. Dolabella le supplie de remettre le grand événement. César repousse avec dédain ces appréhensions : il aime mieux « mourir que de craindre la mort ». Il entre donc au Sénat. Bientôt on entend des clameurs, des cris de mort derrière le théâtre. Puis Cassius parait un poignard à la main. Il annonce que César vient de périr. Dolabella s'efforce d'exciter contre les meurtriers la colère du peuple, mais celui-ci donne raison à Cassius. Survient Antoine, qui par ses pleurs, par son attitude, par son langage habile s'impose peu à peu à l'attention de la foule, d'abord prévenue contre lui. Il rappelle la bonté de César, ses libéralités, il fait connaître le testament dans lequel il lègue ses biens au peuple. Le fond du théâtre s'ouvre : on apporte le corps de César, couvert de sa robe sanglante. Antoine descend delà tribune, se jette à genoux auprès du corps et montre aux Romains lès blessures du dictateur. Il rapporte le dernier mot que César a prononcé. A Brutus qui le frappait, il pardonnait en l'appelant: « O mon fils ! » Alors le peuple complètement retourné, profère contre les meurtriers des cris de vengeance. Antoine entend bien profiter de cette colère pour succéder à César.

1734-1738 - Voltaire s'était installé à Cirey, chez Mme du Châtelet ; ce fut le lieu de sa retraite et le centre de ses activités jusqu'à la mort de sa maîtresse en septembre 1749. Elle exerça sur lui une grande influence.
Née le 17 décembre 1706, Gabriellé-Émilie Le Tonnelier de Breteuil avait épousé le marquis du Châtelet en 1725. C'était une femme très intelligente et très instruite, passionnée de science et de philosophie, qui n'avait pas toutes les grâces attendues, mais qui possédait des qualités viriles d'énergie, de franchise, de courage. Elle devait être pour Voltaire non seulement une amie sûre, mais une prudente conseillère ; elle le détourna de certains périls, le défendit quelquefois de lui-même et l'encouragea à l'étude et au travail. Mme du Deffand, qui la connaissait bien, a tracé de son ancienne amie un portrait peu bienveillant, mais curieux : « Représentez-vous une femme grande et sèche... une très petite tête, le visage aigu, le nez pointu, deux petits yeux vert de mer, le teint noir, rouge, échauffé, la bouche plate, les dents clairsemées et extrêmement gâtées, voilà la figure de la belle Emilie, figure dont elle est si contente qu'elle n'épargne rien pour la foire valoir : frisures, pompons, pierreries, verreries, tout est à profusion... » Et les méchancetés mondaines auxquelles Mme du Châtelet était en butte, donnèrent à Voltaire l'idée de son Épître sur la Calomnie, qui lui fut dédiée: " La médisance est la fille immortelle De l'amour-propre et de l'oisiveté. Ce monstre ailé paraît mâle et femelle, Toujours parlant, et toujours écouté.."
Les poursuites entamées contre lui, le besoin de se recueillir pour l'œuvre de longue haleine qu'allait être "le Siècle de Louis XIV", la nécessité qu'il lui semblait d'acquérir en science et en philosophie les connaissances qui lui manquaient, autant d'éléments expliquant cette retraite.
Philosophe par son esprit critique, par ses idées sur la religion, sur la société, sur le bonheur, il le devint au sens encyclopédique en se faisant métaphysicien, physicien, chimiste, mathématicien, économiste, historien, sans jamais cesser d'écrire des comédies, des tragédies, des épîtres ou des vers galants. Avec Mme du Châtelet, il commente Newton, Leibniz, Christian von Wolff, Samuel Clarke, Bernard de Mandeville et fait des expériences ; sa correspondance avec Frédéric II de Prusse et le rôle qu'il espère jouer auprès du prince l'amènent à s'instruire sur la diplomatie et sur les problèmes économiques.
Toutes ces activités et ces recherches, au cœur desquelles est le concept de civilisation, aboutissent au Traité de métaphysique (Voltaire y travailla du début de 1734 à la fin de 1736 ; il ne fut pas publié de son vivant), aux Éléments de la philosophie de Newton (publiés en 1738), au Siècle de Louis XIV (une première version est prête en 1738 ; le début en fut publié en 1739 et aussitôt saisi), aux sept Discours sur l'homme (composés et diffusés plus ou moins clandestinement en 1738) et au projet de l'Essai sur les mœurs....

1736 - "Le Mondain"
Parmi les Poésies de Voltaire écrites à Cirey, on cite l'Épître sur la Calomnie (1733), l'Êpître sur la philosophie de Newton (1736), Le Mondain (1736), et Les Discours sur l'homme (1738).
Dans la première partie de sa vie, Voltaire nous apparaît comme un joyeux épicurien heureux de vivre en son siècle, le Mondain...
"Regrettera qui veut le bon vieux temps,
Et Page d'or, et le règne d'Astrée,
Et les beaux jours de Saturne et de Rhée,
Et le jardin de nos premiers parents;
Moi je rends grâce à la nature sage,
Qui, pour mon bien, m'a fait naître en cet âge
Tant décrié par nos tristes frondeurs :
Ce temps profane est tout fait pour mes mœurs.
J 'aime le luxe, et même la mollesse,
Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,
La propreté, le goût, les ornements :
Tout honnête homme a de tels sentiments.
Il est bien doux pour mon cœur très immonde
De voir ici l'abondance à la ronde,
Mère des arts et des heureux travaux,
Nous apporter, de sa source féconde,
Et des besoins et des plaisirs nouveaux.
L'or de la terre et les trésors de l'onde,
Leurs habitants et les peuples de l'air,
Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde.
Oh! le bon temps que ce siècle de fer !
Le superflu, chose très nécessaire
A réuni l'un et l'autre hémisphère...
Quand la nature était dans son enfance,
Nos bons aïeux vivaient dans l'ignorance,
Ne connaissant ni le tien ni le mien,
Qu'auraient-ils pu connaître? Ils n'avaient rien
Ils étaient nus; et c'est chose très claire
Que qui n'a rien n'a nul partage à faire.
Sobres étaient. Ah! je le crois encor :
Martialo n'est point du siècle d'or.
D'un bon vin frais ou la mousse ou la sève
Ne gratta point le triste gosier d'Ève;
La soie et l'or ne brillaient point chez eux.
Admirez-vous pour cela nos aïeux?
Il leur manquait l'industrie et l'aisance :
Est-ce vertu? c'était pure ignorance.
Quel idiot, s'il avait eu pour lors
Quelque bon lit, aurait couché dehors ?
Or maintenant voulez-vous, mes amis,
Savoir un peu, dans nos jours tant maudits,
Soit à Paris, soit dans Londres, ou dans Rome,
Quel est le train des jours d'un honnête homme?
Entrez chez lui : la foule des beaux-arts,
Enfants du goût, se montre à vos regards.
De mille mains l'éclatante industrie
De ces dehors orna la symétrie.
L'heureux pinceau, le superbe dessin
Du doux Corrége et du savant Poussin
Sont encadrés dans l'or d'une bordure ;
C'est Bouchardon qui fit cette figure,
Et cet argent fut poli par Germain :
Des Gobelins l'aiguille et la teinture
Dans ces tapis surpassent la peinture.
Tous ces objets sont vingt fois répétés
Dans des trumeaux tout brillants de clartés.
De ce salon je vois par la fenêtre,
Dans des jardins, des myrtes en berceaux;
Je vois jaillir les bondissantes eaux.
Mais du logis j'entends sortir le maître :
Un char commode, avec grâces orné.
Par deux chevaux rapidement traîné,
Paraît aux yeux une maison roulante,
Moitié dorée, et moitié transparente :
Nonchalamment je l'y vois promené;
De deux ressorts la liante souplesse
Sur le pavé le porte avec mollesse.
... Il faut se rendre à ce palais magique
Où les beaux vers, la danse, la musique,
L'art de tromper les yeux par les couleurs,
L'art plus heureux de séduire les cœurs,
De cent plaisirs font un plaisir unique.
Il va siffler quelque opéra nouveau,
Ou, malgré lui, court admirer Rameau.
Allons souper. Que ces brillants services,
Que ces ragoûts ont pour moi de délices !
Qu'un cuisinier est un mortel divin!
Chloris, Églé me versent de leur main
D'un vin d'Aï dont la mousse pressée,
De la bouteille avec force élancée,
Comme un éclair fait voler le bouchon ;
Il part, on rit; il frappe le plafond.
De ce vin frais l'écume pétillante
De nos Français est l'image brillante.
Le lendemain donne d'autres désirs,
D'autres soupers, et de nouveaux plaisirs.
Or maintenant, monsieur du Télémaque ,
Vantez-nous bien votre petite Ithaque,
Votre Salente, et vos murs malheureux,
Où vos Crétois, tristement vertueux,
Pauvres d'effets, et riches d'abstinences,
Manquent de tout pour avoir l'abondance :
J'admire fort votre style flatteur,
Et votre prose, encor qu'un peu traînante;
Mais, mon ami, je consens de grand cœur
D'être fessé dans vos murs de Salente,
Si je vais là pour chercher mon bonheur.
Et vous, jardin de ce premier bonhomme,
Jardin fameux par le diable et la pomme,
C'est bien en vain que, par l'orgueil séduits,
Huet , Calmet dans leur savante audace,
Du paradis ont recherché la place :
Le paradis terrestre est où je suis."
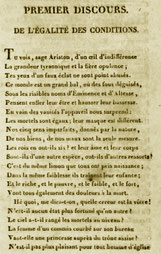
1734-1737, "Les Discours sur l’homme"
"Ce monde est un grand bal, où des fous déguisés, Sous les risibles noms d'Eminence et d’Altesse, Pensent enfler leur être et hausser leur bassesse." - Les trois premiers sont de l'année 1734. Le premier prouve l'égalité des conditions, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque profession une mesure de biens et de maux qui les rend toutes égales. Le second, que l'homme est libre, et qu'ainsi c'est à lui à faire son bonheur. Le troisième, que le plus grand obstacle au bonheur est l'envie.
Les quatre derniers sont de l'année 1737, le quatrième montre, que, pour être heureux, il faut être modéré en tout. Le cinquième, que le plaisir vient de Dieu. Le sixième, que le bonheur parfait ne peut être le partage de l'homme en ce monde, et que l'homme n'a point à se plaindre de son état. Enfin, le septième, que la vertu consiste à faire du bien à ses semblables, et non pas dans de vaines pratiques de mortification..
PREMIER DISCOURS. '
DE L’ÉGALITÉ DES CONDITIONS.
Tu vois, sage Ariston, d’un œil d'indifférence
La grandeur tyrannique et la fière opulence ;
Tes yeux d’un faux éclat ne sont point abusés.
Ce monde est un grand bal, où des fous déguisés,
Sous les risibles noms d'Eminence et d’Altesse ,
Pensent enfler leur être et hausser leur bassesse.
En vain des vanités l’appareil nous surprend ;
Les mortels sont égaux ; leur masque est différent.
Nos cinq sens imparfaits , donnés par la nature,
De nos biens, de nos maux sont la seule mesure.
Les rois en ont-ils six ? et leur âme et leur corps
Sont-ils d’une autre espèce, ont-ils d’autres ressorts?
C’est du même limon que tous ont pris naissance ;
Dans la même faiblesse ils traînent leur enfance ;
Et le riche , et le pauvre, et le faible, et le fort,
Vont tous également des douleurs à la mort.
Hé quoi, me dira-t-on, quelle erreur est la vôtre!
N'est-il aucun état plus fortuné qu’un autre ?
Le ciel a-t-il rangé les mortels au niveau ?
La femme d’un commis courbé sur son bureau
Vaut-elle une princesse auprès du trône assise ?
N'est-il pas plus plaisant pour tout homme d'église
D orner son front tondu d'un chapeau rouge ou vert,
Que d’aller, d’un vil froc obscurément couvert,
Recevoir à genoux , après lande ou matine ,
De son prieur cloîtré vingt coups de discipline ?
Sous un triple mortier n’est-on pas plus heureux
Qu’un clerc enseveli dans un greffe poudreux?
Non : Dieu serait injuste, et la sage nature
Dans ses dons partagés garde plus de mesure.
Pense-t-on qu’ici-bas son aveugle faveur
Au char de la fortune attache le bonheur ?
Un jeune colonel a souvent l’impudence
De passer en plaisirs un maréchal de France.
À être heureux comme un roi, dit le peuple hébété :
Hélas l pour le bonheur que fait la majesté ?
En vain sur ses grandeurs un monarque s’appuie;
Il gémit quelquefois, et bien souvent s'ennuie.
Son favori sur moi jette à peine un coup-d’œil.
Animal composé de bassesse et d’orgueil,
Accablé de dégoûts en inspirant l'envie,
Tour-à-tour on t’encense , et l’on te calomnie.
Parle ; qu’as-tu gagné dans la chambre du roi ?
Un peu plus de flatteurs et d’ennemis que moi.
Sur les énormes tours de notre observatoire,
Un jour , en consultant leur céleste grimoire ,
Des enfans d’Uranie un essaim curieux ,
D’un tube de cent pieds braqué contre les cieux,
Observait les secrets du monde planétaire.
Un rustre s’écria : Ces sorciers ont beau faire,
Les astres sont pour nous aussi bien que pour eux.
On en peut dire autant du secret d’être heureux ;
Le simple, l’ignorant , pourvu d’un instinct sage ,
En est tout aussi près au fond de son village.
Que le fat important qui pense le tenir,
Et le triste savant qui croit le définir.
On dit qu’avant la boîte apportée à Pandore
Nous étions tous égaux : nous le sommes encore.
Avoir les mêmes droits à la félicité ,
C’est pour nous la parfaite et seule égalité......"
Pendant ces années de 1735 à 1740, qui représentent !a première partie de la période de Cirey, nous voyons Voltaire avec son ami Thiériot, le paresseux, le viveur que l'on peut met à contribution pour lui demander des anecdotes sur le siècle de Louis XIV; avec l'abbé Moussinot, «l'aimable facteur», le factotum infatigable, chargé de ravitailler Voltaire en livres et en instruments de physique comme en objets de toilette, ayant mission de lui envoyer de l'argent et d'abord de lui en trouver, en relançant les débiteurs plus ou moins haut placés; avec l'abbé d'Olivet, ancien jésuite et académicien, dont on ne veut pas se laisser oublier, auquel on tient à donner une bonne opinion de Mme du Châtelet (elle goûte si bien Cicéron en latin et même en français, dans la traduction de l'abbé d'Olivel), mais qu'il s'agit de gagner un peu à la philosophie nouvelle, celle de Locke, puisque celle de Platon est si pitoyable. Un coup de théâtre se produit quand, parmi les correspondants de l'exilé de Cirey lorsque vient prendre place le Prince Royal de Prusse. C'est lui qui a fait les premières avances. Il prend l'auteur de Zaïre pour son professeur de français, de rhétorique et de poésie, de philosophie tout autant. II faut faire fête à cet admirateur inattendu, qui annonce un prince affranchi des préjugés Comment n'être pas flatté et comment ne pas mettre en un tel disciple les plus folles espérances ?
"Souffrez que je vous dise qu'il n'y a point d'homme sur la terre qui ne doive des actions de grâces au soin que vous prenez de cultiver, par la saine philosophie, une âme née pour commander. Croyez qu'il n'y a eu de véritablement bons rois que ceux qui ont commencé comme vous par s'instruire, par connaître les hommes, par aimer le vrai, par détester la persécution et la superstition. Il n'y a point de prince qui, en pensant ainsi, ne puisse ramener l'âge d'or dans ses Etats. Pourquoi si peu de rois recherchent-ils cet avantage? Vous le sentez, monseigneur; c'est que presque tous songent plus à la royauté qu'à l'humanité : vous faites précisément le contraire. Soyez sûr que. si, un jour, le tumulte des affaires et la méchanceté des hommes n'altèrent point un si divin caractère, vous serez adoré de vos peuples et chéri du monde entier. Les philosophes dignes de ce nom voleront dans vos États; et, comme les artisans célèbres viennent en foule dans le pays où leur art est plus favorisé, les hommes qui pensent viendront entourer votre trône..." (26 août 1736)
Quant à la lettre à Milord Hervey, elle s'adresse moins à un homme qu'à l'opinion européenne et à la postérité. C'est une éloquente apologie du grand roi et une démonstration persuasive des obligations de l'humanité envers lui : "Je ne considère pas seulement Louis XIV parce qu'il a fait du bien aux Français, mais parce qu'il a fait du bien aux hommes ; c'est comme homme, et non comme sujet, que j'écris ; je veux peindre le dernier siècle, et non pas simplement un prince. Je suis las des histoires où il n'est question que des aventures d'un roi, comme s'il existait seul, ou que rien n'existât que par rapport à lui ; en un mot, c'est encore plus d'un grand siècle que d'un grand roi que j'écris l'histoire.." (1740)
1740-1749 - Mais la retraite à Cirey n'est ni constante, ni solitaire, les visiteurs se succèdent et quand des pages de la Pucelle disparaissent de leur tiroir, il doit fuir en Hollande quand le texte du Mondain circule (novembre 1736). La seconde partie de la période de Cirey sera encore plus agitée : voyages à Lille auprès de sa nièce Mme Denis (qui devint sa maîtresse à partir de 1744) ; voyages à Paris pour la représentation, vite interdite, de Mahomet (août 1741) et pour celle de Mérope triomphale (février 1743) ; rencontre avec Frédéric II à Wesel, près de Clèves (septembre 1740) ; mission diplomatique à Berlin et en Hollande (1743-1744) ; séjours à la cour de Stanislas Leszczyński en Lorraine (1748) ; séjours à Versailles pour la représentation de la Princesse de Navarre et celle du Temple de la gloire (1745)....

"Mérope" (1743), la tragique et très ancienne histoire de la reine de Messénie et qui inspira nombre d'auteurs dramatiques, tel que Francesco Scipione Maffei en 1713-1714. C'est de cette dernière adaptation que part Voltaire, mais acclimaté au public français. L'héroïne est une mère et une veuve comme Andromaque, obsédée comme elle par les prétentions du vainqueur de son mari, le tyran Polyphonte, usurpateur du trône de Messine.
Dans l'Acte premier, le roi île Messène, Cresphonte, a péri sous les coups d'assassins avec deux de ses fils. Un seul de ses enfants, Egisthe, a échappé, emporté par son gouverneur Narbas. Quinze ans se sont écoulés depuis ce temps. Mérope inconsolable ne vit que pour conserver le trône à son fils absent. Sans nouvelles de lui. elle ne pense qu'à lui. Cependant le peuple, qui veut un roi, accepterait pour tel Polyphonie, un des officiers de l'ancien roi, ambitieux qui offre à Mérope de l'épouser et de partager le trône avec elle. La reine repousse ces avances avec hauteur. On apprend, scène suivante, que c'est Polyphonte qui a causé la mort du roi et de ses deux fils, que c'est lui qui, depuis quinze ans fait poursuivre Egisthe et qui est prêt à le perdre s'il revient...

1744 à 1750, à Paris, la période la plus brillante de la vie de Voltaire,
il fréquente la cour où l'introduit Mme de Pompadour, et gaspille un peu de temps en de multiples plaisirs. La correspondance de Voltaire, de 1743 à 1746,le montre cheminant habilement vers la faveur de la cour et vers l'Académie, buts qu'il avait si souvent visés, mais qui lui avaient toujours échappé, au moment où il allait les atteindre. Bien des obstacles l'en écartaient et ces obstacles, c'était lui-même qui les avait mis sur sa route, s'il est vrai qu'ils s'appelaient les Lettres philosophiques ou la Pucelle, voire le Mondain, ses démêlés avec l'abbé Desfontaines, où avec Jore. D'un autre côté, on pouvait s'étonner de ne pas voir à l'Académie l'auteur de Zaïre et de Mérope, l'écrivain le plus prestigieux de son temps soit en vers, soit en prose, l'historien, le philosophe dont la renommée avait dépassé les frontières du pays et dont toute l'Europe commençait à s'occuper.
C'est que Voltaire cherche à obtenir la faveur du roi ; son "Poème de Fontenoy" fut imprimé par l'imprimerie royale...

"Le Poème de Fontenoy" (1745)
La bataille de Fontenoy fut gagnée le 11 mai 1745. La nouvelle en arriva à Paris dans la nuit du 13 au 14. Voltaire composa son œuvre avec une grande rapidité. L'approbation du censeur est du 17 mai. La victoire de Fontenoy, qui vaut à Louis XV la conquête de la Flandre et une extrême popularité, - il y assistait en personne -, une victoire qui, voit dans le cadre de la guerre de Succession d'Autriche, la puissance du feu l'emporter sur le mouvement ou la stratégie. Elle coûtera 15 000 hommes aux Coalisés (sur les 55 0000 Anglais, Hollandais, Hanovriens et Autrichiens) et 7 000 aux Français (sur les 75 000 hommes de Maurice de Saxe).
"Le feu qui se déploie, et qui, dans son passage.
S'anime en dévorant l'aliment de sa rage,
Les torrents débordés dans l'horreur des hivers,
Le flux impétueux des menaçantes mers,
Ont un cours moins rapide, ont moins de violence
Que l'épais bataillon qui contre nous s'avance,
Qui triomphe en marchant, qui, le fer à la main,
A travers les mourants s'ouvre un large chemin.
Rien n'a pu l'arrêter ; Mars pour lui se déclare.
Le roi voit le malheur, le brave, et le répare.
Son fils, son seul espoir... Ah ! cher prince, arrêtez;
Où portez-vous ainsi vos pas précipités ?
Conservez cette vie au monde nécessaire.
Louis craint pour son fils, le fils craint pour son père.
Nos guerriers tout sanglants frémissent pour tous deux,
Seul mouvement d'effroi dans ces cœurs généreux.
Vous qui gardez mon roi, vous qui vengez la France,
Vous peuple de héros, dont la foule, s'avance,
Accourez, c'est à vous de fixer les destins :
Louis, son fils, l'Etat, l'Europe est en vos mains,
Maison du roi, marchez, assurez la victoire ;
Soubise et Pecquigny vous mènent à la gloire.
Paraissez, vieux soldats, dont les bras éprouvés
Lancent de loin la mort, que de près vous bravez...."
En avril 1745, Voltaire est nommé historiographe de France, puis élu à l'Académie française en avril 1746, après une longue profession de foi qui répond à toutes les calomnies. Et en décembre de la même année, il reçoit le brevet de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi... "Les grands talents sont toujours nécessairement rares, écrira Voltaire dans Discours de réception à l'Académie, surtout quand le goût et l'esprit d'une nation sont formés. Il en est alors des esprits cultivés comme de ces forêts où les arbres pressés et élevés ne souffrent pas qu'aucun porte sa tète trop au-dessus des autres. Quand le commerce est en peu de mains, on voit quelques fortunes prodigieuses, et beaucoup de misère; lorsqu'enfin il est plus étendu, l'opulence est générale, les grandes fortunes rares. C'est précisément, messieurs, parce qu'il y a beaucoup d'esprit en France qu'on y trouvera dorénavant moins de génies supérieurs.
Mais enfin, malgré celte culture, universelle de la nation, je ne nierai pas que cette langue, devenue si belle, et qui doit être fixée par tant de bons ouvrages, peut se corrompre aisément. On doit avertir les étrangers qu'elle perd déjà beaucoup de sa pureté dans cette célèbre république, si longtemps notre alliée où le français est la langue dominante, au milieu des factions contraires à la France. Mais si elle s'altère dans ces pays par le mélange des idiomes, elle est prèle à se gâter parmi nous par le mélange des styles. Ce qui déprave le goût, déprave enfin le langage. Souvent on affecte d'égayer des ouvrages sérieux et instructifs par les expressions familières de la conversation. Souvent on introduit le style marotique dans les sujets les plus nobles : c'est revêtir un prince des habits d'un farceur..."

Le tournant de 1746 - Voltaire comprend que de Versailles il n'obtiendra au mieux qu'un statut de poète de cour et Mme de Pompadour semble lui préférer le vieux tragique Crébillon.
Il se tourne alors vers Sceaux et la duchesse du Maine, pour laquelle il écrivit ses premiers Contes, dont Zadig. Mais, comme en 1726, l'édifice de son succès s'effondre, ses imprudences de plumes, sa familiarité, l'hostilité des intrigants. 1747-1750, Voltaire accompagne Mme du Chatelet à la cour lorraine de Stanislas, mais à la nostalgie de Paris vient brutalement s'ajouter la mort de Mme du Châtelet qui le plonge dans le désarroi (1749). De retour à Paris chez sa nièce Mme Denis, il tentera un dernier effort pour rentrer en grâce mais finira par céder aux invitations de Frédéric II....
Epître à Mme Denis (1748), épitre qui, antérieure de quelques mois à la mort de Mme du Châtelet, traduit les sentiments de lassitude et de désenchantement que Voltaire éprouvait alors. Il évoque ici Colbert qui, malgré les immenses services qu'il rendit, était très impopulaire, on fit clos réjouissances publiques à sa mort en 1683. Fatigué du monde, déçu par la Cour et même par le public, il semblait prêt à se retirer pour « passer avec les sages le soir serein d'un jour mêlé d'orages ».
"...De froids bons mots, des équivoques fades,
Des quolibets et des turlupinades,
Un rire faux que l'on prend pour gaité,
Font le brillant de la société.
C'est donc ainsi, troupe absurde et frivole,
Que nous usons de ce temps qui s'envoie ;
C'est donc ainsi que nous, perdons des jours
Longs pour les sots, pour qui pense si courts ?
Mais que ferai-je ? où fuir loin de moi-même?
Il faut du monde; on le condamne, on l'aime :
On ne peut vivre avec lui, ni sans lui.
Notre ennemi le plus grand, c'est l'ennui.
Tel qui chez soi se plaint d'un sort tranquille,
Vole à la cour, dégoûté de la ville.
Si dans Paris chacun parle au hasard,
Dans cette cour on se hait avec art,
Et de la joie, ou fausse ou passagère,
On n'a pas même une image légère.
Heureux qui peut de son maître approcher !
Il n'a plus rien désormais à chercher.
Mais Jupiter, au fond de l'empyrée,
Cache aux humains sa présence adorée.
Il n'est permis qu'à quelques demi-dieux
D'entrer le soir au cabinet des cieux.
Faut-il aller, confondu dans la presse,
Prier les dieux de la seconde espèce,
Qui des mortels font le mal ou le bien?
Comment aimer des gens qui n'aiment rien ? ...
A leur lever pressez-vous pour attendre.
Pour leur parler sans vous en faire entendre,
Pour obtenir après trois mois d'oubli,
Dans l'antichambre un refus très poli.
«Non, dites-vous, la cour ni le beau monde
Ne sont point faits pour celui qui les fronde.
Fuis pour jamais ces puissants dangereux ;
Fuis les plaisirs, qui sont trompeurs comme eux.
Bon citoyen, travaille pour la France,
Et du public attends ta récompense. »
Qui? le public ! ce fantôme inconstant,
Monstre à cent voix, Cerbère dévorant,
Qui flatte et mord, qui dresse par sottise
Une statue, et par dégoût la brise ?
Tyran jaloux de quiconque le sert,
Il profana la cendre de Colbert :
Et prodiguant l'insolence et l'injure,
Il a flétri la candeur la plus pure :
Il juge, il loue, il condamne au hasard
Toute vertu, tout mérite et tout art...
Mais il revient, il répare sa honte ;
Le temps l'éclairé : oui, mais la mort plus prompte
Ferme mes yeux dans ce siècle pervers,
En attendant que les siens soient ouverts.
Chez mes neveux on me rendra justice ;
Mais, moi vivant, il faut que je jouisse.
Quand dans la tombe un pauvre homme est inclus,
Qu'importe an nom, un bruit qu'on n'entend plus ?
... Ah ! cachons-nous; passons avec les sages
Le soir serein d'un jour mêlé d'orages ;
Et dérobons à l'œil de l'envieux
Le peu de temps que me laissent les dieux.
Tendre amitié, don du ciel, beauté pure,
Porte un jour doux dans ma retraite obscure !
Puissé-je vivre et mourir dans tes bras,
Loin du méchant qui ne te connaît pas !"

1747 - "Zadig"
Réfugié à Sceaux, chez la duchesse du Maine où règne encore l'esprit léger de la Régence, le courtisan déçu de Versailles inaugure avec Zadig (1747) la veine des contes philosophiques à la manière anglaise. Dans ces récits en apparence anodins Voltaire répand ses idées au fil de ses mésaventures de courtisan, lui qui a connu l'inconstance des rois et la perversité des courtisans. Zadig, jeune Babylonien riche et plein de qualités, croit avoir tout pour être heureux, mais les caprices de la destinée sont immenses dans cette petite société du XVIIIe siècle...
La Danse des hauts receveurs des deniers de Sa Gracieuse Majesté - "Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadíg; il eut confiance en sa sagesse et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. "Je plais au roi, dit-il, ne serais-je pas perdu?" Cependant il ne pouvait se dérober aux caresses de Sa Majesté ; car il faut avouer que Nabussan, roi de Serendib, fils de Nussanab, fils de Nabassun, fils de Sanbusna, était un des meilleurs princes de l'Asie ; et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer.
Ce bon prince était toujours loué, trompé et volé : c'était à qui pillerait ses trésors. Le receveur général de l'île de Serendib donnait toujours cet exemple, fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait; il avait changé de trésorier plusieurs fois, mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à Sa Majesté, et la plus grosse aux administrateurs.
Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. "Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-vous pas le moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point? Assurément, répondit Zadig, je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes." Le roi, charmé, lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. "Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête homme.
Vous vous moquez, dit le roi ; voilà une plaisante façon de choisir un receveur de mes finances! Quoi! vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile ! Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, répartit Zadig ; mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme." Zadig parlait avec tant de confiance que le roi crut qu'il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. "Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig; les gens et les livres à prodiges m'ont toujours déplu : si Votre Majesté veut me laisser faire l'épreuve que je lui propose, elle sera bien convaincue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée." Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple que si on le lui avait donné pour un miracle ; "Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendrez. - Laissez-moi faire, dit Zadig ; vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez."
Le jour même il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de Sa Gracieuse Majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habits de soie légère, le premier de la lune du Crocodile, dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de soixante et quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin : tout était préparé pour le bal, mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un après l'autre, par ce passage, dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses trésors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, Sa Majesté ordonna qu'on les fît danser. Jamais ón ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce; ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés. "Quels fripons !" disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. "Ah ! l'honnête homme ! le brave homme !" disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés avec la plus grande justice du monde ; car chacun, dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches, et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante et quatre danseurs il y eût soixante et trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la Tentation. On aurait, en Perse, empalé ces soixante et trois seigneurs ; en d'autres pays, on eût fait une chambre de justice qui eût consommé en frais le triple de l'argent volé, et qui n'eût rien remis dans les coffres du souverain; dans un autre royaume, ils se seraient pleinement justifiés, et auraient fait disgracier ce danseur si léger à Serendib, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent. " (Chap.XIV)
"Nous sentons que nous sommes sous la main d'un être invisible ; c'est tout, et nous ne pouvons faire un pas au-delà. Il y a une témérité insensée à vouloir deviner ce que c'est que cet être, s'il est étendu ou non, s`il existe dans un lieu ou non, comment il existe, comment il opère" (Dict. Phílosophique, Dieu).
Ici, l'idée du déisme semble s'imposer sous les querelles religieuses, toutes les religions sone n fait d'accord sur l'essentiel...
"Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassora. Il se trouva à table, dès le second jour, avec un Egyptien, un Indien Gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celte, et plusieurs autres étrangers qui, dans leurs fréquents voyages vers le golfe Arabique, avaient appris assez d'arabe pour se faire entendre. L'Égyptien paraissait fort en colère.
"Quel abominable pays que Bassora ! disait-il ; on m'y refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde. Comment donc! dit Sétoc ; sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme ? - Sur le corps de ma tante, répondit l'Égyptien ; c'était la plus brave femme d'Égypte. Elle m'accompagnait toujours ; elle est morte en chemin ; j'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons ; et je trouverais dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d'or sur un effet si solide." Tout en se courrouçant, il était près de manger d'une excellente poule bouillie, quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur: « Ah! qu'allez-vous faire? - Manger de cette poule, dit l'homme à la momie. - Gardez-vous en bien, dit le Gangaride ; il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante? Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. - Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? reprit le colérique Égyptien ; nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien. - Vous adorez un bœuf ! est-il possible? dit l'homme du Gange. - Il n'y a rien de si possible, repartit l'autre ; il y a cent trente-cinq mille ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n'y trouve à redire. - Ah ! cent trente-cinq mille ans ! dit l' Indien, ce compte est un peu exagéré ; il n'y en a que quatre-vingt mille que l'Inde est peuplée, et assurément nous sommes vos anciens ; et Brama nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. - Voilà un plaisant animal que votre Brama, pour le comparer à Apis ! dit l'Égyptien ; qu'a donc fait votre Brama de si beau?"
Le bramin répondit : "C'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. - Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de lui ; c'est le poisson Oannès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages. Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. Il eut plusieurs enfants qui furent tous rois, comme chacun sait. J'ai son portrait chez moi que je révère comme je le dois. On peut manger du bœuf tant qu'on veut ; mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson ; d'ailleurs vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. La nation égyptienne ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les Indiens ne se vantent que de quatre-vingt mille, tandis que nous avons des almanachs de quatre mille siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Oannès."
L'homme de Cambalu, prenant la parole, dit : « Je respecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grecs, les Celtes, Brama, le bœuf Apis, le beau poisson Oannès ; mais peut-être que le Li ou le Tien, comme on voudra l'appeler, vaut bien les bœufs et les poissons. Je ne dirai rien de mon pays ; il est aussi grand que la terre d'Égypte, la Chaldée, et les Indes ensemble. Je ne dispute pas d'antiquité, parce qu'il suffit d'être heureux, et que c'est fort peu de chose d'être ancien ; mais, s'il fallait parler d'almanachs, je dirais que toute l'Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu'on sût l'arithmétique en Chaldée.
- Vous êtes de grands ignorants tous tant que vous êtes! s'écria le Grec : est-ce que vous ne savez pas que le Chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est?"
Ce Grec parla longtemps ; mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on disputait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teutath et le gui de chêne qui valussent la peine qu'on en parlât ; que, pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche ; que les Scythes, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde ; qu'ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes, mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation ; et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teutath, il lui apprendrait à vivre.
La querelle s'échauffa pour lors, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin : il s'adressa d'abord au Celte, comme au plus furieux ; il lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du gui ; il loua le Grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de chose à l'homme du Cathay, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite il leur dit : "Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis".
A ce mot, ils se récrièrent tous. "N'est-il pas vrai, dit-il au Celte, que vous n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne? Assurément, répondit le Celte. Et vous, monsieur l'Égyptien vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs ? Oui, dit l'Égyptien. Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. D'accord, dit le Chaldéen. L'Indien, ajouta-t-il, et le Cathayen, reconnaissent comme vous un premier principe. Je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le Grec a dites, mais je suis sûr qu'il admet aussi un Être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent."
Le Grec, qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. "Vous êtes donc tous du même avis, répliqua Zadig, et il n'y a pas là de quoi se quereller." Tout le monde l'embrassa. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence, et qu'il allait être brûlé à petit feu..." (Chap. XII)
L'Episode de l'Ermite aborde l'idée de la Providence, la raison peut-elle s'accommoder d'une explication "métaphysique" de cette singulière notion qui semble s'imposer quoiqu'on en dise...
"Il rencontra en marchant un ermite, dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement. Zadig s'arrêta, et lui fit une profonde inclination. L'ermite le salua d'un air si noble et si doux que Zadig eut la curiosité de l'entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. "C'est le livre des destinées, dit 1'ermite ; voulez-vous en lire quelque chose?" Il mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout instruit qu'il était dans plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. Cela redoubla encore sa curiosité. "Vous me paraissez bien chagrin, lui dit ce bon père. - Hélas ! que j'en ai sujet! dit Zadig. - Si vous permettez que je vous accompagne, repartit le vieillard, peut-être vous serai-je utile ; j'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux."
Zadig se sentit du respect pour l'air, pour la barbe, et pour le livre de l'ermite. Il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures. L'ermite parlait de la destinée, de la justice, de la morale, du souverain bien, de la faiblesse humaine, des vertus et des vices, avec une éloquence si vive et si touchante que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible. Il le pria avec insistance de ne le point quitter jusqu'à ce qu'ils fussent de retour à Babylone.
"Je vous demande moi-même cette grâce, lui dit le vieillard ; jurez-moi par Orosmade que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours, quelque chose que je fasse". Zadig jura, et ils partirent ensemble..."
Par la suite, les deux voyageurs sont magnifiquement accueillis par un riche seigneur ; mais Zadig, admirant sa générosité, constate avec stupéfaction que l'ermite a dérobé à leur hôte un bassin d'or garni de pierreries. Le lendemain, les voici reçus chichement par un avare : nouvelle surprise, l'ermite, satisfait, remercie ce mauvais hôte et lui donne l'objet précieux dérobé la veille. Zadig proteste, mais la réponse de l'ermite constitue une première justification des injustices apparentes de la Destinée par les intentions secrètes de la Providence : « Cet homme magnifique, qui ne reçoit les étrangers que par vanité et pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage ; l'avare apprendra à exercer l 'hospitalité : ne vous étonnez de rien, et suivez-moi." L'étape suivante les conduit chez un philosophe qui les accueille avec une amabilité extrême...
"...Leur séparation fut tendre ; Zadig surtout se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable. Quand l'ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent longtemps l'éloge de leur hôte. Le vieillard, au point du jour, éveilla son camarade. "Il faut partir, dit-il ; mais, tandis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection." En disant ces mots, il prit un flambeau, et mit le feu à la maison. Zadig, épouvanté, jeta des cris, et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse.
L'ermite l'entraînait par une force supérieure ; la maison était enflammée. L'ermite, qui était déjà assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. "Dieu merci ! dit-il, voilà la maison de notre cher hôte détruite de fond en comble! L'heureux homme!" A ces mots Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre et de s'enfuir; mais il ne fit rien de tout cela, et toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite, il le suivit malgré lui à la dernière couchée.
Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans, plein d'agréments et son unique espérance. Elle fit du mieux qu'elle put les honneurs de sa maison. Le lendemain elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme empressé marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le pont : "Venez, dit l'ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante." Il le prend alors par les cheveux et le jette dans la rivière. L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau, et est engouffré dans le torrent. "O monstre! ô le plus scélérat de tous les hommes! s'écria Zadig. - Vous m'aviez promis plus de patience, lui dit l'ermite en l'interrompant : apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense, apprenez que ce jeune homme dont la Providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un an, et vous dans deux . - Qui te l'a dit, barbare? cria Zadig; et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal ?"
Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut ; quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. "O envoyé du ciel, ô ange divin ! s'écria Zadig en se prosternant, tu es donc descendu de l'empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels? Les hommes, dit l'ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître : tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d'être éclairé."
Zadig lui demanda la permission de parler. "Je me défie de moi-même, dit-il ; mais oserais-je te prier de m'éclaircir un doute : ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l'avoir rendu vertueux, que de le noyer?"
Jesrad reprit : "S'il avait été vertueux, et s'il eût vécu, son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser, et le fils qui en devait naître. - Mais quoi, dit Zadig, il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs? et que les malheurs tombent sur les gens de bien? - Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux : ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien.
- Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et point de mal? - Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre, l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse ; et cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l'Être suprême, de qui le mal ne peut approcher... Tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps-fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée : mais il n'y a point de hasard ; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance... Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. - Mais, dit Zadig ...."
Comme il disait "mais", l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère. Zadig, à genoux, adora la Providence, et se soumit. L'ange lui cria du haut des airs: "Prends ton chemin vers Babylone"...." (Chap.XX)
Fin de la 1ere partie....
