- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Somerset Maugham (1874-1965), "Of Human Bondage" (1915, "Servitude humaine"), "The Razor’s Edge" (1944, "Le Fil du rasoir") - John Cowper Powys
(1872-1963), "Wood and Stone" (1915), "Givre et sang" (Ducdame, 1925), ""A Glastonbury Romance" (1932) - ....
Last update: 12/26/2016

Somerset Maugham (1874-1965), John Cowper Powys (1872-1963), Ford Madox Ford (1873-1939) font partie de ces romanciers qui débutent à la fin de l'époque victorienne et vivent une progressive mutation du roman : le roman victorien semble dépassé, inadapté à ce qui se donne comme "modernité" dans ce "nouveau monde" qui sort de la première guerre mondiale. Il sera d'usage d'appliquer le terme de "modernisme" à cette période qui s'étend de 1915 à 1930 qui voit s'imposer en Angleterre James Joyce, Virginia Woolf, D.H. Lawrence. Le roman moderniste, a contrario du roman victorien, ne pense plus que le langage puisse rendre compte du monde dans sa réalité, que l'histoire et les personnages soient des éléments structurant d'un récit, l'intériorité, la multiplication des points de vue, l'hésitation, le doute, l'incohérence, la contradiction entre désormais dans la narration...
(Ambrose McEvoy - circa 1911 - The Ear-Ring - Tate Britain - London)

Somerset Maugham (1874-1965)
"The writer cannot afford to wait for experience to come to him, he must go out in search of it.” Somerset Maugham est le maître de la désillusion, de
la vanité des aspirations humaines et des pièges de l'amour : il déploie des intrigues et des personnages avec un cynisme qui lui est très particulier et une habileté technique que l'on a pu
juger comme froide et par trop éloignée des passions de chair et de sang : il disait de lui-même manquer d'imagination "My lack of imagination obliged me to set down quite straightforwardly what
I had seen with my own eyes and heard with my own ears.”
Né à Paris où son père était en poste à l'ambassade de Grande-Bretagne, Maugham eut une vie longue et mouvementée : élevé dans un monde cosmopolite et fortuné, mais orphelin à 10 ans, recueilli par un oncle pasteur anglican qui lui offre une éducation austère, il fait des études à Canterbury et à Heidelberg, découvre comme médecin la misère à Londres (St Thomas’s Hospital), s'installe en France (la fameuse villa mauresque de Cap Ferrat, en 1928), y aborde le théâtre. Après la Première Guerre mondiale, il sert dans l'Intelligence Service ("Ashenden, or the British Agent" (1928) fût réutilisé dans les manuels d'entraînement du MI6) et prend une certaine habitude de mener une double vie, Il épouse sa maîtresse Syrie Wellcome en 1917 (en divorce en 1928) et entame une liaison avec Gerald Haxton en 1915 (remplacé par Alan Searle en 1944).


Auteur de plus d'une soixantaine de romans, recueil de nouvelle et pièces de théâtre, on retrouve son expérience de "médecin malgré lui" dans "Liza of Lambeth" (1897), une autobiographie qui lui donne la notoriété (1915, "Of Human Bondage"), et des romans qui affirme sa réputation de romancier n'hésitant pas à s'en prendre aux institutions sociales et à une certaine arrogance de la haute société britannique, "The Moon and Six pence" (1919), "The Painted Veil" (1925), "Cakes and Ale" (1930), "The Razor's Edge" (1945), Catalina (1948). Outre son théâtre (Lady Frederick, 1907, son premier grand succès), ses Complete Short Stories remplissent trois volumes, nombre de ses oeuvres sont extrêmement connues par les films qui en ont été tirés : "Our Betters" (1933) de George Cukor, avec Constance Bennett, "The Painted Veil" (1934), de Richard Boleslawski, avec Greta Garbo, "Of Human Bondage" (1934) de John Cromwell, avec Leslie Howard et Bette Davis, "The Moon and Sixpence" (1942), d'Albert Lewin, avec George Sanders, Herbert Marshall...

"Cakes and Ale: or, the Skeleton in the Cupboard" (1930, "La Ronde de l'Amour")
Willie Ashenden, écrivain d'une cinquante d'années, est invité à déjeuner par un autre écrivain et critique, Alroy Kear, qui travaille sur la biographie
d'un célèbre romancier, Driffield, vieille connaissance de Ashenden. Celui-ci est alors assailli de souvenirs, et tout particulièrement vis-à-vis de Rosie, la femme de Driffield et d'une grand
liberté sexuelle, qui un jour le quitta. La biographie d'un homme de lettres renommé se transforme ainsi en un portrait d'un couple au destin reconstitué avec une émouvante finesse, au delà du
cynisme apparent. Le roman fut reconnu par la critique littéraire.
"You see, she wasn't a woman who ever inspired love. Only affection. it was absurd to be jealous over her. She was like a clear deep pool in a forest glade, into which it's heavenly to plunge, but it is neither less cool nor less crystalline because a tramp and a gipsy and a game-keeper have plunged into it before you."
"Voyez-vous, cette femme n'a jamais inspiré de l'amour. Seulement de l'attachement. C'était absurde d'être jaloux d'elle. Elle ressemblait à l'étang profond d'une clairière où il est délicieux de plonger, mais qui n'est ni moins frais, ni moins cristallin quand un vagabond, un bohémien, un garde-chasse s'y sont baignés avant vous."

"Of Human Bondage" (1915, "Servitude humaine")
Le plus célèbre des romans de Maugham puise dans sa propre biographie pour narrer l'histoire de la vie de Philip Carey depuis son enfance jusqu'à l'âge
adulte, tourmenté très tôt à cause de son pied bot, perdant progressivement sa foi religieuse et découvrant que l'existence est souvent sordide, sinon futile. Il finit par fuir à Londres pour
poursuivre, sans véritable vocation, des études de médecine, et rencontre un amour dévastateur en la personne de Mildred, une serveuse sans scrupule, qui le méprise et le hait, mais dont il ne
peut se passer.
Le jour s'est levé, gris et terne...
"The day broke gray and dull. The clouds hung heavily, and there was a rawness in the air that suggested snow. A woman servant came into a room in which a child was sleeping and drew the curtains. She glanced mechanically at the house opposite, a stucco house with a porticd, and went to the child’s bed.
“Wake up, Philip,” she said.
She pulled down the bed-clothes, took him in her arms, and carried him downstairs. He was only half awake.
“Your mother wants you,” she said.
She opened the door of a room on the floor below and took the child over to a bed in which a woman was lying. It was his mother. She stretched out her arms, and the child nestled by her side. He did not ask why he had been awakened. The woman kissed his eyes, and with thin, small hands felt the warm body through his white flannel nightgown. She pressed him closer to herself.
“Are you sleepy, darting?” she said.
Her voice was so weak that it seemed to come already from a great distance. The child did not answer, but smiled comfortably, tie was very happy in the large, warm bed, with those soft arms about him. He tried to make himself smaller still as he cuddled up against his mother, and he kissed her sleepily. In a moment he closed his eyes and was fast asleep. The doctor came forwards and stood by the bed-side.
“Oh, don’t take him away yet,” she moaned.
The doctor, without answering, looked at her gravely. Knowing she would not be allowed to keep the child much longer, the woman kissed him again; and she passed her hand down his body till she came to his feet ; she held the right foot in her hand and felt the five small toes; and then slowly passed her hand over the left one. She gave a sob.
“What’s the matter?” said the doctor. “You’re tired.”
She shook her head, unable to speak, and the tears rolled down her cheeks. The doctor bent down.
“Let me take him.”
She was too weak to resist his wish, and she gave the child up. The doctor handed him back to his nurse.
“You’d better put him back in his own bed.”
"Very well, sir.”
The little boy, still sleeping, was taken away. His mother sobbed now broken-heartedlv.
‘What will happen to him, poor child?”
The monthly nurse tried to quiet her, and presently, from exhaustion, the crying ceased. The doctor walked to a table on the other side of the room, upon which, under a towel, lay the body of a still-born child. He lifted the towel and looked. He was hidden from the bed by a screen, but the woman guessed what he was doing.
“Was it a girl or a boy?” she whispered to the nurse.
“Another boy.”
The woman did not answer. In a moment the child’s nurse came back. She approached the bed.
“Master Philip never woke up,” she said.
There was a pause. Then the doctor felt his patient’s pulse once more.
“I don’t think there’s anything I can do just now,” he said. "I’ll call again after breakfast.”
“I’ll show you out, sir,” said the child’s nurse.
They walked downstairs in -silence. In the hall the doc- tor stopped.
“You’ve sent for Mrs. Carey’s brother-in-law, haven’t you ?”
“Yes. sir.”
“D’you know at what time he’ll be here?”
“No, sir, I’m expecting a telegram.”
“What about the little boy? I should think he’d be bet- ter out of the way.”
“Miss Watkin said she’d take him, sir.”
“Who’s she?”
“She’s his godmother, sir. D’you think Mrs. Carey will get over it, sir ?”
The doctor shook his head.
"Of Human Bondage" est le récit, très minutieux, de l`adolescence, de la formation culturelle et de l`éducation sentimentale d'un jeune Anglais, vers la fin du XIXe siècle. Philip Carey, fils d'un chirurgien mort quelques mois avant sa naissance, a perdu sa mère tout enfant. Affligé d'un pied-bot, une infirmité qui aura de graves répercussions sur sa sensibilité, il est recueilli par son oncle, pasteur anglican dans une bourgade de pêcheurs du comté de Kent. La femme du pasteur, qui n'a pu avoir d`enfants, accueille avec une joie intense le jeune Philip, et, après quelques difficultés dues au grand amour que l`enfant continue de porter à sa mère, elle parviendra à gagner l'affection de son neveu. Dans la solitude du presbytère, Philip, que son infirmité éloigne des jeux de l`enfance, passe pourtant quelques mois de bonheur, remplis de lectures qui lui donnent le goût de l`évasion. Mais, lorsque son oncle l'aura placé comme pensionnaire dans un collège, les premières rencontres avec les garçons de son âge seront particulièrement pénibles : Philip devient la risée de ses camarades, qui imitent sa démarche ou l`obligent, au dortoir, à leur laisser toucher son pied. Ces jeunes démons ne sont pourtant point foncièrement mauvais : ils sont simplement à un âge où il est encore impossible de faire l'expérience de la douleur. Philip s'habitue pourtant, mais, parvenu à la fin de ses études, brusquement dégoûté, il refuse de se faire prêtre, à la grande déception de son oncle.
C`est le temps de l`incertitude : le jeune homme voyage, mène une aventure assez banale et ridicule avec une vieille fille, accepte enfin sans entrain une place d`employé de bureau. Comme il passe tous ses instants de loisir à courir les musées et les galeries, il croit bientôt découvrir en lui une vocation de peintre, et, ayant vendu tout ce qui lui restait de l'héritage familial, décide d`aller à Paris suivre les cours des Beaux-Arts. Après avoir passé deux ans dans le milieu cosmopolite des artistes de la fin du siècle, Philip est contraint de s'avouer à lui-même qu'il ne sera jamais qu`un peintre médiocre. Et, obéissant peut-être à la voix de l'hérédité, il décide de devenir médecin, comme son père. Aussitôt passionné, il parvient, malgré de nombreuses difficultés matérielles, à conquérir son diplôme. Pendant ses années d`internat, soit par les nécessités de son métier, soit par les hasards d`une liaison avec une femme des moins intéressantes, Philip aura pu toucher quelques abîmes de la misère humaine. C`est pourtant sur des images de réconciliation avec la vie, celles d`une idylle heureuse dans l'île Thanet, où le jeune docteur rencontrera la femme de sa vie. que s'achève le récit. Somerset Maugham suit une précision envoûtante les aventures de Philip. éludant volontairement digressions, descriptions ou lyrisme qui ne seraient pas indispensables pour dégager la personnalité du héros, le tout dans un style neutre (trad.Stock 1937).

"The Razor’s Edge" (1944, "Le Fil du rasoir")
Trois millions de ce roman seront vendus aux Etats-Unis dès son lancement - Profondément marqué d’avoir vu à la guerre un de ses camarades mourir devant
lui, le jeune Larry Darrell ne peut se résoudre à suivre le chemin tout tracé qui s’ouvre devant lui : un mariage dans la bonne société avec Isabel qui l’aime plus que tout et une confortable
carrière dans la finance. Il sent qu’il doit d’abord trouver quel sens donner à sa vie…
"Jamais je n’ai commencé un roman avec plus d’appréhension. Et si j’appelle ce livre un roman, c’est parce que je ne sais vraiment quel autre nom lui donner. J’ai peu de choses à raconter, et mon récit ne se termine ni par une mort ni par un mariage. La mort met fin à tout, ce qui en fait la conclusion la plus complète de toute histoire; mais le mariage est aussi une fin très convenable, et les snobs de l’esprit on tort de railler ce que l’on a coutume d’appeler un dénouement heureux. Le commun des mortels suit un instinct très normal en considérant que de cette façon tout ce qui doit être dit est dit. Lorsqu’un homme et une femme, après toutes les vicissitudes que l’on peut se plaire à imaginer, se sont enfin unis, ils ont rempli leur fonction biologique et l’intérêt se porte sur la génération à venir. Mais je tiens mon lecteur en suspens. Ce livre est fait de mes souvenirs sur un homme avec qui le hasard de la destinée m’a mis en étroit contact, mais à de longs intervalles seulement, et je ne sais guère ce qu’il lui est arrivé entre-temps. Mon imagination pourrait sans doute combler les vides d’une manière assez plausible et donner ainsi plus de cohésion à mon récit; je n’en ai nulle envie.
Je veux me borner à relater ce que je sais pour l’avoir appris moi-même.
J’ai écrit, il y a plusieurs années, un roman intitulé L’Envoûté. J’avais entrepris de raconter l’histoire d’un peintre célèbre, Paul Gauguin; et, usant du privilège du romancier, j’avais imaginé certains épisodes destinés à illustrer le personnage de ma création tel que me le faisaient voir les rares données que je possédais concernant le fameux artiste français. Dans ce livre-ci, je n’ai rien essayé de semblable. Je n’ai rien inventé. Pour éviter d’embarrasser des gens encore vivants, j’ai donné aux personnages de ce récit des noms de fantaisie, et j’ai pris d’autres précautions encore afin de m’assurer que nul ne puisse les reconnaître. L’homme de qui je vais parler n’est pas célèbre. Peut-être ne le sera-t-il jamais. Peut-être, parvenu au terme de son existence, ne laissera-t-il pas plus de traces de son passage sur terre qu’une pierre jetée dans une rivière n’en laisse à la surface de l’eau. Dans ce cas, si mon livre doit être jamais lu, ce sera seulement à cause de l’intérêt qu’il pourra représenter par lui-même. Mais il se peut aussi que le genre de vie choisi par mon héros, la force et la douceur particulières de son caractère aient une influence toujours croissante sur ses semblables, de sorte que, longtemps peut-être après sa mort, on reconnaîtra qu’à cette époque vivait un être vraiment exceptionnel. On saura, alors, clairement de qui il s’agit, et les curieux qui voudront se documenter au moins quelque peu sur sa jeunesse pourront trouver dans cet ouvrage certains détails intéressants. Dans ces limites ainsi admises, mon livre sera, je pense, une source utile d’information pour les biographes de mon ami.
Je ne prétends pas avoir reproduit textuellement les conversations que j’ai rapportées. Je n’ai jamais pris note de ce qui fut dit en telle ou telle autre circonstance; mais j’ai, quant à moi, bonne mémoire et, bien que j’aie relaté ces entretiens dans mon propre style, le sens en est, je crois, rendu fidèlement. J’ai dit, un peu plus haut, n’avoir rien inventé; mais une légère rectification me paraît nécessaire. Comme l’ont fait les historiens depuis le temps d’Hérodote, j’ai pris la liberté de prêter aux personnages de mon récit des propos que je n’ai pas entendus moi-même et qu’il m’eût d’ailleurs été impossible d’entendre. Mes raisons ont été celles des chroniqueurs : donner de la vie et de la vraisemblance à des scènes qui, rapportées tout simplement, n’eussent produit aucun effet. Je voudrais être lu, et je crois être en droit de faire tout ce que je peux pour donner de l’attrait à mon livre. Le lecteur intelligent découvrira facilement lui-même où j’ai eu recours à cet artifice, et il lui sera parfaitement loisible d’en faire abstraction.
Il est encore une autre raison à l’appréhension que j’éprouve en entreprenant ce récit : les principaux personnages sont Américains. L’âme des êtres est très difficile à connaître, et je ne pense pas qu’il soit jamais possible de la pénétrer entièrement s’il ne s’agit de compatriotes. Car les humains ne sont pas seulement eux-mêmes; ils sont aussi le milieu où ils sont nés, le foyer dans la ville ou la ferme où ils ont appris à faire leurs premiers pas, les jeux qui ont amusé leur enfance, les contes de vieilles femmes qu’ils ont entendus, la nourriture qu’ils ont mangée, les écoles qu’ils ont fréquentées, les sports qu’ils ont pratiqués, les poètes qu’ils ont lus, le Dieu qu’ils ont adoré. Ce sont toutes ces choses qui les ont faits ce qu’ils sont, ces choses que l’on ne peut apprendre par ouï-dire et que l’on peut saisir seulement si on les a vécues soi-même. On ne peut les connaître qu’en s’identifiant avec elles. Seule l’observation directe permet de comprendre la mentalité d’étrangers : c’est pourquoi il est difficile de donner de la vraisemblance à leur caractère à travers les pages d’un livre. Un psychologue aussi subtil et prudent qu'Henry James lui-même, bien qu’ayant vécu en Angleterre pendant quarante ans, n’a jamais réussi à créer un type d’Anglais totalement anglais. Pour ma part, je me suis toujours abstenu, sauf dans quelques courtes nouvelles, de dépeindre des personnages autres que mes propres compatriotes; et si, dans de petits contes, je me suis aventuré à me départir de cette règle, c’est que cette forme littéraire permet de décrire les caractères plus sommairement. Vous indiquez au lecteur les grands traits, et lui laissez le soin de compléter lui-même les détails. On peut se demander pourquoi, ayant fait de Paul Gauguin un Anglais, je ne pouvais agir de même pour les personnages de ce livre. La réponse est simple : je ne le pouvais pas. Ils n’auraient plus été ce qu’ils sont. Je ne prétends pas qu’ils soient des Américains tels que les Américains se voient eux-mêmes; ils sont des Américains vus par les yeux anglais.
En 1919, me rendant en Extrême-Orient, et passant par Chicago, je m’y arrêtai deux ou trois semaines pour des raisons qui n’ont rien à faire avec ce récit. Je venais de publier un roman à succès, et la vogue dont je jouissais alors me valut d’être interviewé dès mon arrivée. Le matin suivant, on m’appela au téléphone. Je répondis.
- C’est Elliott Templeton qui parle.
- Elliott ? Je vous croyais à Paris.
- Non, je suis en visite chez ma sœur. Nous aimerions vous avoir à déjeuner chez nous aujourd’hui.
- Avec joie.
Il me fixa l’heure et me donna l’adresse.
Je connaissais Elliott Templeton depuis quinze ans. Il avait, à cette époque, largement dépassé la cinquantaine ; c’était un homme grand, élégant, aux traits réguliers; ses épais cheveux foncés et ondulés grisonnaient tout juste assez pour souligner la distinction de son allure. Il était toujours admirablement habillé. Il achetait son linge chez Charvet, mais ses vêtements, ses chaussures et ses chapeaux venaient de Londres. Il avait un appartement à Paris sur la rive gauche, dans l’élégante rue Saint-Guillaume. Les gens qui ne l’aimaient pas prétendaient qu’il faisait des affaires, mais cette insinuation le remplissait d’indignation. Il avait du goût et de la culture; il ne se refusait pas à reconnaître que dans le passé, au début de son installation à Paris..."
Laurence Darrel, Larry, le héros de "The Razor's Edge", est un jeune homme pourvu de rentes modestes dont il se satisfait : intellectuel par-dessus tout, affamé d`absolu, il cherche, avant tout, les réponses aux grandes questions, à l`origine, à la fin de la vie. Autant d'aspirations que sa fiancée, Isabel, nièce d`Eliott Templeton, habile aventurier, courtier en tableaux, ne partage pas avec lui. Isabel ne désire que luxe, songe à faire un beau mariage, se moque assez de la métaphysique et voudrait que son fiancé abandonne ses bibliothèques et ses musées pour un bon métier d'affaires : mais Larry refuse toutes les places qu`on lui propose. Il s`en va en France poursuivre des études à la Bibliothèque nationale. Isabel le rejoint après deux ans pour essayer de l`en arracher et soumet Larry au chantage de la rupture : à la stupéfaction de la jeune fille. Larry accepte la séparation. Contrainte par sa propre ruse, Isabel cède enfin aux instances de Gray Maturin, un millionnaire de Chicago, depuis longtemps épris d`elle. Le mariage est célébré. Larry, par hygiène cérébrale, se fait embaucher dans une mine de charbon. Avec un Polonais au tempérament mystique. rencontré à la mine, il voyage ensuite en Belgique, en Allemagne. A Bonn, Larry passe une année dans un couvent bénédictin. Puis, comme la religion n`a pas su mieux répondre que la métaphysique à l`inquiétude de son âme, il part pour l`Espagne. où il croit que l'art pourra lui entrouvrir une voie. Peu après, il entreprend un grand voyage aux Indes, en Birmanie, en
Chine : auprès des brahmanes qui l`initient à l`art d`hypnotiser et de guérir. il trouve enfin une certaine paix intérieure. Rentré a Paris, dix années après le mariage d'Isabel, il retrouve celle-ci et son mari. Le millionnaire a été ruiné par le krach de 1929. Isabel aime son mari, sans doute, mais sa tendresse de jeune fille pour Larry ne s`est pas éteinte. Aussi, lorsque Larry retrouve Sophie, une de leurs anciennes camarades de Chicago, Isabel ne contient pas sa colère, d`autant plus qu'on parle de mariage entre Larry et Sophie. Celle-ci, après la mort dans un accident de voiture de son premier mari et de son enfant, s`était mise à boire et à se droguer. Larry l`avait soignée, guérie. La veille du mariage, Isabel, qui avait offert à Sophie sa robe de cérémonie, invite la jeune femme chez elle pour un dernier essayage. Avant l'arrivée de Sophie, Isabel s`en va, laissant en évidence sur la table une bouteille de vodka. Sophie boit, se soûle, s`enfuit pour toujours à Toulon, où elle tombera dans la débauche : on la retrouvera la gorge tranchée. Larry, dégoûté, sa fièvre intellectuelle maintenant apaisée sinon comblée, finit par distribuer son argent, s`engage dans l'équipage d'un bateau en partance pour l`Amérique où il espère trouver une place de chauffeur. Avant de partir, il a consigné ses recherches dans un livre dont il se soucie assez peu de savoir s'il sera vendu : il croit ne pouvoir désormais trouver la joie et le bonheur que dans l`existence la plus ordinaire, loin des riches et des snobs. Chacun est récompensé selon ses désirs : l`oncle Templeton est devenu une des célébrités du monde parisien. Le vieil aventurier meurt dans les bras de l`Eglise et laisse une fortune à sa nièce. Isabel redevient donc ce qu'elle a toujours souhaité être : riche. Vis-à-vis d`elle, Maugham ne se montre point sévère et, en dépit du caractère souvent conventionnel de ses personnages, et malgré leurs erreurs, les rend également attachants au lecteur. Mais l`idée principale de l`auteur était de décrire le "roman d`apprentissage" d'un jeune intellectuel moderne (Trad. Plon, 1946).

"Ashenden: Or the British Agent" (1928, "Mr Ashenden, agent secret")
"Somerset Maugham a démontré, avant Ian Fleming et John Le Carré, que la littérature et l'espionnage pouvaient faire excellent ménage. Avec ce volume de
nouvelles, on entre de plain-pied dans la biographie du grand écrivain britannique. Car Mr Ashenden n'est autre que l'auteur lui-même. « Ce recueil s'inspire de mon expérience d'agent secret
pendant la guerre (celle de 1914 - 1918), a-t-il écrit, mais remaniée au service de la fiction." (Editions Robert Laffont).
"Ashenden rentrait à Genève par une nuit de tempête. Sous un vent glacial venu des montagnes, le vapeur trapu luttait contre les vagues qui agitaient le lac. Une pluie mêlée de neige balayait le pont par rafales, avec les accès de hargne d'une matrone acariâtre qui ressasse un grief. Ashenden s'était rendu en France pour rédiger et expédier son rapport. Deux jours plus tôt, vers cinq heures de l'après-midi, l'un de ses agents, d'origine indienne, était venu le voir dans sa chambre d'hôtel et ne l'y avait trouvé que par chance, car sa visite était impromptue : ses instructions lui enjoignaient de ne prendre contact avec son supérieur qu'en cas d'urgence et pour une raison grave.
Ashenden avait appris de sa bouche qu'un Bengali au service des Allemands venait de passer la frontière en provenance de Berlin et que sa malle en osier noir contenait de nombreux documents propres à intéresser le gouvernement de Sa Majesté. C'était l'époque où les Empires centraux s'efforçaient de fomenter des troubles aux Indes pour contraindre l'Angleterre à y maintenir ses troupes, voire à en retirer de France pour les y affecter. On avait réussi à faire arrêter le Bengali par la police de Berne sous une inculpation assez sérieuse pour le neutraliser quelque temps ; mais l'on n'avait pas pu mettre la main sur la malle. L'agent d'Ashenden, un garçon fort habile et d'un grand courage, évoluait librement dans les milieux indiens hostiles à la cause britannique. Il venait d'y apprendre qu'avant d'aller à Berne, le Bengali avait pris la précaution de déposer le colis à la consigne de la gare de Zurich. Mais, à présent qu'il était en prison dans l'attente d'un jugement, il ne trouvait pas le moyen de faire passer à l'un de ses complices le bulletin de bagages. Les services secrets allemands, qui attachaient un grand prix à récupérer sans délai le contenu de la malle, mais désespéraient d'y parvenir dans le respect de la légalité, avaient résolu de s'en emparer cette nuit-là en pénétrant par effraction dans les locaux de la consigne.
La témérité et l'ingéniosité de ce projet émoustillèrent Ashenden, voué pour sa part à des missions souvent très fastidieuses. Il y reconnaissait la fougue et l'absence de scrupules du responsable local du service d'espionnage allemand. Mais, comme l'opération était prévue la nuit suivante à deux heures du matin, il n'y avait pas une minute à perdre. Il ne pouvait pas prendre le risque de télégraphier ou de téléphoner à l'officier des services britanniques en poste à Berne. Lui envoyer l'Indien était hors de question - cet agent lui avait rendu
visite au péril de sa vie : si quelqu'un le voyait ressortir de la chambre, il y avait lieu de craindre qu'on ne retrouvât un jour son cadavre flottant à la surface du lac, percé d'un coup de poignard entre les deux épaules. Ashenden n'avait qu'un seul recours : se déplacer lui-
même.
En faisant très vite, il pouvait encore prendre le prochain train pour Berne. Il enfila son pardessus, mit son chapeau en dévalant les marches et sauta dans un taxi. Quatre heures plus tard, il sonnait à la porte du quartier général des services britanniques de contre-espionnage. Une seule personne, qu'il demanda à voir, y connaissait son nom. Un homme de haute taille, aux traits tirés, qu'il rencontrait pour la première fois, vint le chercher dans la salle d'attente pour l'introduire dans son bureau. Mis au courant, il consulta sa montre.
- Il est trop tard pour que nos services puissent intervenir à Zurich : pas moyen d'arriver à temps.
Il réfléchit.
- Nous allons mettre les autorités helvétiques sur cette affaire. Elles disposent d'un téléphone privé et, quand vos petits amis tenteront leur effraction, je suis convaincu qu'ils trouveront dans la gare à qui parler. En tout cas, je vous conseille de repartir pour Genève.
Il serra la main d”Ashenden et le reconduisit. Ce dernier ne se faisait aucune illusion : il ne connaîtrait jamais la suite des événements. Rivet minuscule dans une vaste machine d'un fonctionnement complexe, il n'avait jamais le privilège de suivre une action de bout en bout : qu'il eût aidé à son déclenchement, contribué à son épilogue, ou bien encore à l'une de ses étapes, il était rare qu'il apprît le résultat de son intervention. Il se sentait frustré comme par l'un de ces romans modernes qui, présentant au lecteur une série d'épisodes autonomes, lui laissent le soin d'en rassembler le puzzle, pour construire mentalement un récit qui se tienne.
A présent, malgré son cache-col et sa pelisse, Ashenden grelottait. Il aurait pu s'installer pour lire dans le salon, bien chauffé et bien éclairé, mais il avait estimé préférable de n'en rien faire pour éviter d'être reconnu par quelque habitué de ce trajet, qui aurait pu, dès lors, s'interroger sur les motifs de ses navettes constantes entre Genève et Thonon-les-Bains. Dans l'obscurité du pont, il s'abritait donc du mieux qu'il pouvait, pour la durée de ce retour fastidieux. Il n'arrivait pas à distinguer devant lui les lumières de Genève, et la pluie, qui tournait de plus en plus à la neige, l'empêchait de se repérer. Le Léman, si joli par beau temps, et calme comme une pièce d'eau dans un jardin à la française, prenait, sous la tempête, l'aspect ténébreux et sinistre d'une mer démontée. Ashenden se promettait, dès son retour à l'hôtel, de faire allumer un feu dans sa cheminée devant laquelle, après un bain brûlant, il s'installerait pour dîner douillettement en pyjama et robe de chambre. La perspective de cette soirée en tête à tête avec sa pipe lui réchauffait le cœur au point de justifier bel et bien rétrospectivement les affres de la traversée.
Deux matelots, baissant la tête pour se protéger des rafales de neige fondue, passèrent près de lui d'un pas lourd et l'un d'eux lui cria :
- Nous arrivons.
Ils se préparaient à retirer une barre du bastingage pour faire place à la passerelle de débarquement. Ashenden s'efforça à nouveau de percer les ténèbres où le vent mugissait, et distingua avec soulagement, au milieu du brouillard, les lumières du quai. Il ne fallut pas plus de deux ou trois minutes pour amarrer le bateau et Ashenden, le visage tout emmitouflé, rejoignit le petit groupe de passagers qui attendait pour descendre. Malgré la fréquence de ses voyages - car il devait passer le lac une fois par semaine pour remettre son rapport et recevoir ses instructions sur le sol français - il n'avait jamais l'esprit bien tranquille au moment de débarquer. Rien sur son passeport n'attestait son transit par la France : le vapeur y faisait deux escales au cours d'un circuit qui partait de la Suisse pour y revenir ; si bien qu'Ashenden pouvait ne s'être rendu qu'à Vevey ou à Lausanne. Mais comment être sûr que la police secrète ne l'avait pas remarqué et n'avait pas découvert en le faisant suivre qu'il avait fait étape en France ? Dans ce cas, il aurait du mal à expliquer l'absence d'un cachet sur son passeport. L'histoire qu'il avait préparée lui semblait à lui-même assez peu convaincante. Certes, les autorités helvétiques seraient bien en peine de démontrer qu'il n'était pas un touriste ordinaire, mais il n'en risquait pas moins de passer deux ou trois journées désagréables sous les verrous, puis de se voir piteusement reconduit manu militari jusqu'à la frontière ! Les Suisses n'ignoraient pas que leur pays était un nid d'espions : une foule d'agents secrets de tout poil, de révolutionnaires, d'agitateurs hantaient les hôtels de leurs villes principales. Soucieux de maintenir sa neutralité, leur gouvernement était fermement décidé à réprimer tous les agissements susceptibles de troubler ses bons rapports avec l'une ou l'autre des puissances belligérantes.
Comme d'habitude, deux policiers, debout sur le quai, surveillaient la descente des passagers, et Ashenden, qui prit son air le plus désinvolte en passant devant eux, eut le soulagement de ne pas être interpellé. Il s'enfonça dans l'obscurité, pressant le pas vers son hôtel. La tempête avait dédaigneusement balayé tout ce qui faisait l'ordre et la propreté méticuleuse de la promenade. Les magasins étaient fermés et les rares passants qu'il croisa avançaient de guingois, la tête rentrée dans les épaules comme s'ils fuyaient la vindicte aveugle de l'Inconnu. En cette nuit d'encre dont le froid vous transperçait, la civilisation semblait prendre honte de ce qui la séparait de la nature et se faire humble face à la fureur des éléments.
C'était de la grêle, à présent, qui cinglait son visage. La chaussée que l'eau rendait glissante l'obligeait à n'avancer qu'avec précaution. Son hôtel donnait sur le lac. Quand il arriva, un chasseur lui ouvrit la porte et un tourbillon d'air l'accompagna jusque dans le vestibule,
faisant s'envoler les papiers de la réception. Ebloui par la lumière vive, Ashenden s'arrêta au bureau pour demander s'il avait du courrier.
Comme il n'y avait rien, il était sur le point de prendre l'ascenseur quand le réceptionniste l'informa que deux messieurs l'attendaient dans sa chambre. Ashenden ne connaissait personne à Genève.
- Vraiment ? s'écria-t-il, stupéfait. De qui peut-il s'agir ?
Pour se faire bien voir du réceptionniste, il l'avait remercié par de copieux pourboires pour ses menus services. Ce dernier le regarda avec un petit sourire.
- Je peux bien vous le dire : ces gens sont de la police.
- Qu'est-ce qui les amène ? demanda Ashenden.
- Ils ne m'ont pas fait de confidences. Ils voulaient savoir où vous étiez. Quand je leur ai dit que vous faisiez une promenade, ils ont déclaré qu'ils attendraient votre retour.
- Ça fait longtemps qu'ils sont là ?
- Une heure.
Ashenden, consterné, prit soin de conserver un visage impassible.
›- Je vais voir ce qu'ils veulent, dit-il.
Mais, quand le garçon d'ascenseur s'effaça pour le laisser entrer dans la cabine, il secoua la tête :
- Non, je monterai à pied pour me réchauffer un peu.
Pour se donner le temps de réfléchir, il gravit lentement les trois étages. Ses jambes n'arrivaient pas à le suivre. La raison pour laquelle deux officiers de police tenaient tellement à le voir n'était pas mystérieuse. Pressé de questions, il craignait de s'effondrer. Et si on l'arrêtait pour espionnage, il n'échapperait pas, pour cette nuit au moins, à la prison. Lui qui rêvait plus que jamais d'un bain brûlant et d'un repas tranquille au coin du feu ! Il eut la tentation de faire demi-tour et de fuir l'hôtel en y abandonnant toutes ses affaires : n'avait-il pas son passeport en poche ? Il connaissait par cœur les heures des trains pour la France et serait hors d'atteinte avant même que les autorités helvétiques n'aient eu le temps de se retourner. Pourtant, il continuait de monter d'un pas lourd. L'idée de renoncer si facilement à son entreprise lui déplaisait fort. N'avait-il pas accepté en connaissance de cause de partir pour Genève ? Il estimait souhaitable de mener sa mission jusqu'à son terme. A coup sûr, la perspective de passer deux années dans une prison suisse ne l'enchantait guère, mais c'était là un risque du métier : au même titre que, pour un monarque, l'éventualité d'un assassinat. Arrivé au troisième palier, il se dirigea vers sa chambre. Le manque de sérieux d'Ashenden lui était souvent reproché. Sans doute restait-il enclin à prendre les choses avec le sourire car, dans l'instant où il hésitait à franchir la porte, sa situation lui apparut soudain sous un jour plus ou moins comique. Reprenant courage, il s'avisa de payer d'audace et, après avoir tourné la poignée, affronta ses visiteurs avec un franc sourire :
- Bonsoir, messieurs, dit-il.
La pièce baignait dans une vive lumière. Toutes les lampes y étaient allumées cependant qu'un bon feu flambait dans l'âtre. Mais l'air était envahi par la fumée grise des âcres cigares à quatre sous que, pour tromper leur attente, les deux inconnus fumaient à la chaîne. A les
voir assis, engoncés dans leur pardessus et coiffés de leur chapeau melon, l'on aurait pu croire qu'ils venaient d'arriver ; mais il suffisait de regarder les cendres accumulées dans le petit cendrier posé sur la table pour changer d'avis : ils devaient être là depuis assez longtemps pour connaître par cœur la disposition des lieux. Bien charpentés, inclinant à la corpulence, ces deux colosses moustachus rappelaient à Ashenden les deux géants de l'Or du Rhin : Fafner et Fasolt. Leurs énormes brodequins, leur façon pataude de se carrer dans leur fauteuil, leur air soupçonneux et balourd à la fois ne laissaient aucun doute sur leur appartenance à la police d'Etat. Ashenden jeta un coup d'œil autour de lui. C'était un homme soigneux et il vit aussitôt que ses affaires, encore que bien remises en ordre, avaient été déplacées. Il devina que ses effets personnels avaient été soumis à une perquisition. Il ne s'en émut pas, car il ne gardait chez lui aucun papier compromettant. Il avait appris par cœur son code secret, et déchiré le modèle avant de quitter l'Angleterre. Les messages qu'il recevait d'Allemagne lui étaient remis par des tiers et il s'empressait de les transmettre à
leurs destinataires. Mais, s'il n'avait rien à craindre d'une perquisition, l'existence de celle-ci étayait ses soupçons : quelqu'un l'avait dénoncé à la police pour ses activités de contre-espionnage.
- Que puis-je faire pour votre service, messieurs ? demanda-t-il d'un ton amène. Il fait chaud ici : n'aimeriez-vous pas vous mettre à l'aise ?
De les voir assis le chapeau sur la tête l'agaçait un peu.
- Nous ne restons qu'un instant, dit l'un d'eux. Nous passions dans le quartier et, comme l'on nous a dit à la réception que vous n'alliez pas tarder à rentrer, l'idée nous est venue de vous attendre.
Il ne s'était pas découvert. Ashenden dénoua son écharpe et enleva sa pelisse.
- Un cigare ? proposa-t-il.
Il présenta la boîte successivement aux deux inspecteurs. Le premier, Fafner, répondit: "Ce n'est pas de refus"; le second, Fasolt, se servit en silence, ne prenant même pas la peine de le remercier.
Mais la marque des cigares sembla les impressionner puisque, après l'avoir vue, l'un et l'autre ôtèrent leur couvre-chef.
- Par ce temps de cochon, votre promenade a dû manquer de charme ? fit observer Fafner en jetant dans le feu le bout de son cigare qu'il venait de couper avec les dents.
Ashenden avait pour principe (non moins approprié à la vie quotidienne qu'à la pratique du contre-espionnage) de toujours s'en tenir à la vérité aussi longtemps qu'elle pouvait le servir. D'où cette réponse :
- Je ne suis pas fou. Je me serais bien gardé de sortir par un temps pareil sans y être obligé. J'avais promis d'aller voir aujourd'hui un ami malade qui habite Vevey. En revenant, il faisait un froid de chien sur le lac.
- Nous sommes de la police, laissa tomber Fafner négligemment.
Comment Ashenden aurait-il pu ne pas s'en rendre compte ? Ses visiteurs devaient le prendre pour un grand naïf. Mieux valait, pourtant, en l'occurrence, éviter le persiflage.
- Ah bon ! fit-il...."

"The Three Fat Women of Antibes" (1933, "Les Trois Grosses Dames d'Antibes")
"Les Trois Grosses Dames d'Antibes est le premier de quatre recueils à paraître dans la collection « Pavillons poche » qui rassemblent les nouvelles de
Somerset Maugham. On y découvre l'univers de l'auteur : l'Empire britannique, cet ailleurs colonial que l'auteur chérit et qui le fait rêver ; l'Espagne, un autre ailleurs parfois idéalisé ; et
la France, ou il a passé son enfance. Abordant dans un anticonformisme avoué ses thèmes de prédilection littéralement amoraux, ces courts récits mettent notamment en scène des fils de bonne
famille qui se mettent à jouer et fréquenter des femmes, un repris de justice qui part dans le Pacifique, devient bigame et goûte enfin au bonheur... Autant de personnages dépeints avec ironie et
tendresse. Les nouvelles, parfois cruelles, dénoncent avec un esprit décapant le monde étriqué de la bourgeoisie et de ses préoccupations, et l'univers désuet de l'aristocratie. Souvent drôle,
plein de fantaisie et empreint d'une certaine nostalgie, ce volume est celui d'un monde en train de disparaître, celui de la jeunesse de l'auteur." (Editions Robert Laffont)
"L'une s'appelait Mrs Richman, et elle était veuve. La deuxième, qui s'appelait Mrs Sutcliffe, était américaine et deux fois divorcée. La troisième, Miss Hickson, était célibataire. Toutes trois avaient atteint une aimable quarantaine et elles avaient de la fortune. Mrs. Sutcliff portait l'insolite prénom d'Arrow. Du temps où elle était jeune et svelte, elle en était assez fière, car ce prénom lui convenait et les plaisanteries qu'il suscitait, bien que trop souvent répétées, flattaient agréablement son amour-propre. Et elle n'était pas loin de penser qu'il correspondait aussi à sa personnalité, suggérant quelque chose de direct, de vif et de résolu. Il lui plaisait moins, maintenant que l'embonpoint avait estompé ses traits délicats, que ses bras et ses épaules étaient si empâtés et ses hanches si massives. Elle avait de plus en plus de mal à trouver des robes qui la faisaient paraître telle qu'elle aimait se voir. Quant aux plaisanteries inspirées par son prénom, elles se faisaient à présent derrière son dos, et elle savait fort bien qu'elles n'avaient rien d'agréable. Elle ne se résignait guère à la maturité. Elle continuait à porter du bleu, pour mettre en valeur la couleur de ses yeux et, à force d'artifices, sa blonde chevelure avait conservé son éclat.
Elle savait gré à Beatrice Richman et à Frances Hickson d'être tellement plus fortes qu'elle, qu'à côté de ses amies elle semblait presque mince. Toutes deux étaient ses aînées et avaient tendance à la traiter en gamine. Ce n'était pas désagréable. Dotées d'un bon naturel,
ces deux femmes la taquinaient gentiment au sujet de ses amoureux, alors qu'elles-mêmes avaient écarté de leurs pensées ce genre de sottise - Miss Hickson n'y avait d'ailleurs jamais songé - et elles envisageaient ses flirts avec bienveillance. Il allait de soi qu'un de ces
prochains jours Arrow allait faire le bonheur d'un troisième homme.
- Mais il faut veiller à ne plus prendre de poids, mon chou, disait Mrs. Richman.
- Et, pour l'amour du ciel, assurez-vous qu'il bridge convenablement, ajoutait Miss Hickson.
Elles envisageaient pour Arrow un homme frisant la cinquantaine, mais bien conservé et d'allure distinguée. Amiral à la retraite et bon golfeur, ou veuf sans charges de famille, mais, dans les deux cas, jouissant d'un confortable revenu. Arrow les écoutait avec bonne grâce
sans jamais laisser entrevoir qu'elle avait sur la question des idées fort différentes. Certes, elle ne demandait pas mieux que de se remarier, mais l'homme de ses rêves était soit un svelte Italien à la noire chevelure, aux yeux ardents et au nom aristocratique, soit un Espagnol de noble lignée, l'un ou l'autre ayant trente ans d'âge, et pas un jour de plus. Il lui arrivait, en se regardant dans la glace, de se convaincre qu'elle-même n'en faisait guère plus.
C'étaient de grandes amies, en vérité, Miss Hickson, Mrs. Richman et Arrow Sutcliffe. L'embonpoint les avait réunies et le bridge avait cimenté leur alliance. Elles s'étaient rencontrées pour la première fois à Karlsbad, alors qu'elles séjournaient dans le même hôtel, suivies par le même médecin, qui se montrait à leur égard également impitoyable.
Beatrice Richman était énorme. Belle femme au demeurant, aux yeux superbes, aux joues fardées, aux lèvres peintes. Elle se trouvait bien dans sa condition de veuve nantie. Elle adorait manger. Elle aimait les tartines beurrées, la crème fraîche, les pommes de terre et
les beignets bien gras. Aussi, pendant onze mois de l'année, ingurgitait-elle à peu près tout ce qui lui faisait envie, pour consacrer le dernier mois à sa cure d'amaigríssement de Karlsbad. Mais, d'année en année, elle prenait de l'importance. Elle réprimandait son médecin, sans pour autant l'émouvoir. Il se contentait de lui rappeler quelques vérités élémentaires.
"Mais si je ne puis plus rien manger de ce que j'aime, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ! " protestait-elle.
Il haussait une épaule désapprobatrice. Plus tard, elle devait confier à Miss Hickson qu'elle soupçonnait le médecin d'être bien moins brillant qu'elle ne l'avait cru. Miss Hickson s'esclaffa bruyamment. C'était son genre. Elle avait une voix de basse profonde, une figure
large, plate, au teint brouillé, éclairé par de petits yeux pétillants. Elle marchait d'un pas traînant, les mains dans les poches et, loin des regards indiscrets, elle fumait volontiers de longs cigares. Elle s'habillait de façon aussi masculine que possible. "Bon sang, de quoi j'aurais l'aír avec des fanfreluches et des falbalas ? disait-elle. Quand on est grosse comme moi, autant se mettre à l'aise ! "
Elle portait des costumes de tweed et des grosses chaussures et, quand c'était possible, se promenait nu-tête. Elle était forte comme un bœuf et se targuaít, au golf, d'avoir des "drives" beaucoup plus longs que la plupart des hommes. Elle avait son franc-parler et, par la
variété de ses jurons, pouvait faire concurrence à un docker. Bien que son prénom fût Frances, elle aimait mieux se faire appeler Frank.
Autoritaire, mais non dépourvue de tact, c'était par la force joviale de son caractère qu'elle maintenaít l'unité du trio. Ensemble elles prenaient les eaux, se baignaient à la même heure, ensemble elles faisaient leur promenade de santé et arpentaient le court de tennis sous la férule d'un entraîneur professionnel qui s'employait à les faire courir, et c'est à la même table qu'elles absorbaient leur frugal repas de régime.
Rien n'altérait leur bonne humeur, si ce n'est l'aiguille de la balance et, lorsque l'une ou l'autre accusait le même poids que la veille, ni les grosses blagues de Frank, ni la bonhomie de Beatrice, ni Arrow et ses jolies mines de chaton ne parvenaient à dissiper la mélancolie générale.
On prenait alors des mesures draconiennes et la coupable se mettait au lit pour vingt-quatre heures, sans autre nourriture que le fameux bouillon de légumes du médecin, qui avait un goût d'eau chaude dans laquelle on aurait abondamment rincé un chou.
Jamais une amitié si sincère n'avait fleuri entre trois femmes. Elles se seraient d'ailleurs suffi à elles-mêmes s'il ne leur avait fallu trouver un quatrième au bridge.
C'étaient des joueuses acharnées et enthousiastes. Aussi, à peine achevés les rites quotidiens de la cure, s'installaient-elles à la table de bridge. Arrow, malgré sa féminité, était la plus forte des trois, menant un jeu dur et brillant, sans pitié, ne concédant jamais un point et ne manquant jamais de tirer profit d'une faute de l'adversaire. Beatrice avait un jeu sûr et sérieux ; Frank, impulsive, était une grande théoricienne qui connaissait le nom des grands champions sur le bout du doigt.
Toutes les trois se plongeaient dans de longues discussions sur les systèmes rivaux, se lançaient à la tête Culberson et Sims. Jamais, de toute évidence, l'une d'elles n'avait joué une carte sans pouvoir l'appuyer d'une quinzaine d'arguments valables. Cependant, il ressortait des conversations qui s'ensuivaient qu'il existait quinze raisons, également excellentes, pour ne pas jouer la carte en question.
La vie aurait été parfaite, malgré la perspective d'avoir pour toute nourriture l'infect bouillon, quand cette "sacrée" (selon Beatrice), "fichue" (selon Frank), "sale" (selon Arrow) balance prétendait qu'on n'avait pas perdu une once de graisse en l'espace de deux jours,
s'il n'y avait pas eu cet éternel problème de trouver un partenaire de leur force au bridge.
C'est pour cette raison qu'un beau jour qui fait l'objet de ce récit, Frank invita Lena Finch à faire un séjour à Antibes. Les trois amies s'y étaient installées pour quelques semaines, sur une suggestion de Frank. Frank, avec son bon sens, avait en effet jugé absurde qu'à peine la cure terminée Beatrice, qui perdait toujours une vingtaine de livres, s'abandonnât à son appétit insatiable et reprît tout le poids qu'elle venait de perdre. Beatrice était une faible. Elle avait besoin d'une compagne à la volonté ferme pour surveiller son régime. Frank avait donc proposé, après la cure de Karlsbad, de louer une maison à Antibes, où elles auraient l'occasion de prendre de l'exercice - tout le monde sait qu'il n'y a rien de tel que la natation pour maigrir - et où elles continueraient, dans la mesure du possible, à suivre le régime.
En engageant leur propre cuisinier, elles pouvaient, à tout le moins, proscrire une nourriture trop riche. Et il était permis d'espérer qu'elles perdraient toutes les trois quelques livres de plus. L'idée semblait excellente. Beatrice en voyait tout l'intérêt et elle savait assez bien résister aux tentations si elles ne lui étaient pas mises sous le nez. De plus, elle aimait jouer de l'argent et un petit tour au casino, deux ou trois fois par semaine, constituerait un agréable passe-temps.
Arrow, quant à elle, adorait Antibes et, après un mois à Karlsbad, elle serait au mieux de sa forme. Elle n'aurait que l'embarras du choix parmi les jeunes Italiens, les Espagnols passionnés, les Français empressés et les Anglais dégingandés, qui tous se baladaient, à longueur de journée, en short de bain et en peignoir coloré.
Le plan se révéla parfait. La vie était belle. Deux fois par semaine, les amies ne mangeaient que des œufs durs et des tomates crues et, tous les matins, elles se pesaient, le cœur léger. Arrow atteignit les soixante-dix kilos et se sentit très jeune fille. Beatrice et Frank, en se
plaçant d'une certaine manière sur le plateau, ne dépassaient pas les quatre-vingt-cinq kilos.
Mais il était toujours aussi malaisé de mettre la main sur un quatrième au bridge. Celui-ci jouait comme un pied, celui-là était si lent qu'il vous rendait folle. Un tel était chicanier, un autre se montrait mauvais perdant, tel autre avait tout d'un escroc. Étrangement, elles
avaient le plus grand mal à trouver le bridgeur idéal.
Un matin, sur la terrasse donnant sur la mer, alors qu'elles prenaient en pyjama leur thé (sans sucre ni lait) avec les biscottes recommandées par le Dr Heudebert (garanties sans matière grasse), Frank leva la tête de son courrier.
- Lena Finch va descendre sur la Côte, annonça-t-elle.
- Qui est-ce ? demanda Arrow.
- Elle a épousé un de mes cousins, qui est mort il y a deux ou trois mois, et elle se remet d'une dépression nerveuse. Qu'en pensez-vous ? Si on l'invitait ici pour une quinzaine ?
- Elle bridge ? demanda Beatrice.
- Si elle bridge ! tonna Frank. C'est même une sacrée bridgeuse ! Du coup, nous pourrons être complètement indépendantes.
- Quel âge a-t-elle ? demanda Arrow.
- Elle a mon âge.
- L'idée me semble bonne...
Affaire conclue, Frank, avec son dynamisme habituel, sortit à grands pas, à peine terminé le petit déjeuner, pour envoyer un télégramme, et, trois jours plus tard, Lena Finch était là. Frank l'accueillit à sa descente du train. Lena portait un deuil strict mais discret en hommage
à son mari récemment disparu. Frank ne l'avait pas vue depuis deux ans. Elle l'embrassa chaleureusement et l'examina avec attention.
- Vous avez drôlement décollé, mon petit, dit-elle.
Lena dit, courageusement, en souriant :
- J 'ai eu des tas de malheurs ces derniers temps. Et j'ai pas mal maigri.
Frank poussa un soupir, mais il aurait été difficile de déterminer si elle soupirait d'envie ou de compassion pour la perte cruelle éprouvée par sa cousine.
Lena, néanmoins, ne paraissait pas outre mesure déprimée, et même, après un bain rapide, elle se déclara prête à accompagner Frank à Eden Roc. Frank présenta la nouvelle arrivée à ses deux amies et toutes les quatre allèrent s'asseoir dans le coin appelé "la Maison des
singes". C'était une sorte de véranda surplombant la mer, avec, au fond, un bar où se pressaient les estivants, en tenue de bain, pyjama ou peignoir, qui bavardaient et consommaient autour des tables. Le cœur tendre de Beatrice s'attendrit sur la veuve esseulée. Et Arrow, ayant constaté que Lena était pâle, que son physique était quelconque et qu'elle approchait de la cinquantaine, fut toute disposée à lui accorder son amitié. Un serveur s'approcha de leur table.
- Que prendrez-vous, ma petite Lena ? demanda Frank.
- Oh ! je ne sais pas, la même chose que vous, un Martini dry ou un White Lady...."

"The Casuarina Tree" (1926, "Le Sortilège malais")
Recueil de six nouvelles : "Before the Party", "P. and O.", "The Outstation", "The Force of Circumstance", "The Yellow Streak", "The
Letter".

John Cowper Powys (1872-1963)
"Endure or escape". Miller et Dreiser firent de Powys l'une des figures les plus fortes de la littérature contemporaine, parce qu'il entendait
ré-enchanter un monde alors submergé par un discours matérialiste et rationnel, dissoudre son identité sociale dans la contemplation sensuelle des paysages du Dorset et des montagnes du Pays de
Galles : et retrouver ainsi une sorte de conscience proto-humaine de l'existence ("Moi Ichtyosaure") dans laquelle le détail le plus sordide ou insolite rejoint la rêverie cosmique,
l'humain le non-humain. Comment parvenir à vivre dans une matérialité qui n'est perçue que comme contrainte ou hostilité, si ce n'est en développant une expérience des sens et en absorbant
par la contemplation toute l'essence du réel, nous affranchir ainsi des normes collectives et du poids de l'identité de notre humaine existence.

Né à Shirley (Derbyshire) d'un pasteur anglican, qui le marque fortement par son rigide manichéisme, et d'une mère masochiste et rêveuse, descendante des poètes Cowper et Donne, l'étrange personnalité névrotique de John Cowper vit une jeunesse exaltée dans un paysage du Dorset qui permet de donner libre cours à son imagination sans borne. Après des études de théologie à Cambridge et un mariage dont le bonheur fut médiocre, John Cowper quitte son Dorset natal pour un volontaire exil en Amérique (1905-1930), dont il sillonne presque tous les États comme conférencier : sa culture encyclopédique, ses improvisations, sa capacité à endosser les personnalités des écrivains qu'il présente, lui confèrent un succès considérable. Il publie quatre romans, inspirés de Thomas Hardy et de George Eliot, quatre recueils de poèmes, des essais critiques et philosophiques et obtient la consécration en 1929 avec "Wolf Solent", première étape du cycle des romans du Wessex : "A Glastonbury Romance" (1932), "Weymouth Sands" (1934), "Maiden Castle" (1936). La fin de sa vie s'écoula au pays de Galles, la culture celte devenant la principale source de son inspiration et d'une philosophie centrée sur la contemplation de la Nature et sur le pouvoir de l'imagination (Autobiography, 1934; Owen Glendower: An Historical Novel, 1941). Il mourut à Blaenau, Merioneth (North Wales).

"Wood and Stone" (1915)
"BOIS ET PIERRE", la première œuvre du romancier gallois, écrite alors qu'il avait plus de quarante ans : devaient suivre alors une quinzaine de romans, dont le dernier fut publié en 1960, à quatre-vingt-huit ans, parmi lesquels figurent "Wolf Solent", "Les Enchantements de Glastonbury", "Les Sables de la mer" et "Camp retranché", qui constituent avec le plus difficile, "Poríus", les points culminants de son oeuvre. Le titre annonce ce que sera dans l'ordre poétique la plus grande contribution de Powys au roman contemporain, une divination de la vie élémentale, une orchestration cosmique des drames humains, grâce auxquelles Powys tente, mieux que D. H. Lawrence et que Joyce, de dévoiler les secrets rapports de la créature et de l'univers dans l'ordre érotique. Le bois et la pierre représentent donc en quelque sorte la polarité harmonique de ce roman, sur laquelle se greffent et se modulent deux réflexions-démonstrations, l'une héritée de Nietzsche (la lutte séculaire entre l'instinct de puissance et l'instinct de sacrifice), l'autre, qui lutte contre la première, de Thomas Hardy, le grand romancier du Wessex, à qui le roman est dédié, et en qui Powys voit un des derniers représentants des "grands humanistes moelleux du passé".
Lutte donc entre discordance et harmonie. Géographiquement, brossée dans le premier chapitre, celle-ci est située dans le Somerset, vieux comté anglais plein, comme le Dorset, de vestiges de l'occupation romaine. Une carrière et son propriétaire, qui en est l'émanation; c'est Mr. Romer, et la pierre qu'il exploite : le pôle de la puissance se double d'une "sensualité sombre et perverse". Face à lui, Quincunx, paria au divin nom pythagoricien, sympathique et solitaire excentrique qui, "prenant un plaisir étrange et inversé à s'offrir nu à 'adversaire": il incarne la "mythologie du sacrifice". Les autres personnages se répartissent en obéissance à cette polarité fondamentale : Gladys Romer, la fille de la pierre, un démon blond dont la brune amie, Lacrima, Italienne exilée, est douce et angélique. Par la logique de leurs appartenances élémentales, l'une est assurée du triomphe tandis que l'autre paraît vouée à l'échec. En face d'elles deux frères, Luke et James Andersen, le coq un peu cynique et le tendre sentimental, amoureux de Lacrima. La mort du second conduira son frère à des réflexions sur le monde et la vie dans lesquelles on peut voir l'expression de la philosophie de l'auteur à cette époque. Il y a encore John Goring, l'associé de Romer, Mrs. Seldom et sa fille, Vennie, "l'une des rares femmes pour qui, même dans des conditions ordinaires, l'idée du sexe est dégoûtante et repoussante " (elle entrera au couvent), Mr. Wone, le candidat socialiste, dérisoirement opposé au puissant Romer; et, surtout, les deux hommes d'Eglise : Hugh Clavering, le pasteur rongé par la sexualité réprimée, et passablement ridiculisé dans une superbe scène de tentation qui le mène au voyeurisme, et Francis Taxater, le catholique, fin diplomate et d'excellentes manières, hommage révélateur de Powys à une religion qui toujours le fascina, et dont il a dit que, "si elle avait penché un peu plus du côté érotique", il l'aurait adoptée. Non pas une intrigue, conventionnelle, mais une galerie de portraits affirmant la correspondance entre l'univers psychique et l'univers élémental et qui s'achève par un magnifique finale sous la pluie...
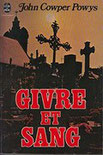
1925 - "Givre et sang" (Ducdame)
Givre et Sang est sans doute le roman le plus sombre de Powys, écrit sous le signe de la nuit, et celui avec lequel il achève, après "Bois et Pierre" et "Rodmoor", sa formation de romancier, il avait 53 ans, et ne faisait qu'aborder des années d'inspiration , phénomène rare en littérature, puisque vont paraître successivement "Wolf Solent", "Les Enchantements de Glastonbury", "Les Sables de la mer" et "Camp retranché", une dizaine d'années, 1925-1935, son chef d'oeuvr, "Porius", étant publié alors qu'il a près de quatre-vingt ans. Le titre, "Ducdame", est emprunté à "Comme il vous plaira", de Shakespeare, "Qu'est-ce que ce duc-dame", invocation grecque destinée à appeler les fous à faire le cercle.. Le pilier principal de l'oeuvre est représenté par les Ashover, famille de vieux propriétaires terriens qui sont les châtelains de la petite ville du Dorset, où se passe l`histoire. Comme les Andersen de "Bois et Pierre", les deux frères Ashover sont de caractères opposés mais complémentaires. Lexie, le plus jeune, dont le profil évoque celui de l`empereur Claude, est atteint d'une maladie incurable. Rook Ashover est quant à lui héros sombre et inquiétant (Rook ou "corbeau"), partagé, dans ce qui n'est au fond qu'une forme obsessionnelle de son puritanisme, entre trois femmes, Lady Ann, sa cousine, de la race dominante des Amazones, Netta Page, sa maîtresse, jeune fille de la ville qui fait partie des héroïnes tendres et douces de Powys, et Nell, la femme du pasteur William Hastings, pasteur solitaire. excentrique et demi-fou qui exultera de sa découverte, le dynamisme de l`univers est bipolaire, il existe une "immense énergie antivitale" qui tend aveuglément à détruire la vie.
Mais en fait Rook est surtout lié par un attachement dévorant à son frère Lexie, dont la vie est pour le moins menacée. Toute l'intrigue du livre va reposer sur le fait que Rook répugne aux liens du mariage et refuse l'idée même de paternité, refus qu'il partage avec Hastings - auteur, par ailleurs, d'un ouvrage sur la Destruction - et qui constitue, entre ces deux personnages, comme le reflet de leur fascination devant la mort. Car le vrai sujet de "Givre et Sang" est dans cet affrontement des forces de vie et de mort, même si, en fin de compte, sous la poussée des habitants du manoir, Rook épouse sa cousine Ann, mariage auquel il ne consentira que parce qu'il renchérit sur les liens du sang. La disparition de Netta, qui a décidé de fuir, l'attente de l'enfant de Lady Ann, la rivalité amoureuse des deux frères auprès de Nell, la présence angoissante de deux nains qui se révèleront être des bàtards, Ashover et surtout I'attrait dévastateur qu'exerce le paysage sur le comportement de Rook, tout cela va conduire peu à peu au déferlement d'une folie meurtrière. A l'arrière-plan de ces deux mondes de l'esprit et des sens, se devine un autre univers, hanté par la clarté de la lune (le givre), la voix des morts (le sang) et I'hérédité maudite des Ashover...
"... En s'approchant des sapins au sommet de la colline, Rook se surprit à rassembler les fils enchevêtrés de sa conscience en un pauvre écheveau. Un sentiment de culpabilité s'empara de lui et se mêla à son impuissance en face de ces événements précipités. Il évoqua tristement le temps où il avait hérité d'Ashover, l'époque ou toute sa sensibilité s'était fixée sur Lexie, et les longues conversations délicieuses, libres de toute responsabilité, qu'ils avaient eues sous les haies fleuries et embaumées, dans les champs de blé brûlants et près des berges de la rivière.
Il se souvint d'une certaine soirée de juin où, aux côtes de son frère, il avait vu s'enfoncer lentement dans les profondeurs d'un étang une grande salamandre au ventre orangé, tandis que montaient des champs le bourdonnement des lourdes faucheuses ainsi que l'odeur du trèfle fraîchement coupé, et que voltigeaient des libellules aux ailes indolentes; il avait alors répondu au bonheur parfait de Lexie par le désir malencontreux qu' "il arrive quelque chose de neuf et d'étrange".
Un an à peine après ce vœu funeste, il rencontrait Netta, et alors, que de soucis son impatience avait attirés sur eux tous ! Il essaya de cerner la faiblesse, ou plutôt le vice de sa nature, qui l'avait fourvoyé dans cette impasse. Si seulement il avait été capable d'une passion simple et unique, tout eût été si différent! C'était ce maudit détachement de son esprit, mêlé a cette sensualité froide et singulière, qui avait donné à son influence sur ses amis ce caractère maléfique. Si seulement il avait su se garder de l'amour des femmes! Sans doute sa nature était-elle semblable à celle des moines du Moyen Age pour qui tout contact féminin était néfaste, à cause, précisément, de ce manque étrange de sensibilité normale.
Parvenu à la Crête du Héron, immobile sous un des sapins, les yeux fixés sur les fraîches pousses vertes, humides et luisantes d'un plant d'arums sauvages, Rook fit un effort pathétique et désespéré pour se représenter la perspective de sa vie.
Il constata que tous ses rapports humains étaient empreints d'une froideur perverse de saurien : avec Netta, c'était une perversité mitigée de pitié, avec Ann une perversité teintée de camaraderie, avec Nell une perversité imbue de romanesque. Inconsciemment frappé par la forme bizarre de ces arums insolites, il se surprit à identifier sa propre ambiguïté au contour de leurs feuilles, et la nature de Lexie, tellement plus franche et plus saine, à l'épée pourpre dressée sans vergogne au milieu des pétales; et devant cette excroissance impudique issue de l'immense univers indifférent, il se prit à songer qu'il aurait mieux fait de cristalliser tous ses sentiments sur Lexie seul, et de satisfaire sa nature de satyre, si elle devenait par trop exigeante, par des rencontres éphémères dans les rues de la ville. Il comprit à quel point toutes ses relations avec les autres êtres, Ann, ou Netta, ou Nell, étaient en réalité superficielles, extérieures à sa secrète illusion vitale, extérieures au lien profond, subconscient, qui l'attachait à Lexie.
Et tandis qu'il laissait ses pensées descendre dangereusement cette pente, il fut soudain submergé par une peur morbide et angoissée de la vie, peur d'autant plus lourde et poignante qu'il avait pris des responsabilités vis-à-vis de trois femmes. Et dans cet air embaumé du printemps, il fut tenté de hurler comme une bête prise au piège. Pourquoi, ô pourquoi s`était-il laissé empêtrer de la sorte? Soudain, comme une marée amère des profondeurs, comme l'eau salée de la mer se mêlerait à l'eau douce d'une rivière, vint l'accabler le poids de ces diverses existences humaines qu'il avait marquées de façon si désastreuse. Leur vie devait leur sembler aussi importante qu'à ses yeux sa propre vie, et pourtant il avait cru pouvoir, dans son égoïsme aveugle, en disposer comme d'objets insensibles et inanimés. Il méritait assurément le fer qui le pénétrait à présent jusqu'à l'os! Avec une froide lucidité, il examina les étapes du scepticisme philosophique, du désenchantement spirituel qui l'avait peu à peu détaché du travail, de l'ambition et de tout projet. Il se rendit compte que c'était son refus de prendre au sérieux les problèmes essentiels de la vie qui avait attiré sur lui tant de catastrophes.
Lexie, qui avait un sens bien plus grand du réel, ne se serait jamais laissé prendre ainsi, parce qu'il considérait la vie comme une œuvre d'art et se conduisait en conséquence, avec sagacité et prudence, malgré son humour scandaleux.
Avec un soupir venu du fond de son âme, l'infortuné Rook s'éloigna du plant d'arums où il s'était comme enlisé, et descendit la pente de Battlefield en courant gauchement, comme au temps où Lexie se moquait de lui et le narguait, lorsqu'ils étaient enfants.
C'était comme si une vrille s'enfonçait en lui, dont la pointe aiguë grinçait sur le parchemin de son âme, ainsi que la mine d'un crayon sur une ardoise. Et il est probable que rien de ce qu'Ann, Netta ou Nell avaient eu ou auraient jamais à supporter par sa faute n'approchait de ce qui le poursuivait tandis qu'il descendait cette colline - une misère froide et cruelle comme un dogue meurtrier.
Arrivé au manoir, il entra par la porte de la cuisine, comme c'était son habitude et, avant lui, celle de son père...."
(traduction D.de Margerie, F.X.Jaujard, Seuil)
Alliance vécue ici de façon inégalable, entre une approche sensuelle des éléments et la tentation exaspérée du néant. Rook se sait condamné, se laisse envahir par l`idée de la mort, retrouve le dernier jour de septembre, Netta, de retour de Londres mais qui ne lui oppose qu'absolue indifférence alors qu'il lui avoue son manque total d`amour pour Ann: "Que n'était-il possible d'avoir des relations amoureuses avec les arbres, avec les éléments, comme en ont les personnages de la mythologie!".
Et c'est par une nuit de pluie torrentielle qui impose à la conscience de Rook l`image d'une noyade dans "ces vastes éléments inhumains ", que les tensions devenues intolérables se résolvent enfin.
Rook erre dans la forêt, noire de nuit, son élément naturel, et y trouve la mort. William Hastings, le pasteur a trouvé l'instant propice de sa froide vengeance, s'enfuit dans la nuit, se saisit d'un lourd rateau à bout de fer, toute une jalousie rentrée, bouillonnante ...
"Rook s'avançait à pas rapide vers le milieu du pont. Il ne voyait ni la palissade blanche à son côté, ni la rivière gonflée qui coulait à ses pieds, ni ligne imprécise de la route devant lui, et moins encore la silhouette accroupie. Ce qu'il vit fut le visage de Lexie à sa fenêtre. Ce qu'il vit fut l'expression de feinte consternation qu'il lui connaissait bien. Il entendit la voix de son frère l'interroger: Tout va-t-il bien pour l'enfant ? Et pour Ann? Pourquoi donc es-tu si bouleversé, Rook ? - Alors, avant même qu'il ait eu le temps de faire autre chose que ce bond mental par lequel l'esprit peut passer d'une réalité à l'autre, Hastings l'avait assailli. D'un coup terrible de son arme insolite, le pasteur frappa Rook à la tête, et le bras que Rock avait instinctivement levé pour se protéger ne heurta que le manche du râteau. Assommé par le coup, sans connaissance, Rook tomba lourdement en arrière contre un des balustres en bois du parapet. Sa charpente osseuse et massive fut trop lourde pour cette planche pourrie par les intempéries, qui céda dans un craquement sinistre, et inconscient, il fut précipité dans la rivière. Le visage renversé dans le courant rapide, il flottait à présent, privé de toute force, de toute résistance, et ne fut bientôt plus que la dépouille, la forme, l'image d'un homme. Le corps dériva entre les berges de la Frome, et les herbes balayèrent son visage, sourd aux éclaboussures et aux murmures des eaux noires et gonflées de pluie.
Le cadavre avait disparu dans les ténèbres - et même en plein jour, personne n'aurait sans doute pu l'apercevoir - lorsque William Hastings, ayant jeté son arme, émergea de la torpeur où il avait sombré après avoir frappé son coup meurtrier. Il s'occupa un moment, l'esprit vide et figé, à détacher, pour les jeter a l'eau, les morceaux de bois déchiquetés qui restaient suspendus au-dessus de la rivière. Puis, d'un pas lent et fatigué, il reprit le chemin par où il était venu. Abattu, terrasse par l'orage de la passion et par la tension physique qu'il avait éprouvée en cette journée, il ne put continuer longtemps sa marche. Bien avant d'atteindre le portail de la maison de l'Octroi, il se laissa tomber au bord de la route, tassé sur lui-même, fiévreux, hagard, et il perdit rapidement toute lucidité..."
En novembre. l'enfant d'Ann a un mois, Lexie recouvre lentement son vieil humour et Netta se recueille sur la tombe de Rook. Le roman s'achève par une scène singulière, l'arrivée d'un manège où se retrouvent Lexie et Nell ...

"Wolf Solent" (1929)
Wolf Solent, contraint de quitte son emploi de professeur pour s'être lancé dans une critique délirante du positivisme moderne, revient vers sa région
natale, le Dorset, s'y établit et accepte de rédiger une chronique des histoires salaces de la région pour un certain M.Urquhart. Mais Wolf non seulement est assailli par ses souvenirs,
notamment d'un père paillard et infidèle, mais rencontre deux femmes, Gerda Torp, une beauté locale et rustique qu'il épouse, et Christie Malakite, avec qui elle entretient une liaison
spirituelle. Le roman entre alors dans une nouvelle dimension qui oppose continuellement réalité et illusion, intériorité et normes sociales : Wolf ne parvient à accepter le pire, une femme qui
le trompe publiquement, à évoluer dans un monde social qui se révèle rapidement hostile, en se portant avec une immense joie intérieure vers l'inhumain des éléments naturels et le pouvoir sans
fin de son imagination, "a sinking onto his soul".
"Wolf himself, if pressed to describe his life-illusion, would have used some simple earthly metaphor. He would have said that his magnetic impulses ressembled the expanding of great vegetables leaves over a still pool - leaves nourished by hushed noons, by liquid, transparent nights, by all the movements of the elements - but making some inexplicable difference, merely by their spontaneous expansion, to the great hidden struggle always going on in Nature between the good and the evil forces."
"Si l'on avait pressé Wolf de décrire ce qu'il appelait son "illusion vitale", il aurait usé d'une métaphore terrestre. Il aurait expliqué que ses impulsions magnétiques étaient comme ces grandes feuilles vertes qui s'étalent à la surface immobiles des mares - nourries de furtifs soleils de midi et de nuits douces et transparentes, nourries des tous les mouvements des éléments - ces feuilles dont la croissance spontanée suffit, inexplicablement, à modifier l'équilibre entre les forces du Bien et du Mal s'affranchissant silencieusement au sein de la Nature."

"A Glastonbury Romance" (1932, Les Enchantements de Glastonbury)
Henry Miller, en lisant "A Glastonbury Romance", écrivit à Lawrence Durrell: "my head began bursting as I read. No, I said to myself, it is impossible
that any man can put all this - so much - down on paper. It is super-human."
Roman-fleuve de John Cowper Powys, qui compte quatre volumes : dans le premier volume, "Le testament", "la vision panoramique qu'il inaugure baigne à la
fois dans l'atmosphère contemporaine de la ville de Glastonbury et dans celle mythique de la geste du roi Arthur. Jamais Powys n'a été aussi loin dans sa peinture de la pitié, des obsessions
secrètes, des amours homosexuelles, des souvenirs-écrans de l'enfance, des désirs insatisfaits, de l'horreur et de la fascination mêlées à la violence."
The Will
At the striking of noon on a certain fifth of march, there occurred within a causal radius of Brandon railway-station and yet beyond the deepest pools of emptiness between the utter- most stellar systems one of those infinitesimal ripples in the creative silence of the First Cause which always occur when an exceptional stir of heightened consciousness agitates any living organism in this astronomical universe. Something passed at that moment, a wave, a motion, a vibration, too tenuous to be called magnetic, too subliminal to be called spiritual, between the soul of a particular human being who was emerging from a third-class carriage of the twelve-nineteen train from London and the divine- diabolic soul of the First Cause of all life.
1 - Le testament
"Ce 5 mars pendant que sonnait midi, des ondes infimes prirent naissance dans le rayon immédiat de la gare pour bientôt se répandre - sous, le silence créateur de la Cause Première, ainsi qu'il advient chaque fois que la conscience tend au paroxysme chez un habitant de notre univers - à travers les abîmes déployés entre les plus distantes des
galaxies. Dans cet instant, une vibration impondérable - trop ténue pour qu'on pût la dire magnétique, trop sublime pour qu'on pût la dire spirituelle - passa entre l'âme d'un certain voyageur du train de Londres, émergé d'un compartiment de troisième à l'arrêt de Brandon, et l'âme de la Cause Première, diabolique et divine, de laquelle toute vie procède.
De l'âme du grand soleil embrasé, dont les rayons foudroyaient à l'oblique la face du voyageur occupé à bien assujettir une valise noire dans sa main droite et un bâton de coudrier dans sa main gauche, de subtiles ondes d'une extrême puissance irradiaient aussi; mais entre celles-ci et les sentiments éprouvés par l'homme, seulement la relation la plus ténue et la plus impalpable. Ces ondes s'apparentaient davantage à l'état d'âme de certaines tribus, humaines vivant au cœur de l'Afrique, ou encore à celui de quelques rares sages à travers le monde, philosophes assez doués d'imagination pour reconnaître la personnalité consciente de l'astre ardent, dans son rayonnement magnétique partout dispensateur de la vie. Or si l'astre du jour par toute son immensité propulsait, irrésistibles, ses pensées de feu géantes, et s'il rugissait de formidables vagues qui se chevauchaient et s'amoncelaient, et s'estompaient puis gagnaient du terrain, très turbulente aura d'activité psychique, et l'expression même de l'énergie concentrée dans la chimie d'un corps de colosse - pourtant le système nerveux du microscopique bipède en était moins affecté que par la bise qui lui soufflait au visage.
Pardessus boutonné jusqu'au cou et doigts crispés sur sa canne et sur sa valise, le voyageur gagnait la sortie, et ce qu'il éprouvait, de façon consciente et floue, s'apparentait bien davantage à l'ample registre des émois rêveurs de la vie conçue suivant l'âme de la terre.
Mystérieusement au fait de chaque et de toute conscience, humaine et infra-humaine, par elle mise au monde, la terre aurait fort bien pu inspirer et d'une vibrante manière celui-ci de ses enfants, qui tendit à midi vingt son billet au chef de gare, puis s'engagea sur l'étroite route poussiéreuse qui mène à la lande de Brandon. Mais que la terre se fût désintéressée du sort du voyageur s'explique bien facilement puisque celui-ci ne sollicita pas son intercession ; au lieu de prier la terre, il s'en remettait habituellement à l'âme de sa mère défunte. Exigeants et jaloux sont tous les dieux, et tout culte partagé leur inspire une aversion profonde.
Avant de s'éloigner du quai, John Crow avait jeté un coup d'œil furtif et soupçonneux sur le groupe des autres voyageurs groupés autour des bagages qu'on venait de tirer du fourgon. Dans l'état d'esprit confus qui était le sien, il avait cru que tous ces gens sans exception s'étaient habillés pour des obsèques. Lui-même avait mis une cravate noire et portait, cousu sur la manche, un crêpe de deuil bien visible.
Heureusement, se dit-il, en marchant vent debout le long de la route, que j'ai pu acheter précipitamment une cravate noire chez M. Teste. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit si Lisette n'avait pas fini par m'y obliger.
A trente-cinq ans, John Crow était un être frêle et d'un physique mal défini. Orphelin à vingt ans et laissé sans ressources, il avait de ce jour-là connu à Paris une existence précaire et plus ou moins sordide. Cette vie irrégulière avait marqué d'une empreinte forte les traits d'un visage amaigri et farouche. Ce visage faisait incertainement penser soit à la faiblesse du clochard congénital promis à la déchéance en chute libre, et dans ce cas on remarquait surtout la bouche qui avait l'air de s'affaisser ; soit à un Don Quichotte, à un détraqué de l'idéalisme, les hautes pommettes bien en évidence. L'attention se portait également sur un aspect contradictoire et assez inquiétant de la physionomie. Au-dessous des yeux et du renfoncement accusé des orbites, les joues étaient agitées d'un tremblement spasmodique; cette particularité allait de pair avec une contraction furtive des paupières, où se révélait quelque chose d'oblique, presque d'un renard. Or ces traits étranges formaient un contraste déconcertant avec l'expression du regard. Celle-ci faisait penser bel et bien à des sirènes sans âme humaine, telles les créations marines de Scopas.
A cold blue sky and a biting east wind were John Crow’s companions now as he took the bare grass-edged road towards Bran- don Heath. The raw physical discomfort produced by this wind, and the gathering together of his bodily forces to contend, with it, soon brought down by several pegs the emotional excitement in which he had left the train. That magnetic ripple in the divine- diabolic soul of the creative energy beyond space and time which had corresponded to, if not directly caused, his agitated state, sank back in reciprocal quiescence; and the physical tenseness and strain which he now experienced were answered in the far-off First Cause by an indrawn passivity as if some portion of that fount of life fell under the constriction of freezing.
The soundless roaring of the great solar furnace up there in the vast ether became, too, at that moment worse than merely indifferent to the motions of this infinitesimal creature advancing into the bracken- grown expanses of the historic Heath, like a black ant into a flowerpot.
Avançant vers la lande de Brandon sur la route dénudée entre ses bordures herbeuses, John Crow avait pour compagnons le ciel bleu et froid, et le mordant vent d'est. Eprouvé physiquement par ce vent désagréable, il rassemblait ses forces contre lui, et par le fait même son état de surexcitation à la descente du train s'était beaucoup atténué. L'âme diabolique et divine de l'énergie créatrice avait émis ce magnétisme des ondes où, par-delà espace et temps, sa propre fébrilité anxieuse s'était reflétée, si même elle n'en avait pas été la conséquence directe; et maintenant les ondes se retiraient, dans une quiétude qui l'atteignait semblablement.
A la tension physique qui était devenue sienne répondait, dans le lointain tréfonds de la Cause Première, une passivité en retrait, comme si quelque élément de la fontaine de vie s'était pétrifié de froid. Là-haut, c'était l'inaudible rugissement du grand brasier solaire cloué fixe dans l'infini de l'espace; et le brasier tout à coup fut pire qu'indifférent aux actes de la créature minuscule. Celle-ci progressait parmi les fougères de la lande illustre, comme une fourmi noire dans un pot de fleurs.
La démarche du voyageur était lasse, et bientôt il ralentit l'allure, quoique lui fût apparu, fraîchement repeint, le poteau indicateur : «Vers Northwold» . L'astre tout à son rugissement et à son tournoiement, pris au lacs de confluence, entre les maelströms de gaz ardents figure maîtresse de la tornade créatrice, demeurait à cet instant sur le quant à soi. C'est que l'âme du soleil assimilait John Crow, non seulement à ces êtres qui négligent d'invoquer les divins pouvoirs, mais encore à ces êtres qui dans leur impiété rationnelle et maligne catégoriquement dénient toute espèce de conscience à l'astre sublime. Néanmoins, entre toutes les autres grandes divinités qui entouraient le voyageur, la terre demeurait la plus envieuse, et la plus hostile. John Crow se rendait dans la maison de sa défunte mère sous l'empire d'une misanthropie âpre et sans partage, et cela, l'âme de la terre devait obscurément l'éprouver.
Aussi, elle qui prodiguait ses vibrations aux bourgeons vert-jaune des haies d'aubépine, aux tendres fleurs blanches des épines noires, aux crosses timides des fougères et aux teintes nacrées des célidoines, à John Crow déniait l'exquis bien-être et le bien premier, qu'elle répandait alentour. Que la pensée de sa mère l'ait rendu triste à ce point, c'était un fait étrange, qu'il n'était pas à même d'analyser. Comment aurait-il pu savoir que, si nourries pourtant de connaissance multiple - mousses humides et vertes, sèches écailles des lichens, odeur exaltante et douce des ajoncs épineux, racines fragiles des crocus aux fleurs lilas, gonflement opiniâtre des calices laineux des fleurs de coucou, vies embryonnaires des œufs des fauvettes sous la miraculeuse protection d'une coquille bleue - les pensées de la terre-mère céderaient aux émois et affres d'une jalousie morose, et indéfinissable et insatiable, envers une mère humaine ?
La tête légèrement penchée sur le col haut boutonné de sa redingote, John Crow se ressouvenait de différents moments de ses nuits récentes, passées en compagnie de la jeune Lisette et du vieux Pierre. Et alors même qu'il affrontait le vent d'est glacial, ces moments lui revenaient à l'esprit, tout imprégnés des odeurs subtiles d'une rue du Quartier latin. Il revoyait la camelote bien entretenue qui constituait tout l'intérieur de Lisette, et la photographie de lui-même, prise à la foire de Saint-Cloud, dont Lisette avait garni le dessus de cheminée. ll revoyait les dérisoires rideaux de mousseline retenus par un gros noeud de satin vert, et la grande glace fêlée, avec des amours baroques sculptés dans les coins (un angle dédoré laissait transparaître les cicatrices du bois mis à nu, noirâtre comme après un commencement d'incendie). Il revoyait ces choses sur l'horizon gris et lointain, là où on lui avait si souvent dit de distinguer, par-delà des lieues et des lieues de plaines marécageuses, les puissantes tours de la cathédrale d'Ely. Il revoyait ces choses alors qu'il avait sous les yeux les aubépines rabougries que le lichen blanchissait. Il les revoyait devant les crosses nouveau-nées des fougères, raidies de sève jaune, protégées du vent par le feuillage desséché de l'année précédente, et tapies innombrables comme autant de serpents tachetés, plus forts de savoir prendre la vie à la gorge. Il les revoyait devant les troncs rouges et tordus des pins sylvestres massés. ci et là, devant les prestes queues blanches de lapins de garenne qui détalaient, devant les ailes déployées des émouchets solitaires.
Et inlassablement il se redisait, "Philip aura tout l'argent de grand-mère, bien entendu. Bien entendu, c'est à Philip que tout l'argent de grand-mère reviendra".
Quand il fut parvenu à l'endroit où la lande de Brandon semble se rassembler en elle-même et acquérir sa personnalité entière, enfin que de tout son haut et sur le mode inquisiteur elle a l'air de dire, Et qui donc es-tu, étranger du diable ? En réponse à cette exclamation furibonde John Crow grommela d'abord, histoire de relever le gant, puis il rétorqua, afin de faire connaître à ces lieux qu'il n'était pas le commun chemineau : "j'obtiendrai de Philip qu'il me fasse une situation à Glastonbury". Il avait fait route maintenant depuis près d'une heure, et il était allé bon pas ; car la morsure de l'air froid attisait en lui, eût-on dit, une énergie inspirée et maligne, et il avançait en défiant le vent et le soleil, et l'hostilité de la terre. Il commençait de s'apercevoir que le paysage de la lande se muait peu à peu en un paysage de campagne peuplé de fermes, quand il entendit venir derrière lui une voiture rapide...."
Dans le second volume, " John Cowper Powys analyse avec une hardiesse toute moderne les nuances du désir. Chacun des personnages incarne un aspect ou une virtualité de la personnalité de l'auteur. On retrouve John Crow : il est partagé entre son amour pour sa cousine et sa passion pour Tom Barter et ses visions, entre autres celle qu'il a de l'épée du roi Arthur, autant d'étapes dans l'itinéraire spirituel de l'auteur."
Dans le troisième tome, "John Cowper Powys jette un coup d'œil plus général sur Glastonbury qui devient le creuset de la mythologie propre et l'apparente à un monde archaïque où revivent les légendes celtes, en particulier le Graal. Au contact de la force étrange qui en émane les sentiments se concentrent, les passions s'exacerbent et créent la légende de Glastonbury".
Enfin, dans le dernier volume, "les situations et les passions évoquées dans Le Testament, La Crucifixion et Le Miracle, éclatent avec les grandes marées d'équinoxe de mars. Chacun des habitants de Glastonbury parvient alors à l'apogée de son destin. John Geard, qui est la projection magnifiée de Powys tel qu'il s'est toujours rêvé, meurt en apothéose dans la scène finale du déluge au moment où lui apparaît Cybèle, la déesse virile couronnée de tours, symbole de cette constante de l'œuvre : l'androgyne." (Editions Gallimard)

"Weymouth Sands" (1934, "Les Sables de la mer")
"Sous un nom imaginaire, Weymouth est le théâtre où John Cowper Powys met en scène une passionnante troupe de « pantins planétaires » : professeur de latin
louvoyant autour des écueils de l'érotisme, prophète persécuté nimbé d'étranges lueurs mystico-grotesques, homme d'affaires qui puise sa raison d'être dans les profondeurs de son coffre-fort,
homme de la mer uni aux éléments par sa puissante vitalité, vierges folles, vierges sages, bien d'autres premiers rôles et nombre de figurants. Qu'on nous les montre sous un jour tragique ou
cocasse, en proie à leurs rêves ou à leurs idées fixes, amarrés au quotidien ou entraînés vers un tournant entre tous marquant de leur vie, ces hommes et ces femmes se révèlent dans leur vérité
la plus secrète. Aux fils de leurs jours s'entrecroisent les thèmes typiques de l’oeuvre de John Cowper Powys : hantises de déviations sexuelles et mentales, extatiques communications entre
l'animé et l'inanimé, le tout traversé de visions, de rumeurs et de souffles qui donnent à l'ensemble une prodigieuse ampleur cosmique orchestrée par le rythme inlassable, antédiluvien de la
mer." (Le Livre de Poche, LGF)
"As he tossed from side to side in that windless, starlit silence, with the sea-airs
from the unruffled West Bay flowing in through their open window, there came moments when his hold on objective reality
grew
faint, and when a strange exultation seized him, made up of his love's lost maidenhead
and his passionate possession of her, made up of the wild mixing of their blood ; and in the tide of this exultation he felt
as if blood and death and the blow with which he would rid the world of the Dog, were all part of some mystical transaction, beautiful, terrible, miraculous, that he had
only to carry to its appointed end, to redeem all. It must have been about three o'clock when this final
exultation came upon him. For a long time he had been answering to something in that feverish half-sleep, to something which held out a clue, a solution. Once he had disturbed
the girl by a start and a jerk and a convulsed groan.
"Blood . . . blood," he had heard her repeat; but she had sunk again into
unconsciousness; and he took it for granted that she had no notion of what he was suffering in his mind.
But this "something" in his half-sleep which had been the clue to everything — what was
it? It had seemed to him a complete solution, turning everything to peace, to satisfaction . . . but what was it?
When he recalled it now, in this cold, clear, deadly lucidity into which he had roused himself, it seemed to him as though it had been the Clipping Stone! But how could the
Clipping Stone be a clue to anything — least of all to what he was going to do to the Dog? The Jobber began
to suffer. A cold, grey, not-to-be-pushed-off wedge of desolate misery seemed to come in now through that window opposite him. He felt as if in the act of possessing Perdita he had lost his main-spring. All was
done, all was over. To sink down upon blood and ashes and let what must be be — that was
all that remained..."
"Tandis qu'il s'agitait ainsi dans le silence de cette nuit calme qu'éclairaient les étoiles, qu'éventaient de douces brises marines exhalées par la
Plage de Galets et pénétrant par la fenêtre ouverte, son sens de la réalité objective par instants s'affaiblissait. Skald était saisi par les transports étranges d'une joie triomphante faite des
souvenirs de la nuit, de la virginité ravie de sa bien-aimée, de la passion qu'il avait mise à la faire sienne, de la mêlée fougueuse de leur chair. Et à mesure que grandissait cette exaltation
il avait le sentiment que le sang, la mort, le coup par lequel il allait débarrasser le monde du Bouledogue étaient les éléments d'une transaction mystique terrible, magnifique, miraculeuse,
qu'il n'avait qu'à mener à bien pour que tout fût racheté. Il devait être environ trois heures quand cette sensation de victoire le souleva pour la dernière fois. Dans son demi-sommeil fiévreux,
depuis longtemps, quelque chose en lui répondait à un appel, à une voix qui proposait un éclaircissement, une solution. Une fois il avait par un sursaut, un gémissement convulsif, dérangé Perdita
et l'avait entendue répéter :
« Du sang... du sang... » puis elle était retombée dans son inconscience. Il prit
pour allant de soi qu'elle ignorait ce qu'il endurait. Mais qu'était-ce donc qui, dans ce demi-sommeil, venait de lui apporter la clef de tout, lui avait paru contenir la solution parfaite, le
moyen de tout dénouer dans la paix et le contentement? Qu'était-ce donc? Dans l'état de lucidité implacable où il s'éveillait à présent il lui semblait que c'était la Pierre de l'Étau ! Mais
comment? La Pierre ne pouvait rien arranger ! Et moins encore en ce cas qu'en tout autre !
Elle n'avait aucun rapport avec l'affaire qu'il allait régler ! Aucun rapport avec le Bouledogue ! Skald commença à souffrir. Grise, glaçante,
déchirante, impossible à repousser, une détresse semblait enfoncer son tranchant par la fenêtre qui lui faisait face. Il avait l'impression qu'en prenant Perdita il avait perdu son mobile
essentiel. Tout était fini. S'enfoncer dans le sang et la cendre, laisser ce qui devait arriver arriver — rien d'autre ne restait à faire..."
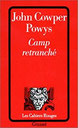
"Maiden Castle" (1936, "Camp retranché")
"Dans Camp retranché (1936), des personnages plutôt complexes s'entrecroisent. Ils portent le lourd fardeau des obsessions de l'auteur: hantise du joug
paternel, déviations sexuelles et mentales, sensations érotico-mystiques. Dorchester devient une ville enchantée..." (Editions Grasset)

"Autobiography" (1934)
"John Cowper Powys naît dans un presbytère de l'ère victorienne où le pasteur, son père, tel un démiurge nimbé de légendes druidiques, le marque de son
empreinte en lui ouvrant, non les voies du Seigneur, mais l'univers du fétichisme. Sa mère figure seulement sous le voile d'une dédicace et il ne fera que d'hermétiques allusions à ses sœurs et à
sa femme dans ce «récit de son aventure humaine». Enfant, il est tourmenté par la peur et le sadisme, mais exalté par le sentiment d'être magicien et les enchantements des sables de la mer. Jeune
homme, il entre en extatiques communications avec «l'inanimé», mais il hante Brighton et ses casinos, comme il courra ensuite les «burlesques» américains, harcelé par son vice érotico-mystique de
«moine satyre». C'est un «rat de bibliothèque», mais c'est aussi un «acteur-né», qui, durant vingt ans, exercera aux États-Unis un don magnétique de «conférencier ambulant». C'est un obsédé qui
oscillera souvent sur les bords de la démence mais qui, à soixante ans (et ici se devine une présence féminine aussi précieuse que discrète), a dompté ses démons : devenu démiurge à son tour, il
anime les personnages de son Autobiographie et de ses grands romans du souffle protéen de son génie." (Editions Gallimard) Les pages les
plus révélatrices sont celles consacrées à l'analyse de son évolution d'une ambisexualité obsédante jusqu'à une sorte de pansexualité cosmique. La conquête sur lui-même et à laquelle il consacra
la moitié de sa vie fut celle de l'acceptation du principe féminin qui sous-tendait sa vie. Et ce fils de pasteur, si peu esthète, si peu artiste, trouva dans la création littéraire le souffle
qui lui donna existence ...
