- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814), "Les Cent Vingt Journées de Sodome" ou "l'Ecole du libertinage" (1785), "Justine ou les Malheurs de la vertu" (1791-1797), "La Philosophie dans le boudoir" (1795), "Aline et Valcour" (1795), "Juliette ou les Prospérités du vice" (1797)- ...
Last update 10/10/2021
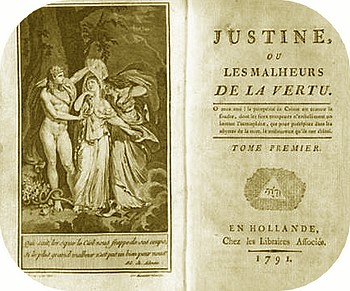
Le sadisme n'est pas un nom donné à une pratique aussi ancienne qu'Eros, écrovait Michel Foucault (Madness and civilisation), mais c'est bien un fait culturel massif qui apparaît précisément à la fin du XVIIIe siècle, et qui constitue l'une des plus grandes conversions de l'imaginaire occidental, une déraison transformée en délire du cœur, en folie du désir, en dialogue insensé de l'amour et de la mort dans la présomption illimitée de l'appétit... - LE MARQUIS DE SADE (1740-1814), libertin lui-même, ne revendiquait pas pour ses livres une ambition morale autre que la recherche du plaisir, effrénée parce que toujours insatisfaite. "Justine au les malheurs de la vertu" (1791), puis "Juliette ou les prospérités du vice" (1798) sont les œuvres d'un anticonformiste qui, par prédilection, célèbre l'érotisme dans le paroxysme où il rejoint la cruauté. Les outrances mêmes ont valu à cette œuvre curieuse un ostracisme tenace, sans doute excessif, ou bien à l'opposé une admiration de principe, sans doute excessive elle aussi ...
Il passa quelques vingt-sept années, dont quatorze de son âge mûr, dans onze prisons différentes et, longtemps exclu de l'histoire littéraire et cantonné dans l'histoire psychiatrique, le nom de Sade a mis longtemps pour s'imposer : même si, de Lamartine à Flaubert, on peut constater son influence souterraine au XIXe s. Le jugement esthétique reste difficile sur une œuvre qui se situe aux confins de la littérature, dont l'écriture et la lecture ont tant suscité jadis scandales et polémiques....
Écrivain de l'extrême, Sade décrit une société et un système de relations sociales sur le déclin, les dernières années de l'ancien régime en France. Les histoires de Justine et Juliette se déroulent à une époque précédant immédiatement la Révolution française. Les Cent Vingt Journées de Sodome se déroulent au XVIIe siècle. Ses héros ont financé leurs ébats meurtriers grâce aux vastes profits de la guerre de Trente Ans. La Philosophie dans le boudoir se déroule entre 1789 et 1793 ; à l'extérieur de la pièce où se déroule l'action de cet intermède dramatique, on vend des pamphlets révolutionnaires sur les marches du Palais de l'Égalité, mais les acteurs du boudoir sont des aristocrates, des membres d'une classe privilégiée. Dans toutes ces fictions, Sade travaille avant tout sur le mode de la pornographie ; il utilise ce mode pour faire une satire particulièrement féroce de l'humanité, et le temps historique dans lequel se situent les romans est essentiel à la satire.
Mais Sade dépasse non seulement la plupart des satiristes et des pornographes, mais se surprend à croire, par intermittence, qu'il est possible de transformer radicalement la société et, avec elle, la nature humaine. Ce n'est qu'alors que la liberté serait envisageable, pour l'heure, la liberté d'une classe, d'un sexe ou d'un individu nécessite la non-liberté des autres.
Et plus encore, très singulièrement, à la différence d'un pornographe assumé en tant que tel, Sade décrit décrit les relations sexuelles dans le contexte d'une société qui, - si elle ne connaît pas la liberté mais la pure exploitation, généralement par des hommes sur des femmes -, la sexualité n'y est pas pour autant un paradis artificiel mais un modèle de l'enfer et de la souffrance. Il nous dit très explicitement que dans toutes les orgies qu'il nous relate, la main qui fouette est toujours celle qui détient le véritable pouvoir (politique ou de fait) et que la victime, elle, en est totalement dénuée.
Sade a ainsi la très singulière capacité de rendre suspect chaque aspect de la sexualité, toute tendresse est fausse, trompeuse, piégée, tout plaisir contient en lui-même les germes de quelques atrocités. La vertueuse sera condamnée à passer une vie dans laquelle elle ne rencontra jamais un seul moment de jouissance, et Juliette, sa sœur et son antithèse, va se déshumaniser complètement dans la recherche du plaisir....
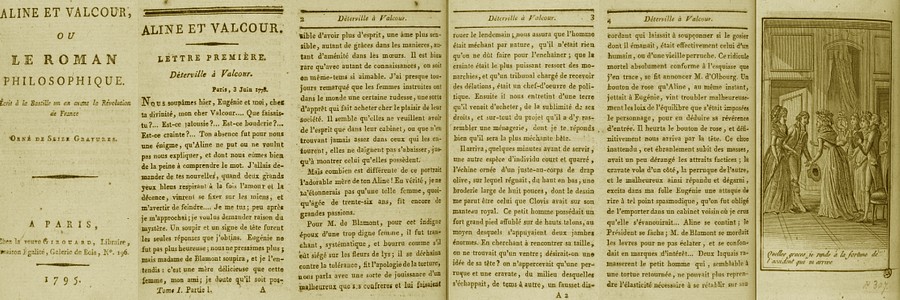

Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814)
Donatien Alphonse François, comte de Sade, plus connu sous le nom de Marquis de Sade, eut une réaction très singulière aux changements de cette fin du XVIIIe : un intérêt soudain pour la relation entre le pouvoir, la douleur et le plaisir, qui inspirera le terme "sadisme". Sans les Surréalistes, au début du XXe siècle, peut-être n'aurait-il pas connu une telle renommée...
Né d'une vieille famille provençale dont le château est situé à Lacoste, non loin d'Avignon, le jeune aristocrate est envoyé en Provence, où l'accueillent ses tantes, puis son oncle, l'abbé de Sade, correspondant érudit de Voltaire mais aussi libertin qui a des démêlés avec la justice. A dix ans, le marquis de Sade fut mis au collège Louis-le-Grand. A quatorze ans, il entra dans les chevaux-légers, d'où il passa, comme sous-lieutenant, au régiment du roi. II devint ensuite lieutenant de carabiniers et gagna sur les champs de bataille, en Allemagne, pendant la guerre de Sept Ans, le grade de capitaine. Réformé à la signature du traité de Paris, il revint à Paris et épousa le 17 mai 1763, contre son gré, Renée-Pélagie de Montreuil, issue de la petite noblesse de robe, mais richement dotée. Il eût préféré, nous dit-on, se marier avec la sœur cadette de celle-ci. Celle qu'il aimait ayant été mise dans un couvent, il éprouva un si grand dépit qu'il sombra dans la débauche. En fait, le marquis de Sade a donné beaucoup de détails autobiographiques sur son enfance et sa jeunesse dans "Aline el Valcour", où il s'est peint sous le nom de Valcour. On trouverait peut-être dans "Juliette" des détails sur son séjour en Allemagne. Quatre mois après son mariage, il était emprisonné à Vincennes. En 1768 éclata le scandale de la veuve Rose Keller, accusant Sade d'avoir flagellé une femme qu'il avait fait mettre nue et attaché à un arbre. Cette affaire entraîna le second emprisonnement du marquis de Sade, au château de Saumur, puis à la prison de Pierre-Encise, à Lyon. Au bout de six semaines, il fut remis en liberté. En juin 1772 a lieu l'affaire de Marseille, une orgie rassemblant autour de Sade et de son domestique plusieurs prostituées auxquelles des doses d'aphrodisiaques font croire qu'elles sont empoisonnées. Elles témoignent de sodomie et de pratiques homosexuelles entre Sade et son valet. Les deux hommes s'enfuient et sont condamnés à mort par contumace. Sade séduit sa belle-sœur chanoinesse, avec laquelle il part en Italie. Il est bien vite arrêté. Sa vie n'est plus dès lors qu'une alternance de séjours en prison et de quelques rares périodes de liberté. S'étant plusieurs fois enfui grâce à la complicité de sa femme, il est toujours repris.
Après avoir parcouru quelques grandes villes, il voulut se rapprocher de la France et vint à Chambéry, où il fut arrêté par la police sarde et incarcéré au château de Miolans, le 8 décembre 1772, mais parvint à s'échapper. Après un court séjour en Italie, il rentra en France et reprit, au château de la Cosle, sa vie de débauches. Il venait assez souvent à Paris, où il fut arrêté le 14 janvier 1777 et conduit au donjon de Vincennes et, de là, transféré à Aix, où un arrêt du 30 juin 1778 cassa la sentence de 1772. Un nouvel arrêt le condamna, pour les faits de débauche outrée, à ne pas aller à Marseille pendant trois années. Pendant qu'on le menait d'Aix à Vincennes, il s'échappa encore grâce à sa femme et fut arrêté quelques mois après au château de la Coste.
En avril 1779, à 39 ans, il fut enfermé de nouveau à Vincennes, d'où il ne devait plus sortir que pour entrer à la Bastille, le 29 février 1784. Il y écrivit la plupart de ses ouvrages. En 1782, il rédige le Dialogue entre un prêtre et un moribond, dialogue dans la tradition des débats d'idées fréquents au XVIIIe s., et, en 1785, "les Cent Vingt Journées de Sodome", qui poussent d'emblée le libertinage à ses extrêmes limites. Il écrit ensuite un conte à la Voltaire, "les Infortunes de la vertu", et "Aline et Valcour", ambitieux roman philosophique....
En 1789, ayant connu la Révolution qui se préparait, le marquis de Sade eut des démêlés avec le gouverneur de la Bastille, la prison était par ailleurs presque déserte. Le 4 juillet, il était transféré à l'hospice des fous de Charenton. Puis un décret de l'Assemblée constituante sur les lettres de cachet rendit au marquis sa liberté et il sortit de la maison de Charenton le 23 mars 1790. Sa femme, qui s'était retirée au couvent de Saint-Aure, ne voulut plus le revoir et mourut, dans son château d'Echauffour, le 7 juillet 1810.
En liberté, le marquis de Sade mena alors une vie régulière, vivant de sa plume et publiant ses ouvrages, faisant jouer des pièces à Paris, à Versailles, se montra un véritable Républicain en assistant assidument aux séances de la Société populaire de sa section, et en vint à exprimer en politique un certain nombre d'idées. Suspect, sans doute à cause de ses déclamations contre la peine de mort, il fut arrêté le 6 décembre 1793, mais remis en liberté en octobre 1794. Sous le Directoire, le marquis cessa de s'occuper de politique et recevait beaucoup de monde rue du Pot-de- Fer-Saint-Sulpice. Il avait alors 54 ans.
Au mois de juillet 1800, le marquis fit paraître "Zoloé el ses deux acolytes", roman à clef qui provoqua un énorme scandale, dans lequel on y reconnaissait le Premier Consul (d'Orsec, anagramme de Corse), Joséphine (Zoloé), Mme Tallien (Laureda), Mme Visconti (Volsange), Barras (Sabar), Tallien (Fessinol).
Son arrestation fut décidée le 5 mars 1801 ; il fut arrêté chez son éditeur, à qui il devait remettre un manuscrit remanié de Juliette qui servit de prétexte à cette arrestation. Il fut enfermé à Sainte-Pélagie, de là transféré à l'hôpital de Bicêtre, comme fou, et enfin enfermé à l'hospice de Charenton le 27 avril 1803. Il y mourut, à l'âge de soixante-quinze ans, le 2 décembre 1814, ayant passé vingt-sept années, dont quatorze de son âge mûr, dans onze prisons différentes. Et on ne dispose de portrait authentique du marquis de Sade. Restif de la Bretonne, qui connaissait bien ses ouvrages, imprimés ou manuscrits, ne l'a jamais rencontré. « C'est, dit-il dans "Monsieur Nicolas", un homme à longue barbe blanche qu'on porta en triomphe en le tirant de la Bastille.» ...

1785 – "Les 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage"
Alors qu'il était emprisonné à la Bastille, Sade écrivit "Les cent vingt journées de Sodome". Il sera publié en 1904 par le psychiatre allemand Iwan Bloch sous le pseudonyme d'Eugen Duehren, pour qui Sade, cent ans avant Richard von Krafft-Ebing, le précurseur de la psychopathologie sexuelle, dressant la nomenclature de toutes les passions dans leurs rapports avec l'instinct sexuel.
A la fin du règne de Louis XIV, peu avant le commencement de la Régence, au moment où le peuple français avait été appauvri par les différentes guerres du roi Soleil, et tandis qu'un
petit nombre de vampires avaient sucé le sang de la nation, s'étaient enrichis de la misère générale, quatre libertins (un duc, un juge, un financier, un prince de l'Église) s'enferment dans un château fort de la Forêt-Noire pour assouvir toutes leurs passions sur une vingtaine de victimes des deux sexes...
Le duc de Blangis et son frère, l'archevêque de..., établissent avant tout un plan dont ils font part à l'infâme Durcet et au président Curval. Afin d'être mieux liés l'un à l'autre, ils épousent avant tout chacun la fille de l'autre, font caisse commune et destinent annuellement deux millions à leurs plaisirs. On engage quatre maquerelles pour le recrutement des filles et quatre appareilleurs pour celui des garçons, et quatre soupers galants sont donnés chaque mois dans quatre petites maisons de quatre différents quartiers de Paris.
Avant tout, l'auteur trace le portrait du duc de Blangis et nous met au courant de son existence. Maître à 18 ans d'une fortune énorme, il l'a grossie par un grand nombre d'escroqueries et de crimes. Il a toutes les passions, tous les vices ; son coeur est le plus dur qui soit. Il a commis tous les crimes, toutes les infamies. On doit être méchant complètement et non « vertueux dans le crime et criminel dans la vertu». Le vice est pour lui la source des « plus délicieuses voluptés ». Il est d'avis que la raison du plus forl est toujours la meilleure. Il a tué sa mère, violé sa sœur. A 23 ans il s'est lié avec «trois compagnons de vices ». Il se livre au brigandage, enlève deux jolies filles des bras de leur mère au bal de l'Opéra. Il tue sa femme, épouse la maîtresse de son frère, mère d'Aline, une héroïne du roman. En fait de stature, c'est un Hercule. Cet homme, qui a maintenant 50 ans, est le « chef-d'œuvre de la Nature ». On prendrait ce blasphémateur pour le dieu même de la lubricité. II est si fort qu'il pourrait écraser un cheval entre ses jambes. Ses excès de bouche sont inimaginables. II boit dix bouteilles de bourgogne à chacun de ses repas...
L'archevêque, son frère, lui ressemble, mais il est moins fort et plus spirituel. Sa santé est moins insolente, il est plus raffiné. Il a 45 ans, de beaux yeux, une vilaine bouche et un corps efféminé. Le doyen de ces débauchés a 60 ans, c'est le président de Curval ; grand, maigre et sec, il a l'air d'un squelette. Son long nez s'effile au-dessus d'une bouche livide. Il est couvert de poils comme un satyre. Il est impotent. Il a toujours aimé le crime : « Il se fit chercher des victimes partout pour les immoler à la perversion de ses goûts. » Ce qu'il aime le mieux, ce sont les empoisonnements. Enfin, le quatrième libertin, Durcet, a 53 ans ; il est efféminé, petit, gros et gras. Son visage est poupin. Il s'enorgueillit d'avoir une peau très blanche, des hanches de femme, une voix douce et agréable. Cet aspect dénote évidemment un cinède, et dès sa jeunesse il fut le giton du duc.
Après les portraits des débauchés, voici ceux de leurs épouses. Constance, la femme du duc et fille de Durcet, est une grande femme mince, faite à peindre ; on dirait d'un lis ; ses traits sont pleins de noblesse et ont de la finesse. Elle a de grands yeux noirs pleins de feu, des petites dents très blanches, elle a maintenant 22 ans. Son père l'a plutôt élevée comme si elle avait été sa maîtresse que comme sa fille, sans pouvoir cependant la dépouiller de sa bonté de cœur ni de sa pudeur. Adélaïde, femme de Durcet et fille du président de Curval, est une beauté d'une autre sorte que la brune Constance. Elle a 20 ans ; elle est petite, blonde, sentimentale, romanesque. Elle a des yeux bleus. Ses traits respirent la décence. Elle a de beaux sourcils, un noble front, un petit nez aquilin, une bouche un peu grande. Elle est agréable à voir et penche un peu la tète sur son épaule droite. Cependant, elle est plutôt l' "esquisse que le modèle de la beauté". Elle aime la solitude et pleure en secret. Le président n'a pu détruire ses sentiments religieux. Elle prie souvent. Cela lui attire des corrections de son père et de son mari. C'est une bienfaitrice des pauvres, pour lesquels elle se sacrifie. Julie, la femme du président, est l'aînée des filles du duc, elle est grande et élancée, un peu grasse. Elle a de beaux yeux bruns, un joli nez, des traits enjoués, des cheveux châtains, une vilaine bouche, des dent cariées qui, avec ses tendances à la malpropreté, lui ont attiré l'amour du président, qui a des goûts infects. Elle a voué à l'eau une inimitié éternelle. Gourmande et ivrognesse, elle est d'une insouciance complète. Sa plus jeune sœur, Aline, en réalité fille de l'archevêque, n'a que 18 ans, un visage frais et piquant, un nez en l'air, des yeux bruns et animés, une bouche délicieuse, une taille ravissante, une jolie peau douce et légèrement brune. L'archevêque l'a laissée dans l'ignorance de tout, elle sait à peine lire et écrire, ne connaît pas le sentiment religieux, a des idées et des sentiments enfantins. Ses réponses sont imprévues et drôles. Elle joue sans cesse avec sa sœur, déteste l'archevêque et craint le duc « comme le feu ». Elle est paresseuse.
Ensuite vient le plan de l'ouvrage et les plaisirs imaginés par les quatre roués. Il est entendu chez de Sade que les sensations qui proviennent du langage des mots sont très puissantes. Les quatre roués décident de s'entourer de tout « ce qui pouvait satisfaire les autres sens par la lubricité» et de se faire raconter, « par ordre », toutes les dépravations, toutes les perversions sexuelles. Après de longues recherches, les libertins trouvent quatre vieilles femmes qui ont beaucoup vu et beaucoup retenu. Elles connaissent toutes les dépravations sexuelles et peuvent les réunir dans un récit systématique. La première doit exposer seulement les 150 perversions les plus simples, les plus communes, les moins raffinées. La deuxième doit en donner un même nombre de « plus rares et plus compliquées », dans lesquelles un ou plusieurs hommes agissent avec plusieurs femmes. La troisième doit montrer 150 dépravations criminelles ayant trait aux lois, à la nature et à la religion. Les excès de cette dernière catégorie amènent au meurtre, et ces plaisirs meurtriers sont si variés que la quatrième conteuse doit indiquer 150 de ces diverses tortures.
Les quatre libertins veulent pratiquer les enseignements de ces récits avec leurs femmes et d'autres « objets ». Ces quatre « historiennes », dont la science est extraordinaire, sont d'anciennes prostituées devenues appareilleuses. La Duclos a 48 ans. Elle est encore bien. La Chanville a 50 ans. C'est une tribade enragée. La Martaine a 52 ans ; comme elle était barrée, elle s'est fait pédiquer dès son jeune âge. La Desgranges a 56 ans. C'est « le vice personnifié », un squelette auquel manquent 10 dents, trois doigts et un œil. Elle boite et elle est rongée par un chancre. Son âme est « le réceptacle de tous les vices ». Il n'y a pas de crime qu'elle n'ait commis. Au demeurant, ses collègues ne sont pas des anges non plus.
On s'occupe de l'approvisionnement en « objets luxurieux » des deux sexes : huit filles, huit garçons, huit hommes et quatre servantes. On engage les appareilleuses et les appareilleurs les plus fameux de France pour recruter le matériel, dont le choix est fait avec beaucoup de raffinement. On prend partout, dans les couvents, dans les familles, 130 filles de 12 à 15 ans pour lesquelles on donne aux maquerelles 30.000 francs. Sur ces 130 filles on en retient 8. On agit de même pour les garçons et les hommes remis par les « agents de sodomie ». La revue des filles à la maison de campagne du duc dure treize jours. On en examine dix par jour. On examine de la même façon les garçons, les drauques et les servantes.
Cette assemblée se rend au château du duc ; c'est le théâtre du récit et des orgies pendant neuf mois. On a disposé les meubles, réuni des vivres et des vins. Le château est au milieu de forêts, entouré de hautes montagnes presque inaccessibles. Le domaine est clos par une muraille élevée qu'encercle un grand fossé. Au dehors, le paysage est tranquille et quasi religieux, ce qui prête plus de prix au libertinage. Toutes les chambres donnent sur une grande cour intérieure...
Tous entrent au château le 29 octobre, à 8 heures du soir. Comme au conclave, sur la demande du duc, on mure les portes et les issues. Jusqu'au 1er novembre (quatre jours) les victimes se reposent, et les quatre libertins établissent le règlement. Il est court : Lever à 10 heures du matin, puis visite aux garçons. A 11 heures, collation (chocolat, rôti, vin) dans le sérail des filles qui versent nues et à genoux. Dîner de 3 à 5 heures, servi par les épouses et les vieilles. Café au salon. Entrée dans la salle de récit à 6 heures. Les costumes féminins sont changés chaque jour. On varie entre l'asiatique, l'espagnol, le grec, le vêtement de nonne, de fée, de magicienne, de veuve, etc. A 6 heures sonnant, l'historienne commence son récit, qui dure pendant quatre heures, interrompu par les intermèdes de plaisirs de diverses sortes que se procurent les libertins. A 10 heures, souper. Alors commencent les orgies du cabinet d'assemblée éclairé a giorno. Cela dure jusqu'à 2 heures. Il y a un certain nombre de fêtes, et, chaque dimanche soir, on procède à la correction des garçons et filles qui ont commis quelques peccadilles. On n'autorise que le langage lascif. On ne doit pas nommer Dieu sinon en blasphémant. Pas de repos. Les services les plus bas et les plus dégoûtants sont rendus parles filles et les épouses, qui doivent s'exécuter avec grâce.
Après l'élaboration du règlement, le duc harangue, le 31 octobre, les femmes réunies au salon. Sa harangue est peu encourageante ;en voici à peu près la conclusion : le mieux qui puisse arriver à une femme, c'est de mourir de bonne heure. De Sade s'adresse alors au lecteur, lui demandant de cuirasser son cœur. Il va étaler 600 perversions sexuelles qui toutes existent : « On a distingué avec soin chacune de ces passions par un trait en marge, au-dessous duquel est le nom qu'on peut donner à cette passion. »
Alors commencent Les 120 jours de Sodome.
Le 1er novembre, la Duclos ouvre la session en exposant les 150 perversions simples, celles delà première classe. Chaque jour, elle en explique cinq. Le récit est interrompu par des discussions, des observations et des amusements variés. Cette première partie est la seule que de Sade ait développée avec toute l'ampleur que comportait un tel sujet. Ensuite, le papier a du lui manquer. Les autres parties, la deuxième avec la Chanville et ses 150 « passions doubles », la troisième avec les 150 perversions criminelles de la Marlaine et la quatrième avec les 150 perversions meurtrières de la Desgranges, sont abrégées, on pourrait dire esquissées. La Duclos parle en novembre, la Chanville en décembre, la Martaine en janvier, la Desgranges en février. Les récits se terminent le dernier jour, et l'on finit en massacrant les dernières victimes ..

DOLMANCÉ - Eh bien ! quel est l'objet, Eugénie, sur lequel vous voulez qu'on vous entretienne?
EUGÉNIE - Je voudrais savoir si les mœurs sont vraiment nécessaires dans un gouvernement, si leur influence est de quelque poids sur le génie d'une nation.
DOLMANCÉ - Ah ! parbleu, en partant ce matin, j'ai acheté au palais de l'Egalité une brochure qui, s'il en faut croire le titre, doit nécessairement répondre à votre question... A peine sort-elle de la presse!
Mme DE SAINT-ANGE - Voyons. (Elle lit : Français, encore un effort, si vous voulez être républicains.) Voilà, sur ma parole, un singulier titre ; il promet. Chevalier, toi qui possèdes un bel, organe, lis-nous cela.
DOLMANCÉ - Ou je me trompe, ou cela doit parfaitement répondre à la question d'Eugénie.
EUCÉNIE - Assurément.
Mme DE SAINT-ANGE - Sors, Augustin, ceci n'est pas fait pour toi ; mais ne t'éloigne pas ; nous sonnerons dès qu'il faudra que tu reparaisses.
LE CHEVALIER- Je commence.
FRANÇAIS - ENCORE UN EFFORT, SI VOUS VOULEZ ÊTRE REPUBLICAINS
LA RELIGION - Je viens vous offrir de grandes idées ; on les écoutera, elles seront réfléchies ; si toutes ne plaisent pas, au moins en restera-t-il quelques-unes ; j'aurai contribué en quelque chose au progrès des lumières, et je serai content. Je ne le cache point, c'est avec peine que je vois la lenteur avec laquelle nous tâchons d'arriver au but ; c'est avec inquiétude que je sens que nous sommes à la veille de le manquer encore une fois. Croit-on que ce but sera atteint quand on nous aura donné des lois ? Qu'on ne l'imagine pas. Que ferions-nous de lois sans religions? Il nous faut un culte et un culte fait pour le caractère d'un républicain, bien éloigné de ne jamais pouvoir reprendre celui de Rome. Dans un siècle où nous sommes aussi convaincus que la religion doit être appuyée sur la morale et non pas la morale sur la religion, il faut une religion qui aille aux moeurs, qui en soit comme le développement, comme la suite nécessaire, et qui puisse, en élevant l'âme, la tenir perpétuellement à la hauteur de cette liberté précieuse dont elle fait aujourd'hui son unique idole.
Or je demande si l'on peut supposer que celle d'un esclave de Titus, que celle d'un vil histrion de Judée puisse convenir à une nation libre et guerrière qui vient de se régénérer ? Non, mes compatriotes, non, vous ne le croyez pas. Si, malheureusement pour lui, le Français s'ensevelissait encore dans les ténèbres du christianisme, d'un côté l'orgueil, la tyrannie, le despotisme des prêtres, vices toujours renaissants dans cette horde impure, de l'autre la bassesse, les petites vues, les platitudes des dogmes et des mystères de cette indigne et fabuleuse religion, en émoussant la fierté de l'âme républicaine, l'auraient bientôt ramenée sous le joug que son énergie vient de briser ! Ne perdons pas de vue que cette puérile religion était une des meilleures armes aux mains de nos tyrans ; un de ses premiers dogmes était de rendre à César ce qui appartenait à César ; mais nous avons détrôné César et nous ne voulons plus rien lui rendre. Français, ce serait en vain que vous vous flatteriez que l'esprit d'un clergé assermenté ne doit pas être celui d'un réfractaire : il est des vices d'état dont on ne se corrige jamais. Avant dix ans, au moyen de la religion chrétienne, de sa superstition, de ses préjugés, vos prêtres, malgré leur pauvreté, reprendraient sur les âmes l'empire qu'ils avaient envahi, ils vous renchaîneraient à des rois, parce que la puissance de ceux-ci étaya toujours celle de l'autre, et votre édifice républicain s'écroulerait, faute de bases.
O ! vous qui avez la faux à la main, portez le dernier coup à l'arbre de la superstition ; ne vous contentez pas d'élaguer les branches ; déracinez tout à fait une plante dont les effets sont si contagieux; ; soyez parfaitement convaincus que votre système de liberté et d'égalité contrarie trop ouvertement les ministres des autels du Christ pour qu'il en soit jamais un seul ou qui l'adopte de bonne foi, ou qui ne cherche pas à l'ébranler, s'il parvient à prendre quelque emprise sur les consciences. Quel sera le prêtre qui, comparant l'état où l'on vient de le réduire avec celui dont il jouissait autrefois, ne fera pas tout ce qui dépendra de lui pour recouvrer et la confiance et l'autorité qu'on lui a fait perdre ? Et que d'êtres faibles et pusillanimes redeviendront bientôt les esclaves de cet ambitieux tonsuré ? Pourquoi n'imagine-t-on pas que les inconvénients qui ont existé peuvent encore renaître ? Dans l'enfance de l'Eglise chrétienne, les prêtres n'étaient-ils pas ce qu'ils sont aujourd'hui ? Vous voyez où ils étaient parvenus ! Qui pourtant les avait conduits là ? N'étaient ce pas les moyens que leur fournissait la religion? Or, si vous ne la défendez pas absolument, cette religion, ceux qui la prêchent, ayant toujours les mêmes moyens, arriveront bientôt au même but. Anéantissez donc à jamais ce qui peut détruire un jour votre ouvrage. Songez que le fruit de vos travaux n'étant réservé qu'à vos neveux, il est de votre devoir, de votre probité, de ne leur laisser aucun de ces germes dangereux qui pourraient les replonger dans le chaos dont nous avons tant de peine à sortir.
Déjà nos préjugés se dissipent, déjà le peuple abjure les absurdités catholiques ; il a déjà supprimé les temples ; les prétendus fidèles, désertant le banquet apostolique, laissent les dieux de farine aux souris. Français, ne vous arrêtez point ; l'Europe entière, une main déjà sur le bandeau qui fascine ses yeux, attend de vous l'effort qui doit l'arracher de son front. Hâtez-vous, ne laissez pas à Rome la sainte, s'agitant en tous sens pour réprimer votre énergie, le temps de se conserver peut-être encore quelques prosélytes. Frappez sans ménagement sa tête altière et frémissante, et qu'avant deux mois l'arbre de la liberté, ombragent les débris de la chaire de saint Pierre, couvre du poids de ses rameaux victorieux toutes ces méprisables idoles du christianisme, effrontément élevées sur les cendres et des Catons et des Brutus.
Français, je vous le répète, l'Europe attend de vous d'être à la fois délivrée du sceptre et de l'encensoir. Songez qu'il vous est impossible de l'affranchir de la tyrannie royale sans lui faire briser en même temps les freins de la superstition religieuse ; les liens de l'une sont trop intimement unis à l'autre pour qu'en en laissant subsister une des deux vous ne retombiez pas bientôt sous l'empire de celle que vous aurez négligé de dissoudre. Ce n'est plus ni aux genoux d'un être imaginaire ni à ceux d'un vil imposteur qu'un républicain doit fléchir : ses uniques dieux doivent être maintenant le courage et la liberté. Rome disparut dès que le christianisme s'y prêcha, et la France est perdue si elle s'y réfère encore....
(...)

CESSONS DE CROIRE QUE LA RELIGION PUISSE ÊTRE UTILE A L'HOMME. Ayons de bonnes lois, et nous saurons nous passer de religion. Mais il en faut une au peuple, assure-t-on ; elle l'amuse, elle le contient. A la bonne heure ! Donnez-nous donc, en ce cas, celle qui convient à des hommes libres. Rendez-nous les dieux du paganisme. Nous adorerons volontiers Jupiter, Hercule ou Pallas ; mais nous ne voulons plus du fabuleux auteur d'un univers qui se meut lui-même ; nous ne voulons plus d'un dieu sans étendue, et qui pourtant remplit tout de son immensité, d'un dieu tout-puissant, et qui n'exécute jamais ce qu'il désire, d'un être souverainement bon, et qui ne fait que des mécontents, d'un être ami de l'ordre, et dans le gouvernement duquel tout est en désordre. Non, nous ne voulons plus d'un Dieu qui dérange la nature, qui est le père de la confusion, qui meut l'homme au moment où l'homme se livre à des horreurs ; un tel Dieu nous fait frémir d'indignation, et nous le reléguons pour jamais dans l'oubli d'où l'infâme Robespierre a voulu le sortir.
Français, à la place de cet indigne fantôme, substituons les simulacres imposants qui rendaient Rome la maîtresse de l'univers : traitons toutes les idoles chrétiennes comme nous avons traité celles de nos rois. Nous avons replacé les emblèmes de la liberté sur les bases qui soutenaient autrefois les tyrans ; réédifions de même l'effigie des grands hommes sur les piédestaux de ces polissons adorés par le christianisme. Cessons de redouter pour nos campagnes l'effet de l'athéisme ; les paysans n'ont-ils pas senti la nécessité de l'anéantissement du culte catholique, si contradictoire aux vrais principes de la liberté ?
(...)
"L'IGNORANCE ET LA PEUR, LEUR DREZ-VOUS ENCORE, VOILA LES DEUX BASES DE TOUTES LES RELIGIONS. L'incertitude où l'homme se trouve, par rapport à son Dieu, est précisément le motif qui l'attache à sa religion. L'homme a peur dans les ténèbres, tant au physique qu'au moral ; la peur devient habituelle en lui et se change en besoin : il croirait qu'il lui manquerait quelque chose s'il n'avait plus rien à espérer ou à craindre. Revenez ensuite à l'utilité de la morale ; donnez-leur sur ce grand objet beaucoup plus d'exemples que de leçons, beaucoup plus de preuves que de livres, et vous en ferez de bons citoyens ; vous en ferez de bons guerriers, de bons pères, de bons époux ; vous en ferez des hommes d'autant plus attachés à la liberté de leur pays qu'aucune idée de servitude ne pourra plus se présentera leur esprit,qu'aucune terreur religieuse ne viendra troubler leur génie. Alors le véritable patriotisme éclatera dans toutes les âmes; il y régnera dans toute sa force et dans toute sa pureté, parce qu'il y deviendra le seul sentiment dominant, et qu'aucune idée étrangère n'en attiédira l'énergie ;alors, votre seconde génération est sûre, et votre ouvrage, consolidé par elle, va de venir la loi de l'univers. Mais si, par crainte ou pusillanimité, ces conseils ne sont pas suivis, si on laisse subsister les bases de l'édifice que l'on avait cru détruire, qu'arrivera-t-il ? On rebâtira sur ces bases, et l'on y placera les mêmes colosses, à la cruelle différence qu'ils y seront cette fois cimentés d'une telle force que ni votre génération, ni celles qui la suivront ne réussiront à les culbuter. Qu'on ne doute pas que les religions ne soient le berceau du despotisme : le premier de tous les despotes fut un prêtre ; le premier roi et le premier empereur de Rome, Numa et Auguste, s'associèrent l'un et l'autre au sacerdoce; Constantin et Clovis furent plutôt des abbés que des souverains ; Héliogabale fut prêtre du soleil. De tous les siècles il y eut dans le despotisme et dans la religion une telle connexité qu'il reste plus que démontré qu'en détruisant l'un l'on doit saper l'autre, par la grande raison que le premier servira toujours de loi au second. Je ne propose cependant ni massacres, ni exportations; toutes ces horreurs sont trop loin de mon âme pour oser seulement les concevoir une minute. Non, n'assassinez point ; n'exportez point , ces atrocités sont celles des rois ou des scélérats qui les imitèrent; ce n'est point en faisant comme eux que vous forcerez de prendre en horreur ceux qui les exerçaient. N'employons la force que pour les idoles ; il ne faut que des ridicules pour ceux qui les servent ; les sarcasmes de Julien nuisirent plus à la religion chrétienne que tous les supplices de Néron ...
(...)
"... Après avoir démontré que LE THEISME NE CONVIENT NULLEMENT A UN GOUVERNEMENT REPUBLICAIN, il me paraît nécessaire de prouver que les mœurs françaises ne lui conviennent pas davantage. Cet article est d'autant plus essentiel que ce sont les moeurs qui vont servir de motifs aux lois qu'on va promulguer.
Français, vous êtes trop éclairés pour ne pas sentir qu'un nouveau gouvernement va nécessiter de nouvelles mœurs; il est impossible que le citoyen d'un Etat libre se conduise comme l'esclave d'un roi despote ; ces différences de leurs intérêts, de leurs devoirs, de leurs relations entre eux déterminent essentiellement une manière tout autre de se comporter dans le monde; une foule de petites erreurs, de petits délits sociaux, considérés comme très essentiels sous le gouvernement des rois, qui devaient exiger d'autant plus qu'ils avaient plus besoin d'imposer des freins pour se rendre respectables et inabordables à leurs sujets, vont devenir nuls ici ; d'autres forfaits, connus sous les noms de régicide et de sacrilège, sous un gouvernement qui ne connaît plus ni rois, ni religion, doivent s'anéantir de même dans un État républicain.
En accordant la liberté de conscience et celle de la presse, songez, citoyens, qu'à bien peu de chose près on doit accorder celle d'agir, et qu'excepté ce qui choque directement les bases du gouvernement il vous reste on ne saurait moins de crimes à punir, parce que, dans le fait, il est fort peu d'actions criminelles dans une société dont la liberté et l'égalité font les bases, et qu'à bien peser et bien examiner les choses il n'y a vraiment de criminel que ce que réprouve la loi ; car la nature nous dictant également des vices et des vertus, en raison de notre organisation, ou, plus philosophiquement encore, en raison du besoin qu'elle a de l'un ou de l'autre, ce qu'elle nous inspire deviendrait une mesure très certaine pour régler avec précision ce qui est mal. Mais, pour mieux développer mes idées sur un objet aussi essentiel, nous allons classer les différentes actions de la vie de l'homme, que l'on était convenu jusqu'à présent de nommer criminelles, et nous les toiserons ensuite aux vrais devoirs d'un républicain.
On a considéré de tous temps les devoirs de l'homme sous les trois différents rapports suivants :
1) - Ceux que sa conscience et sa crédulité lui imposent envers l'être suprême;
2) - Ceux qu'il est obligé de remplir avec ses frères ;
3) - Enfin ceux qui n'ont de relation qu'avec lui.
La certitude où nous devons être qu'aucun dieu ne s'est mêle de nous, et que, créatures nécessitées de la nature, comme les plantes et les animaux, nous sommes ici parce qu'il était impossible que nous n'y fussions pas ; cette certitude, sans doute, anéantit, comme on le voit, tout d'un coup la première partie de ces devoirs, je veux dire ceux dont nous nous croyons faussement responsables envers la divinité; avec eux disparaissent tous les délits religieux, tous ceux connus sous les noms vagues et infinis d'impiété, de sacrilège, de blasphème, d'athéisme, etc., tous ceux, en un mot, qu'Athènes punit avec tant d'injustice dans Alcibiade, et la France dans l'infortuné Labarre. S'il y a quelque chose d'extravagant dans le monde, c'est de voir des hommes qui ne connaissent leur Dieu et ce que peut exiger ce Dieu que d'après leurs idées bornées vouloir néanmoins décider sur la nature de ce qui contente ou de ce qui fâche ce ridicule fantôme de leur imagination. Ce ne serait donc point à permettre indifféremment tous les cultes que je voudrais qu'on se bornât; je désirerais qu'il fût libre de se rire ou de se moquer de tous; que des hommes, réunis dans un temple quelconque pour invoquer l'Eternel à leur guise, fussent vus comme des comédiens sur un théâtre, au jeu desquels il est permis à chacun d'aller rire. Si vous ne voyez pas les religions sous ce rapport, elles reprendront le sérieux qui les rend importantes, elles protégeront bientôt les opinions, et l'on ne se sera pas plus tôt disputé sur les religions qu'on se rebattra pour les religions; l'égalité détruite par la préférence ou la protection accordée à l'une d'elles disparaîtra bientôt du gouvernement, et de la théocratie réédifiée renaîtra bientôt l'aristocratie. Je ne saurais donc trop le répéter : PLUS DE DIEUX, Français, plus de dieux, si vous ne voulez pas que leur funeste empire vous replonge bientôt dans toutes les horreurs du despotisme; mais ce n'est qu'en vous en moquant que vous détruirez tous les dangers à leur suite, ils reparaîtront aussitôt en foule si vous y mettez de l'humeur ou de l'importance. Ne renversez point leurs Idoles en colère, pulvérisez-les en jouant et l'opinion tombera d'elle-même....
(...)
De ces premiers principes il découle, on le sent, la nécessité de faire des lois douces et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de LA PEINE DE MORT, parce que la loi, froide par elle-même, ne saurait être accessible aux passions qui peuvent légitimer dans l'homme la cruelle action du meurtre ; l'homme reçoit de la nature les impressions qui peuvent lui faire pardonner cette action, et la loi, au contraire, toujours en opposition avec la nature et ne recevant rien d'elle, ne peut être autorisée à se permettre les mêmes motifs, il est impossible qu'elle ait les mêmes droits. Voilà de ces distinctions savantes et délicates qui échappent à beaucoup de gens, parce que fort peu de gens réfléchissent ; mais elles seront accueillies des gens instruits à qui je les adresse, et elles influeront, je l'espère, sur le nouveau code que l'on prépare.
La seconde raison pour laquelle on doit anéantir la peine de mort, c'est qu'elle n'a jamais réprimé le crime, puisqu'on le commet chaque jour au pied de l'échafaud. On doit supprimer cette peine, en un mot, parce qu'il n'y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre, puisqu'il résulte évidemment de ce procédé qu'au lieu d'un homme de moins en voilà tout d'un coup deux, et qu'il n'y a que des bourreaux ou des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière.
Quoi qu'il en soit, enfin, les forfaits que nous pouvons commettre envers nos frères se réduisent à quatre principaux : la calomnie, le vol, les délits qui, causés par l'impurelé, peuvent atteindre désagréablement les autres, et le meurtre.
TOUTES CES ACTIONS, CONSIDEREES COMME CAPITALES DANS UN GOUVERNEMENT MONARCHIQUES, SONT-ELLES AUSSI GRAVES DANS UN ETAT REPUBLICAIN?
C'est ce que nous allons analyser avec le flambeau de la philosophie, car c'est à sa seule lumière qu'un tel examen doit s'entreprendre. Qu'on ne me taxe point d'être un novateur dangereux; qu'on ne dise pas qu'il y a du risque à émousser, comme le feront peut-être ces écrits, le remords dans l'âme des malfaiteurs, qu'il y a le plus grand mal à augmenter par la douceur de ma morale le penchant que ces mêmes malfaiteurs ont aux crimes : j'atteste ici formellement n'avoir aucune de ces vues perverses ; j'expose les idées qui, depuis l'âge de raison, se sont identifiées en moi et au jet desquelles l'infâme despotisme des tyrans s'était opposé depuis tant de siècles ; tant pis pour ceux que ces grandes idées corrompraient ; tans pis pour ceux qui ne savent saisir que le mal dans des opinions philosophiques, susceptibles de se corrompre à tout ! Qui sait s'ils ne se gangrèneraient peut-être pas aux lectures de Sénèque et de Charron ? Ce n'est point à eux que je parle ; je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre, et ceux-là me liront sans danger....
(...)

Les délits que nous venons d'examiner dans cette seconde classe des devoirs de l'homme envers ses semblables consistent dans LES ACTIONS QUE PEUT FAIRE ENTREPRENDRE LE LIBERTINAGE, parmi lesquelles se distinguent particulièrement comme plus attentatoires à ce que chacun doit aux autres la prostitution, l'adultère, l'inceste, le viol, la sodomie. Nous ne devons certainement pas douter que tout ce qui s'appelle crimes moraux, c'est-à-dire toutes les actions de l'espèce de celles que nous venons de citer, ne soient parfaitement indifférentes dans un gouvernement dont le seul devoir consiste à conserver, par tel moyen que ce puisse être, la forme essentielle à son maintien: voilà l'unique morale d'un gouvernement républicain.
Or, puisqu'il est toujours contrarié par les despotes qui l'environnent, on ne saurait imaginer raisonnablement que ses moyens conservateurs puissent être des moyens moraux car il ne se conservera que par la guerre, et rien n'est moins moral que la guerre.
Maintenant, je demande COMMENT ON PARVIENDRA A DEMONTRER QUE, DANS UN ETAT IMMORAL PAR SES OBLIGATIONS, IL SOIT ESSENTIEL QUE LES INDIVIDUS SOIENT MORAUX? JE DIS PLUS : IL EST BON QU'ILS NE LE SOIENT PAS. Les législateurs de la Grèce avaient parfaitement senti l'importante nécessité de gangrener les membres, pour que, leur dissolution morale influant sur celle utile à la machine, il en résultât l'insurrection toujours indispensable dans un gouvernement qui, parfaitement heureux comme !e gouvernement républicain, doit nécessairement exciter la haine et la jalousie de tout ce qui l'entoure. L'insurrection, pensaient ces sages législateurs, n'est point un état moral; elle doit être pourtant l'état permanent d'une république ; il serait donc aussi absurde que dangereux d'exiger que ceux qui doivent maintenir le perpétuel ébranlement immoral de la machine fussent eux-mêmes des êtres moraux, parce que l'état moral d'un homme est un état de paix et de tranquillité, au lieu que son état immoral est un état de mouvement perpétuel, qui le rapproche de l'insurrection nécessaire, dans laquelle il faut que le républicain tienne toujours le gouvernement dont il est membre.
Détaillons maintenant, et commençons par analyser LA PUDEUR, ce mouvement pusillanime, contradictoire aux affection impures. S'il était dans les intentions de la nature que l'homme fût pudique, assurément elle ne l'aurait pas fait naître nu ; une infinité de peuples, moins dégradés que nous par la civilisation, vont nus et n'en éprouvent aucune honte ; il ne faut pas douter que l'usage de se vêtir n'ait eu pour unique base et l'inclémence de l'air et la coquetterie des femmes ; elles sentirent qu'elles perdraient bientôt tous les effets du désir si elles les prévenaient, au lieu de les laisser naître; elles conçurent que, la nature d'ailleurs ne les ayant pas créées sans défauts, elles s'assureraient bien mieux tous les moyens de plaire en déguisant ces défauts par des parures; ainsi la pudeur, loin d'être une vertu, ne fut donc plus qu'un des premiers effets de la corruption, qu'un des premiers moyens de la coquetterie des femmes.
(...)
Si, comme je viens de le dire tout à l'heure, aucune passion n'a plus besoin de toute l'extension de la liberté que celle-là, aucune, sans doute, n'est aussi despotique ; c'est là que l'homme aime à commander, à être obéi, à s'entourer d'esclaves contraints à le satisfaire; or, toutes les fois que vous ne donnerez pas à l'homme LE MOYEN SECRET D'EXHALER LA DOSE DE DESPOTISME QUE LA NATURE MIT AU FOND DE SON COEUR, il se rejettera pour l'exercer sur les objets qui l'entourent, il troublera le gouvernement. Permettez, si vous voulez éviter ce danger, un libre essor à ces désirs tyranniques, qui, malgré lui, le tourmentent sans cesse ; content d'avoir pu exercer sa petite souveraineté au milieu du harem d'icoglans ou de sultanes que vos soins et son argent lui soumettent, il sortira satisfait et sans aucun désir de troubler un gouvernement qui lui assure aussi complaisamment tous les moyens de satisfaire sa concupiscence ; exercez, au contraire, des procédés différents, imposez sur ces objets de la luxure publique les ridicules entraves jadis inventées par la tyrannie ministérielle et par la lubricité de nos Sardanapales ; l'homme, bientôt aigri contre votre gouvernement, bientôt jaloux du despotisme que vous lui imposez, et las de votre manière de le régir, en changera comme il vient de le faire.
(...)
Jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre ; IL EST AUSSI INJUSTE DE POSSEDER EXCLUSIVEMENT UNE FMME QU'IL EST DE POSSEDER DES ESCLAVES ; tous les hommes sont nés libres, tous sont égaux en droits ; ne perdons jamais de vue ces principes; il ne peut donc être jamais donné, d'après cela, de droit légitime à un sexe de s'emparer exclusivement de l'autre, et jamais l'un de ces sexes ou l'une de ces classes ne peut posséder l'autre arbitrairement. Une femme même, dans la puretés des lois de la nature, ne peut alléguer, pour motif du refus qu'elle fait à celui qui la désire, l'amour qu'elle a pour un autre, parce que ce motif en devient un d'exclusion, et qu'aucun homme ne peut être exclu de la possession d'une femme, du moment qu'il est clair qu'elle appartient décidément à tous les hommes. L'acte de possession ne peut être exercé que sur un immeuble ou un animal ; jamais il ne peut l'être sur un individu qui nous ressemble, et tous les liens qui peuvent enchaîner une femme à un homme, de telle espèce que vous puissiez les supposer, sont aussi injustes que chimériques.
S'il devient donc incontestable que nous ayons reçu de la nature le droit d'exprimer nos vœux indifféremment à toutes les femmes, il le devient de même que nous avons celui de l'obliger de se soumettre à nos vœux, non pas exclusivement, je me contrarierais, mais momentanément. Il est incontestable que nous avons le droit d'établir des lois qui la contraignent de céder aux feux de celui qui la désire; la violence même étant un des effets de ce droit, nous pouvons l'employer légalement. Eh ! la nature n'a-t-elle pas prouvé que nous avions ce droit en nous départissant la force nécessaire à les soumettre à nos désirs ?
En vain les femmes doivent-elles faire parler pour leur défense ou la pudeur, ou leur attachement à d'autres hommes ; ces moyens chimériques sont nuls ; nous avons vu plus haut combien la pudeur était un sentiment factice et méprisable. L'amour, qu'on peut appeler la folie de l'âme, n'a plus de titres pour légitimer leur constance ; ne satisfaisant que deux individus, l'être aimé et l'être aimant, il ne peut servir au bonheur des autres, et c'est pour le bonheur de tous, et non pour un bonheur égoïste et privilégié, que nous ont été données les femmes. Tous les hommes ont donc un droit de jouissance égal sur toutes les femmes ; il n'est donc aucun homme qui, d'après les lois de la nature, puisse s'ériger sur une femme un droit unique et personnel. La loi qui les obligera de se prostituer tant que nous le voudrons aux maisons de débauche dont il vient d'être question et qui les y contraindra si elles s'y refusent, qui les punira si elles y manquent, est donc une loi des plus équitables et contre laquelle aucun motif légitime ou juste ne saurait réclamer.
Un homme qui voudra jouir d'une femme ou d'une fille quelconque pourra donc, si les lois que vous promulguez sont justes, la faire sommer de se trouver dans l'une des maisons dont je vous ai parlé, et là, sous la sauvegarde des matrones de ce temple de Vénus, elle lui sera livrée pour satisfaire, avec autant d'humilité et de soumission, tous les caprices qu'il lui plaira de se passer avec elle, de quelque bizarrerie ou de quelque irrégularité qu'ils puissent être, parce qu'il n'en est aucun qui ne soit dans la nature, aucun qui ne soit avoué par elle. Il ne s'agirait plus ici que de fixer l'âge ; or, je prétends qu'on ne le peu t sans gêner la liberté de celui qui désire la jouissance d'une fille de tel ou tel âge.
Celui qui a le droit de manger le fruit d'un arbre peut assurément le cueillir mûr ou vert, suivant les aspirations de son goût. Mais, objectera-t-on, il est un âge où les procédés de l'homme nuiront décidément à la santé de la fille. Cette considération est sans aucune valeur; dès que vous m'accordez le droit de propriété sur la jouissance, ce droit est indépendant des effets produits par la jouissance ...
(...)
Si nous admettons, comme nous venons de le faire, que toutes les femmes doivent être soumises à nos désirs, assurément nous pouvons leur permettre de même de satisfaire amplement tous les leurs ; nos lois doivent favoriser sur cet objet leur tempérament de feu, et il est absurde d'avoir placé et leur honneur et leur vertu dans la force antinaturelle qu'elles mettent à résister aux penchants qu'elles ont reçus avec bien plus de profusion que nous ; cette injustice des mœurs est d'autant plus criante que nous consentons à la fois à les rendre faibles à force de séduction, et à les punir ensuite de ce qu'elles cèdent à tous les efforts que nous avons faits pour les provoquer à la chute. Toute l'absurdité de nos mœurs est gravée, ce me semble, dans cette inéquitable atrocité, et ce seul exposé devrait nous faire sentir l'extrême besoin que nous avons de les changer pour de plus pures.
Je dis donc que les femmes, ayant reçu des penchants bien plus violents que nous aux plaisirs de la luxure, pourront s'y livrer tant qu'elles le voudront, absolument dégagées de tous les liens de l'hymen, de tous les faux préjugés de la pudeur, absolument rendues à l'état de nature ; je veux que les lois leur permettent de se livrer à autant d'hommes que bon leur semblera ; je veux que la jouissance de tous les sexes et de toutes les parties de leur corps soient soumises aux hommes ; et, sous la clause spéciale de se livrer de même à tous ceux qui le désireront, il faut qu'elles aient la liberté de jouir également de tous ceux qu'elles croiront dignes de les satisfaire.
Quels sont, je le demande, les dangers de cette licence ? Des enfants qui n'auront point de pères ? Eh ! qu'importe dans une république où tous les individus ne doivent avoir d'autre mère que la patrie, où tous ceux qui naissent sont tous enfants de la patrie ! Ah! combien l'aimeront mieux ceux qui, n'ayant jamais connu qu'elle, sauront, dès en naissant, que ce n'est que d'elle qu'ils doivent tout attendre ? N'imaginez pas de faire de bons républicains, tant que vous isolerez dans leurs familles les enfants qui ne doivent appartenir qu'à la république. En donnant là seulement à quelques individus la dose d'affection qu'ils doivent répartir sur tous leurs frères, ils adoptent inévitablement les préjugés souvent dangereux de ces individus ; leurs opinions, leurs idées s'isolent, se particularisent, et toutes les vertus d'un homme d'Etat leur deviennent absolument impossibles. Abandonnant enfin leur coeur tout entier à ceux qui les ont fait naître, ils ne trouvent plus dans ce cœur aucune affection pour celle qui doit les faire vivre, les faire connaître et les illustrer, comme si ces seconds bienfaits n'étaient pas plus importants que les premiers ! ...."

"Le marquis de Sade, écrit Guillaume Apollinaire, cet esprit le plus libre qui ait encore existé, avait sur la femme des idées particulières et la voulait aussi libre que l'homme. Ces idées, que l'on dégagera quelque jour, ont donné naissance à un double roman : "Justine" et "Juliette". Ce n'est pas au hasard que le marquis a choisi des héroïnes et non pas des héros. Justine, c'est l'ancienne femme, asservie, misérable et moins qu'humaine ; Juliette, au contraire, représente la femme nouvelle qu'il entrevoyait, un être dont on n'a pas encore idée, qui se dégage de l'humanité, qui aura des ailes et qui renouvellera l'univers...
Justine et Juliette sont les filles d'un riche banquier parisien. Elles ont été élevées jusqu'à 14 et 15 ans dans un couvent célèbre de Paris. Des événements imprévus : la banqueroute de leur père, sa mort, bientôt suivie de celle de leur mère, modifient complètement la destinée de ces jeunes filles. Elles doivent, quitter le couvent et subvenir elles-mêmes aux besoins de leur vie. Juliette, vive, insouciante, volontaire, d'une beauté insolente, se trouve heureuse de cette liberté. La cadette, Justine, naïve, mélancolique et douce, sent toute l'étendue de son malheur. Juliette, qui se sait belle, cherche aussitôt à tirer parti de sa beauté. Justine est vertueuse et veut le demeurer. Elles se réparent. Justine va retrouver des amis de sa famille qui la repoussent. Un curé cherche à la séduire. Elle finit par aller chez un gros négociant, M. Dubourg, qui aime à faire pleurer les enfants. Elle ne lui cache pas son étonnement et son dégoût lorsqu'il lui expose ses théories luxurieuses. Elle lui résiste, et il la met dehors. Pendant ce temps, une certaine Mme Desroches, chez qui elle est descendue, lui vole tout ce qu'elle possède. Justine se trouve à la merci de cette femme qui la met en rapport avec une Mme Delmonse, sorte de demi-mondaine assez chic, qui lui vante les agréments de la prostitution. On essaye de prostituer Justine et on la ramène au vieux Dubourg. Elle résiste encore, et après quelques aventures déplorables, Justine, malgré son innocence, finit par aller en prison.
Elle y fait connaissance avec une certaine Dubois, coquine qui a commis tous les crimes imaginables. Toutes deux sont condamnées à mort. La Dubois incendie la prison, elles se sauvent et joignent une bande de brigands les plus infâmes qui se puissent rencontrer. Justine parvient à se sauver avec Saint-Florent, marchand qu'elle a délivré des mains des brigands et qui se dit son oncle. Il la viole et l'abandonne évanouie. En revenant à elle, Justine aperçoit ensuite un jeune homme, M. de Bressac, qui se livre à des divertissements contre nature avec son laquais. Ils lui font quelques avances et finissent par la conduire auprès de la vertueuse Mlle de Bressac qui, s'apitoyant sur le sort de Justine, veut la ramènera Paris et s'occuper de sa réhabilitation. Malheureusement, la Delmouse est partie pour l'Amérique, et l'affaire ne peut être tirée au clair. Bressac, pendant ce temps, se livre à des orgies épouvantables, il pollue sa mère et force même Justine à la tuer. Justine se sauve au bourg de Saint-Marcel, près de Paris, et entre chez un chirurgien nommé Rodin qui, avec sa sœur Célestine, tient une école mixte où ne sont admis que des enfants d'une beauté remarquable, n'ayant ni moins de douze ans, ni plus de dix-sept, et au nombre de cent pour chaque sexe. Rodin enseigne les garçons, et Céline les filles. Justine se lie avec la fille de Rodin, Rosalie. Rodin ne commet pas seulement des incestes, il se livre avec son collègue Rambeau à des opérations chirurgicales, aussi audacieuses que criminelles, auxquelles ils soumettent la malheureuse Justine qui échappe à la mort presque miraculeusement et va à Sens.
Assise au crépuscule au bord d'un étang, elle entend qu'on jette quelque chose dans l'eau ; voyant que c'est une toute petite fille, elle la sauve ; mais le meurtrier rejette l'enfant et emmène Justine à son château. C'est un antialcoolique et un végétarien qui a la manie de rendre les femmes enceintes et de ne voir chacune d'elles qu'une seule fois. Il se nomme M. de Bandole et a des idées assez curieuses sur la conception. C'est ainsi qu'après le congrès il laisse les femmes suspendues la tète en bas, pendant neuf jours, pour être bien certain de les avoir fécondées. Justine est tirée des mains de M. de Bandole par le frère de la Dubois, le brigand Cœur-de-Fer. Ensuite Justine entre dans une al)baye de Bénédictins où le satanisme est en honneur. Il s'y trouve des sérails d'enfants des deux sexes. Le moine Jérôme raconte toutes les ignominies de sa longue vie emplie de meurtres et d'incestes. Il décrit les pays qu'il a visités: l'Allemagne, l'Italie, Tunis, Marseille, etc. Justine quitte le cloître. Elle rencontre Dorothée d'Esterval, femme d'un aubergiste criminel qui tient une hôtellerie isolée dans laquelle il assassine les voyageurs qui s'y aventurent. Dorothée a peur. Elle supplie Justine de venir avec elle. Justine la suit dans l'auberge où se commettent tant de crimes. Bressac survient ; il est, en effet, parent d'Esterval. Tous se rendent chez le comte de Germande, qui est également un de leurs parents. Celui-ci a pris la détestable habitude de martyriser sa femme, dont la beauté est admirable. Il lui tire « deux palettes de sang » tous les quatre jours.
Ensuite Justine a encore une série d'aventures difficiles à résumer et qui se passe dans la famille Verneuil, chez les Jésuites, au milieu de tribades et d'invertis de toutes sortes. Justine rencontre ensuite le faux monnayeur Roland et finit par être enfermée dans la prison de Grenoble. Elle est sauvée par un avocat du barreau de cette ville, M. S... A l'auberge elle rencontre la Dubois qui la conduit à la maison de campagne de l'archevêque de Grenoble, dans laquelle il y a un cabinet à glaces pouvant se transformer en une épouvantable chambre de torture où l'archevêque fait décapiter les femmes après les avoir ignoblement outragées. « Lorsque les femmes entrèrent avec le prélat, elles trouvèrent dans ce local un gros abbé de quarante-cinq ans, dont la figure était hideuse et toute la construction gigantesque; il lisait, sur un canapé, la "Philosophie dans le Boudoir".
Justine s'échappe ; il lui arrive un certain nombre d'aventures épouvantables. On l'incarcère de nouveau et, derechef, la voilà condamnée à mort. Elle s'évade, erre lamentablement et finit par rencontrer une jolie dame qu'accompagnent quatre messieurs. C'est Juliette, qui accueille sa sœur avec tendresse et lui vante la vie criminelle : « J'ai suivi la route du vice, moi, mon enfant ; je n'y ai jamais rencontré que des roses. »
Voilà cette Justine que le marquis de Sade a toujours désavouée avec une ténacité prodigieuse. Il avait ses raisons pour cela, sachant bien que la gloire ne lui en serait point ôtée tandis qu'un aveu de sa part aurait justifié aux yeux des contemporains toutes les représailles qu'on n'aurait pas manqué, en ce cas, d'exercer contre lui. On a même, de ces désaveux, un témoignage imprimé....

1791 – "Justine ou les Malheurs de la vertu"
"Les infortunes de la vertu" constituent en 1787 la 1ère version de "Justine", tandis que la Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu, suivie de l'Histoire de Juliette, sa sœur, ou les Prospérités du vice, seront publiées en 1797. Justine et Juliette sont les filles d'un riche banquier parisien. Elles ont été élevées jusqu'à 14 et 15 ans dans un couvent célèbre de Paris. Des événements imprévus, la banqueroute de leur père, sa mort, bientôt suivie de celle de leur mère, modifient complètement la destinée de ces jeunes filles. Elles doivent, quitter le couvent et subvenir elles-mêmes aux besoins de leur vie.
Juliette, vive, insouciante et volontaire, d'une beauté insolente, se trouve heureuse de cette liberté. La cadette, Justine, naïve, mélancolique et douce, ressent toute l'étendue de son malheur. Juliette, qui se sait belle, cherche aussitôt à tirer parti de sa beauté. Justine est vertueuse et veut le demeurer.
Elles se séparent. Justine va retrouver des amis de sa famille qui la repoussent. Un curé cherche à la séduire. Elle finit par aller chez un gros négociant, M. Dubourg, qui aime à faire pleurer les enfants. Elle ne lui cache pas son étonnement et son dégoût lorsqu'il lui expose ses théories luxurieuses. Elle lui résiste, et il la met dehors. Pendant ce temps, une certaine Mme Desroches, chez qui elle est descendue, lui vole tout ce qu'elle possède. Justine se trouve à la merci de cette femme qui la met en rapport avec une Mme Delmonse, une demi-mondaine, qui lui vante les agréments de la prostitution. On essaye de prostituer Justine et on la ramène au vieux Dubourg. Elle résiste encore, et après quelques aventures, Justine, malgré son innocence, finit par aller en prison. Elle y fait connaissance avec une certaine Dubois, qui a commis tous les crimes imaginables. Toutes deux sont condamnées à mort. La Dubois incendie la prison, elles se sauvent et joignent une bande de brigands les plus infâmes qui se puissent rencontrer. Justine parvient à se sauver avec Saint-Florent, marchand qu'elle a délivré des mains des brigands et qui se dit son oncle. Il la viole et l'abandonne évanouie. En revenant à elle, Justine aperçoit ensuite un jeune homme, M. de Bressac, qui se livre à quelques divertissements avec son laquais. Ils lui font des avances et finissent par la conduire auprès de la vertueuse Mme de Bressac qui, s'apitoyant sur le sort de Justine, veut la ramènera Paris et s'occuper de sa réhabilitation. Malheureusement, la Delmouse est partie pour l'Amérique, et l'affaire ne peut être tirée au clair. Bressac, pendant ce temps, se livre à des orgies épouvantables, et demande la jeune fille de le seconder pour assassiner sa mère. Justine se sauve au bourg de Saint- Marcel, près de Paris, et entre chez un chirurgien nommé Rodin qui, avec sa sœur Célestine, tient une école mixte où ne sont admis que des enfants d'une beauté remarquable, n'ayant ni moins de douze ans, ni plus de dix-sept, et au nombre de cent pour chaque sexe. Rodin enseigne les garçons, et Céline les filles. Justine se lie avec la fille de Rodin, Rosalie. Rodin ne commet pas seulement des incestes, il se livre avec son collègue Rambeau à des opérations chirurgicales, aussi audacieuses que criminelles, auxquelles ils soumettent la malheureuse Justine qui échappe à la mort presque miraculeusement et va à Sens- Assise au crépuscule au bord d'un étang, elle entend qu'on jette quelque chose dans l'eau ; voyant que c'est une toute petite fille, elle la sauve ; mais le meurtrier rejette l'enfant et emmène Justine à son château. Il a pour habitude de rendre les femmes enceintes et de ne voir chacune d'elles qu'une seule fois, et de tuer les enfants qui naissent au bout de dix-huit mois. Il séquestre ainsi une trentaine de femmes. Il se nomme M. de Bandole et Justine est tirée de ses par le frère de la Dubois, le brigand Cœur-de-Fer. Ensuite Justine entre dans une abbaye de Bénédictins où le satanisme est en honneur. Il s'y trouve des sérails d'enfants des deux sexes. Le moine Jérôme raconte toutes les ignominies de sa longue vie emplie de meurtres et d'incestes. Il décrit les pays qu'il a visités: l'Allemagne, l'Italie, Tunis, Marseille, etc.
Justine quitte le cloître. Elle rencontre Dorothée d'Esterval, femme d'un aubergiste criminel qui tient une hôtellerie isolée dans laquelle il assassine les voyageurs qui s'y aventurent. Dorothée a peur. Elle supplie Justine de venir avec elle. Justine la suit dans l'auberge où se commettent tant de crimes. Bressac survient ; il est, en effet, parent d'Esterval. Tous se rendent chez le comte de Germande, qui est également un de leurs parents. Celui-ci a pris la détestable habitude de martyriser sa femme, dont la beauté est admirable. Il lui tire « deux palettes de sang » tous les quatre jours. Ensuite Justine a encore une série d'aventures qui se passe dans la famille Verneuil, chez les Jésuites, au milieu de tribades et d'invertis de toutes sortes. Justine rencontre ensuite le faux monnayeur Roland et finit par être enfermée dans la prison de Grenoble. Elle est sauvée par un avocat du barreau de cette ville, M. S... A l'auberge elle rencontre la Dubois qui la conduit à la maison de campagne de l'archevêque de Grenoble, dans laquelle il y a un cabinet à glaces pouvant se transformer en une épouvantable chambre de torture où l'archevêque fait décapiter les femmes après les avoir ignoblement outragées.
Justine s'échappe ; il lui arrive un certain nombre d'aventures épouvantables. On l'incarcère de nouveau et, derechef, la voilà condamnée à mort. Elle s'évade, erre lamentablement et finit par rencontrer une jolie dame qu'accompagnent quatre messieurs. C'est Juliette, qui accueille sa sœur avec tendresse et lui vante la vie criminelle : « J'ai suivi la route du vice, moi, mon enfant ; je n'y ai jamais rencontré que des roses. »
Justine chez M. Dubourg...
"Vous me permettrez de cacher mon nom et ma naissance, madame ; sans être illustre, elle est honnête, et je n'étais pas destinée à l'humiliation ou vous me voyez réduite. Je perdis fort jeune mes parents; je crus, avec le peu de secours qu'ils m'avaient laissé, pouvoir attendre une place convenable, et, refusant toutes celles qui ne l'étaient pas, je mangeai, sans m'en apercevoir, à Paris où je suis née, le peu que je possédais ; plus je devenais pauvre, plus j'étais méprisée; plus j'avais besoin d'appui, moins j'espérais d'en obtenir ; mais de toutes les duretés que j'éprouvai dans les commencements de ma malheureuse situation, de tous les propos horribles qui me furent tenus, je ne vous citerai que ce qui m'arriva chez M. Dubourg, un des plus riches traitants de la capitale. La femme chez qui je logeais m'avait adressée à lui comme à quelqu'un dont le crédit et les richesses pouvaient le plus sûrement adoucir la rigueur de mon sort.
Après avoir attendu très longtemps dans l'antichambre de cet homme, on m'introduisit; M. Dubourg, âgé de quarante-huit ans, venait de sortir du lit ; entortille d'une robe de chambre flottante qui cachait à peine son désordre, on s'apprêtait à le coiffer ; il fit retirer et me demanda ce que je voulais. «Hélas! monsieur, lui répondis-je toute confuse, je suis une pauvre orpheline qui n'a pas encore quatorze ans et qui connaît déjà toutes les nuances de l'infortune ; j'implore votre commisération, ayez pitié de moi je vous conjure. »
Et alors je lui détaillai tous mes maux, la difficulté de rencontrer une place, peut-être même un peu la peine que j'éprouvais à en prendre une, n'étant pas née pour cet état ; le malheur que j'avais eu, pendant tout cela, de manger le peu que j'avais... le défaut d'ouvrage, l'espoir où j'étais qu'il me faciliterait les moyens de vivre ; tout ce que dicte enfin l'éloquence du malheur, toujours rapide dans une âme sensible, toujours à charge à l'opulence...
Après m'avoir écoutée avec beaucoup de distraction, M. Dubourg me demanda si j'avais toujours été sage. — «Je ne serais aussi pauvre ni aussi embarrassée, monsieur, répondis-je, si j'avais voulu cesser de l'être. » — « Mais, me dit à cela M. Dubourg, à quel titre prétendez-vous que les gens riches vous soulagent, si vous ne les servez en rien ?» — « Et de quel service prétendez-vous parler, monsieur? répondis-je; je ne demande pas mieux que de rendre ceux que la décence et mon âge me permettront de remplir. » — « Les services d'une enfant comme vous sont peu utiles dans une maison, me répondit Dubourg; vous n'êtes ni d'âge, ni de tournure à vous placer comme vous le demandez. Vous ferez mieux de vous occuper de plaire aux hommes et de travaillera trouver quelqu'un qui consente à prendre soin de vous ; cette vertu dont vous faites un si grand étalage ne sert à rien dans le monde : vous aurez beau fléchir au pied de ses autels, son vain encens ne vous nourrira point. La chose qui flatte le moins les hommes, celle dont ils font le moins de cas, celle qu'ils méprisent le plus souverainement, c'est la sagesse de votre sexe; on n'estime ici-bas, mon enfant, que ce qui rapporte ou ce qui délecte ; et de quel profit peut nous être la vertu des femmes ? Ce sont leurs désordres qui nous servent et qui nous amusent mais leur chasteté nous intéresse on ne saurait moins.
Quand les gens de notre sorte donnent, en un mot, ce n'est jamais que pour recevoir ; or, comment une petite fille comme vous peut-elle reconnaître ce qu'on fait pour elle, si n'est par l'abandon le plus entier de tout ce qu'on exige de son corps?» — « Oh ! monsieur, répondis-je le cœur gros de soupirs, il n'y a donc plus ni honnêteté ni bienveillance chez les hommes?» — « Fort peu, répliqua Dubourg; ; on en parle tant, comment voulez- vous qu'il y en ait? On est revenu de cette manie d'obliger gratuitement les autres ; on a reconnu que les plaisirs de la charité n'étaient que les jouissances de l'orgueil, et, comme rien n'est aussi dissipé, on a vu qu'avec une enfant comme vous, par exemple, il valait infiniment mieux retirer, pour fruit de ses avances, tous les plaisirs que peut offrir la luxure que ceux très froids et très utiles de la soulager gratuitement ; la réputation d'un homme libéral, aumônier, généreux, ne vaut pas, même à l'instant où il en jouit le mieux, le plus petit plaisir des sens. » — « Oh ! monsieur, avec de pareils principes, il faut que l'infortunée périsse !» — « Qu'importe ? il y a plus de sujets qu'il n'en faut en France; pourvu que la machine ait toujours la même élasticité, que fait à l'Etat le plus ou le moins d'individus qui la pressent ?» — « Mais croyez-vous que des enfants respectent leurs pères quand ils sont ainsi maltraités ?» — « Que fait à un père l'amour d'enfants qui le gênent?» — «Il vaudrait donc mieux qu'on nous eût étouffés dès le berceau !» — « Assurément, c'est l'usage dans beaucoup de pays ; c'était la coutume des Grecs ; c'est celle des Chinois ; là, les enfants malheureux s'exposent ou se mettent à mort. A quoi bon laisser vivre des créatures qui, ne pouvant plus compter sur les secours de leurs parents, ou parce qu'ils en sont privés ou parce qu'ils n'en sont pas reconnus, ne servent plus dès lors qu'à surcharger l'Etat d'une denrée dont il a déjà trop ? Les bâtards, les orphelins, les enfants mal conformés devraient être condamnés à mort dès leur naissance : les premiers et les seconds, parce que, n'ayant plus personne qui veuille ou qui puisse prendre soin d'eux, ils souillent la société d'une lie qui ne peut que lui devenir funeste un jour ; et les autres, parce qu'ils ne peuvent lui être d'aucune utilité. L'une et l'autre de ces classes sont, à la société, comme ces excroissances de chair qui, se nourrissant du suc des membres sains, les dégradent et les affaiblissent ; ou, si vous l'aimez mieux, comme ces végétaux parasites qui, se liant aux bonnes plantes, les détériorent et les rongent en s'adaptant leur semence nourricière. Abus criants de ces aumônes destinées à nourrir une telle écume que ces maisons richement dotées qu'on a l'extravagance de leur bâtir, comme si l'espèce des hommes était tellement rare, tellement précieuse, qu'il fallût en conserver jusqu'à la plus vile portion I Mais laissons une politique où tu ne dois rien comprendre, mon enfant ; pourquoi se plaindre de son sort, quand il ne tient qu'à soi d'y remédier » — « A quel prix, juste ciel ! » — «A celui d'une chimère, d'une chose qui n'a de valeur que celle que ton orgueil y met. Au reste, continue ce barbare en se levant et ouvrant la porte, voilà tout ce que je puis pour vous ; consentez-y ou délivrez-moi de votre présence ; je n'aime pas les mendiants... »
Mes larmes coulèrent, il me fut impossible de les retenir ; le croirez-vous, madame ? elles irritèrent cet homme au lieu de l'attendrir. Il referme la porte et, me saisissant par le collet de ma robe, il me dit avec brutalité qu'il va me faire faire de force ce que je ne veux pas lui accorder de bon gré. En cet instant cruel mon malheur me prête du courage ; je me débarrasse de ses mains, et m'élançant vers la porte : « Homme odieux, lui dis-je en m'échappant, puisse le Ciel aussi grièvement offensé par toi te punir, comme tu le mérites, de ton exécrable endurcissement ! Tu n'es digne ni de ces richesses dont tu fais un si vil usage, ni de l'air même que tu respires dans un monde souillé par tes barbaries. »
La répression du crime diminue le bonheur social..
«Ne croîs pas, répondait-il à mes sages conseils, que l'espèce d'hommage que j'ai rendu à la vertu dans toi soit une preuve, ni que j'estime la vertu, ni que j'aie envie de la préférer au vice. Ne l'imagine pas, Thérèse, tu t'abuserais ; ceux qui, partant de ce que j'ai fait envers toi, soutiendraient, d'après ce procédé, l'importance ou la nécessité de la vertu tomberaient dans une grande erreur, et je serais bien fâché que tu crusses que telle est ma façon de penser. La masure qui me sert d'abri à la chasse quand les rayons trop ardents du soleil dardent à plomb sur mon individu n'est assurément pas un monument inutile, sa nécessité n'est que de circonstance : je m'expose à une sorte de danger, je trouve quelque chose qui me garantit, je m'en sers, mais ce quelque chose en est-il moins utile ? en peut-il être moins méprisable ?
Dans une société totalement vicieuse, la vertu ne servirait à rien : les nôtres n'étant pas de ce genre, il faut absolument ou la jouer, ou s'en servir, afin d'avoir moins à redouter ceux qui la suivent. Que personne ne l'adopte, elle deviendra utile. Je n'ai donc pas tort quand je soutiens que sa nécessité n'est que d'opinion ou de circonstances ; la vertu n'est pas un mode d'un prix incontestable, elle n'est qu'une manière de se conduire qui varie suivant chaque climat et qui, par conséquent, n'a rien de réel : cela seul en fait voir la (utilité. Il n'y a que ce qui est constant qui soit réellement bon ; ce qui change perpétuellement ne saurait prétendre au caractère de bonté. Voilà pourquoi l'on a mis l'immutabilité au rang des perfections de l'Eternel ; mais la vertu est absolument privée de ce caractère; il n'est pas deux peuples sur la surface du globe qui soient vertueux de la même manière ; donc la vertu n'a rien de réel, rien de bon intrinsèquement et ne mérite en rien notre culte; il faut s'en servir comme d'étai, adopter politiquement celle du pays où l'on vit, afin que ceux qui la pratiquent par goût, ou qui doivent la révérer par état, vous laissent en repos, et afin que cette vertu, respectée où vous êtes, vous garantisse, par sa prépondérance de convention, des attentats de ceux qui professent le vice.
Mais, encore une fois, tout cela est de circonstance, et rien de tout cela n'assigne un mérite réel à la vertu. Il est telle vertu, d'ailleurs, impossible à de certains hommes ; or, comment me persuaderez-vous qu'une vertu qui combat ou qui contrarie les passions puisse se trouver dans la Nature ? Et si elle n'y est pas, comment peut-elle être bonne ? Assurément ce seront, chez les hommes dont il s'agit, les vices opposés à ces vertus qui deviendront préférables, puisque ce seront les seuls modes..., les seules manières d'être qui s'arrangeront le mieux à leur physique ou à leurs organes; il y aura donc dans cette hypothèse des vices très utiles : or, comment la vertu le sera-t-elle si vous me démontrez que ces contraires puissent l'être ?
On vous dit à cela : la vertu est utile aux autres, et en ce sens elle est bonne ; car s'il est reçu de ne faire que ce qui est bon aux autres, à mon tour je ne recevrai que du bien. Ce raisonnement n'est qu'un sophisme : pour le peu de bien que je reçois des autres, en raison de ce qu'ils pratiquent la vertu, par l'obligation de la pratiquera mon tour, je fais un million de sacrifices qui ne me dédommagent nullement. Recevant moins que je ne donne, je fais donc un mauvais marché : j'éprouve beaucoup plus de mal des privations que j'endure pour être vertueux que je ne reçois de bien de ceux qui le sont ; l'arrangement n'étant point égal, je ne dois donc pas m'y soumettre, et, sûr, étant vertueux, de ne pas faire aux autres autant de bien que je recevrais de peines en me contraignant à l'être, ne vaudra-t-il donc pas mieux que je renonce à leur procurer un bonheur qui doit me coûter autant de mal ?
Reste maintenant le tort que je peux faire aux autres étant vicieux et le mal que je recevrai à mon tour si tout le monde me ressemble. En admettant une entière circulation de vices, je risque assurément, j'en conviens ; mais le chagrin éprouvé par ce que je risque est compensé par le plaisir de ce que je fais risquer aux autres ; voilà, dès lors, l'égalité établie, dès lors tout le monde est à peu près également heureux ; ce qui n'est pas et ne saurait être dans une société où les uns sont bons et les autres méchants, parce qu'il résulte, de ce mélange, des pièges perpétuels qui n'existent point dans l'autre cas.
Dans la société mélangée, tous les intérêts sont divers ; voilà la source d'une infinité de malheurs ; dans l'autre association, tous les intérêts sont égaux ; chaque individu qui la compose est doué des mêmes goûts, des mêmes penchants ; tous marchent au même but ; tous sont heureux. Mais, vous disent les sots, le mal ne rend point heureux. Non, quand on est convenu d'encenser le bien ; mais déprisez, avilissez ce que vous appelez le bien, vous ne révérez plus ce que vous aviez la sottise d'appeler le mal ; et tous les hommes auront du plaisir à le commettre, non point parce qu'il sera permis (ce serait quelquefois une raison pour en diminuer l'attrait), mais c'est que les lois ne le puniront plus, et qu'elles diminuent, par la crainte qu'elles inspirent, le plaisir qu'a placé la Nature au crime. Je suppose une société où il sera convenu que l'inceste (admettons ce délit comme tout autre), que l'inceste, dis-je, soit un crime : ceux qui s'y livreront seront malheureux, parce que l'opinion, les lois, le culte, tout viendra glacer leurs plaisirs ; ceux qui désireront de commettre ce mal et qui ne l'oseront, d'après ces freins, seront également malheureux : ainsi la loi qui proscrira l'inceste n'aura fait que des infortunés. Que dans la société voisine l'inceste ne soit point un crime : ceux qui ne le désireront pas ne seront point malheureux, et ceux qui le désireront seront heureux. Donc la société qui aura permis cette action conviendra mieux aux hommes que celle qui aura érigé cette même action en crime.
Il en est de même de toutes les autres actions maladroitement considérées comme criminelles : en les observant sous ce point de vue, vous faites une foule de malheureux ; en les per- mettant, personne ne se plaint ; car celui qui aime cette action quelconque s'y livre en paix, et celui qui ne s'en soucie pas, ou reste dans une sorte d'indifférence qui n'est nullement douloureuse, ou se dédommage de la lésion qu'il a pu recevoir par une foule d'autres lésions dont il grève à son tour ceux dont il a eu à se plaindre.
Donc tout le monde, dans une société criminelle, se trouve ou très heureux ou dans un état d'insouciance qui n'a rien de pénible ; par conséquent, rien de bon, rien de respectable, rien de fait pour rendre heureux dans ce qu'on appelle la vertu. Que ceux qui la suivent ne s'enorgueillissent donc pas de cette sorte d'hommage que le genre de constitution de nos sociétés nous force à lui rendre : c'est une affaire purement de circonstances, de convention; mais, dans le fait, ce culte est chimérique, et la vertu qui l'obtient un instant n'en est pas pour cela la plus belle. »
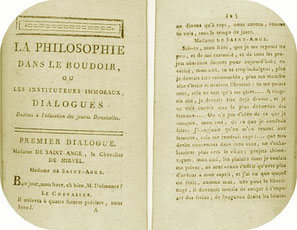
1795 – "La Philosophie dans le boudoir, ou Les Instituteurs libertins"
L'ouvrage se présente comme une série de dialogues retraçant l'éducation érotique et sexuelle d'une jeune fille de 15 ans, dont le père est aussi libertin que la mère est dévote. Une libertine, Mme de Saint-Ange, veut initier Eugénie de Mistival «dans les plus secrets mystères de Vénus». Elle est aidée en cela par son frère (le chevalier de Mirvel), un ami de son frère (Dolmancé), par son jardinier (Augustin) et le valet Lapierre. Les dissertations érotico-philosophiques tiennent ici une place importante d'autant qu'il s'agit pour Mme de Saint-Ange de placer "dans cette jolie petite tête" tous les principes du libertinage le plus effréné, détruire tous les principes inculqués par sa mère, auxquels sont substitués l'athéisme, le blasphème, l'égoïsme, l'avidité, le vol, l'assassinat, l'adultère, l'inceste, la sodomie. La jeune fille se montrera une élève particulièrement attentive mais vont la dépasser d'autant qu'elle rêve d'exercer sur sa propre mère toutes les leçons de cruauté qu'elle a désormais acquises. Le cinquième dialogue comprend la lecture d'un long pamphlet révolutionnaire intitulé "Français, encore un effort si vous voulez être républicain", qui appelle à la suppression de toute religion et à la réduction au minimum de toute législation contraignante. Cette œuvre qui exalte la jouissance sexuelle trouve son apogée dans la répudiation par Eugénie de sa mère venue la rechercher. Mme de Mistival est violée, battue, contaminée par la vérole et finalement cousue...
Portrait d'Eugénie...
DE SAINT-ANGE - Eh bien, mon cher amour, pour recompenser aujourd'hui ta délicate complaisance, je vais livrer à tes ardeurs une jeune fille vierge et plus belle que l'Amour.
LE CHEVALIER - Comment! avec Dolmancé... tu fais venir une femme chez toi ?
DE SAINT-ANGE - Il s'agit d'une éducation ; c'est une petite fille que j'ai connue au couvent l'automne dernier, pendant que mon mari était aux eaux. Là, nous ne pûmes rien, nous n'osâmes rien, trop d'yeux étaient fixés sur nous, mais nous nous promîmes de nous réunir dès que cela serait possible ; uniquement occupée de mon désir, j'ai, pour y satisfaire, fait connaissance avec sa famille. Son père est un libertin... que j'ai captivé. Enfin la belle vient, je l'attends ; nous passerons deux jours ensemble... deux jours délicieux ; la meilleure partie de ce temps, je l'emploie à éduquer cette jeune personne, Dolmancé et moi nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné, nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie, nous lui inspirerons nos désirs, et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on se divertisse, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de Cythère, Dolmancé à celle des roses de Sodome. J'aurai deux plaisirs à la fois : celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans nos filets. Eh bien ! chevalier, ce projet est-il digne de mon imagination ?
LE CHEVALIER - Il ne peut être conçu que par elle : il est divin, ma sœur, et je te promets d'y remplir à merveille le rôle charmant que tu m'y destines. Ah ! friponne, comme tu vas jouir du plaisir d'éduquer cette enfant ! quelles délices pour toi de la corrompre, d'étouffer dans ce jeune cœur toutes les semences de vertu et de religion qu'y placèrent ses institutrices! En vérité, cela est trop roué pour moi.
Mme DE SAINT-ANGE - Il est bien sûr que je n'épargnerai rien pour la pervertir, pour dégrader, pour culbuter dans elle tous les faux principes de morale dont on aurait pu déjà l'étourdir ; je veux, en deux leçons, la rendre aussi scélérate que moi... aussi impie,... aussi débauchée. Préviens Dolmancé, mets-le au fait dès qu'il arrivera, pour que le venin de ses immoralités, circulant dans ce jeune cœur avec celui que j'y lancerai, parvienne à déraciner dans peu d'instants toutes les semences de vertu qui pourraient y germer sans nous.
LE CHEVALIER - Il était impossible de mieux trouver l'homme qu'il te fallait: l'irréligion, l'impiété, l'inhumanité, le libertinage découlent des lèvres de Dolmancé comme autrefois l'onction mystique de celles du célèbre archevêque de Cambrai ; c'est le plus profond séducteur, l'homme le plus corrompu, le plus dangereux... Ah! ma chère amie, que ton élève réponde aux soins de l'instituteur, et je le la garantis bientôt perdue.
Mme DE SAINT-ANGE - Cela ne sera sûrement pas long avec les dispositions que je lui connais...
LE CHEVALIER - Mais dis-moi, chère sœur, ne redoutes-tu rien des parents ? Si cette petite fille venait à jaser quand elle retournera chez elle ?
Mme DE SAINT-ANGE - Ne crains rien, j'ai séduit le père... il est à moi. Faut- il enfin te l'avouer ? je me suis livrée à lui pour qu'il fermât les yeux ; il ignore mes desseins, mais il n'osera jamais les approfondir... Je le tiens.
LE CHEVALIER - Tes moyens sont affreux !
Mme DE SAINT-ANGE - Voilà comment il les faut pour qu'ils soient sûrs.
LE CHEVALIER - Eh! dis-moi, je te prie, quelle est cette jeune personne?
Mme DE SAINT-ANGE - On la nomme Eugénie ; elle est la fille d'un certain Mistival, l'un des plus riches traitants de la capitale, âgé d'environ trente-six ans ; la mère en a tout au plus trente- deux et la petite fille quinze. Mistival est aussi libertin que sa femme est dévote. Pour Eugénie, ce serait en vain, mon ami, que j'essayerais de te la peindre : elle est au-dessus de mes pinceaux; qu'il te suffise d'être convaincu que ni toi ni moi n'avons certainement jamais vu rien d'aussi délicieux au monde.
LE CHEVALIER - Mais esquisse au moins, si tu ne peux peindre, afin que, sachant à peu près à qui je vais avoir affaire, je me remplisse mieux l'imagination de l'idole où je dois sacrifier.
Mme DE SAINT-ANGE - Eh bien! mon ami, ses cheveux châtains, qu'à peine on peut empoigner, lui descendent au bas des fesses ; son teint est d'une blancheur éblouissante; son nez un peu aquilin, ses yeux d'un noir d'ébène et d'une ardeur!... Oh ! mon ami, il n'est pas possible de tenir à ces yeux-là. Tu n'imagines point toutes les sottises qu'ils m'ont fait faire... Si tu voyais les jolis sourcils qui les couronnent,... les intéressantes paupières qui les bordent! Sa bouche est très petite, ses dents superbes, et tout cela d'une fraîcheur !... Une de ses beautés est la manière élégante dont sa belle tête est attachée sur ses épaules, l'air de noblesse qu'elle a quand elle la tourne... Eugénie est grande pour son âge : on lui donnerait dix-sept ans ; sa taille est un modèle d'élégance et de finesse, sa gorge délicieuse... Ce sont bien les deux plus jolis petits tétons !... A peine y a-t-il de quoi remplir la main, mais si doux,... si frais,.. . si blancs ! Vingt fois j'ai perdu la tête en les baisant, et si tu avais vu comme elle s'animait sous mes caresses... comme ses deux grands yeux me peignaient l'état de son âme !... Mon ami, je ne sais pas comment est le reste. Ah ! s'il en faut juger par ce que je connais, jamais l'Olympe n'eut une divinité qui la valût... Mais je l'entends... laisse-nous ; sors par le jardin pour ne point la rencontrer et sois exact au rendez-vous.
LE CHEVALIER - Le tableau que tu viens de me faire te répond de mon exactitude...
Français ! encore un effort, si vous voulez être Républicains...
EUGÉNIE - Allons, je vous pardonne et je dois respecter des principes qui conduisent à des égarements. Comment ne les adopterais-je pas, moi qui ne veux plus vivre que dans le crime? Asseyons-nous et jasons un instant ; je n'en puis plus. Continuez mon instruction, Dolmancé, et dites-moi quelque chose qui me console des excès où me voilà livrée ; éteignez mes remords ; encouragez-moi.
Mme DE SAINT-ANGE - Cela est juste, il faut qu'un peu de théorie succède à la pratique : c'est le moyen d'en faire une écolière parfaite.
DOLMANCÉ - Eh bien ! quel est l'objet, Eugénie, sur lequel vous voulez qu'on vous entretienne?
EUGÉNIE - Je voudrais savoir si les mœurs sont vraiment nécessaires dans un gouvernement, si leur influence est de quelque poids sur le génie d'une nation.
DOLMANCÉ - Ah ! parbleu, en partant ce matin, j'ai acheté au palais de l'Egalité une brochure qui, s'il en faut croire le titre, doit nécessairement répondre à votre question... A peine sort-elle de la presse!
Mme DE SAINT-ANGE - Voyons. (Elle lit : Français, encore un efforl, si vous voulez être républicains.) Voilà, sur ma parole, un singulier titre ; il promet. Chevalier, toi qui possèdes un bel organe, lis-nous cela.
DOLMANCÉ - Ou je me trompe, ou cela doit parfaitement répondre à la question d'Eugénie.
EUCÉNIE - Assurément.
Mme DE SAINT-ANGE - Sors, Augustin, ceci n'est pas fait pour toi ; mais ne t'éloigne pas ; nous sonnerons dès qu'il faudra que tu reparaisses.
LE CHEVALIER - Je commence.
FRANÇAIS, Encore un effort, si vous voulez être républicains.
LES MŒURS
Après avoir démontré que le théisme ne convient nullement à un gouvernement républicain, il me paraît nécessaire de prouver que les mœurs françaises ne lui conviennent pas davantage. Cet article est d'autant plus essentiel que ce sont les moeurs qui vont servir de motifs aux lois qu'on va promulguer.
Français, vous êtes trop éclairés pour ne pas sentir qu'un nouveau gouvernement va nécessiter de nouvelles mœurs; il est impossible que le citoyen d'un Etat libre se conduise comme l'esclave d'un roi despote ; ces différences de leurs intérêts, de leurs devoirs, de leurs relations entre eux déterminent essentiellement une manière tout autre de se comporter dans le monde; une foule de petites erreurs, de petits délits sociaux, considérés comme très essentiels sous le gouvernement des rois, qui devaient exiger d'autant plus qu'ils avaient plus besoin d'imposer des freins pour se rendre respectables et inabordables à leurs sujets, vont devenir nuls ici ; d'autres forfaits, connus sous les noms de régicide et de sacrilège, sous un gouvernement qui ne connaît plus ni rois, ni religion, doivent s'anéantir de même dans un État républicain. En accordant la liberté de conscience et celle de la presse, songez, citoyens, qu'à bien peu de chose près on doit accorder celle d'agir, et qu'excepté ce qui choque directement les bases du gouvernement il vous reste on ne saurait moins de crimes à punir, parce que, dans le fait, il est fort peu d'actions criminelles dans une société dont la liberté et l'égalité font les bases, et qu'à bien peser et bien examiner les choses il n'y a vraiment de criminel que ce que réprouve la loi ; car la nature nous dictant également des vices et des vertus, en raison de notre organisation, ou, plus philosophiquement encore, en raison du besoin qu'elle a de l'un ou de l'autre, ce qu'elle nous inspire deviendrait une mesure très certaine pour régler avec précision ce qui est mal. Mais, pour mieux développer mes idées sur un objet aussi essentiel, nous allons classer les différentes actions de la vie de l'homme, que l'on était convenu jusqu'à présent de nommer criminelles, et nous les toiserons ensuite aux vrais devoirs d'un républicain.
On a considéré de tous temps les devoirs de l'homme sous les trois différents rapports suivants :
1° Ceux que sa conscience et sa crédulité lui imposent envers l'être suprême;
2° Ceux qu'il est obligé de remplir avec ses frères ;
3° Enfin ceux qui n'ont de relation qu'avec lui.
La certitude où nous devons être qu'aucun dieu ne s'est mêle de nous, et que, créatures nécessitées de la nature, comme les plantes et les animaux, nous sommes ici parce qu'il était impossible que nous n'y fussions pas ; cette certitude, sans doute, anéantit, comme on le voit, tout d'un coup la première partie de ces devoirs, je veux dire ceux dont nous nous croyons faussement responsables envers la divinité; avec eux disparaissent tous les délits religieux, tous ceux connus sous les noms vagues et infinis d'impiété, de sacrilège, de blasphème, d'athéisme, etc., tous ceux, en un mot, qu'Athènes punit avec tant d'injustice dans Alcibiade, et la France dans l'infortuné Labarre. S'il y a quelque chose d'extravagant dans le monde, c'est de voir des hommes qui ne connaissent leur Dieu et ce que peut exiger ce Dieu que d'après leurs idées bornées vouloir néanmoins décider sur la nature de ce qui contente ou de ce qui fâche ce ridicule fantôme de leur imagination. Ce ne serait donc point à permettre indifféremment tous les cultes que je voudrais qu'on se bornât; je désirerais qu'il fût libre de se rire ou de se moquer de tous; que des hommes, réunis dans un temple quelconque pour invoquer l'Eternel à leur guise, fussent vus comme des comédiens sur un théâtre, au jeu desquels il est permis à chacun d'aller rire. Si vous ne voyez pas les religions sous ce rapport, elles reprendront le sérieux qui les rend importantes, elles protégeront bientôt les opinions, et l'on ne se sera pas plus tôt disputé sur les religions qu'on se rebattra pour les religions; l'égalité détruite par la préférence ou la protection accordée à l'une d'elles disparaîtra bientôt du gouvernement, et de la théocratie réédifiée renaîtra bientôt l'aristocratie. Je ne saurais donc trop le répéter : plus de dieux, Français, plus de dieux, si vous ne voulez pas que leur funeste empire vous replonge bientôt dans toutes les horreurs du despotisme; mais ce n'est qu'en vous en moquant que vous détruirez tous les dangers à leur suite, ils reparaîtront aussitôt en foule si vous y mettez de l'humeur ou de l'importance. Ne renversez point leurs Idoles en colère, pulvérisez-les en jouant et l'opinion tombera d'elle-même.
En voilà suffisamment, je l'espère, pour démontrer qu'il ne doit être promulgué aucune loi contre les délits religieux, parce que qui offense une chimère n'offense rien, et qu'il serait de la dernière inconséquence de punir ceux qui outragent ou qui méprisent un culte, dont rien ne vous démontre avec évidence la priorité sur les autres; ce serait nécessairement adopter un parti et influencer dès lors la balance de l'égalité, première loi de votre nouveau gouvernement.
Passons aux seconds devoirs de l'homme, ceux qui le lient avec ses semblables; cette classe est la plus étendue de toutes.
La morale chrétienne, trop vague sur les rapports de l'homme avec ses semblables, pose des bases si pleines de sophismes qu'il nous est impossible de les admettre, parce que, si l'on veut édifier des principes, il faut bien se garder de leur donner des sophismes pour bases. Elle nous dit, cette absurde morale, d'aimer notre prochain comme nous-même. Rien ne serait assurément plus sublime s'il était possible que ce qui est faux pût jamais porter les caractères de la beauté. Il ne s'agit pas d'aimer ses semblables comme soi-même, puisque cela est contre les lois de la nature et que son seul organe doit diriger toute notre vie; il n'est question que d'aimer nos semblables comme des amis que la nature nous donne, et avec lesquels nous devons vivre d'autant mieux dans un Etat républicain que la disparition des distances doit nécessairement resserrer les liens.
Que l'humanité, la fraternité, la bienfaisance nous prescrivent d'après cela nos devoirs réciproques, et remplissons-les individuellement avec le simple degré d'énergie que nous a donné sur ce point la nature, sans blâmer et surtout sans punir ceux qui, plus froids et plus atrabilaires, n'éprouvent pas dans ces liens, néanmoins si touchants, toutes les douceurs que d'autres y rencontrent ; car, on en conviendra, ce serait ici une absurdité palpable que de vouloir prescrire des lois universelles ; ce procédé serait aussi ridicule que celui d'un général d'armée qui voudrait que tous ses soldats fussent vêtus d'un habit fait sur la même mesure ; c'est une injustice effrayante que d'exiger que des hommes, de caractères inégaux, se plient à des lois égales : ce qui va à l'un ne va point à l'autre.
Je comprends que l'on ne peut pas faire autant de lois qu'il y a d'hommes; mais les lois peuvent être si douces, en si petit nombre, que tous les hommes, de quelque caractère qu'ils soient, puissent facilement s'y plier. Encore exigerais-je que ce petit nombre de lois fût d'espèce à pouvoir s'adapter facilement à tous les différents caractères ; l'esprit qui la dirigerait serait de frapper plus ou moins, en raison de l'individu qu'il faudrait atteindre. Il est démontré qu'il y a telle vertu dont la pratique est impossible à certains hommes, comme il y a tel remède qui ne saurait convenir à tel tempérament. Or, quel sera le comble de votre injustice si vous frappez de la loi celui auquel il est impossible de se plier à la loi?
L'iniquité que vous commettriez en cela ne serait-elle pas égale à celle dont vous vous rendriez coupables si vous vouliez forcer un aveugle à discerner les couleurs ?
De ces premiers principes il découle, on le sent, la nécessité de faire des lois douces et surtout d'anéantir pour jamais l'atrocité de la peine de mort, parce que la loi, froide par elle-même, ne saurait être accessible aux passions qui peuvent légitimer dans l'homme la cruelle action du meurtre ; l'homme reçoit de la nature les impressions qui peuvent lui faire pardonner cette action, et la loi, au contraire, toujours en opposition avec la nature et ne recevant rien d'elle, ne peut être autorisée à se permettre les mêmes motifs, il est impossible qu'elle ait les mêmes droits. Voilà de ces distinctions savantes et délicates qui échappent à beaucoup de gens, parce que fort peu de gens réfléchissent ; mais elles seront accueillies des gens instruits à qui je les adresse, et elles influeront, je l'espère, sur le nouveau code que l'on prépare.
La seconde raison pour laquelle on doit anéantir la peine de mort, c'est qu'elle n'a jamais réprimé le crime, puisqu'on le commet chaque jour au pied de l'échafaud.
On doit supprimer cette peine, en un mot, parce qu'il n'y a point de plus mauvais calcul que celui de faire mourir un homme pour en avoir tué un autre, puisqu'il résulte évidemment de ce procédé qu'au lieu d'un homme de moins en voilà tout d'un coup deux, et qu'il n'y a que des bourreaux ou des imbéciles auxquels une telle arithmétique puisse être familière.
Quoi qu'il en soit, enfin, les forfaits que nous pouvons commettre envers nos frères se réduisent à quatre principaux : la calomnie, le vol, les délits qui, causés par l'impureté, peuvent atteindre désagréablement les autres, et le meurtre.
Toutes ces actions, considérées comme capitales dans un gouvernement monarchique, sont-elles aussi graves dans un Etat républicain? C'est ce que nous allons analyser avec le flambeau de la philosophie, car c'est à sa seule lumière qu'un tel examen doit s'entreprendre. Qu'on ne me taxe point d'être un novateur dangereux; qu'on ne dise pas qu'il y a du risque à émousser, comme le feront peut-être ces écrits, le remords dans l'âme des malfaiteurs, qu'il y a le plus grand mal à augmenter par la douceur de ma morale le penchant que ces mêmes malfaiteurs ont aux crimes : j'atteste ici formellement n'avoir aucune de ces vues perverses ; j'expose les idées qui, depuis l'âge de raison, se sont identifiées en moi et au jet desquelles l'infâme despotisme des tyrans s'était opposé depuis tant de siècles ; tant pis pour ceux que ces grandes idées corrompraient ; tans pis pour ceux qui ne savent saisir que le mal dans des opinions philosophiques, susceptibles de se corrompre à tout ! Qui sait s'ils ne se gangrèneraient peut-être pas aux lectures de Sénèque et de Charron ? Ce n'est point à eux que je parle ; je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre, et ceux-là me liront sans danger.
J'avoue avec la plus extrême franchise que je n'ai jamais cru que la calomnie fût un mal, et surtout dans un gouvernement comme le nôtre, où tous les hommes, plus liés, plus rapprochés, ont évidemment un plus grand intérêt à se bien connaître. De deux choses l'une : ou la calomnie porte sur un homme véritablement pervers, ou elle tombe sur un homme vertueux. On conviendra que, dans le premier cas, il devient à peu près indifférent que l'on dise un peu plus de mal d'un homme connu pour en faire beaucoup ; peut-être même alors le mal qui n'existe pas éclairera-t-il sur celui qui est, et voilà le malfaiteur mieux connu.
S'il règne, je suppose, une influence malsaine à Hanovre, mais que je ne doive courir d'autres risques, en m'exposant à cette inclémence de l'air, que de gagner un accès de fièvre, pourrai-je savoir mauvais gré à l'homme qui, pour m'empêcher d'y aller, m'aurait dit qu'on y mourait en y arrivant? Non, sans doute; car, en m'effrayant par un grand mal, il m'a empêché d'en éprouver un petit.
La calomnie porte-t-elle au contraire sur un homme vertueux : qu'il ne s'en alarme pas, qu'il se montre, et tout le venin du calomniateur retombera bientôt sur lui- même. La calomnie, pour de telles gens, n'est qu'un scrutin épuratoire dont leur vertu ne sortira que plus brillante. Il y a même ici du profit pour la masse des vertus de la république ; car cet homme vertueux et sensible, piqué de l'injustice qu'il vient d'éprouver, s'appliquera à mieux faire encore ; il voudra surmonter cette calomnie dont il se croyait à l'abri, et ses belles actions n'acquerront qu'un degré d'énergie de plus. Ainsi, dans le premier cas, le calomniateur aura produit d'assez bons effets en grossissant les vices de l'homme dangereux; dans le second, il en aura produit d'excellents en contraignant la vertu à s'offrir à nous tout entière.
Or, je demande maintenant sous quel rapport le calomniateur pourra vous paraître à craindre, dans un gouvernement surtout où il est essentiel de connaître les méchants et d'augmenter l'énergie des bons? Que l'on se garde donc bien de prononcer aucune peine contre la calomnie; considérons-la sous le double rapport d'un fanal et d'un stimulant, et, dans tous les cas, comme quelque chose de très utile. Le législateur, dont toutes les idées doivent être grandes comme l'ouvrage auquel il s'applique, ne doit jamais étudier l'effet du délit qui ne frappe qu'individuellement ; c'est son effet en masse qu'il doit examiner; et quand il observera de cette manière les effets qui résultent de la calomnie, je le défie d'y trouver rien de punissable; je défie qu'il puisse placer quelque ombre de justice à la loi qui la punirait ; il devient au contraire l'homme le plus juste et le plus intègre s'il la favorise ou la récompense.
Le vol est le second des délits moraux dont nous nous sommes proposé l'examen. Si nous parcourons l'antiquité, nous verrons le vol permis, récompensé dans toutes les républiques de la Grèce; Sparte et Lacédémone le favorisaient ouvertement; quelques autres peuples l'ont regardé comme une vertu guerrière ; il est certain qu'il entretient le courage, la force, l'adresse, toutes les vertus, en un mot, utiles à un gouvernement républicain, et par conséquent au nôtre. J'oserai demander, sans partialité maintenant, si le vol, dont l'effet est d'égaliser les richesses, est un grand mal dans un gouvernement dont le but est l'égalité ? Non, sans doute, car s'il entretient l'égalité d'un côté, de l'autre il rend plus exact à conserver son bien. Il y avait un peuple qui punissait, non pas le voleur, mais celui qui s'était laissé voler, afin de lui apprendre à soigner ses propriétés. Ceci nous amène à des réflexions plus étendues.
A Dieu ne plaise que je veuille attaquer ou détruire ici le serment du respect des propriétés que vient de prononcer la nation ; mais me permettra-t-on quelques idées sur l'injustice de ce serment ? Quel est l'esprit d'un serment prononcé par tous les individus d'une nation? N'est-il pas de maintenir une parfaite égalité parmi les citoyens, de les soumettre tous également à la loi protectrice des propriétés de tous ? Or, je vous demande maintenant si elle est bien juste la loi qui ordonne à celui qui n'a rien de respecter celui qui a tout ? Quels sont les éléments du pacte social ? Ne consistent-ils pas à céder un peu de sa liberté et de ses propriétés pour assurer et maintenir ce que l'on conserve de l'un et de l'autre?
Toutes les lois sont assises sur ces bases ; elles sont les motifs des punitions infligées à celui qui abuse de sa liberté ; elles autorisent de même les impositions; ce qui fait qu'un citoyen ne se récrie pas lorsqu'on les exige de lui, c'est qu'il sait qu'au moyen de ce qu'il donne on lui conserve ce qui lui reste ; mais, encore une fois, de quel droit celui qui n'a rien s'enchaînera-t-il sous un pacte qui ne protège que celui qui a tout ? Si vous faites un acte d'équité en conservant par votre serment les propriétés du riche, ne faites-vous pas une injustice en exigeant ce serment du conservateur qui n'a rien ? Quel intérêt celui-ci a-t-il à votre serment, et pourquoi voulez-vous qu'il promette une chose uniquement favorable à celui qui diffère autant de lui par des richesses? Il n'est assurément rien de plus injuste : un serment doit avoir un effet égal sur tous les individus qui le prononcent ; il est impossible qu'il puisse enchaîner celui qui n'a aucun intérêt à son maintien, parce qu'il ne serait plus alors le pacte d'un peuple libre : il serait l'arme du fort sur le faible, contre lequel celui-ci devrait se révolter sans cesse ; or, c'est ce qui arrive dans le serment du respect des propriétés que vient d'exiger la nation ; le riche seul y enchaîne le pauvre, le riche seul a intérêt au serment que prononce le pauvre avec tant d'inconsidération qu'il ne voit pas qu'au moyen de ce serment extorqué à sa bonne foi, il s'engage à faire une chose qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de lui.
Convaincus, ainsi que vous devez l'être, de cette barbare inégalité, n'aggravez donc pas votre injustice en punissant celui qui n'a rien d'avoir osé dérober quelque chose à celui qui a tout ; votre inéquitable serment lui en donne plus le droit que jamais. On le contraignant au parjure par ce serment absurde pour lui, vous légitimez tous les crimes où le portera ce parjure ; il ne vous appartient donc plus de punir ce dont vous avez été la cause. Je n'en dirai pas davantage pour faire sentir la cruauté horrible qu'il y a à punir les voleurs. Imitez la loi sage du peuple dont je viens de parler : punissez l'homme assez négligent pour se laisser voler, mais ne prononcez aucune espèce de peine contre celui qui vole ; songez que votre serment l'autorise à cette action et qu'il n'a fait, en s'y livrant, que suivre le premier et le plus sacré des mouvement de la nature, celui de conserver sa propre existence, n'importe aux dépens de qui.
Les délits que nous venons d'examiner dans cette seconde classe des devoirs de l'homme envers ses semblables consistent dans les actions que peut faire entreprendre le libertinage, parmi lesquelles se distinguent particulièrement comme plus attentatoires à ce que chacun doit aux autres la prostitution, l'adultère, l'inceste, le viol, la sodomie. Nous ne devons certainement pas douter que tout ce qui s'appelle crimes moraux, c'est-à-dire toutes les actions de l'espèce de celles que nous venons de citer, ne soient parfaitement indifférentes dans un gouvernement dont le seul devoir consiste à conserver, par tel moyen que ce puisse être, la forme essentielle à son maintien: voilà l'unique morale d'un gouvernement républicain.
Or, puisqu'il est toujours contrarié par les despotes qui l'environnent, on ne saurait imaginer raisonnablement que ses moyens conservateurs puissent être des moyens moraux, car il ne se conservera que par la guerre, et rien n'est moins moral que la guerre.
Maintenant, je demande comment on parviendra à démontrer que, dans un État immoral par ses obligations, il soit essentiel que les individus soit moraux? Je dis plus : il est bon qu'ils ne le soient pas. Les législateurs de la Grèce avaient parfaitement senti l'importante nécessité de gangrener les membres, pour que, leur dissolution morale influant sur celle utile à la machine, il en résultât l'insurrection toujours indispensable dans un gouvernement qui, parfaitement heureux comme !e gouvernement républicain, doit nécessairement exciter la haine et la jalousie de tout ce qui l'entoure. L'insurrection, pensaient ces sages législateurs, n'est point un état moral; elle doit être pourtant l'état permanent d'une république ; il serait donc aussi absurde que dangereux d'exiger que ceux qui doivent maintenir le perpétuel ébranlement immoral de la machine fussent eux-mêmes des êtres moraux, parce que l'état moral d'un homme est un état de paix et de tranquillité, au lieu que son état immoral est un état de mouvement perpétuel, qui le rapproche de l'insurrection nécessaire, dans laquelle il faut que le républicain tienne toujours le gouvernement dont il est membre.
Détaillons maintenant, et commençons par analyser la pudeur, ce mouvement pusillanime, contradictoire aux affection impures. S'il était dans les intentions de la nature que l'homme fût pudique, assurément elle ne l'aurait pas fait naître nu ; une infinité de peuples, moins dégradés que nous par la civilisation, vont nus et n'en éprouvent aucune honte ; il ne faut pas douter que l'usage de se vêtir n'ait eu pour unique base et l'inclémence de l'air et la coquetterie des femmes ; elles sentirent qu'elles perdraient bientôt tous les effets du désir si elles les prévenaient, au lieu de les laisser naître; elles conçurent que, la nature d'ailleurs ne les ayant pas créées sans défauts, elles s'assureraient bien mieux tous les moyens de plaire en déguisant ces défauts par des parures; ainsi la pudeur, loin d'être une vertu, ne fut donc plus qu'un des premiers effets de la corruption, qu'un des premiers moyens de la coquetterie des femmes. Lycurgue et Solon, bien pénétrés que les résultats de l'impudeur tiennent le citoyen dans l'état immoral essentiel aux lois du gouvernement républicain, obligèrent les jeunes filles à se montrer nues aux théâtres. Rome imita cet exemple : on dansait nu aux jeux de Flore ; la plus grande partie des mystères païens se célébraient ainsi ; la nudité passa même pour vertu chez quelques peuples. Quoiqu'il en soit, de l'impudeur naissent des penchants luxurieux ; ce qui résulte de ces penchants compose les prétendus crimes que nous analysons, et dont la prostitution est le premier effet. Maintenant que nous sommes revenus sur tout cela de la foule d'erreurs religieuses qui nous captivaient et que, plus rapprochés de la nature par la quantité des préjugés que nous venons d'anéantir, nous n'écoutons que sa voix, bien assurés que, s'il y avait du crime à quelque chose, ce serait plutôt à résister aux penchants qu'elle nous inspire qu'à les combattre, persuadés que la luxure était une suite de ces penchants, il s'agit bien moins d'éteindre cette passion dans nous que de régler les moyens d'y satisfaire en paix ; nous devons donc nous attacher à mettre de l'ordre dans cette partie, à y établir toute la sûreté nécessaire à ce que le citoyen, que le besoin rapproche des objets de luxure, puisse se livrer avec ces objets à tout ce que ses passions lui prescrivent, sans jamais être enchaîné par rien, parce qu'il n'est aucune passion dans l'homme qui ait plus besoin de toute l'extension de la liberté que celle-là. Différents emplacements sains, vastes, proprement meublés et sûrs dans tous les points, seront érigés dans les villes; là, tous les sexes, tous les âges, toutes les créatures seront offerts aux caprices des libertins qui viendront jouir, et la plus entière subordination sera la règle des individus présentés ; le plus léger refus sera puni aussitôt arbitrairement par celui qui l'aura éprouvé. Je dois encore expliquer ceci, le mesurer aux mœurs républicaines ; j'ai promis partout la même logique, je tiendrai parole.
Si, comme je viens de le dire tout à l'heure, aucune passion n'a plus besoin de toute l'extension de la liberté que celle-là, aucune, sans doute, n'est aussi despotique ; c'est là que l'homme aime à commander, à être obéi, à s'entourer d'esclaves contraints à le satisfaire; or, toutes les fois que vous ne donnerez pas à l'homme le moyen secret d'exhaler la dose de despotisme que la nature mit au fond de son cœur, il se rejettera pour l'exercer sur les objets qui l'entourent, il troublera le gouvernement. Permettez, si vous voulez éviter ce danger, un libre essor à ces désirs tyranniques, qui, malgré lui, le tourmentent sans cesse ; content d'avoir pu exercer sa petite souveraineté au milieu du harem d'icoglans ou de sultanes que vos soins et son argent lui soumettent, il sortira satisfait et sans aucun désir de troubler un gouvernement qui lui assure aussi complaisamment tous les moyens de satisfaire sa concupiscence ; exercez, au contraire, des procédés différents, imposez sur ces objets de la luxure publique les ridicules entraves jadis inventées par la tyrannie ministérielle et par la lubricité de nos Sardanapales ; l'homme, bientôt aigri contre votre gouvernement, bientôt jaloux du despotisme que vous lui imposez, et las de votre manière de le régir, en changera comme il vient de le faire...."

Le marquis de Sade avait épousé, contre son gré Mlle de Montreuil. Il eût préféré se marier avec la sœur cadette de celle-ci. Celle qu'il aimait ayant été mise dans un couvent, il en éprouva un grand dépit, un grand chagrin, et se livra à la débauche. Le marquis de Sade a donné beaucoup de détails autobiographiques sur son enfance et sa jeunesse dans "Aline el Valcour", où il s'est peint sous le nom de Valcour. On trouverait peut-être dans "Juliette" des détails sur son séjour en Allemagne. Quatre mois après son mariage, il était emprisonné à Vincennes. En 1768 éclata le scandale de la veuve Rose Keller. Le marquis de Sade, semble-t-il, était moins coupable qu'on ne le prétendit. Cette affaire n'est pas encore éclaircie. A ce propos, Charles Desmaze (Le Châlelet de Paris, Didier et C, 1863) indique : "Dans les papiers des commissaires du Châtelet se trouve le procès-verbal, dressé par l'un d'eux, de l'information faite contre le marquis de Sade, prévenu d'avoir, à Arcueil, déchiqueté à coups de canif une femme qu'il avait fait mettre nue et attacher à un arbre et d'avoir versé sur les plaies saignantes de la cire à cacheter brûlante". Et le docteur Cabanes, qui a signalé ce passage du livre de Charles Desmaze dans la Chronique médicale (15 décembre 1902), ajoute : « C'est un dossier qu'il serait utile de retrouver et de publier pour éclaircir le procès toujours pendant du divin marquis. » Quoi qu'il en soit, dès 1764, dans un de ses rapports, l'inspecteur de police Marais disait : « J'ai très fort recommandé à la Brissaut, sans m'expliquer davantage, de ne pas lui fournir de filles pour aller avec lui en petites maisons. » Marais écrivait encore, dans son rapport du 16 octobre 1767: « On ne tardera pas à entendre encore parler des horreurs de M. le comte de Sade. Il fait l'impossible pour déterminer la demoiselle Rivière, de l'Opéra, à vivre avec lui et lui a offert
vingt-cinq louis par mois, à condition que les jours où elle ne serait pas au spectacle, elle irait les passer avec lui à sa petite maison d'Arcueil. Cette demoiselle-là refuse. » Sa petite maison d'Arcueil, l'Aumônerie, aurait abrité, d'après la rumeur publique, des orgies dont la mise en scène, sans doute, devait être effrayante, sans qu'il s'y commit, je crois de véritables cruautés. L'affaire Rose Keller entraîna le second emprisonnement du marquis de Sade. Il fut enfermé au château de Saumur, puis à la prison de Pierre-Encise, à Lyon. Au bout de six semaines, il fut remis en liberté. En juin 1772 a lieu l'affaire de Marseille ; elle avait moins de gravité encore que l'affaire de la veuve Keller. Cependant le Parlement d'Aix condamna le marquis, par contumace, à la peine de mort. Ce jugement fut cassé en 1778. A la veille de sa seconde condamnation, le marquis s'enfuit en Italie en enlevant la sœur de sa femme ... (Guillaume Apollinaire)

"Aline et Valcour" (1795)
Roman composé à la Bastille, entre 1785 et 1788, par le marquis de Sade, publié en 1795 (et réédité en 1956), cet ouvrage, parmi tous ceux de l'auteur, est celui qui devrait devenir le plus rapidement un "classique", car, si les situations y sont osées, le style en est toujours "moral". ll s`agit d'un roman par lettres (soixante-douze lettres, quatre volumes, plus de treize cents pages) qui nous raconte parallèlement deux histoires distinctes n'ayant pour lien que la parenté des personnages. Un père débauché, le président de Blamont, pour abuser de sa fille, Aline, veut la marier au financier Dolbourg, libertin de ses amis. Il a déjà fait subir un sort semblable à Sophie qu'il prend aussi pour sa fille. Mais Sophie, à cause d`une substitution due à une nourrice infidèle, a pris la place de Lénore, véritable sœur d'Aline. Aline est une jeune fille très vertueuse; elle aime Valcour et en est aimée. Quant à la présidente de Blamont, c'est le modèle des épouses. Elle croit à l'indissolubilité des liens du mariage et supporte donc toutes les perversités de son mari, mais elle souhaite l'union d`Aline et de Valcour. Blamont essaie d'éloigner Valcour, qui est pauvre, en lui offrant une fortune. Valcour refuse. Blamont lui tend alors un guet-apens dont il ne réchappe que par hasard. Blamont se débarrasse ensuite de son épouse, qui gêne ses projets,. en la faisant empoisonner par sa femme de chambre. Désespérée par la mort de sa mère. et pensant qu'elle n`a plus aucune chance d'échapper à son père. Aline se suicide.
A ce premier récit se mêle l'histoire de Lénore et de son "amant", Sainville. Des pirates ont enlevé Lénore, et tandis que, de pays en pays, elle déjoue les ruses des libertins qui la convoitent, Sainville la recherche à travers le monde. Les aventures de Sainville occupent la lettre XXXV (trois cent quarante pages), celles de Lénore la lettre XXXVIII (trois cent quatre-vingt-sept pages).
ll s'agit en fait de deux romans dans le roman qui contiennent peut-être les plus belles pages que nous ait léguées la littérature du XVIIIe siècle. Les œuvres de J.-J. Rousseau pourraient pâlir à côté de la description de l'île de Tamoé, description qui nous livre. par la bouche de Zamé, le roi de l`île. le message "socialisant" de Sade. Au milieu d`une œuvre où toutes les "ténèbres" ont été rassemblées pour cerner absolument les frontières du mal et de la solitude naît ici une singulière éclaircie qui dicte cet étonnant désir de "travailler à réunir autour de moi la plus grande somme de bonheur possible, en commençant à faire celui des autres ..."
Histoire de Sophie - "On me nomme Sophie, madame, dit-elle en s'adressant à Mme de Blamont, mais je serais bien en peine de vous rendre compte de ma naissance, je ne connais que mon père, et j'ignore les particularités qui ont pu me donner le jour. Je fus élevée dans le village de Berseuil, par la femme d'un vigneron qui se nomme Isabeau ; j'allais la joindre quand vous m'avez trouvée. Elle m'a servi de nourrice et m'a prévenue, dès que je pus entendre raison, qu'elle n'était point ma mère, et que je n'étais chez elle qu'en pension. Jusqu'à l'âge de treize ans, je n'ai eu d'autre visite que celle d'un monsieur qui venait de Paris, le même, à ce que dit Isabeau, qui m'avait apportée chez elle, et qu'elle m'assura secrètement être mon père. Rien de plus simple et de plus monotone que l'histoire de mes premiers ans, jusqu'à l'époque fatale où l'on m'arracha de l'asile de l'innocence, pour me précipiter, malgré moi, dans l'abîme de la débauche et du vice.
J'allais atteindre ma treizième année, lorsque l'homme dont je vous parle vint me trouver pour la dernière fois avec un de ses amis du même âge que lui, c'est-à-dire environ cinquante ans. Ils firent retirer Isabeau et m'examinèrent tous deux avec la plus grande attention. L'ami de celui que je devais prendre pour mon père fit beaucoup d'éloges de moi... j'étais, selon lui, charmante, faite à peindre... Hélas ! c'était la première fois que je l'entendais dire, je n'imaginais pas que ces dons de la nature dussent devenir l'origine de ma perte... qu'ils dussent être la cause de tous mes malheurs ! L'examen des deux amis était entremêlé de légères caresses; quelquefois même on s'en permettait où la décence n'était rien moins que respectée... ensuite tous deux se parlaient bas... je les vis même rire... Eh quoi ! la gaîté peut donc naître où se médite le crime? L'âme peut donc s'épanouir au milieu des complots formés contre l'innocence ? Tristes effets de la corruption I que j'étais loin d'en augurer les suites! Elles devaient être bien amères pour moi. On fit revenir Isabeau...
— Nous allons vous enlever votre jeune élève, dit M. Delcour (c'est le nom de celui qu'on m'avait dit de regarder en père) ; elle plaît à M. de Mirville, dit-il en montrant son ami, il va la conduire à sa femme, qui en prendra soin comme de sa fille...
Isabeau se mit à pleurer, et, me jetant dans ses bras aussi chagrine qu'elle, nous mêlâmes nos regrets et nos pleurs...
— Ah ! monsieur, dit Isabeau en s'adressant à M. de Mirville, c'est l'innocence et la candeur mêmes, je ne lui connais nul défaut... je vous la recommande, monsieur, je serais au désespoir s'il lui arrivait quelque malheur...
— Des malheurs ? interrompit Mirville, je ne vous la prends que pour faire sa fortune.
Isabeau. — Que le ciel au moins la préserve de la faire aux dépens de son honneur !
Mirville. — Que de sagesse dans la bonne nourrice I On a bien raison de dire que la vertu n'est plus qu'au village.
Isabeau, à M. Delcour. — Mais vous m'aviez dit, ce me semble, monsieur, à votre dernière visite, que vous la laisseriez au moins jusqu'à ce qu'elle eût rempli ses premiers devoirs de religion.
Delcour. — De religion?
Isabeau. — Oui, monsieur.
Delcour. — Eh bien ! est-ce que cela n'est pas fait ?
Isabeau. — Non, monsieur, elle n'est pas encore assez instruite ; M. le curé l'a remise à l'année prochaine.
De Mirville. — Oh I parbleu, nous n'attendrons pourtant pas jusque-là, je l'ai promise pour demain à ma femme... et je veux... Eh ! mais! ne s'acquitte-t-on pas de ces misères-là partout ?
Delcour. — Partout, et aussi bien chez nous qu'ici. Ne croyez-vous donc pas, Isabeau, qu'il puisse être dans la capitale d'aussi bons directeurs de jeunes filles que dans votre village de Berseuil ...
Puis se tournant vers moi :
— Sophie, voudriez-vous mettre des entraves à votre fortune? Quand il s'agit de la conclure... le plus petit retard...
— Hélas ! monsieur, interrompis-je naïvement, dès que vous me parlez de fortune, j'aimerais mieux que vous fissiez celle d'Isabeau et que vous me permissiez de ne la jamais quitter.
Et je me rejetais dans les bras de cette tendre mère... et je l'inondais de mes pleurs...
— Va, mon enfant, va, dit celle-ci ; — et me pressant sur son sein : je te remercie de ta bonne volonté, mais tu ne m'appartiens pas... obéis à ceux de qui tu dépens, et que ton innocence ne t'abandonne jamais. Si tu tombes dans la disgrâce, Sophie, souviens-toi de la bonne mère Isabeau, tu trouveras toujours un morceau de pain chez elle; s'il te coûte quelque peine à gagner, au moins tu le mangeras pur... il ne sera pas arrosé des larmes du regret et du désespoir..
— Bonne femme, en voilà assez, ce me semble, dit Delcour en m'arrachant des bras de ma nourrice, cette scène de pleurs, toute pathétique qu'elle puisse être, met un retard à nos désirs... Partons...
On m'enlève, on se précipite dans une berline qui fend l'air et nous rend à Paris le même soir.
Si j'avais eu un peu plus d'expérience, ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que j'éprouvais, aurait dû me convaincre, avant d'arriver, que les devoirs que l'on me destinait étaient bien différents de ceux que je remplissais à Berseuil, qu'il entrait bien d'autres projets que ceux de servir une dame dans la destination qui m'attendait, et qu'en un mot cette innocence que me recommandait si fort ma bonne nourrice était bien près d'être oubliée. M. de Mirville, à côté duquel j'étais dans la voiture, me mit bientôt au point de ne pouvoir douter de ses horribles intentions : l'obscurité favorisait ses entreprises, ma simplicité les encourageait. M. Delcour s'en divertissait et l'indécence était à son comble... Mes larmes coulèrent alors avec profusion...
— Peste soit de l'enfant, dit Mirville... cela allait le mieux du monde... et je croyais qu'avant que nous fussions arrivés... mais je n'aime pas à entendre brailler...
— Eh ! bon, bon, répondit Delcour, jamais guerrier s'effraya-t-il du bruit de sa victoire ? Quand nous fûmes l'autre jour chercher ta fille, auprès de Chartres, me vis-tu m'alarmer comme toi ? Il y eut pourtant, comme ici, une scène de larmes... et cependant, avant que d'être à Paris, j'eus l'honneur d'être ton gendre...
— Oh ! mais vous, gens de robe, dit M. de Mirville, les plaintes vous excitent; vous ressemblez beaucoup aux chiens de chasse, vous ne faites jamais si bien la curée que quand vous avez forcé la bête. Jamais je ne vis d'âmes si dures que celles de ces suppôts de Bartole. Aussi n'est-ce pas pour rien qu'on vous accuse d'avaler le gibier tout cru pour avoir le plaisir de le sentir palpiter sous vos dents...
— Il est vrai, dit Delcour, que les financiers sont soupçonnés d'un cœur bien plus sensible...
— Par ma foi, dit Mirville, nous ne faisons mourir personne ; si nous savons plumer la poule, au moins ne l'égorgeons-nous pas. Notre réputation est mieux établie que la vôtre, et il n'y a personne qui, au fond, ne nous appelle de bonnes gens...
De pareilles platitudes, et d'autres propos que je ne compris point, parce que je ne les avais jamais entendus, mais qui me parurent encore plus affreux, et par les expressions qui les entrelaçaient et par l'indignité des actions dont Mirville les entrecoupait ; de telles horreurs, dis-je, nous conduisirent à Paris, et nous arrivâmes.
La maison où nous descendîmes n'était pas tout à fait dans Paris, j'en ignorais la position ; plus instruite maintenant, je puis vous dire qu'elle était située près de la barrière des Gobelins. Il était environ dix heures du soir quand on arrêta dans la cour ; nous descendîmes. — La voiture fut renvoyée et nous entrâmes dans une salle où le souper paraissait prêt à être servi. Une vieille femme et une jeune fille de mon âge étaient les seules personnes qui nous attendaient ; et ce fut avec elles que nous nous mîmes à table ; il me fut facile de voir pendant le souper que cette jeune fille, nommée Rose, était à M. Delcour ce qu'il me parut que M. de Mirville désirait que je lui fusse. Quant à la vieille, elle était destinée à être notre gouvernante ; son emploi me fut expliqué tout de suite et on m'apprit en même temps que cette maison était celle où je devais loger avec ma jeune compagne, et qui n'était autre que cette fille de M. de Mirville et que M. Delcour et lui disaient avoir été dernièrement chercher près de Chartres. Ce qui prouve, madame, que ces deux messieurs s'étaient réciproquement donné leurs deux filles pour maîtresses, sans que l'une de ces malheureuses créatures connût mieux que l'autre la seconde partie des liens qui les attachaient à ces deux pères.
Vous me permettrez de taire, madame, les indécents détails de ce souper et de l'affreuse nuit qui le suivit; un autre salon, plus petit et plus artistement meublé, fut destiné à ces honteuses circonstances. Rose et M. Delcour y passèrent avec nous; celle-ci, déjà au fait, n'opposa nul refus ; son exemple me fut proposé pour adoucir la ligueur des miens, et pour m'en faire sentir l'inutilité on me fit craindre la force si je m'avisais de les continuer...
Que vous dirais-je, madame? Je frémis... je pleurai... rien n'arrêta ces monstres, et mon innocence fut flétrie.
Vers trois heures du matin, les deux amis se séparèrent ; chacun passa dans son appartement pour y finir le reste de la nuit et nous suivîmes ceux qui nous étaient destinés.
Là, M. de Mirville acheva de me dévoiler mon sort.
— Vous ne devez plus douter, me dit-il durement, que je vous ai prise pour vous entretenir ; votre état vient d'être éclairci de manière à ne plus vous laisser de soupçon. Ne vous attendez pourtant pas à une fortune bien brillante ni à une vie très dissipée ; le rang que monsieur et moi tenons dans le monde nous oblige à des précautions qui rendent votre solitude un devoir. La vieille femme que vous avez vue près de Rose et qui doit également prendre soin de vous nous répond de votre conduite à l'une et à l'autre : une incartade... une évasion... serait sévèrement punie, je vous en préviens ; du reste, soyez avec moi honnête, persévérante et douce, et si la différence de nos âges s'oppose à un sentiment de votre part dont je suis médiocrement envieux, que, pour prix du bien que je vous ferai, je trouve du moins en vous toute l'obéissance sur laquelle je devrais compter si vous étiez ma femme légitime. Vous serez nourrie, vêtue, etc., et vous aurez cent francs par mois pour vos fantaisies; cela est médiocre, je le sais; mais à quoi vous servirait le surplus dans la retraite où je suis forcé de vous tenir ; d'ailleurs, j'ai d'autres arrangements qui me ruinent. Vous n'êtes pas ma seule pensionnaire... c'est ce qui fait que je ne pourrai vous voir que trois fois par semaine, vous serez tranquille le reste du temps; vous vous distrairez ici avec Rose et la vieille Dubois; l'une et l'autre, dans leur genre, ont des qualités qui vous aideront à mener une vie douce, et sans vous en douter, ma mie, vous finirez par vous trouver heureuse.
Cette belle harangue débitée, M. de Mirville se coucha et m'ordonna de prendre place auprès de lui.
Je tire le rideau sur le reste, madame, en voilà assez pour vous faire voir quel était l'affreux sort qui m'était destiné ; j'étais d'autant plus malheureuse qu'il me devenait impossible de m'y soustraire, puisque le seul être qui eût de l'autorité sur moi... mon père même, me contraignait à m'y résoudre et me donna l'exemple du désordre.
Les deux amis partirent à midi; je fis plus ample connaissance avec ma gardienne et ma compagne ; les circonstances de la vie de Rose ne difïéraient en rien de celles de la mienne ; elle avait six mois de plus que moi. Elle avait, comme moi, passé sa vie dans un village, élevée par sa nourrice, et n'était à Paris que depuis trois jours ; mais la distance énorme du caractère de cette fille au mien s'est toujours opposée à ce que je fisse aucune liaison avec elle ; étourdie, sans coeur, sans délicatesse, n'ayant aucune sorte de principes, la candeur et la modestie que j'avais reçues de la nature s'arrangeaient mal avec tant d'indécence et de vivacité ; j'étais obligée de vivre avec elle, les liens de l'infortune nous unirent, mais jamais ceux de l'amitié.
Pour la Dubois, elle avait les vices de son état et de son âge : impérieuse, tracassière, méchante, aimant beaucoup plus ma compagne que moi ; il n'y avait rien là, comme vous voyez, qui dût m'attacher fort à elle, et le temps que j'ai été dans cette maison je l'ai presque entièrement passé dans ma chambre, livrée à la lecture que j'aime beaucoup et dont j'ai pu faire aisément mon occupation, moyennant l'ordre que M. de Mirville avait donné de ne jamais me laisser manquer de livres.
Rien de plus réglé que notre vie; nous nous promenions à volonté dans un fort beau jardin, mais nous ne sortions jamais de son enceinte; trois fois par semaine, les deux amis, qui ne paraissaient jamais qu'alors, se réunissaient, soupaient avec nous, se livraient à leurs plaisirs l'un devant l'autre deux ou trois heures de l'après-midi et allaient, de là, finir le reste de la nuit chacun avec la sienne, dans son appartement, qui devenait le nôtre le reste du temps...
- Quelle indécence ! interrompit Mme de Blamont... Eh quoi ! les pères aux yeux de leurs filles !
Ma chère amie, dit Mme de Senneval, n'approfondissons pas ce gouffre d'horreur, cette infortunée nous apprendrait peut-être des atrocités d'un bien autre genre.
— Que savez-vous s'il n'est pas essentiel que nous le sachions ? dit Mme de Blamont... Mademoiselle, continua en rougissant cette femme vraiment honnête et respectable, je ne sais comment vous exposer ma question... mais n'est-il jamais arrivé pis ?
Et comme elle vit que Sophie ne la comprenait point, elle me chargea de lui expliquer bas ce qu'elle voulait dire.
— Une sorte de jalousie, dominant l'un et l'autre ami, est peut-être le seul frein qui les ait contenus sur ce que vous voulez dire, madame, reprit Sophie ; au moins ne dois-je supposer que ce sentiment pour cause d'une retenue... qui dans de telles âmes, n'eut sûrement jamais la vertu pour principe. Il est mal de juger ainsi son prochain sans preuves, je le sais, mais d'autres écarts... tant d'autres turpitudes ont si bien su me convaincre de la dépravation de mœurs de ces deux amis que je ne dois assurément attribuer leur sagesse dans ce que vous voulez dire qu'à un sentiment plus impérieux que leur débauche; or, je n'en ai point vu qui l'emportât sur leur jalousie.
— Elle est difficile à entendre avec cette communauté de plaisir dont vous nous parlez, dit Mme de Senneval.
— Et surtout avec ces autres pensionnaires dont M. de Mirville convenait, ajouta Mme de Blamont.
— Je l'avoue, mesdames, reprit Sophie, peut-être est-ce ici un de ces cas où le choc violent de deux passions ne laisse triompher que la plus vive ; mais ce qu'il y a de bien sûr, c'est que le désir de conserver chacun leur bien, désir né de leur jalousie, trop reconnue pour en douter, l'emporta toujours dans leur cœur et les empêcha d'exécuter... des horreurs... dont ma compagne, je le sais, n'eût fait que rire et qui m'eussent paru plus affreuses que la mort même.
— Poursuivez, dit Mme de Blamont, et ne trouvez pas mauvais que l'intérêt que vous m'avez inspire m'ait fait frémir pour vous.
— Jusqu'à l'événement qui m'a valu votre protection, continua Sophie en s'adressant toujours à Mme de Blamont, il me reste fort peu de chose à vous apprendre. Depuis que j'étais dans cette maison, mes appointements m'étaient payés avec la plus grande exactitude, et n'ayant aucun motif de dépense, je les économisais dans la vue de trouver peut-être un jour l'occasion de les faire tenir à ma bonne Isabeau, dont le souvenir m'occupait sans cesse. J'osai communiquer cette intention à M. deMirville, ne doutant point qu'il ne me procurât lui-même la manière d'exécuter l'action que je méditais... Innocente ! Où allais-je supposer la compassion ? Habita-t-elle jamais dans le sein du vice et du libertinage ?
— Il vous faut oublier tous ces sentiments villageois, me répondit brutalement M. de Mirville, cette femme a été beaucoup trop payée des petits soins qu'elle a eus de vous ; vous ne lui devez plus rien.
— Et ma reconnaissance, monsieur, ce sentiment si doux à nourrir dans soi, si délicieux à faire éclater?
— Bon, bon, chimère que toutes ces reconnaissances-là. Je n'ai jamais vu qu'on en retirât quelque chose et je n'aime à nourrir que les sentiments qui rapportent. Ne parlons plus de cela, ou, puisque vous avez trop d'argent, je cesserai de vous en donner davantage.
Rejetée de l'un, je voulus recourir à l'autre, et je parlai de mon projet à M. Delcour. Il le désapprouva plus durement encore : il me dit qu'à la place de M. de Mirville il ne me donnerait pas un sou, puisque je ne songeais qu'à jeter mon argent par la fenêtre. Il me fallut renoncer à cette bonne œuvre, faute de moyens pour l'accomplir.
Mais avant que d'en venir à ce qui donna lieu à la malheureuse catastrophe de mon histoire, il faut que vous sachiez, madame, que les deux pères s'étaient plus d'une fois, devant nous, cédé leur autorité sur leurs filles, en se priant réciproquement de ne point les ménager quand elles se donneraient des torts, et cela pour nous mieux inspirer la retenue, la soumission et la crainte dont ils voulaient nous composer des chaînes; or, je vous laisse à penser si tous deux abusaient de cette autorité respective ; M. de Mirville, extraordinairement brutal, me traitait surtout avec une dureté inouïe, au plus léger caprice de son imagination ; et quoiqu'il agît devant M. Delcour, celui-ci ne prenait pas plus ma défense que Mirville ne prenait celle de sa fille quand Delcour la maltraitait de même, ce qui arrivait tout aussi souvent.
Cependant, madame, il faut vous l'avouer : entièrement coupable, entièrement complice du malheureux commerce où j'étais entraînée, la nature trahit et mon devoir et mes sentiments, et, pour me punir davantage, elle voulut faire éclore dans mon sein un gage de mon déshonneur. Ce fut à peu près vers ce temps que ma compagne, impatientée de la vie qu'elle menait, m'avoua qu'elle méditait une évasion...."
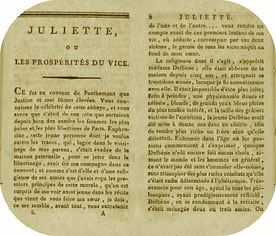
1797 – "L’Histoire de Juliette, sa soeur, ou les prospérités du vice"
"Juliette ou les Prospérités du Vice", suite de "Justine", contraste parfaitement avec cet ouvrage. Justine traîne une existence de vertu misérable et tombe entre les mains de personnages dont la façade d'honorabilité sociale recouvre les pires perversions (clergé, aristocrates et parlementaires). Diamétralement opposée, qui n'a pas de scrupule à se prostituer, va se tailler rapidement une place de reine dans le monde des courtisanes. Après s'être imposée à Paris et avoir fait un mariage honorable, elle entreprend un voyage triomphal dans la péninsule italienne dont elle rencontre les princes, en particulier le pape et le roi des Deux-Siciles. Le récit fait alterner les orgies les plus complexes et les plus sanglantes avec les débats philosophiques pour lesquels l'auteur n'hésite pas à emprunter à ses devanciers des Lumières. Il recopie (ou restitue de mémoire) des passages de Voltaire, d'Holbach ou Fréret. Les personnages répètent les principaux arguments en faveur de l'athéisme et de la relativité de toute morale. La fin du roman fait se rencontrer les deux sœurs et mourir Justine, foudroyée par l'orage : conclusion métaphysique qui marque l'ambiguïté d'une œuvre hésitant entre l'absence de Dieu et la foi en un « Être suprême en méchanceté ».
En sortant du couvent avec sa sœur, Juliette entre chez une appareilleuse qui la présente à un certain Dorval, «le plus grand voleur de Paris». Il lui donne à entôler deux Allemands. Elle rencontre ensuite le scélérat Noirceuil qui a causé la banqueroute de son père et s'est enrichi en dépouillant un grand nombre de familles. Il la présente au ministre d'Etat Saint-Fond qui, contre certaines complaisances, lui procure les moyens de satisfaire son goût effréné pour le luxe. II la met à la tète du département des poisons. Les empoisonnements politiques recommencent, entremêlés de tortures variées que l'on fait subir aux victimes officielles. Une Anglaise, amie de Juliette, lady Clairwill, la fait admettre dans la Société des amis du crime, dont fait partie Saint- Fond. Le ministre ayant préparé un projet de dépopulation de la France, il le communique à Juliette, qui ne peut réprimer un mouvement de surprise et d'horreur. Saint-Fond s'en aperçoit. Elle comprend que sa vie est menacée. Elle se sauve à Angers chez une appareilleuse de second plan, elle y rencontre un riche gentilhomme qui l'épouse et qu'elle empoisonne. Elle part ensuite pour l'Italie, visite les grandes villes en se prostituant partout aux personnages les plus opulents. Elle s'associe avec un chevalier d'industrie nommé Sbrigani. lis se rendent à Florence, où ils s'arrêtent quelque temps. Juliette, comme dans toutes les villes de résidence où elle passe, est admise à la cour. Je n'insiste pas sur toutes les scènes criminelles qui se passent à toutes les pages de ce roman. A Rome, Juliette est reçue par le pape Pie VII à qui elle énumère tous les crimes de la papauté. Elle gagne ensuite Naples. En route il lui arrive de nouvelles aventures avec des brigands, dans la troupe desquels elle retrouve lady Clairwill. A Naples, le roi Ferdinand Ier la reçoit avec beaucoup d'égards. Après des descriptions d'Herculanum, de Pompéi, Juliette finit, avec la complicité de la reine Marie-Caroline, par voler une certaine quantité de millions au roi de Naples. L'opération ayant réussi, Juliette dénonce la reine et reprend le chemin de la France....
Le premier Ministre : M. de Saint-Fond...
"M. de Saint-Fond était un homme d'environ quarante ans. de l'esprit, un caractère bien faux, bien traître, bien libertin, bien féroce, infiniment d'orgueil, possédant l'art de voler la France au suprême degré et celui de distribuer des lettres de cachet, au seul désir de ses plus légères passions ; plus de vingt mille individus de tout sexe et de tout âge gémissaient par ses ordres dans les différentes forteresses royales dont la France est hérissée, et parmi ces vingt mille êtres, me disait-il un jour plaisamment, je te jure qu'il n'en est pas un seul de coupable. D'Albert, premier président du Parlement de Paris, était également du souper ; ce ne fut qu'en entrant que Noirceuil m'en prévint. — Tu dois, me dit-il, les mêmes égards à ce personnage-ci qu'à l'autre ; il n'y a pas douze heures qu'il était maître de ta vie ; tu sers de dédommagement aux égards qu'il a eus pour toi ; pouvais-je le mieux acquitter ?
Quatre filles charmantes composaient, avec Mme de Noirceuil et moi, le sérail offert à ces messieurs. Ces créatures, pucelles encore, étaient du choix de la Duvergier. On nommait Eglé la plus jeune, blonde âgée de treize ans, et d'une figure enchanteresse ; Lolotte suivait, c'était la physionomie de Flore même : on ne vit jamais tant de fraîcheur ; à peine avait-elle quinze ans ; Henriette en avait seize et réunissait à elle seule plus d'attraits que les poètes n'en prêtèrent jamais aux trois Grâces. Lindane avait dix-sept ans ; elle était faite à peindre, des yeux d'une singulière expression et le plus beau corps qu'il fût possible de voir.
Six jeunes garçons, de quinze à vingt ans, nous servaient nus et coiffés en femme ; chacun des libertins qui composaient le souper avait, ainsi que vous le voyez par cet arrangement, quatre objets de luxure à ses ordres, deux femmes et deux garçons. Comme aucun de ces individus n'était encore dans le salon lorsque j'y parus, d'Albert et Saint-Fond, après m'avoir embrassée, cajolée, louée pendant un quart d'heure, me plaisantèrent sur mon aventure. — C'est une charmante petite scélérate, dit Noirceuil, et qui, par la soumission la plus aveugle aux passions de ses juges, vient les remercier de la vie qu'elle leur doit. — J'aurais été bien fâché de la lui ôter, dit d'Albert ; ce n'est pas pour rien que Thémis porte un bandeau, et vous m'avouerez que, quand il s'agit de juger de jolis petits êtres comme ceux-là, nous devons toujours l'avoir sur les yeux. — Je lui promets pour sa vie l'impunité la plus entière, dit Saint-Fond ; elle peut faire absolument tout ce qu'elle voudra ; je lui proteste de la protéger dans tous ses écarts et de la venger, comme elle l'exigera, de tous ceux qui voudraient troubler ses plaisirs, quelque criminels qu'ils puissent être. — Je lui en jure autant, dit d'Albert ; je lui promets, de plus, de lui faire avoir demain une lettre du chancelier qui la mettra à l'abri de toutes les poursuites qui, par tel tribunal que ce soit, pourraient être intentées contre elle dans toute l'étendue de la France. Mais, Saint-Fond, j'exige quelque chose de plus ; tout ce que nous faisons ici n'est qu'absoudre le crime, il faut l'encourager : je te demande donc des brevets de pension pour elle, depuis deux mille francs jusqu'à vingt-cinq, en raison du crime qu'elle commettra. — Juliette, dit Noirceuil, voilà, je crois, de puissants motifs et pour donner à tes passions toute l'extension qu'elles peuvent avoir et pour ne nous cacher aucun de tes écarts. — Mais il faut en convenir, messieurs, poursuivit aussitôt mon amant sans me donner le temps de répondre, vous faites là un merveilleux usage de l'autorité qui vous est confiée par les lois et par le monarque... — Le meilleur possible, répondit Saint-Fond ; on n'agit jamais mieux que lorsqu'on travaille pour soi : cette autorité nous est confiée pour faire le bonheur des hommes; n'y travaillons-nous pas en faisant le nôtre et celui de cet aimable enfant ? — En nous revêtant de cette autorité, dit d'Albert, on ne nous a pas dit : Vous ferez le bonheur de tel ou tel individu,abstractivement de tel ou tel autre; on nous a simplement dit : Les pouvoirs que nous vous transmettons sont pour faire la félicité des hommes; or il est impossible de rendre tout le monde également heureux ; donc, dès qu'il en est parmi nous quelques-uns de contents, notre but est rempli. — Mais, dit Noirceuil qui ne controversait que pour faire briller ses amis, vous travaillez pourtant au malheur général en sauvant le coupable et perdant l'innocent. — Voilà ce que je nie, dit Saint-Fond : le vice fait beaucoup plus d'heureux que la vertu ; je sers donc bien mieux le bonheur général en protégeant le vice qu'en récompensant la vertu. — Voilà des systèmes bien dignes de coquins comme vous, dit Noirceuil. — Mon ami, dit d'Albert, puisqu'ils font aussi votre joie, ne vous en plaignez point. — Vous avez raison, dit Noirceuil ; il me semble, au surplus, que nous devrions un peu plus agir que jaser. Voulez-vous Juliette seule un moment, avant que l'on arrive ? — Non, pas moi, dit d'Albert, je ne suis nullement curieux des tête-à-tête... j'y suis d'un gauche... l'extrême besoin que j'ai d'être toujours aidé dans ces choses-là fait que j'aime autant patienter jusqu'à ce que tout le monde y soit. — Je ne pense pas tout à fait ainsi, dit Saint-Fond, et je vais entretenir un instant Juliette au fond de ce boudoir.
A peine y fûmes-nous que Saint-Fond m'engagea à me mettre nue.
Pendant que j'obéissais : — On m'a assuré, me dit-il, que vous seriez d'une complaisance aveugle à mes fantaisies ; elles répugnent un peu, je le sais, mais je compte sur votre reconnaissance ; vous savez ce que j'ai fait pour vous; je ferai plus encore; vous êtes méchante, vindicative, eh bien I poursuivit-il en me remettant six lettres de cachet en blanc qu'il ne s'agissait plus que de remplir pour faire perdre la liberté à qui bon me semblerait, voilà pour vous amuser; prenez, de plus, ce diamant de mille louis pour payer le plaisir que j'ai de faire connaissance avec vous ce soir... Prenez, prenez, tout cela ne me coûte rien, c'est l'argent de l'Etat. — En vérité, monseigneur, je suis confuse de vos bontés. — Oh ! je n'en resterai pas là ;je veux que vous me veniez voir chez moi ; j'ai besoin d'une femme qui, comme vous, soit capable de tout; je veux vous charger de la partie des poisons. — Quoi ! Monseigneur, vous vous servez de pareilles choses? — Il le faut bien : il y a tant de gens dont nous sommes obligés de nous défaire... Point de scrupules, je me flatte. — Pas le moindre, monseigneur ; je vous jure qu'il n'est aucun crime dans le monde capable de m'effrayer, et qu'il n'en est pas un seul que je ne commette avec délices... — Ah ! baisez- moi, vous êtes charmante, dit Saint-Fond. Eh bien ! au moyen de ce que vous me promettez là, je vous renouvelle le serment que je vous ai fait de vous procurer l'impunité la plus entière. Faites pour votre compte tout ce que bien vous semblera : je vous proteste de vous retirer de toutes les mauvaises aventures qui pourraient en survenir ; mais il faut me prouver, tout de suite, que vous êtes capable d'exercer l'emploi que je vous destine; tenez, me dit-il en me remettant une petite boîte, je placerai ce soir près de vous, au souper, celle des filles sur laquelle il m'aura plu de faire tomber l'épreuve ; caressez-la bien — la feinte est le manteau du crime — trompez-la le plus adroitement que vous pourrez, et jetez cette poudre, au dessert, dans des verres de vin qui lui seront servis : l'effet ne sera pas long ; je reconnaîtrai là si vous êtes digne de moi et, dans ce cas, votre place vous attend.
— Oh ! monseigneur, répondis-je avec chaleur, je suis à vos ordres ; donnez, donnez, vous allez voir comme je vais me conduire..."

Pendant le Directoire, le marquis cessa de s'occuper de politique. Il recevait beaucoup de monde chez lui, rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice, où il s'était transporté. Une femme pâle, mélancolique et distinguée remplissait l'office de maîtresse de maison. Le marquis l'appelait parfois sa Justine, et on la disait fille d'un émigré. M. d'Alméras pense que cette femme était la "Constance" à laquelle "Justine" avait été dédiée. Quoi qu'il en soit, les renseignements sur cette amie font complètement défaut.
Au mois de juillet 1800, le marquis fit paraître "Zoloé el ses deux acolytes", roman à clef qui provoqua un énorme scandale. On y reconnaissait le Premier Consul (d'Orsec, anagramme de Corse), Joséphine (Zoloé), Mm Tallien (Laureda), Mme Visconti (Volsange), Barras (Sabar), Tallien (Fessinol), etc.. Le marquis avait été obligé de l'éditer lui-même.
Son arrestation fut décidée le 5 mars 1801 ; il fut arrêté chez son éditeur, Bertrandet, à qui il devait remettre un manuscrit remanié de "Juliette" qui servit de prétexte à cette arrestation. Il fut enfermé à Sainte-Pélagie, de là transféré à l'hôpital de Bicêtre, comme fou, et enfin enfermé à l'hospice de Charenton le 27 avril 1803. Il y mourut, à l'âge de soixante-quinze ans, le 2 décembre 1814, ayant passé vingt-sept années, dont quatorze de son âge mûr, dans onze prisons différentes...

1800 - "Zoloé et ses deux acolytes", ou Quelques décades de la vie de trois jolies femmes; histoire véritable du siècle dernier..
MARIAGE DIPLOMATIQUE - Episodes :
Le Vicomte de Sabar (Barras).- Baron d'Orsec, soyez le bienvenu. Je vous attendais avec impatience ; je m'occupe de votre bonheur.
Le Baron d'Orsec, Corse (Bonaparte) . - Sérieusement ?
Vicomte de Sabar. - Très sérieusement, en vérité. Vous n'avez pas l'air riche ; rien de moins stable que les emplois et la faveur dans un pays comme celui-ci. Un beau jour, vous pourriez bien ne conserver que la cape et l'épée. Foi de gentilhomme, il me paraîtrait dur d'en revenir à la simple paie d'officier.
Baron d'Orsec - Aussi votre prudence, dit-on, à pourvoir à l'avenir...
Vicomte de Sabar. - Vous croyez ?... Je disais donc que, pour vous mettre à l'abri des caprices du sort, il vous faudrait faire un bon mariage.
Baron d'Orsec. - Ma santé, mes goûts, vicomte, ne s'accordent guère avec vos vues. Je ne vous en remercie pas moins de votre zèle. Vous le savez, mon ami, j'ai vaincu sans femme; je puis vivre de même.
Vicomte dé Sabar. - Quelle simplicité !... Je vous donne une femme mûre qui ne demande que votre nom. Deux cent mille livres de bonnes rentes avec sa main, beaucoup d'amis...
Baron d'Orsec - Son nom ?
Vicomte de Sabar. - La comtesse de Barmont, Zoloé, toujours aimable, charmante, magnifique, du meilleur ton, d'une famille ancienne, d'une fraîcheur, ma foi, très appétissante...
Baron d'Orsec. - Et d'une coquetterie...
Vicomte de Sabak. - Eh ! morbleu !... qu'est-ce que cet enfantillage, mon ami ? Veuve, elle a pu user de sa liberté ; mariée, elle se renfermera dans les bornes de la décence. N'est-ce pas tout ce que tu demandes ?
Baron d'Orsec. - Mais pourquoi tant de générosité, mon ami ? Pourquoi ne pas garder ce cadeau pour vous-même ?
Vicomte de Sabar. - Et ma femme ?... Réponds donc, avant de me quitter.
Baron d'Orsec - Mais encore... Qui vous a chargé de cette mission ?
Vicomte de Sabar. - Prononcez le oui, et Zoloé ne dira pas non.
Baron d'Orsec - J'entends..
"... Les desseins de Bonaparte ..
On avait, fait de longues excursions ; le soir, longue veille, et, la nuit, longue séance de volupté : ces dames n'étaient pas visibles à midi. Les trois adorateurs, en attendant leur lever, s'étaient réunis et, pour tromper leur impatience, s'étaient acheminés vers le bois. Insensiblement, la conversation s'anima, se prolongea ; le sujet en était riche, intéressant. Le voici mot pour mot :
— Zoloé est charmante, dit le prince italien. Si on pouvait lui faire un reproche, ce serait d'outrer le luxe et l'appareil ; et encore pourrait-on l'excuser en considérant sa fortune et la brillante destinée qu'on lui prépare.
— Vraiment, dit Milord, on parle de son mariage avec le baron d'Orsec.
— Laurida m'a confié ce secret, dit gravement l'Espagnol. Conçoit-on une pareille union ?
— Je vois bien, reprend l'Italien, que vous ne connaissez pas le baron. Cet homme ne rêve que la gloire et tous les genres de gloire. Il ne se borne pas à être un autre César, un Périclès, un Solon. Il veut donner au monde l'exemple de toutes les vertus qui ont honoré l'humanité. Téméraire dans les combats, c'est pour montrer au soldat le chemin de la victoire. Impénétrable dans le conseil, il ne rassemble les opinions que pour perfectionner la sienne ; et celle qu'il adopte est toujours la meilleure ou la plus heureuse. L'avenir se déroule devant ses yeux. Il sera tout ce qui lui permettra d'être le destin de sa patrie. Il ne travaille que pour son bonheur. Il irait à l'extrémité de la terre moissonner de nouveaux lauriers, pourvu qu'ils concourussent à la prospérité de son pays.
— Le gouvernement actuel est d'une absurdité palpable, il l'admire et le craint, mais le peuple ne voit en lui qu'un héros ; ce héros le sauvera ; le plan de son bonheur est tracé dans sa tête ; tôt ou tard il le mettra à exécution ; les gens de bien soupirent après cet heureux moment.
— Milord. C'est le seul homme dont la nation anglaise redoute la politique, la valeur et la sagesse. Mais nous avons Pitt, et quelques guinées de plus ou de moins pourraient bien nous en délivrer.
— L'Espagnol. Que dites-vous, Forbess ? C'est affreux ; non, le peuple anglais est trop généreux pour désirer l'emploi de moyens aussi lâches.
— Forbess. Ne vous ai-je pas nommé Pitt ?
— L'Italien. Pitt échouera dans ses complots. Le génie de la France et sa sagesse le protègent. Mais si vous ne devinez pas le but du mariage en question, le voici : tous les partis en France se croisent, se choquent ; aucun point de ralliement. Celui qu'on appelle aristocrate abhorre la domination des hommes qui sont couverts de crimes et de sang. Le forcené démagogue est irrité de voir qu'on ose l'emmuseler et que les prépondérants l'abandonnent à son ignominie. Les peureux, les indifférents, qui forment le plus grand nombre, invoquent un seul maître qui joigne le courage aux lumières, les vertus aux talents, et ils trouvent tout cela dans d'Orsec. Son mariage avec Zoloé lui attache une classe proscrite. L'éclat de ses victoires ne permet pas à la malveillance de s'en offenser. Il a fait ses preuves de justice et d'honneur envers tous les partis : tous l'estiment, le révèrent comme un ami et un homme supérieur.
— Milord. Qu'il en soit ce qu'il plaira à la fortune, je ne veux pas m'en fatiguer ici. Me voilà en France : si la paix y règne, je serai citoyen de France, sinon je reverrai mes dieux pénates. Je ne connais d'Orsec que par sa réputation et ses triomphes. Il ne peut que protéger tout homme ami de la paix et de l'ordre public. Quant à moi, je ne veux que jouir. Peu m'importe sous quel pilote arriver au port, pourvu que j'y parvienne sans tourmente et sans naufrage.
Le bel Italien allait reprendre le fil de son discours, mais l'amoureux Espagnol le fit arrêter en lui rappelant que ces dames devaient être visibles et qu'il était grand temps d'aller leur faire la cour..."
"Analyse de mes malheurs et de mes persécutions depuis vingt-six ans", par L.-A. Pitou, auteur du "Voyage à Cayenne" et de l' "Urne des Stuarts el des Bourbons", à Paris, 1816. Louis-Ange Pitou (1747-1866), journaliste et chansonnier contre-révolutionnaire, nous présente un Sade qui doit être présenté sans doute comme un monstre, mais il lui trouve toutefois bien des traces de "bienfaisance" ...
« Dans les dix-huit mois que j'ai passés à Sainte-Pélagie, en 1802 et 1803, attendant mes lettres de grâce, j'étais dans le même corridor que le fameux marquis de Sade, auteur du plus exécrable ouvrage que la perversité humaine ait jamais inventé. Ce misérable était si entaché de la lèpre des crimes les plus inconcevables que l'autorité l'avait ravalé au-dessous du supplice et même au-dessous de la brute en le rangeant au nombre des maniaques : la justice, ne voulant ni salir ses archives du nom de cet être, ni que le bourreau, en le frappant, lui fît obtenir la célébrité dont il était si avide, l'avait relégué dans un coin de prison, en donnant à tout détenu la permission de la débarrasser de ce fardeau.
« L'ambition de la célébrité littéraire fut le principe de la dépravation de cet homme, qui n'était pas né méchant. Ne pouvant élever son vol au niveau de celui des écrivains moraux de premier ordre, il avait résolu d'entr'ouvrir le gouffre de l'iniquité et de s'y précipiter pour reparaître enveloppé des ailes du génie du mal et de s'immortaliser en étouffant toute vertu et divinisant publiquement tous les vices. Cependant, on apercevait encore de lui des traces de quelque vertu, telle que la bienfaisance. Cet homme frémissait à l'idée de la mort et tombait en syncope en voyant ses cheveux blancs. Parfois il pleurait en s'écriant dans un commencement de repentir qui n'avait pas de suite : « Mais pourquoi suis-je aussi affreux,
et pourquoi le crime est-il si charmant ? Il m'immortalise, il faut le faire régner dans le monde. »
« Cet homme avait de la fortune et ne manquait de rien ; il entrait quelquefois dans ma chambre, et il me trouvait riant, chantant et toujours de bonne humeur, mangeant sans dégoût et sans chagrin mon morceau de pain noir ou ma soupe de prison. Son visage s'enflammait de colère. « Vous êtes donc heureux ? disait-il. — Oui, monsieur. — Heureux ! — Oui, monsieur. » Puis mettant la main sur mon cœur et gambadant, je lui disais : « Je n'ai rien là qui me pèse, je suis un milord, monsieur le marquis ; voyez, j'ai de la dentelle à ma cravate, à mon mouchoir; voilà des manchettes de point qui ne m'ont point coûté fort cher et, au lieu de broderie, je vais amener la mode de festanger ou de franger les habits. — Vous êtes fou, monsieur Pitou. — Oui, monsieur le marquis ; mais, dans la misère, j'ai la paix du cœur. » Il s'approchait de ma table, et la conversation continuait : « Que lisez-vous là ? — C'est la Bible. — Ce Tobie est un bon homme, mais ce Job fait des contes. — Des contes, monsieur, qui seront des réalités pour vous et pour moi. — Quoi, des réalités, monsieur, vous croyez à ces chimères et vous pouvez rire ? — Nous sommes fous l'un et l'autre, monsieur le marquis, vous d'avoir peur de vos chimères, moi de rire en croyant à mes réalités. »
« Cet homme vient de mourir à Charenton... Moi je suis libre... »
