- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Montesquieu (1689-1755), "De l'Esprit des Lois" (1748) - .......
Last update 10/10/2021
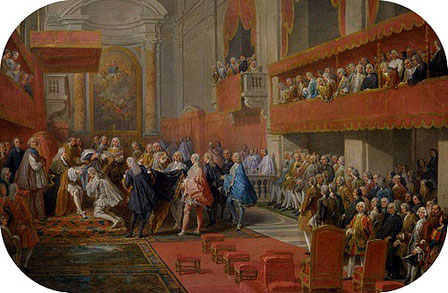
Bien que Montesquieu appartienne à la première moitié du XVIIIe siècle et que le grand mouvement philosophique soit postérieur à 1750, Montesquieu, esprit modéré mais sincèrement réformateur, va formuler des idées qui inspireront les grands initiateurs de 89 et au-delà.
Montesquieu et l'Esprit des lois? Les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses, l'influence des causes morales, la séparation et l'équilibre des pouvoirs, la légitimité fondée sur la prescription, conforme à l'ordre...
A partir de 1734, date de publication des "Considérations sur la grandeur des Romaíns et leur décadence" de Montesquieu et des "Lettres philosophiques" de Voltaire, la philosophie, sous ses différents aspects, historique, politique, métaphysique, scientifique, et même pratique, devient l'objet essentiel de la littérature : l'histoire des œuvres se confond avec l'histoire des idées.
Mais l’Esprit des Lois est écrit en 1748 par un Montesquieu, qui a alors cinquante‑neuf ans, et qui appartient par son âge et sa formation à la première période du siècle. De tous les penseurs de son époque, il est à peu près le seul qui considère les problèmes politiques en eux‑mêmes, sans référence à une conception explicite de l’esprit et de la nature. Par rapport à Locke qui pense que les lois et les constitutions sont créées par un accord libre et arbitraire des volontés, Montesquieu part d'une situation historique donnée, naturelle, où certaines conditions physiques ou culturelles vont s’enchaîner les unes les autres pour fonder une réalité politique et sociale.
Il y a bien autre chose dans l'Esprit des Lois que ce qu'on y a vu de son temps, l'idée que la vie des sociétés, et les lois politiques qui en sont l'un des facteurs dominants, sont des effets dont il faut chercher les causes, et que ces causes ne sont ni le hasard, ou le simple jeu des passions humaines, comme le pense Voltaire, ni d'invincibles lois naturelles comme celles qui régissent tous les phénomènes quelconques, mais des raisons qui tiennent à la nature spécifique de l'être humain, et donc, en dernier ressort, à sa raison. S'il retrace l'influence des causes physiques, le tempérament, le climat, le territoire, les moyens de subsistance, c'est aux causes morales qu'il attribue la prépondérance.
Que nous dit-il, après Montaigne et Pascal, que la diversité des lois sur la planète Terre peut nous faire douter de la réalité et de la stabilité de la justice humaine, cette diversité semble témoigner du caractère conventionnel des lois, et s'opposer à l'idée d'une loi naturelle et donc universelle ? Montesquieu semble rejeter cette alternative...
«J’ai d’abord examiné les hommes et j’ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n’étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J’ai posé les principes, et j’ai vu les cas particuliers s’y plier comme d’eux‑mêmes, les histoires de toutes les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d’une autre plus générale» (Esprit des Lois, Préface). Toute sa méthode consiste donc à examiner les lois positives dans leurs relations mutuelles, en montrant comment, par sa nature, telle loi implique telle autre loi et exclut telle autre ; il y a, par conséquent, entre les lois positives, des relations naturelles d’exclusion et d’inclusion, commandées non par l’arbitraire d’un homme ou d’une assemblée, mais par la nécessité des choses. « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Il y a une raison primitive, et les lois sont les rapports qui se trouvent entre les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux... Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. »
Ainsi, telle forme de gouvernement impliquera telle ou telle législation politique ou civile, et il faut savoir examiner comment certains facteurs naturels, tels que le climat ou la nature du terrain, ou bien certains facteurs acquis, comme les mœurs, le commerce, l’usage de la monnaie, la densité de la population, les croyances religieuses, viennent transformer ces lois (« les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre").
Toute société est une mécanique qui requiert l'intervention d'un art humain qui, usant des lois naturelles, en règle les effets avec la plus grande efficacité: « Si je pouvais faire que ceux qui commandent augmentassent leurs connaissances sur ce qu’ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus fortuné des mortels.»
A l'époque de Montesquieu, on est singulièrement préoccupé par le degré de liberté possible compatible avec la situation historique de la France, de très nombreuses études sur les origines et la nature de la monarchie française ont vu le jour, et du ministère de Richelieu au siècle de Louis XIV, on peut aisément noter les tendances absolutistes qui risquent de changer la monarchie française en un despotisme à l’orientale: une grande partie de son livre s’explique par le dessein d’y parer.
De ce souci vient sa distinction, si nouvelle, des trois formes de gouvernement : démocratie, monarchie et despotisme ; car laissant de côté la démocratie qui est un gouvernement périmé, dont, presque seule, l’antiquité nous offre l’exemple, l’attention devait se porter surtout sur la distinction entre la monarchie et le despotisme. La monarchie est caractérisée par des rangs, des prééminences, des ordres, une noblesse héréditaire, l'ensemble réglé par la loi, par la passion avec laquelle chacun, noble, parlement ou simple citoyen, tient à son rang et à ses privilèges. Au contraire du despotisme qui, exigeant une obéissance passive ne peut se maintenir que par la crainte. « La plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si, par un long abus de pouvoir..., le despotisme s’établissait à un certain point, il n’y aurait pas de mœurs ni de climats qui tinssent ; et, dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres... Les fleuves courent se mêler dans la mer ; les monarchies vont se perdre dans le despotisme... »
"Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses", écrira Montesquieu dans la Préface de l'Esprit des Lois. Sa méthode positive et prudente s'alimente aux sources du réel de son époque.
Les institutions et les lois les meilleures sont celles qui se trouvent en harmonie avec la "nature des choses", et, dans chacun des cas considérés, avec la structure historique d'une nation, c'est-à-dire non pas seulement avec les causes physiques et économiques qui agissent sur elle, mais avec son caractère, ses usages, ses mœurs, qui imposent au législateur les règles de conduite qu'il doit suivre pour son gouvernement. Qu'il s'agisse du gouvernement républicain sous ses deux formes, démocratique et aristocratique, dont le principe est, dans le premier cas, la vertu, c'est-à-dire l'amour de la patrie et l'amour de l'égalité, et, dans le second, la modération; qu'il s'agisse du gouvernement monarchique,
dont le ressort est l'honneur, qui fait que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers; ou qu'il s'agisse enfin du gouvernement despotique, dont le principe est la crainte, la crainte du souverain qui est à la fois le frein et la protection du peuple, - et ce dernier est haïssable, car il n'a pas à redouter, comme les deux autres, de se corrompre par la corruption de son principe, mais il est de sa nature corrompu (liv. VIII), - le but premier d'un gouvernement doit être d'assurer aux hommes toute la liberté dont ils sont capables.
Cette "liberté du peuple" ne doit pas être confondue avec "le pouvoir du peuple" (XI, 2); car "le peuple n'est point du tout propre à discuter des affaires, ni à prendre des résolutions actives demandent quelque exécution » (XI, 6), et la liberté véritable ne consiste pas, comme il le croit et comme on le croit communément, "à faire ce que l'on veut. Dans un État,
c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit point vouloir". Voilà précisément ce que doivent assurer les lois; et, s'il en est ainsi, la liberté peut être définie "le droit de faire tout ce que les lois permettent" (XI, 3).
Mais cette liberté politique, comment se réalisera-t-elle? et comment pourra-t-elle être garantie? Montesquieu l'exprimera avec précision (XI, 6), lorsqu'il déclare que "la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté", et lorsqu'il montre qu'elle est due à la séparation et à l'équilibre des trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, se limitant et se contrôlant de telle sorte que chacun d'eux se trouve empêché de devenir tyrannique.
"Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers" (XI, 6). Le premier droit de l'homme et du citoyen est d'être bien gouverné.
Et c'est pourquoi Montesquieu est monarchiste, tout en observant que la monarchie doit se garder du despotisme (VIII, 17), comme la démocratie, qui n'est pas un État libre par sa nature (XI, 4-), doit se garder d'un esprit d'extrême égalité. Tel est précisément le modèle que présente la constitution d'Angleterre (XI, 6), où la monarchie a ce caractère spécial d'avoir la liberté pour objet direct (XI, 7). Et Montesquieu sait bien que les lois politiques et civiles de chaque nation "doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre" (I, 3). Mais, du moins, de "la gloire", à laquelle tendent les autres monarchies, "il résulte un esprit de liberté qui, dans ces États, peut faire d'aussi grandes choses"; et de plus, si les trois pouvoirs n'y sont pas distribués et fondus sur le modèle de la constitution anglaise, ils peuvent être disposés de façon à approcher plus ou moins de la liberté politique (XI, 7), en suivant "l'ordre des choses" et en sauvegardant "les prérogatives des corps" (VIII, 6), c'est-à-dire leurs fonctions naturelles : ce qui est le propre d'un gouvernement modéré, et se trouve réalisé dans la monarchie française, telle qu'elle a été instituée à l'origine (XXX-XXXI) - car "c'est bien dans les anciennes lois françaises que l'on trouve l'esprit de la monarchie" (VI, 10), et telle qu'elle existe encore en France, moyennant quelques réformes.
Dans le même temps, alors que s'élabore la pensée de Montesquieu, le gouvernement royal s'efforce de lutter contre la propagande philosophique : en 1734, le Parlement de Paris fit brûler les Lettres anglaises de Voltaire. Mais, au milieu du siècle, les idées philosophiques s'étaient répandues dans l'ensemble du public cultivé et les mesures que prenaient parfois les autorités inquiètes n'aboutissaient qu'à accroître le mécontentement : ce fut le cas par exemple en 1752, de l'arrêt porté par le Conseil d'État contre l'Encyclopédie, à la suite d'une intervention de la Faculté de Théologie. L'autorité centrale d'ailleurs n'était pas sans contradictions et l'Encyclopédie profita, contre les Jésuites et le parti dévot, de l'appui de Mme de Pompadour. Mais dans ce contexte de plus en plus conflictuel, on ne pourra que constater pour l'heure l'échec des idées de Montesquieu face à celles de Rousseau, le tournant de 1789-1791 sera en la matière décisif...

Montesquieu (1689-1755)
Charles-Louis de Secondat, qui sera baron de Montesquieu, naît le 18 janvier 1689 au château de la Brède près de Bordeaux. Après des études classiques et des études de droit, il est conseiller de Bordeaux en 1714. Marié en 1715, l'année même de la mort de Louis XIV, Montesquieu avait été reçu membre de l'Académie de Bordeaux le 3 avril 1716. Dans les différents discours qu'il prononça au sein de ce cénacle littéraire d'une province qui avait déjà donné Montaigne, Montesquieu avait à diverses reprises fait preuve de son goût pour l'antiquité. En 1716, il devient aussi «président à mortier» au Parlement de Guyenne, il a 27 ans. Mais en 1726, il vendra sa charge pour se consacrer entièrement à l'étude.
Son milieu intellectuel sera parisien où il fréquente Fontenelle. Son sentiment nobiliaire, le préjugé des rangs liés à une dynamique de l’honneur le conduisirent à rejoindre une forme de morale stoïcienne. La défense des parlements comme pouvoirs intermédiaires, l’acceptation de la vénalité des charges tiendront à sa vision d’une monarchie modérée. Il aura une réputation de libre et bel esprit qui font de lui plus un citoyen qu’un sujet. Sa préoccupation principale concerne l’Etat légitime où les lois s’exercent autrement que comme puissance. Il fréquente alors à la fois les salons et les académies et rédige des mémoires scientifiques....
1721
Publication et succès des Lettres persanes, que Montesquieu a dû commencer à écrire vers 1717. A partir de cette date, Montesquieu, il a 32 ans, fait à Paris de fréquents et coûteux séjours, malgré l'état précaire de ses finances. Il fréquente la haute société débauchée, Maurepas, le comte de Caylus, le chevalier d'Aydies, participe aux fêtes de Bellébat chez Mme de Prie, maîtresse du duc de Bourbon, Jeanne-Agnès Berthelot de Pléneuf, la femme la plus influente à la cour du jeune Louis XV qui dispensait les honneurs tant de l'hospitalité de ce prince que de son gouvernement, et célèbre, comme Voltaire, le peu dévot curé de Courdimanche. On le voit également à Chantilly, chez Mlle de Clermont, sœur du duc de Bourbon...

"Mademoiselle de Clermont en sultane", par Jean-Marc Nattier (1733) Londres, Wallace Collection : à plus de quarante ans, le fils de portraitiste et élève de Rigaud, Jean-Marc Nattier (1685-1766) connaîtra enfin un renouveau de carrière avec "Mlle de Clermont prenant les eaux" (1729), instaurant une nouvelle façon de présenter le portrait, des oeuvres superficielles mais agréables à contempler, pose élégante, clarté du coloris : c'est le début de douze années de succès parisien...


1721 - "Les Lettres persanes"
Six ans à peine s'étaient écoulées depuis la mort de Louis XIV lorsque les Lettres persanes furent publiées anonymement en 1721 sous une fausse adresse à Cologne, et augmentées de onze lettres nouvelles en 1754, ainsi que de « Quelques Réflexions sur Les Lettres persanes ». L’originalité qui a assuré son succès immédiat et sa célébrité tient à l’articulation d’un point de vue critique adopté par un observateur étranger sur la France du temps, d’une intrigue de sérail et de la forme épistolaire.
La satire de la société contemporaine par un témoin qui arrive de l’extérieur et se trouve donc étranger aux valeurs françaises avait déjà été pratiquée par Gian Paolo Marana dans "L’Espion du Grand Seigneur" (1684-1689), qui relatait avec ironie les événements survenus en France depuis un demi-siècle. La forme épistolaire s’était déjà imposée avec la traduction de la correspondance d’Héloïse et d’Abélard et les "Lettres portugaises" de Guilleragues (1669), prétendument traduites en français. Enfin l’exotisme du sérail s’était développé avec la publication des récits de voyage en Orient et d’essais tels que les "Voyages de Tavernier en Turquie, en Perse et aux Indes" (1676-1679), les "Amusements sérieux et comiques d'un Siamois", de Dufresny (1669), le "Traité des eunuques" de Charles Ancillon (1707), la traduction des "Milles et une nuits" par Galland (1704-1717), le "Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales" (1711).
Le grand art du jeune parlementaire qu’est alors Montesquieu a été d’aiguiser la satire par la force du style, de pimenter l’intrigue orientale par une révolte des femmes dans le sérail, de multiplier les correspondants et de jouer, dans la chronologie du roman, sur le décalage croissant entre rédaction et réception des lettres.
Datées à l’aide du calendrier persan, les lettres s’échelonnent d’avril 1711 à novembre 1720, mais elles sont classées tantôt selon leur rédaction, tantôt selon leur arrivée. Il faut en effet toutes ces années à Usbek et Rica, deux seigneurs persans, dont l'un, Rica, est le plus vif et satirique, tandis qu'Usbek, l'autre, est le plus méditatif et réfléchi, pour quitter Ispahan, gagner Smyrne, Livourne et Paris, où ils vont découvrir et approfondir la culture française. L’Orient, caractérisé par le régime politique despotique et son principe, la terreur, devient l’image d’une monarchie occidentale qui prétend se fonder sur l’honneur et le respect des corps intermédiaires entre le roi et le peuple (l’aristocratie, les parlements). L’islam offre au christianisme un reflet caricatural de ses dogmes absurdes et de ses institutions contraires à l’utilité sociale. Usbek et Rica eux-mêmes, qui prétendent voyager par goût du savoir, se sont mis en route pour la France afin d’échapper à une révolution de palais à Ispahan.

Les Lettres persanes - LETTRE XXIV - Paris est aussi grand qu'Ispahan, premières impressions de Rica à Paris. Satire légère des mœurs et habitudes parisiennes, satire plus hardie du système politique et de la religion. Les embarras de la circulation à Paris sont un sujet depuis très longtemps inépuisable, permettant la satire politique et sociale où l'humour se fait mordant: "D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut..." - Une gravure de 1720 montre combien la rue Quincampoix et certains quartiers de Paris connaissent une extraordinaire animation. ..
"Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent toutes à la fois.
Paris est aussi grand qu'Ispahan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en Pair, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée, et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras.
Tu ne le croirais pas peut-être : depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leur machine que les Français : ils courent ; ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les
feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un Chrétien : car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête, mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi, et qui me passe, me fait faire un demi-tour, et un autre, qui me croise de l'autre côté, me remet soudain où le premier m'avait pris; et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues.
Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes : je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne, son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre, et, par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées.
D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant ; tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.
Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner : il y a un autre magicien, plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le Pape. Tantôt il lui fait croire que trois ne font qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce.
Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps, pour l'exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit, qu'il appela Constitution, et voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte, qui divise toute la Cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette Constitution leur défend de lire un livre que tous les Chrétiens disent avoir été apporté du Ciel: c'est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la Constitution: elles ont mis les hommes dans leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilège. On doit pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal, et, par le grand Hali, il faut qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi. Car, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le Paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du Paradis." (De Paris, le 4 de la lune de Rediab 2, 1712)

Les Lettres persanes - LETTRE XXX - Comment peut-on être persan? Comprendre les différences entre les hommes, avoir le sens du relatif dans les sciences, dans l'histoire, aussi bien que dans la vie quotidienne, c'est une des grandes conquêtes de la philosophie du siècle. Dans cette Lettre, Montesquieu note d'abord l'impuissance des Parisiens à sortir d'eux-mêmes, impuissance ridicule par sa naïveté même, puis il procède à une contre-épreuve : nul ne remarque le Persan s'il s'habille comme les Parisiens et tous s'esclaffent d'entendre dire qui il est...
"Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivai, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel : vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres; si j 'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi : les femmes mêmes faisaient un arc-en-ciel, nuancé de mille couleurs, qui m'entourait; si j'étais aux spectacles, je trouvais d'abord cent lorgnettes dressées contre ma figure : enfin jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entr'eux : Il faut avouer qu'il a l'air bien persan. Chose admirable! je trouvais de mes portraits partout; je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées : tant on craignait de ne m 'avoir pas assez vu. Tant d'honneurs ne laissent pas d'être à charge : je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare; et, quoique j'aie très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d 'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement : libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique; car j 'entrai tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois une heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d 'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard, apprenait à la compagnie que j'étaís Persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement : « Ah! ah! Monsieur est Persan? C'est une chose extraordinaire! Comment peut-on être Persan?..."
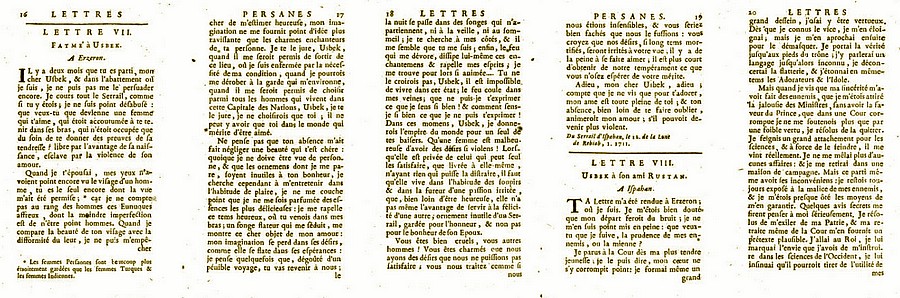

Les Lettres persanes - LETTRE XXIX - Rica à Ibben, à Smyrne
Le pape est le chef des chrétiens. C'est une vieille idole qu'on encense par habitude. Il était autrefois redoutable aux princes même: car il les déposait aussi facilement que nos magnifiques sultans déposent les rois d'Irimette et de Géorgie. Mais on ne le craint plus. Il se dit successeur d'un des premiers chrétiens, qu'on appelle saint Pierre, et c'est certainement une riche succession: car il a des trésors immenses et un grand pays sous sa domination.
Les évêques sont des gens de loi qui lui sont subordonnés, et ont, sous son autorité, deux fonctions bien différentes: quand ils sont assemblés, ils font, comme lui, des articles de foi; quand ils sont en particulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de dispenser d'accomplir la loi. Car tu sauras que la religion chrétienne est chargée d'une infinité de pratiques très difficiles, et, comme on a jugé qu'il est moins aisé de remplir ses devoirs que d'avoir des évêques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti pour l'utilité publique. De sorte que si l'on ne veut pas faire le rahmazan; si on ne veut pas s'assujettir aux formalités des mariages; si on veut rompre ses vœux; si on veut se marier contre les défense de la loi; quelquefois même, si on veut revenir contre son serment: on va à l'Évêque ou au Pape, qui donne aussitôt la dispense.
Les évêques ne font pas des articles de foi de leur propre mouvement. Il y a un nombre infini de docteurs, la plupart dervis, qui soulèvent entre eux mille questions nouvelles sur la religion. On les laisse disputer longtemps, et la guerre dure jusqu'à ce qu'une décision vienne la terminer. Aussi puis-je t'assurer qu'il n'y a jamais eu de royaume où il y ait eu tant de guerres civiles que dans celui de Christ. Ceux qui mettent au jour quelque proposition nouvelle sont d'abord appelés hérétiques. Chaque hérésie a son nom, qui est, pour ceux qui y sont engagés, comme le mot de ralliement. Mais n'est hérétique qui ne veut: il n'y a qu'à partager le différend par la moitié et donner une distinction à ceux qui accusent d'hérésie, et, quelle que soit la distinction, intelligible ou non, elle rend un homme blanc comme de la neige, et il peut se faire appeler orthodoxe.
Ce que je te dis est bon pour la France et l'Allemagne : car j'ai ouï dire qu'en Espagne et en Portugal, il y a de certains dervis qui n'entendent point raillerie, et qui font brûler un homme comme de la paille. Quand on tombe entre les mains de ces gens-là, heureux celui qui a toujours prié Dieu avec de petits grains de bois à la main, qui a porté sur lui deux morceaux de drap attachés à deux rubans, et qui a été quelquefois dans une province qu'on appelle la Galice ! Sans cela un pauvre diable est bien embarrassé. Quand il jurerait comme un païen qu'il est orthodoxe, on pourrait bien ne pas demeurer d'accord des qualités et le brûler comme hérétique : il aurait beau donner sa distinction. Point de distinction ! Il serait en cendres avant que l'on eût seulement pensé à l'écouter.
Les autres juges présument qu'un accusé est innocent; ceux-ci le présument toujours coupable: dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur; apparemment parce qu'ils croient les hommes mauvais. Mais, d'un autre côté, ils en ont si bonne opinion, qu'ils ne les jugent jamais capables de mentir: car ils reçoivent le témoignage des ennemis capitaux, des femmes de mauvaise vie, de ceux qui exercent une profession infâme. Ils font dans leur sentence un petit compliment à ceux qui sont revêtus d'une chemise de soufre, et leur disent qu'ils sont bien fâchés de les voir si mal habillés, qu'ils sont doux, qu'ils abhorrent le sang, et sont au désespoir de les avoir condamnés. Mais, pour se consoler, ils confisquent tous les biens de ces malheureux à leur profit.
Heureuse la terre qui est habitée par les enfants des prophètes ! Ces tristes spectacles y sont inconnus. La sainte religion que les anges y ont apportée se défend par sa vérité même: elle n'a point besoin de ces moyens violents pour se maintenir. »

Les Lettres persanes - LETTRE CVI - Usbek à Rhédi, à Venise
«Ou tu ne penses pas ce que tu dis, ou bien tu fais mieux que tu ne penses. Tu as quitté ta patrie pour t'instruire, et tu méprises toute instruction. Tu viens pour te former dans un pays où l'on cultive les beaux-arts, et tu les regardes comme pernicieux. Te le dirai-je, Rhédi ? Je suis plus d'accord avec toi que tu ne l'es avec toi-même.
As-tu bien réfléchi à l'état barbare et malheureux où nous entraînerait la perte des arts ? Il n'est pas nécessaire de se l'imaginer: on peut le voir. Il y a encore des peuples sur la terre chez lesquels un singe passablement instruit pourrait vivre avec honneur: il s'y trouverait à peu près à la portée des autres habitants; on ne lui trouverait point l'esprit singulier, ni le caractère bizarre; il passerait tout comme un autre et serait même distingué par sa gentillesse.
Tu dis que les fondateurs des empires ont presque tous ignoré les arts. Je ne te nie pas que des peuples barbares n'aient pu, comme des torrents impétueux, se répandre sur la terre et couvrir de leurs armées féroces les royaumes les plus policés. Mais, prends-y garde, ils ont appris les arts ou les ont fait exercer aux peuples vaincus; sans cela, leur puissance aurait passé comme le bruit du tonnerre et des tempêtes.
Tu crains, dis-tu, que l'on n'invente quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage. Non: si une si fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens; et le consentement unanime des nations ensevelirait cette découverte. Il n'est point de l'intérêt des princes de faire des conquêtes par de pareilles voies ils doivent chercher des sujets, et non pas des terres.
Tu te plains de l'invention de la poudre et des bombes; tu trouves étrange qu'il n'y ait plus de place imprenable: c'est-à-dire que tu trouves étrange que les guerres soient aujourd'hui terminées plus tôt qu'elles ne l'étaient autrefois.
Tu dois avoir remarqué, en lisant les histoires, que, depuis l'invention de la poudre, les batailles sont beaucoup moins sanglantes qu'elles ne l'étaient, parce qu'il n'y a presque plus de mêlée.
Et quand il se serait trouvé quelque cas particulier où un art aurait été préjudiciable, doit-on pour cela le rejeter? Penses-tu, Rhédi, que la religion que notre saint prophète a apportée du Ciel soit pernicieuse, parce qu'elle servira un jour à confondre les perfides chrétiens ?
Tu crois que les arts amollissent les peuples et, par là, sont cause de la chute des empires. Tu parles de la ruine de celui des anciens Perses, qui fut l'effet de leur mollesse. Mais il s'en faut bien que cet exemple décide, puisque les Grecs, qui les vainquirent tant de fois, et les subjuguèrent, cultivaient les arts avec infiniment plus de soin qu'eux.
Quand on dit que les arts rendent les hommes efféminés, on ne parle pas du moins des gens qui s'y appliquent, puisqu'ils ne sont jamais dans l'oisiveté, qui, de tous les vices, est celui qui amollit le plus le courage.
Il n'est donc question que de ceux qui en jouissent. Mais, comme, dans un pays policé, ceux qui jouissent des commodités d'un art sont obligés d'en cultiver un autre, à moins de se voir réduits à une pauvreté honteuse, il suit que l'oisiveté et la mollesse sont incompatibles avec les arts.
Paris est peut-être la ville du monde la plus sensuelle, et où l'on raffine le plus sur les plaisirs; mais c'est peut-être celle où l'on mène une vie plus dure. Pour qu'un homme vive délicieusement, il faut que cent autres travaillent sans relâche. Une femme s'est mis dans la tête qu'elle devait paraître à une assemblée avec une certaine parure; il faut que, dès ce moment, cinquante artisans ne dorment plus et n'aient plus le loisir de boire et de manger: elle commande, et elle est obéie plus promptement que ne serait notre monarque, parce que l'intérêt est le plus grand monarque de la terre.
Cette ardeur pour le travail, cette passion de s'enrichir, passe de condition en condition, depuis les artisans jusques aux grands. Personne n'aime à être plus pauvre que celui qu'il vient de voir immédiatement au-dessous de lui. Vous voyez à Paris un homme qui a de quoi vivre jusqu'au jour du jugement, qui travaille sans cesse et court risque d'accourcir ses jours, pour amasser, dit-il, de quoi vivre.
Le même esprit gagne la nation : on n'y voit que travail et qu'industrie. Où est donc ce peuple efféminé dont tu parles tant ?
Je suppose, Rhédi, qu'on ne souffrît dans un royaume que les arts absolument nécessaires à la culture des terres, qui sont pourtant en grand nombre, et qu'on en bannît tous ceux qui ne servent qu'à la volupté ou à la fantaisie; je le soutiens : cet État serait un des plus misérables qu'il y eût au monde.
Quand les habitants auraient assez de courage pour se passer de tant de choses qu'ils doivent à leurs besoins, le peuple dépérirait tous les jours, et l'État deviendrait si faible qu'il n'y aurait si petite puissance qui ne pût le conquérir.
Il me serait aisé d'entrer dans un long détail, et de te faire voir que les revenus des particuliers cesseraient presque absolument, et, par conséquent, ceux du prince. Il n'y aurait presque plus de relation de facultés entre les citoyens; on verrait finir cette circulation de richesses et cette progression de revenus qui vient de la dépendance où sont les arts les uns des autres : chaque particulier vivrait de sa terre et n'en retirerait que ce qu'il lui faut précisément pour ne pas mourir de faim. Mais comme ce n'est pas quelquefois la vingtième partie des revenus d'un État, il faudrait que le nombre des habitants diminuât à proportion, et qu'il n'en restât que la vingtième partie.
Fais bien attention jusqu'où vont les revenus de l'industrie. Un fonds ne produit annuellement à son maître que la vingtième partie de sa valeur; mais, avec une pistole de couleur, un peintre fera un tableau qui lui en vaudra cinquante. On en peut dire de même des orfèvres, des ouvriers en laine, en soie, et de toutes sortes d'artisans.
De tout ceci, on doit conclure, Rhédi, que, pour qu'un prince soit puissant, il faut que ses sujets vivent dans les délices; il faut qu'il travaille à leur procurer toutes sortes de superfluités, avec autant d'attention que les nécessités de la vie. »

Les Lettres persanes - LETTRE LXXIV - De la morgue des "grands" et de la noblesse...
Usbek à Rica, à *'*'*.
"Il y a quelques jours qu'un homme de ma connaissance me dit : "Je vous ai promis de vous produire dans les bonnes maisons de Paris ; je vous mène à présent chez un grand seigneur qui est un des hommes du royaume qui représente le mieux."
"Que veut dire cela, Monsieur ? Est-ce qu'il est plus poli, plus affable que les autres ? Non, me dit-il. - Ah ! j'entends ; il fait sentir à tous les instants la supériorité qu'il a sur tous ceux qui l'approchent. Si cela est, je n'ai que faire d'y aller : je la lui passe tout entière, et je prends condamnation."
Il fallut pourtant marcher, et je vis un petit homme si fier, il prit une prise de tabac avec tant de hauteur, il se moucha si impitoyablement, il cracha avec tant de flegme, il caressa ses chiens d'une manière si offensante pour les hommes, que je ne pouvais me lasser de l'admirer. « Ah ! bon Dieu ! dis-je en moi-même, si, lorsque j'étais à la cour de Perse, je représentais ainsi, je représentais un grand sot !" Il aurait fallu, Rica, que nous eussions eu un bien mauvais naturel pour aller faire cent petites insultes à des gens qui venaient tous les jours chez nous nous témoigner leur bienveillance : ils savaient bien que nous étions au-dessus d'eux, et, s'ils l'avaient ignoré, nos bienfaits le leur auraient appris chaque jour.
N'ayant rien à faire pour nous faire respecter, nous faisions tout pour nous rendre aimables : nous nous communiquions aux plus petits ; au milieu des grandeurs, qui endurcissent toujours, ils nous trouvaient sensibles ; ils ne voyaient que notre cœur au-dessus d'eux : nous descendions jusqu'à leurs besoins. Mais, lorsqu'il fallait soutenir la majesté du Prince dans les cérémonies publiques ; lorsqu'il fallait faire respecter la Nation aux étrangers ; lorsque, enfin, dans les occasions périlleuses, il fallait animer les soldats, nous remontions cent fois plus haut que nous n'étions descendus : nous ramenions la fierté sur notre visage, et l'on trouvait quelquefois que nous représentions assez bien". (De Paris, le 10 de la lune de Saphar, 1715).

Les Lettres persanes - LETTRE XXXV - Des cafés littéraires et des discussions aussi vives que vides..
Usbek à Rhédi, à Venise.
"Le café est très en usage à Paris: il y a un grand nombre de maisons publiques où on le distribue. Dans quelques-unes de ces maisons, on dit des nouvelles; dans d'autres, on joue aux échecs. Il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent : au moins, de tous ceux qui en sortent, il n'y a personne qui ne croie qu'il en a quatre fois plus que lorsqu'il y est entré. Mais ce qui me choque de ces beaux esprits, c'est qu'ils ne se rendent pas utiles à leur patrie, et qu'ils amusent leurs talents à des choses puériles.
Par exemple, lorsque j'arrivai à Paris, je les trouvai échauffés sur une dispute la plus mince qui se puisse imaginer: il s'agissait de la réputation d'un vieux poète grec dont, depuis deux mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort. Les deux partis avouaient que c'était un poète excellent: il n'était question que du plus ou du moins de mérite qu'il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux : mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres : voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement de part et d'autre des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n'admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu'un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller, devant un de ces défenseurs du poète grec, attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé ! et je crois que ce zèle, si délicat sur la réputation des morts, s'embraserait bien pour défendre celle des vivants ! Mais quoi qu'il en soit, ajoutais-je, Dieu me garde de m'attirer jamais l'inimité des censeurs de ce poète, que le séjour de deux mille ans dans le tombeau n'a pu garantir d'une haine si implacable ! Ils frappent à présent des coups en l'air : mais que serait-ce, si leur fureur était animée par la présence d'un ennemi ?..." (A Paris, le dernier de la lune de Zilhagé, 1713.)

Les Lettres persanes - LETTRE XCVII - A l'aube du siècle des lumières une ère nouvelle semble s'ouvrir..
Usbek à Hassein, Dervis de la montagne de Jaron.
"O toi, sage Dervis, dont l'esprit curieux brille de tant de connaissances, écoute ce que je te vais dire. Il y a ici des philosophes qui, à la vérité, n'ont point atteint jusqu'au faîte de la sagesse orientale: ils n'ont point été ravis jusqu'au trône lumineux ; ils n'ont point entendu les paroles ineffables dont les concerts des anges retentissent, ni senti les formidables accès d'une fureur divine; mais, laissés à eux-mêmes, privés des saintes merveilles, ils suivent dans le silence les traces de la raison humaine.
Tu ne saurais croire jusqu'où ce guide les a conduits. Ils ont débrouille le Chaos et ont expliqué, par une mécanique simple, l'ordre de l'architecture divine. L'auteur de la nature a donné du mouvement à la matière : il n'en a pas fallu davantage pour produire cette prodigieuse variété des effets que nous voyons dans l'Univers.
Que les législateurs ordinaires nous proposent des lois pour régler les sociétés des hommes; des lois aussi sujettes au changement que l'esprit de ceux qui les proposent, et des peuples qui les observent! Ceux-ci ne nous parlent que des lois générales immuables éternelles, qui s'observent sans aucune exception avec un ordre, une régularité et une promptitude infinie, dans l'immensité des espaces.
Et que crois-tu, homme divin, que soient ces lois? Tu t'imagines peut-être qu'entrant dans le conseil de l'Éternel tu vas être étonné par la sublimité des mystères ; tu renonces par avance à comprendre, tu ne te proposes que d'admirer. Mais tu changeras bientôt de pensée: elles n'éblouissent point par un faux respect; leur simplicité les a fait longtemps méconnaître, et ce n'est qu'après bien des réflexions qu'on en a vu toute la fécondité et toute l'étendue.
La première est que tout corps tend à décrire une ligne droite, à moins qu'il ne rencontre quelque obstacle qui l'en détourne; et la seconde, qui n'en est qu'une suite, c'est que tout corps qui tourne autour d'un centre tend à s'en éloigner, parce que, plus il en est loin, plus la ligne qu'il décrit approche de la ligne droite.
Voilà, sublime Dervis, la clef de la nature ; voilà des principes féconds, dont on tire des conséquences à perte de vue. La connaissance de cinq ou six vérités a rendu leur philosophie pleine de miracles et leur a fait faire presque autant de prodiges et de merveilles que tout ce qu'on nous raconte de nos saints prophètes.
Car, enfin, je suis persuadé qu'il n'y a aucun de nos docteurs qui n'eût été embarrassé si on lui eût dit de peser dans une balance tout l'air qui est autour de la terre, ou de mesurer toute l'eau qui tombe chaque année sur sa surface, et qui n'eût pensé plus de quatre fois avant de dire combien de lieues le son fait dans une heure, et quel temps un rayon de lumière emploie à venir du soleil à nous ; combien de toises il y a d'ici à Saturne ; quelle est la courbe selon laquelle un vaisseau doit être taillé pour être le meilleur voilier qu'il soit possible..." (De Paris, le 10 de la lune de Chahban, 1716.)

Les Lettres persanes - LETTRES XI A XIV - Evocation d'un peuple imaginaire, les Troglodytes, montrant qu'il n'est pas de vie sociale possible sans vertus morales.
L'insubordination et l'égoïsme entraîner l'anarchie avec tous ses maux, la liberté ne peut subsister sans vertu civique et morale. Et pourtant il arrive que le peuple puisse se lasser de la vertu, et passe ainsi de I'état démocratique à l'état monarchique : "Je vois bien ce que c'est, ô Troglodytes ! votre vertu commence à vous peser. Dans l'état ou vous êtes, n'ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux malgré vous : sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le malheur de vos premiers pères. Mais ce joug vous paraît trop dur ; vous aimez mieux être soumis à un prince et obéir à ses lois, moins rigides que vos mœurs. Vous savez que, pour lors, vous pourrez contenter votre ambition, acquérir des richesses et languir dans une lâche volupté, et que, pourvu que vous évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n'aurez pas besoin de la vertu" (Lettre XIV).
"Il y avait en Arabie un petit peuple, appelé Troglodyte, qui descendait de ces anciens Troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits, ils n'étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, ils avaient deux yeux; mais ils étaient si méchants et si féroces, qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. Ils avaient un roi d'une origine étrangère, qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement ; mais ils conjurèrent 3 contre lui, le tuèrent, et exterminèrent toute la famille royale.
Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement; et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, qu'il leur devinrent insupportables ; et ils les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéiraient plus à personne; que chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans consulter ceux des autres.
Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient : "Qu'ai-je affaire d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point? Je penserai uniquement à moi. Je vivrai heureux : que m'importe que les autres le soient ? Je me procurerai tous mes besoins ; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les autres Troglodytes soient misérables."
On était dans le mois où l'on ensemence les terres; chacun dit: "Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir ; une plus grande quantité me serait inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien." Les terres de ce petit royaume n'étaient pas de même nature : il y en avait d'arides et de montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année la sécheresse fut très grande, de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte.
L'année d'ensuite fut très pluvieuse; les lieux élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire, et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine ; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils l'avaient été eux-mêmes...
Il y avait un homme qui possédait un champ assez fertile, qu'il cultivait avec grand soin. Deux de ses voisins s'unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ ; ils firent entre eux une union pour se défendre contre tous ceux qui voudraient l'usurper, et, effectivement, ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois. Mais un des deux, ennuyé de partager ce qu'il pouvait avoir tout seul, tua l'autre et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long : deux autres Troglodytes vinrent l'attaquer ; il se trouva trop faible pour se défendre, et il fut massacré...
Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du pays voisin et donna ses remèdes si à propos qu'il guérit tous ceux qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qu'il avait traités demander son salaire ; mais il ne trouva que des refus. Il retourna dans son pays, et il y arriva accablé des fatigues d'un si long voyage. Mais bientôt après il apprit que la même maladie se faisait sentir de nouveau et affligeait plus que jamais cette terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois et n'attendirent pas qu'il vînt chez eux. "Allez, leur dit-il, hommes injustes! Vous avez dans l'âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir; vous ne méritez pas d'occuper une place sur la Terre, parce que vous n'avez point d'humanité et que les règles de l'équité vous sont inconnues : je croirais offenser les dieux, qui vous punissent, si je m'opposais à la justice de leur colère." (Lettre XI).

1724-1727
En 1724, Fontenelle introduit Montesquieu dans le salon de Mme de Lambert, où il retrouve Jean-Jacques Dortous de Mairan, La Motte-Houdart (1672-1731), Marivaux, Crébillon, l'abbé Dubos, etc. En 1725, paraît "Le Temple de Guide", roman plus galant que libertin et présenté comme une traduction du grec. Montesquieu fit des difficultés pour s'avouer l'auteur de cet ouvrage, qu'il avait écrit pour Mlle de Clermont..
Marie Anne de Bourbon (1697-1741), dite Mademoiselle de Clermont, fille du prince de Condé, avait vingt-sept ans et avait la beauté, l'éclat, et surtout la vivacité, Nattier l'a peinte (Musée Condé, Chantilly) comme une naïade aux joues roses et à la grâce conquérante. La tradition veut que Montesquieu ait été ébloui par ses charmes, et que, pour lui faire sa cour, il ait composé "Le Temple de Gnidos", "le dessein du poème est de faire voir, que nous sommes heureux par les sentiments du coeur, et non par les plaisirs des sens, mais que notre bonheur n'est jamais si pur qu'il ne soit troublé par les accidents". Il s'agit d'un petit poème en prose qu'il suppose être traduit du grec. " Il n'y a que les têtes bien frisées et bien poudrées, dit-il, qui connaissent tous les mérites du "Temple de Gnidos". "Vénus préfère le séjour de Gnide à celui de Paphos et d'Amathonte. Elle ne descend point de l'Olimpe sans venir parmi les Gnidiens. Elle a tellement accoutumé ce peuple heureux à sa vue , qu'il ne sent plus cette horreur sacrée qu'inspire la présence des dieux. Quelquefois elle se couvre d'un nuage, et on la reconnoît à l'odeur divine qui sort de ses cheveux parfumez d'ambroisie. La ville est au milieu d'une contrée sur laquelle les dieux ont versé leurs bienfaits à pleines mains. On y jouit d'un printemps éternel..."
Le Temple de Gnidos semble lui avoir valu de nombreuses faveurs, et Montesquieu osa se présenter à l'Académie française : il appartenait en effet à la société d'où elle recrutait ses membres, mais comme il passait pour l'auteur des "Lettres persanes", le roi refusa son consentement au choix de l'Académie sous prétexte que Montesquieu n'était pas résident de Paris. Montesquieu retourna à Bordeaux et s'appliqua à se rendre éligible. En 1725, il lit à l'Académie locale de Bordeaux des fragments d'un traité stoïcien sur les " Devoirs ", et ses " Réflexions sur la Distinction et la Réputation ". Il prononce un " Discours sur les motifs qui doivent nous encourager dans la recherche de la connaissance".
En 1726, ayant besoin d'argent, et lassé d'un métier qui l'ennuie et le retient à Bordeaux, Montesquieu vend sa charge, sous condition qu'elle reviendra à son fils. En 1727, Montesquieu est sans doute introduit dans le Club de l'Entresol, fondé en 1724 par l'abbé Alary, et où l'on discutait de législation et d'économie politique. Il semble y avoir lu, sans grand succès, son Dialogue de Sylla et d'Eucrate, composé vers 1724.

VOYAGES? Montesquieu quitte Paris le 5 avril 1728 et arrive à Vienne le 26 avril, fut chaleureusement accueilli, rencontra le prince Eugène, nous sommes alors en pleine période de confrontations diplomatiques entre les différentes puissances européennes, l'Espagne et l'Autriche se sont rapprochées, l'Angleterre, la France et la Prusse viennent de répondre en concluant l'alliance de Hanovre. Pour Montesquieu, ce sont les manières agréables et faciles, le plaisir d'observer, l'éclat de la vie de cour, le prestige des grandes affaires publiques, qui le fascinent quelque temps. Il visita la Hongrie, où il put étudier la féodalité et le servage ; il vit de loin, par-dessus la frontière, la république de Pologne, et s'enquit des causes de l'anarchie qui la menait à la ruine, puis passa en Italie.
A Venise, Montesquieu recueille nombre de données et y rencontre deux célèbres aventuriers échoués au bord de l'Adriatique, le comte de Bonneval, officier français devenu musulman et pacha, et Law qui y vit en exil. C'est sans doute auprès de l'abbé Conti, savant et poète, qu'il apprend l'existence d'une oeuvre célèbre, "La Science nouvelle" (Scienza Nuova), de Giambattista Vico (1668-1744). Du 14 au 24 septembre 1728, Montesquieu se rend de Venise à Milan, s'arrête un ou deux jours à Padoue, puis à Vicence, et puis à Vérone., consigne dans ses notes des remarques sur les cultures, les moeurs et les institutions des pays qu'il traverse. Le 16 octobre, il partit pour le Piémont, en faisant un détour par le Lac Majeur et les îles Borromées. A Turin, il obtient audience du roi Victor-Amédée II mais trouve la capitale du royaume bien froide. Mais à Turin comme à Venise, les Piémontais n'étaient guère plus accessibles que les Vénitiens. Rapidement, il visite Lucques, Pise et Livourne et atteint Florence le 1er décembre. Il y resta six semaines enchanté par la sociabilité de ses habitants, visitant la Galerie du Grand-Duc et le Palais Pitti. Le 15 janvier 1729, Montesquieu se mit en route pour Rome, où il parvint le 4e jour, après avoir visité Sienne et Viterbe. Le Cardianl de Polignac lui apprit une foule d'anecdotes et lui fit lecture d'un livre de L'Anti Lucrèce. Montesquieu en part le 18 avril pour passer une quinzaine de jours à Naples, et revient séjourner deux mois à Rome où il rencontre des cardinaux, des Anglais jacobites et des jésuites revenus de Chine. Puis il remonte vers l'Autriche, arrive à Innsbrück le 1er août, traverse l'Allemagne, passe à Amsterdam le 15 octobre, s'embarque le 31 pour l'Angleterre. Montesquieu rapporta de son voyage à travers l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne et la Hollande une foule de notions sur des sujets les plus variés.

De ce voyage en Italie, on peut retenir un point de rencontre entre Vico et Montesquieu. Montesquieu connut par son ami et compatriote bordelais Barbot l'œuvre de Doria, qui, dans sa Vita civile (1710) expose ou reprend les thèmes de la "Scienza nuova", sur la valeur originelle des premiers temps, sur la succession des trois âges, celui des dieux, celui des héros, celui des hommes, sur le dessein que l'historien, selon Vico, doit se proposer, et qui est de chercher les raisons, la cause intérieure et fondamentale, l'esprit des lois, et le principe propre à chacun des gouvernements. Il subit plus profondément encore, avec l'influence de Bolingbroke, l'influence de Gravina, l'ami de Vico, l'auteur du livre "Origines juris civilis" (1708), que lui avaient fait connaître ses amis italiens, l'abbé Guasco et l'abbé Cerati.
Il y trouva le fil directeur qui lui manquait, dans cette idée que l'origine et le développement du droit, dont le type et le modèle est le droit romain, ne sont le fruit, ni du hasard comme le veut Épicure, ni de la force comme le prétend Hobbes, mais de la Raison universelle,
.... une Raison universelle qui s'exprime dans le droit naturel, et qui produirait partout les mêmes effets si n'intervenaient dans chaque nation des influences particulières, tempérament, climat, nature du terrain et genre de vie, mœurs, religion, inclinations, impuissantes d'ailleurs, comme le montre Vico, à masquer le fait que le droit suit chez tous les peuples une même évolution. Les pages sur lesquelles s'ouvre l'Esprit des Lois (1748), au cours desquelles il distingue les lois naturelles, suite de la création divine, de la fatalité et de l'arbitraire :
"Première partie. Livre I. Des lois en général. Chapitre I. Des lois dans le rapport qu'elles ont avec les divers êtres.
Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses: et, dans ce sens, TOUS LES ÊTRES ONT LEURS LOIS ; la Divinité a ses lois ; le monde matériel a ses lois ; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs lois ; l’homme a ses lois.
Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents ?
IL Y A DONC UNE RAISON PRIMITIVE ; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux.
Dieu a du rapport avec l’univers, comme créateur et comme conservateur : les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces règles, parce qu’il les connaît ; il les connaît parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance.
Comme nous voyons que le monde, formé par le mouvement de la matière, et privé d’intelligence, subsiste toujours, il faut que ses mouvements aient des lois invariables; et, si l’on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il aurait des règles constantes, ou il serait détruit. Ainsi la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles.
Ces règles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mû et un autre corps mû, c’est suivant les rapports de la masse et de la vitesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, diminués, perdus ; chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.
LES ÊTRES PARTICULIERS INTELLIGENTS PEUVENT AVOIR DES LOIS QU'ILS ONT FAITES; MAIS ILS EN ONT AUSSI QU'ILS N'ONT PAS FAITES. Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles ; ils avaient donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles.
Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux.
Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les établit : comme, par exemple, que supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes, il serait juste de se conformer à leurs lois ; que, s’il y avait des êtres intelligents qui eussent reçu quelque bienfait d’un autre être, ils devraient en avoir de la reconnaissance ; que, si un être intelligent avait créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu’il a eue dès son origine ; qu’un être intelligent, qui a fait du mal à un être intelligent, mérite de recevoir le même mal, et ainsi du reste.
MAIS IL S'EN FAUT BIEN QUE LE MONDE INTELLIGENT SOIT AUSSI BIEN GOUVERNES QUE LE MONDE PHYSIQUE. Car, quoique celui-là ait aussi des lois qui, par leur nature, sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes.
La raison en est que les êtres particuliers intelligents sont bornés par leur nature, et par conséquent sujets à l’erreur ; et, d’un autre côté, il est de leur nature qu’ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives ; et celles même qu’ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours."
Mais dans ce nouveau monde que Montesquieu commence à explorer, il lui manque encore un fil directeur, une orientation que Vico avait de son côté, comme Bossuet, trouvé dans le gouvernement providentiel des événements et des hommes, et dans la manière dont Dieu les fait servir ä l'exécution de ses desseins.
Dans une lettre à David Hume de mars 1747, il le loue de cette "belle dissertation", où, dit-il, "vous donnez beaucoup plus grande influence aux causes morales qu'aux causes physiques". Dans l'Esprit des Lois (XIV, 5. Cf. XVI, 4-), il déclarera "que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, et les bons ceux qui s'y sont, opposés". Dans les Explications données à la Faculté de Théologie sur 17 propositions de l'Esprit des Lois qu'elle avait censurées, Montesquieu écrira : «"L'on peut dire que le livre de l`Esprit des Lois forme un triomphe perpétuel de la morale sur le climat, ou plutôt, en général, sur les causes physiques... Tout l'ouvrage n'a guère pour objet que d'établir l'influence des causes morales." Les causes morales, tel est le fil conducteur qui se tissent patiemment. Car il y a bien autre chose dans l'Esprit des Lois que ce qu'on y a vu de son temps, l'idée que la vie des sociétés, et les lois politiques qui en sont l'un des facteurs dominants, sont des effets dont il faut chercher les causes, et que ces causes ne sont ni le hasard, ou le simple jeu des passions humaines, comme le pense Voltaire, ni d'invincibles lois naturelles comme celles qui régissent tous les phénomènes quelconques, mais des raisons qui tiennent à la nature spécifique de l'être humain...

1730, Londres...
Montesquieu arrive à Londres le 3 novembre 1730. Il avait déjà, dans la cent quatrième Lettre Persane, exprimé toute son admiration pour la théorie monarchique anglaise et pour l'esprit libre du peuple anglais. Il avait fait l'éloge de cette monarchie qui sortie du peuple pour servir le peuple ne pourrait, à son avis, se maintenir qu'en se souvenant de ses origines et de ce peuple qui ne considérait pas l'obéissance passive comme une vertu. Reçu partout, Montesquieu fréquente la cour et les milieux mondains, politiques et littéraires, et assiste aux séances des deux chambres à une époque où Robert Walpole domine la vie politique anglaise depuis 1721, tandis que George II vient de succéder à George Ier. Une expérience qui lui permit d'écrire le sixième chapitre du livre VI (Que dans les monarchies, les ministres ne doivent pas juger) et le vingt-septième chapitre du livre XIX de l'Esprit des Lois...
"Comment les lois peuvent contribuer à former les moeurs, les manières et le caractère d'une nation...
LES COUTUMES D'UN PEUPLE ESCLAVE SONT UNE PARTIE DE SA SERVITUDE : CELLES D'UN PEUPLE LIBRE SONT UNE PARTIE DE SA LIBERTE. J’ai parlé au livre XII d’un peuple libre ; j’ai donné les principes de sa constitution : voyons les effets qui ont dû suivre, le caractère qui a pu s’en former, et les manières qui en résultent.
Je ne dis point que le climat n’ait produit, en grande partie, les lois, les mœurs et les manières de cette nation ; mais je dis que les mœurs et les manières de cette nation devraient avoir un grand rapport à ses lois.
Comme il y aurait dans cet État deux pouvoirs visibles : la puissance législative et l’exécutrice, et que tout citoyen y aurait sa volonté propre, et ferait valoir à son gré son indépendance, la plupart des gens auraient plus d’affection pour une de ces puissances que pour l’autre, le grand nombre n’ayant pas ordinairement assez d’équité ni de sens pour les affectionner également toutes les deux.
Et, comme la puissance exécutrice, disposant de tous les emplois, pourrait donner de grandes espérances et jamais de craintes, tous ceux qui obtiendraient d’elle seraient portés à se tourner de son côté, et elle pourrait être attaquée par tous ceux qui n’en espéreraient rien.
Toutes les passions y étant libres, la haine, l’envie, la jalousie, l’ardeur de s’enrichir et de se distinguer, paraîtraient dans toute leur étendue ; et si cela était autrement, l’État serait comme un homme abattu par la maladie, qui n’a point de passions parce qu’il n’a point de forces. La haine qui serait entre les deux partis durerait, parce qu’elle serait toujours impuissante.
Ces partis étant composés d’hommes libres, si l’un prenait trop le dessus, l’effet de la liberté ferait que celui-ci serait abaissé, tandis que les citoyens, comme les mains qui secourent le corps, viendraient relever l’autre.
Comme chaque particulier, toujours indépendant, suivrait beaucoup ses caprices et ses fantaisies, on changerait souvent de parti ; on en abandonnerait un où l’on laisserait tous ses amis pour se lier à un autre dans lequel on trouverait tous ses ennemis ; et souvent, dans cette nation , on pourrait oublier les lois de l’amitié et celles de la haine.
Le monarque serait dans le cas des particuliers ; et, contre les maximes ordinaires de la prudence, il serait souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’auraient le plus choqué, et de disgracier ceux qui l’auraient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les autres princes font par choix. On craint de voir échapper un bien que l’on sent, que l’on ne connaît guère, et qu’on peut nous déguiser ; et la crainte grossit toujours les objets. Le peuple serait inquiet sur sa situation, et croirait être en danger dans les moments même les plus sûrs.
D’autant mieux que ceux qui s’opposeraient le plus vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés de leur opposition, ils augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne saurait jamais au juste s’il serait en danger ou non. Mais cela même contribuerait à lui faire éviter les vrais périls où il pourrait, dans la suite, être exposé.
Mais le corps législatif ayant la confiance du peuple, et étant plus éclairé que lui, il pourrait le faire revenir des mauvaises impressions qu’on lui aurait données, et calmer ses mouvements.
C’est le grand avantage qu’aurait ce gouvernement sur les démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avait une puissance immédiate ; car, lorsque les orateurs l’agitaient, ces agitations avaient toujours leur effet.
Ainsi, quand les terreurs imprimées n’auraient point d’objet certain, elles ne produiraient que de vaines clameurs et des injures : et elles auraient même ce bon effet, qu’elles tendraient tous les ressorts du gouvernement, et rendraient tous les citoyens attentifs. Mais si elles naissaient à l’occasion du renversement des lois fondamentales, elles seraient sourdes, funestes, atroces, et produiraient des catastrophes. Bientôt on verrait un calme affreux, pendant lequel tout se réunirait contre la puissance violatrice des lois. Si, dans le cas où les inquiétudes n’ont pas d’objet certain, quelque puissance étrangère menaçait l’État, et le mettait en danger de sa fortune ou de sa gloire ; pour lors, les petits intérêts cédant aux plus grands, tout se réunirait en faveur de la puissance exécutrice.
Que si les disputes étaient formées à l’occasion de la violation des lois fondamentales, et qu’une puissance étrangère parût, il y aurait une révolution qui ne changerait pas la forme du gouvernement, ni sa constitution : car les révolutions que forme la liberté ne sont qu’une confirmation de la liberté.
Une nation libre peut avoir un libérateur ; une nation subjuguée ne peut avoir qu’un autre oppresseur. Car tout homme qui a assez de force pour chasser celui qui est déjà le maître absolu dans un État, en a assez pour le devenir lui-même.
Comme, pour jouir de la liberté, il faut que chacun puisse dire ce qu’il pense ; et que, pour la conserver, il faut encore que chacun puisse dire ce qu’il pense, un citoyen, dans cet État, dirait et écrirait tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire ou d’écrire.
Cette nation, toujours échauffée, pourrait plus aisément être conduite par ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes ; et il serait facile à ceux qui la gouverneroient de lui faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts. Cette nation aimerait prodigieusement sa liberté, parce que cette liberté serait vraie ; et il pourrait arriver que, pour la défendre, elle sacrifierait son bien, son aisance, ses intérêts ; qu’elle se chargerait des impôts les plus durs, et tels que le prince le plus absolu n’oserait les faire supporter à ses sujets.
Mais, comme elle aurait une connaissance certaine de la nécessité de s’y soumettre, qu’elle paierait dans l’espérance bien fondée de ne payer plus ; les charges y seraient plus pesantes que le sentiment de ces charges ; au lieu qu’il y a des États où le sentiment est infiniment au-dessus du mal. Elle aurait un crédit sûr, parce qu’elle emprunterait à elle-même, et se paierait elle-même. Il pourrait arriver qu’elle entreprendrait au-dessus de ses forces naturelles, et ferait valoir contre ses ennemis d’immenses richesses de fiction, que la confiance et la nature de son gouvernement rendraient réelles. Pour conserver sa liberté, elle emprunterait de ses sujets ; et ses sujets, qui verraient que son crédit serait perdu si elle était conquise, auraient un nouveau motif de faire des efforts pour défendre sa liberté.
Si cette nation habitait une île, elle ne serait point conquérante, parce que des conquêtes séparées l’affaibliraient. Si le terrain de cette île était bon, elle le serait encore moins, parce qu’elle n’aurait pas besoin de la guerre pour s’enrichir. Et, comme aucun citoyen ne dépendrait d’un autre citoyen, chacun ferait plus de cas de sa liberté que de la gloire de quelques citoyens, ou d’un seul. Là, on regarderait les hommes de guerre comme des gens d’un métier qui peut être utile et souvent dangereux, comme des gens dont les services sont laborieux pour la nation même ; et les qualités civiles y seraient plus considérées.
Cette nation, que la paix et la liberté rendraient aisée, affranchie des préjugés destructeurs, serait portée à devenir commerçante. Si elle avait quelqu’une de ces marchandises primitives qui servent à faire de ces choses auxquelles la main de l’ouvrier donne un grand prix, elle pourrait faire des établissements propres à se procurer la jouissance de ce don du ciel dans toute son étendue...."
L'Angleterre à présent est le pays le plus libre qui soit au monde, écrit-il, le prince n'a le pouvoir de faire aucun tort imaginable à qui que ce soit par la raison que son pouvoir est contrôlé par un Acte. Si, ajoute-t-il, la Chambre basse devenait maîtresse, son pouvoir serait illimité et dangereux parce qu'elle aurait en même temps le pouvoir exécutif, au lieu qu'à présent le pouvoir illimité est dans le Parlement et le roi, et la puissance exécutive dans le roi, dont le pouvoir est borné. Il constate que le peuple a bien peu de respect pour ses souverains, Walpole est ainsi l'objet de très nombreuses satires de la part d'écrivains comme John Gay, Jonathan Swift, Alexander Pope, Henry Fielding, Samuel Johnson, mais parvient à conserver l'appui du peuple et de la Chambre des communes. Montesquieu est de même frappé du nombre et de la licence des journaux et publications périodiques. Les publications journalières et hebdomadaires étaient à cette époque au nombre d'une vingtaine. Les plus importants étaient la London Gazette, British Journal, Weekly Medley, Evening Post, Whitehall Evening Post, London Evening Post, St James's Evening Post, London Journal, Appleby's Weekly Journal, British Gazetteer, The Postman, The Craftsman, The Daily Post, Fog 's Weekly Journal, The Weekly Spectator. La licence de la presse, dit-il, trouve en elle-même son correctif car les opinions des innombrables sectes et factions qui divisent le pays trouvent également leur expression dans les différents journaux, de telle sorte que les manifestations des journalistes se neutralisent mutuellement....
1731
De retour en France en mai 1731, il se retire à La Brède pour y rassembler jusqu'au printemps de 1733 ses réflexions et résumer ses observations en vue d'élaborer un grand ouvrage sur l'histoire et l'explication des lois.
1734
En 1734, il publie, en Hollande, les "Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence", qui sont à la fois un chapitre détaché de l'ouvrage en cours, et aussi une sorte de vérification expérimentale de ses premières constatations. Le succès n'est pas la hauteur de ses espérances...

1734 - "Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence"
Montesquieu détache en 1734 du futur "Esprit des Lois" des "Considérations" consacrées à l'histoire de Rome, une histoire qui le fascine particulièrement et qu'il connaît bien. Comment le peuple romain a-t-il pu atteindre cette "grandeur" , à partir d'origines très humbles, et périr de cette même grandeur. C’est l’analyse d’un cycle complet de devenir historique débouchant sur une interprétation de l’énigme qu’est la chute d’une civilisation devant les barbares. Il montre que les divisions au sein d’une République sont consubstantielles à sa force et à la liberté.
"Les premiers Romains ne mettaient point dans leurs armées un plus grand nombre de troupes auxiliaires que de romaines ; et, quoique leurs alliés fussent proprement des sujets, ils ne voulaient point avoir pour sujets des peuples plus belliqueux qu'eux-mêmes. Mais dans les derniers temps, non seulement ils n'observèrent pas cette proportion des troupes auxiliaires, mais même ils remplirent de soldats barbares les corps de troupes nationales.
Ainsi, ils établissaient des usages tout contraires à ceux qui les avaient rendus maîtres de tout ; et comme autrefois leur politique constante fut de se réserver l'art militaire et d'en priver tous leurs voisins, ils le détruisaient pour lors chez eux, et l'établissaient chez les autres.
Voici, en un mot, l'histoire des Romains : ils vainquirent tous les peuples par leurs maximes ; mais, lorsqu'ils y furent parvenus, leur république ne put subsister; il fallut changer de gouvernement, et des maximes contraires aux premières, employées dans ce gouvernement nouveau, firent tomber leur grandeur.
Ce n'est pas la fortune qui domine le monde : on peut le demander aux Romains, qui eurent une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite non interrompue de revers lorsqu'ils se conduisirent sur un autre. Il y a des causes générales, soit morales, soit physiques, qui agissent dans chaque monarchie, l'élèvent, la maintiennent ou la précipitent; tous les accidents sout soumis à ces causes ; et si le hasard d'une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un État, il y avait une cause générale qui faisait que cet État devait périr par une seule bataille. En un mot, l'allure principale entraîne avec elle tous les accidents particuliers...
Enfin, les Romains perdirent leur discipline militaire ; ils abandonnèrent jusqu'à leurs propres armes. Végèce dit que les soldats les trouvant trop pesantes, ils obtinrent de l'empereur Gratien de quitter leur cuirasse et ensuite leur casque : de façon qu'exposés aux coups sans défense, ils ne songèrent plus qu'à fuir. Il ajoute qu'ils avaient perdu la coutume de fortifier leur camp ; et que, par cette négligence, leurs armées furent enlevées par la cavalerie des Barbares. La cavalerie fut peu nombreuse chez les premiers Romains : elle ne faisait que la onzième partie de la légion, et très souvent moins ; et, ce qu'il y a d'extraordinaire, ils en avaient beaucoup moins que nous, qui avons tant de sièges à faire, où la cavalerie est peu utile. Quand les Romains furent dans la décadence, ils n'eurent presque plus que de la cavalerie. Il me semble que, plus une nation se rend savante dans l'art militaire, plus elle agit par son infanterie ; et que, moins elle le connaît, plus elle multiplie sa cavalerie : c'est que, sans la discipline, l'infanterie pesante ou légère n'est rien ; au lieu que la cavalerie va toujours, dans son désordre même. L'action de celle-ci consiste plus dans son impétuosité et un certain choc ; celle de l'autre dans sa résistance et une certaine immobilité : c'est plutôt une réaction qu'une action. Enfin, la force de la cavalerie est momentanée : l'infanterie agit plus longtemps ; mais il faut de la discipline pour qu'elle puisse agir longtemps.
Les Romains parvinrent à commander à tous les peuples, non seulement par l'art de la guerre, mais aussi par leur prudence, leur sagesse, leur constance, leur amour pour la gloire et pour la patrie. Lorsque, sous les empereurs, toutes ces vertus s'évanouirent, l'art militaire leur resta, avec lequel, malgré la faiblesse et la tyrannie de leurs princes, ils conservèrent ce qu'ils avaient acquis ; mais lorsque la corruption se mit dans la milice même, ils devinrent la proie de tous les peuples.
Un empire fondé par les armes a besoin de se soutenir par les armes. Mais comme, lorsqu'un État est dans le trouble, on n'imagine pas comment il peut en sortir, de même, lorsqu'il est en paix et qu'on respecte sa puissance, il ne vient point dans l'esprit comment cela peut changer : il néglige donc la milice, dont il croit n'avoir rien à espérer et tout à craindre, et souvent même il cherche à l'affaiblir.
C'était une règle inviolable des premiers Romains, que quiconque avait abandonné son poste, ou laissé ses armes dans le combat, était puni de mort. Julien et Valentinien avaient, à cet égard, rétabli les anciennes peines. Mais les Barbares pris à la solde des Romains, accoutumés à faire la guerre comme la font aujourd'hui les Tartares, à fuir pour combattre encore, à chercher le pillage plus que l'honneur, étaient incapables d'une pareille discipline.
Telle était la discipline des premiers Romains, qu'on y avait vu des généraux condamner à mourir leurs enfants pour avoir, sans leur ordre, gagné la victoire ; mais, quand ils furent mêlés parmi les Barbares, ils y contractèrent un esprit d'indépendance qui faisait le caractère de ces nations ; et, si l'on lit les guerres de Bélisaire contre les Goths, on verra un général presque toujours désobéi par ses officiers.
Sylla et Sertorius, dans la fureur des guerres civiles, aimaient mieux périr que de faire quelque chose dont Mithridate pût tirer avantage ; mais, dans les temps qui suivirent, dès qu'un ministre ou quelque grand cmt qu'il importait à son avarice, à sa vengeance, à son ambition, de faire entrer les Barbares dans l'empire, il le leur donna d'abord à ravager..."
1735-1748
Désormais, l'histoire de la vie de Montesquieu va se confondre avec l'élaboration du monumental "Esprit des lois" qui étudie les rapports entre les institutions et la nature des choses, c'est-à-dire, en fait, toute la législation humaine. Montesquieu a travaillé vingt ans à son grand ouvrage, lisant, entre autres, tous les anciens et les modernes qui pouvaient le documenter, Platon (la République, les Lois), Aristote (la Politique), Plutarque (les Vies, les Œuvres morales), Machiavel (le Prince, 1514; Discours politique sur la première décade de Tite-Live, 1516), Thomas Morus (Utopie, 1516), Hobbes (Du Citoyen, 1642), Locke(Essai sur le gouvernement civil, 1690), Pufendorf (Du Droit de la Nature et des Nations, 1672), Jean Bodin(les Six livres de la République, 1576-1578), François Hotman (Franco-Gallia, 1573)...
Cette œuvre immense ne procède pas seulement du plaisir de connaître et d'expliquer, mais aussi du désir de réformer les lois pour les mettre davantage en accord avec la raison et la réalité même du monde et des hommes. Il y travaille assidûment tout en s'occupant de ses biens et en faisant au moins sept séjours à Paris de 1733 à 1748. L'ouvrage est écrit aux deux tiers en 1742, et terminé à la fin de 1746.
"L'Esprit des lois" paraît en 1748 à Genève, connaît un succès considérable et provoque des attaques auxquelles Montesquieu répond en 1751 par une "Défense de l'Esprit des lois".
Il meurt à Paris en 1755. Son œuvre et sa pensée "Les Lettres Persanes" (1721) et "l'Esprit des lois" (1748) sont deux ouvrages fort différents par la forme et par le ton. Mais il est facile d'y découvrir l'unité profonde de la pensée de Montesquieu. Dès le premier ouvrage, l'observation piquante aboutit souvent à une comparaison déjà scientifique; le sens critique s'accompagne d'une méditation sur les mœurs et sur les régimes politiques, et distingue sous les apparences passagères les réalités profondes. Si Montesquieu abandonne Paris et la Perse pour la Rome antique, c'est afin d'y faire une expérience nouvelle et nous proposer une méthode de recherche et d'exposition rationnelles. Examinant les faits historiques, il cherche les lois dont dépend le destin des États et des gouvernements; il ébauche ainsi une véritable Philosophie de l'Histoire.
Enfin l'Esprit des lois nous offre une synthèse d'observations historiques et géographiques, un système rationnel et complet d'institutions et de principes exemplaires, accordés aux circonstances et à la nature humaine. L'ensemble constitue une leçon de méthode scientifique et philosophique qui reste aussi efficace au XXIe siècle qu'elle l'était au milieu du XVIIIe siècle. Le style Le style de Montesquieu reflète un véritable art d'écrire. A la rigueur logique et disciplinée de la phrase et du paragraphe, il sait allier la finesse du trait humoristique ou même caricatural qui vise à retenir l'attention de son lecteur. Son œuvre de philosophie politique a également ce brillant, ce souci de l'image et de l'effet qui combattent l'austérité abstraite de l'argumentation.

1748 - "De l’Esprit des Lois"
Montesquieu voit son pays inclinant vers le despotisme, et redoute que ce despotisme ne la conduise à l'anarchie, c'est-à-dire à la forme la plus redoutable de la décadence. Il veut dès lors restaurer «l'homme de bien politique», et pour cela lui montrer comment une grande institution sociale s'organise, grandit, prospère, décroît et se ruine, et en tirer leçon pour toutes les législations humaines. C'est ainsi qu'à partir de son expérience des différents pays européens et de nombreux témoignages, Charles de Montesquieu va élaborer sur près de vingt ans une comparaison poussée des systèmes politiques. Il en tire une synthèse dans "l’Esprit des lois". Face aux attaques qu’il déclenche, notamment de la part des jésuites et des jansénistes, Montesquieu répondra en publiant "Défense de l’Esprit des lois" en 1750. Certains éléments de son ouvrage seront repris lors de la rédaction de la nouvelle Constitution, au moment de la Révolution.
Dans l’Esprit des Lois, il entreprend d’éclaircir le lien de causalité générales et particulières, ce qui détermine l’esprit, l’humeur, les moeurs des hommes, individuellement et collectivement, à l’intérieur d’une société qui est à la fois naturelle, historique et politique. Il s’efforce de montrer comment se créent les identités nationales et politiques, base d'un idéal pratique, déterminer le système des lois, qui, dans des circonstances historiques et physiques données, produit le maximum de liberté, la liberté étant «le droit de faire tout ce que les lois permettent». Partant du principe que le peuple n’est pas propre à discuter de ces affaires, il faut, pour assurer cette liberté, que chacun des pouvoirs publics existants soit limité et contrôlé par une force qui lui fasse équilibre.
Ainsi dans la constitution anglaise et ses trois pouvoirs constitutifs que sont la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui regardent le droit des gens ou gouvernement, et la puissance exécutrice de celles qui concernent le droit civil ou puissance judiciaire. Si ces pouvoirs dépendent d’une même volonté et que cette volonté soit celle d’un seul, alors toute liberté disparaît.

De l’Esprit des lois - Préface..
"Si, dans le nombre infini des choses qui sont dans ce livre, il y en avait quelqu'une qui, contre mon attente, pût offenser, il n'y en a pas du moins qui ait été mise avec mauvaise intention. Je n'ai point naturellement l'esprit désapprobateur. Platon remerciait le ciel de ce qu'il était né du temps de Socrate; et moi je lui rends grâces de ce qu'il m'a fait naître dans le gouvernement où je vis, et de ce qu'il a voulu que j'obéisse à ce qu'il m 'a fait aimer.
Je demande une grâce que je crains qu'on ne m'accorde pas; c'est de ne pas juger, par la lecture d'un moment, d'un travail de vingt années; d'approuver ou de condamner le livre entier, et non pas quelques phrases. Si l'on veut chercher le dessein de l'auteur, on ne le peut bien découvrir que dans le dessein de l'ouvrage.
J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. J 'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi, ou dépendre d 'une autre plus générale. Quand j'ai été rappelé à l'antiquité, j'ai cherché à en prendre l'esprit pour ne pas regarder comme semblables des cas réellement différents, et ne pas manquer les différences de ceux qui paraissent semblables.
Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. Ici, bien des vérités ne se feront sentir qu'après qu'on aura vu la chaîne qui les lie à d 'autres. Plus on réfléchira sur les détails plus on sentira la certitude des principes. Ces détails mêmes, je
ne les ai pas tous donnés; car qui pourrait dire tout sans un mortel ennui?
On ne trouvera point ici ces traits saillants qui semblent caractériser les ouvrages d'aujourd'hui. Pour peu qu'on voie les choses avec une certaine étendue, les saillies s'évanouissent; elles ne naissent d'ordinaire que parce que l'esprit se jette tout d 'un côté, et abandonne tous les autres.
Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes; et on en tirera naturellement cette conséquence, qu'il n'appartient de proposer des changements qu'à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d 'un coup de génie toute la constitution d'un État.
Il n 'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés des magistrats ont commencé par être les préjugés de la nation. Dans un temps d'ignorance, on n'a aucun doute, même lorsqu'on fait les plus grands maux; dans un temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. On sent les abus anciens, on en voit la correction; mais on voit encore les abus de la correction même. On laisse le mal, si l'on craint le pire; on laisse le bien, si on est en doute du mieux. On ne regarde les parties que pour juger du tout ensemble; on examine toutes les causes pour voir tous les résultats.
Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois; qu'on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels.
Si je pouvais faire en sorte que ceux qui commandent augmentassent leurs connaissances sur ce qu'ils doivent prescrire, et que ceux qui obéissent trouvassent un nouveau plaisir à obéir, je me croirais le plus heureux des mortels.
Je me croirais le plus heureux des mortels, si je pouvais faire que les hommes pussent se guérir de leurs préjugés. J'appelle ici préjugés non pas ce qui fait qu'on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même...
C 'est en cherchant à instruire les hommes que l'on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de tous. L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe.
J'ai bien des fois commencé et bien des fois abandonné cet ouvrage; j'ai mille fois abandonné aux vents les feuilles que j'avais écrites; je sentais tous les jours les mains paternelles tomber; je suivais mon objet sans former de dessein; je ne connaissais ni les règles ni les exceptions; je ne trouvais la vérité que pour la perdre : mais quand j'ai découvert mes principes, tout ce que je cherchais est venu à moi et dans le cours de vingt années, j'ai vu mon ouvrage commencer, croître, s'avancer et finir.
Si cet ouvrage a du succès, je le devrai beaucoup à la majesté de mon sujet : cependant je ne crois pas avoir totalement manqué de génie. Quand j’ai vu ce que tant de grands hommes, en France, en Angleterre et en Allemagne, ont écrit avant moi, j’ai été dans l’admiration, mais je n’ai point perdu courage. «Et moi aussi je suis peintre» ai-je dit avec le Corrège."
Le livre se divise en trois parties.
L'Esprit des Lois - Partie théorique (I-VIII): des lois en général dans leurs rapports avec Dieu, le monde matériel, l’être intelligent : chapitres très abstraits; dans leurs rapports avec les différents gouvernements et les principes de ces gouvernements, la Vertu pour les démocraties, l’Honneur pour les monarchies, la Peur pour le despotisme. Sont relatives aux principes des gouvernements les lois de l’éducation, la forme des jugements et la nature des peines, les lois somptuaires touchant au luxe et à la condition des femmes. Montesquieu traite ensuite de la corruption des principes des trois gouvernements.
I, I. — DES LOIS DANS LES RAPPORTS QU’ELLES ONT AVEC LES DIVERS ÊTRES
Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois; la divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l’homme a ses lois.
Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents? Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui se trouvent entre elle et les différents êtres et les rapports de ces divers êtres entre eux. Dieu a du rapport avec l’univers comme créateur et comme conservateur; les lois selon lesquelles il a créé sont celles selon lesquelles il conserve; il agit selon ces règles parce qu’il les a faites; il les a faites parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance.
Comme nous voyons que le monde formé par le mouvement de la matière et privé d’intelligence subsiste toujours, il faut que ses mouvements aient des lois invariables; et si l’on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il aurait des règles constantes, ou il serait détruit.
Ainsi la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le Créateur sans ces règles pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles...
Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont faites; mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles; ils avaient donc des rapports possibles et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient pas égaux...
...Mais il s’en faut que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Car quoique celui-ci ait aussi des lois qui par leur nature sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est que les êtres particuliers intelligents sont bornés par leur nature et par conséquent sujets à l’erreur; et d’un autre côté il est de leur nature qu’ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives; et celles même qu’ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours...
L’homme, comme être physique, est, ainsi que les autres corps, gouverné par des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les lois que Dieu a établies, et change celles qu’il établit lui-même. Il faut qu’il se conduise et cependant il est un être borné, il est sujet à l’ignorance et à l’erreur comme toutes les intelligences finies; les solides connaissances qu’il a, il les perd encore comme créature sensible, il devient sujet à mille passions. Un tel être pouvait à tous les instants oublier son créateur; Dieu l’a rappelé à lui par les lois de la religion. Un tel être pouvait à tous les instants s’oublier lui-même; les philosophes l’ont averti par les lois de la morale. Fait pour vivre dans la société, il y pouvait oublier les autres; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les lois politiques et civiles.
I, II — DES LOIS DE LA NATURE
Avant toutes ces lois, sont celles de la nature, ainsi nommées parce qu’elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les connaître bien, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les lois de la nature seront celles qu’il recevrait dans un état pareil. Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la première des lois naturelles par son importance, et non pas dans l’ordre de ces lois. L’homme, dans l’état de nature, aurait plutôt la faculté de connaître, qu’il n’aurait des connaissances. Il est clair que ses premières idées ne seraient point des idées spéculatives: il songerait à la conservation de son être, avant de chercher l'origine de son être. Un homme pareil ne sentirait d’abord que sa faiblesse; sa timidité serait extrême; et, si l’on avait
là-dessus besoin de l’expérience, l’on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages: tout les fait trembler, tout les fait fuir.
Dans cet état, chacun se sent inférieur; à peine chacun se sent-il égal. On ne chercherait donc point à s’attaquer, et la paix serait la première loi naturelle.
Le désir que Hobbes donne d’abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres, n’est pas raisonnable. L’idée de l’empire et de la domination est si composée, et dépend de tant d’autres idées, que ce ne serait pas celle qu’il aurait d’abord.
Hobbes demande « pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés? et pourquoi ils ont des clefs pour fermer leurs maisons ? ».
Mais on ne sent pas que l’on attribue aux hommes, avant l’établissement des sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu’après cet établissement, qui leur fait trouver des motifs pour s’attaquer et pour se défendre. Au sentiment de sa faiblesse, l’homme joindrait le sentiment de ses besoins. Ainsi une autre loi naturelle serait celle qui lui inspirerait de chercher à se nourrir.
J’ai dit que la crainte porterait les hommes à se fuir : mais les marques d’une crainte réciproque les engageraient bientôt à s’approcher. D’ailleurs, ils y seraient portés par le plaisir qu’un animal sent à l’approche d’un animal de son espèce. De plus, ce charme que les deux sexes s’inspirent par leur différence, augmenterait ce plaisir; et la prière naturelle qu’ils se font toujours l’un à l’autre serait une troisième loi. Outre le sentiment que les hommes ont d’abord, ils parviennent encore à avoir des connaissances; ainsi ils ont un second lien que les autres animaux n’ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s’unir; et le désir de vivre en société est une quatrième loi naturelle.
I, III. — DES LOIS POSITIVES
Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse; l’égalité, qui était entre eux, cesse, et l’état de guerre commence. Chaque société particulière vient à sentir sa force; ce qui produit un état de guerre de nation en nation. Les particuliers, dans chaque société, commencent à sentir leur force ; ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société; ce qui fait entre eux un état de guerre. Ces deux sortes d’état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d’une si grande planète, qu’il est nécessaire qu’il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux; et c’est le droit des gens. Considérés comme vivants dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés; et c’est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux; et c’est le DROIT CIVIL.
Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe : que les diverses nations doivent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, dans la guerre, le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. L’objet de la guerre, c’est la victoire, celui de la victoire, la conquête, celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs; ils connaissent des droits de la guerre et de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les vrais principes.
Outre le droit des gens, qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particulières, dit très bien Gravina, forme ce qu’on appelle l’ÉTAT POLITIQUE.
La force générale peut être placée entre les mains d’un seul, ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d’un seul était le plus conforme à la nature. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car, si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d’un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères, ou, après la mort des frères, celui des cousins germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l’union de plusieurs familles. Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.
Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très bien Gravina, est ce qu’on appelle l’état civil.
La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre.
Il faut qu’elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu’on veut établir; soit qu’elles le forment, comme font les lois politiques; soit qu’elles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays; au climat glacé, brûlant ou tempéré; à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières.
Enfin elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C’est dans toutes ces vues qu’il faut les considérer.
C’est ce que j’entreprends de faire dans cet ouvrage. J’examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce qu’on appelle I’esprit des lois. Je n’ai point séparé les lois politiques des civiles : car, comme je ne traite point des lois, mais de l’esprit des lois, et que cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses, j’ai dû moins suivre l’ordre naturel des lois, que celui de ces rapports et de ces choses.
J’examinerai d’abord les rapports que les lois ont avec la nature et avec le principe de chaque gouvernement : et, comme ce principe a sur les lois une suprême influence, je m’attacherai à le bien connaître; et, si je puis une fois l’établir, on en verra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent être plus particuliers."

II, II. — DU GOUVERNEMENT RÉPUBLICAIN ET DES LOIS RELATIVES A LA DÉMOCRATIE
Lorsque, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une Démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une Aristocratie. Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le monarque ; à certains autres, il est le sujet. Il ne peut être monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, et de quelle manière il doit gouverner.
Libanius dit qu’à Athènes un étranger qui se mêlait dans rassemblée du peuple, était puni de mort. C’est qu’un tel homme usurpait le droit de souveraineté. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées; sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il fallait dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avait tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l’Italie et une partie de la terre dans ses murailles, on n’avait point fixé ce nombre; et ce fut une des grandes causes de sa ruine.
Le peuple qui a la souveraine puissance doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire; et ce qu’il ne peut pas bien faire, il faut qu’il le fasse par ses ministres. Ses ministres ne sont point à lui s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats. Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou sénat. Mais, pour qu’il y ait confiance, il faut qu’il en élise les membres; soit qu’il les choisisse lui-même, comme à Athènes; ou par quelque magistrat qu’il a établi pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions.
Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Il sait très bien qu’un homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès; il est donc très capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu ; que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contents de lui, qu’on ne l’a pas convaincu de corruption : en voilà assez pour qu’il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d’un citoyen : cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique qu’un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas.
Si l’on pouvait douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il n’y aurait qu’à jeter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonnants que firent les Athéniens et les Romains : ce qu’on n’attribuera pas sans doute au hasard.
On sait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les plébéiens, il ne pouvait se résoudre à les élire, et quoiqu’à Athènes on pût, par la loi d’Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n’arriva jamais, dit Xénophon, que le bas peuple demandât celles qui pouvaient intéresser son salut ou sa gloire.
Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus, de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n’est pas propre à gérer par lui-même. Il faut que les affaires aillent, et qu’elles aillent un certain mouvement, qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.
Dans l’État populaire on divise le peuple en de certaines classes. C’est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés; et c’est de là qu’ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité.
Servius Tullius suivit, dans la composition des classes, l’esprit de l’aristocratie. Nous voyons, dans Tite-Live et dans Denys d’Halicarnasse, comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avait divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formaient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premières centuries, les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes, il jeta toute la foule des indigents dans la dernière : et chaque centurie n’ayant qu’une voix, c’étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage, plutôt que les personnes.
Solon divisa le peuple d’Athènes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire, mais ceux qui pouvaient être élus; et laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges, mais que ce ne fût que dans les trois premières, où étaient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats. Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est, dans la république, une loi fondamentale, la manière de le donner est une autre loi fondamentale.
Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie : le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Mais comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés. Solon établit à Athènes que l’on nommerait par choix à tous les emplois militaires, et que les sénateurs et les juges seraient élus par le sort.
Il voulut que l’on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense, et que les autres fussent données par le sort. Mais pour corriger le sort, il régla qu’on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient; que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges, et que chacun pourrait l’accuser d’en être indigne cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature, il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s’était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.
La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrage est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C’est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron écrit que les lois qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république romaine furent une des grandes causes de sa chute. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu’il en faut penser.
Sans doute que, lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics, et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux, et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la république romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout; il ne fut plus possible d’éclairer une populace qui se perdait.
Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages, ou dans une démocratie le sénat, comme il n’est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauraient être trop secrets. La brigue est dangereuse dans un sénat; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l’est pas dans le peuple, dont la nature est d’agir par passion. Dans les États où il n’a point de part au gouvernement, il s’échauffera pour un acteur, comme il aurait fait pour les affaires.
Le malheur d’une république, c’est lorsqu’il n’y a plus de brigues; et cela arrive lorsqu’on a corrompu le peuple à prix d’argent : il devient de sang-froid, il s’affectionne à l’argent, mais il ne s’affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement et de ce qu’on y propose, il attend tranquillement son salaire.
C’est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer; il est même souvent à propos d’essayer une loi avant de l’établir. La constitution de Rome et celle d’Athènes étaient très sages. Les arrêts du sénat avaient force de loi pendant un an; ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple.

De l’esprit des lois - La Séparation des Pouvoirs - Le principe énoncé ici par Montesquieu s'est imposé à toute les Constitutions démocratiques et à toutes les nations dites civilisées. Il commence par définir nettement les trois pouvoirs possibles et montre ensuite par des exemples les inconvénients que présente leur réunion sur la tête d'un seul homme ou dans un corps de magistrature (chap. VI).
"Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs: la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger; et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État.
La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d 'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté; et, pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.
Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d 'un oppresseur.
Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré, parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme..."

De l’esprit des lois - La Démocratie - Nourri de lettres grecques et romaines, Montesquieu admire les démocraties antiques, et en tant qu'humaniste, il a l'esprit républicain mais sa conception de la vertu républicaine est particulièrement complexe et on y mêle ainsi trop aisément vertu politique et vertu morale, faute de définition claire, si ce n'est de ligne de démarquage avec le monarchie. Cette ambiguïté ne s'estompera pas avec le temps...
"Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintiennent ou se soutiennent. La force des lois dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre, règlent ou contiennent tout. Mais dans un État populaire, il faut un ressort de plus, qui est la Vertu.
Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l'histoire, et est très conforme à la nature des choses. Car il est clair que, dans une monarchie, où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire, où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-même et qu'il en portera le poids.
Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par négligence, cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal : il n'a qu'à changer de conseil, ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, l'État est déjà perdu.
Ce fut un assez beau spectacle, dans le siècle passé, de voir les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avaient part aux affaires n'avaient point de vertu, que leur ambition était irritée par le succès de celui qui avait le plus osé, que l'esprit d'une faction n'était réprimé que par l'esprit d'une autre, le gouvernement changeait sans cesse : le peuple, étonné, cherchait la démocratie, et ne la trouvait nulle part. Enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu'on avait proscrit.
Quand Sylla voulut rendre à Rome la liberté, elle ne put plus la recevoir : elle n'avait plus qu'un faible reste de vertu; et comme elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibère, Caïus, Claude, Néron, Domitien, elle fut toujours plus esclave : tous les coups portèrent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. Les politiques grecs, qui vivaient dans le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d'autre force qui pût le soutenir que celle de la vertu.
Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses, et de luxe même. Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, et l'avarice entre dans tous. Les désirs changent d'objets : ce qu'on aimait, on ne l'aime plus ; on était libre avec les lois, on veut être libre contre elles ; chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître ; ce qui était maxime, on l'appelle rigueur ; ce qui était règle, on l'appelle gêne ; ce qui était attention, on l'appelle crainte. C'est la frugalité qui y est l'avarice, et non pas le désir d'avoir.
Autrefois le bien des particuliers faisait le trésor public ; mais pour lors le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La république est une dépouille; et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous" (III, 3).

De l’esprit des lois - Principes des gouvernements non démocratiques - La "modération aristocratique" et "l'honneur monarchique" sont, comme "la vertu démocratique", des principes complexes; en revanche, la crainte, sur laquelle se fonde le despotisme, est un ressort simple et brutal, efficace mais grossier. De plus, la crainte dégrade les âmes, tandis que les trois autres principes les exaltent. C'est dire que le despotisme ne saurait convenir à des peuples civilisés, conscients de la dignité humaine...
Aristocratie? - " Comme il faut de la vertu dans le gouvernement populaire, il en faut aussi dans l'aristocratie. Il est vrai qu'elle n'y est pas si absolument requise. Le peuple, qui est à l'égard des nobles ce que les sujets sont à l'égard du monarque, est contenu par leurs lois. Il a donc moins besoin de vertu que le peuple de la démocratie. Mais comment les nobles seront-ils contenus? Ceux qui doivent faire exécuter les lois contre leurs collègues sentiront d'abord il qu'ils agissent contre eux-mêmes. Il faut donc de la vertu dans ce corps, par la nature de la constitution.
Le gouvernement aristocratique a par lui-même une certaine force que la démocratie n'a pas. Les nobles y forment un corps qui, par sa prérogative et pour son intérêt particulier, réprime le peuple : il suffit qu'il y ait des lois, pour qu'à cet égard elles soient exécutées. Mais autant qu'il est aisé à ce corps de réprimer les autres, autant est-il difficile qu'il se réprime lui-même. Telle est la nature de cette constitution, qu'il semble qu'elle mette les mêmes gens sous la puissance des lois, et qu'elle les en retire.
Or, un corps pareil ne peut se réprimer que de deux manières : ou par une grande vertu, qui fait que les nobles se trouvent en quelque façon égaux à leur peuple, ce qui peut former une grande république ; ou par une vertu moindre, qui est une certaine modération qui rend les nobles au moins égaux à eux-mêmes, ce qui fait leur conservation. La modération est donc l'âme de ces gouvernements. J'entends celle qui est fondée sur la vertu, non pas celle qui vient d'une lâcheté et d'une paresse de l'âme" (III, 4).
Monarchie ? - "Le gouvernement monarchique suppose, comme nous avons dit, des prééminences, des rangs, et même une noblesse d'origine. La nature de l'honneur est de demander des préférences et des distinctions ; il est donc, par la chose même, placé dans ce
gouvernement. L'ambition est pernicieuse dans une république. Elle a de bons effets dans la monarchie ; elle donne la vie à ce gouvernement ; et on y a cet avantage, qu'elle n'y est pas dangereuse, parce qu'elle y peut être sans cesse réprimée.
Vous diriez qu'il en est comme du système de l'univers, où il y a une force qui éloigne sans cesse du centre tous les corps, et une force de pesanteur qui les y ramène. L'honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il les lie par son action même et il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers.
Il est vrai que, philosophiquement parlant, c'est un honneur faux qui conduit toutes les parties de l'État ; mais cet honneur faux est aussi utile au public que le vrai le serait aux particuliers qui pourraient l'avoir. Et n'est-ce pas beaucoup d'obliger les hommes à faire toutes les actions difficiles, et qui demandent de la force, sans autre récompense que le bruit de ces actions?" (III, 7).
Despotisme? "Comme il faut de la vertu dans une république, et dans une monarchie de l'honneur, il faut de la crainte dans un gouvernement despotique pour la vertu, elle n'y est point nécessaire, et l'honneur y serait dangereux. Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s'estimer beaucoup eux-mêmes seraient en état d'y faire des révolutions. Il faut donc que la crainte y abatte tous les courages et y éteigne jusqu'au moindre sentiment d'ambition. Un gouvernement modéré peut, tant qu'il veut, et sans péril, relâcher ses ressorts : il se maintient par ses lois et par sa force même. Mais lorsque dans le gouvernement despotique le prince cesse un moment de lever le bras, quand il ne peut pas anéantir à l'instant ceux qui ont les premières places, tout est perdu : car le ressort du gouvernement, qui est la crainte, n'y étant plus, le peuple n'a plus de protecteur.
C'est apparemment dans ce sens que des cadis ont soutenu que le grand Seigneur n'était point obligé de tenir sa parole ou son serment, lorsqu'il bornait par là son autorité. Il faut que le peuple soit jugé par les lois, et les grands par la fantaisie du prince; que la tête du dernier sujet soit en sûreté, et celle des bachas toujours exposée. On ne peut parler sans frémir de ces gouvernements monstrueux. Le sophi de Perse, détrône de nos jours par Mirivéis vit le gouvernement périr avant la conquête, parce qu'il n`avait pas versé assez de sang.
L'histoire nous dit que les horribles cruautés de Domitien effrayèrent les gouverneurs au point que le peuple se rétablit un peu sous son règne. C'est ainsi qu'un torrent qui ravage tout d›un côté laisse de l'autre des campagnes où l'œil voit de loin quelques prairies". (III, 9).

De l’esprit des lois - De la corruption des principes des gouvernements - Montesquieu place en tête du Livre VIII, "De la corruption des principes des trois gouvernements", cette réflexion générale : "La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes. " Puis il examine le cas de la démocratie, un régime menacé par les ambitions individuelles mais plus encore par l'esprit d'insubordination, ou esprit d'égalité extrême, encouragé par la politique des démagogues, et qui provoque l'anarchie, terrain favorable à l'établissement du despotísme.
"Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême, et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, et dépouiller tous les juges. Il ne peut plus y avoir de vertu dans la république. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats: on ne les respecte donc plus. Les délibérations du sénat n'ont plus de poids : on n'a donc plus d'égards pour les sénateurs, et par conséquent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas du respect pour les vieillards, on n'en aura pas non plus pour les pères ; les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage: la gêne du commandement fatiguera, comme celle de l'obéissance. Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour de l'ordre, enfin plus de vertu.
On voit dans le Banquet de Xénophon une peinture bien naïve d'une république où le peuple a abusé de l'égalité. Chaque convive donne à son tour la raison pourquoi il est content de lui. "Je suis content de moi, dit Charmidès, à cause de ma pauvreté. Quand j'étais riche, j'étais obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j'étais plus en état de recevoir du mal d'eux que de leur en faire ; la république me demandait toujours quelque nouvelle somme; je ne pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai acquis de l'autorité ; personne ne me menace, je menace les autres; je puis m'en aller ou rester. Déjà les riches se lèvent de leur place et me cèdent le pas. Je suis un roi, j'étais esclave ; je payais un tribut à la république, aujourd'hui elle me nourrit ; je ne crains plus de perdre, j'espère d'acquérir."
Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'il ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur ; pour qu'il n'aperçoive pas leur avance, ils flattent sans cesse la sienne. La corruption augmentera parmi les corrupteurs, et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics ; et, comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais, avec sa paresse et son luxe, il n'y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui. Il ne faudra pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple., sans retirer encore plus de lui ; mais, pour retirer de lui, il faut renverser l'État. Plus il paraîtra tirer d'avantage de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable ; un seul tyran s'élève ; et le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de sa corruption.
La démocratie a donc deux excès à éviter : l'esprit d'inégalité, qui la mène à l'aristocratie, ou au gouvernement d'un seul ; et l'esprit d'égalité extrême, qui la conduit au despotisme d'un seul, comme le despotisme d'un seul finit par la conquête." (VIII, 2).
De l’esprit des lois - De la corruption du principe de la monarchie - Montesquieu songe ici, sous d'apparentes généralités, à la monarchie française, sa critique de l'absolutisme établi par Louis XIV est à peine déguisée. Quant au principe du gouvernement despotique, il "se corrompt sans cesse, parce qu'il est corrompu par sa nature" (VIII, 10)...
"Comme les démocraties se perdent lorsque le peuple dépouille le sénat, les magistrats et les juges de leurs fonctions, les monarchies se corrompent lorsqu'on ôte peu à peu les prérogatives des corps ou les privilèges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous ; dans l'autre au despotisme d'un seul.
"Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de Souï, dit un auteur chinois, c'est qu'au lieu de se borner, comme les anciens, à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes." L'auteur chinois nous donne ici la cause de la corruption de presque toutes les monarchies.
La monarchie se perd, lorsqu'un prince croit qu'il montre plus sa puissance en changeant l'ordre des choses qu'en les suivant; lorsqu'il ôte les fonctions naturelles des uns pour les donner arbitrairement à d'autres, et lorsqu'il est plus amoureux de ses fantaisies que de ses volontés. La monarchie se perd, lorsque le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle l'État à sa capitale, la capitale à sa cour, et la cour à sa seule personne. Enfin elle se perd, lorsqu'un prince méconnaît son autorité, sa situation, l'amour de ses peuples; et lorsqu'il ne sent pas bien qu'un monarque doit se juger en sûreté, comme un despote doit se croire en péril. (VIII, 6).
Le principe de la monarchie se corrompt lorsque les premières dignités sont les marques de la première servitude, lorsqu'on ôte aux grands le respect des peuples, et qu'on les rend de vils instruments du pouvoir arbitraire. Il se corrompt encore plus, lorsque l'honneur a été mis en contradiction avec les honneurs, et que l'on peut être à la fois couvert d'infamie et de dignités.
Il se corrompt lorsque le prince change sa justice en sévérité ; lorsqu'il met, comme les empereurs romains, une tête de Méduse sur sa poitrine; lorsqu'il prend cet air menaçant et terrible que Commode faisait donner à ses statues. Le principe de la monarchie se corrompt lorsque des âmes singulièrement lâches tirent vanité de la grandeur que pourrait avoir leur servitude, et qu'elles croient que ce qui fait que l'on doit tout au prince fait que l'on ne doit rien à sa patrie.
Mais, s'il est vrai (ce que l'on a vu dans tous les temps) qu'à mesure que le pouvoir du monarque devient immense, sa sûreté diminue, corrompre ce pouvoir jusqu'à le faire changer de nature, n'est-ce pas un crime de lèse-majesté contre lui?" (VIII, 7).
L'Esprit des Lois - Partie pratique (IX-XXVI) : des lois dans leur rapport avec la force défensive, avec la force offensive. Montesquieu à ce sujet trace les portraits de Charles XII, le politique qui va contre la nature des choses, et d’Alexandre, le politique très sage. Le livre XI (chap. Vl) contient l’étude de la Constitution anglaise. Les livres XII et XIII traitent de la liberté politique, des tributs et des revenus publics, les livres XIV-XVIII des lois dans le rapport qu’elles ont avec la nature du climat. Ces pages sont neuves; mais on a pu reprocher à Montesquieu d’avoir poussé sa thèse trop loin. Les lois de l’esclavage ont du rapport avec la nature du climat : ce qui n’empêche pas Montesquieu d’écrire contre l’esclavage une page vigoureuse, pleine d’humour à la manière de Swift. Viennent ensuite (XIX-XXV), les lois étudiées dans leur rapport avec les mœurs - ici (XIX, XXVII) se place une étude du caractère de la nation anglaise -, avec le commerce, les monnaies, le nombre d’habitants, la religion.
La religion arrive bien tard, nous sommes au vingt-quatrième chapitre, c’est que, pour Montesquieu, la religion est une force comme les autres : il l’étudie en politique, objectivement, mais semble la sous-estimer. On trouve dans cette partie d’excellentes pages sur la tolérance et la Très humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne et de Portugal.

Livre XI, chapitre I
DES LOIS QUI FORMENT LA LIBERTÉ POLITIQUE DANS SON RAPPORT AVEC LA CONSTITUTION.
CHAPITRE PREMIER. IDEE GÉNÉRALE.
Je distingue les lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution, d’avec celles qui la forment dans son rapport avec le citoyen. Les premières seront le sujet de ce livre-ci ; je traiterai des secondes dans le livre suivant.
CHAPITRE II. DIVERSES SIGNIFICATIONS DONNÉES AU MOT DE LIBERTÉ.
Il n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières, que celui de liberté. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avaient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils devaient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, et de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci, pour le privilège de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois. Certain peuple a longtemps pris la liberté pour l’usage de porter une longue barbe. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, et en ont exclu les autres. Ceux qui avaient goûté du gouvernement républicain l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avaient joui du gouvernement monarchique l’ont placée dans la monarchie. Enfin chacun a appelé liberté le gouvernement qui était conforme à ses coutumes ou à ses inclinations ; et comme dans une république on n’a pas toujours devant les yeux, et d’une manière si présente, les instruments des maux dont on se plaint, et que même les lois paraissent y parler plus, et les exécuteurs de la loi y parler moins, on la place ordinairement dans les républiques, et on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme dans les démocraties le peuple paraît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernements, et on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple.
CHAPITRE III. CE QUE C’EST QUE LA LIBERTÉ.
Il est vrai que dans les démocraties le peuple paraît faire ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, et à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir.
Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, et ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir.
CHAPITRE IV. CONTINUATION DU MÊME SUJET.
La démocratie et l’aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les États modérés ; elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir ; mais c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ! la vertu même a besoin de limites.
Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet.
CHAPITRE V. DE L’OBJET DES ÉTATS DIVERS.
Quoique tous les États aient en général un même objet, qui est de se maintenir, chaque État en a pourtant un qui lui est particulier. L’agrandissement était l’objet de Rome ; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des lois judaïques ; le commerce, celui de Marseille ; la tranquillité publique, celui des lois de la Chine ; la navigation, celui des lois des Rhodiens ; la liberté naturelle, l’objet de la police des sauvages ; en général, les délices du prince, celui des États despotiques ; sa gloire et celle de l’État, celui des monarchies; l’indépendance de chaque particulier est l’objet des lois de Pologne ; et ce qui en résulte, l’oppression de tous.
Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S’ils sont bons, la liberté y paraîtra comme dans un miroir.
Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l’a trouvée, pourquoi la chercher ?

De l’esprit des lois - La théorie des climats...
Au Livre XIV, Montesquieu abordera l'étude des causes physiques qui agissent sur les lois positives, ce sera la fameuse "théorie des climats": " S’il est vrai que le caractère de l’esprit et les passions du cœur soient extrêmement différents dans les divers climats, les lois doivent être relatives et à la différence de ces passions, et à la différence de ces caractères". De toutes les théories de Montesquieu, c’est celle du climat et de son influence qui a fait le plus de bruit, c’était la première fois que, dans les temps modernes, on donnait aux causes physiques une action aussi marquée sur la vie des peuples.
"L’air froid resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps ; cela augmente leur ressort, et favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Il diminue la longueur de ces mêmes fibres ; il augmente donc encore par là leur force. L’air chaud, au contraire, relâche les extrémités des fibres, et les allonge ; il diminue donc leur force et leur ressort. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L’action du cœur et la réaction des extrémités des fibres s’y font mieux, les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est plus déterminé vers le cœur, et réciproquement le cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets : par exemple, plus de confiance en soi-même, c’est-à-dire plus de courage ; plus de connaissance de sa supériorité, c’est-à-dire moins de désir de la vengeance ; plus d’opinion de sa sûreté, c’est-à-dire plus de franchise, moins de soupçons, de politique et de ruses. Enfin cela doit faire des caractères bien différents. Mettez un homme dans un lieu chaud et enfermé, il souffrira, par les raisons que je viens de dire, une défaillance de cœur très-grande. Si, dans cette circonstance, on va lui proposer une action hardie, je crois qu’on l’y trouvera très-peu disposé ; sa faiblesse présente mettra un découragement dans son âme ; il craindra tout, parce qu’il sentira qu’il ne peut rien. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards le sont ; ceux des pays froids sont courageux comme le sont les jeunes gens. Si nous faisons attention aux dernières guerres, qui sont celles que nous avons le plus sous nos yeux, et dans lesquelles nous pouvons mieux voir de certains effets légers, imperceptibles de loin, nous sentirons bien que les peuples du nord, transportés dans les pays du midi, n’y ont pas fait d’aussi belles actions que leurs compatriotes, qui, combattant dans leur propre climat, y jouissaient de tout leur courage.
La force des fibres des peuples du nord fait que les sucs les plus grossiers sont tirés des aliments. Il en résulte deux choses : l’une, que les parties du chyle, ou de la lymphe, sont plus propres, par leur grande surface, à être appliquées sur les fibres, et à les nourrir ; l’autre, qu’elles sont moins propres, par leur grossièreté, à donner une certaine subtilité au suc nerveux. Ces peuples auront donc de grands corps et peu de vivacité. Les nerfs, qui aboutissent de tous côtés au tissu de notre peau, font chacun un faisceau de nerfs. Ordinairement ce n’est pas tout le nerf qui est remué, c’en est une partie infiniment petite. Dans les pays chauds, ou le tissu de la peau est relâché, les bouts des nerfs sont épanouis et exposés à la plus petite action des objets les plus faibles. Dans les pays froids, le tissu de la peau est resserré, et les mamelons comprimés ; les petites houppes sont, en quelque façon, paralytiques ; la sensation ne passe guère au cerveau que lorsqu’elle est extrêmement forte, et qu’elle est de tout le nerf ensemble. Mais c’est d’un nombre infini de petites sensations que dépendent l’imagination, le goût, la sensibilité, la vivacité..."
Dans sa Défense de l'Esprit des Lois, Montesquieu reviendra sur sa théorie de climat, "En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines ..."
"Ce que l'auteur a dit sur le climat, est encore une matière très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes : le climat et les autres causes physiques produisent un nombre infini d'effets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on l'auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir si dans des pays éloignés entre eux, si sous des climats différents, il y a des caractères d'esprit nationaux. Or, qu'il y ait de telles différences, cela est établi par l'universalité presque entière des livres qui ont été écrits. Et, comme le caractère de l'esprit indue beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sauroit encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités da cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre; et l'on en a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains de tous les lieux et de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une façon humaine. Il auroit pu joindre là bien des questions que l'on agite dans les écoles sur les vertus humaines et sur les vertus chrétiennes; mais ce n'est point avec ces questions que l'on fait des livres de physique, de politique et de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines : cela choque-t-il l'empire de Celui qui a créé, ou les mérites de Celui qui a racheté?
Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la manière la plus convenable et la plus conforme à son caractère, quel mal a-t-il fait en cela?
On raisonnera de même à l'égard de diverses pratiques locales de religion. L'auteur n'avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises : il a dit seulement qu'il y avoit des climats ou de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c'est-à-dire, étoient plus aisées à pratiquer par les peuples de ces climats que par les peuples d'un autre. De ceci il est inutile de donner des exemples; il y en a cent mille.
Je sais bien que la religion est indépendante par elle- même de tout effet physique quelconque; que celle qui est bonne dans un pays est bonne dans un autre, et qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays sans l'être dans tous; mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes et pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans de certains pays que dans d'autres, et dans de certaines circonstances que dans d'autres : et, dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bon sens.
L'auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs ; mais, dit le critique, les femmes s'y brûlent à la mort de leur mari. Il n'y a guère de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l'esprit humain, et comment il sait séparer les choses les plus unies, et unir celles qui sont les plus séparées? Voyez là-dessus les réflexions de l'auteur, au chapitre III du livre XIV.."

Enfin, au livre XV, Montesquieu attaquera l'esclavage, il est des philosophes dont les textes aboutiront à sa suppression par la Convention en 1794, - "Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique,ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres..." (chapitre V) - et au livre XXV attaquera l'intolérance en matière de religion, l'intolérance des Inquisiteurs d'Espagne et du Portugal...
La tolérance?
LIVRE XXV - CHAPITRE IX. DE LA TOLÉRANCE EN FAIT DE RELIGION.
"Nous sommes ici politiques et non pas théologiens ; et, pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion et l’approuver."
Dans sa "Défense", Montesquieu reviendra sur le sujet de la "tolérance" qu'il s'efforcera d'expliciter, une tolérance dictée par une seule orientation, laisser le plus possible les choses en l'état, aussi diverses soient-elles, et éviter d'introduire toute nouveauté.
"Tout ce que l'auteur nous a objecté sur la tolérance se rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV. « Nous sommes ici politiques et non pas théologiens ; et pour les théologiens mêmes, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, et l'approuver.
« Lorsque les lois de l'État ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent aussi à se tolérer entre elles.» On prie de lire le reste du chapitre.
On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté au chapitre X, livre XXV : « Voici le principe fondamental des lois politiques en fait de religion. Quand on est le maître dans un État de recevoir une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y est établie, il faut la tolérer. »
On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs États à la religion chrétienne : effectivement c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille du roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matière à beaucoup de déclamations, j'y ferai deux réponses. La première, c'est que l'auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chapitre I, à la fin : « La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques et les meilleures lois civiles; parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir. » Si donc la religion chrétienne est le premier bien, et les lois politiques et civiles le second, il n'y a point de lois politiques et civiles dans un état, qui puissent ou doivent y empêcher l'entrée de la religion chrétienne.
Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s'établit pas par les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l'histoire de l'Église, et vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d'entrer dans un pays, elle sait s'en faire ouvrir les portes; tous les instruments sont bons pour cela : quelquefois Dieu veut se servir de quelques pêcheurs ; quelquefois il va prendre sur le trône un empereur, et fait plier sa tête sous le joug de l'Évangile. La religion chrétienne se cache- t-elle dans des lieux souterrains ? Attendez un moment, et vous verrez la Majesté Impériale parler pour elle. Elle traverse, quand elle veut, les mers, les rivières et les montagnes; ce ne sont pas les obstacles d'ici-bas qui l'empêchent d'aller. Mettez de la répugnance dans les esprits, elle saura vaincre ces répugnances : établissez des coutumes, formez des usages, publiez des édits, faites des lois; elle triomphera du climat, des lois qui en résultent, et des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.
On dit : « C'est comme si vous alliez dire aux rois d'Orient qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. » C'est être bien charnel, que de parler ainsi. Étoit-ce donc Hérode qui devoit être le Messie? Il semble qu'on regarde Jésus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un État voisin, cache ses pratiques et ses intelligences. Rendons-nous justice : la manière dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez pure pour penser à l'employer à la conversion des peuples?"
De l’esprit des lois - Partie annexe (XXVII-XXIX), qui répond à cette annonce de l’édition originale de l'Esprit des lois : «... à quoi l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises et sur les loix féodales. » Elle n’intéresse plus aujourd’hui que les spécialistes....
Après la mort de Fleury en 1743, Louis XV décide de ne plus avoir de Premier ministre et de s'occuper lui-même de l'État, il a 33 ans, est d'une intelligence indéniable et ne manque pas de courage, mais il est par tempérament et par éducation terriblement indifférent et blasé; il se montre quelquefois maladroit avec ceux qui ont affaire à lui, renonce souvent à l'action, alors même qu'il la sait nécessaire. Les séances du Conseil l'ennuient - il aime mieux la chasse - et, à la vie de parade, il préfère la vie de famille et la compagnie de ses favorites : ce seront tour à tour la duchesse de Châteauroux, qui de 1742 à. 1745 eut le mérite d'essayer de l'encourager à s'occuper des intérêts de l'État, et, à partir de 1743, Mme Lenormant d'Étioles, une jeune bourgeoise qu'il créa marquise de Pompadour. Cette dernière devint la véritable souveraine des fêtes, des plaisirs et des arts, mais elle prétendit jouer un rôle politique et, en dépit de l'appui qu'elle apporta à Choiseul à la fin du règne de Louis XV, elle contribua surtout à la désorganisation du pouvoir, aggrava le délabrement des finances et rendit le roi impopulaire par ses dépenses excessives.
Pourtant, trois ministres intelligents essayaient de réorganiser la monarchie: le marquis d'Argenson, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, de 1744 à 1747, son frère le comte d'Argenson, secrétaire d'État à la guerre à partir de 1743, et Machault d'Arnouville, contrôleur général des Finances de 1745 à 1756 puis secrétaire d'État à la marine de 1754 à 1757.
La situation internationale s'est transformée en ce qui concerne la succession d'Autriche. L'Angleterre a mis sur pied en faveur de Marie-Thérèse, avec la Hollande puis la Saxe, la ligue de Worms, dirigée contre la France, contre son candidat Charles VII et l'Espagne. Les coalisés passent le Rhin et pénètrent en Alsace. Le roi lui-même prend alors la tête des armées et Frédéric II, en s'alliant à nouveau à la France en 1744, rétablit un équilibre des forces qui arrête l'invasion.
En 1745, les troupes françaises entreprennent la conquête des Pays-Bas et, malgré une nouvelle volte-face de Frédéric II qui signe en 1744 un accord avec Marie-Thérèse, remportent sous le commandement du brillant Maurice de Saxe le grand succès de Fontenoy (1745), en présence du roi, puis les victoires de Raucoux (1746) et de Laufeld (1747). Mais Louis XV se hâte de conclure à. Aix-la-Chapelle, en 1748, une paix qui est surtout avantageuse "pour le roi de Prusse" et dont l'opinion publique fut tout à fait ulcérée...

En 1749, L'Esprit des lois est attaqué avec modération par les jésuites (le Journal de Trévoux, en avril 1749), puis par le financier Dupin, qui se rétracte, puis, très violemment, par les jansénistes (les Nouvelles ecclésiastiques, en octobre 1749). Montesquieu répondit aux premiers dans les "Éclaircissements sur l'Esprit des lois". Il y définit la vertu, principe du gouvernement républicain, et confirme qu'il faut entendre par vertu l'amour de la patrie, de l'égalité et de la frugalité. En 1750, Montesquieu publie une "Défense de l'Esprit des lois" beaucoup plus développée et plus importante que les Éclaircissements.
La bataille littéraire est violente. Montesquieu est défendu par Voltaire, et même par Fréron, mais son livre est dénoncé à l'Assemblée générale du Clergé et à la Faculté de théologie de l'Université de Paris. Il l'est également à Rome, où l'on demande qu'il soit mis à l'index. En 1751, Montesquieu discute avec la Sorbonne, mais à Rome, après de longues tractations, son livre est inscrit à l'Index le 29 novembre. Cependant, Montesquieu est retourné à La Brède.
"Défense de l'Esprit des lois"
"On a divisé cette défense en trois parties. Dans la première, on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l'auteur de L' Esprit des Lois. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisième contient des réflexions sur la manière dont on l'a critiqué. Le public va connoître l'état des choses; il pourra juger.
Quoique L'Esprit des Lois soit un ouvrage de pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur a eu souvent occasion d'y parler de la religion chrétienne : il l'a fait de manière à en faire sentir toute la grandeur; et, s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.
Cependant dans deux feuilles périodiques qui ont paru coup sur coup, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de savoir s'il est spinosiste et déiste ; et, quoique ces deux accusations soient par elles-mêmes contradictoires, on le mène sans cesse de l'une à l'autre. Toutes les deux étant incompatibles ne peuvent pas le rendre plus coupable qu'une seule ; mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.
Il est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué le monde matériel d'avec les intelligences spirituelles.
Il est donc spinosiste, lui qui, dans le second article, a attaqué l'athéisme : «Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité: car, quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle, qui a produit des êtres intelligents?»
Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles : «Dieu a du rapport à l'univers comme créateur et comme conservateur ; les lois selon lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il conserve; il agit selon ces règles, parce qu'il les connoît ; il les connoît, parce qu'il les a faites; il les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec sa sagesse et sa puissance.»
Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté : «Comme nous voyons que le monde formé par le mouvement de la matière et privé d'intelligence" subsiste toujours, etc.»
Il est donc spinosiste, lui qui a démontré contre Hobbes et Spinosa, «que les rapports de justice et d'équité étoient antérieurs à toutes les lois positives ».
Il est donc spinosiste, lui qui a dit au commencement du chapitre second : « Cette loi qui en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur nous porte vers lui est la première des lois naturelles par son importance.»
Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut mieux être athée qu'idolâtre? paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.
Que dit-on, après des passages si formels? Et l'équité naturelle demande, que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation.
PREMIERE OBJECTION.
«L'auteur tombe dès le premier pas. Les lois, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les lois des rapports ! Cela se conçoit-il?... Cependant l'auteur n'a pas changé la définition ordinaire des lois, sans dessein. Quel est donc son but? le voici. Selon le nouveau système, il y a entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le Grand Tout, un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la confusion jusqu'au trône du premier Être. C'est ce qui fait dire à Pope que les choses n'ont pu être autrement qu'elles ne sont, et que tout est bien comme il est. Cela posé, on entend la signification de ce langage nouveau, que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. A quoi l'on ajoute que, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois ; la Divinité a ses lois; le monde matériel a ses lois ; les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois; les bêtes ont leurs lois; l'homme a ses lois. »
RÉPONSE.
Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a ouï dire que Spinosa admettoit un principe aveugle et nécessaire qui gouvernoit l'univers: il ne lui en faut pas davantage : dès qu'il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L'auteur a dit que les lois étoient un rapport nécessaire : voilà donc du spinosisme, parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se trouve spinosiste à cause de cet article, quoique cet article combatte expressément les systèmes dangereux. L'auteur a eu en vue d'attaquer le système de Hobbes, système terrible, qui, faisant dépendre toutes les vertus et tous les vices de l'établissement des lois que les hommes se sont faites, et voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, et que la première loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renverse, comme Spinosa, et toute religion et toute morale. Sur cela l'auteur a établi premièrement, qu'il y avoit des lois de justice et d'équité avant l'établissement des lois positives : il a prouvé que tous les êtres avoient des lois ; que, même avant leur création, ils avoient des lois possibles ; que Dieu lui-même avoit des lois, c'est-à-dire les lois qu'il s'étoit faites. Il a démontré qu'il était faux que les hommes naquissent en état de guerre ; il a fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé qu'après l'établissement des sociétés ; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, et les conséquences de celles de Spinosa, et qu'il lui est arrivé qu'on l'a si peu entendu, que l'on a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu'il fait contre le spinosisme. Avant d'entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l'état de la question, et savoir du moins si celui qu'on attaque est ami ou ennemi...."
Réponse à la Défense de l'Esprit des Lois, 24 avril 1750
"On a répandu dans le public une brochure in -12, qui porte pour titre : Défense de l'Esprit des Lois. L'auteur de cette brochure prétend que nous avons critiqué sans fondement le livre de l'Esprit des Lois, dans nos feuilles des 9 et 16 octobre 1749. Si on l'en croit, « le critique, - en parlant de nous, - n'a vu et ne voit que des mots... Il semble avoir juré de n'être jamais au fait de la question, et de n'entendre pas un seul des passages qu'il attaque... Ses deux feuilles ressemblent à un ouvrage, qui, comme les songes d'un malade, ne fait voir que des fantômes vains... »
Il faut compter beaucoup sur la crédulité d'un lecteur pour hasarder de pareilles forfanteries. Des reproches que l'on a faits à l'auteur de l'Esprit des Lois, il y en a sur lesquels il essaye de se justifier, et ne le fait pas; il y en a sur lesquels il n'ose pas même tenter de se justifier. Commençons par ceux-ci.
Nous avons reproché à l'auteur de l'Esprit des Lois d'avoir dit : «Qu'il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique » : ce qui suppose en Dieu un défaut de sagesse et un manque de puissance. A ce reproche point de réponse. Nous avons reproché à l'auteur d'avoir dit : « Que la vertu n'est point le principe du gouvernement monarchique; que dans les monarchies la politique fait faire les grandes choses, avec le moins de vertu qu'elle peut; que les lois tiennent la place de toutes les vertus héroïques que nous trouvons dans les anciens, et dont nous avons seulement entendu parler; que les monarchies n'en ont aucun besoin; que l'État nous en dispense; que la vertu n'est point nécessaire dans un gouvernement despotique, que l'honneur y seroit dangereux.» Point de réponse. Nous avons reproché à l'auteur d'avoir dit : Que « le monachisme est né dans les pays chauds d'Orient, où l'on est moins porté à l'action qu'à la spéculation ». Nous lui avons reproché d'avoir mis sur la même ligne avec les derviches de la religion mahométane et les pénitents idolâtres des Indes, les moines les plus saints et les plus édifiants de l'Église catholique. Nous avons relevé ce que dit l'auteur, que «dans le midi de l'Europe, les lois qui devroient chercher à ôter tous les moyens de vivre sans travail, donnent à ceux qui veulent être trop oisifs des places propres à la vie spéculative, et y attachent des richesses immenses.» A ces reproches point de réponse...."
1750s - Vers un mécontentement général - Les difficultés financières étaient aiguës dans le royaume de France : Machault d'Arnouville, intendant honnête et travailleur, entreprit de remettre en ordre les caisses publiques en s'attaquant aux privilèges du clergé et de la noblesse; il fit le projet d'un impôt du "vingtième" sur les revenus de tous, pour alimenter une caisse d'amortissement de la dette publique. La résistance du Parlement et du clergé fut très vive; les opposants furent emprisonnés, mais le roi finalement céda aux pressions et fit ordonner en décembre 1751 l'exemption de l'Église, ruinant ainsi l'essentiel de la réforme.
L'apaisement religieux, que le cardinal Fleury avait maintenu tant bien que mal, se trouva rompu dès 1746 par l'affaire des "billets de confession" : certains évêques avaient ordonné à leurs prêtres, pour lutter contre l'hérésie janséniste, d'exiger un billet de confession conforme aux directives contenues dans la bulle Unigenitus avant d'accorder les derniers sacrements; de nombreux incidents provoquèrent des protestations et des émeutes. Le Parlement de Paris saisit l'occasion d'intervenir contre l'archevêque et alla jusqu'à rédiger les Grandes Remontrances. Le roi prit d'abord de sévères mesures, emprisonna et exila des récalcitrants, puis faiblit et demanda l'intervention du pape qui ne suffit pas pour calmer l'agitation; le roi dut accepter en 1757 un véritable compromis où la faiblesse de l'autorité royale et l'existence d'une opposition puissante étaient nettement mises en évidence.
En ces années sombres, la monarchie française semble fléchir partout, Voltaire en fait une synthèse satirique en décrivant un Louis XV sous le "Siècle de Louis XIV" (1751), la paix établie à Aix-la-Chapelle se révèle éphémère; Frédéric II, qui craint d'être isolé, décide de se rapprocher de George II pour le détacher de l`Autriche et le 15 janvier 1756, par le traité de Whitehall, l'Angleterre, le Hanovre - alors possession du roi d'Angleterre - et la Prusse font alliance contre la Russie et la France. Marie-Thérèse, en revanche, fait tous ses efforts pour établir un accord avec Louis XV et le roi saisit l'occasion de cette alliance, conclue à Versailles le Ier mai 1756, pour éviter l'isolement dont il se sent menacé à son tour. Frédéric II, s'étant jeté sans déclaration de guerre sur la Saxe et ayant battu l'armée saxonne, les petits princes allemands indignés se joignirent à la coalition et un second traité de Versailles affermit l'accord entre l'Autriche et la France en 1757. Ainsi, la guerre de Sept Ans s'engagea dans des conditions peu favorables pour le roi de Prusse, mais la situation de la France entraînée dans une conflagration ruineuse sur le continent n'était pas sans péril, au moment où la concurrence de la puissance maritime anglaise se faisait inquiétante et agressive.
Pourtant, c'est la politique intérieure de la monarchie et la vie privée du roi qui provoquèrent le mécontentement général. Depuis la mort de Louis XIV, la diffusion des œuvres philosophiques ("Lettres persanes" et "Considérations sur les Romains" de Montesquieu, "Lettres anglaises" de Voltaire) a développé l'esprit critique : la royauté absolue n'est plus considérée comme la seule forme possible de gouvernement et surtout la politique et la personne même du roi provoquent des protestations et des sarcasmes ; les pamphlets, les manifestations populaires se multiplient.
"On voit s'élever une antipathie extraordinaire entre le roi et son peuple, surtout le peuple de Paris. Dans les émeutes du mois de mai dernier, tout le peuple révolté vomit à foison des propos exécrables contre le roi", écrit le marquis d'Argenson dans ses Mémoires à la date du 23 juillet 1750.
Un article du Dictionnaire portatif, dont Voltaire eut l'idée dès 1757 et qu'il enrichit constamment, traduit bien ce développement d'une opinion publique de plus en plus consciente des injustices et des insuffisances du temps, qui réclame la liberté d'information et de pensée...
"LIBERTÉ D 'IMPRIMER -- On a imprimé 5 à 6 000 brochures en Hollande contre Louis XIV; aucune n'a contribué à lui faire perdre les batailles de Blenheim, de Turin et de Ramillies.
En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls,
risques et fortunes. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé; je n'en connais point qui ait fait de mal réel. Des théologiens ou de prétendus politiques crient : "La religion est
détruite, le gouvernement est perdu, si vous imprimez certaines vérités ou certains paradoxes". Ne vous avisez jamais de penser qu'après en avoir demandé la licence à un moine ou à un commis. Il est contre le bon ordre qu'un homme pense par soi-même. Homère, Platon, Cicéron, Virgile, Pline, Horace n'ont jamais rien publié qu'avec l'approbation des docteurs de Sorbonne et de la Sainte Inquisition.
Voyez dans quelle décadence horrible la liberté de la presse a fait tomber l'Angleterre et la Hollande! Il est vrai qu'elles embrassent le commerce du monde entier et que l'Angleterre est victorieuse sur terre et sur mer; mais ce n'est qu'une fausse grandeur, une fausse opulence, elles marchent à grands pas à leur ruine. Un peuple éclairé ne peut subsister...
Non, Rome n'a point été vaincue par des livres; elle l'a été pour avoir révolté l'Europe par ses rapines, par la vente publique des indulgences; pour avoir insulté aux hommes pour avoir voulu les gouverner comme des animaux domestiques, pour avoir abusé de son pouvoir à un tel excès qu'il est étonnant qu'il lui soit resté un seul village. Henri VIII, Elisabeth, le duc de Saxe, le landgrave de Hesse, les princes d'Orange, les Condé, les Coligny ont tout fait, et les livres rien. Les trompettes n'ont jamais gagné de batailles et n'ont fait tomber de murs que ceux de Jericho. Vous craignez les livres comme certaines bourgades ont craint les violons. Laissez lire, et laissez danser, ces deux amusements ne feront jamais de mal au monde....."

Dans la deuxième partie de sa Défense de l'esprit des lois, Montesquieu se demande si en fin de compte ceux qui tentent de le censurer ont réellement lu son livre, et peut-être en effet nul à son époque ne l'a réellement lu, dans un contexte où la question religieuse emporte le politique, trop en avance qu'il est sur son temps et en décalage avec les évènements et les idées philosophiques qui s'emparent en profondeur du débat publique...
«Les gens les plus sensés de divers pays de l'Europe, les hommes les plus éclairés et les plus sages, ont regardé le livre de l'Esprit des Lois comme un ouvrage utile : ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes, qu'il étoit propre à former d'honnêtes gens, qu'on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu'on y encourageoit les bonnes.
D'un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d'un livre dangereux; il en a fait le sujet des invectives les plus outrées. Il faut que j'explique ceci.
Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il critiquoit dans ce livre, il n'a pas seulement su quelle étoit la matière qui y étoit traitée : ainsi, déclamant en l'air, et combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espèce : il a bien critiqué le livre qu'il avoit dans la tête, il n'a pas critiqué celui de l'auteur.
Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les yeux? Ceux qui auront quelques lumières verront du premier coup d'œil que cet ouvrage a pour objet les lois, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense, puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes; puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il examine celles qui conviennent le plus à la société, et à chaque société ; qu'il en cherche l'origine; qu'il en découvre les causes physiques et morales; qu'il examine celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes, et celles qui n'en ont aucun; que de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus et celle qui l'est moins ; qu'il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, et de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion : car, y ayant sur la terre une religion vraie et une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel et une infinité d'autres qui sont nées sur la terre, il n'a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines : ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n'a eu qu'à l'adorer, comme étant une institution divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il devoit traiter; parce que, par sa nature, elle n'est sujette à aucun examen : de sorte que, quand il en a parlé, il ne l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage , mais pour lui payer le tribut de respect et d'amour qui lui est dû par tout chrétien ; et, pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvoit faire avec les autres, il pût la faire triompher de toutes.
Ce que je dis se voit dans tout l'ouvrage ; mais l'auteur l'a particulièrement expliqué au commencement du livre vingt-quatrième, qui est le premier des deux livres qu'il a faits sur la religion. Il le commence ainsi : « Comme on peut juger parmi les ténèbres celles qui sont les moins épaisses, et parmi les abîmes ceux qui sont les moins profonds; ainsi l'on peut chercher entre les religions fausses, celles qui sont les plus conformes au bien de la société, celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet de mener les hommes aux félicités de l'autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.
« Je n'examinerai donc les diverses religions du monde que par rapport au bien que l'on en tire dans l'État civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre. »
L'auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des institutions humaines, a dû en parler, parce qu'elles entroient nécessairement dans son plan. Il n'a point été les chercher, mais elles sont venues le chercher. Et, quant à la religion chrétienne, il n'en a parlé que par occasion; parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n'entroit point dans le plan qu'il s'étoit proposé.
Qu'a-t-on fait pour donner une ample carrière aux déclamations, et ouvrir la porte la plus large aux invectives? On a considéré l'auteur comme si, à l'exemple de M. Abbadie', il avoit voulu faire un Traité sur la religion chrétienne : on l'a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux Traités de théologie chrétienne : on l'a repris comme si, parlant d'une religion quelconque, qui n'est pas la chrétienne, il avoit eu à l'examiner selon les principes et les dogmes de la religion chrétienne : on l'a jugé comme s'il s'étoit chargé, dans ses deux livres, d'établir pour les chrétiens, et de prêcher aux mahométans et aux idolâtres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes les fois qu'il a employé le mot de religion, on a dit : « C'est la religion chrétienne. » Toutes les fois qu'il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, et qu'il a dit qu'elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays que telle autre pratique, on a dit : « Vous les approuvez donc, et vous abandonnez la foi chrétienne. » Lorsqu'il a parlé de quelque peuple qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jésus-Christ, on lui a dit : a Vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne.» Quand il a examiné en écrivain politique quelque pratique que ce soit, on lui a dit : «C'étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte; et je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne ; mais c'est pour vous cacher que vous les dites; car je connois votre cœur, et je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre livre ; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet dans lequel il a été écrit ; mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de ce que vous dites; mais j'entends très-bien ce que vous ne dites pas. »

En 1753, Montesquieu est directeur de l'Académie française. Il écrit l'article Goût pour l'EncycIopédie de Diderot et d'Alembert. En 1754, après avoir passé l'été à La Brède, Montesquieu décide de retourner une dernière fois à Paris avant de revenir chez lui définitivement. Il arrive à Paris fin décembre.
Mais en janvier 1755, Montesquieu tombe malade. Son état devient bientôt grave. Il se confesse à un père jésuite et proclame sa fidélité à la religion, mais défend ses papiers contre son confesseur. Il meurt, entouré d'amis, le lundi 10 février. Le lendemain, à 5 heures du soir, il est enterré dans l'église Saint-Sulpice. Seul de tous les "philosophes", Diderot assiste à son enterrement.
L'attentat de Damiens contre le roi en 1757, qui ne fut après tout que le geste d'un exalté, apparut caractéristique d'une grande exaspération des esprits et des nerfs. Le gouvernement crut bon d'exiler et d'envoyer aux galères des écrivains. Dans l'immédiat, cet attentat permit à Mme de Pompadour d'obtenir du roi la disgrâce de Machault et d'Argenson....
Ce que Descartes avait fait pour la philosophie, avec son Discours de la méthode, Pascal pour la théologie, avec ses Provinciales, Fontenelle pour les sciences, avec ses Entretiens sur la pluralité des mondes, Montesquieu l’a fait pour le droit et la législation. Aussi vigoureusement que quiconque, il a dénoncé les abus tant dans l’ordre politique que dans l’ordre social. Ses attaques contre le despotisme, ses protestations contre la barbarie dans les peines, contre l’esclavage - et en cela il a été réellement novateur -, contre l’intolérance religieuse, ses revendications au sujet du devoir d’assistance de l’État envers les malheureux, ont été formulées avec une clarté de vues remarquable. Mais loin de se borner à critiquer, Montesquieu a également eu l’ambition de reconstruire : il a examiné les diverses formes de gouvernement et déterminé celle qui lui semblait la plus compatible avec l’état de la société de son temps. Aussi éloigné de l’illusion que de l’utopie, il a choisi ses matériaux dans la réalité, et a rêvé d’introduire dans notre monarchie les principes de la Constitution anglaise. C’est de ses idées que devaient s’inspirer plus tard les auteurs de la Constitution de 1791....
Mais la grande vague des "philosophes" a balayé pour un temps bien des idées encore fragiles...
