- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Arthur Schnitzler (1862-1931), "Sterben" (1892), "Frau Bertha Garlan (1900), "Leutnant Gustl" (1900), "Frau Beate und ihr Sohn" (1913), "Fräulein Else" (1924), "Traumnovelle" (1926), "Der Weg ins Freie" (1907, Vienne au crépuscule), "Therese. Chronik eines Frauenlebens" (1928) - Hermann Bahr (1863-1934) - Hugo Hofmannsthal (1874-1929) - Peter Altenberg (1859-1919) - ...
Last update: 12/20/2016
Schnitzler est, à Vienne des années 1895-1928, le peintre des amours de passage et des relations éphémères. Mais plus encore, en terme de technique littéraire, il est l'un des premiers à introduire le monologue intérieur. Ce monologue qui semble si spontané, est en fait extraordinairement structuré et renvoie à ce fameux procédé de libre association que Freud mettait alors à jour. Privé de narration, le lecteur est alors mis au défi de lire entre les lignes. Le sujet? Schnitzler est parmi ceux qui ont su évoquer d'une manière si troublante et si sensible les méandres du coeur féminin. Douloureuses et tragiques destinées de femmes que celles de ses héroïnes, Mlle Else, Berthe Garlan, Anna, Thérèse, leur quête malheureuse de l'amour les conduit inexorablement à mourir de honte ou de chagrin ...

Reinhold Völkel (1873-1938), le café Griensteidl, Vienne, 1896, fréquenté par Arthur Schnitzler, Peter Altenberg, le maître de l'esquisse et de la tranche de vie (Wie ich es sehe, 1896), Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, tout autant que Gustav Klimt ou Adolf Loos (Historisches Museum der Stadt, Vienne).

Arthur Schnitzler (1862-1931)
Les oeuvres d'Arthur Schnitzler ont suscité beaucoup de controverses, principalement à cause de la description qu'il y fait de la sexualité. Il a, longtemps après sa mort, été qualifié de pornographe. Ecrivain et critique, Arthur Schnitzler suit très tôt les traces de son père, grand médecin juif, et étudie la médecine et la psychiatrie à l'université de Vienne. Sigmund Freud devient l'un de ses amis et, sensible à sa plume, le pousse à écrire. Il débute la rédaction de pièces de théâtre qui sont jouées à Prague. En 1892, Hermann Bahr, Hugo Hofmannsthal et Arthur Schnitzler se fréquentent à Vienne. En 1895, "Libelei" lui assure une solide notoriété en Autriche et en Allemagne. Il abandonne alors son poste à l'hôpital, mais garde quelques patients. "La Ronde" (créée seulement en 1920) fit longtemps scandale par sa structure et son sujet : chaque nouveau personnage devient l'amant ou la maîtresse du personnage précédent, qui s'efface alors, chacun des partenaires de la « ronde » révélant l'inanité de l'idéal.
Lorsque la monarchie des Habsbourg s'effondre, Arthur Schnitzler passe de l'écriture de pièces à la fiction. "Vienne au crépuscule" (1908) évoque les difficultés de la création chez un musicien hanté par l'échec, tout en évoquant de manière ouverte l'antisémitisme de la société autrichienne. "Thérèse" (1928) raconte l'échec d'une femme dans sa lutte pour échapper à l'étroitesse bourgeoise.
Mais Schnitzler demeure avant tout l'auteur de très nombreuses nouvelles, à travers lesquelles il expérimente toutes les potentialités de la forme. Il utilise la forme du monologue intérieur dès 1901, dans "Lieutenant Gustl" puis dans "Mademoiselle Else" (1924). Nombre de ses nouvelles ont pour héros des êtres velléitaires, hantés par la mort ou la folie comme dans l'une de ses dernières œuvres, "l'Appel des ténèbres" (1931), représentation vertigineuse d'une conscience paranoïaque. Freud voyait en lui une sorte de « double » : Schnitzler, qui se démarque de la théorie psychanalytique en élaborant sa propre réflexion sur l'inconscient, la rejoint cependant par son inlassable exploration du psychisme.
Le suicide de sa fille le marque profondément marqué, il meurt un an plus tard en 1931. En 1933, Goebbels organise des autodafés à Berlin et les oeuvres de l'écrivain autrichien, comme ceux de nombreux intellectuels juifs, partent en fumée.

Son théâtre : Liebelei (1896, Amourette), Reigen (La Ronde, 1897), Der einsame Weg (1903, Le Chemin solitaire), Das weite Land (1911, Terre
étrangère). Ses premières pièces de théâtre, Anatole (1892), Amourette (1895), reflètent l'atmosphère viennoise typique, mélange de
mélancolie et de grâce heureuse, de scepticisme et d'ironie mondaine, de sentimentalité et de passion. Schnitzler a un sens très particulier des mouvements de l'âme et des choses qu'il traite
avec une élégance brillante et un art tout impressionniste. Dans ses drames l'action est subordonnée à la mobilité d'un dialogue complexe; aussi aime-t-il particulièrement les pièces en un acte
ou les récits.
Ses nouvelles : Sterben (1892, Mourir), Frau Bertha Garlan (1900, Berthe Garlan), Leutnant Gustl (1900, Le Sous-lieutenant Gustel), Die Fremde (1902,
L'Étrangère), Frau Beate und ihr Sohn (1913, Madame Béate et son fils), Casanovas Heimfahrt (1918, Le Retour de Casanova), Fräulein Else (1924, Mademoiselle Else), Traumnovelle (1926, La Nouvelle
rêvée), Spiel im Morgengrauen (1926, Les Dernières Cartes).
Ses romans: Der Weg ins Freie (1907, Vienne au crépuscule), Therese. Chronik eines Frauenlebens (1928).

"Amourette" (Libelei, 1895)
Dans ce drame représenté en 1895, Schnitzler, pour la première fois, va puiser son inspiration dans le monde de la petite bourgeoisie viennoise, un monde qui lui suggéra par la suite certains de ses personnages les plus émouvants de son oeuvre. Fritz Lobheimer est l'amant d'une dame de la bonne société viennoise. L'ami de Fritz, Théodore Kaiser, veut le persuader de rompre cette liaison dangereuse, dans laquelle il y a plus de snobisme et de vanité que de sentiment et de sensualité. Il le pousse à se consacrer plutôt à une de ces amourettes passagères qui commencent sans difficultés et se dénouent sans tourments inutiles. Dans ce dessein, il fait connaître à Fritz l'amie de sa Mitzi, la douce Christine, fille d'un vieux mandoliniste qui bien vite se rend compte de ce qui se passe, mais n'a pas le courage d'entraver les désirs de sa fille. Son âme est encore assombrie par le souvenir de sa propre sœur qui, ayant été gardée par lui avec une farouche jalousie, a fini par se faner sans un seul sourire. Christine aime Fritz et, se croyant aimée, est heureuse. Mais un soir, tandis que les deux jeunes couples dînent ensemble en toute gaieté, arrive le mari outragé de la dame avec laquelle Fritz a une relation amoureuse. Avant découvert leur liaison, il entend demander réparation et se battre avec son rival. Fritz accepte le duel et meurt sur le terrain. Trois jours plus tard, Théodore, vêtu de noir, vient annoncer la mort de Fritz à Christine. Cette nouvelle brise le cœur de la jeune fille. Elle comprend alors qu'elle n'a été pour Fritz qu'un jouet, une amourette sans conséquence alors qu'elle l'aimait véritablement. Elle courra, désespérée, se jeter sur sa tombe et et son père pressent qu'elle ne reviendra plus jamais...

Max Ophüls adapta au cinéma "Libelei" en 1933, avec Magda Schneider (Christine Weiring), Wolfgang Liebeneiner (le lieutenant Fritz Lobheimer), Paul Hörbiger (Hans Weiring), Luise Ullrich (Mizzi Schlager), Olga Tchekowa (la baronne von Eggerdorff), Gustaf Gründgens (le baron von Eggerdorff), Willy Eichberger (Théo Kaiser)...

Lieutenant Gustl (Leutnant Gustl, 1901)
A travers les réflexions d'un sous-officier qui envisage de se suicider à l'aube pour un point d'honneur (et qui finit par y renoncer), Arthur Schnitzler remet en cause les conventions et les préjugés sur lesquels repose la société viennoise d'avant-guerre. Si, ce soir-là, on n'avait pas offert au jeune lieutenant Gustel un billet pour assister à un concert, il n'aurait pas eu l'occasion, au vestiaire, d'injurier le boulanger Habetswallner qui l'injurie à son tour et file avant que l'arroseur arrosé n'ait eu le temps de réagir... Etrange hasard qui crée l'offense dont la seule issue est le suicide, car demande-t-on réparation à un boulanger quand on est jeune officier de l'armée autrichienne, royale et impériale ? Se tirer une balle dans la tête ? Certes la décision est prise, mais, comme l'heure du suicide est fixée à l'aube, Gustel dispose de toute la nuit pour faire défiler les personnages proches et les moments marquants qui ont rythmé sa vie. Vie dérisoire ? Peut-être. Mais combien difficile à quitter ...
"Combien de temps ça va encore durer?,.. Il faut que je regarde ma montre... probable que ça n’se fait pas dans un concert aussi sérieux. Mais qui donc le verra? Si quelqu’un le voit, c’est qu’il ne fait pas plus attention que moi, et alors y a pas de raison que je me gêne pour lui... Neuf heures un quart, seulement? J’ai l’impression d’être à ce concert depuis au moins trois heures. Faut dire que j’ai pas l’habitude... Qu’est- ce que c’est, au fait? Il faut que je regarde le programme... Ah. voilà : oratorio? J'aurais plutôt dit une messe. C’est bon pour l’église, ces choses-là. Et puis l’avantage de l'église, c’est qu’on peut filer quand on veut. — Si au moins j’avais une place en bout de rangée ! — Patience, patience! Tout a une fin, même les oratorios! Peut-être que c'est très beau et que c’est moi qui ne suis pas d’humeur? Et pourquoi il faudrait que je sois d’humeur? Quand je pense que je suis venu ici pour me distraire... J’aurais dû donner le billet à Benedek, il aime ces choses-là lui ; il joue du violon. Mais alors c’est Kopetzky qui aurait été vexé. C’était vraiment très gentil de sa part, en tout cas l’intention y était. Un brave type, ce Kopetzky. Le seul sur qui on peut compter... C’est parce que sa sœur chante là-haut avec les autres. Au moins cent jeunes filles, et toutes habillées en noir ; comment est-ce que je pourrais la repérer ? ! C’est parce qu elle chante ici qu’il a eu le billet, Kopetzky... Pourquoi donc il n’y est pas allé lui-même? — Elles chantent très bien, d’ailleurs. C’est très émouvant — mais oui, bravo, bravo! C’est ça, applaudissons aussi. Le bonhomme à côté de moi tape dans ses mains comme un fou. Ça lui plaît vraiment tant que ça ? — La fille dans la loge de l’autre côté est très jolie. C’est moi qu’elle regarde, ou c’est le monsieur là-bas avec la barbe blonde? Ah, un solo. Qui c’est? Alto : Mademoiselle Walker, soprano Mademoiselle Michalek... c’est sûrement la soprano... Ça fait un bai que j’ai pas été à l’Opéra. À l’Opéra, je trouve toujours à me diverti même quand c’est ennuyeux. Je pourrais d’ailleurs y retourner après-demain, pour la Traviata. Oui, mais après-demain, je ne serai peut-être plus qu’un cadavre bien mort! Mais non, n’importe quoi, j’y crois pas moi-même ! Attendez un peu, mon cher Docteur, je vais vous faire passer l’envie de faire des remarques de ce genre ! Je m’en vais vous trancher je bout du nez...
Si seulement je pouvais mieux voir cette fille, dans la loge ! J’emprunterais bien les jumelles du monsieur à côté de moi, mais il est capable de me bouffer tout cru si je le dérange dans son recueillement... Dans que. coin se trouve la sœur de Kopetzky? Est-ce que je la reconnaîtrais? Mas je ne l’ai vue que deux ou trois fois, la dernière, c’était au cercle des officiers... Est-ce que ce sont toutes des jeunes filles convenables, toutes les cent? Hoho, s'il vous plaît... -Avec la participation de la chorale - Chorale... C’est drôle, je m’étais toujours imaginé que c’était les chanteuses du Ballet de Vienne, enfin, je veux dire, bien sûr, je savais que c’était autre chose!... Ah, quels souvenirs! C’était Zum Grünen Tor ... Comme s’appelait-elle donc? Et puis un jour elle m’a envoyé une carte postale de Belgrade... un beau coin ça aussi! — Quel veinard, ce Kopetzky. dire que ça fait longtemps qu'il est au café à fumer son Virginia!...
Qu’est-ce qu’il a donc à me regarder comme ça, ce type? J’ai l’impression qu’il voit que je m’ennuie et que je n’ai rien à faire ici... Je vous conseille de prendre un air un peu moins insolent, sinon, on s’expliquera tout à l’heure au Foyer! — Il détourne déjà la tête!... Pas un qui ait le courage de soutenir mon regard ! «Tu as les plus beaux yeux que j’aie jamais vus!» C’est Steffi qui m’a dit ça, l’autre jour... O Steffi. Steffi, Steffi ! — En fait, c’est la faute de Steffi si je suis ici à supporter ces jérémiades pendant des heures. — Ah, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs, cette façon qu’elle a de m’envoyer promener tout le temps ! Ça aurait pu être une si belle soirée ! J’aurais bien envie de lire la petite lettre de Steffi. Je l’ai sur moi. Mais si je sors mon portefeuille, le type à côté de moi va me bouffer tout cru ! — Je sais bien ce qu’il y a dedans... elle ne peut pas venir parce qu’elle doit aller dîner avec « lui »... Ah, c’était comique, il y a huit jours, elle avec lui à la Gartenbaugesellschaft, et moi en face d’eux avec Kopetzky..."

Mademoiselle Else (Fräulein Else, 1924)
Arthur Schnitzler utilise une fois de plus le monologue intérieur pour mettre à nu, sur un mode dramatique, les pulsions cachées de l'héroïne Mademoiselle Else. Discours entendu, discours parlé, discours silencieux s'entrecroisent sans cesse à travers les réflexions des protagonistes. « Une jeune fille de la bourgeoisie viennoise, en villégiature avec sa tante dans un palace italien, apprend que son père, ruiné à la suite de malversations financières, ne pourra être sauvé du déshonneur et de la prison que si elle parvient à soutirer à un ancien ami de la famille, le marchand d’art Dorsday, une somme importante. Celui-ci lui promet l’argent à la condition qu’il puisse la contempler nue. Le vieux Dorsday répugne à Else et sa proposition déclenche chez elle un délire qui trouvera son épilogue grandiose dans la scène où elle se déshabille dans les salons de l’hôtel avant de se donner la mort en absorbant des somnifères. »
(I) "Tu ne veux vraiment plus jouer, Else ? - « Non, Paul, je n'en peux plus. À tout à l'heure. Au revoir, chère Madame. » - «Mais enfin, Else, ne m'appelez pas toujours Madame. Dites Cissy, tout simplement.» - «Au revoir, Madame Cissy. » - «Pourquoi partez-vous déjà, Else ? Il nous reste deux bonnes heures avant le dîner. ›› - «Jouez votre simple avec Paul, Madame, moi je vous gâcherais votre plaisir, aujourd'hui. » - «Laissez-la, chère Madame, elle fait du genre, c'est son jour. Un genre d 'ailleurs qui te va à ravir, Else... Et ton sweater rouge, encore mieux. ›› - «J'espère que tu auras plus de succès avec le genre bleu, Paul. À tout à l'heure.»
Das war ein ganz guter Abgang. Hoffentlich glauben die Zwei nicht, daß ich eifersüchtig bin. - Daß sie was miteinander haben, Cousin Paul und Cissy Mohr, darauf schwör' ich. Nichts auf der Welt ist mir gleich- gültiger. - Nun wende ich mich noch einmal um und winke ihnen zu. Winke und lächle. Sehe ich nun gnädig aus? - Ach Gott, sie spielen schon wieder. Eigentlich spiele ich besser als Cissy Mohr; und Paul ist auch nicht gerade ein Matador. Aber gut sieht er aus — mit dem offenen Kragen und dem Bösen-Jungen-Gesicht. Wenn er nur weniger affektiert wäre. Brauchst keine Angst zu haben, Tante Emma . . .
Was für ein wundervoller Abend! Heut' war' das richtige Wetter gewesen für die Tour auf die Rosetta-Hütte. Wie herrlich der Cimone in den Himmel ragt!
- Um fünf Uhr früh war' man aufgebrochen. Anfangs war' mir natürlich übel gewesen, wie gewöhnlich. Aber das verliert sich. - Nichts köstlicher als das Wandern im Morgengrauen. - Der ein- äugige Amerikaner auf der Rosetta hat aus- gesehen wie ein Boxkämpfer. Vielleicht hat ihn beim Boxen wer das Aug' ausgeschla- gen. Nach Amerika würd' ich ganz gern heiraten, aber keinen Amerikaner. Oder ich heirat' einen Amerikaner und wir leben in Europa. Villa an der Riviera. Marmorstufen ins Meer. Ich liege nackt auf dem Marmor.
- Wie lang ist'a her, daß wir in Mentone waren? Sieben oder acht Jahre. Ich war dreizehn oder vierzehn. Ach ja, damals waren wir noch in besseren Verhältnissen. - Es war eigentlich ein Unsinn die Partie aufzuschieben. Jetzt wären wir jedenfalls schon zurück. - Um vier, wie ich zum Tennis gegangen bin, war der telegraphisch angekündigte Expreßbrief von Mama noch nicht da. Wer weiß, ob jetzt. Ich hätt' noch ganz gut ein Set spielen können. - Warum grüßen mich diese zwei jungen Leute? Ich kenn' sie gar nicht. Seit gestern wohnen sie im Hotel, sitzen beim Essen links am Fenster, wo früher die Holländer gesessen sind. Hab ? ich ungnädig gedankt? Oder gar hochmütig? Ich bin's ja gar nicht. Wie sagte Fred auf dem Weg vom ,Coriolan' nach Hause? Frohgemut. Nein, hochgemut. Hochgemut sind Sie, nicht hochmütig, Else. - Ein schönes Wort. Er findet immer schöne Worte. - Warum geh' ich so langsam? Furcht' ich mich am Ende vor Mamas Brief? Nun, Angenehmes wird er wohl nicht enthalten. Expreß! Vielleicht muß ich wieder zurückfahren. O weh. Was für ein Leben — trotz rotem Seidensweater und Seidenstrümpfen. Drei Paar! Die arme Verwandte, von der reichen Tante eingeladen. Sicher bereut sie's schon. Soll ich's dir schriftlich geben, teuere Tante, daß ich an Paul nicht im Traum denke? Ach, an nie- manden denke ich. Ich bin nicht verliebt. In niemanden. Und war noch nie verliebt. Auch in Albert bin ich's nicht gewesen, ob- wohl ich es mir acht Tage lang eingebildet habe. Ich glaube, ich kann mich nicht ver- lieben. Eigentlich merkwürdig. Denn sinnlich bin ich gewiß. Aber auch hochgemut und ungnädig Gott sei Dank. Mit dreizehn war ich vielleicht das einzige Mal wirklich verliebt. .."
Une assez belle sortie. J 'espère qu'ils ne me croient pas jalouse... Je jurerais qu'ils ont une liaison, cousin Paul et Cissy Mohr. Rien au monde ne m'indiffère davantage... Je me retourne et leur adresse un signe de la main. Un signe de la main et un sourire. Ai-je l'air de faire du genre maintenant ?... Dieu, ça y est, ils jouent. En fait, je joue mieux que Cissy Mohr; et Paul non plus n'est pas vraiment un matador. Il a une belle allure pourtant... avec son col ouvert et sa tête de méchant garçon. Si seulement il était moins affecté. Tu n'as rien à craindre, tante Emma...
Quelle magnifique fin de journée! Le temps aurait été idéal pour escalader le Rosetta, jusqu'au refuge. Qu'il est majestueux, le Cimone, dressé dans ce ciel !... Nous nous serions mis en route à cinq heures. J'aurais eu mal au cœur, comme d'habitude. Après, ça passe... Il n'y a rien de plus sublime que de marcher dans l'aurore... L'Américain borgne, sur le Rosetta, avait l'air d'un boxeur. C'est peut-être à la boxe qu'on lui a crevé l'œil. J'aimerais assez me marier en Amérique, mais pas avec un Américain. Ou alors je me marie avec un Américain, et nous vivrons en Europe. Villa sur la Riviera, escalier de marbre plongeant dans la mer. Moi, étendue nue sur le marbre...
Il y a combien de temps que nous étions à Menton? Sept ou huit ans. J'en avais treize ou quatorze. Ah, nous connaissions des jours meilleurs, alors... C'était idiot de remettre notre ascension. Nous serions déjà rentrés. À quatre heures, quand je suis allée au tennis, cet exprès annoncé par Maman dans son télégramme n'était pas arrivé. Maintenant, peut-être, qui sait. J'aurais pu encore jouer largement un set... Pourquoi ces deux jeunes gens me saluent-ils ? Je ne les connais pas. Ils sont à l'hôtel depuis hier, ils prennent leurs repas à gauche, près de la fenêtre, à la table où étaient assis les Hollandais. Ai-je fait du genre pour les remercier? Ai-je fait la fière ? Je ne le suis pas. Comment Fred m'a-t-il appelée après Coríolan, en me raccompagnant? Allègre. Non, altière. Vous êtes altière, Else, pas fière... Belle expression. Il trouve toujours de belles expressions... Pourquoi je marche si lentement? Aurais-je peur de la lettre de Maman? Elle ne m'apprendra rien d'agréable, c'est certain. Un exprès! Peut-être faudra-t-il que je rentre. Quelle pitié! Quelle vie, en dépit de mon sweater en soie rouge et de mes bas de soie. Trois paires! La parente pauvre que sa riche tante invite. Elle le regrette sûrement. Tu le voudrais noir sur blanc, chère Tante, que je ne pense pas à Paul, pas même en rêve? Je ne pense à personne. Je ne suis pas amoureuse. De personne. Et je ne suis encore jamais tombée amoureuse. D'Albert non plus; je le croyais pourtant, une illusion de huit jours. Je dois être incapable de tomber amoureuse. C'est curieux, au fond. Je suis sensuelle, il n'y a pas de doute. Mais aussi altière, Dieu merci, et du genre distant! À treize ans j'ai dû tomber amoureuse, la seule et unique fois. ..."
(..) Il faut que je regarde où je marche. Le chemin est dans le noir. C`est curieux, je me sens mieux que tout à l`heure. Rien n'a changé, et pourtant je me sens mieux. Quel était ce rêve? Un matador? Quel était ce matador? L'hôtel est plus loin que je ne pensais. Ils seront encore tous à table. Je vais m'asseoir tranquillement, dire que j'ai eu une migraine, et me faire servir le menu. Monsieur von Dorsday viendra de lui-même à ma table pour me dire que ce n'était qu'une plaisanterie. Pardonnez, mademoiselle Else, pardonnez cette piètre plaisanterie, j`ai d`ores et déjà télégraphié à ma banque. Mais non, il ne le dira pas. Il n'aura pas télégraphié. Rien n'a changé. Il attend. Monsieur von Dorsday attend. Non, je ne veux pas le voir. Je ne peux plus le voir. Je ne veux plus voir personne. Plus retourner à l'hôtel, plus rentrer à la maison. Je ne veux pas retourner à Vienne, je ne veux aller chez personne, personne, ni Papa ni Maman, ni Rudi ni Fred, ni Bertha ni Tante Irène. C'est encore elle la mieux, elle comprendrait tout. Mais je n'ai plus rien à faire avec elle, ni avec personne. Si j'étais magicienne, je me transporterais au loin, dans un autre coin du monde. Sur un magnifique bateau en pleine Méditerranée, mais pas seule. Avec Paul, par exemple. Ça me plairait assez. Ou bien j'habiterais une villa au bord de la mer, nous serions allongés sur l'escalier de marbre qui plonge dans l'eau, il me tiendrait serrée dans ses bras et me mordrait les lèvres, comme Albert il y a deux ans, l'impertinent, près du piano. Non. J'aimerais m`allonger seule sur cet escalier de marbre, au bord de la mer, et attendre. Il arriverait un garçon ou plusieurs. J'aurais le choix : les autres, dédaignés par moi, de désespoir se jetteraient dans la mer. Ou bien ils patienteraient jusqu'au lendemain. Quelle vie délicieuse. À quoi me serviraient, sinon, mes magnifiques épaules et mes belles jambes. Et à quoi me servirait-il d'être sur terre? Ils n'auraient que ce qu`ils méritent tous, ils m'ont éduquée avec un seul objectif : que je me vende, de n'importe quelle façon! Le théâtre, ils ne voulaient pas en entendre parler! Ils se sont moqués de moi. Mais il leur aurait bien plu, l'an passé, que j'épouse Wilomitzer, ce patron bientôt quinquagénaire. Tout juste s'ils ne m'ont pas forcé la main. Papa a quand même eu honte... Mais Maman y a fait très nettement allusion.
Qu'il est immense, cet hôtel, on dirait une gigantesque forteresse enchantée, tout illuminée. Tout est géant. Les montagnes aussi. De quoi prendre peur. Jamais elles n'ont été si noires. La lune n'est pas levée. Elle ne se lèvera que pour le spectacle, le grand spectacle sur le pré, quand monsieur von Dorsday fera danser nue son esclave. Mais qu'ai-je à faire de monsieur von Dorsday? Allons, mademoiselle Else, que d'histoires'?! Vous qui vous apprêtiez à filer, à devenir la maîtresse d'inconnus, les uns après les autres. La bagatelle que monsieur von Dorsday vous demande vous coûterait donc tellement? Vous étiez prête à vous vendre pour un collier de perles, de belles robes, une villa au bord de la mer? Et la vie de votre père compterait moins pour vous ?... Ce serait pourtant un bon commencement. La justification de tout ce qui arrivera par la suite. C'est vous qui avez fait ça de moi, pourrais-je dire, c'est vous qui êtes responsables, tous, de ce que je suis devenue, pas seulement Papa et Maman. Rudi aussi et Fred, et tout le monde, tout le monde, puisque personne ne se soucie de moi. Un peu de tendresse quand vous êtes jolie, un peu de sollicitude quand vous avez de la fièvre; ils vous envoient à l'école et vous offrent des leçons de piano et de français; l`été, vous partez en villégiature, pour votre anniversaire vous recevez des cadeaux et à table ils parlent de n'importe quoi. Mais, de ce qui se passe en moi, de ce qui ronge et s'effraie en moi, vous en êtes-vous jamais préoccupés? Dans le regard de Papa, une intuition passait parfois, vite envolée. Et aussitôt revenaient son travail, ses soucis, le boursicotage... et sans doute une femme, dans le plus grand des secrets, «pas très distinguée, entre nous »... et moi, j'étais seule à nouveau. Eh bien, que ferais-tu, Papa, que ferais-tu aujourd'hui si je n'existais pas?
Tiens, me voilà devant cet hôtel... C'est terrible d'être forcée d`y pénétrer, de voir tous ces gens, monsieur von Dorsday, ma tante, Cissy. Quel bonheur, tout à l'heure sur le banc, quand j'étais morte. Matador... si seulement je savais ce que... Il y avait une régate, mais oui, je l'ai regardée depuis ma fenêtre. Mais qui était ce matador ? ... Si au moins je n'étais pas tellement fatiguée, si terriblement fatiguée. Comment rester éveillée jusqu'à minuit, et me faufiler dans la chambre de monsieur von Dorsday? Dans le couloir je rencontrerai peut-être Cissy. Est-elle nue sous sa robe de chambre, quand elle va le rejoindre? C'est difficile quand on n'a pas l'habitude de ces choses-là. Ne devrais-je pas demander conseil à Cissy. Bien sûr, je ne lui dirais pas qu'il s`agit de Dorsday; elle s'imaginera que j'ai un rendez-vous nocturne avec l'un de ces beaux garçons qui sont à l'hôtel. Avec le grand blond aux yeux étincelants, par exemple. Mais il n'est plus ici. Soudain éclipsé. Tiens, je n'avais encore jamais pensé à lui. Hélas, il ne s'agit pas du grand blond aux yeux étincelants, ni de Paul, mais de monsieur von Dorsday. Comment vais-je m`y prendre? Que lui dire? Oui, tout simplement? ..."

"Fräulein Else" est porté à l'écran par Paul Czinner en 1929, avec Elisabeth Bergner (1897-1986): ils émigrèrent tous deux en Angleterre en 1933, puis aux Etat-Unis. Paul Czinner avait déjà en 1924, avec celle qui deviendra sa femme, tourné "Eine Unverstandene Frau" (A qui la faute), portrait psychologique d'une femme qui ne se résigne pas à la platitude de sa vie et qui finira par se suicider. Les deux plus grandes stars nationales du moment, Emil Jannings et Conrad Veidt donnaient alors la réplique à Elisabeth Bergner....
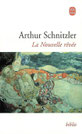
Traumnovelle (La Nouvelle rêvée , 1926)
« Je ne sais chanter d'autre chant que celui trop familier de l'amour, du jeu et de la mort », écrivait Arthur Schnitzler.
Exemplaire de cette triple obsession, "La Nouvelle rêvée", chef-d'oeuvre d'érotisme et de fantastique achevé en 1925 après une genèse de dix-sept ans, fascina Stanley Kubrick qui s'en inspira
pour son film "Eyes wide shut" de 1999, avec Tom Cruise (Dr. Bill Harford), Nicole Kidman (Alice Harford), Sydney Pollack (Victor Ziegler), Todd Field (Nick Nightingale). A Vienne durant le
carnaval, Fridolin, qui est médecin, est appelé au chevet d'un mourant. Après la mort de son patient, il se trouve entraîné dans une soirée masquée. Mots de passe, femmes voilées, musique
suave... tout concourt au mystère et au sentiment d'irréalité. De son côté, dans la même nuit, Albertine, son épouse, va vivre en rêve des aventures analogues empreintes d'une trouble sensualité.
Entre les songes pervers de la femme et les transgressions «vraies» de l'homme, la réalité percute et se trouble.

Madame Béate et son fils (Frau Beate und ihr Sohn, 1913)
Veuve depuis cinq ans, Béate Heinold ne vit plus que pour son fils Hugo, dont elle a toujours voulu être non seulement la mère, mais aussi l'amie, la confidente. Or Hugo, qui traverse sa première crise sentimentale - il a dix-sept ans - est brusquement devenu un étranger, silencieux et fermé. Intimidée et perplexe devant cet être nouveau pour elle, Béate trouvera-t-elle apaisement et réconfort dans la brève aventure qui par ailleurs s'offre à elle ?

La Ronde (Reigen, 1897)
La pièce est constituée de dix brefs dialogues entre deux personnages, un homme et une femme qui ont une relation sexuelle. Le spectateur assiste aux préliminaires, au jeu de séduction ou de pouvoir, et à la fin du tête-à-tête. La ronde est constituée par le fait que chacun des protagonistes a deux partenaires successifs et apparaît donc dans deux scènes consécutives, et que le dernier personnage a une relation avec la première. Arthur Schnitzler appelait cette pièce originale, audacieuse, "Liebesreigen", « La Ronde d'Amour ». La circulation du désir, de la maladie -en filigrane, la syphilis- le passage d'un monde social à un autre, la menace de la mort, des désastres de la guerre, ce cercle infernal demeure fascinant. Il note la fin de sa rédaction dans son journal, au 24 février 1897 et quelques jours plus tard, avoue dans une lettre « de tout l'hiver, je n'ai écrit qu'une suite de scènes parfaitement impubliable et sans grande portée littéraire mais qui, si on l'exhume dans quelques centaines d'années, jettera sans doute un jour singulier sur certains aspects de notre civilisation » ...
I - LA FILLE ET LE SOLDAT
Tard le soir. Près du pont du jardin d'Augarten, au bord du Danube.
LE SOLDAT, arrive en sifflant, il rentre au quartier.
LA FILLE : Tu viens, mon bel ange?
LE SOLDAT, se retourne et continue son chemin.
LA FILLE : Tu ne veux pas venir avec moi?
LE SOLDAT: Ah! C'est moi, le bel ange?
LA FILLE: Bien sûr, qui d'autre?... Viens chez moi, dis, j'habite tout près.
LE SOLDAT : J'ai pas le temps. Il faut que je rentre à la caserne.
LA FILLE : T'as bien le temps d'y être, à la caserne! ll fait meilleur chez moi.
LE SOLDAT, se rapprochant d 'elle. Ça, C'est possible!
LA FILLE : Chut! Il peut toujours arriver un flic...
LE SOLDAT : Tu veux rire! Un flic! Moi aussi, j'ai mon arme.
LA FILLE : Allez, viens avec moi.
LE SOLDAT : Laisse-moi tranquille! De toute façon, j'ai pas d'argent.
LA FILLE : j'ai pas besoin d'argent.
LE SOLDAT s'arrête. Ils sont près d'un réverbère: T'as pas besoin d'argent? T'es donc une princesse?. ..
LA FILLE : Chez moi, c'est les civils qui casquent. Pour un gars comme toi, c'est toujours à l'oeil.
LE SOLDAT : Alors t'es peut-être bien celle dont Huber m'a parlé?
LA FILLE : Je connais pas de Huber.
LE SOLDAT: Sûrement que c'est toi. Tu sais bien - au café, dans la Schiffgasse -, et vous avez filé chez toi.
LA FILLE : Il y en a tant que j'ai ramené du café... oh là là!
LE SOLDAT : Alors, on y va? Allons-y!
LA FILLE : Quoi, t'es pressé maintenant?
LE SOLDAT: Ben, qu'est-ce qu'on attend? Et puis, à dix heures, il faut que je sois à la caserne.
LA FILLE : Y a longtemps que t'es dans l'armée?
LE SOLDAT : Qu'est-ce que ça peut bien te faire? T'habites loin?
LA FILLE : Dix minutes de marche.
LE SOLDAT : C'est trop loin pour moi. Donne-moi un bisou.
LA FILLE, l'embrassant: Toute façon, c'est ce que je préfère, quand j'ai un béguin pour quelqu`un.
LE SOLDAT: Pas moi. Décidément, je ne t'accompagne pas, c'est trop loin pour moi!
LA FILLE : Tiens, tu devrais venir demain après-midi...
LE SOLDAT : Entendu. Donne-moi ton adresse.
LA FILLE : Mais si ça se trouve, après tu viendras pas.
LE SOLDAT: Puisque je te le dis!
LA FILLE: Tiens, tu ne sais pas?... Si tu trouves que c'est trop loin ce soir, de venir chez moi... par là... par là... Montrant le Danube?
LE SOLDAT: Où ça, là?
LA FILLE : On y est bien tranquille aussi... Il ne passe pas un chat à cette heure.
LE SOLDAT : Bah! ça ne me dit guère.
LA FILLE: Moi, ça me dit toujours... Allez, reste avec moi! Qui sait si demain on sera encore en vie!
LE SOLDAT : Alors viens. .. mais vite!
LA FILLE : Attention, c'est qu'il fait noir. Si tu fais un faux pas, tu te fiches dans le Danube.
LE SOLDAT : Toute façon, ça serait le mieux!
LA FILLE: Chut!... Attends encore un peu. On va trouver un banc là, tout près.
LE SOLDAT : On dirait que tu connais le coin, par ici!
LA FILLE : C'est un type comme toi que je voudrais pour ami!
LE SOLDAT : Je serais bien trop jaloux pour toi!
LA FILLE : Je me chargerais de te faire passer ça.
LE SOLDAT: Ha !...
LA FILLE: Pas si fort! Tout de même, un flic pourrait s'égarer par ici. Dire qu'on est en plein Vienne, c'est pas croyable, non?
LE SOLDAT : Allez, viens là.
LA FILLE: Mais qu'est-ce qui te prend? Si nous glissons, nous roulons dans le fleuve.
LE SOLDAT, se jetant sur elle: Ah! tu...
LA FILLE : Surtout, cramponne-toi bien.
LE SOLDAT : Aie pas peur...
...................................................................................
LA FILLE : Sur le banc, ç'aurait été plus commode.
LE SOLDAT: Ici ou là... Allons, remonte, grouille!
LA FILLE : Qu'est-ce que t'as à courir comme ça. ..?
LE SOLDAT : Faut que je rentre... Toute façon, je suis déjà en retard.
LA FILLE : Dis donc, comment t'appelles-tu?
LE SOLDAT : Qu'est-ce que ça peut bien te faire, comment je m'appelle?
LA FILLE : Moi, je m'appelle Léocadia.
LE SOLDAT : Ohl!.. Jamais entendu un nom pareil!
LA FILLE : Dis?
LE SOLDAT : Ben quoi?
LA FILLE: Tu me donneras tout de même bien dix balles pour ma chambre ?
LE SOLDAT: Non, mais!... tu me prends peut-être pour un micheton? Bonjour chez toi, Léocadia!
LA FILLE : Marlou! Voyou!
Il a disparu.
II - LE SOLDAT ET LA FEMME DE CHAMBRE
Au Prater. Un dimanche soir. ,
Un chemin qui mène du Wurstelprater aux allées sombres. On entend encore les échos de la musique et les flonflons de la Fünfkreuzertan, une polka assez vulgaire, jouée par des instruments a vent.
LA FEMME DE CHAMBRE : Alors, dites-moi enfin pourquoi vous avez voulu partir si tôt!
LE SOLDAT rit d 'un air embarrassé et niais.
LA FEMME DE CHAMBRE : On s'amusait si bien. J'aime tant danser!
LE SOLDAT la prend par la taille.
LA FEMME DE CHAMBRE, le laissant faire: Pourquoi me serrez-vous comme ça, puisque nous ne dansons plus? ›
LE SOLDAT : Comment vous appelez-vous? Kathi?
LA FEMME DE CHAMBRE : Vous avez toujours une Kathi dans la tête...
LE SOLDAT : Ah oui... je sais... Marie!
LA FEMME DE CHAMBRE: Dites, il fait bien noir ici... ça me fait peur, à moi.
LE SOLDAT: Faut pas avoir peur quand je suis avec vous!... Heureusement qu'on est là, nous autres!
LA FEMME DE CHAMBRE : Mais, où c'qu'on arrive par là? Il n'y a plus personne. Allez, retournons... Ce qu'il fait noir!
LE SOLDAT tirant sur son cigare dont le bout devient tout rouge: Voilà qu'il fait déjà plus clair! Ha ha! C'est toi, ma poulette!
LA FEMME DE CHAMBRE: Mais qu'est-Ce que vous faites là? Si j'avais su ça...
LE SOLDAT : Parole d'honneur, il n'y en avait pas une plus chouette que vous, ce soir, chez Swoboda, mam'selle Marie!
LA FEMME DE CHAMBRE : Vous les avez donc toutes tâtées?
LE SOLDAT: On sent ça, en dansant. On sent beaucoup de choses en dansant! Ha ha!
LA FEMME DE CHAMBRE: Oui, mais la blonde avec sa figure de travers, vous l'avez fait danser plus souvent que moi.
LE SOLDAT : C'est une vieille connaissance à un ami à moi.
LA FEMME DE CHAMBRE : Le caporal qui a la moustache à la redresse?
LE SOLDAT: Mais non... le civil, vous savez, celui qui était assis à une table avec moi... qui a la voix enrouée.
LA FEMME DE CHAMBRE : Ah! oui. .. je sais. Il en a du toupet, celui-là.
LE SOLDAT : Est-ce qu'il vous a fait quelque chose? Ah, il aurait affaire à moi! Qu'est-ce qu'il vous a fait?
LA FEMME DE CHAMBRE: Oh! rien... Seulement j'ai bien vu comment il était avec les autres.
LE SOLDAT : Dites, mam'selle Marie...
LA FEMME DE CHAMBRE : Vous allez me brûler avec votre cigare.
LE SOLDAT : Paârdon.. Mam'selle Marie! Et si on se disait tu?
LA FEMME DE CHAMBRE : Nous nous connaissons pas encore assez pour ça...
LE SOLDAT : Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se sentir et qui se disent tu tout de même.
LA FEMME DE CHAMBRE : La prochaine fois, quand nous... Mais, monsieur Franz...
LE SOLDAT : Vous avez retenu mon nom?
LA FEMME DE CHAMBRE : Mais, monsieur Franz. _.
LE SOLDAT : Dites Franz, mam'selle Marie...
LA FEMME DE CHAMBRE : Tenez-vous donc tranquille! Voyons, si quelqu'un venait!
LE SOLDAT: Et quand même il viendrait quelqu'un... on y voit pas à deux pas devant soi.
LA FEMME DE CHAMBRE : Mais je vous en prie! Où est-ce que ça mène, par là?
LE SOLDAT : Regardez... par là en voilà deux, tout comme nous.
LA FEMME DE CHAMBRE : Où ça?Je ne vois rien.
LE SOLDAT : Là... devant nous.
LA FEMME DE CHAMBRE ; Pourquoi dites-vous ; « deux comme nous»?...
LE SOLDAT : Dame, je veux dire qu'ils s'aiment bien, comme nous.
LA FEMME DE CHAMBRE : Mais faites donc attention... qu'est-ce qu'il y a là, un peu plus, je tombais.
LE SOLDAT : Ah! ce sont les arceaux qui entourent les pelouses.
LA FEMME DE CHAMBRE : Poussez donc pas comme ça, vous allez me faire tomber.
LE SOLDAT : Chut, pas si fort!
LA FEMME DE CHAMBRE : Dites, je vais crier pour de bon... Mais qu'est-ce qui vous prend. . . voyons. . .
LE SOLDAT : Il n'y a pas un chat, que je vous dis!
LA FEMME DE CHAMBRE : Alors, retournons là où il y a du monde.
LE SOLDAT: On n'a pas besoin de monde, dis, Marie, on a besoin de personne... pour ça... ha ha!
LA FEMME DE CHAMBRE: Voyons, monsieur Franz, je vous en prie, pour l'amour du ciel! Dites donc, si j'avais... su ça... Oh... Oh... Viens!...
.....................................................................
LE SOLDAT, aux anges: Bon Dieu de bon Dieu!... ah...
LA FEMME DE CHAMBRE : je ne vois pas ta figure!
LE SOLDAT : Oh, il s'agit bien de figure...
LE SOLDAT: Hé, mam'selle Marie, vous ne pouvez pas rester couchée comme ça, dans l'herbe.
LA FEMME DE CHAMBRE : Dis voir, Franz, aide-moi.
LE SOLDAT: Allez, hop là!
LA FEMME DE CHAMBRE : Ah! mon Dieu, Franz!
LE SOLDAT ; Eh bien! qu'est-ce que tu lui veux, à Franz!
LA FEMME DE CHAMBRE : C'est mal, Ce que tu as fait là, Franz!
LE SOLDAT : Oui, entendu... Une seconde, attends un peu.
LA FEMME DE CHAMBRE : Pourquoi que tu t'éloignes?
LE SOLDAT : Tu me permettras bien de rallumer mon Virginia?
LA FEMME DE CHAMBRE : C'est qu'il fait si noir!
LE SOLDAT : Dès demain matin, il fera jour.
LA FEMME DE CHAMBRE : Dis-moi au moins, tu m'aimes?
LE SOLDAT : Ben, t'as dû quand même t'en apercevoir, mam'selle Marie, ha ha!
LA FEMME DE CHAMBRE : Où allons-nous par là?
LE SOLDAT : Ben, on y retourne.
LA FEMME DE CHAMBRE : Dis, je t'en prie, pas si vite!
LE SOLDAT : Pourquoi que tu grognes? Moi, j'aime pas me balader dans le noir.
LA FEMME DE CHAMBRE : Dis, Franz, est-ce que tu m'aimes?
LE SOLDAT : Mais je viens de te l'dire, que je t`aime!
LA FEMME DE CHAMBRE : Et dis, tu ne voudrais pas me donner un baiser?
LE SOLDAT, avec condescendance: Voilà... Écoute un peu... on entend déjà la musique.
LA FEMME DE CHAMBRE : Si ça se trouve, t'as encore envie de danser?
LE SOLDAT : Pour sûr... pourquoi pas?
LA FEMME DE CHAMBRE : Vois-tu, Franz, moi je suis obligée de rentrer... Toute façon, ils vont m'attraper... Ma patronne est une de ces... Ce qu'elle voudrait, c'est qu'on sorte jamais!
LE SOLDAT : Ben alors, t'a plus qu'à rentrer.
LA FEMME DE CHAMBRE : Je pensais, monsieur Franz, que vous me feriez un bout de conduite.
LE SOLDAT : Vous faire un bout de conduite? Ah!
LA FEMME DE CHAMBRE : Vous savez, c'est trop triste de rentrer toute seule à la maison! l
LE SOLDAT : Et où habitez-vous?
LA FEMME DE CHAMBRE : C'est même très loin... dans la Porzellangasse.
LE SOLDAT : Ah oui? C'est mon chemin aussi... Mais c'est trop tôt pour moi... ça guinche encore là-bas, et aujourd'hui, j'ai encore le temps... je n'ai pas besoin d'être à la caserne avant minuit... je retourne danser.
LA FEMME DE CHAMBRE : Ah, je vois... ça va être le tour de la blonde qui a la figure de travers.
LE SOLDAT : Ha !... je trouve pas qu'elle a la figure tellement de travers!
LA FEMME DE CHAMBRE : Mon dieu, que les hommes sont dégoûtants! Je parie que vous faites la même chose avec toutes.
LE SOLDAT : Ça, ce serait trop ! ..
LA FEMME DE CHAMBRE: Franz, je vous en prie, arrêtez pour aujourd'hui... restez avec moi ce soir, dites... Voyez-vous, je...
LE SOLDAT: D'accord, ça va!... Mais j'ai le droit de danser, tout de même!
LA FEMME DE CHAMBRE : Moi, je ne danserai plus avec personne, ce soir!
LE SOLDAT : Tiens, nous y voilà!
LA FEMME DE CHAMBRE : Où ça? .
LE SOLDAT: Chez Swoboda! Comme on est vite revenu!... On joue toujours le... tadarada tadarada. Il fredonne l'air. Alors, si tu veux m'attendre, je te reconduirai chez toi... Autrement... Salutl...
LA FEMME DE CHAMBRE : Bon, j'attendrai.
Ils entrent dans la salle ou l'on danse.
LE SOLDAT : Vous savez, mam'selle Marie, vous pouvez vous faire servir un bock. Se tournant vers une blonde qui passe devant lui au bras d'un garçon et sur un ton cérémonieux: Mademoiselle, voulez-vous me faire l'honneur? ...
III - LA FEMME DE CHAMBRE ET LE JEUNE MONSIEUR
Une chaude après-midi d 'été. - Les parents sont partis à la campagne. C'est le jour de sortie de la cuisinière. Dans la cuisine, la femme de chambre écrit une lettre au soldat, qui est son petit ami. - On a sonné dans la chambre du jeune monsieur. Elle se lève et va voir. Le jeune monsieur est couché sur le canapé, en train de lire un roman français, tout en fumant....
La Ronde ou comment un couple se comporte avant comme après avoir fait l'amour, dix couples que l'auteur place chaque fois dans une situation différente, l'intention étant de dévoiler ce que les hommes en général s'efforcent de dissimuler. Une volonté audacieuse qui sait ici éviter toute complaisance licencieuse. La trouvaille de Schnitzler pour éviter d'être par trop scabreux, consiste à nous faire parcourir tous les degrés de l'échelle sociale. En nous offrant toute la gamme des attitudes que peut fournir le même fait, du désir de l'être dit inculte aux raffinements de l'aristocrate. Dix couples donc: la fille et le soldat ; le soldat et la femme de chambre ; la femme de chambre et le jeune homme ; le jeune homme et la jeune femme ; la jeune femme et son mari ; le mari et la grisette ; la grisette et l'homme de lettres ; l'homme de lettres et l'actrlce ; l'actrice et le comte ; le comte et la courtisane....
Schauspielerin - Und wie verhält sich das mit der Liebe?
Graf - Wenn man daran glaubt, ist immer eine da, die einen gern hat.
L'actrice - Et qu'en est-il de l'amour?
Le comte - Si l'on y croit, il s'en trouve toujours une pour vous aimer.

"La Ronde" fut adaptée au cinéma par Max Ophüls (1950), une ronde amoureuse au casting français prestigieux, Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Daniel Gélin, Danielle Darrieux, Fernand Gravey, Odette Joyeux, Jean-Louis Barrault, Isa Miranda, Gérard Philipe, Jean Clarieux, Jean Ozenne, Robert Vattier, une série d'histoires amoureuses entretenues par une fatalité de la luxure.. «Et moi, lance le meneur de jeu, en frac et haut-de-forme, qui va faire tourner sous nos yeux le carrousel de la ronde des amours, qu'est-ce que je suis dans cette histoire ? La ronde, l'auteur, le compère, un passant ? Je suis vous, enfin je suis n'importe quel d'entre vous ? Je suis l'incarnation de votre désir, de votre désir de tout connaître...» Max Ophüls venait alors de tourner "Letter from an Unknown Woman" (1948) et enchaînera, en France, "Le Plaisir" (1952), adapté de Maupassant...

Vienne au crépuscule (Der Weg ins Freie, 1908)
Le roman Vienne au crépuscule (Der Weg ins Freie, mot à mot : « Le Chemin de la liberté ») est l'œuvre de Schnitzler la plus conforme au modèle européen du grand « roman de société ». Commencé durant l'été de 1902, publié en 1908, l'ouvrage présente une des fresques les plus suggestives de la métropole habsbourgeoise à l'époque de la « modernité viennoise. » L'« éducation sentimentale » (au sens où l'entendait Flaubert) du jeune aristocrate Georg von Wergenthin sert de fil conducteur au roman qui réunit les principaux thèmes chers à Schnitzler. Il incarne le type de l'esthète prisonnier de son narcissisme qui ne parvient, ni dans ses relations amoureuses ni dans sa vie sociale, à sortir de lui-même.
Après la mort de son père, Georg reprend, non sans quelque peine, une vie sociale en fréquentant le salon de Mme Ehrenberg. femme d`un riche industriel juif. Simultanément se noue une liaison entre Georg et Anna Rosner, fille d`une famille de la petite bourgeoisie. En dépit de l`amour profond, du dévouement et de l`intelligence sensible d`Anna, elle restera pour Georg plus une "aventure" qu`une relation l`engageant pleinement. Anna attend un enfant de lui, mais Georg s`avère incapable d`assumer réellement devant la société et pour lui-même, cette paternité. ll loue pour Anna une maison hors de Vienne et vient la voir régulièrement. Après un accouchement extrêmement difficile, Anna met au monde un enfant mort-né. Même cette épreuve ne parvient pas à provoquer en Georg une véritable transformation. ll reçoit une proposition d`engagement comme chef d`orchestre à Detmold, hésite un instant par crainte de se lier, là aussi, puis part, incité en cela par Anna. qui feint sans doute de se persuader elle-même qu`elle le rejoindra. Revenant à l'occasion d`un congé, il retrouve Anna, sans toujours pouvoir ni s`engager fermement ni rompre définitivement, continue de vivre cette liaison sans la vivre, se réservant toujours le "chemin de la liberté". De multiples épisodes. actions et personnages secondaires gravitent autour de cet axe, toujours liés à la problématique fondamentale de l`œuvre : la responsabilité. Le milieu social que fréquente le baron von Wergenthin permet à Schnitzler de dresser un tableau d`une société, au sein de laquelle l`apparence, la légèreté masquent l`absence de véritable engagement et de responsabilité face aux problèmes cruciaux de l`heure. L`unité du roman réside dans cette correspondance entre son héros et la société qu`il décrit. De plus, la majorité des personnages fréquentant le salon Ehrenberg sont d`origine juive. Schnitzler se fixant par là pour objectif de présenter à son lecteur toute la diversité des attitudes de la communauté juive face aux problèmes de l`assimilation, de l'antisémitisme, du sionisme. (Trad. Stock. 1988).
" ... Âgée alors de trente-quatre ans, la grande, imposante Mme Ehrenberg était encore belle, elle avait des yeux voilés et donnait une impression de grande lassitude. L'arrivée, un jour, de son époux laissa à Georges un souvenir inoubliable; le fabricant de cartouches, riche à millions, venu surprendre les siens, détruisit d’un coup par sa seule apparition toute la distinction des Ehrenberg. Georges le voyait encore surgissant pendant le petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel; un petit homme maigre à la barbe poivre et sel, aux yeux bridés, dans un complet de flanelle blanche mal repassé, avec sur sa tête ronde un chapeau de paille foncé au ruban à rayures blanches et rouges, et aux pieds des chaussures noires, poussiéreuses. I] parlait d’un ton trainant à intonation toujours moqueuse, même des choses les plus insignifiantes, et, dés qu’il ouvrait la bouche, on percevait derrière un calme apparent une peur secrète sur le visage de son épouse. Elle tentait de se venger en se gaussant de lui, mais elle n’était pas a la hauteur de sa muflerie. Oscar, lui, affectait dans la mesure du possible d’être étranger à tout cela. Sur ses traits se lisait le mépris un peu vague de descendre d’un être si peu digne de lui, et il souriait aux jeunes aristocrates, quêtant leur compréhension. Else seule se montrait à cette époque affectueuse envers son père. Elle lui donnait volontiers le bras à la promenade, et parfois lui sautait au cou en public...."
Schnitzler utilise ses personnages comme un prisme pour disséquer une civilisation en déclin. Leur force vient de leur complexité, aucun n’est tout à fait héros ou méchant, mais tous sont profondément humains...
- Georg von Wergenthin, jeune compositeur aristocrate, protagoniste central, il incarne l’indécision existentielle de la bourgeoisie viennoise. Son histoire d’amour avec Anna Rosner révèle son égoïsme passif et son incapacité à s’engager. Symbole de l’homme moderne, détaché et complice des maux qu’il déplore.
- Anna Rosner, jeune chanteuse, maîtresse de Georg, la victime sacrificielle du roman : aimante, vulnérable, elle meurt en couches, abandonnée. En contraste avec les femmes mondaines (Mme Ehrenberg) par sa pureté tragique. Sa mort souligne l’échec de toutes relations authentiques dans une société marquée par un profonde hypocrisie.
- Heinrich Bermann, écrivain juif tourmenté, ami de Georg, le porte-parole des dilemmes identitaires juifs, déchiré entre assimilation et désir de vérité. Ses monologues explorent la mélancolie intellectuelle et l’antisémitisme latent. Il incarne la lucidité désespérée (Nous sommes des étrangers partout).
- Leo Golowski, militant sioniste, frère de Thérèse. Il représente la réponse radicale à l’antisémitisme (rejet de l’assimilation, appel à un État juif). Ses débats avec Heinrich sont le cœur politique du roman. Il est le symbole de la colère constructive, mais aussi de l’intransigeance.
- Therese Golowski, sœur de Leo, engagée dans les luttes sociales, elle refuse les rôles traditionnels féminins et incarne tout ce qu’Anna n’est pas : intellectuelle, militante, libre. Georg est fasciné par son audace, mais cette attirance restera platonique et vague. Therese elle-même le méprise pour son indécision. Leur "relation" n’est qu’un miroir de ses propres faiblesses.
- Les Ehrenberg, Mme Ehrenberg, une bourgeoise juive assimilée, hôtesse de salon, symbole de l’illusion de l’intégration (Nous sommes des Européens); M. Ehrenberg, mari effacé et businessman juif, il incarne l’autodestruction par l’assimilation silencieuse. Else Ehrenberg, leur fille, cynique mais tendre avec son père, la lucidité impuissante et l’amour comme résistance.
- Oscar, le dandy oisif et manipulateur, l'antithèse de Georg, cynisme actif vs indécision passive. Il révèle toute la vacuité de l’esthétisme bourgeois et ses provocations mettent à jour les hypocrisies sociales.
- Nürnberger, un journaliste ironique et désabusé, la voix de la désillusion politique (Tout est mensonge), il complète Heinrich en offrant une perspective plus amère et moins intellectuelle.
"In einer dunkelblauen Maiennacht lagen sie in zwei Segeltuchstühlen auf dem Verdeck des Schiffes, das sie nach Genua führte. Ein alter Franzose mit hellen Augen, der bei der Abendmahlzeit ihr Gegenüber gewesen war, blieb eine Weile neben ihnen stehen und machte sie auf die Sterne aufmerksam, die wie schwere silberne Tropfen im Unendlichen hingen. Einzelne nannte er mit Namen, höflich und verbindlich, als fühle er sich gedrungen, die funkelnden Himmelswanderer und das junge Ehepaar miteinander bekannt zu machen. Dann empfahl er sich und stieg in seine Kajüte hinunter. Georg aber dachte an seine einsame Fahrt auf gleichem Wege unter gleichem Himmel im vorigen Frühjahr, nach seinem Abschied von Grace. Von ihr hatte er Anna erzählt, nicht so sehr aus einem innern Bedürfnis, als um durch das Lebendigmachen einer bestimmten Gestalt und Nennung eines bestimmten Namens seine Vergangenheit von dem rätselhaft Unheimlichen zu befreien, in dem sie sich für Anna manchmal zu verlieren schien. Anna wußte von Labinskis Tod, von Georgs Gespräch mit Grace an Labinskis Grab, von Georgs Aufenthalt mit ihr in Sizilien, sogar ein Bild von Grace hatte er ihr gezeigt. Und doch, mit leichtem Schauer gestand er sich ein, wie wenig Anna selbst von dieser Epoche seines Daseins wußte, über die er sich beinahe rückhaltslos mit ihr ausgesprochen hatte; und er empfand, wie unmöglich es war, einem andern Wesen von einer Zeit, die es nicht miterlebt hatte, von dem Inhalt so vieler Tage und Nächte einen Begriff zu geben, deren jede Minute von Gegenwart erfüllt gewesen war. Er erkannte, wie wenig die kleinen Unaufrichtigkeiten, die er sich in seinen Erzählungen manchmal zuschulden kommen ließ, bedeuten mochten gegenüber dem unvertilgbaren Hauch der Lüge, den jede Erinnerung aus sich selbst gebiert, auf dem kurzen Weg von den Lippen des einen zu dem Ohr des andern. Und wenn Anna später einmal einem Freund, einem neuen Geliebten, so ehrlich, als sie nur vermochte, von der Zeit berichten wollte, die sie mit Georg verbracht, was konnte der am Ende erfahren? Nicht viel mehr als eine Geschichte, wie er sie hundertmal in Büchern gelesen: von einem jungen Geschöpf, das einen jungen Mann geliebt hatte, mit ihm herumgereist war, Wonnen empfunden und zuweilen Langeweile, sich mit ihm vereint gefühlt hatte und manchmal doch einsam; und selbst wenn sie versucht hätte, von jeder Minute Rechenschaft abzulegen... es blieb doch ein unwiderbringlich Vergangenes, und für den, der es nicht selbst erlebt hatte, konnte Vergangenes nie Wahrheit werden.
Die Sterne glitzerten über ihnen. Annas Kopf war langsam an seine Brust gesunken, und er stützte ihn sanft mit den Händen. Nur das leise Rauschen in der Tiefe verriet, daß das Schiff sich weiterbewegte. Nun ging es immer dem Morgen entgegen, der Heimat, der Zukunft. Zu klingen und zu kreisen begann die Zeit, die so lang stumm über ihnen geruht. Georg fühlte plötzlich, daß er sein Schicksal nicht mehr in der Hand hatte. Alles ging seinen Lauf. Und nun spürte ers durch den ganzen Körper gleichsam bis in die Haare, daß das Schiff unter seinen Füßen unaufhaltsam vorwärts eilte..."
Par une nuit d’un bleu profond en ce mois de mai, ils étaient allongés dans des chaises de toile sur le pont du navire qui les emmenait à Gênes. Un vieux Français aux yeux clairs, assis en face d’eux pendant le dîner, s’était arrêté un moment près d’eux pour leur montrer les étoiles, suspendues comme de lourdes gouttes d’argent dans l’infini. Il en nomma quelques-unes, poliment et avec affabilité, comme s’il se sentait obligé de présenter ces voyageurs célestes étincelants au jeune couple. Puis il prit congé et descendit dans sa cabine. Georg, lui, pensait à son voyage solitaire l’année précédente, sur cette même route, sous ce même ciel, après avoir quitté Grace. Il avait parlé d’elle à Anna, non par besoin intérieur, mais pour libérer son passé de ce mystère inquiétant dans lequel il semblait parfois se perdre aux yeux d’Anna. Anna connaissait la mort de Labinski, la conversation de Georg avec Grace sur la tombe de Labinski, leur séjour en Sicile, et il lui avait même montré un portrait de Grace. Pourtant, il s’avoua avec un léger frisson combien Anna savait peu de choses sur cette période de sa vie, bien qu’il lui en eût parlé presque sans réserve. Il ressentait alors l’impossibilité de transmettre à un autre être le sens d’une époque qu’il n’avait pas vécue, le contenu de tant de jours et de nuits dont chaque minute avait été emplie de présence. Il comprit combien les petits mensonges qu’il avait parfois laissé échapper dans ses récits étaient insignifiants face au souffle indélébile de fausseté que toute mémoire engendre d’elle-même, sur le court chemin des lèvres de l’un à l’oreille de l’autre. Et si Anna, plus tard, racontait à un ami, à un nouvel amant, aussi honnêtement que possible, le temps qu’elle avait passé avec Georg, que pourrait-il finalement en retenir ? Pas beaucoup plus qu’une histoire comme il en avait lu des centaines dans les livres : celle d’une jeune créature qui avait aimé un jeune homme, avait voyagé avec lui, connu des extases et parfois de l’ennui, s’était sentie unie à lui et pourtant parfois seule ; et même si elle avait tenté de rendre compte de chaque minute… cela restait un passé irrémédiable, et pour celui qui ne l’avait pas vécu, le passé ne pouvait jamais devenir vérité.
Les étoiles scintillaient au-dessus d’eux. La tête d’Anna avait lentement glissé contre sa poitrine, et il la soutenait doucement entre ses mains. Seul le léger bruissement des flots trahissait la progression du navire. Ils allaient maintenant à la rencontre du matin, de la patrie, de l’avenir. Le temps, qui avait longtemps reposé silencieux sur eux, se mit à résonner et à tourbillonner. Georg sentit soudain qu’il n’avait plus son destin en main. Tout suivait son cours. Et maintenant, il le ressentait dans tout son corps, jusqu’au bout des cheveux : le navire filait irrésistiblement sous ses pieds..."
"Vienne au crépuscule" (Der Weg ins Freie, littéralement "Le Chemin vers la liberté", mais de fait, personne ne trouve de "liberté") est une œuvre d'autant plus majeure de Schnitzler (et singulière dans la littérature autrichienne) qu'elle est à la fois
- une peinture précise de la société viennoise fin de siècle (l'intrigue n'est pas linéaire, mais faite d'une mosaïque de destins, reflet d’une société en crise),
- une narration introspective, où les dialogues et monologues intérieurs révèlent les tourments de personnages ambivalents,
- et une critique acerbe mais subtile de l’antisémitisme (il est omniprésent, mais rarement explicite, il se glisse dans les conversations, les sous-entendus), de l’hypocrisie bourgeoise et de l’inauthenticité quasi absolue des relations humaines ...
Vienne, début du XXᵉ siècle. L’Empire austro-hongrois décline, Schnitzler nous livre 'atmosphère des cercles intellectuels et artistiques viennois, qui tous illustrent les tensions de l’époque : antisémitisme rampant, crise des valeurs bourgeoises et de leurs conventions, déclin de l'aristocratie, montée des idéologies (socialisme, sionisme), mais sans qu'aucune d'entre elles ne comble le malaise spirituel des personnages. Ceux-ci parlent, débattent, séduisent, mais rien ne change.
Au coeur de ce vaste crépuscule qui ne dit pas son nom, Schnitzler dépeint une relation entre deux êtres, Georg von Wergenthin, un aristocrate compositeur sans grand talent, et Anna Rosner, une jeune chanteuse de la classe moyenne, comme une lente dissolution, marquée par l'égoïsme de l'un et la vulnérabilité de l'autre. Georg voit Anna comme une "idylle esthétique", une voix qui le touche, mais dont l'amour est un caprice, et non un engagement. Anna, quant à elle, s’attache à lui avec une ferveur naïve, lui abandonne tout, son corps, sa voix, sans exigence réciproque. Georg la laissera s’enfermer dans un rôle de maîtresse dévouée, et lors de sa grossesse se refuse de prendre une décision, ni mariage, ni rupture claire, juste une lâcheté en silence. Schnitzler nous montre un amour qui se délite par usure, bien plus que par drame. Georg et Anna ne se quittent pas, mais glissent l’un loin de l’autre, jusqu’à la tragédie. Le roman s’achève sur une impression de vide et d’échec, typique de la sensibilité fin-de-siècle. ..
(...)
»Sie Heinrich, hätten sich in meinem Falle schuldig gefühlt?«
»Vielleicht auch nicht. Wie kann ich das wissen. Sie denken jetzt wahrscheinlich daran, daß ich neulich ein Wesen direkt in den Tod getrieben und mich trotzdem sozusagen ohne Schuld gefühlt habe?«
»Ja daran denk ich. Und darum versteh ich nicht...«
Heinrich zuckte die Achseln. »Ja. Ich hab mich ohne Schuld gefühlt. Irgendwo in meiner Seele. Und wo anders, tiefer vielleicht, hab ich mich schuldig gefühlt... und noch tiefer, wieder schuldlos. Es kommt immer nur darauf an, wie tief wir in uns hineinschauen. Und wenn die Lichter in allen Stockwerken angezündet sind, sind wir doch alles auf einmal: schuldig und unschuldig, Feiglinge und Helden, Narren und Weise. ›Wir‹ – das ist vielleicht etwas zu allgemein ausgedrückt. Bei Ihnen, zum Beispiel, Georg, dürften sich alle diese Dinge viel einfacher verhalten, wenigstens wenn Sie von der Atmosphäre unbeeinflußt sind, die ich zuweilen um Sie verbreite. Darum geht's Ihnen auch besser als mir. Viel besser. In mir sieht's nämlich greulich aus. Sollten Sie das noch nicht bemerkt haben? Was hilft's mir am Ende, daß in allen meinen Stockwerken die Lichter brennen? Was hilft mir mein Wissen von den Menschen und mein herrliches Verstehen? Nichts... Weniger als nichts. Im Grunde möcht ich ja doch nichts anderes, Georg, als daß all das Furchtbare der letzten Zeit nichts gewesen wäre, als ein böser Traum. Ich schwöre Ihnen, Georg, meine ganze Zukunft und weiß Gott was alles gäb ich her, wenn ich's ungeschehen machen könnte. Und wär es ungeschehen... so wär ich wahrscheinlich geradeso elend wie jetzt.«
Sein Gesicht verzerrte sich, als wenn er aufschreien wollte. Gleich aber stand er wieder da, starr, regungslos, fahl, wie ausgelöscht. Und er sagte: »Glauben Sie mir, Georg, es gibt Momente, in denen ich die Menschen mit der sogenannten Weltanschauung beneide. Ich, wenn ich eine wohlgeordnete Welt haben will, ich muß mir immer selber erst eine schaffen. Das ist anstrengend für jemanden, der nicht der liebe Gott ist.«
Er seufzte schwer auf. Georg gab es auf, ihm zu erwidern. Unter den Weiden schritt er mit ihm dem Ausgang zu. Er wußte, daß diesem Menschen nicht zu helfen war. Irgend einmal war ihm wohl bestimmt, von einer Turmspitze, auf die er in Spiralen hinaufgeringelt war, hinabzustürzen ins Leere; und das würde sein Ende sein. Georg aber war es gut und frei zumut. Er faßte den Entschluß, die drei Tage, die jetzt ihm gehörten, so vernünftig als möglich auszunutzen. Das beste war wohl, irgendwo in einer schönen, stillen Landschaft allein zu sein, auszuruhen und sich zur neuen Arbeit zu sammeln. Das Manuskript der Violinsonate hatte er mit nach Wien genommen. Die vor allem dachte er zu vollenden.
Sie durchschritten das Tor und standen auf der Straße. Georg wandte sich um, aber die Friedhofsmauer hielt seinen Blick auf. Erst nach ein paar Schritten hatte er den Ausblick nach dem Talgrund wieder frei. Doch konnte er nur mehr ahnen, wo das kleine Haus mit dem grauen Giebel lag; sichtbar war es von hier aus nicht mehr. Über die rötlich-gelben Hügel, die die Landschaft abschlossen, sank der Himmel in mattem Herbstschein. In Georgs Seele war ein mildes Abschiednehmen von mancherlei Glück und Leid, die er in dem Tal, das er nun für lange verließ, gleichsam verhallen hörte; und zugleich ein Grüßen unbekannter Tage, die aus der Weite der Welt seiner Jugend entgegenklangen."
"— Dis-moi, Heinrich, est-ce que tu te serais senti coupable à ma place ?"
"Peut-être pas non plus. Comment pourrais-je le savoir ? Tu penses sans doute à ce que je t'ai raconté récemment, comment j'ai poussé quelqu'un droit vers la mort sans pourtant me sentir vraiment coupable ?"
"Oui, c'est exactement ce à quoi je pense. Et c'est pourquoi je ne comprends pas..."
Heinrich haussa les épaules. "Oui. Je ne me suis pas senti coupable. Dans une partie de mon âme. Et ailleurs, plus profondément peut-être, je me suis senti coupable... et encore plus profondément, à nouveau innocent. Tout dépend de la profondeur à laquelle nous regardons en nous-mêmes. Et quand toutes les lumières sont allumées à tous les étages, nous sommes tout cela à la fois : coupables et innocents, lâches et héros, fous et sages. 'Nous' - c'est peut-être trop général. Pour toi, Georg, par exemple, ces choses doivent être bien plus simples, du moins quand tu n'es pas influencé par l'atmosphère que je répands parfois autour de moi. C'est pourquoi tu vas mieux que moi. Bien mieux. En moi, c'est un vrai carnage. Tu ne l'avais pas encore remarqué ? À quoi me sert-il que toutes les lumières brillent à tous mes étages ? À quoi me servent ma connaissance des hommes et ma merveilleuse compréhension ? À rien... Moins que rien. Au fond, Georg, je ne souhaite qu'une chose : que toute l'horreur de ces derniers temps n'ait été qu'un mauvais rêve. Je te jure, Georg, je donnerais tout mon avenir et que sais-je encore pour pouvoir l'annuler. Et si c'était annulé... je serais probablement tout aussi misérable qu'aujourd'hui."
Son visage se tordit comme s'il allait hurler. Mais aussitôt, il redevint immobile, figé, livide, comme éteint. Et il dit : "Crois-moi, Georg, il y a des moments où j'envie les gens qui ont une vision du monde bien ordonnée. Moi, si je veux un monde bien ordonné, je dois d'abord le créer moi-même. C'est fatigant pour quelqu'un qui n'est pas le bon Dieu."
Il poussa un profond soupir. Georg renonça à lui répondre. Sous les saules, il marcha avec lui vers la sortie. Il savait qu'on ne pouvait aider cet homme. Un jour ou l'autre, il était voué à s'élancer du haut d'une tour, après y avoir grimpé en spirale, et à tomber dans le vide ; ce serait sa fin. Mais Georg, lui, se sentait léger et libre. Il prit la résolution d'utiliser au mieux les trois jours qui lui restaient. Le mieux serait sans doute de se retrouver seul dans un beau paysage tranquille, de se reposer et de se préparer à un nouveau travail. Il avait emporté le manuscrit de sa sonate pour violon à Vienne. C'était cela surtout qu'il comptait achever.
Ils franchirent le portail et se retrouvèrent sur la route. Georg se retourna, mais son regard buta contre le mur du cimetière. Ce n'est qu'après quelques pas qu'il retrouva la vue sur la vallée. Mais la petite maison au pignon gris n'était plus visible d'ici ; il ne pouvait que deviner où elle se trouvait. Sur les collines rougeâtres qui fermaient le paysage, le ciel s'abaissait dans la lumière terne de l'automne. Dans l'âme de Georg, c'était un doux adieu à toutes les joies et peines qu'il avait connues dans cette vallée qu'il quittait pour longtemps, et dont il entendait comme un écho qui se perdait ; en même temps, c'était un salut aux jours inconnus qui, du lointain du monde, résonnaient vers sa jeunesse."

"Géronimo, l'aveugle et son frère" (Der blinde Geronimo und sein Bruder, 1912)
Cette brève nouvelle est souvent considéré comme le chef-d'œuvre de l'écrivain autrichien, Arthur Schnitzler, sans doute pour son optimisme et sa bonté rayonnante qui tranche avec le noir pessimisme de "Thérèse" ou de "Mademoiselle Else". Geronimo et Charles sont frères, fils d'un propriétaire campagnard. Un jour, pendant que les deux jeunes frères jouent à l'arc, Charles blesse son frère qui devient aveugle. A partir de se moment, il ne va vivre que pour l'infortuné Géronimo. Il lui enseigne le chant et à jouer de la guitare; à la mort de leur père, il accompagne Géronimo dans les pays de la Valteline. où Géronimo chante et joue dans les auberges et les cafés. Ils vivent ainsi se soutenant l'un l'autre avec affection. Mais une plaisanterie cruelle qui lui est faite par un déséquilibré jette trouble et défiance dans le cœur du jeune aveugle, qui croit que son frère lui dérobe une partie de ses gains. Pour reconquérir la confiance de ce dernier, Charles détrousse deux étrangers afin de rendre à son frère la monnaie d'or qu'il avait. Lorsque Charles est arrêté, tout s'éclaire pour Geronimo : l'amour fraternel va les réunir à nouveau et ils retrouvent ainsi l'unique joie de leur vie.
"Der blinde Geronimo stand von der Bank auf und nahm die Gitarre zur Hand, die auf dem Tisch neben dem Weinglase bereit gelegen war. Er hatte das ferne Rollen der ersten Wagen vernommen. Nun tastete er sich den wohlbekannten Weg bis zur offenen Türe hin, und dann ging er die schmalen Holzstufen hinab, die frei in den gedeckten Hofraum hinunterliefen. Sein Bruder folgte ihm, und beide stellten sich gleich neben der Treppe auf, den Rücken zur Wand gekehrt, um gegen den naßkalten Wind geschützt zu sein, der über den feuchtschmutzigen Boden durch die offenen Tore strich.
Unter dem düsteren Bogen des alten Wirtshauses mußten alle Wagen passieren, die den Weg über das Stilfserjoch nahmen. Für die Reisenden, welche von Italien her nach Tirol wollten, war es die letzte Rast vor der Höhe. Zu langem Aufenthalte lud es nicht ein, denn gerade hier lief die Straße ziemlich eben, ohne Ausblicke, zwischen kahlen Erhebungen hin. Der blinde Italiener und sein Bruder Carlo waren in den Sommermonaten hier so gut wie zu Hause.
Die Post fuhr ein, bald darauf kamen andere Wagen. Die meisten Reisenden blieben sitzen, in Plaids und Mäntel wohl eingehüllt, andere stiegen aus und spazierten zwischen den Toren ungeduldig hin und her. Das Wetter wurde immer schlechter, ein kalter Regen klatschte herab. Nach einer Reihe schöner Tage schien der Herbst plötzlich und allzu früh hereinzubrechen.
Der Blinde sang und begleitete sich dazu auf der Gitarre; er sang mit einer ungleichmäßigen, manchmal plötzlich aufkreischenden Stimme, wie immer, wenn er getrunken hatte. Zuweilen wandte er den Kopf wie mit einem Ausdruck vergeblichen Flehens nach oben. Aber die Züge seines Gesichtes mit den schwarzen Bartstoppeln und den bläulichen Lippen blieben vollkommen unbeweglich. Der ältere Bruder stand neben ihm, beinahe regungslos. Wenn ihm jemand eine Münze in den Hut fallen ließ, nickte er Dank und sah dem Spender mit einem raschen, wie irren Blick ins Gesicht. Aber gleich, beinahe ängstlich, wandte er den Blick wieder fort und starrte gleich dem Bruder ins Leere. Es war, als schämten sich seine Augen des Lichts, das ihnen gewährt war, und von dem sie dem blinden Bruder keinen Strahl schenken konnten.
"Géronimo l’aveugle se leva du banc et prit la guitare posée sur la table, à côté de son verre de vin. Il avait entendu au loin le roulement des premières voitures. À présent, il tâtonna jusqu’à la porte ouverte, puis descendit les étroites marches de bois qui menaient directement à la cour couverte. Son frère le suivit, et tous deux se postèrent près de l’escalier, le dos au mur, pour se protéger du vent humide et glacé qui traversait les portails ouverts, balayant le sol boueux.
Sous la voûte sombre de la vieille auberge, toutes les voitures devaient passer pour franchir le col du Stelvio. Pour les voyageurs venant d’Italie vers le Tyrol, c’était la dernière halte avant l’ascension. L’endroit n’invitait guère à s’attarder : la route, plate et sans perspective, serpentait entre des collines dénudées. L’Italien aveugle et son frère Carlo étaient ici comme chez eux durant les mois d’été.
La diligence entra, suivie bientôt d’autres voitures. La plupart des voyageurs restaient assis, bien emmitouflés dans des couvertures et des manteaux ; d’autres descendirent et arpentèrent impatiemment l’espace entre les portails. Le temps empirait : une pluie froide commençait à claquer. Après une série de beaux jours, l’automne semblait s’installer soudain, bien trop tôt.
L’aveugle chanta, s’accompagnant à la guitare d’une voix inégale, parfois stridente, comme toujours lorsqu’il avait bu. Par moments, il tournait la tête vers le haut, comme dans un geste de supplication vaine. Mais les traits de son visage — barbe de plusieurs jours, lèvres bleuâtres — restaient parfaitement immobiles. Son frère aîné se tenait près de lui, presque sans bouger. Quand quelqu’un laissait tomber une pièce dans son chapeau, il hochait un remerciement et fixait le donateur d’un regard rapide, presque égaré. Puis, comme effrayé, il détournait aussitôt les yeux et, comme son frère, fixait le vide. On eût dit que ses yeux avaient honte de la lumière qui leur était accordée — cette lumière dont ils ne pouvaient offrir une seule parcelle à l’aveugle...."

"Thérèse, chronique de la vie d'une femme" (Therese, Chronik eines Frauenlebens, 1928)
Un sombre tableau de la décadence de la société autrichienne après le première guerre mondiale, déchirant par endroits tant la médiocrité de l'atmosphère est profonde. Thérèse est la fille d'un ancien officier supérieur, dévoyée par l'exemple de son père. Pour fuir la vie de province, elle s'emploie comme institutrice à Vienne. A partir de ce moment, sa vie devient d'une amère tristesse: elle passe d'amant en amant et de famille en famille dans la vaine tentative de lier durablement à elle un homme ou de se créer une famille dans la famille d'autrui en s'attachant les enfants que souvent elle instruit avec un amour sincère et un dévouement généreux. Mais cette société d'industriels, de banquiers. de négociants, de magistrats est indifférente. D'une aventure passagère il lui nait un fils qu'elle élève à force de sacrifices. Mais ce fils sombre et devient un vaurien sans scrupules qui, un jour, égorge sa mère qui lui refusait ses économies. Thérèse meurt en demandant l'indulgence pour son enfant, car elle-même, au jour si sombre de sa naissance, avait eu un instant envie de le tuer.
"... Placée chez un agent de change, elle eut à s'occuper d'un petit garçon de sept ans. Mais la mère de l'enfant, mal mariée, isolée et malheureuse, vouait une affection passionnée à son fils et n`était satisfaite que quand elle l'avait à elle seule. Thérèse avait donc beaucoup de loisirs et eût pu passer des journées entières à Enzbach. Souvent, cependant, elle se soustrayait à cette obligation et préférait flâner dans les rues de Vienne. Elle s'entendait de moins en moins avec les fermiers, et l'outrecuidance d'Agnès lui semblait intolérable.
Le hasard voulut qu'elle rencontrât un soir un des jeunes gens qui lui avaient fait la cour, deux ans plus tôt, au bal des Greitler. Il sembla ravi de la revoir et trouva que le destin faisait bien les choses. Thérèse, surprise de sa propre faiblesse, convint d'un rendez-vous avec lui et devint sienne. Il était étudiant en droit, gai, entreprenant, insouciant. Thérèse l'aima avec fougue et lui sacrifia les heures qu'elle eût dû passer à Enzbach. Elle eût voulu lui parler d'elle plus intimement, mais il ne semblait pas se soucier de ses confidences, et bientôt elle renonça à tout essai de ce genre pour ne pas lui déplaire.
Au début de l'été elle reçut une joyeuse lettre d'adieu. Son amant trouvait qu'elle avait été une bonne petite compagne, l'assurait de son affection et demandait qu'elle lui gardât un bon souvenir. Thérèse pleura pendant deux jours et deux nuits. Puis elle alla à Enzbach, revit son fils, eut l'impression de l'aimer plus qu'avant, jura sur l'image de la Vierge de ne plus le négliger, fit la paix avec les fermiers, que l`absence d'Agnès rendait conciliants, et retourna à Vienne, l'âme apaisée.
Il lui semblait enfin s'être retrouvée, après avoir étanché la soif brûlante de ses sens. Elle songea a ses devoirs professionnels et voulut reprendre la direction de son élève. La mère du petit vit cela d'un mauvais œil, jalouse sans l'avouer. Délaissée par son mari, exaspérée par la manière d'être de l'institutrice, elle lui reprocha de vouloir accaparer l'amour de son fils, de vouloir le détourner d'elle. Cette scène violente fut suivie d'autres accès du même genre, et Thérèse comprit qu'elle devait quitter la maison.
Son nouveau poste lui plut. Deux jeunes filles lui furent confiées, toutes deux d'intelligence moyenne, mais dociles, gentilles et musiciennes. Leur père, fabricant, travaillait beaucoup et aimait son métier; leur mère était de caractère enjoué et facile. Thérèse, habituée maintenant à s'adapter rapidement à toutes les conditions d'existence, connaissait l'art subtil de doser l'intimité et de garder les distances. Cette science, indispensable dans le métier qu'elle avait choisi, lui permettait de prodiguer à ses élèves une affection à la fois maternelle et réservée, d'appuyer sur la note tendre, si le besoin s'en faisait sentir, et somme toute, d'écarter toute sentimentalité sans rester indifférente. Libre de cœur et d'âme lorsqu'elle partait, elle se sentait chez elle, aussitôt rentrée. Elle allait voir son fils régulièrement, sans jamais s'inquiéter de lui durant les semaines de séparation.
Au début de l'hiver elle trouva le train d'Enzbach bondé et fut obligée de monter en première. Un monsieur distingué, d'un certain âge, était installé dans le compartiment. Il aborda Thérèse, engagea une conversation, et raconta que, partant à l'étranger, il devait s'arrêter dans une petite station, non loin du château de ses amis, qu'il allait voir en passant. C'était la raison pour laquelle il s'était servi du train omnibus. Sa façon de parler était précieuse, de son index ganté il caressait sa moustache anglaise. Thérèse lui laissa croire qu'elle était mariée, et raconta qu'elle allait à la campagne voir une amie qui habitait là toute l'année avec sa nombreuse famille. Ils se séparèrent à Enzbach, l'étranger lui baisa la main et obtint d'elle un rendez-vous pour quinze jours plus tard, à son retour de Munich.
Thérèse monta le sentier bien connu d'un pas plus léger que de coutume. Elle était flattée dans son amour-propre. Jamais comme ce jour-là elle n'avait senti tout ce qui la séparait de son enfant, jamais sa façon de parler ne lui avait paru si paysanne Ne serait-il pas temps de le soustraire à ce milieu rustique, de chercher à le placer à Vienne? La chose était difficile. Dans la pièce basse, à la lueur de la lampe fumeuse, elle buvait son café, écoutait le bavardage de la mère Leutner, observait Agnès qui cousait près du poêle, parée de ses plus beaux atours, tandis que François lisait en ânonnant. Elle revit la silhouette élégante de l'étranger dans un compartiment de première classe, sa pelisse de fourrure et ses gants jaunes, vit le train qui l'emmenait à travers des tourbillons de neige vers des pays lointains. En pensant à lui, elle se sentait inconsciemment devenir la jeune femme qu`elle avait prétendu être. Que dirait cet homme s'il savait qu'elle n'était pas allée voir une amie, mais plutôt son enfant, un enfant illégitime, conçu d'un imposteur, d'un nommé Casimir Tobisch! Elle frissonna, appela François, l'embrassa et le cajola, saisie d'un inexplicable remords.
Les quinze jours qui suivirent lui semblèrent interminables comme si l'instant de revoir cet étranger avait été le but unique de sa vie. Plus la date fixée approchait, plus elle craignait qu'il manquât au rendez-vous; bien à tort du reste. Il l'attendait déjà quand elle parut. Son aspect au premier abord la déçut, il était petit, chauve, ce dont elle ne s'était pas aperçue durant leur trajet commun. Mais sa façon de construire ses phrases, le son de sa voix, bientôt la tinrent sous le charme. Elle déclara, en arrivant, ne disposer que d'une demi-heure et avoir rendez-vous avec son mari pour aller au théâtre. L'étranger acquiesça de la tête sans insister. Il était discret, réservé, et tint seulement à se présenter pour réparer l'oubli de la première fois : Monsieur Bing, fonctionnaire dans un ministère et docteur en droit. Il n'essaya pas de savoir le nom de Thérèse et la laissa libre de le lui révéler le jour où elle comprendrait qu'elle pouvait avoir confiance en lui. Interrogé par elle, il parla de son voyage, voyage d'affaires et non de plaisir. Il avait eu le temps cependant d`aller à l'Opéra à Berlin. C'était là sa seule distraction.
- Êtes-vous musicienne, madame? demanda-t-il.
- J'aime beaucoup la musique, mais je n'ai guère le temps d'aller au théâtre ou au concert.
- Évidemment, fit-il, vos devoirs de maîtresse de maison, de mère de famille.
Thérèse secoua la tête.
- Je n'ai pas d'enfant. Mon unique petit est mort.
Elle se demanda pourquoi elle mentait, pourquoi elle reniait François, pourquoi elle provoquait le destin. Son compagnon s'excusa, désolé, disait-il, d'avoir effleuré ce sujet douloureux Elle lui sut gré de cette délicatesse, autant que si son deuil eût été réel. Au tournant d'une rue, elle le pria de la quitter. Il s'exécuta sans récriminer, Seule, furieuse de l'avoir congédie, sentant soudain le vide affreux de cette soirée qu'elle lui avait réservée, elle ne put que rentrer à la maison et dîner tristement avec ses élèves et leurs parents.
Ils se revirent un soir d'hiver par un gros froid. Le Dr Bing invita Thérèse à venir prendre une tasse de thé chez lui. Elle résista pour la forme et finit par accepter. L'appartement était accueillant, le dîner succulent et bien servi. Il n'en eût pas fallu tant pour que la soirée finit selon les prévisions de Thérèse et à la satisfaction de son hôte, Il ne lui posa aucune question et semblait prêt à croire tout ce qu'elle lui disait. Mais Thérèse, craignant d'être démasquée tôt ou tard, tint à ce qu'il connut au moins une partie de la vérité. À la visite suivante elle raconta à son amant qu'elle avait été mariée, mais qu'elle était divorcée; son mari l'avait quittée après la mort de leur enfant. Comme elle avait renoncé à toute aide pécuniaire de la part de cet homme, elle avait dû gagner sa vie et s'était placée comme institutrice. Le Dr Bing prit sa main, la baisa et se montra plus respectueux encore qu'avant.
Ils se voyaient tous les quinze jours régulièrement. Thérèse attendait impatiemment le moment de se retrouver dans l'appartement douillet, sous la lumière tamisée des lampes, de goûter aux menus, savamment combinés par le maitre de maison. Cette aventure faisait diversion dans la morne uniformité de sa vie, et elle aimait les accessoires de sa liaison plus encore que son amant. Il était resté le même, sa voix demeurait harmonieuse et voilée, sa façon de parler précieuse et charmante; mais ce qu'il disait n`intéressait plus son amie. Quand il parlait politique, on eût dit qu'il s'adressait à un collègue au ministère, tant son ton était sec et tranchant; il choisissait souvent pour ses dissertations les moments les moins appropriés; ses rapports sur les théâtres avaient quelque chose de conventionnel qui rappelèrent à Thérèse certains comptes rendus de journaux. Elle préférait l'entende parler de sa mère qu'il adorait et qu'il disait supérieurement bonne et intelligente. Discrètement, ais avec une évidente satisfaction, M. Bing offrit à Thérèse d'améliorer sa situation par une modeste rente mensuelle. Elle refusa d'abord, puis accepta.
Cette époque paisible de sa vie eût pu être heureuse, si elle n'avait senti plus que jamais tout le décousu, toute l'insipidité de son existence. Tentée parfois de se confier à l'homme qui était son amant, elle se ressaisissait sur la pente des aveux; son silence lui était dicté autant par sa naturelle réserve que par la résistance passive qu'elle sentait en son ami. Il évitait ses confidences, soucieux de garder son indépendance et d'écarter les responsabilités. Thérèse ne se leurrait pas; elle sentait que cette liaison était éphémère, autant que sa situation chez les fabricants demeurait provisoire. ..."
La génération d'après la guerre se détache du naturalisme des non-dits d'Arthur Schnitzler, l'introspection fine et les jeux de société bourgeoise viennoise paraissent dépassées face à l'absurdité et la violence de l'Histoire ..
Il se sentit isolé ; le suicide de sa fille et la mort tragique de son ami Hofmannsthal le rejetèrent dans un pessimisme amer et désespéré. Après "Thérèse, chronique de la vie d'une femme", sa dernière œuvre, "Fuite dans les ténèbres" (Flucht in die Finsternis, 1931), est le message ultime d'un psychologue génial, obsédé par la mort et la folie ...

Hugo Hofmannsthal (1874-1929)
Natif de Vienne, Hugo Hofmannsthal se lie avec Stefan George qui dirigeait Feuilles pour I'art (Blätter für die Kunst), la revue du symbolisme allemand. Il compose entre seize et vingt-cinq ans toutes ses Poésies - mais refuse de suivre Stefan George dans un hermétisme trop fermé - tout autant que ses premiers drames lyriques : "Hier", "La Mort du Titien" (Der Tod des Tizian, 1892), "Le fou et la mort" (Der Tor und der Tod, 1893), "La Dame à la fenêtre", "La Mine de Falun", "L'Aventurier et la cantatrice" (Der Abenteurer und die Sängerin), l'ensemble formant un "petit théâtre du monde" pour reprendre le titre d'un de ses drames, "Das Kleine Welttheater".Le poète habite à Vienne, y fut accueilli dans les salons et les cercles littéraires et devint l'ami de Schnitzler et de Bahr. Se rendant souvent à Paris, c'est pourtant Venise qu'il choisit à plusieurs reprises pour y camper les personnages de son théâtre. C'est en Italie qu'il connut Gabriele D'Annunzio (1863-1938) et la rivale italienne de Sarah Bernhardt, Eleonora Duse (1858-1924), qu'il admira tant. Suivirent alors des tragédies d'inspiration grecque ou élisabéthaine : "Electra", "OEdipe et le Sphinx", "Venise sauvée".
C'est avec "La Femme sans ombre" que Hugo Hofmannsthal accède à la maturité et c'est de cette époque que datent ses meilleures œuvres en prose, et qui comptent parmi les meilleures qu'ait produites la langue allemande. "Andreas"
Il écrit par la suite des livrets d'opéra pour le compositeur Richard Strauss - Le Chevalier à la rose (Der Rosenkavalier, 1911), Aríanne à Naxos (Ariadne auf Naxos, 1912), La Femme sans ombre (Die Frau ohne Schatten), Hélène d'Ègypte, Arabella, deux grands drames religieux et politiques, proches des oeuvres de Claudel, Le Grand Théâtre du monde de Salzbourg" et "La Tour", qui constituent en quelque sorte son testament spirituel. Il mourut d'une crise cardiaque le jour de l'enterrement de son fils, Franz, mort par suicide...
"La Femme sans ombre" (Die Frau ohne Schatten)
Opéra en trois actes de Richard Strauss (1864-1949) sur un livret de Hugo von Hofmannsthal et représenté pour le première fois à Vienne en 1919. L'Ombre est le symbole procréateur de vie, cause et fin de tout bonheur humain; la femme qui en est dépourvue ne peut avoir de descendance. Tel est le sens allégorique du livret qui, de tous ceux qu'Hofmannsthal écrivit pour Strauss est considéré comme le plus hermétique. La symbolique est partout. Chaque personnage, chaque fait signifie quelque chose qui dépasse sa nature et échappe le plus souvent à la compréhension du spectateur. On entre dans l'histoire par un personnage, le teinturier Barak, mari malheureux d'une femme qui, bien qu'elle le puisse, ne veut pas lui donner d'enfant. Elle est poussée par une force magique à vendre son ombre à une reine qui en est privée et qui si elle ne réussit pas à s'en procurer une dans un temps limité, s'est vue condamnée. par la volonté de son père - souverain du royaume des esprits - à revenir au domaine paternel après avoir abandonné son époux bien-aimé, tandis qu'il sera changé en pierre. Conseillée par sa nourrice, la reine descend sur terre et pousse la femme du teinturier à lui céder son ombre; mais, émue par le douleur de Barak, inconsolable de ne pouvoir être père, elle décide de renoncer à son projet et, à ce prix, obtient la maternité en récompense. Barak aussi est favorisé: sa femme lui donne enfin l'enfant tant désiré. Tout s'achève donc dans une apothéose édifiante. L'orchestration de Strauss est suffisamment riche et sensible pour savoir, mieux que le conte lui-même, alterner le terrestre et le surnaturel de l'intrigue.
