- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

La Revolución Mexicana - Mariano Azuela (1873-1952), "Los de abajo" (Ceux d'en-bas, 1916) - Martín Luis Guzmán (1887-1977), "El Águila y la Serpiente" (1928), "La Sombra del Caudillo" (1929) - ....
Last update: 2023/11/11

Les crises mondiales et l’éveil de la conscience nationale au début du XXe siècle ont produit de violentes révolutions politiques en Russie, en Chine, en Iran et dans d’autres pays, en particulier au Mexique. L’expansion économique de l’Europe occidentale et des États-Unis dans ces cultures indigènes exceptionnellement fortes a considérablement affecté leurs politiques, leurs productions et leurs pratiques culturelles. En 1910, se posent un certain nombre de questions qui ne peuvent rester sans réponse, la concentration de la richesse et du pouvoir entre les mains des élites métropolitaines et des étrangers, l’érosion du statut des élites provinciales et locales, artisans, ouvriers industriels, petits agriculteurs et ouvriers agraires.
Le Mexique a été la première révolution réussie....
Ses révolutionnaires venaient de tous les niveaux de la société. Les élites dissidentes ont rejoint les masses dans une guerre civile violente et prolongée. Les insurgés étaient assez forts pour réussir là où leurs homologues iraniens ont échoué, et ils l’ont fait sans les défaites écrasantes dans les guerres étrangères qui ont affaibli les anciens régimes en Russie et en Chine. Les révolutions dans ces quatre pays sont nées de conditions similaires. Les gouvernements avaient essayé de moderniser chaque pays par l’expansion économique alimentée par le capital étranger, la privatisation ou la commercialisation de l’agriculture, et les dictatures centralisées. Dans chaque cas, ces programmes ont produit des demandes de participation politique plus large, de réforme agraire et de contrôle national des ressources et des moyens de production. Au Mexique, la stagnation de la vie politique, économique et culturelle, la toute-puissance des étrangers et la faiblesse du gouvernement mexicain ont donné naissance à un soulèvement populaire sans précédent en Occident....
Le roman de la révolution mexicaine est généralement défini comme un long récit en prose traitant du bouleversement révolutionnaire qui a commencé en 1910. Beaucoup de ces romans se concentrent sur les aspects militaires du conflit au cours de la décennie suivante, mais d’autres racontent son effet sur les civils ou se déroulent après 1920. Ces œuvres sont souvent décrites comme épisodiques et même cinématographiques, en raison de leurs courtes scènes et de leur manque de profondeur psychologique. Ils sont souvent autobiographiques; en effet, certaines des œuvres les plus connues du groupe ne sont pas des romans au sens conventionnel, mais sont plutôt des récits d’expérience personnelle. Bien que toutes ces œuvres soient nationalistes dans la mesure où leurs décors, thèmes et personnages sont entièrement mexicains, elles n’offrent en aucun cas une vision positive de la Révolution et de ses réalisations. Leurs auteurs sont susceptibles d’être critiques ou désillusionnés ou au mieux ambivalents concernant les personnes et les événements qu’ils décrivent...

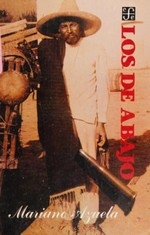

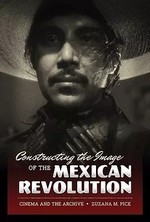
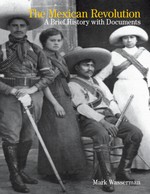



En 1900, en Amérique latine, la demande étrangère en matières premières provoqua un boom économique, qui donna aux Etats les moyens d`absorber une énorme vague d'immigration. Le continent vit ainsi pousser un peu partout des villes construites sur le modèle européen. Au Mexique, le schéma de croissance provoqua une explosion sociale dévastatrice. Sous la longue dictature de Porfirio Díaz,- trente-quatre ans, 1871-1911, dans un système de corruption organisée (David Alfaro Siqueiros l'a représenté les pieds sur la Constitution, entouré de capitalistes et de femmes du monde) -, les capitaux étrangers affluèrent pour être investis dans le développement des mines d`argent et de cuivre du Nord, dans l'industrie pétrolière (les 10 000 barils de brut de 1901 passèrent ainsi à 15 millions en 1911, plaçant le Mexique dans le peloton de tête des pays exportateurs de pétrole), dans les exportations de produits agricoles (sucre du Yucatan), et dans la construction ferroviaire, routière et portuaire. C'est ainsi qu'à l'aube du XXe siècle le cinquième du territoire mexicain était, dit-on, aux mains des capitaux britanniques et américains. L'accroissement de la production semblait malheureusement aller de pair avec une aggravation de la pauvreté et, si les trois quarts des Mexicains travaillaient la terre, c'était pour 95 pour cent d`entre eux en tant que journaliers, réduits à un quasi-servage, par 8 000 à 9 000 gros planteurs mexicains et étrangers qui se partageaient les terres. La dimension de l'oppression - et la rapidité des expropriations - explique la férocité de la Révolution mexicaine qui, dans la seconde décennie du siècle, fit près de 250 000 morts ...
On a souvent écrit que le retard des pays andins aurait été l'effet de l'inertie d'une population à prédominance indienne, des interprétations racistes qui se recoupent alors avec le positivisme de Spencer et de Comte, idéologie favorite de cette période d'avant-guerre, et elles sont particulièrement à l'honneur dans le Mexique de Porfirio Díaz. Celui-ci était lui-même d'ascendance indienne et son gouvernement résolument créole, mais seuls sont appréciés alors les idées, les modes et les spécialistes européens, l'art et la culture indigènes étant tenus pour rien. La main-d'œuvre indienne alimente une révolution industrielle et commerciale dont bénéficient les élites créoles et les capitalistes étrangers. Par une ironie du sort, la période de la Reforma, avant Díaz, associée au nom du grand président indien Juarez, a contribué à saper les fondements économiques et sociaux de la vie indienne. Les terres communales indiennes et les biens de l'Église ont été également jugés comme des entraves au progrès, mais leur vente n'a servi qu'à agrandir les grands domaines et les propriétés des étrangers qui, vers 1910, possèdent entre un cinquième et un septième de toute la terre mexicaine. Les Indiens constituent désormais un prolétariat sans terres, tandis que les plantations de canne à sucre du Morelos ou de henequen du Yucatan s'étendent pour répondre à la demande qui s'accroît dans les premières années du siècle.


La révolution du Mexique est le fait dominant de la première moitié du XXe siècle, mais, sur le plan international, ses répercussions sont tout de même moins importantes que celles, plus tard, de la révolution cubaine. Elle résulte des tensions internes d'une économie en expansion, dans laquelle la classe moyenne mexicaine a été frustrée d'une partie du pouvoir économique et politique qui lui revenait, et qui ne permet plus aux hacíendas traditionnelles de concurrencer les exploitations à haut rendement de l'élite porfirienne et des capitalistes étrangers.
"Madero a libéré un tigre", "voyons un peu comment il va l'apprivoiser" - Francisco Madero (1873-1913), le premier leader révolutionnaire, - nommé président à la place de Diaz en novembre 1911 -, est un spiritualiste à la parole douce, issu d'une famille de propriétaires du nord enrichis par la distillation de l'eau-de-vie, curieux héraut pour l'une des révolutions les plus destructrices des temps modernes. C'est un libéral à l'ancienne mode, influencé par la politique moraliste nord-americaine, convaincu que la réforme politique suffira à régénérer la société mexicaine. Mais il sous-estime les aspirations agraires des paysans et s'aliène le soutien de Zapata en refusant de prendre les armes contre les grands propriétaires. Son assassinat en 1915 lui vaut un regain de popularité et lui confère, dans la mort, une grandeur qui lui a échappé de son vivant.
Sa disparition provoque des conflits entre les caudillos régionaux : Obregón et Calles de Sonora dans le nord-ouest, Villa de Chihuahua et Carranza de Coahuila dans le nord, tous ces États étant particulièrement perméables à l'influence nord-américaine et présentant une plus grande mobilité sociale que les provinces plus étroitement contrôlées avoisinant la capitale.
Pendant quatre ans, les adversaires avancent et reculent le long des voies ferrées, et Mexico est investie tour à tour par les armées rivales. Pendant quatre ans, Villa, Zapata, Huerta et Carranza se battent. Venustiano Carranza (1859-1920) finit par l'emporter, et la constitution qu'il établit en 1917 demeure la base de la République mexicaine. Président du Mexique de 1915 à 1920, il est assassiné le 21 mai 1920 à Tlaxcalantongo. Ardent nationaliste, il saura s'opposer dès avril 1914, à un débarquement des Américains venus intimider son ennemi, le général Huerta, à Veracruz, et en 1916, il empêcha la capture de Villa lors de l'expédition punitive dirigée par le général Pershing en réponse au raid mené contre la ville frontalière américaine de Colombus (Nouveau-Mexique). Il fâchera les États-Unis en instituant la nation mexicaine propriétaire de l'industrie pétrolière et jouera un rôle clé en prônant la neutralité du Mexique lors de la Première Guerre mondiale....
Les immenses peintures murales de Diego Rivera (1886-1957), José Clemente Orozco (1883-1989) et David Alfaro Siqueiros (1896-1974) illustrent pour le peuple les leçons de la guerre. Carranza, idéalisé par González Camarena (1908-1980), qui fait une figure puissante d 'un homme chétif et peu imposant. Dans une autre représentation, Marx harangue les ouvriers et montre du doigt la terre promise, tandis que les forces corrompues de la société, l'armee et l'Eglise amassent leurs richesses....
En 1917, une Constitution est donc proclamée, formulant les principes révolutionnaires qui devront inspirer la codification à venir : agrarianisme, indianisme, socialisme, nationalisme, anticléricalisme, non-rééligibilité du président.
Un trait particulier au Mexique est la façon dont le mythe révolutionnaire trouve son expression dans l'art plutôt que dans la littérature.
Remontant aux sources indiennes et s'inspirant de la tradition extraordinairement riche de l'art populaire, des peintres - dont les plus célèbres sont Rivera, Orozco et Siqueiros, créent un art mural révolutionnaire sans équivalent et, mieux que les écrivains, constituent l'avant-garde culturelle mexicaine. Rappelons toutefois les quelques écrivains de la Révolution mexicaine tels que Mariano Azuela (1873-1952), qui, avec "Los de abajo" (Ceux d'en bas, 1916), le premier roman de la révolution mexicaine, et "Los Fracasados" (Les Ratés de la vie, 1908), qui dénonce, non sans ironie, les injustices politiques et sociales, voire la réalité de la révolution elle-même, et Martín Luis Guzmán (1887-1977), avec "El Águila y la Serpiente" (1928), "La Sombra del Caudillo" (1929)...
Les années vingt inaugureront la recherche d'une identité nouvelle. La Première Guerre mondiale met fin à l'emprise culturelle exercée par l'Europe sur l'Amérique latine depuis l'indépendance. Après ce massacre, nombreux sont ceux qui pensent que l'Europe a perdu le droit de tenir le flambeau de la civilisation. Ils s'intéressent toujours aux dernières créations de la poésie et de l'art d'avant-garde, mais ils se tournent vers d'autres sources d'inspiration....
En 1921, après la fin de la phase militaire de la Révolution, le général Alvaro Obregón accède au pouvoir. Le Mexique quitte la tourmente d'un État "oligarchique" pour un État "moderne", favorisant l’urbanisation, la petite bourgeoisie, et les éléments d'une nouvelle identité mexicaine, tant sur le plan culturel (Escuela Mexicana de Pintura y Escultura) que politique....

La révolution mexicaine a commencé en 1910 avec le renversement du dictateur Porfirio Diaz. "The Wind That Swept Mexico", écrit par Anita Brenner et publié en 1943, est le premier livre à présenter un large compte rendu de cette révolution dans ses différentes phases. En 1971, second ouvrage d'importance, "The Mexican Revolution", écrit par Adolfo Gilly, et le concours du grand poète mexicain Octavio Paz...

Mariano Azuela (1873-1952)
Mariano Azuela, né à Lagos de Moreno (Etat de Jaliaco), fit des études de médecine et, dans de nombreux articles, prit violemment parti contre le régime corrompu de Porfirio Diaz. Lorsque éclata la révolution, il s'engagea dans les troupes de Pancho Villa; après la défaite de ce dernier, il dut s'exiler aux U.S.A., où il composa son chef-d'oeuvre, "Los de abajo", qui devait faire de lui l`un des maitres de la littérature mexicaine. Le roman a été publié dans un journal de langue espagnole El Paso en 1915 et publié sous forme de livre en 1916, mais il est resté pratiquement inconnu jusqu’à sa redécouverte au milieu des années 1920. A la fois épique et objectif, réaliste et lyrique, Azuela s'est surtout préoccupé de dénoncer la misère et l'injustice dans ses nombreux romans, parmi lesquels ""Mala yerba" (1909), "Los caciques" (1917; The Bosses, 1956), "Las Moscas" (1918), "Las tribulaciones de una familia decente" (1919; The Trials of a Respectable Family, 1963), "La Luciernaga" (1932), "Pedro Moreno el insurgente" (1935). Il commentera son attitude envers la Révolution en écrivant : « mon amertume est dirigée contre les hommes, pas contre l’idée, les hommes qui corrompent tout »...
"Ceux d'en bas" (Los de abajo (1915; traduit en 1929 en anglais "The Underdogs) fut durant longtemps frappé par une conspiration du silence de la part des critiques mexicains traditionalistes; c'est que l'œuvre qui, par son contenu et sa technique, échappait à leur entendement, contrariait par son pessimisme, son hétérodoxie, sa lucidité aussi, les critiques révolutionnaires (Trad. avec une Préface de Valery Larbaud, 1930).

Mariano Azuela (1873-1952), "Los de abajo" (Ceux d'en-bas, 1916)
Durante la Revolucion Mexicana, Mariano Azuela fue medico de la faccion la que comandaba Francisco Villa, de ahi que algunas de sus mas notables obras literarias esten inspiradas por aquellos hechos de armas. Entre todas ellas, Los de abajo, redactada en 1915 en El Paso (Texas), sintetiza admirablemente lo que el ilustre escritor pensaba de la Revolucion y como vio el mismo su furia destructora. Se trata de una historia descarnada, concebida con la sinceridad y la valentia de un hombre que nunca cedio a la tentacion de adornar artificiosamente o de falsear los acontecimientos, y escrita con un lenguaje directo que auna la belleza a la sencillez....
"Mira esa piedra como ya no se para…" - Cette description de la révolution mexicaine a inauguré un genre littéraire qui prospère encore aujourd'hui. Chronique d'événements historiques, écrite peu de temps après que les derniers ne se soient produíts, c'est aussi un poème épique qui traite des déshérités et a pour personnage central un héros fictif et idéalisé, Demetrio Macias. Victime des abus du pouvoir, il abandonne sa famille pour se lancer dans une révolte qui ne prendra fin qu'à sa mort. Deux années durant, il harcèle l'armée a la téte d'une bande de rebelles. Ce qui ne paraissait au début qu'une révolte désorganisée trouve vite une justification idéologique et une protection collective conférées dans le discours de Luís Cervantes, médecin et journaliste. Sous son aile protectrice, Macias devient un leader révolutionnaire, mais la coexistence des deux hommes est vite remise en cause par la jalousie et l'avidité. Abandonné par Cervantes, après avoir perdu le soutien des paysans et oublié l'objectif de sa lutte, qui tourne à la vengeance, il ne retrouve sa famille que pour mourir...
Relatant les exploits d’une bande de paysans révolutionnaires dirigée par Demetrio Macias, le roman révèle les convictions d’Azuela sur la futilité du conflit. Dans celui-ci, Macías se bat d’abord contre les fédéraux de Huerta et plus tard contre les Carrancistas sans motif clair. Lorsque sa femme lui demande pourquoi il se bat, il répond en jetant un caillou dans un ravin et en le regardant rouler. Alberto Solís, un personnage souvent vu comme le porte-parole d’Azuela, répond à la même question en comparant la Révolution à un ouragan : « L’homme qui s’y rend n’est plus un homme mais une misérable feuille sèche ballottée par la tempête. » Luis Cervantes, le seul personnage qui parle de la Révolution comme d’une lutte pour la liberté et la justice, est un opportuniste qui s’était opposé à Madero et a soutenu Huerta...
Sobre, dépourvue de tout lyrisme, l'oeuvre est émouvante par sa vérité et sa sincérité. Les personnages y parlent un langage réel, un langage qui les différencie et les caractérise. Les mexicanismes, les impropriétés de la langue parlée y sont respectés. Le narrateur intervient directement pour dénoncer certains problèmes hérités du XIXe siècle. L'agilité d'un dialogue qui change de registre lexical selon la situation de chaque personnage, les alternances de temps qui offrent à chaque scène le rythme approprié, et les descriptions impressionnistes de la nature et des personnages en font un texte moderne qui a influencé les meilleurs des romans mexicains ultérieurs ...
Primera parte, Capítulo 13, p.49.
- Yo soy de Limón, allí, muy cerca de Moyahua, del puro cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo de tierra para sembrar; es decir, que nada me faltaba. Pues, señor, nosotros los rancheros tenemos la costumbre de bajar al lugar cada ocho días. Oye uno su misa, oye el sermón, luego va a la plaza, compra sus cebollas, sus jitomates y todas las encomiendas. Después entra uno con los amigos a la tienda de Primitivo López a hacer las once. Se toma la copita; a veces es uno condescendiente y se deja cargar la mano, y se le sube el trago, y le da mucho gusto, y ríe uno, grita y canta, si le da su mucha gana. Todo está bueno, porque no se ofende a nadie. Pero que comienzan a meterse con usté; que el policía pasa y pasa, arrima la oreja a la puerta; que al comisario o a los auxiliares se les ocurre quitarle a usté su gusto... ¡Claro, hombre, usté no tiene la sangre de horchata, usté lleva el alma en el cuerpo, a usté le da coraje, y se levanta y les dice su justo precio! Si entendieron, santo y bueno; a uno lo dejan en paz, y en eso paró todo. Pero hay veces que quieren hablar ronco y golpeado... y uno es lebroncito de por sí... y no le cuadra que nadie le pele los ojos...
Y, sí señor; sale la daga, sale la pistola... ¡Y luego vamos a correr la sierra hasta que se les olvida el difuntito!
- Je suis de Limón, là, tout près de Moyahua, dans le pur canyon de Juchipila. J'avais ma maison, mes vaches et un lopin de terre à semer ; autrement dit, je ne manquais de rien. Eh bien, monsieur, nous, les éleveurs, avons l'habitude de nous rendre sur place tous les huit jours. Vous entendez la messe, le sermon, puis vous allez à la plaza, vous achetez vos oignons, vos tomates et tous les produits d'épicerie. Ensuite, tu vas avec tes amis au magasin de Primitivo López pour faire onze heures. Parfois, l'un d'entre eux est condescendant et se laisse tenir la main, et la boisson monte, et il apprécie beaucoup, rit, crie et chante, s'il en a envie. Tout va bien, car personne n'est offensé. Mais quand on commence à vous harceler, quand le policier passe et repasse, et colle son oreille à la porte, quand il vient à l'idée du commissaire ou des auxiliaires de vous priver de votre plaisir ? Bien sûr, mon vieux, tu n'as pas le sang de la horchata, tu as ton âme dans ton corps, tu as du courage, et tu te lèves et tu leur dis ton juste prix ! S'ils ont compris, saint et bon, ils te laissent en paix, et c'est là que tout s'est arrêté. Mais il y a des moments où ils veulent parler rauque et battu... et toi tu es un peu lebroncito de nature... et ça ne t'arrange pas qu'on te pèle les yeux....
Et, oui monsieur, sortez le poignard, sortez le pistolet... Et puis on va passer la scie jusqu'à ce qu'ils oublient le petit diffunct !
"Bueno. ¿Qué pasó con don Mónico? ¡Faceto! Muchísimo menos que con los otros. ¡Ni siquiera vio correr el gallo!... Una escupida en las barbas por entrometido, y pare usté de contar... Pues con eso ha habido para que me eche encima a la federación. Usté ha de saber del chisme ése de México, donde mataron al señor Madero y a otro, a un tal Félix o Felipe Díaz, ¡qué sé yo!... Bueno: pues el dicho don Mónico fue en persona a Zacatecas a traer escolta para que me agarraran. Que diz que yo era maderista y que me iba a levantar. Pero como no faltan amigos, hubo quien me lo avisara a tiempo, y cuando los federales vinieron a Limón, yo ya me había pelado. Después vino mi compadre Anastasio, que hizo una muerte, y luego Pancracio, la Codorniz y muchos amigos y conocidos.
Después se nos han ido juntando más, y ya ve: hacemos la lucha como podemos."
"Eh bien, qu'est-il arrivé à Don Monico ? Faceto ! Beaucoup moins que les autres, il n'a même pas vu le coq courir !.... Un crachat sur sa barbe pour s'être mêlé de ce qui ne le regarde pas, et on arrête de compter.... Il n'en fallait pas plus pour que je me jette la fédération à la figure. Vous devez être au courant de ces ragots au Mexique, où ils ont tué M. Madero et un autre, un certain Felix ou Felipe Diaz, qu'est-ce que j'en sais ? Eh bien, ledit Don Monico s'est rendu en personne à Zacatecas pour amener une escorte afin qu'ils puissent m'attraper. Il a dit que j'étais un Maderista et que j'allais me soulever. Mais comme on ne manque pas d'amis, quelqu'un m'a prévenu à temps et lorsque les fédéraux sont arrivés à Limón, j'avais déjà été arrêté. Ensuite, mon compadre Anastasio est mort, puis Pancracio, La Codorniz et beaucoup d'amis et de connaissances.
De plus en plus de gens nous ont rejoints, et vous voyez : nous nous battons du mieux que nous pouvons".
- Mi jefe - dijo Luis Cervantes después de algunos minutos de silencio y meditación—, usted sabe ya que aquí cerca, en Juchipila, tenemos gente de Natera; nos conviene ir a juntarnos con ellos antes de que tomen Zacatecas. Nos presentamos con el general...
- No tengo genio para eso... A mí no me cuadra rendirle a nadie.
- Pero usted, sólo con unos cuantos hombres por acá, no dejará de pasar por un cabecilla sin importancia. La revolución gana indefectiblemente; luego que se acabe le dicen, como les dijo Madero a los que le ayudaron: "Amigos, muchas gracias; ahora vuélvanse a sus casas..."
- No quiero yo otra cosa, sino que me dejen en paz para volver a mi casa.
- Allá voy... No he terminado: "Ustedes, que me levantaron hasta la Presidencia de la República, arriesgando su vida, con peligro inminente de dejar viudas y huérfanos en la miseria, ahora que he conseguido mi objeto, váyanse a coger el azadón y la pala, a medio vivir, siempre con hambre y sin vestir, como estaban antes, mientras que nosotros, los de arriba, hacemos unos cuantos millones de pesos."
Demetrio meneó la cabeza y sonriendo se rascó:
- ¡Luisito ha dicho una verdad como un templo! - exclamó con entusiasmo el barbero Venancio.
- Como decía -prosiguió Luis Cervantes -, se acaba la revolución, y se acabó todo. ¡Lástima de tanta vida segada, de tantas viudas y huérfanos, de tanta sangre vertida! Todo, ¿para qué? Para que unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes. Usted es desprendido, y dice: "Yo no ambiciono más que volver a mi tierra". Pero ¿es de justicia privar a su mujer y a sus hijos de la fortuna que la Divina Providencia le pone ahora en sus manos? ¿Será justo abandonar a la patria en estos momentos solemnes en que va a necesitar de toda la abnegación de sus hijos los humildes para que la salven, para que no la dejen caer de nuevo en manos de sus eternos detentadores y verdugos, los caciques?... ¡No hay que olvidarse de lo más sagrado que existe en el mundo para el hombre: la familia y la patrial...
- Comme je le disais, poursuit Luis Cervantes, la révolution est finie, et tout est fini. Dommage que tant de vies aient été fauchées, tant de veuves et d'orphelins, tant de sang versé ! Tout cela pour quoi ? Pour que quelques coquins s'enrichissent et que tout reste comme avant ou pire. Vous êtes détaché et vous dites : "Je n'ai d'autre ambition que de retourner sur ma terre". Mais est-il juste de priver votre femme et vos enfants de la fortune que la divine Providence a mise entre vos mains ? Est-il juste d'abandonner la patrie en ce moment solennel où il faudra toute l'abnégation de vos humbles enfants pour la sauver, pour qu'ils ne la laissent pas retomber entre les mains de ses éternels propriétaires et bourreaux, les caciques ?.. Il ne faut pas oublier ce qu'il y a de plus sacré au monde pour l'homme : la famille et la patrie ?
Macías sonrió y sus ojos brillaron.
- ¿Qué, será bueno ir con Natera, curro?
- No sólo bueno —pronunció insinuante Venancio -, sino indispensable, Demetrio.
-Mi jefe - continuó Cervantes-, usted me ha simpatizado desde que lo conocí, y lo quiero cada vez más, porque sé todo lo que vale. Permítame que sea enteramente franco. Usted no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión.
-Vous mon chef, reprit Cervantès, vous avez sympathisé avec moi depuis que je vous connais, et je vous aime de plus en plus, parce que je sais ce que vous valez. Permettez-moi d'être tout à fait franc. Vous ne comprenez pas encore votre véritable, votre haute et noble mission.
Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta revolución. Mentira que usted ande por aquí por don Mónico, el cacique; usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del des-tino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo.
No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza; por ellos estamos luchando nosotros.
Toi, homme modeste et sans ambition, tu ne veux pas voir le rôle très important que tu joues dans cette révolution. Il est faux de dire que vous êtes ici à cause de Don Monico, le cacique ; vous vous êtes soulevés contre le caciquismo qui ravage toute la nation. Nous sommes les éléments d'un grand mouvement social qui doit s'achever pour l'agrandissement de notre pays. Nous sommes des instruments du destin pour la revendication des droits sacrés du peuple. Nous ne luttons pas pour renverser un misérable assassin, mais contre la tyrannie elle-même. C'est ce qu'on appelle se battre pour des principes, avoir des idéaux. Villa, Natera, Carranza se sont battus pour eux ; nous nous battons pour eux.
- Sí, sí; cabalmente lo que yo he pensado - dijo Venancio entusiasmadísimo.
- Pancracio, apéate otras dos cervezas..
"Los de abajol" (1916) est donc le premier roman consacré à la Révolution mexicaine, Azuela a laissé son témoignage sur l'explosion populaire qui devait renverser le régime du président Porfirio Díaz et modifier profondément le destin du Mexique. Médecin dans le camp de Pancho Villa, l'auteur put observer les réactions de "ceux d'en bas", les révolutionnaires, et même entendre leurs confidences. Et il raconte. Pourquoi sont-ils entrés dans la "bola", - terme par lequel ils désignent la Révolution -, qu'en attendaient-ils, savaient-ils eux-même où ils allaient? Tous se battent en effet mais tous n'ont pas le même idéal, les mêmes intentions, les mêmes impulsions. Certains sont des purs, d`autres libèrent les forces du mal qu'ils portent en eux. Les nombreuses scènes de pillage évoquées en sont la preuve. On peut être un héros, on peut aussi être un voleur ou un bandit ("El tema del "yo robé", aunque parece inagotable, se va extinguiendo cuando en cada banca aparecen tendidos de naipes, que atraen a jefes y oficiales como la luz a los mosquitos"). L'aveuglement de "ceux d`en haut", les privilégiés, a déchaîné la violence de l'Histoire et celle-ci est incontrôlable. Ainsi, le "güero" (le blond) Margarito est entré dans la "bola" pour assouvir ses instincts brutaux, pour tuer et pour violer (il finira par se suicider). "La codorniz" (la Caille) se bat pour le plaisir, par divertissement. Les deux protagonistes du roman, le "ranchero" Demetrio Macias et l'universitaire Luis Cervantes incarnent deux attitudes révolutionnaires opposées, deux conceptions de l'action et de la vie...
Ainsi lorsque Luis Cervantes rencontre pour la première fois Demetrio Macías, parle-t-il à propos des rebelles de "coreligionnaire" (Primera parte, Capítulo 5), un terme qui leur est totalement étranger, il ne parvient pas tout simplement à traduire en mots compréhensibles la cause pour laquelle ils se battent...
- Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario...
- ¿Corre... qué? —inquirió Demetrio, tendiendo una oreja.
- Correligionario, mi jefe..., es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden.
Demetrio sonrió: —¿Pos cuál causa defendemos nosotros?...
Luis Cervantes, desconcertado, no encontró qué contestar.
- Mi' qué cara pone!... ¿Pa qué son tantos brincos?... ¿Lo tronamos ya, Demeterio? —
preguntó Pancracio, ansioso.
Demetrio llevó su mano al mechón de pelo que le cubría una oreja, se rascó largo rato, meditabundo; luego, no encontrando la solución, dijo:
- Sálganse... que ya me está doliendo otra vez... Anastasio, apaga la mecha. Encierren a ése
en el corral y me lo cuidan Pancracio y Manteca. Mañana veremos.
- ¡Ah, Villal... La palabra mágica. El gran hombre que se esboza; el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. - ¡Nuestro Napoleón mexicano! —exclama Luis Cervantes. - Sí, "el Águila azteca, que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta"... Así dije en un discurso en Ciudad Juárez —habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera...
Primera parte, Capítulo 20, Luis Cervantes et Alberto Solís, un Cervantès qui veut exalter la figure de Villa, héros populaire, et qui le fait en se référant à la culture européenne, en le comparant à Napoléon, déçu de la révolution, il choisira le chemin du cynisme, alors que le désenchantement de Solis le conduit malgré tout à se référer à Villa comme l'"aigle aztèque", plus proche de l'imaginaire des soldats paysans, le voici choisissant au bout du compte de se laisser emporter par "huracán de la revolución"...
"Una silueta dolorida ha pasado por su memoria. Una mujer con su hijo en los brazos, atravesando por las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna... Una casa ardiendo..." (Segunda parte, Capítulo 5) - Une image qui vient à l’esprit de Démétrius alors que don Monique implore miséricorde pour sa femme et ses enfants lorsque les révolutionnaires envahissent sa maison, un Démétrius qui n'entend pas participer pas à cette violence insensée qui saisit ses hommes. Mais ni idéologue ni politique, il ne peut espérer quelque ascension et échapper à la machine infernale de la révolution....
Luis Cervantes, homme éduqué, réfléchit et calcule. Il est révolutionnaire par idéal mais il sait que, si la Révolution triomphe, elle lui donnera richesse et puissance. Comme elle se prolonge, il préfère opter pour la sécurité et se retirer à temps. ll s'installe à El Paso, en terre américaine, et profite des biens que la Révolution lui a rapportés. ll laisse Demetrio Macias et les hommes "d'en bas" poursuivre leur marche aveugle vers la mort...
Demetrio Macias s'est engagé dans les rangs de la Révolution pour se venger de ceux qui ont détruit son foyer et pour abattre ce féodalisme rural qui le persécute et l`écrase, lui et ses compagnons. Quand il retrouve pour la dernière fois sa femme, à la fin du roman, et qu'elle le supplie de ne plus repartir et lui demande : "Pourquoi se battre encore, Demetrio ?"
Demetrio, les sourcils froncés, ramasse distraitement un caillou et le jette au fond de la gorge. Il reste songeur en regardant le précipice et dit : "Tu vois, ce caillou, il ne s`arrête plus..."
La mujer de Demetrio Macías, loca de alegría, salió a encontrarlo por la vereda de la sierra, llevando de la mano al niño.
¡Casi dos años de ausencia! Se abrazaron y permanecieron mudos; ella embargada por los sollozos y las lágrimas. Demetrio, pasmado, veía a su mujer envejecida, como si diez o veinte años hubieran transcurrido ya.
La femme de Demetrio Macías, folle de joie, est allée à sa rencontre sur le sentier de la montagne, tenant son enfant par la main.
Presque deux ans d'absence ! Ils s'embrassent et se taisent, elle est submergée de sanglots et de larmes. Demetrio, stupéfait, voit sa femme vieillie, comme si dix ou vingt ans s'étaient déjà écoulés.
Luego miró al niño, que clavaba en él sus ojos con azoro. Ysu corazón dio un vuelco cuando reparó en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flamante de sus ojos. Y quiso atraerlo y abrazarlo; pero el chiquillo, muy asustado, se refugió en el regazo de la madre.
—¡Es tu padre, hijo!... ¡Es tu padre!...
El muchacho metía la cabeza entre los pliegues de la falda y se mantenía huraño.
Demetrio, que había dado su caballo al asistente, caminaba a pie y poco a poco con su mujer y su hijo por la abrupta vereda de la sierra.
—¡Hora sí, bendito sea Dios que ya veniste!... ¡Ya nunca nos dejarás! ¿Verdad? ¿Verdad que ya te vas a quedar con nosotros?...
La faz de Demetrio se ensombreció.
Y los dos estuvieron silenciosos, angustiados.
Una nube negra se levantaba tras la sierra, y se oyó un trueno sordo. Demetrio ahogó un suspiro. Los recuerdos afluían a su memoria como una colmena.
La lluvia comenzó a caer en gruesas gotas y tuvieron que refugiarse en una rocallosa covacha.
Puis il leva les yeux vers le garçon, qui le regardait avec admiration. Et son cœur bondit lorsqu'il remarqua la reproduction des mêmes lignes d'acier sur son visage, et l'éclat de ses yeux. Elle voulut l'attirer et l'embrasser, mais le petit garçon, très effrayé, se réfugia sur les genoux de sa mère.
-C'est ton père, mon fils, c'est ton père !
Le petit garçon mit sa tête entre les plis de sa jupe et resta maussade.
Démétrius, qui avait donné son cheval au préposé, marchait lentement avec sa femme et son fils sur le sentier escarpé de la sierra.
-Maintenant, Dieu soit béni, tu es venu... Tu ne nous quitteras plus jamais ! Ne veux-tu pas, ne veux-tu pas, rester avec nous ?
Le visage de Démétrius s'assombrit.
Et tous deux se taisent, angoissés.
Un nuage noir s'éleva derrière la chaîne de montagnes, et il y eut un sourd coup de tonnerre. Démétrius étouffa un soupir. Les souvenirs reviennent comme une ruche.
La pluie se mit à tomber à grosses gouttes et ils durent s'abriter dans une hutte rocheuse.
El aguacero se desató con estruendo y sacudió las blancas flores de San Juan, manojos de estrellas prendidos en los árboles, en las peñas, entre la maleza, en los pitahayos y en toda la serranía.
Abajo, en el fondo del cañón y a través de la gasa de la lluvia, se miraban las palmas rectas y
cimbradoras; lentamente se mecían sus cabezas angulosas y al soplo del viento se desplegaban en abanicos. Y todo era serranía: ondulaciones de cerros que suceden a cerros, más cerros circundados de montañas y éstas encerradas en una muralla de sierra de cumbres tan altas que su azul se perdía en el zafir.
—¡Demetrio, por Dios!... ¡Ya no te vayas!... ¡El corazón me avisa que ahora te va a suceder algo!... Y se deja sacudir de nuevo por el llanto.
El niño, asustado, llora a gritos, y ella tiene que refrenar su tremenda pena para contentarlo.
La lluvia va cesando; una golondrina de plateado vientre y alas angulosas cruza oblicuamente los hilos de cristal, de repente iluminados por el sol vespertino.
—¿Por qué pelean ya, Demetrio?
Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedrecita y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desfiladero, y dice:
—Mira esa piedra cómo ya no se para...
L'averse s'abattit avec fracas et secoua les fleurs blanches de San Juan, des grappes d'étoiles épinglées sur les arbres, sur les rochers, dans les sous-bois, sur les pitahayos et sur toute la chaîne de montagnes. En bas, au fond du canyon et à travers la gaze de la pluie, on voyait les palmiers droits et en crête ; lentement, leurs têtes anguleuses se balançaient et, dans le souffle du vent, elles se déployaient en éventails. Et tout était montagneux : des ondulations de collines succédant à des collines, d'autres collines entourées de montagnes et celles-ci enfermées dans un mur de montagnes aux sommets si hauts que leur bleu se perdait dans le saphir.
- Demetrius, pour l'amour de Dieu !... Ne pars pas maintenant !... Mon coeur me dit qu'il va t'arriver quelque chose !... Et il se laisse à nouveau secouer par les pleurs.
L'enfant effrayé pousse de grands cris, et elle doit contenir son immense chagrin pour le rendre heureux.
La pluie s'arrête ; une hirondelle au ventre argenté et aux ailes anguleuses traverse obliquement les fils de cristal, soudain illuminés par le soleil du soir. Pourquoi se battent-ils déjà, Démétrius ? Démétrius, les sourcils rapprochés, ramasse distraitement un caillou et le jette au fond du canyon. Il regarde la gorge d'un air pensif et dit : - Regarde cette pierre, elle ne s'arrête plus.....
Demetrius se livre à la Révolution avec une obstination aveugle, un fatalisme qui ne veut pas reconnaître l'échec, qui le pousse à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Son destin est de marcher avec ses hommes et de combattre, retrouvant ainsi le destin des anciens nomades. - "Dans leur cœur bouillonne le cœur des vieilles tribus nomades. Peu leur importe de savoir où ils vont et d'où ils viennent, ce qu'il faut c'est marcher, marcher sans cesse, ne jamais s'arrêter; être les maîtres de la vallée, des plaines, de la sierra et de tout ce que le regard embrasse." ....
"Fue una verdadera mañana de nupcias. Había llovido la víspera toda la noche y el cielo amanecía entoldado de blancas nubes. Por la cima de la sierra trotaban potrillos brutos de crines alzadas y colas tensas, gallardos con la gallardía de los picachos que levantan su cabeza hasta besar las nubes.
Los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiado de la alegría de la mañana. Nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante. La gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto. Y por eso los soldados cantan, ríen y charlan locamente. En su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas. Nada importa saber adónde van y de dónde vienen; lo necesario es caminar, caminar siempre, no estacionarse jamás; ser dueños del valle, de las planicies, de la sierra y de todo lo que la vista abarca. Arboles, cactus y helechos, todo aparece acabado de lavar. Las rocas, que muestran su ocre como el orín las viejas armaduras, vierten gruesas gotas de agua transparente.
Los hombres de Macías hacen silencio un momento. Parece que han escuchado un ruido conocido: el estallar lejano de un cohete; pero pasan algunos minutos y nada se vuelve a oír.
—En esta misma sierra —dice Demetrio—, yo, sólo con veinte hombres, les hice más de quinientas bajas a los federales.
C'était un vrai matin de noces. Il avait plu toute la nuit précédente et le ciel se levait avec des nuages blancs. Au sommet de la sierra trottaient de gros poulains à la crinière relevée et à la queue tendue, galants comme les picachos qui lèvent la tête pour embrasser les nuages. Les soldats marchent le long des escarpements du sol rocailleux, tout à la joie du matin. Personne ne pense à la balle acérée qui peut les attendre. La grande joie du départ réside entièrement dans l'inattendu. C'est pourquoi les soldats chantent, rient et bavardent sans retenue. L'âme des anciennes tribus nomades bouillonne dans leur esprit. Peu importe où ils vont et d'où ils viennent ; ce qu'il faut, c'est marcher, marcher toujours, ne jamais s'arrêter ; être maîtres de la vallée, des plaines, des montagnes et de tout ce que l'œil peut voir. Arbres, cactus et fougères, tout semble avoir été lavé. Les rochers, qui montrent leur ocre comme la rouille d'une vieille armure, versent d'épaisses gouttes d'eau transparente.
Les hommes de Macias restent un instant silencieux. Il leur semble avoir entendu un bruit familier : le souffle lointain d'une explosion ; mais quelques minutes s'écoulent et plus rien ne se fait entendre.
- Dans cette même sierra, dit Demetrio, avec seulement vingt hommes, j'ai infligé plus de cinq cents pertes aux Fédéraux.
Y cuando Demetrio comienza a referir aquel famoso hecho de armas, la gente se da cuenta del grave peligro que va corriendo. ¿Conque si el enemigo, en vez de estar a dos días de camino todavía, les fuera resultando escondido entre las malezas de aquel formidable barranco, por cuyo fondo se han aventurado? Pero ¿quién sería capaz de revelar su miedo? ¿Cuándo los hombres de Demetrio dijeron: "Por aquí no caminamos"?
Y cuando comienza un tiroteo lejano, donde va la vanguardia, ni siquiera se sorprenden ya. Los reclutas vuelven grupas en desenfrenada fuga buscando la salida del cañón. Una maldición se escapa de la garganta seca de Demetrio: - ¡Fuego!... ¡Fuego sobre los que corran!... ¡A quitarles las alturas! —ruge después como una fiera.
Et lorsque Démétrius commença à parler de ce fameux fait d'armes, ils comprirent le danger qui les guettait : et si l'ennemi, au lieu d'être à deux jours de marche, était caché dans les broussailles de ce formidable ravin, au fond duquel ils s'étaient aventurés ? Mais qui pourrait révéler sa peur, et quand une fusillade lointaine éclate, là où va l'avant-garde,s'ils ne sont pas surpris, les recrues s'abandonnent à une fuite éperdue, cherchant la sortie du canyon. Un juron s'échappe de la gorge sèche de Demetrio : -Feu !... Feu sur ceux qui courent !... et rugit comme une bête sauvage...
Pero el enemigo, escondido a millaradas, desgrana sus ametralladoras, y los hombres de Demetrio caen como espigas cortadas por la hoz. Demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando Anastasio resbala lentamente de su caballo sin exhalar una queja, y se queda tendido, inmóvil. Venancio cae a su lado, con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora y el Meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo. De repente Demetrio se encuentra solo. Las balas zumban en sus oídos como una granizada. Desmonta, arrástrase por las rocas hasta encontrar un parapeto, coloca una piedra que le defienda la cabeza y, pecho a tierra, comienza a disparar. El enemigo se disemina, persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros.
Demetrio apunta y no yerra un solo tiro... ¡Paf!... ¡Pan... ¡Pan...
Su puntería famosa lo llena de regocijo; donde pone el ojo pone la bala. Se acaba un cargador y mete otro nuevo. Y apunta...
Mais l'ennemi, caché avec ses milliers d'hommes, tire de ses mitrailleuses et les hommes de Démétrius tombent comme des épis de maïs coupés par la faucille. Démétrius verse des larmes de rage et de douleur tandis qu'Anastase glisse lentement de son cheval, sans une plainte, et reste immobile. Venancio tombe à ses côtés, la poitrine horriblement déchirée par la mitrailleuse, et le Meco dégringole et roule jusqu'au fond de l'abîme. Demetrio se retrouve soudain seul. Les balles résonnent à ses oreilles comme une tempête de grêle. Il descend de cheval, rampe sur les rochers jusqu'à ce qu'il trouve un parapet, place une pierre pour défendre sa tête et, le torse baissé, commence à tirer. L'ennemi se disperse, poursuivant les rares fugitifs qui restent cachés parmi les chaparros.
Demetrio vise et ne rate pas un seul coup... Paf !... Pan... Pain... Sa fameuse visée le remplit de joie ; là où il vise, il tire sa balle. Il n'a plus de chargeur, en met un nouveau et vise...
El humo de la fusilería no acaba de extinguirse. Las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso; las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas; ramonean apaciblemente las vacas. La sierra está de gala; sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia. Y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa, como pórtico de vieja catedral, Demetrio Macías con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón de su fusil..
La fumée de la fusillade ne s'est pas encore éteinte. Les cigales chantent leur imperturbable et mystérieuse chanson ; les pigeons chantent doucement dans les coins des rochers ; les vaches paissent paisiblement. La chaîne de montagnes est en fête ; sur ses sommets inaccessibles, la brume si blanche tombe comme un rideau de neige sur la tête d'une jeune mariée. Et au pied d'une immense crevasse, comme le portique d'une vieille cathédrale, Demetrio Macías, les yeux fixés à jamais, continue de pointer le canon de son fusil...

Martín Luis Guzmán (1887-1977)
"El águila y la serpiente" (1928; L’aigle et le serpent, 1930) a été écrit par Martin Luis Guzmán (1887-1976) alors qu’il vivait en Espagne de 1925 à 1936. Il s’agit d’un récit inédit des expériences de l’auteur de 1913, quand, en tant qu’ennemi de Huerta, il a fui aux États-Unis, à 1915, date à laquelle il a de nouveau quitté le Mexique après l’effondrement du gouvernement dirigé par Eulalio Gutiérrez. La figure dominante du livre, cependant, est Pancho Villa, que Guzmán considérait avec un mélange de fascination et de crainte. Plus tard, dans la semi-fiction "Memorias de Pancho Villa" (1951; Les Mémoires de Pancho Villa, 1965), il créera un récit à la première personne de la vie de Villa jusqu’en 1915. L’autre œuvre littéraire majeure de Guzmán, "La sombra del caudillo" (1929), ne fut publiée au Mexique qu’en 1938. Contrairement à la plupart des autres romans de la Révolution, celui-ci traite des événements après 1920, étant un récit fictif d’un concours présidentiel dans lequel le caudillo sans nom emploie la trahison et le meurtre pour installer son candidat choisi comme son successeur. Pour les lecteurs mexicains, le roman rappelle des événements réels, en particulier la révolte infructueuse des généraux Francisco Serrano et Arnulfo Gómez, qui s’est opposé à la réélection d’Alvaro Obregón en 1928. Guzmán dénonce la dictature dans le roman, mais les défauts de son protagoniste, le général Ignacio Aguirre, et ses partisans montrent clairement qu’il croit que les défauts du système politique mexicain ne peuvent pas être imputés uniquement au caudillo.

"AVEC PANCHO VILLA" (Memorias de Panchot Vílla)
Parmi les œuvres consacrées à la Révolution mexicaine, la gigantesque épopée de Martin Luis Guzman (1887-1977), publiée en 1938-39, - un millier de pages - occupe une place reconnue. Hommage vibrant à cette Révolution, Guzmán y fait parler Villa lui-même, et cette audacieuse fiction lui permet de brosser un portrait particulièrement réussi du caudillo mexicain. Sa grande ombre couvre tout le roman, dans sa rigueur et sa rudesse. Il apparaît comme pris sur le vif, véritable instantané photographique multiplié au travers des différents chapitres. Rusé plus qu'intelligent, d'un courage physique exceptionnel, mélange séduisant de réactions enfantines, voire animales, et de grandeur incontestable, c'est lui qui anime cette immense fresque historique que déroule Guzman aux yeux du lecteur. Avec une maîtrise accomplis, l'écrivain mexicain raconte l'histoire de la Révolution sans que jamais l'œuvre prenne des allures de roman-fleuve, ni ne tombe dans la pédanterie artificielle d'un faux livre d'histoire. Dense, serré, le récit maintient en haleine, fascine le lecteur, depuis le soulèvement madériste contre Porfirio Diaz en 1910 jusqu'aux luttes à la fois sordides et sanglantes entre les différentes factions : Carranza, Obregón, Zapata, auquel Guzman s'attache plus particulièrement comme au symbole même de ce qu'aurait pu et dû être la Révolution. Les événements politiques sont vécus de l'intérieur par l'un de leurs protagonistes, et non des moindres. Et c'est d'une rare habileté. Les grandes batailles de la Révolution, comme Passant de Ciudad Juárez (1911) ou la bataille de San Pedro de las Colomas (1914), laissent le champ libre à Guzmán, pour une spectaculaire évocation, qui ne perd rien pour autant de son exactitude historique. Il sait de plus rendre à merveille le parler populaire, pour ne pas dire paysan des plaines du nord de la République mexicaine, en lui gardant toute son authentique saveur. (Trad. Grasset).

"El Águila y la Serpiente" (1928)
Un récit autobiographique romancé de l'écrivain mexicain Martin Luis Guzmán (1887-1977), publié tout d'abord sous forme de feuilleton, en 1927, au Mexique, puis en totalité dans un ouvrage qui ne parut en Espagne que l'année suivante. Le titre est inspiré de l'écusson mexicain qui représente un aigle sur le point de dévorer un serpent, et le récit se déroule pendant les années 1913-1915, de la révolution mexicaine. On notera au passage les descriptions de paysages mexicains, extraordinairement puissantes et évocatrices.
Le roman débute au moment de la présidence du général Huerta, et s'achève lors de la chute de la Convention dont le président fut Eulalio Gutiérrez. L'auteur, jeune Mexicain frais émoulu de l'université, entraine le lecteur dans les péripéties nombreuses de sa lutte révolutionnaire. Il se présente, dès les premières lignes, comme un "révolutionnaire constitutionnaliste" obligé de s'exiler aux Etats-Unis, mais bien décidé à mettre fin au gouvernement de Victoriano Huerta. Plein d'espoir, il se lance dans l'action qui doit libérer le Mexique des "caudillos" et mener la Révolution au succès. Tandis qu'autour de lui les uns soutiennent Carranza, les autres Obregón, d`autres Villa, lui entre dans la révolution "libre de tout préjugé vis-à-vis des personnalités", mais il prend bientôt contact avec les chefs dont il tracera des portraits extrêmement vivants et personnels, car il ne cachera pas l`antipathie ou la sympathie qu'ils lui inspirent.
L`auteur perd vite ses illusions lorsqu'il voit que la révolution est en si mauvaises mains ; chacun ne cherchant qu'à satisfaire ses ambitions personnelles. Et cette phase du livre est particulièrement marquée par la lutte des généraux (surtout lors de la prise de la capitale vers la fin de l`année 1913). Quant à la Convention d'Aguascalientes (1914), à laquelle assiste l`auteur, son souci majeur est de libérer le Mexique de l`emprise de Carranza, tout aussi bien que de celle de Villa et de Zapata.
Et ce que l'auteur reproche aux chefs révolutionnaires, c'est surtout leur manque de culture, de patriotisme et de respect pour la vie humaine. De tous ces personnages historiques, se détache celui de Martin Luis Guzmán, car le narrateur sait introduire son lecteur dans un monde qu'il découvre et qu'il décrit comme il le ressent, il intervient dans le récit, et prend progressivement sa véritable place, celle de l'intellectuel qui, pour sauver son pays, est entré dans la lutte politique. (Trad. avec une longue préface de B. Cendrars, éd. Gallimard, 1967).
Un extrait présentant une vision cynique des manœuvres au sein des rangs constitutionnalistes pour enrichir et responsabiliser leurs dirigeants, une représentation bien décourageante de l’intelligentsia et de la bureaucratie révolutionnaires...
"Une fois, nous étions assis autour de la table après le dîner, comme d'habitude, nous étions dix ou vingt. . . . Nous nous sentions tous bien. Ce matin-là, la fanfare militaire avait traversé la ville à deux reprises en jouant le réveil pour célébrer les deux dernières victoires de nos troupes, à Chihuahua et à Tepic. Sur ce motif, Carranza se mit à pontifier, comme à son habitude, et finit par ériger en fait indiscutable la supériorité d'une armée improvisée et enthousiaste sur une armée scientifiquement organisée. Une telle affirmation doit forcément être considérée comme une hérésie par tout soldat entraîné, et ce fut le cas cette nuit-là. [Felipe] Angeles attendit que Carranza ait terminé, puis, avec douceur dans la formulation, mais avec beaucoup d'énergie dans les arguments, il prit la défense de l'art de la guerre comme quelque chose qui peut être appris et enseigné et qui peut être mieux exercé au fur et à mesure que l'on l'étudie. Mais Carranza, despotique dans ses conversations comme dans tout le reste, interrompit brusquement son ministre de la Guerre par cette déclaration brutale, clôturant l'affaire : "Dans la vie, général, dit-il, surtout pour diriger et gouverner les hommes, la seule chose nécessaire ou utile est la bonne volonté."
Angeles but une gorgée de sa tasse de café et ne prononça plus une syllabe. Tous les autres se taisent et les derniers mots du premier chef flottent dans le silence qui s'installe. "Est-ce que ça va finir comme ça ? me suis-je demandé. "Ce n'est pas possible. Quelqu'un va sûrement remettre les choses à leur place." Mais, malheureusement, plus d'une minute s'écoula avant que quelqu'un ne fasse un geste pour parler. Don Venustiano savourait en silence le plaisir de dicter même nos idées. Peut-être a-t-il apprécié le spectacle de notre servilité et de notre lâcheté. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou non. Un sentiment de honte m'envahit. Je me suis souvenu que j'avais pris parti pour la Révolution et que, pour cela, j'avais été obligé de sacrifier toute ma vie antérieure ; je me suis senti sur les cornes d'un dilemme. Ou bien ma rébellion contre Victoriano Huerta était insensée, ou bien je me devais de protester ici aussi, ne serait-ce qu'en paroles.
Le silence autour de la table était encore plus dense qu'auparavant. Cela allait-il m'arrêter ? Décidément, non. Je me lançai tête baissée dans la petite aventure qui me classerait immédiatement et pour toujours parmi les dissidents et les mécontents du champ révolutionnaire.
« N’est-ce pas bizarre? » dis-je, sans me couvrir, en regardant droit dans les profondeurs des yeux bénins du premier chef; « Je pense exactement le contraire. Je rejette totalement la théorie selon laquelle la bonne volonté peut remplacer la capacité et l’efficacité. Le dicton « L’enfer est pavé de bonnes intentions » me semble très sage, car ceux dont la principale caractéristique est la bonne volonté assument toujours des tâches qui dépassent leurs forces, et c’est là leur faiblesse. C’est peut-être parce que je ne suis pas sorti de l’école depuis longtemps, mais je suis un fervent croyant dans les livres et la formation et je déteste les improvisations et les makeshi, sauf quand ils ne peuvent pas être évités. Je crois que, d’un point de vue politique, la technique est une nécessité vitale pour le Mexique, au moins dans trois aspects fondamentaux : la finance, l’éducation publique et la guerre. »
Mon emportement produisit plus de stupeur que de surprise. Don Venustiano me regardait d'un air bienveillant, si bienveillant que j'ai tout de suite compris qu'il ne me pardonnerait jamais mon audace.
À l'exception de [Rafael] Zubarán, qui me lança un regard de compréhension amicale, d'Angeles, qui me regarda d'un air approbateur, et d'[Alberto] Pani, qui manifesta sa solidarité avec moi par des sourires énigmatiques, personne ne leva les yeux de la nappe. Et seul Adolfo de la Huerta, essayant de faire passer tout cela pour une sorte de plaisanterie, est venu me soutenir, ou plutôt m'aider. Il a fait tout ce qu'il a pu pour effacer la mauvaise impression que ma présomption avait laissée dans l'esprit de Carranza. C'était un acte courageux et honorable de sa part, né de son esprit de conciliation, car il l'a fait au risque de tomber lui-même en disgrâce. . . .
Le général Iturbe me proposa, par l'intermédiaire du colonel Eduardo Hay, un poste militaire dans sa brigade qui ne manquait pas d'attraits. Je devais être lieutenant-colonel et chef d'état-major adjoint. . . . Je ne pouvais me résoudre à troquer ma précieuse indépendance de parole et d'action contre la discipline rigide du soldat, et l'une des raisons pour lesquelles je ne le faisais pas était que je ne voyais aucune raison de faire un tel sacrifice. Je n'avais aucune ambition politique ou militaire ; et, d'ailleurs, les principaux chefs de la Révolution étaient loin d'être, à mon avis, assez désintéressés et idéalistes pour que je veuille me lier à eux, même indirectement, par des chaînes qui sont toujours dangereuses et pas toujours faciles à briser. . . .
L'idée de rejoindre l'entourage du premier chef ne m'attirait pas du tout. Dans l'orbite de Don Venustiano, les intrigues et la flagornerie la plus basse prenaient de l'ampleur ; les tripoteurs, les raconteurs, les lèche-bottes, les pandores avaient la mainmise sur tout. Et même s'il y avait des moments où cette atmosphère nauséabonde était dissipée par la présence d'hommes d'un tout autre calibre, les hommes honnêtes, ceux qui étaient prêts à se lever et à être comptés pour leurs principes, perdaient leur temps dans ce cercle complètement partisan, à moins qu'ils n'aient des devoirs si importants qu'ils ne pouvaient pas être abandonnés. Il était vain de concevoir de faux espoirs. À cette époque, j'avais beaucoup appris et je savais que Carranza, vieux et têtu, ne changerait jamais. Il continuerait à répondre aux flatteries plutôt qu'aux actes, à la servilité plutôt qu'à l'habileté. Jusqu'à sa mort, il serait influencé par l'abjection, la mesquinerie, car lui-même, dont la constitution était totalement dépourvue de grandeur, n'était pas exempt d'une mesquinerie essentielle. Sa froideur calculatrice, que les porteurs d'encens appelaient le gi× d'un grand homme d'État, lui servait à mesurer l'insignifiant et non le grand, de sorte qu'il gâchait ses plus beaux moments. Qui a jamais vu chez lui un enthousiasme réel, officiel ou privé, à l'égard des grands événements de la Révolution ? Il n'était pas magnanime, même lorsqu'il s'agissait de récompenser. . . .
« Carranza, ai-je dit, n’est rien d’autre qu’un politicien égoïste qui est diablement habile à tourner à son propre avantage sa formation dans la vieille école de la politique mexicaine. Il n’y a aucun sens réel du devoir civique ou des idéaux de quelque nature que ce soit dans l’homme. Personne qui n’est pas un flatteur et un lèche-bottes, ou qui ne prétend pas être pour faire avancer ses ambitions personnelles avec l’aide de Carranza, ne peut travailler avec lui. Il corrompt systématiquement les gens ; il attise les passions mauvaises, les intrigues mesquines, voire la malhonnêteté, chez ceux qui l’entourent, afin qu’il puisse mieux gérer et tenir le fouet sur eux. Il n’y a pas un révolutionnaire avec aucune personnalité, ou même sincèrement dévoué à la cause, qui, à moins d’avoir été disposé à se laisser utiliser comme un outil, n’a pas été obligé de rompre avec lui ou d’accepter un rôle insignifiant et humiliant. Et ceux qui n’ont pas encore rompu ouvertement avec lui sont sur des charbons ardents et ne savent pas quelle attitude adopter. Vous savez aussi bien que moi que beaucoup de nos amis sont dans l’une de ces deux situations. C’est ce qui s’est passé ou se passe avec Maytorena, avec Angeles, avec Villarreal, avec Blanco, avec Vasconcelos, avec Bonilla, et même avec vous. Vous vous souvenez des rebuffades et de l’hostilité secrète avec lesquelles il vous traitait quand nous étions à Nogales. La vérité est que Carranza rêve de devenir un autre Porfirio Diaz, un Porfirio Diaz plus grand et meilleur, car il admire et vénère sa mémoire. N’est-il pas évident que Carranza essaie de tout tourner à cette fin, et qu’il ne se soucie pas d’un rap sur le bien que la Révolution pourrait apporter au Mexique? Vous savez très bien que, dès le premier instant, Carranza a systématiquement divisé la Révolution contre elle-même [...] »
. . . L'explication de ce qui s'est passé pendant que Carranza était au pouvoir se trouve, mieux que toute autre chose, dans la confusion volontaire qui s'est produite entre meum et tuum, confusion liée au fait de prendre et non de donner. Sans ce détail caractéristique, son règne devient un phénomène politique presque inintelligible. On ne peut pas comprendre autrement la signification historique - en dehors de l'aspect purement individuel - des actes privés de nombreux proches de Carranza, ni les moments culminants des événements politiques de ces jours et des jours suivants : le pillage officiel des banques, le scandale du papier-monnaie à Veracruz, et l'uniformisation de la monnaie.
Il est curieux de constater que le public, si enclin à se tromper - quoi qu'on en dise - et si enclin à attribuer héroïsme et grandeur à des dieux aux pieds d'argile, a mis le doigt dans l'engrenage dès le début. De Carranza, la fantaisie populaire a fait carrancear, et "carranzaiser" et "voler" sont devenus synonymes. Le vol est devenu un impératif catégorique pour les adeptes de Carranza, en partie parce que c'était un moyen sûr et rapide d'obtenir ce qu'ils voulaient, et en partie parce que c'était un sport et un amusement..."

"L'OMBRE DU CAUDILLO" (La sombra del CaudiIlo)
Roman écrit par Martin Luis Guzmán (1887-1977), publiée en 1929, qui s`intègre dans la littérature post-révolutionaire mexicaine. Les événements envisagés couvrent en effet les années 20, au moment du gouvernement Calles ("el Jefe máximo de la Revolución", Plutarco Elías Calles, débute son mandat en 1924 : la guerre des Cristeros, qui marque la rupture de relations entre l'Église et l'État, est l'épisode principale de sa mainmise sur le pays directement ou indirectement au-delà de 1928). Le récit. serré, dense. fait apparaître une figure attachante et originale, celle d'lgnacio Aguirre, général et ministre en place, homme jeune et énergique qui pose malgré lui sa candidature à la présidence de la République et dont Guzmán n`hésite pas à souligner toutes les contradictions, sources de questions de conscience souvent dramatiques. Ami des premiers jours du Caudillo, qui pourtant soutient son rival, Hilario Jiménez, il lui faut, contre son gré, accepter la caution du parti de l`opposition. Ignacio Aguirre domine tout le roman, tant par sa présence physique que par sa lente évolution psychologique, présentée comme inéluctable, dès le début. A ses côtés, "ses" femmes (depuis son épouse légitime jusqu`à la jeune fille de bonne famille qu'il séduit, une fois de plus sans le vouloir) et son éminence grise Axkaná, belle figure de politique, ambitieux pour les autres. pour ceux dont il conçoit la destinée comme exceptionnelle - et c'est le cas d'Aguirre. L'une des scènes les plus violentes du roman est celle où Axkaná est torturé par les partisans d'Hilario Jimenez : on l`imbibe de "tequila" à l`entonnoir. avant de le gaver d'huile par le même procédé. À l'arrière-plan se profilent des ombres toutes-puissantes, les chefs des partis politiques comme Olivier, que les partisans de Jiménez tentent vainement d'assassiner. Influencé par la logique seule et voyant en Aguirre l`homme capable de soulever les masses. il met tout son poids dans la balance en sa faveur. Mais le Caudillo craint Aguirre en qui il voit un rival trop heureux. ll le laisse assassiner, lui et ses amis : une fusillade brève. exécutée par des subalternes haineux. Ici la fatalité régit la progression dramatique, le lecteur se laisse emporter par cette symphonie fantastique où le rythme sait se faire tour à tour ample, d'une menaçante lenteur, ou bien tragiquement précipité. Les caractères mêmes des personnages se modèlent sur ces continuelles fluctuations, et ne sont saisis dans leur vérité qu'au fur et à mesure de leurs mouvements bien plus que de leurs réflexions. (Trad. Gallimard, 1960).

José Vasconcelos (1882-1959)
Souvent inclus dans le référentiel des romans révolutionnaires, "Ulises criollo" (1935), premier volume de l’autobiographie en cinq volumes de José Vasconcelos (1882-1959), retrace sa vie jusqu’à la mort de Madero, dont il avait été un partisan. Vasconcelos a choisi le nom d'Ulysse comme épithète, car sa carrière et celle des Mexicains contemporains suggéraient une odyssée, et il a ajouté criollo (d’origine européenne) en hommage à l’héritage hispanique du Mexique.
"Cartucho" (1931; traduit en 1988) de Nellie Campobello (1900-1986), est la seule œuvre de cet ensemble de romans écrite par une femme, est aussi un récit personnel. Il se compose de cinquièmes brefs croquis prétendant être le récit d’un enfant de la Révolution dans sa ville du nord. La prose simple et apparemment sans art de Campobello rend les histoires d’effusion de sang et de cruauté d’autant plus convaincantes.
