- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Rudyard Kipling (1865–1936), "Barrack-Room Ballads" (1882), "Plain Tales from the Hills" (1887), "Three Soldiers" (1888), "From Sea To Sea" (1889), "In Black and White" (1889), "The Jungle Book" (1894), "Seven Seas" (1896), "Kim" (1901), "Puck of Pook’s Hill" (1906). - A.E, Housman (1859-1936), "A Shropshire Lad" (1886), "A Shropshire Lad" (1896) - Wilfred Owen (1893-1918), "Anthem for Doomed Youth" (1917) - Siegfried Sassoon (1886-1967), "The General", "Memoirs of a Fox-Hunting Man" (1928) - ......
Last update : 18/12/2016

"East is East and West is West, and never the twain shall meet", écrira Kipling, l’Orient est l’Orient et l’Occident est l’Occident, et jamais les deux ne se rencontreront. Mais quel étrange cas que celui de Rudyard Kipling. Né à Bombay en 1865, il a fait ses études en Angleterre avant de retourner en Inde pour travailler comme rédacteur dans un journal à Lahore. À l'âge de trente-deux ans, il avait déjà écrit des dizaines d'histoires populaires, rassemblées dans des volumes tels que "Plain Tales from the Hills", "Soldiers Three" et "Wee Willie Winkie" (tous publiés pour la première fois en 1888) ; le roman "The Light That Failed" (1891) ; un étonnant assortiment de poèmes, rassemblés dans "Barrack-Room Ballads" (1882) et d'autres volumes ; et des classiques pour enfants tels que "The Jungle Book" (1894) et "Captains Courageous" (1896). À l'âge de quarante-deux ans, il avait remporté le prix Nobel de littérature - le premier écrivain de langue anglaise à le faire - mais à partir de ce moment-là, la carrière littéraire de Kipling a entamé ce qu'un biographe a appelé une "longue récession" jusqu'à sa mort en 1936.
En raison de la position colonialiste d'une grande partie de son œuvre - le poème "The White Man’s Burden" (Le fardeau de l'homme blanc) n'en est qu'un exemple -, il est facile de voir dans le déclin de sa réputation le reflet de la fortune de l'Empire auquel il était étroitement allié. Il est encore plus facile, pour reprendre les termes du critique V. S. Pritchett, "to tie his politics around his neck and sink him" (de lui attacher sa politique autour du cou et de le faire sombrer). Mais, grâce à la portée extra-politique de son imagination, Kipling se maintient à flot dans l'affection des lecteurs grâce à des œuvres aussi inspirées que le poème "If-" (1910), l'inoubliable récit d'aventures "The Man Who Would Be King" (1888), le merveilleux roman d'Inde et d'espionnage "Kim" (1901) et une foule d'autres poèmes, esquisses et récits. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'il est impossible de lire une page de Kipling sans être surpris par une expression animée tant par son phrasé que par sa poésie. Le dynamisme de son don verbal est palpable et la force de son ingéniosité une invite constante : le son, le sens et l'invention narrative se combinent pour peindre des images d'un monde sensuellement riche qui ressemble au monde réel mais qui est en réalité un véritable tour de passe-passe...
Il n'y a pas, peut-être, de meilleur endroit pour rencontrer Kipling et ses qualités d'écrivain que dans ses "Just So Stories For Little Children" (1902), écrites pour sa petite fille, à qui elles ont sans doute été adressées pour la première fois. Les douze contes qu'il rassemble apportent des réponses extrêmement satisfaisantes à des questions dignes de l'imagination d'un enfant : comment le chameau a obtenu sa bosse, par exemple, comment l'alphabet a été créé et comment l'éléphant a obtenu sa trompe. Chaque conte s'adresse au "Best Beloved " du narrateur, auquel tout enfant qui écoute s'identifiera certainement :
"In the High and Far-Off Times the Elephant, O Best Beloved, had no trunk. He had only a blackish, bulgy nose, as big as a boot, that he could wriggle about from side to side; but he couldn’t pick up things with it. But there was one Elephant - a new Elephant - an Elephant’s Child - who was full of ’satiable curiosity, and that means he asked ever so many questions." (Dans les temps anciens et lointains, l'éléphant, ô mon bien-aimé, n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un nez noirâtre et volumineux, gros comme une botte, qu'il pouvait agiter d'un côté à l'autre ; mais il ne pouvait pas ramasser des objets avec. Mais il y avait un éléphant. Mais il y avait un éléphant - un nouvel éléphant - un enfant d'éléphant - qui était plein d'une curiosité insatiable, ce qui signifie qu'il posait toujours autant de questions).
Le ton est tellement imbriqué dans la prose de Kipling que tout parent lisant les Just So Stories à haute voix se transforme en maître conteur, et que chaque Best Beloved sera heureux de les écouter encore et encore...

Rudyard Kipling (1865–1936)
Rudyard Kipling publia ses premières nouvelles en 1887, lesquelles furent suivies de six autres volumes. Ces récits, écrits dans une prose vive, pleine d'humour sont autant de petites réussites nonchalantes et précises. Kipling sait, à force d'anecdotes, de traits saillants et comme esquissés, rendre toute la sève de ses observations. Ses contes très inventifs, spirituels, sont extraordinairement vivants. On lui reproche à juste titre de faire l'apologie de l'impérialisme britannique, mais faut-il lui reconnaître sa capacité à restituer la complexité des sociétés orientales, notamment de l'Inde. Dès 1882, il donnait ses premiers récits, alors fantastiques, “The Phantom Rickshaw,” “The Strange Ride of Morrowbie Jukes,” et le plus fameux d'entre eux, “The Mark of the Beast” (1890)...
"The Mark of the Beast", une histoire de lycanthropie. Il s'agit de l'un des premiers textes de Kipling, écrit en Inde avant son retour en Angleterre. Grâce aux bons offices de Sir Ian Hamilton, un officier de l'armée désireux de promouvoir l'œuvre de Kipling, l'histoire se retrouva sur le bureau de deux éditeurs importants, Andrew Lang et William Sharp, qui reculèrent tous deux d'horreur à la lecture de l'histoire. Lang commenta : " ... c'est un truc empoisonné qui a laissé une impression extrêmement désagréable sur mon esprit ". Sharp, tout aussi perturbé, écrivit à Hamilton : "Je vous recommande vivement de brûler instantanément ce détestable ouvrage. J'ose espérer que l'auteur de l'article en question est très jeune et qu'il mourra fou avant d'avoir atteint la trentaine. L'histoire a néanmoins été publiée dans le Pioneer, le journal d'Allahabad, en 1890 et plus tard, Kipling écrivit une suite, "The Return of Imray", dont l'intrigue, comme l'original, s'articule autour d'une insulte faite à un Indien qui a des conséquences tragiques. "The Phantom Rickshaw" penche également du côté de l'horreur du spectre des histoires de fantômes. Le personnage central est hanté par des visions d'un pousse-pousse spectral habité par sa maîtresse décédée, ce qui le conduit à la folie. Ce récit a plus d'une touche du style et du sujet d'Edgar Allan Poe et pourtant il est peut-être moins prévisible, loin de l'atmosphère étouffante des environs gothiques et sombres du paysage de Poe et situé dans le Simla de Kipling. "They" est peut-être la plus grande histoire de fantômes de Kipling. C'est certainement la plus sensible et la plus tendre, qui engendre un sentiment de malaise et de mélancolie plutôt que de choc et d'horreur. Nous sommes ici en plein vingtième siècle - l'histoire a été écrite en 1904 - et l'automobile joue un rôle important dans l'intrigue. Le narrateur, qui se promène dans la campagne du Sussex au printemps, se perd et découvre une vieille maison de campagne appartenant à une femme aveugle qui s'occupe de plusieurs enfants "insaisissables". Ce n'est qu'après d'autres visites qu'il apprend le secret poignant de la maison et des enfants. L'habitude de Kipling d'exorciser sa propre douleur et ses doutes dans sa poésie et sa prose ne trouve pas de meilleur exemple que dans cette histoire. L'auteur l'a écrite pour l'aider à surmonter le chagrin qu'il avait ressenti à la mort de sa fille, quelque cinq ans plus tôt. La séparation finale de l'histoire représente sur la page l'acceptation par Kipling de la perte de son propre enfant et est d'autant plus émouvante que Kipling s'implique personnellement dans le récit. L'un des plaisirs accessoires de "They" est la rare célébration par Kipling du paysage anglais, que le narrateur décrit avec une fraîcheur élégiaque : "I let the country flow under my wheels. The orchid-studded flats of the East gave way to the thyme, ilex, and grey grass of the Downs; these again to the rich cornland and fig-trees of the lower coast, where you can carry the beat of the tide on your left hand for fifteen level miles ..."
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:
If you can dream – and not make dreams your master;
If you can think – and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings – nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son!
"The White Man's Burden" (Le Fardeau de l'homme blanc), publié à l'origine en février 1899 dans la revue mensuelle américaine populaire McClure's, avec pour sous-titre Les The United States and the Philippine Islands, mettant en gardant les puissances impérialistes en pleine expansion américaine qui suivra la guerre hispano-américaine ...
Take up the White Man's burden—
Send forth the best ye breed—
Go bind your sons to exile
To serve your captives' need;
To wait in heavy harness,
On fluttered folk and wild—
Your new-caught, sullen peoples,
Half-devil and half-child.
Take up the White Man's burden—
In patience to abide,
To veil the threat of terror
And check the show of pride;
By open speech and simple,
An hundred times made plain,
To seek another's profit,
And work another's gain.
Take up the White Man's burden—
The savage wars of peace—
Fill full the mouth of Famine
And bid the sickness cease;
And when your goal is nearest
The end for others sought,
Watch Sloth and heathen Folly
Bring all your hope to nought.
Take up the White Man's burden—
No tawdry rule of kings,
But toil of serf and sweeper—
The tale of common things.
The ports ye shall not enter,
The roads ye shall not tread,
Go make them with your living,
And mark them with your dead.
Prenez le fardeau de l'Homme Blanc
Envoyez le meilleur de votre descendance
Promettez vos fils à l'exil
Pour servir les besoins de vos prisonniers ;
Pour veiller sous un lourd harnais,
Sur un peuple folâtre et sauvage
Vos peuples boudeurs, tout juste pris,
Moitié démon et moitié enfant.
Prenez le fardeau de l'Homme Blanc
D'accepter la règle avec patience,
D'adoucir la menace de la terreur
Et de réprimer la démonstration d'orgueil ;
Par des paroles directes et simples,
Exprimées clairement cent fois,
De rechercher le profit d'un autre,
Et travailler pour qu'un autre y gagne.
Prenez le fardeau de l'Homme Blanc
Les guerres cruelles de la paix
Remplissez la bouche de Famine
Et demandez à la maladie de cesser ;
Et quand vous êtes au plus près du but
La fin que vous recherchez pour les autres,
Regardez Paresse, et Bêtise la païenne
Réduire tout votre espoir à néant.
Prenez le fardeau de l'Homme Blanc
Pas la loi clinquante des rois,
Mais la besogne du serf et du domestique
L'histoire des choses banales.
Les ports où vous n'entrerez pas,
Les routes que vous ne devrez pas prendre,
Allez en faire votre existence,
Et laissez vos morts tout le long
"The Ballad of East and West" (1889) - Il n’y a ni Orient ni Occident, ni Frontière, ni Race, ni Naissance, Quand deux hommes forts se tiennent face à face, bien qu’ils viennent du bout du monde ... Dans The Ballad of East and West, un officier anglais et un voleur de chevaux afghan découvrent l’amitié en respectant leur mutuel courage. Le fils d'un colonel anglais prend un cheval et part récupérer la jument volée à son père par Kamel, chef de tribu à la frontière nord-ouest du Raj britannique ... "Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet" BUT "there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth", deux lignes qui semblent se contredire et qui ont donné lieu à bien des interprétations, souvent accusatrices ...
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, though they come from the ends of the earth!
Kamal is out with twenty men to raise the Border-side,
And he has lifted the Colonel’s mare that is the Colonel’s pride.
He has lifted her out of the stable-door between the dawn and the day,
And turned the calkins upon her feet, and ridden her far away.
Then up and spoke the Colonel’s son that led a troop of the Guides:
“Is there never a man of all my men can say where Kamal hides?”
Then up and spoke Mohammed Khan, the son of the Ressaldar:
“If ye know the track of the morning-mist, ye know where his pickets are.
At dusk he harries the Abazai — at dawn he is into Bonair,
But he must go by Fort Bukloh to his own place to fare,
So if ye gallop to Fort Bukloh as fast as a bird can fly,
By the favour of God ye may cut him off ere he win to the Tongue of Jagai.
But if he be past the Tongue of Jagai, right swiftly turn ye then,
For the length and the breadth of that grisly plain is sown with Kamal’s men.
There is rock to the left, and rock to the right, and low lean thorn between,
And ye may hear a breech-bolt snick where never a man is seen.”
The Colonel’s son has taken a horse, and a raw rough dun was he,
With the mouth of a bell and the heart of Hell and the head of the gallows-tree.
The Colonel’s son to the Fort has won, they bid him stay to eat —
Who rides at the tail of a Border thief, he sits not long at his meat.
He’s up and away from Fort Bukloh as fast as he can fly,
Till he was aware of his father’s mare in the gut of the Tongue of Jagai,
Till he was aware of his father’s mare with Kamal upon her back,
And when he could spy the white of her eye, he made the pistol crack.
He has fired once, he has fired twice, but the whistling ball went wide.
“Ye shoot like a soldier,” Kamal said. “Show now if ye can ride!”
It’s up and over the Tongue of Jagai, as blown dustdevils go,
The dun he fled like a stag of ten, but the mare like a barren doe.
The dun he leaned against the bit and slugged his head above,
But the red mare played with the snaffle-bars, as a maiden plays with a glove.
There was rock to the left and rock to the right, and low lean thorn between,
And thrice he heard a breech-bolt snick tho’ never a man was seen.
They have ridden the low moon out of the sky, their hoofs drum up the dawn,
The dun he went like a wounded bull, but the mare like a newroused fawn.
The dun he fell at a water-course — in a woeful heap fell he,
And Kamal has turned the red mare back, and pulled the rider free.
He has knocked the pistol out of his hand — small room was there to strive,
“‘Twas only by favour of mine,” quoth he, “ye rode so long alive:
There was not a rock for twenty mile, there was not a clump of tree,
But covered a man of my own men with his rifle cocked on his knee.
If I had raised my bridle-hand, as I have held it low,
The little jackals that flee so fast were feasting all in a row:
If I had bowed my head on my breast, as I have held it high,
The kite that whistles above us now were gorged till she could not fly.”
Lightly answered the Colonel’s son: “Do good to bird and beast,
But count who come for the broken meats before thou makest a feast.
If there should follow a thousand swords to carry my bones away,
Belike the price of a jackal’s meal were more than a thief could pay.
They will feed their horse on the standing crop, their men on the garnered grain,
The thatch of the byres will serve their fires when all the cattle are slain.
But if thou thinkest the price be fair, — thy brethren wait to sup,
The hound is kin to the jackal-spawn, — howl, dog, and call them
(...)
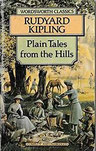
"Plain Tales from the Hills" (1887)
Recueils de nouvelles publiées de 1886 à 1888 dans la Civil and Military Gazette, puis en recueil chez Macmillan en 1890. Le tout jeune Kipling, revenu dans son pays natal avec un poste de journaliste, se rend aussitôt célèbre avec ces contes où il est déjà tout entier présent. Les collines? c`est "Simla", la station située sur les premiers contreforts de l`Himalaya, où les militaires et les civils rêvent d'aller en congé. Dans les collines on respire un air presque léger, une société se reforme. Certains, les plus malins, y passent toute la durée de leur service. A Simla règnent les femmes, désoeuvrées, intrigantes, parfois en famille mais souvent séparées de leur mari en garnison dans des provinces plus rudes. Les collines? c`est l`envers de la conquête, de la gloire, des dangers et des splendeurs de l`Empire. Les collines? c`est le petit côté des choses, la faiblesse des soldes et des traitements, les bassesses pour obtenir une planque, les mariages arrangés, les adultères intéressés, les bizutages, les déceptions en tout genre, l`inaction et la nostalgie du pays natal. C'est l`incompréhension des indigènes, l`aveuglement des colons sur la complexité du monde dans lequel ils se trouvent plongés, c`est le mépris réciproque des uns pour les autres. C`est aussi la patience, la vengeance à longue échéance et l`écrasement inéluctable du plus faible. Le regard aigu de Kipling et sa verve sont à l`œuvre sur ce petit monde bavard et mesquin à qui il donne une dimension parfois tragique, presque métaphysique. sans jamais perdre la distance de l'humour. La volonté de montrer d`emblée toutes les facettes de son talent lui fait choisir tous les milieux et prendre tous les tons. Le futur poète des chansons de soldats crée là un de ses plus fameux personnages, le soldat Mulvaney, dont le jargon défie la lecture, ainsi que Mrs. Hauksbee, le policier Strickland et les Soldiers Three (Privates Mulvaney, Ortheris et Learoyd). Mais on voit surtout, dés le départ, émerger un des thèmes essentiels de Kipling, celui qui hante toute son œuvre : nous sommes toujours étrangers, une partie de nous-mêmes est dans un autre camp, les hommes seront toujours les hommes et les femmes, les femmes, les Blancs et les "natives" de chaque côté de la barrière, irrésistiblement attirés les uns vers les autres et inéluctablement différents. (Trad. Robert Laffont. 1987, Gallimard. 1991).

"Soldiers three and other stories" (Trois Soldats, 1888)
Ces huit nouvelles publiées à Allahabad en 1888, constituent, quant à la forme, au milieu et aux personnages, la suite des "Plain Tales from the Hills" et sont parmi les plus belles pages de Rudyard Kipling. Les troupiers dont il s`agit sont Térence Mulvaney, Irlandais, Stanley Ortheris, du Yorkshire, et John Learoyd, un Londonien du menu peuple. Tous les trois, appartenant au même régiment, sont unis par une amitié à toute épreuve et, dans leur terrible jargon truffé d`argot militaire et même d'expressions indiennes, ils se racontent les
aventures qu`ils ont courues. Tantôt c`est Mulvaney qui se vante d`avoir sauvé l`honneur de son régiment en empêchant le capitaine de sa compagnie d`enlever la fille du colonel, tantôt les trois compères sont de mèche pour vendre, au prix de trois cents roupies, à une dame De Sussa, un chien bâtard qu`ils lui ont dépeint comme un fox-terrier. C`est encore le fameux Mulvaney qui, voulant venir en aide à un jeune officier, doit convenir que ce dernier sait fort bien se tirer d"aFfaire tout seul. Une autre fois, alors qu'il croyait conter fleurette à la jeune femme de son sergent, il ne trouve rien d`autre qu`un fantôme. Cependant, les meilleurs récits sont : "With the Main Guard", qui contient la splendide description d`une rencontre entre Anglais et rebelles indiens ...
‘Don’t know what the bloomin’ Paythans called it. We called it Silver’s Theayter. You know that, sure!’
‘Silver’s Theatre — so ‘twas. A gut betune two hills, as black as a bucket, an’ as thin as a girl’s waist. There was over-many Paythans for our convaynience in the gut, an’ begad they called thimselves a Reserve — bein’ impident by nature! Our Scotchies an’ lashins av Gurkeys was
poundin’ into some Paythan rig’mints, I think ‘twas. Scotchies an’ Gurkeys are twins bekaze they’re so onlike an’ they get dhrunk together whin God plazes. As I was sayin’, they sint wan comp’ny av the Ould an’ wan of the Tyrone to double up the hill an’ clane out the Paythan
Reserve. Orf’cers was scarce in thim days, fwhat with dysintry an’ not takin’ care av thimselves, an’ we was sint out wid only wan orf’cer for the comp’ny; but he was a Man that had his feet beneath him, an’ all his teeth in their sockuts.’
‘Who was he?’ I asked.
‘Captain O’Neil — Old Crook — Cruikna-bulleen — him that I tould ye that tale av whin he was in Burma. [Footnote: Now first of the foemen of Boh Da Thone Was Captain O’Neil of the Black Tyrone. The Ballad of Boh Da Thone.] Hah! He was a Man! The Tyrone tuk a little orf’cer bhoy, but divil a bit was he in command, as I’ll dimonstrate presintly. We an’ they came over the brow av the hill, wan on each side av the gut, an’ there was that ondacint Reserve waitin’ down below like rats in a pit.
‘“Howld on, men,” sez Crook, who tuk a mother’s care av us always.
“Rowl some rocks on thim by way av visitin’ kyards.” We hadn’t rowled more than twinty bowlders, an’ the Paythans was beginnin’ to swear tremenjus, whin the little orf’cer bhoy av the Tyrone shqueaks out acrost the valley: — ”Fwhat the devil an’ all are you doin’, shpoilin’ the fun for my men? Do ye not see they’ll stand?”
‘“Faith, that’s a rare pluckt wan!” sez Crook. “Niver mind the rocks, men. Come along down an’ take tay wid thim!”
‘“There’s damned little sugar in ut!” sez my rear-rank man; but Crook heard.
‘“Have ye not all got spoons?” he sez, laughin’, an’ down we wint as fast as we cud. Learoyd bein’ sick at the Base, he, av coorse, was not there.
‘Thot’s a lie!’ said Learoyd, dragging his bedstead nearer. ‘Ah gotten thot theer, an’ you knaw it, Mulvaney.’ He threw up his arms, and from the right armpit ran, diagonally through the fell of his chest, a thin white line terminating near the fourth left rib....
– Je ne sais pas comment ces sacrés Pathans appelaient l’endroit. Mais nous l’appelions le théâtre Silver. Tu le sais bien, voyons !
– Le théâtre Silver… oui, c’est ça. Un défilé entre deux montagnes, noir comme une cuve et mince comme la taille d’une fille. Il y avait beaucoup trop de Pathans à notre convenance dans cette gorge, et pardieu, ils s’appelaient soi-disant la réserve – vu leur indiscrétion naturelle ! Je pense qu’en effet nos Écossais avec des flopées de Gourkas étaient en train de
rosser quelques régiments pathans. Écossais et Gourkas sont frères, vu qu’ils sont tout pareils et qu’ils s’enivrent ensemble quand il plaît à Dieu. Comme je l’ai déjà dit, on avait envoyé une compagnie de notre Ancien et une du Tyrone pour faire le tour par la montagne et nettoyer la réserve pathane. Comme les officiers étaient rares dans ce temps-là, aussi bien à cause de la dysenterie que parce qu’ils ne se ménageaient pas, on nous avait donné un seul officier pour la compagnie ; mais c’était un bougre qui avait ses jambes d’aplomb et toutes ses dents dans leurs alvéoles.
– Qui était-ce ? demandai-je.
– Le capitaine O’Neil… le vieux Croque… Cruiknabullenn… celui dont je vous ai raconté cette histoire quand il était à Burma. Ah ! c’était un bougre ! Les Tyrone n’avaient qu’un petit gamin d’officier, mais c’était un rude bout d’homme quand il commandait, comme je vais vous le montrer bientôt. Notre compagnie et la leur arrivèrent sur la crête de la montagne, une de chaque côté de la gorge, et il y avait cette indiscrète réserve qui attendait là-bas dessous comme des rats dans une fosse.
« – Halte, garçons, que dit Croque, qui prenait toujours de nous un soin maternel. Faites rouler sur eux quelques rochers en guise de cartes de visite.
« Nous n’avions pas fait rouler plus de vingt rochers, et les Pathans commençaient à jurer terriblement, quand voilà le petit gamin d’officier des Tyrone qui glapit par-dessus la vallée :
« – Que diable vous prend-il, de gâter le plaisir à mes hommes ? Vous ne voyez donc pas qu’ils vont résister ?
« – Vrai, il a du cran, celui-là ! dit Croque. Laissez les rochers, garçons. Venez donc en bas prendre le thé avec eux !
« – Il n’y a cré nom pas beaucoup de sucre dedans, dit un homme du rang derrière moi.
« Mais Croque l’entendit.
« – Vous n’avez donc pas tous pris vos cuillers ? qu’il dit en riant.
« Et nous dévalons de toute notre vitesse. Learoyd, qui était malade au dépôt, lui, comme de juste, n’était pas là.
– Tu mens ! fit Learoyd en traînant sa couchette plus près. J’ai attrapé ça là, et tu le sais bien, Mulvaney.
Il leva les bras : partant de son aisselle droite, un mince sillon blanc traversait en diagonale le bas de son thorax et se terminait près de la quatrième côte gauche.
– Je perds la mémoire, dit Mulvaney, sans se démonter. Tu étais là. À quoi pensais-je donc ? À autre chose, bien sûr. Alors, Jack, tu te rappelles donc que notre compagnie et celle des Tyrone se rencontrèrent au fond avec un vlan ! et se virent coincées au milieu des Pathans sans plus pouvoir bouger ?
– Ouf ! c’était une sale passe. On me pressait si fort que je pensais, crénom ! que j’allais bel et bien éclater, dit Ortheris, en se frottant l’estomac d’un air pensif.
– Ce n’était certes pas la place d’un petit homme ; mais c’est quand même un petit homme (et Mulvaney posa la main sur l’épaule d’Ortheris) qui m’a sauvé la vie ce jour-là. Nous restions là, car ces fichus Pathans ne reculaient pas d’un cran, et nous fichtre pas davantage, vu que notre rôle était de les déloger de là. Et le plus extraordinaire de tout c’est qu’eux et nous, nous nous étions précipités en plein dans les bras les uns des autres, et qu’on resta longtemps sans tirer. On ne se servait que du couteau et de la baïonnette quand on pouvait avoir les mains libres, et ça n’arrivait pas souvent. Nous étions corps à corps avec eux, et les Tyrone aboyaient derrière nous d’une façon dont je ne vis pas le sens tout d’abord. Mais je le compris plus tard, et les Pathans aussi.
« – Serrez les rangs ! que lance Croque avec un rire quand l’élan de notre arrivée dans la gorge se fut amorti.
« Et il secouait un grand Pathan velu ; mais aucun des deux n’était capable de rien faire à l’autre, malgré leur envie mutuelle.
« – Corps à corps ! qu’il dit, comme les Tyrone nous poussaient en avant de plus en plus.
« – Et pointez ! dit un sergent qui était derrière.
« Je vois une épée effleurer l’oreille de Croque, et le Pathan l’attrapa dans la pomme d’Adam comme un goret à la foire de Froneen.
« – Merci, confrère de la garde intérieure, que dit Croque, froid comme un concombre sans sel. J’avais justement besoin de place.
« Et il s’avança de l’épaisseur d’un corps d’homme, après avoir rabattu le Pathan sous lui. Dans son agonie l’homme mordit la botte de Croque et en emporta le talon.
« – Poussez, les gars ! que dit Croque. Poussez, bougres de soldats de papier ! qu’il dit. Faut-il que je vous tire pour vous faire avancer ?
« Nous poussâmes donc, jouant des pieds et des poings, et jurant, et comme l’herbe était glissante nos talons ne mordaient pas et Dieu aide l’homme du premier rang qui s’abattit ce jour-là !
– Vous êtes-vous déjà trouvé à la porte du parterre du théâtre Victoria, par un soir d’affluence ? interrompit Ortheris. Eh bien ! c’était pire que ça, car ils allaient dans un sens, et nous voulions les en empêcher. En tout cas je n’avais pas grand’chose à dire.
– Vrai, mon fils ; mais tu l’as dit. Aussi longtemps que je le pus, je gardai le petit homme entre mes genoux, mais il piquait çà et là avec sa baïonnette, aveuglément féroce et raide. C’est un diable d’homme, qu’Ortheris dans la mêlée… pas vrai ? lui demanda Mulvaney.
– Une baïonnette ça ne fait pas le jeu, dit le Londonien. Je savais que je ne valais rien alors, mais je leur donnai de mon bistouri du flanc gauche quand nous eûmes percé. Non ! dit-il, en abattant bruyamment sa main sur le bat-flanc, la baïonnette ne vaut rien pour un petit homme… il pourrait aussi bien, cré nom ! se munir d’une canne à pêche. Je déteste les mêlées à griffes et à crocs ; mais qu’on me donne une culotte un peu usagée et des munitions d’un an de magasin, pour que la poudre embrasse bien la balle, et qu’on me mette quelque part où ne me marchent pas dessus des grands porcs comme toi, et avec l’aide de Dieu je t’enverrai bouler plus de cinq fois sur sept à huit cents mètres. Veux-tu essayer, dis, feignant d’Irlandais ?
– Non, taquin. Je te l’ai vu faire. Mais je dis qu’il n’y a rien de tel que la baïonnette envoyée à bout de bras, avec double torsion si on peut, et ramenée lentement.
– Zut pour la baïonnette, dit Learoyd, qui avait écouté attentivement. Regardez par ici !
Il empoigna un fusil deux centimètres plus bas que la mire d’avant, en le prenant par en dessous, et s’en servit exactement comme on ferait d’un poignard.
– Voyez-vous, dit-il doucement, ça vaut mieux que n’importe quoi, car avec ça on peut aplatir la figure au type, ou bien encore lui casser le bras droit. Ça n’est pas dans les livres, comme juste. Pour moi il n’y a que la crosse.
– Chacun fait à sa mode, c’est comme pour être amoureux, dit tranquillement Mulvaney : crosse, baïonnette ou balle, selon le tempérament de chacun. Eh bien ! comme je vous disais, nous restions là, à nous souffler réciproquement dans la figure et à jurer abondamment. Ortheris maudit la mère qui l’a porté parce qu’il n’était pas de dix centimètres plus grand ; puis il dit :
« – Baisse-toi, gourde, que je puisse en attraper un pardessus ton épaule.
– Tu vas me broyer le crâne, que je dis, en écartant mon bras ; vas-y plutôt par-dessous mon aisselle, petit sagouin sanguinaire, que je dis, mais ne m’atteins pas ou je t’arrache les oreilles.
– Qu’est-ce que tu lui as servi, au Pathan qui était en face de moi, celui qui profitait pour me taillader de ce que je ne pouvais remuer ni bras ni jambe. C’était-il froid ou chaud ?
– Froid, répondit Ortheris, en haut et au défaut des côtes. Il est tombé à plat. Ça valait mieux pour toi.
– Vrai, mon fils ! Ce coincement dont je parle dura cinq bonnes minutes, et puis nous eûmes les bras libres et nous rentrâmes dedans. Je ne me souviens plus au juste de ce que je fis,
mais je ne voulais pas laisser Dinah Shadd veuve au dépôt. Alors, après avoir un peu taillé dans le tas, nous nous arrêtâmes de nouveau. Par derrière, les Tyrone nous traitaient de chiens, de capons et de toutes sortes de noms : nous leur barrions le passage.
« – Qu’est-ce qui leur prend, aux Tyrone ? que je me demande ; ils ont ici de quoi s’offrir un combat des plus honnêtes.
« Mon voisin de derrière me dit tout bas, d’un ton suppliant :
« – Laisse-moi taper sur eux ! Pour l’amour de Marie, fais-moi place à côté de toi, mon grand !
« – Qu’est-ce qui te prend que tu aies si fort envie de te faire tuer ? que je lui dis, sans tourner la tête, car les longs couteaux s’agitaient en face comme le soleil sur la baie de Donegal quand la mer est agitée.
« – Nous avons vu nos morts, qu’il dit en se pressant sur moi ; nos morts qui étaient encore des hommes il y a deux jours ! Et moi qui étais son cousin par le sang je n’ai pas pu emporter Tim Coulan ! Laisse-moi passer, qu’il dit, laisse-moi taper sur eux, ou je te passe au travers du corps !
« – Ma parole, que je me dis, si les Tyrone ont vu leurs morts aujourd’hui, que Dieu secoure les Pathans !
« Et alors je compris pourquoi les Irlandais s’enrageaient de la sorte derrière nous.
« Je fis place à l’homme : il courut en avant, sa baïonnette levée dans le geste du faucheur, enleva du sol un Pathan en attrapant l’animal par son ceinturon, et l’acier se brisa sur la boucle de fermeture.
« – Tim Coulan dormira bien cette nuit, qu’il dit avec un ricanement.
« Et à la même minute il tombait, la tête ouverte en deux, et ricanant par moitiés.
« Les Tyrone poussaient sans cesse de l’avant, et les nôtres les injuriaient, et Croque se démenait en avant de nous tous : son bras qui tenait l’épée manœuvrait comme un levier de
pompe et son revolver crachait tel un chat. Mais le bizarre de la chose c’était le silence qui régnait. On eût dit un combat en rêve… excepté pour ceux qui étaient morts.
« Quand j’eus fait place à l’Irlandais, je me sentis exténué et le cœur barbouillé. C’est ma façon d’être, sauf votre respect, monsieur, dans l’action.
« – Laissez-moi aller, les gars, que je dis, en me reculant parmi eux. Je vais me trouver mal !
... et le dernier, "En fait de simple soldat". où l`on voit un jeune officier se dévouer à ses soldats frappés par une épidémie. au point d`être lui-même victime de la contagion. Les personnages de Kipling, dont les types sont trop accentués peut-être pour exprimer l`exacte vérité, symbolisent avant tout la mentalité très particulière du soldat colonial anglais. Dans certaines nouvelles, l`humour jaillit de la situation, des personnages et de leur argot : dans les autres. au contraire. on respire l'atmosphère chaude, anémiante et parfois tragique de la vie de garnison dans l`lnde tropicale (Trad. UGE. 1980; Robert Laffont, 1988.).

"The Phantom Rickshaw" de 1888 contient l'histoire de “The Man Who Would Be King” (un journaliste britannique rapporte l'histoire d’un couple d’aventuriers comiques qui s’établissent brièvement comme des leaders divins d’une tribu indigène en Afghanistan, toute une exploration de la réalité et de la fiction), et "Wee Willie Winkie", “Baa Baa, Black Sheep” ....

Puis vint le célébrissime "The Jungle Book", 1894 (Le Livre de la jungle, Paris, Mercure de France, 1899) qui propose en sept récits un voyage fabuleux au coeur de la jungle (Mowgli, petit garçon volé dans un village par le tigre Shere Khan, sauvé par un clan de loups et pris sous leur protection par la panthère Bagheera et l'ours Baloo..) ...
"IT was seven o'clock of a very warm evening in the Seeonee hills when Father Wolf woke up from his day's rest, scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in the tips. Mother Wolf lay with her big gray nose dropped across her four tumbling, squealing cubs, and the moon shone into the mouth of the cave where they all lived. "Augrh!" said Father Wolf, "it is time to hunt again"; and he was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined: "Good luck go with you, O Chief of the Wolves; and good luck and strong white teeth go with the noble children, that they may never forget the hungry in this world." ...
C`est essentiellement l'histoire de Mowgli, un "petit d'homme", qui. perdu dans la forêt indienne, se voit recueilli dans la société des animaux. Elevé par une louve (comme dans l'antique légende méditerranéenne). il est, dans une certaine mesure, assujetti à la loi de la jungle tout en lui demeurant quelque peu supérieur et, d`un commun accord, devient le petit roi de ce peuple libre. En effet, comme l`écrit Kipling, "Il y a désormais, dans la jungle, quelque chose de plus que la loi de la jungle". Mowgli ayant été enlevé par la tribu des singes, ses trois amis Baloo (l'ours brun), Bagheera (la panthère noire) et Kaa (le python du rocher) accourent pour le délivrer. A son tour, il combat les ennemis de son peuple d'adoption et s'empare de Shere Khan, le tigre félon aux yeux jaunes. Mais bientôt. devenu jeune homme, il prend conscience de son espèce. C'est non sans tristesse qu'il se détache de ses amis et, comme le constate Frère Gris, l`aîné des petits de la louve. l'homme finit toujours par retourner à l`homme. Alors, Mowgli descend jusqu`aux terres labourées, au pays des hommes, ses frères. C'est la transparence des symboles qui a pu frapper dans cette œuvre où se rencontrent la poésie coloniale, l'apologie de l'idée impériale (innombrables sont les lois de la Jungle, nul n'y peut faillir!) mais tout autant roman d'aventures et l'inspiration classique. Les contes intercalés entre les deux chapitres de l`histoire de Mowgli sont de proportions plus modestes, mais ils ont presque tous un relief saisissant....

"The Second Jungle Book" (1895) le second opus de cet hymne à la jungle en huit nouvelles; "Captains Courageous: a Story of the Grand Banks" (1897) est le roman d'apprentissage du jeune et arrogant Harvey Cheyne dans le monde des pêcheurs du banc de Terre-Neuve; "Kim" (1901) est un second roman d'apprentissage, celui d'un jeune orphelin irlandais dans lequel Kipling restitue l'expérience de son enfance en Inde et sa double culture anglo-indienne, mais aussi et surtout un magnifique roman d'aventure au sens plein du terme....
Le poème "lf", publié en 1910, traite du stoïcisme qui aurait, nous dit-on, tant aidé les Britanniques à construire leur empire : il fut extrêmement populaire pendant la Première Guerre mondiale. Chris Ash, dans "The If Man: Dr Leander Starr Jameson, the Inspiration for Kipling’s Masterpiece" (2011) nous conte la biographie du Dr Leander Starr Jameson, "The Doctor", héros, voyou et coquin de l’Empire qui a inspiré Kipling à écrire son chef-d’œuvre ...
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:
If you can dream – and not make dreams your master;
If you can think – and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:
If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”
If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings – nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son!

"Seven Seas" (Les Sept Mers, 1896)
Poèmes composés par Rudyard Kipling et publiés en 1896, à la gloire de l'impérialisme britannique. Les joies et les fatigues des longues navigations, la richesse des armateurs,
la puissance de la marine de guerre, l'enchantement des terres proches et lointaines de l'Empire, baignées par sept mers, tels sont les thèmes explicites ou voilés de ces trente-trois poésies, dont la valeur n'est pas toujours égale. Le premier groupe est intitulé "‘A Song of the English", et comprend principalement, "Deep-Sea Cables" (les câbles télégraphiques transatlantiques établissant une communication globale instantanée), "Song of the Cities", dans lequel les principaux ports de l'Empire racontent leur histoire.. Et puis il y a la mer, une femme près de la porte du Nord, une femme riche, c’est elle, elle élève une race d’hommes et les jette sur la mer, et certains sont noyés dans l’eau profonde ...
The Sea-Wife
There dwells a wife by the Northern Gate,
And a wealthy wife is she;
She breeds a breed o’ rovin’ men
And casts them over sea.
And some are drowned in deep water,
And some in sight o’ shore,
And word goes back to the weary wife
And ever she sends more.
For since that wife had gate or gear,
Or hearth or garth or bield,
She willed her sons to the white harvest,
And that is a bitter yield.
She wills her sons to the wet ploughing,
To ride the horse of tree,
And syne her sons come back again
Far-spent from out the sea.
The good wife’s sons come home again
With little into their hands,
But the lore of men that ha’ dealt with men
In the new and naked lands;
But the faith of men that ha’ brothered men
By more than easy breath,
And the eyes o’ men that ha’ read wi’ men
In the open books of death.
Rich are they, rich in wonders seen,
But poor in the goods o’ men;
So what they ha’ got by the skin o’ their teeth
They sell for their teeth again.
For whether they lose to the naked life
Or win to their hearts’ desire,
They tell it all to the weary wife
That nods beside the fire.
Her hearth is wide to every wind
That makes the white ash spin;
And tide and tide and ‘tween the tides
Her sons go out and in;
(Out with great mirth that do desire
Hazard of trackless ways,
In with content to wait their watch
And warm before the blaze);
And some return by failing light,
And some in waking dream,
For she hears the heels of the dripping ghosts
That ride the rough roof-beam.
Home, they come home from all the ports,
The living and the dead;
The good wife’s sons come home again
For her blessing on their head!
"The Sea-Wife", d`une épique grandeur, où l'Angleterre est comparée à l'épouse de la Mer qui envoie ses propres fils aux quatre coins du monde à la recherche d'aventures. La mer est, pour Kipling, une splendide école contre la corruption de la civilisation moderne.
"I’ve paid for your sickest fancies; I’ve humoured your crackedest whim / Dick, it’s your daddy, dying; you’ve got to listen to him! / Good for a fortnight, am I? The doctor told you? He lied. / I shall go under by morning, and - Put that nurse outside. / ‘Never seen death yet, Dickie? Well, now is your time to learn, / And you’ll wish you held my record before it comes to your turn. / Not counting the Line and the Foundry, the yards and the village, too, / I’ve made myself and a million; but I’m damned if I made you. ..."
Dans une longue et dramatique poésie, "The Mary Gloster" (1894), le très riche propriétaire d'une société de navigation, pour sauver son fils, amolli par la métropole londonienne, lui impose, avant de mourir, de mettre sa dépouille sur son plus beau navire et de la jeter au plus profond de l'océan au large de Macassar ( Never seen death yet, Dickie? . . . Well, now is your time to learn!). La métrique de presque toutes ces poésies est celle des chansonnettes londoniennes de café-concert au rythme fortement accentué ...
Du vivant de Thomas Hardy (1840-1928), la poésie attirait un lectorat bien plus important que de nos jours. Les œuvres de certains poètes (Rupert Brooke, 1887-1915, et Robert Bridges, 1844-1930, par exemple) furent des best-sellers et l'écriture de poésie était un passe-temps relativement courant parmi la population en général, Un grand nombre de poèmes populaires se référaient au XIXe siècle, par leur forme, leur tonalité et leur contenu, et rares sont ceux qui, aujourd'hui, recueillent un minimum d'attention critique. Les classifications historiques comme "géorgienne" (pour la poésie anglaise écrite pendant le règne du roi George V, 1910-1936) ont même une connotation désobligeante. Certains poètes parvinrent toutefois a être en vogue de leur vivant et à jouir ensuite d'une renommée durable.
C'était le cas de Rudyard Kipling, dont "Barrack-Room Ballads" (1982), le recueil comprenant des poèmes tels que "Danny Deever", "Gunga Din" et "Mandalay", s'inspire du langage vernaculaire et des attitudes des Britanniques en Inde. Kipling connut donc rapidement le succès avec ses poèmes (cf. A Choice of Kipling’s Verse, T.S. Eliot ) et devint bientôt, avec sa présentation intrigante des gens, de l'histoire et de la culture de l'époque, un maître du récit court.
ll célébra l'héroïsme des soldats coloniaux britanniques, mais il reste célèbre pour "Le Livre de la jungle", qui inspira moult ouvrages littéraires et adaptations télévisuelles et cinématographiques....

"Gunga Din" inspira un célèbre film de 1939, réalisé par George Stevens, avec Cary Grant, Victor McLaglen, Douglas Fairbanks Jr. et Joan Fontaine ...
You may talk o’ gin and beer
When you’re quartered safe out ’ere,
An’ you’re sent to penny-fights an’ Aldershot it;
But when it comes to slaughter
You will do your work on water,
An’ you’ll lick the bloomin’ boots of ’im that’s got it.
Now in Injia’s sunny clime,
Where I used to spend my time
A-servin’ of ’Er Majesty the Queen,
Of all them blackfaced crew
The finest man I knew
Was our regimental bhisti, Gunga Din,
He was ‘Din! Din! Din!
‘You limpin’ lump o’ brick-dust, Gunga Din!
‘Hi! Slippy hitherao
‘Water, get it! Panee lao,
‘You squidgy-nosed old idol, Gunga Din.’
The uniform ’e wore
Was nothin’ much before,
An’ rather less than ’arf o’ that be’ind,
For a piece o’ twisty rag
An’ a goatskin water-bag
Was all the field-equipment ’e could find.
When the sweatin’ troop-train lay
In a sidin’ through the day,
Where the ’eat would make your bloomin’ eyebrows crawl,
We shouted ‘Harry By!’
Till our throats were bricky-dry,
Then we wopped ’im ’cause ’e couldn’t serve us all.
It was ‘Din! Din! Din!
‘You ’eathen, where the mischief ’ave you been?
‘You put some juldee in it
‘Or I’ll marrow you this minute
‘If you don’t fill up my helmet, Gunga Din!’
’E would dot an’ carry one
Till the longest day was done;
An’ ’e didn’t seem to know the use o’ fear.
If we charged or broke or cut,
You could bet your bloomin’ nut,
’E’d be waitin’ fifty paces right flank rear.
With ’is mussick on ’is back,
’E would skip with our attack,
An’ watch us till the bugles made 'Retire,’
An’ for all ’is dirty ’ide
’E was white, clear white, inside
When ’e went to tend the wounded under fire!
It was ‘Din! Din! Din!’
With the bullets kickin’ dust-spots on the green.
When the cartridges ran out,
You could hear the front-ranks shout,
‘Hi! ammunition-mules an' Gunga Din!’
I shan’t forgit the night
When I dropped be’ind the fight
With a bullet where my belt-plate should ’a’ been.
I was chokin’ mad with thirst,
An’ the man that spied me first
Was our good old grinnin’, gruntin’ Gunga Din.
’E lifted up my ’ead,
An’ he plugged me where I bled,
An’ ’e guv me ’arf-a-pint o’ water green.
It was crawlin’ and it stunk,
But of all the drinks I’ve drunk,
I’m gratefullest to one from Gunga Din.
It was 'Din! Din! Din!
‘’Ere’s a beggar with a bullet through ’is spleen;
‘’E's chawin’ up the ground,
‘An’ ’e’s kickin’ all around:
‘For Gawd’s sake git the water, Gunga Din!’
(...)
Malgré les critiques ultérieures concernant les opinions impérialistes et l'éventuel racisme de Kipling, ses œuvres ont le mérite d'exposer avec grande conscience les problèmes de l'Empire britannique. En outre, un grand nombre de ses écrits, "Plain Tales from the Hills" (Simples contes des collines, 1888) dressent un tableau réaliste de la psychologie et des conditions de vie difficiles des colons....

A.E. Housman (1859-1936) jouira à l'égal de Kipling d'une popularité durable....
Son livre (63 poèmes), "A Shropshire Lad" (1886), devint un vade-mecum des soldats de la Première Guerre mondiale (THE RECRUIT - Leave your home behind, lad. / And reach your friends your hand. / And go, and luck go with you While Ludlow tower shall stand...). Cette guerre portait toutefois en soi les germes d'une nouvelle poésie spécifique - une poésie dénuée de sentimentalisme, irrémédiablement aux antipodes des valeurs de l'establishment, une poésie qui se confrontait à la modernité et ne regardait pas vers le passé. Un grand nombre de soldats trouvèrent que l'idéalisme patriotique de la poésie du début de la guerre (comme celle de Ruppert Brooke, 1887-1915, par exemple) ne reflétait pas les conditions réelles du conflit. Les stratégies des généraux aristocratiques blanchis sous le harnais s'avérèrent surannées. Le commandement militaire était déconnecté des préoccupations du conscrit ordinaire et se souciait généralement peu de ses conditions de vie difficiles. En outre, l'organisation laissait a désirer, les conditions physiques étaient effroyables et le traumatisme psychique subi par les soldats se heurtait à l'incompréhension. Cette guerre eut le mérite de mettre en lumière les problèmes inhérents à la société en général. Des poèmes comme "Anthem for Doomed Youth" (Hymne à la jeunesse condamnée), de Wilfred Owen (1893-1918) enrichirent la poésie d'un nouveau réalisme doublé d'un arsenal technique à même de donner du poids au message de protestation. Le langage familier donnait la parole au simple soldat, les demi-rimes suggéraient un rejet de l'harmonie et des lieux communs, et l'allitération évoquait les sons de la guerre mécanisée. Des poèmes tels que "The General" (Le Général), de Siegfried Sassoon (1886-1967) en rajoutèrent à ce mélange d'ironie amère et de satire caustique....

Wilfred Owen (1893-1918), "Anthem for Doomed Youth" (1917)
L’un des poètes les plus connus et les plus aimés de Grande-Bretagne, Wilfred Owen (1893-1918), a été tué à l’âge de 25 ans lors de l’un des derniers jours de la Première Guerre mondiale, après avoir agi héroïquement en tant que soldat et officier malgré ses célèbres doutes sur la logique et la conduite de la guerre....
Anthem for Doomed Youth, BY WILFRED OWEN
What passing-bells for these who die as cattle?
— Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles' rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries now for them; no prayers nor bells;
Nor any voice of mourning save the choirs,—
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.
What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of goodbyes.
The pallor of girls' brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.

Siegfried Sassoon (1886-1967), "The General" ...
"The War Poems" publiés en 1919, s'ouvre par une citation en français de Henri Barbusse (Le Feu), "Dans la trêve désolée de cette matinée, ces hommes qui avaient été tenaillés par la fatigue, fouettés par la pluie, bouleversés par toute une nuit de tonnerre, ces rescapés des volcans et de l'inondation entrevoyaient à quel point la guerre, aussi hideuse au moral qu'au physique, non seulement viole le bon sens, avilit les grandes idées, commande tous les crimes—mais ils se rappelaient combien elle avait développé en eux et autour d'eux tous les mauvais instincts sans en excepter un seul; la méchanceté jusqu'au sadisme, l'égoïsme jusqu'à la férocité, le besoin de jouir jusqu'à la folie". I. PRELUDE: THE TROOPS, "Dim, gradual thinning of the shapeless gloom / Shudders to drizzling daybreak that reveals / Disconsolate men who stamp their sodden boots / And turn dulled, sunken faces to the sky / Haggard and hopeless. They, who have beaten down / The stale despair of night, must now renew / Their desolation in the truce of dawn, / Murdering the livid hours that grope for peace...."
The General
“Good-morning, good-morning!” the General said
When we met him last week on our way to the line.
Now the soldiers he smiled at are most of 'em dead,
And we're cursing his staff for incompetent swine.
“He's a cheery old card,” grunted Harry to Jack
As they slogged up to Arras with rifle and pack.
But he did for them both by his plan of attack.

"The light goes off" (1891, La Lumière qui s’éteint)
Premier roman de Kipling, pour lequel il gardera toujours une affection particulière. Maltraités par l’acariâtre Mme Jenkins, deux orphelins, Dick et Maisie, n’ont guère que leur tendresse comme lueur d’espoir et un rêve commun: devenir peintres. Dick y parvient, devenu célèbre par ses croquis de bataille lors de la guerre du Soudan. Le hasard le fait retrouver Maisie et, au nom de leur amour d’enfance, il lui demande de devenir sa femme. Maisie se dérobe, mais, peintre médiocre obsédée par une réussite artistique qui ne viendra probablement jamais, elle a besoin de Dick, et une étrange relation se noue entre eux. Puis, le drame survient: la lumière s’éteint à jamais pour le peintre qui aimait tant la couleur et le soleil...
