- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Baruch Spinoza (1632-1677), "Traité pour la réforme de l'entendement" (1662), "Ethique" (1677), "Tractatus Theologico-Politicus" (1677) - Uriel da Costa (1585-1640) - Henry Oldenburg (1619-1677) - Lodewijk Meyer (1629-1681) - Jarig Jelles (1620-1683) - Adriaan Koerbagh (1633-1669) - Johannes Bouwmeester (1630-1680) - ..
Last update 10/10/2021

"Sans Dieu rien ne peut être ni être conçu" - Le libre-arbitre est une illusion, la liberté humaine est illusoire. Pourtant notre existence d'être humain, qui n'est qu'une part d'une nécessité irréductible à notre nature et qui nous dépasse infiniment, peut nous permettre de formuler malgré tout une connaissance qui nous achemine vers une certaine forme de liberté : une liberté rationnelle qui nous permet de nous appréhender comme un être de passions et de prendre conscience de cette nécessité coextensive à notre nature.
Baruch Spinoza pose, en cette deuxième moitié du XVIIe, une équation qui de nos jours, si elle ne nous est pas compréhensible nous indiffère sans retour. Le XVIIIe siècle est passé par là. Le qualificatif de spinoziste en est venu à désigner abusivement les matérialistes parce qu'il critique la théologie traditionnelle et l'idée d'un Dieu créateur. Certes, le Dieu de Spinoza n'est pas celui du judéo-christianisme, un Dieu personnel auquel il nous est possible de nous adresser. Il n'a crée ni ne transcende ce monde, il est ce monde. Panthéisme et déterminisme se côtoient. Quant à l'être humain, tout à ses passions, il n'a aucune conscience d'appartenir à la nature divine.
Trait particulier de ce XVIIIe siècle en effervescence intellectuelle constante, on réinterprète tant Spinoza que Locke ou Bayle, un Fontenelle retient la métaphysique de Descartes pour ruiner toute métaphysique, il s'agit avant toutes choses de ne retenir du passé que les éléments justifiant le présent et sa critique. Ainsi, de Spinoza, on ignore l'inspiration maîtresse de l'Éthique, son ivresse de Dieu, son effort pour affranchir l'âme de la servitude des passions et la libérer par l'amour intellectuel de Dieu, qui nous fait prendre conscience de notre éternité. On n'en retient que certaines données séparées de leur contexte et qui apparaissent propres à ruiner les croyances traditionnelles et bouleverser l'ordre établi : à savoir que le moteur de tout être est le désir, ou la tendance à persévérer dans son être, que l'être humain n'est pas un empire dans un empire, mais qu'il est régi par les lois nécessaires qui régissent l'univers, que Dieu et la Nature sont une seule et même chose. Bayle expliquera dans son Dictionnaire "Voici ce que c'est : à vue de pays, on appelle Spinozistes tous ceux qui n'ont guère de religion, et qui ne s'en cachent pas beaucoup..."
Plus encore qu'à l'Éthique, on demande au Traité théologico-politique, paru en 1670, traduit en français en 1678, des arguments contre l'autorité sacrée de l'Écriture et de la révélation, des prophéties et des miracles, à l'interprétation desquels, selon Spinoza, ne doit être appliquée aucune autre règle que celles de la critique telles que les prescrit la lumière naturelle, aucune autre méthode que celle dont on se sert pour interpréter la Nature par la Nature elle-même, la foi n'ayant rapport qu'à la pratique de l'obéissance et de la piété, non à la connaissance de la vérité, seul objet de la philosophie : en sorte que l'Écriture laisse la Raison entièrement libre. C'est ce que va montrer encore, avec plus de rigueur, l'oratorien Richard Simon dans son Histoire critique du Vieux Testament (1678) et du Nouveau Testament (1689-1693), et l'on se gardera bien, en le suivant, de maintenir, comme il le fait, la valeur de la tradition pour l'interprétation des textes sacrés issus d'elle, mais l'on en viendra, comme le prévoyait Bossuet, que l'Écriture est à traiter comme un livre humain, et l'on ne tardera pas à dire avec le baron de Lahontan : "Comment veux-tu que je croie la sincérité de ces Bibles écrites depuis tant de siècles, traduites de plusieurs langues par des ignorants qui n'en auront pas conçu le véritable sens, ou par des menteurs qui en auront changé, augmenté ou diminué les paroles qui s'y trouvent aujourd'hui?" (Dialogues curieux, 1703).
Après la cité de Dieu et avec elle, c'est la cité du Roi qui se trouve ébranlée jusque dans ses fondements par les principes qu'on tire de Spinoza. Comme on avait puisé dans le Traité théologico-politique des arguments contre la première, on y cherche des preuves contre la seconde, contre le pouvoir absolu que s'arrogent les rois, contre la superstition par laquelle les puissants tiennent asservi le peuple, dont ils ont pour unique tâche d'assurer la liberté par le respect de leurs droits inaliénables, car telle est la fin de l'État, telle est la condition nécessaire au maintien de la paix. Cependant le pouvoir est-il autre chose qu'une délégation consentie par les sujets? N'est-il pas issu d'un pacte qui est la seule source de son autorité, et dont la fin qui le légitime est précisément de sauvegarder l'intérêt et la liberté de ceux qui l'ont conclu? Voilà ce que laisse dans tous las cas clairement entendre Spinoza dans la préface de son Traité. Et voilà, dans la continuité, ce qu'on enseigne et qu'on pratique en Angleterre comme en Hollande, et ce que revendiquent, avec Jurieu (Lettres pastorales adressées aux fidèles de France qui gémissent sous la captivité de Babylone, 1689) les protestants exilés de France par la Révocation de l'Édit de Nantes (1685). Et voilà enfin ce que proclame Locke, ennemi de la théocratie anglicane comme de tout dogmatisme individuel, et soucieux d'amener l'esprit à "la nature inflexible des choses et à leurs relations inaltérables". On ne discute pas ici du fond mais du détournement de pensée d'un Spinoza qui avait démontré qu'aux yeux de la Raison tout, dans la théorie comme dans la pratique, est soumis à l'ordre nécessaire et éternel de la Nature (Eth. II, 44). Dieu ou la Nature, scande Spinoza, car "je ne sépare pas Dieu de la Nature", écrivait-il à Oldenburg en 1661, et il le justifiait tout au long de son chapitre sur les Miracles, où il s'insurge contre l'opinion de ceux qui assimilent la puissance de Dieu à l'empire arbitraire de je ne sais quelle majesté royale (tanquam Regiae cujusdam majestatis imperium), alors qu'elle n'est autre chose que l'ordre même de la Nature, suite nécessaire des lois éternelles.
De l'équation Dieu-Nature, posée par Spinoza, le XVIIIe siècle ne retiendra que le second terme, qui lui suffisait....

BEERSTRATEN, Jan Abrahamsz, Skating at Sloten, near Amsterdam, 1660-1665, Metropolitan Museum of Art, New York

Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, Baruch Despinoza (après sa rupture avec la synagogue en 1656, Spinoza changea son nom de Baruch pour celui de Benedictus ou Bento. Dans son livre "The philosophy of Spinoza unfolding the latent processes of his reasoning" (1934), H. A. Wolfson distinguera un Spinoza explicite, Benedictus, et un Spinoza implicite, Baruch, cabaliste et scolastique) appartenait à une famille de ces Juifs espagnols qui, pour se soustraire aux suspicions dont ils étaient l'objet, avaient dû émigrer au Portugal, où ils se fixèrent, puis chercher asile en France, à Bordeaux, à Bayonne, à Nantes, et finalement, ou parfois directement même, en Hollande, où, malgré l'intolérance du parti calviniste au pouvoir, ils jouissaient d'une liberté relative dans l'exercice de leur culte. Cependant, les Juifs espagnols et portugais, auxquels Spinoza appartenait - et ce trait doit être retenu, car il explique le caractère foncièrement ibérique de son génie, - étaient très différents de leurs coréligionnaires des Pays-Bas. Ils descendaient, pour la plupart, des Marranes, devenus catholiques å la suite d'un édit de Ferdinand le Catholique en 1492, mais demeurés Juifs de cœur, et Juifs espagnols de tempérament. Soustraits, en leur pays d'origine, à l'enseignement talmudique de la communauté hébraïque, ils s'étaient adonnés aux sciences profanes, logique et métaphysique, mathématiques, mécanique, médecine, qui étaient tout à fait étrangères aux Juifs d'Amsterdam et les surprirent et les scandalisèrent chez les nouveaux venus. Tel cet Uriel da Costa (1585-1640), en qui se découvre la figure tragique des Marranes hispano-portugais, et qui, venu à l'âge de trente ans (vers 1618), de Porto, où il était né, en Hollande, où il se fixa, propose aux hommes dans ses écrits (Carl Gebhardt, Die schriten des Uriel du Costa), et en particulier dans son "Exemplar humanae vitae" (Exemple d'une vie humaine, 1640), un idéal de vie purement humaine, s'attaque à la tradition juive, en montrant que la loi de Moïse est en contradiction avec la loi de nature, et proclame la condition mortelle de l'âme : toutes thèses que l'on retrouvera sous une autre forme chez Spinoza, bien que la tradition spinoziste, demeurée encore vivante de nos jours au Portugal, sépare Spinoza d'Uriel da Costa, tout au moins sur la question controversée de la mortalité ou de l'immortalité de l'âme.
La famille de Spinoza était originaire, ce semble, de Galice, où l'on trouve, dès le XIVe siècle, des Espinosa à Orense. En quittant l'Espagne, les Spinoza s'installèrent d'abord au Portugal, à Figueira, près de Coïmbre, selon les uns, mais plus probablement à Vidigueira, près de Beja, dans le sud du Portugal, et ils gardèrent toujours des attaches étroites avec leur pays d'adoption. Un curieux contrat retrouvé dans les archives de la ville d'Amsterdam relate, à la date du 28 avril 164-1, le mariage de Michael de Espinosa de Vidiger, veuf de Debora Despinosa, avec Esther de Espinosa de Lisbonne, les deux demeurant à Vloijenburg. La famille de Spinoza était alors fixée à Amsterdam, qui était le siège d'une importante communauté juive, riche, bien organisée, dotée d'œuvres d'assistance et d'éducation, et d'une Banque de crédit destinée à financer les entreprises qui avaient été transférées d'Espagne en Hollande : commerce des denrées coloniales, des épices, des joyaux, des pierres précieuses, exigeant des connaissances variées et des relations étendues. Le père du philosophe, Michel Despinoza, comme son grand-père Abraham, était un marchand considéré, qui fut chargé de fonctions importantes au sein de la communauté israélite. Sa mère, la seconde femme de Michel, Hana Debora, mourut en 1638.
Les Spinoza habitèrent d'abord la Cité aux puces (Vloijenburg), puis le quartier plus sain et plus confortable de Burgwall, près de la nouvelle synagogue. A l'école de la communauté juive, ouverte depuis 1620, le jeune Baruch reçut sa première formation. Il fut initié par ses maîtres, notamment par Saül Morteira, à la langue hébraïque, aux livres de l'Ancien Testament, aux études talmudistes : . Spinoza se réfèrera à l'opinion des "anciens Hébreux" dans Ethique II, 7, et dans une lettre à Oldenburg, et citera plusieurs fois le Talmud dans le Traité théologico-politique. Il manifesta de bonne heure ses dons, car, au dire de Johannes Colerus (1647-1707), ministre luthérien et auteur d'une biographie de Spinoza, "il n'avait pas quinze ans qu'il formait des difficultés que les plus habiles d'entre les Juifs avaient de la peine à résoudre". Il reçut là une éducation tout entière pénétrée d'une atmosphère théologique, qui lui apprit à mettre Dieu au principe de toutes ses pensées, de tous ses actes, de tous les événements de sa vie : en sorte que, bien loin de mériter l'appellation d' "athée de système" que lui décernera Pierre Bayle dans son Dictionnaire historique et critique, , - accusation déjà formulée de son vivant et contre laquelle il proteste énergiquement, car "les athées, écrit-il, ont coutume d'avoir un amour immodéré des honneurs et des richesses, que j'ai toujours méprisés" (Ep. 43) -, on doit le considérer bien plutôt, avec Novalis et le romantisme allemand, comme un "penseur ivre de Dieu", quoi qu'on puisse penser par ailleurs de la conception qu'il se fait de Dieu et de son infinie puissance. Au reste, sur ce dernier point, il ne paraît pas douteux qu'il ait subi dès cette époque l'influence d'un maître qui fréquentait la synagogue dans les années 1644-45, le protestant anti-trinitarien Pieterszoon Beelthouwer (1603-1665), appartenant à la secte des Doopszinden, qui enseignait que Dieu est tout, qu'il contient tout, et qui faisait appel à l'unité de la nature, par l'union de Dieu et du monde. Ainsi, tout jeune, à l'âge où l'esprit reçoit ses premières et plus vives impressions, Spinoza était mis en face de la doctrine dont s'inspirera toute sa philosophie : la causalité immanente de Dieu, comme fondement de l'unité de Dieu et de la Nature. En même temps, il était rompu par ses maîtres juifs à l'exégèse subtile et compliquée des textes sacrés (cf. la grande Bible massorético-rabbinique de Johannes Buxtorf (1564-1629), 1618) qui se retrouve dans une partie de son œuvre, et qui l'habitua dès cette époque à un certain raffinement dans l'argumentation.
C'est entre les années 1651 et 1655 que paraît s'être décidée la vocation de Spinoza et que se fixèrent dans son esprit les principes de sa philosophie. Ayant peu de goût pour la profession de marchand, qu'il eut cependant à exercer occasionnellement, et les fonctions publiques lui étant interdites, il parait avoir songé à se préparer au rabbinat, et, en tout cas, il préluda à ses recherches spéculatives par l'étude approfondie de la Cabale et de la philosophie juive du Moyen âge, ainsi que de la scolastique contemporaine.
Cependant, la connaissance de la Bible, du Talmud, de la Cabale et de ses commentateurs, ainsi que de la philosophie juive, ne lui suffisait plus, et il résolut, au dire de Colerus, de ne plus consulter que lui-même, mais de n'épargner aucun soin pour arriver à la découverte de la vérité, dont l'amour était sa passion dominante. Dans son désir d'étendre ses connaissances, il décida de s'adresser à un homme réputé pour la variété de son savoir, le médecin et philosophe Franciscus van den Enden (1602-1674), curieux de l'antiquité classique, de la philosophie nouvelle et des sciences, adepte, au surplus, de la théosophie alors si répandue en Italie et dans les pays germaniques : homme singulier, qui devait passer en France, où il fut médecin et conseiller du roi Louis XIV et finalement pendu pour avoir pris part à une conspiration contre le roi (1674).
C'est après la mort de son père (30 mars 1654) et la rupture de ses liens avec sa famille, que Spinoza paraît s'être rapproché de van den Ende au point d'habiter sa demeure à Amsterdam. Van den Ende avait une fille unique, qui possédait la langue latine parfaitement bien, ainsi que la musique. "Comme Spinoza avait occasion de la voir et de lui parler très souvent", nous conte Colerus après Bayle, "il en devint amoureux, et il a souvent avoué qu'il avait eu dessein de l'épouser. Ce n'est pas qu'elle fût des plus belles et des mieux faites, mais elle avait beaucoup d'esprit, de capacité et d'enjouement : et c'est là ce qui avait touché le cœur de Spinoza, aussi bien qu'un autre disciple de van den Ende, nommé Kerkering, natif de Hambourg. Celui-ci s'aperçut bientôt qu'il avait un rival et ne manqua pas d'en devenir jaloux : ce qui l'obligea de redoubler ses soins et ses assiduités auprès de sa maîtresse. Il le fit avec succès; quoique le présent qu'il avait fait auparavant à cette fille d'un collier de perles de la valeur de deux ou trois cents pistoles contribuât sans doute à lui gagner ses bonnes grâces. Elle les lui accorda donc et lui promit de l'épouser : ce qu°elle exécuta fidèlement après que le sieur Kerkering eut abjuré la religion luthérienne dont il faisait profession et eut embrassé la catholique."
Spinoza revint donc à ses chères études et s'y adonna tout entier (Paul Vulliaud, Spinoza d'après les livres de sa bibliothèque, 1934). Avec van den Ende son horizon s'élargit singulièrement. Il apprit avec lui le latin, qui lui donnait accès à la scolastique et aux sciences, aussi bien qu'aux chefs-d'œuvre de l'antiquité classique, Plaute, Cicéron, Virgile, Ovide, Martial, Sénèque, Tacite, Pétrone, qu'il fréquents assidûment, comme les poèmes de Jean Pinto Delgado, de Francisco de Quevedo, de Gongora, les "Nouvelles exemplaires" de Cervantes, "El Critico" de Balthazar Gracian, les comédies de Perez de Montalvan, qui marquèrent son œuvre de l'influence du baroque. Par van den Ende, il connut ceux qu'on appelait, les "libertins", disciples des Italiens, que l'on soupçonnait de "jeter dans les esprits les premières semences de l'athéisme". En même temps qu'aux plus récents écrits des scolastiques, il s'initie à la philosophie des modernes, avec son armature de sciences, mathématiques, astronomie, mécanique, chimie, sciences de la nature. Il s'adonne lui-même à la recherche : avec son ami Henry Oldenburg (1619-1677) de Brême, secrétaire de la Société royale de Londres et immense intermédiaire des savants de l'époque, dont il fit la connaissance en 1661, il discute des expériences de Robert Boyle sur le nitre, la fluidité et la solidité; avec le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), il s'entretient de questions relatives à l'optique et à la construction des lunettes; avec Christian Huygens (1629-1695), de la réfraction et de l'avantage qu'il y a, selon lui, à se servir comme objectif d'une lentille plane-convexe plutôt que convexe-concave; avec Jarigh Jelles (1620-1683), qui préfaça les éditions posthumes du philosophe, du télescope et des vases communicants....
Il en tire la confirmation de cette idée que l'on doit bannir de la philosophie naturelle les formes substantielles, les qualités et les fins, et que tous les changements des corps se font selon les lois de la mécanique (Ep. 13. Eth. II). Lui-même composa un traité de l'Arc-en-ciel, et, au témoignage des éditeurs de ses OEuvres posthumes, il songeait, lorsqu'il mourut, à écrire un traité d'algèbre, "selon une méthode plus courte et plus intelligible". Il possède et lit, avec les œuvres d'Hippocrate dans l'édition de Cornarius (1554), les observations anatomiques de Niels Stensen (1638-1686), ce médecin danois qui tenta de le convertir au catholicisme (Ep. 76), et il a pu puiser dans l' "Idearum operatricium Idea" de Marcus Marci de Prague (1635) le principe que l'âme est l'idée du corps. Enfin, nous apprend Colerus, les œuvres de René Descartes lui étant tombées entre les mains, il les lut avec avidité, et, dans la suite, il a souvent déclaré que c'était là qu'il avait puisé ce qu'il avait de connaissances en philosophie.
Mais il convient de nous arrêter pour étudier de plus près la dette de Spinoza envers ses prédécesseurs, la pensée de Spinoza ne naît pas ex nihilo, le contexte intellectuel est d'une grande richesse. C'est à la scolastique de son temps qu'il s'adonna d'abord, semble-t-il : par elle, il s'initia à la méthode syllogistique, qui se substitua chez lui aux procédés de discussion talmudiques, et il apprit le maniement des concepts aristotéliciens qui fourniront à son intuition fondamentale de Dieu et de la puissance divine une expression, voire une formulation, qui n`ont pas été étrangères, selon Bergson, à l'infléchissement, sinon même à la déviation de sa visée première. Il ne semble pas que sa formation scolastique ait été puisée aux sources : il possédait, il est vrai, une édition latine des œuvres d'Aristote, ainsi que la "Logica vetus et nova" de Jean Clauberg (1658), le "Systema Logicae" de B. Keekermann (1615), et la "Logique" de Port-Royal. Il a lu saint Augustin, dans l' "Epitome" de ses œuvres qu'en a donné Jean Piscatorius (1555), le "Nucleus historiae ecclesiastique" de l'arminien Christophe Sandius (1668), l' "Institution chrétienne" de Calvin traduite en espagnol par Cyprien de Valera (1597), les ouvrages de Jean de Bologne sur la "Prédestination" (1555), et de Grotius "De satisfactione Christi" contre Fauste Socin (1661). Mais, bien qu'il se réfère aux thomistes et fasse des emprunts à Duns Scot, il ne paraît pas avoir pratiqué saint Thomas non plus que Duns Scot. Ce qu'il en connaît procède de deux auteurs : Adriaan Heereboord (1613-1661), qu'il cite dans les "Cogitala metaphysica" (II, 12), et dont il suit les "Maletemata" (1659) pour son exposé des causes dans le "Court Traité" (I, 3); et Franco Burgersdijck (1590-1635), le maître d°Heerebord à Leyde, chez qui l'on discerne une inspiration suarézienne et scotiste puisée à l'Ecole des théologiens de Salamanque, dont l'influence était alors si forte. Nous la retrouvons, avec des altérations caractéristiques, dans la pensée maîtresse et les formules mêmes des deux premières en date de ses œuvres, le "Court Traité", et les "Cogitata metaphysica" dont il a fait suivre son exposé des "Principes de la philosophie de Descartes", et dans lesquels il aborde, selon ses propres termes, les questions les plus difficiles de la métaphysique, générale et spéciale, concernant l'Être, les affections et les modes sous lesquels nous concevons l'essence et l'existence de chaque chose, et la dépendance nécessaire des créatures à l'égard de Dieu, ainsi que les attributs mêmes de Dieu et la nature de l'esprit humain.
Avec les "Disputationes metaphysicae" (1597) de Francisco Suarez (1548-1617), Spinoza fait des transcendantaux, l'Un, le Vrai, le Bien, de simples êtres de raison (Cog. Met. I, 6); il suit également Suarez dans l'ordre d'exposition des attributs de Dieu (Cog. Met. pt. II) : éternité, unicité, immensité, immutabilité, simplicité essentielle, omniscience, toute-puissance. L'argumentation par laquelle, à l'encontre des arguments de Franco Burgersdijck, il établit l'unicité de Dieu est empruntée à Duns Scot (Distinctiones in IV libros Sententiarum). De l'école franciscaine et des nominalistes, dont l'enseignement était assuré à Salamanque par la chaire de Durand de Saint-Pourçain, il tient cette idée, qui apparaît de bonne heure chez lui et qu'il maintiendra jusqu'au bout, en accord avec son goût de la réalité concrète (l'idée-mère au dire de certains critiques), à savoir que Dieu connaît essentiellement les choses singulières (Court Traité I, 6. Cog. Met. II, 7. Cf. Ethiq. V, 24) : car, dit-il, admettre que Dieu ne connaît que les choses universelles, c'est lui attribuer la connaissance de choses qui ne sont pas et qui n'ont aucune essence en dehors des choses singulières, alors que Dieu connaît essentiellement les choses singulières, qui sans son concours ne peuvent exister même un instant, et ne connaît les choses universelles qu'en tant qu'il connaît les représentations que s'en font les hommes. Sinon, cela reviendrait à dire, avec Aristote et Averroès, que Dieu connaît ce qui n'est pas et ne connaît pas ce qui est.
"Plus nous comprenons les choses singulières, et plus nous comprenons Dieu." Seulement, pour Spinoza, les choses singulières ne sont pas contingentes : le contingent, comme le possible, est un être de raison, ou mieux un simple défaut de notre intelligence (Cog.Met. I, 3). Les choses singulières sont nécessaires comme Dieu même et comme tout ce qui dépend de Dieu. Ici s'opère la coupure entre Spinoza et ses maîtres scolastiques : s'il parle encore, à cette époque, de création (Cog. Met. II, 10) et de choses créées (II, 7), c'est en un tout autre sens qu'eux. A proprement parler, écrit-il à Oldenburg en 1661, les hommes ne sont pas créés, ils sont seulement engendrés (Ep. 4). Et, en 1674, il écrit à Hugo Boxel (Ep. 54) : Parler de création libre, c'est faire du monde un effet fortuit. Spinoza ne conçoit qu'un mode de l'être, en Dieu comme dans tout le reste : la nécessité (Cog. Met. I, 3); car les choses créées ou prétendu telles dépendent de Dieu quant à l'essence et quant à l'existence, et cette dépendance implique une nécessité mise en elles relativement à leur essence et à leur existence, en sorte qu'elles ne sauraient être autrement qu'elles ne sont.
Pensées Métaphysiques, I, III
"La possibilité et la contingence ne sont rien que des défauts de notre entendement.
S’il plaisait à quelqu’un de le nier, il ne serait pas difficile de lui démontrer son erreur. S’il considère la Nature, en effet, et comme elle dépend de Dieu, il ne trouvera dans les choses rien de contingent, c’est-à-dire qui, envisagé du côté de l’être réel, puisse exister ou ne pas exister, ou, pour parler selon l’usage ordinaire, soit contingent réellement ; cela se voit facilement par ce que nous avons enseigné dans l’Axiome 10, partie I : la même force est requise pour créer une chose que la conserver. Par suite, nulle chose créée ne fait quoi que ce soit par sa propre force, de même que nulle chose créée n’a commencé d’exister par sa propre force, d’où il suit que rien n’arrive sinon par la force de la cause qui crée toutes choses, c’est-à-dire de Dieu qui par son concours prolonge à chaque instant l’existence de toutes choses. Rien n’arrivant que par la seule puissance divine il est facile de voir que tout ce qui arrive arrive par la force du décret de Dieu et de sa volonté.
Or comme en Dieu il n’y a ni inconstance ni changement (par la Proposition 18 et le Corollaire de la Proposition 20, partie I), il a dû décréter de toute éternité qu’il produirait les choses qu’il produit actuellement ; et, comme rien n’est plus nécessaire que l’existence de ce que Dieu a décrété qui existerait, il s’ensuit que la nécessité d’exister est de toute éternité dans les choses créées. Et nous ne pouvons pas dire que ces choses sont contingentes parce que Dieu aurait pu décréter autre chose ; car, n’y ayant dans l’éternité ni quand, ni avant, ni après, ni aucune affection temporelle, on ne peut dire que Dieu existât avant ces décrets de façon à pouvoir décréter autre chose.
La conciliation de la liberté de notre arbitre avec la prédestination de Dieu dépasse la compréhension de l’homme.
Pour ce qui touche la liberté de la volonté humaine que nous avons dit être libre (Scolie de la Proposition 15, partie I), elle se conserve aussi par le concours de Dieu, et aucun homme ne veut ou ne fait quoi que ce soit sinon ce que Dieu a décrété de toute éternité qu’il voudrait et ferait. Comment cela est possible tout en maintenant la liberté humaine, cela passe notre compréhension ; et il ne faut pas rejeter ce que nous percevons clairement à cause de ce que nous ignorons ; nous connaissons en effet clairement, si nous sommes attentifs à notre nature, que nous sommes libres dans nos actions et que nous délibérons sur beaucoup pour cette seule raison que nous le voulons ; si nous sommes attentifs aussi à la nature de Dieu nous percevons clairement et distinctement, comme nous venons de le montrer, que tout dépend de lui et que rien n’existe sinon ce dont l’existence a été décrétée de toute éternité par Dieu. Comment maintenant l’existence de la volonté humaine est créée par Dieu à chaque instant de telle sorte qu’elle demeure libre, nous l’ignorons ; il y a en effet beaucoup de choses qui passent notre compréhension et que nous savons cependant qui sont faites par Dieu, comme par exemple cette division réelle de la matière en particules indéfinies en nombre démontrée par nous avec assez d’évidence (dans la Proposition 11, partie II), bien que nous ignorions comment cette division a lieu. On notera que nous supposons connu ici que ces deux notions de possible et de contingent signifient seulement un défaut de notre connaissance au sujet de l’existence d’une chose."
L'idée qui est le point de départ du spinozisme, c'est que de l'immutabilité divine se déduit la nécessité pour toutes choses d'être ce qu'elles sont, de telle sorte que le réel, l'intelligible et le nécessaire ne font qu'un. Cette idée, qui exclut toute création, Spinoza l'a trouvée peut-être chez Chasdaï Crescas et chez Maïmonide, qui lui ont transmis un écho direct de la tradition néoplatonicienne des Alexandrins et, en particulier, de Plotin. Cette même idée, il la trouvait exprimée déjà dans les thèses averroïstes de Boèce de Dacie condamnées en 1277, et chez certains maîtres d'Oxford comme Bradwardine qui, dans son De causa Dei (1335), déduit tout de la volonté nécessitante de Dieu selon une "nécessité toute mathématique" que Leibniz rapproche de Wiclef, de Hobbes et de Spinoza (Théodicée I, 27). Il la trouvait également chez Giordano Bruno (1548-1600), qui, dans ses écrits publiés en 1584 durant son séjour en Angleterre, dit expressément : la multiplicité de l'univers n'étant pas cause de soi doit être ramenée à une cause, car tout ce qui n'est pas principe et première cause a un principe et une cause, à savoir Dieu, l'Unité infinie, qui est tout, qui s'explique en un univers infini ne faisant qu'un avec son principe. Car une cause infinie a nécessairement un effet infini, sans quoi serait amoindrie la perfection et la puissance de Dieu avare de ses possibles. Métaphysique de l'Un, qui tend à un immanentisme décidé, bien que, dans le traité "De minima" (1591), Bruno professe que l'Unité infinie qui contient tout est néanmoins transcendante "super omnia". Dans le dialogue des "Fureurs héroïques" (Heroici Furori), d'inspiration néoplatonicienne, G. Bruno, avant Spinoza, tire de ces principes une éthique, dont la règle unique est l'ascension vers Dieu, le retour de l'âme exilée dans le monde du divers à l'Unité suprême, par la connaissance et l'amour liés, car l'amour et son objet ne font qu'un, et cet objet c'est Dieu (cf. le dernier sonnet du premier dialogue).
L'influence de G. Bruno, comme celle de Léon l'Hébreu, est visible dans le premier dialogue entre l'Entendement, la Raison, l'Amour et la Concupiscence, qui constitue la partie la plus ancienne (v. 1651) du "Court Traité" de Spinoza, et dans lequel, dès le début, l'Entendement soutenu par la Raison déclare ne pas considérer la nature autrement que dans sa totalité, comme infinie et souverainement parfaite, car il y a une substance unique subsistant par elle-même, et, comme la diversité des modes de la pensée se ramène à l'unité d'une même pensée substantielle, l'esprit, il est nécessaire de ramener la pensée substantielle et l'étendue substantielle à l'unité d'une même substance, à la fois pensante et étendue, Dieu, qui n'est autre chose vis-à-vis de ses effets qu'une cause immanente et un tout, eu égard à ce qu'il est composé d'eux...

1660 - "Court Traité de Dieu, de l'homme et de sa béatitude" (Tractatus de Deo et homine ejusque felicitate), composé en hollandais pour des amis chrétiens (1660), Dieu, soi-même et l'entraide, en, vue de la santé de l'âme et pour guider ceux qui sont malades en leur entendement, par l'esprit de douceur et de patience. Un assemblage de notes d'un Spinoza qui n'a pas encore achevé sa réflexion telle qu'elle l'Ethique la restituera..
"DIALOGUE ENTRE L’ENTENDEMENT, L’AMOUR, LA RAISON ET LE DÉSIR.
(1) L’Amour. – Je vois, mon frère, que mon essence et ma perfection dépendent absolument de ta perfection, et que ta perfection, d'où dépend la mienne, n'est autre que la perfection même de l'objet que tu as conçu : dis-moi donc, je te prie, si tu as conçu un être souverainement parfait, qui ne peut être limité par rien, et dans lequel moi-même je suis compris ?
(2) L'Entendement. – Pour moi, il n'y a que la nature elle-même, dans sa totalité, que je conçoive comme infinie et souverainement parfaite : si tu as des doutes à ce sujet, consulte la Raison, qui te répondra.
(3) La Raison. – C'est, pour moi, une vérité indubitable ; car, si nous voulons limiter la nature, il faudrait (ce qui est absurde) la limiter par le Rien et attribuer à ce Rien l'unité, l'éternité, l'infinité. Nous évitons cette absurdité en posant la nature comme une unité éternelle, infinie, toute-puissante, à savoir la nature comme infinie, en qui tout est compris ; et c’est la négation de cette nature que nous appelons le Rien.
(4) Le Désir. – A merveille ! cela s'accorde parfaitement avec l'unité et la variété qui se rencontrent dans la nature. En effet, je vois que la substance pensante n'a aucune communication avec la substance étendue, et que l'une limite l'autre.
(5) Or, si en dehors de ces deux substances vous en posez encore une troisième qui soit parfaite en soi, vous tombez dans d'inextricables difficultés. Car, si cette troisième substance est en dehors des deux autres, elle est privée de toutes les propriétés qui leur appartiennent, ce qui est impossible dans un Tout, en dehors duquel aucune chose ne peut être.
(6) En outre, si cet être est tout-puissant et parfait, il l'est parce qu'il est cause de soi-même, et non parce qu'il aurait produit un autre être ; et cependant celui-là serait en quelque sorte plus tout-puissant encore qui serait capable de produire et lui-même et autre chose.
(7) De même, si vous l’appelez omniscient, il est nécessaire qu'il se connaisse lui-même ; et en même temps vous devez accorder que la connaissance qu'il a de lui-même est moindre que cette connaissance jointe à celle des autres substances : autant de contradictions manifestes. C'est pourquoi je conseille à l'Amour de s'en tenir à ce que je lui dis, sans aller chercher d'autres raisons.
(8) L’Amour. – Que m'as-tu donc montré, ô infâme, si ce n'est ce qui produira ma perte ? car, si je m'unissais jamais à l'objet que tu m'as présenté, aussitôt je me verrais poursuivi par les deux ennemis du genre humain, la Haine et le Repentir, souvent même l'Oubli. C'est pourquoi je me tourne de nouveau vers la Raison, pour qu'elle continue à fermer la bouche à ces ennemis.
(9) La Raison. – Ce que tu dis, ô Désir, à savoir qu'il y a plusieurs substances distinctes, je te dis à mon tour que cela est faux, car je vois clairement qu'il n'en existe qu'une, conservatrice des autres attributs. Que si maintenant tu veux appeler substances le corporel et l'intellectuel par rapport aux modes qui en dépendent, il faut aussi que tu les appelles modes par rapport à la substance dont ils dépendent ; car ils sont conçus par toi non comme existant par eux- mêmes, mais de la même manière que tu conçois vouloir, sentir, entendre, aimer comme les modes de ce que tu appelles substance pensante, à laquelle tu les rapportes comme ne faisant qu'un avec elle : d’où je conclus par tes propres arguments que l'étendue infinie, la pensée infinie et les autres attributs (ou, comme tu t’exprimes, substances) infinis ne sont rien que les modes de cet être un, éternel, infini, existant par soi, en qui tout est un, et en dehors duquel aucune unité ne peut être conçue.
(10) Le Désir. – Je vois une grande confusion dans ta manière de parler, car tu parais vouloir que le tout soit quelque chose en dehors de ses parties et sans elles, ce qui est absurde : car tous les philosophes accordent unanimement que le tout est une seconde intention et qu’il n'est rien de réel dans la nature, en dehors de l’entendement humain.
(11) En outre, comme je le vois encore par ton exemple, tu confonds le tout avec la cause ; car, comme je le dis, le tout n'existe que par et dans ses parties : or, la substance pensante se présente à ton esprit comme quelque chose dont dépendent l'intelligence, l’amour, etc. ; tu ne peux donc pas la nommer un tout, mais une cause dont tous ces effets dépendent.
(12) La Raison. – Je vois bien que tu appelles contre moi tous tes amis ; et ce que tu ne peux faire par tes fausses raisons, tu l'essayes par l'ambiguïté des mots, selon la coutume de ceux qui s'opposent à la vérité. Mais tu ne parviendras pas par ce moyen à tirer l'Amour de ton côté. Tu dis donc que la cause, en tant qu'elle est cause de ses effets, doit être en dehors d'eux. Tu parles ainsi parce que tu ne connais que la cause transitive, et non la cause immanente, qui ne produit rien en dehors d'elle-même : par exemple, c'est ainsi que l'intelligence est cause de ses idées. C'est pourquoi, en tant que ses idées dépendent d'elle, je l’appelle cause ; en tant qu’elle se compose de ses idées, je l'appelle tout ; il en est de même de Dieu, qui par rapport à ses effets, c’est-à-dire aux créatures, n'est autre chose qu'une cause immanente, et qui, au second point de vue, peut être appelé tout."
Quoi qu'il en soit, au surplus, des influences subies, cette idée, chez Spinoza, répondait à une tendance inhérente à son esprit, comme le prouvent, d'abord, l'importance qu'il attribue, dès ses premières spéculations, plutôt qu'aux preuves a posteriori par les causes extérieures, à la preuve ontologique ou a priori de l'existence de Dieu conçu comme cause de soi, c'est-à-dire comme l'Être dont l'essence implique l'existence, bref comme l'Être qui existe par la seule nécessité de sa nature; et, en second lieu, l'extension qu'il en fait à l'infinité des choses, conçue comme découlant, par une inévitable nécessité, de la nature infinie de Dieu, en sorte que tout procède éternellement et nécessairement de Dieu en la même manière que de l'essence de Dieu découle nécessairement son existence. Dans cette conviction rationnelle, de l'uníverselle nécessité des choses qui est, il le dit expressément (Ep. 27), le point de départ de toutes ses spéculations philosophiques, se traduit, sous une forme conceptuelle que l'on a pu juger contestable, le sentiment profond et immédiat qu'a Spinoza de l'infinité de Dieu, liée à son existence nécessaire : c'est elle, selon ses propres termes, qui le délivre, car, pour lui, tout le problème moral se ramène au problème de l'Être; et elle le délivre, l'affranchit et le libère, en lui faisant prendre conscience de sa vraie nature en tant qu'elle dépend du Dieu omniprésent, éternel, tout-puissant, en qui la perfection se confond avec l'être même, et qui ne fait qu'un avec la Nature dont il n'est pas séparé (Ep. 6, fin) : en sorte que nous n'avons pas à tâcher de les rejoindre, par la foi, après qu'on les a séparés, par la raison, mais qu'il suffit, pour atteindre la vérité et la béatitude, de considérer toutes choses sous l'aspect de l'éternité ou de la nécessité, ce qui est tout un. "Unde sequitur, Dei aflirmationes et negationes aeternam semper necessitatem sive veritatem involvere" (Th. Pol., c. 4, p. 6).
Apparaît dans les dialogues du Court Traité, et notamment dans le dialogue entre Erasme et Théophile, Spinoza se heurte à la difficulté majeure de son système, qui est de savoir comment peuvent être conciliées l'immutabilité divine et l'apparition successive, dans la durée, des choses qui forment un « tout ›› avec leur cause immanente éternelle et qui, cependant, commencent et cessent d'exister. La théorie des modes, infinis et finis, par laquelle il tentera de la résoudre, ne lèvera pas la difficulté, non plus que la distinction qu'il établit entre les deux façons de concevoir l'existence des choses comme actuelles (Eth. V.). Et, sans doute, l'idée du « tout ›› n'est qu'un mode de pensée, mais qui 'est pas sans quelque fondement dans la réalité; en sorte que Dieu ne saurait être dit proprement former un tout avec les choses particulières, changeantes et finies, mais qu'elles sont néanmoins unies indissolublement à Dieu comme à leur cause immanente. Peut-être, ainsi que le confesse en conclusion Théophile, la difficulté ne peut-elle être levée que si notre idée de Dieu et notre union à lui sont telles qu'il nous soit impossible d'aimer quelque chose en dehors de Lui.
"DIALOGUE SECOND SE RAPPORTANT D’UNE PART À CE QUI PRÉCÈDE, ET DE L’AUTRE À CE QUI SUIT, ENTRE ÉRASME ET THÉOPHILE.
(1) Érasme. – Je t'ai entendu dire, ô Théophile, que Dieu est la cause de toutes choses, et que pour cette raison il ne peut être qu'une cause immanente. Mais, étant cause immanente de toutes choses, comment peut-il être cause éloignée ? car c'est ce qui parait en contradiction avec une cause immanente.
(2) Théophile. – En disant que Dieu est une cause éloignée, je n'entends pas parler de ces choses que Dieu produit sans aucun autre moyen que sa propre existence : je n'ai pas voulu entendre ce terme dans un sens absolu ; ce que tu aurais pu facilement comprendre par mes propres paroles lorsque j'ai dit que l'on ne peut le nommer cause éloignée qu'à un certain point de vue.
(3) Érasme. – Je comprends assez ce que tu veux me dire ; mais tu as dit en même temps, je m’en souviens, que l’effet d'une cause intérieure (immanente) demeure tellement uni avec sa cause qu'il ne fait qu’un tout avec elle. S'il en est ainsi, il me semble que Dieu ne peut pas être cause immanente ; si, en effet, Dieu et ce qui est produit par Dieu ne font qu'un seul tout, tu attribues à Dieu plus d'essence à un moment qu'à un autre. Délivre-moi de ce doute, je te prie.
(4) Théophile. – Pour échapper à cet embarras, écoute bien ce que j'ai à te dire. L'essence d'une chose n'est pas augmentée par l'union avec une autre chose qui fait un tout avec elle ; mais, au contraire, elle demeure inaltérable dans cette union même.
(5) Pour me faire mieux comprendre, prenons l'exemple suivant : Un statuaire tire du bois plusieurs figures à l'imitation de la figure humaine, il prend l'une d'elles qui a la forme d'une poitrine humaine, et il la joint à une autre qui a la forme d'une tête humaine, et de ces deux réunies il fait un tout qui représente la partie supérieure du corps humain. Direz-vous que l'essence de cette tête a été augmentée par l’union avec la poitrine ? Nullement, car elle est la même qu'auparavant.
(6) Pour plus de clarté, prenons un autre exemple. J'ai l'idée d'un triangle, et en même temps j'ai une autre idée, celle d'une figure qui provient du prolongement du côté de l'un des trois angles, prolongement donnant naissance à un angle nouveau égal aux deux angles internes opposés. Je dis donc que cette idée (l'idée du triangle) en a produit une nouvelle, à savoir celle de l'égalité des trois angles du triangle à deux angles droits : or, cette nouvelle idée est jointe à la première, de façon qu'elle ne peut ni exister ni être conçue sans celle-ci.
(7) De même de toutes les idées que l'on peut avoir, nous faisons un tout, ou, ce qui est la même chose, un être de raison que nous appelons entendement. Ne voyez-vous pas que quoique cette nouvelle idée soit liée à la précédente, cependant il ne se fera aucun changement dans l'essence de celle-ci, et qu'au contraire elle demeure de même sans aucune altération ? C'est ce qu'il est facile de voir dans toute idée qui produit l'amour : car l'amour n'accroît en rien l'essence de l’idée.
(8) Mais pourquoi chercher tant d’exemples, lorsque toi-même tu le vois clairement dans le sujet dont il s'agit : je te l'ai dit clairement, tous les attributs qui ne dépendent pas d'une cause antérieure, et qui ne se définissent pas à l'aide d'un genre plus élevé, appartiennent à l'essence de Dieu ; et comme les choses créées ne peuvent pas constituer d'attributs, elles n'accroissent pas l'essence de Dieu, quoique liées très-étroitement avec cette essence.
(9) Ajoutez que le tout est un être de raison, et qu'il ne diffère de l'universel que par cette circonstance, à savoir : que l’universel se forme des divers individus non unis du même genre, tandis que le tout se forme des divers individus unis, soit du même genre, soit d'un autre genre.
(10) Érasme. – Quant à ce point, je me reconnais satisfait. Mais, en outre, tu as encore dit que le produit d'une cause immanente ne peut pas périr tant que la cause persiste : ce qui me semble être vrai ; mais alors s'il en est ainsi, comment Dieu peut-il être la cause immanente de toutes choses, puisque tant de choses périssent ? Tu diras sans doute, selon ta distinction précédente, que Dieu n'est proprement la cause que des effets qu'il produit sans autre moyen que ses seuls attributs, et que ceux-là par conséquent, tant que leur cause persiste, ne peuvent pas périr ; mais que tu ne reconnais pas Dieu pour cause immanente des effets dont l'existence ne dépend pas immédiatement de lui, mais qui proviennent d'autres choses quelconques (sauf cependant que ces choses elles-mêmes n’agissent et ne peuvent agir sans Dieu et en dehors de Dieu) : d'où il suit que, n'étant pas produites immédiatement par Dieu, elles peuvent périr.
(11) Cependant cela ne me satisfait pas, car je vois que tu conclus que l'entendement humain est immortel, parce qu'il est un effet que Dieu a produit en lui-même. Maintenant, il est impossible que pour la production d'un tel entendement il ait été besoin d'autre chose que des attributs de Dieu, car une essence d'aussi grande perfection doit précisément, comme toutes les autres choses qui dépendent immédiatement de Dieu, avoir été créée de toute éternité ; et si je ne me trompe pas, je t'ai entendu dire cela à toi-même, et, s'il en est ainsi, comment peux-tu te dégager de toute difficulté ?
(12) Théophile. – Il est vrai, Érasme, que les choses qui n'ont besoin, pour leur propre existence, de rien autre que des attributs de Dieu, ont été créées immédiatement par lui de toute éternité ; mais il importe de remarquer que, quoiqu’il puisse être nécessaire qu’une modification particulière (et par conséquent quelque chose d'autre que les attributs de Dieu) soit exigée pour l'existence d'une chose, cependant Dieu ne cesse pas pour cela de pouvoir produire immédiatement une telle chose. Car, entre les conditions diverses qui sont exigées pour faire qu'une chose soit, les unes sont nécessaires pour produire la chose elle-même, les autres pour qu'elle soit possible. Je veux, par exemple, avoir de la lumière dans une certaine chambre ; j’allume cette lumière, et aussitôt cette lumière par elle-même éclaire la chambre ; j'ouvre une fenêtre, ce qui par soi-même ne fait pas la lumière ; mais cela fait que la lumière puisse pénétrer dans la chambre. C'est ainsi encore que, pour le mouvement d'un corps, un autre corps est nécessaire, lequel doit avoir tout le mouvement qui doit passer dans le premier. Mais, pour produire en nous une idée de Dieu, il n'est pas besoin d'aucune chose singulière qui ait déjà en elle ce qui se produit en nous ; il est seulement besoin d'un corps, dont l’idée est nécessaire pour nous montrer Dieu immédiatement : ce que tu aurais pu conclure immédiatement de mes paroles, lorsque j'ai dit que Dieu est connu par lui-même et non par aucune autre chose.
(13) Cependant, je te le dis, aussi longtemps que nous n'avons pas de Dieu une idée claire, qui nous unisse à lui de manière à nous rendre impossible d'aimer rien en dehors de lui, nous ne pouvons pas dire que nous soyons en réalité unis à Dieu et que nous dépendions immédiatement de lui. Si tu as encore quelque chose à me demander, ce sera pour un autre temps ; quant à présent, je suis appelé pour d'autres affaires. Adieu.
(14) Érasme. – Je n'ai rien de plus à te dire pour le présent : je réfléchirai à ce que tu viens de me dire jusqu'à une autre occasion, et je te recommande à Dieu."
A ce point s'est insérée l'influence de Descartes sur Spinoza. Il le connut d'abord, en 1651, comme physicien et philosophe de la nature. Mais dès le Court Traité (I, 7) il cite les Réponses de Descartes aux Cinquièmes Ohjections pour établir que Dieu ne peut être connu par nous d'une connaissance adéquate, et il joint à son traité un appendice conçu selon la méthode géométrique dont Descartes a fait parfois usage, et dont, quelques années plus tard (1663), dans la préface aux "Principes de philosophie de René Descartes" démontrés par Spinoza «more geometrico ››, son ami Louis Meyer (1630-1681), - médecin hollandais éditeur des Principia philosophiae cartesianae et à qui sera adressé ce grand texte philosophique qu’est la Lettre XII sur l’infini (cf.infra) -, vantera les avantages pour la recherche et l'enseignement méthodiques de la vérité, ainsi que la démontré Descartes par une méthode nouvelle qui lui a permis de poser les fondements inébranlables de la philosophie.
Il ne semble pas, au demeurant, que l'influence de Descartes sur Spinoza ait été déterminante comme elle le fut pour Malebranche. Car, lorsqu'il lut Descartes ou qu'il prit connaissance des principes de la philosophie cartésienne, Spinoza était déjà en possession des idées maîtresses et de 'inspiration même de sa doctrine. Cependant, Descartes lui permit de la formuler avec plus de précision, en lui fournissant, avec une méthode appropriée, les cadres extérieurs en même temps que les articulations internes de sa pensée, et, plus précisément encore, le premier chaînon auquel il attachera tous les autres, par un déroulement, d'ailleurs, qui lui est propre et qui, contrairement à Descartes, ne fait appel à rien d'autre. De Descartes il retient d'abord ce principe que les idées claires et distinctes sont toutes vraies, ou, en d'autres termes, que, pour avoir la connaissance certaine de la vérité, nous n'avons besoin d'aucun autre signe que l'idée vraie, c'est-à-dire adéquate, la certitude n'étant rien d'autre que « l'essence objective de la chose ››, c'est-à-dire la chose en tant qu'elle est représentée dans l'entendement sans plus : pour savoir, il n'est pas nécessaire que je sache que je sais. En ce sens, il faut dire que le vrai est à lui-même sa propre marque : « est enim verum index sui et falsi ›› (Ep. 76). De là procède la méthode, qui n'est autre chose que l'idée de l'idée, ou la connaissance réflexive de l'idée, d'abord donnée. Ainsi (Ep. 37), nous formons des perceptions claires et distinctes par la seule puissance absolue de notre nature et de ses lois fixes et certaines, sans nul appel à des causes étrangères telles que la fortune ou le hasard nous en pourrait fournir. La véritable méthode consiste donc essentiellement dans la seule connaissance de l'intellect pur, de sa nature et de ses lois : pour l'acquérir, il est nécessaire, avant toutes choses, de distinguer l'intellect de l'imagination, et les idées vraies de toutes celles qui ne le sont pas, idées fictives, ou fausses, ou dubitatives et indéterminées; et il est suffisant d'en connaître le caractère intrinsèque et l'enchaînement nécessaire, sans qu'il soit besoin de connaître la nature de l'esprit par sa première cause ou de rapporter l'idée à quelque réalité extérieure comme à sa source.
Ceci étant posé, il suit que la méthode la plus parfaite sera la connaissance réflexive de l'idée la plus haute, à savoir de l'Être absolument parfait, et que notre esprit devra produire et tenir toutes ses idées de cette norme suprême, qui est l'origine et la source de toute la nature, comme elle est la source première de toutes nos idées, puisque notre esprit, en tant qu'il perçoit les choses vraiment, est une partie de l'entendement infini de Dieu; et, par conséquent, il est aussi nécessaire que les idées claires et distinctes de l'esprit soient vraies que le sont les idées de Dieu.
Or, cet infléchissement de la méthode cartésienne, ou, si l'on veut, cet usage purement immanent de la méthode sous l'influence des idées qu'il tenait de sa formation première, conduit immédiatement Spinoza à l'affirmation d'où découle tout son système : à savoir que l'Être parfait, Dieu, est le seul être de qui tout dépend, ou, pour parler le langage de Descartes en répudiant sa doctrine, que Dieu est la seule substance, - l'être de la substance enveloppant l'existence nécessaire (Eth. I, 7. II, 10), - bref, qu'il est la Substance unique dont toutes les choses singulières dépendent nécessairement pour leur essence intime, selon des lois fixes et éternelles, en sorte que les connaître vraiment c'est les connaître sans référence à la durée ni au nombre, sous une certaine forme d'éternité, sub quadam specie aeternitatis. Spinoza dira plus tard, en usant de la terminologie cartésienne, que les choses singulières, dans leur essence, sont des modes de Dieu, en ce sens que le corps et l'idée du corps, ou l'åme, sont les modes des deux attributs, Étendue et Pensée, de la Substance infinie : ce qui lui permet de résoudre le problème cartésien de l'union de l'âme et du corps, conçus dans son système comme deux substances distinctes, autrement que ne l'a fait Descartes "par le recours à la cause de l'univers entier, Dieu" (Eth. V), et autrement aussi que ne le fera Leibniz par le système de l'harmonie préétablie, ou Malebranche par le système de l'occasionalisme se référant à la cause unique, Dieu.
Pour Spinoza, Dieu n'est pas seulement l'Être qui fait tout, il est l'Être qui est tout. Il n'est pas seulement la Cause unique à laquelle se rattache tout le mécanisme de l'univers, mais il est la Substance unique de qui tout découle par voie d'identité géométrique : et, de ces deux points encore, - le mécanisme, la méthode géométrique - Spinoza trouvait le modèle chez Descartes, dans les "Principes de philosophie" et dans l'appendice des "Réponses aux secondes objections", où les raisons qui prouvent l'existence de Dieu et la distinction entre l'esprit et le corps humain sont disposées d'une façon géométrique, comme avait déjà fait au XIIe siècle Nicolas d'Amiens en son "De arte catholicae fidei", et comme l'incitait à le faire Thomas Hobbes, dont le "De cive" (lu dans l'édition de 1647), exerça une influence certaine sur les conceptions méthodologiques, aussi bien que politiques et religieuses, de Spinoza. C'est cette voie que Spinoza suit avec une rigueur analytique extrême, qui se fie, ou prétend se fier, aux seules ressources de la raison, procédant de la cause aux effets, lesquels en découlent nécessairement, sans qu'il soit besoin de faire jamais appel à l'expérience : car l'expérience, écrit-il à de Vries en 1663 (Ep. 10), n'est nécessaire que pour connaître ce qui ne peut être conclu de la seule définition de la chose, par exemple l'existence des modes ne nous apprend rien de l'essence des choses, et c'est pourquoi, lorsque l'existence ne diffère pas de l'essence, l'expérience n'est pas requise. Or, il en va de la vertu comme de la raison : car ce qui convient à la raison convient aussi à la vertu (Ep. 68). Nous atteignons donc la béatitude avec la vérité par les seules forces de la raison, sans le secours de l'expérience ni de rien d'autre.
Voilà comment un certain usage de la méthode et des principes cartésiens, commandé par ses présupposés antérieurs, conduit Spinoza, en fin de compte, à des conclusions qui tournent le dos aux conclusions de Descartes. Pour Descartes, le fondement ultime de tout est la volonté, à la fois et mystérieusement toute-puissante et immuable, de Dieu, laquelle n'est autre chose, à notre égard que la création, source de toute contingence dans l'univers. "Creatio, solum voluntas Dei", dit Descartes. A quoi s'opposent les affirmations catégoriques de Spinoza : "Ex necessitate divinae naturae infinita infinitis modis (hoc est omnia, quae sub intellectum infinitum cadere possunt) sequi debent" (Eth. I, 16)...

Ses études, cependant, avaient détaché Spinoza de la foi juive (cf. les chapitres VIII, IX et X du Traité théologico-politique). Il se pose alors, et résout autrement que ses coreligionnaires, le double problème de l'accord de la Bible avec elle-même, - l'authenticité mosaïque du Pentateuque, qu'il conteste, l'interprétation littérale de l'Ecriture par elle-même, qu'il préconise, - et de l'accord de la Bible avec la raison, - concordisme et anthropomorphisme qu'il répudie, en affirmant néanmoins que l'obéissance et la foi, tout incompatibles qu'elles sont avec la philosophie, suffisent au salut. Il abandonne la pratique juive, et se rapproche des sectes protestantes, Collégiants et Mennonites, Quakers et Sociniens antitrinitaires, disciples des Frères polonais, qui réduisent au minimum dogmes et rites, et font consister la religion dans le pur amour intérieur de Dieu et les actions qui s'y conforment, en dehors de toute révélation, des miracles, de l'autorité extérieure. Les disciples de Menno Simonis (1496-1561), à l'instar des anabaptistes, prétendaient revenir à la simplicité apostolique, rejetaient le baptême des enfants, prêchaient l'abstention de toute violence, l'interdiction de participer à la guerre, aux fonctions publiques, de prêter serment, et réduisaient la foi au salut par le Christ; la secte des Collégiants, fondée par les frères van den Kodde en 1619, et à laquelle appartenaient quelques-uns des meilleurs amis de Spinoza, Simon de Vries et Jarigh Jelles, professait que l'Esprit-Saint révèle à tout homme pieux le sens de la Bible et les choses nécessaires au salut, et elle admettait dans son sein les adeptes de toutes les communautés religieuses. Par ses amis, Spinoza fut conduit à la lecture attentive du Nouveau Testament et à l'idée d'un rôle éminent du Christ dans la révélation religieuse, comme voie du salut pour les hommes, auxquels il a transmis par des voies appropriées une sagesse plus qu'humaine.
Le "Court Traité", sa première œuvre, d'abord rédigé en latin pour le petit groupe de ses amis, fut ensuite traduit en langue néerlandaise, selon les termes mêmes de la brève introduction, « à l'usage des amis de la vérité et de la vertu, et pour guérir ceux qui sont malades de l'entendement, par l'esprit de douceur et de patience selon l'exemple du Seigneur Jésus, notre maître le meilleur". Tout le traité se signale par un ton chrétien, ainsi qu'en témoigne ce que dit Spinoza du Dieu sage et bon, auteur de tant d'œuvres sagement ordonnées (II, 24), du Fils de Dieu, de la prédestination, de la régénération et du péché, des vertus de renoncement, d'humilité. Ses positions seront tout autres dans l'Ethique. Mais, après même qu'il aura répudié l'humilité, le renoncement et la pitié (III), après qu'il aura rejeté le miracle comme fondement de l'existence de Dieu et de la religion, car c'est, selon lui, expliquer l'obscur par le plus obscur (Ep. 75), - et conclu que la résurrection du Christ ne saurait être conçue que comme une résurrection spirituelle valable pour les seuls fidèles, il écrira encore à Oldenburg en novembre 1675 (Ep. 73): « Je ne crois pas du tout nécessaire pour le salut de connaître Jésus-Christ selon la chair. Mais il faut penser tout autrement du Fils de Dieu, c'est-à-dire de la Sagesse éternelle de Dieu qui s'est manifestée en toutes choses, et principalement dans l'âme humaine, et, plus que nulle part ailleurs, en Jésus-Christ. Nul, en effet, ne peut sans cette sagesse parvenir à l'état de béatitude, puisque seule elle enseigne ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal. Et puisque cette sagesse s'est manifestée au plus haut point chez Jésus-Christ, ses disciples l'ont prêchée dans la mesure où elle leur a été révélée par lui, et ils ont montré qu'ils pouvaient se glorifier plus que les autres de posséder cet esprit du Christ." Et, bien que "prétendre que Dieu a assumé une nature humaine" lui paraisse "aussi absurde que si l'on disait qu'un cercle a revêtu la forme d'un carré" (Ep. 73), cependant il est très certain que le Christ pouvait dire qu'il est le Temple de Dieu, en ce sens que Dieu s'est manifesté au plus haut point chez lui : ce que Jean, "hébraïsant" quoiqu'il écrive en grec, a exprimé en disant que le Verbe s'est fait chair. Dans sa réponse à Albert Burgh (Ep. 76), où il déclare que la sainteté de vie n'est pas le privilège exclusif de l'Église romaine, Spinoza ajoute : « Le signe unique et le plus certain de la vraie foi catholique, c'est, comme je le dis avec Jean, la justice et la charité : où nous les trouvons, le Christ et réellement; où ils manquent, le Christ est absent. Car nous ne pouvons être conduits à l'amour de la justice et de la charité que par l'Esprit du Christ. »
Cependant, les relations de Spinoza avec les chrétiens, son abandon des pratiques religieuses, le rendaient suspect à ses coreligionnaires. S'il faut en croire Colerus, il commit certaines imprudences qui achevèrent de le discréditer auprès d'eux. Comme il s'était ouvert à deux jeunes hommes qui se disaient ses amis, sur ses véritables sentiments touchant l'interprétation de la Bible, la nature corporelle de Dieu (à ce qu'ils comprirent), l'âme comme principe vivant dont il serait vain de chercher à prouver l'immortalité, ces amis indiscrets, mécontents de ce qu'il avait rompu avec eux, répandirent le bruit qu'il était un ennemi de la synagogue, qu'il méprisait Moïse, qu'il était coupable d'horribles hérésies (horrendas herejas y enormes obras) et professait l'impiété des esprits forts, suspectés de vouloir substituer au culte traditionnel une religion nouvelle en accord avec la science, et de mettre en danger la société même. Ses coreligionnaires, son maître Morteira lui-même, incapables de l'ébranler, usèrent successivement, à son égard, de promesses, de menaces, et enfin de persécutions, pour le mettre hors d'état de nuire à leur cause par son infidélité apparente...
Après avoir comparu devant le collège des rabbins, les "Senhores de Mahamed", Spinoza fut frappé de la peine d'excommunication majeure (schammata) par la synagogue d'Amsterdam, le 27 juillet 1656, avec interdiction à tous de le fréquenter. Il écrivit alors, dans sa langue maternelle, une «Apologia para justificarse de su abdicación de la sinagoga», qui n'a pas été retrouvée, mais dont il est permis de penser, avec Bayle, que le Traité théologien-politique est la reprise et le développement, ainsi qu'on peut l'inférer d'une allusion qu'y fait Spinoza à sa formation religieuse première, proposée en défense des idées hardies qu'il expose sur l'Ecriture. Mais son appel ne parvint pas à fléchir ses juges. Banni d'Amsterdam, il y revint pourtant après quelques mois et se mit en devoir de rédiger ses pensées....

C'est entre 1657 et 1663 que Spinoza élabora son système. Dénué, moins cependant qu'on ne l'a dit, de ressources matérielles, il résolut, pour pourvoir à sa subsistance et vivre d'une vie tranquille et retirée, ainsi que le recommande le Talmud, mais plus encore, ce semble, pour s'initier à la technique de la science, marque de son appartenance aux doctes, d'exercer un métier où il pût utiliser ses connaissances mathématiques; il devint très habile dans l'art de tailler et polir les verres de lunettes, à quoi Descartes et Huyghens attachaient une si grande importance; il apprit aussi le dessin, ce qui lui permit de faire le portrait de personnes de qualité. Recherchant par dessus tout le calme et la solitude afin de se livrer à la pensée, il décida enfin de quitter Amsterdam, où il n'était plus en sûreté, où un fanatique avait même tenté de le poignarder au sortir de la synagogue portugaise, et, après un court séjour à Ouverkerke, où résidaient les familles mennonites des Albertsz et des Persyn, et que fréquentait Rembrandt, il se retira en 1660 à Rhynsburg près de Leyde et y demeura jusqu'en avril 1663. C'est pendant ce séjour à Rbynsburg qu'il composa ou mit au point ses premiers écrits, destinés au petit groupe de disciples et d'amis qui cherchaient auprès de lui une direction non seulement intellectuelle mais spirituelle, tandis que ceux qu'il avait laissés à Amsterdam, et qui formaient une sorte de collège dont l'âme était Simon Joosten de Vries, recevaient ses travaux, les commentaient et les expliquaient, en demandant des explications au maître....
1661, à Oldenburg - "Vous me demandez ensuite quelles erreurs j’observe dans la Philosophie de Descartes et dans celle de Bacon. Bien que je n’aie pas accoutumé de signaler les erreurs commises par d’autres, - je me prêterai à votre désir. Leur première et plus grande erreur consiste en ce qu’ils sont tellement éloignés de connaître la première cause et l’origine de toutes choses. La deuxième en ce qu’ils ne connaissent pas la véritable nature de l’âme humaine. La troisième, en ce qu’ils n’ont jamais saisi la vraie cause de l’erreur. Que d’ailleurs ces trois connaissances qui leur font défaut, soient nécessaires au plus haut point, seuls des hommes privés de toute culture et de tout savoir peuvent l’ignorer. Il suffit, ajouté-je, d’avoir égard aux propositions énoncées ci-dessus pour voir combien ces auteurs sont éloignés de connaître la première cause et l’âme humaine ; je passe donc tout de suite à la troisième erreur..."
Dès le début de 1661, ainsi qu'en fait foi cette lettre à Oldenburg (Ep. 2), où il dénonce les erreurs de Descartes et de Bacon sur la Cause première et l'origine de toutes choses, la vraie nature de l'esprit humain et la vraie cause de 'erreur, il entreprit d'exposer ses idées sur l'Être absolument parfait et infini, Dieu, sur les choses éternelles et le vrai bien, dont la connaissance est seule capable d'assurer à l'âme la joie suprême et continuelle, et cela, selon la méthode la plus claire et la plus brève, celle des géomètres, dont peu après, dans le "Traité de la réforme de l'entendement", "De intellectus emendatione", il s'attachera à définir la fin, l'objet, les règles et les principes. Après avoir donné, « more scolastico rabbinicoque ››, une première et très significative ébauche de sa doctrine dans le Court Traité de Dieu, de l'homme et de la béatitude, destiné au petit cercle de ses amis, le premier en date de ses écrits, dont une partie au moins (les dialogues) paraît antérieure à son départ d'Amsterdam; après avoir donné un exposé géométrique des "Principes de la philosophie de Descartes", suivi de "Pensées métaphysiques" (Cogitata metaphysica), qui fut publié en 1663, il se mit à l'exposé géométrique d'où devait sortir l' "Éthique" et rédigea entièrement le premier livre, "De Deo". Spinoza regardait l'ordre synthétique comme l'ordre juste et nécessaire, sinon pour la découverte, du moins pour l'expression de la pensée une fois arrivée à la pleine maîtrise, et comme le type même de cette "connaissance réflexive" qui, étant "l'idée de l'idée", doit nécessairement calquer son enchaînement sur celui de la Nature, telle qu'il la concevait. Si cet ordre géométrique pouvait paraître ardu, il s'en expliquait en disant, comme il l'observe à la fin de l'Éthique : "« Et sane arduum debet esse, quod adeo raro reperitur", c'est-à-dire, la voie du salut qui doit nous mener à la vraie félicité, par l'effort et le sacrifice, doit être certes une voie ardue, puisqu'elle est si rarement trouvée. Mais tout ce qui est excellent est aussi difficile que rare...

1662 - "Traité pour la réforme de l'entendement"
Au moment de sa mort, Spinoza travaillait à une traduction hollandaise de l'Ancien Testament, à une Grammaire de l'hébreu, à un Traité politique, à un écrit sur la Réforme de l'Entendement; il songeait à un ouvrage sur le mouvement qui devait contenir une réfutation de la physique cartésienne. "Je passe à ta question, à savoir celle-ci, s'il y a ou s'il peut y avoir une méthode telle qu'avec son aide on puisse, sans trébucher, avancer sans fatigue dans la connaissance des choses les plus hautes ? Ou bien, de même que nos corps, nos esprits sont-ils soumis à des défaillances, et nos pensées régies par le hasard plus que par l'art ? Je pense que j'aurai répondu à ces questions si je montre qu'il doit nécessairement y avoir une méthode par laquelle nous pouvons diriger et lier nos perceptions claires et distinctes, et que l'entendement n'est pas, comme le corps, soumis à des défaillances". Le Tractatus se présente donc comme un traité de la méthode et une médecine spirituelle. Dans une première partie, il dissocie les idées vraies des autres, en débutant par sorte de confession dans laquelle il explique que ce que les hommes regardent généralement comme le bien suprême, représente, à ses yeux, des biens faux et périssables et que c'est la possession de la connaissance parfaite qui constitue la béatitude suprême. Il établit ensuite quelques règles de vie, expose les quatre modes de connaissances qui conditionnent la méthode dont seul le quatrième mode saisit l'essence adéquate de la chose, et ce sans danger d'erreur. La seule méthode possible d'accès au vrai est celle qui ne s'apprend que par son exercice, elle est l'acte d'acquisition de l'idée vraie qui s'impose d'elle-même sans le moindre doute. Dans une seconde partie, inachevée, devait être déterminée la nature et les forces de l'entendement, en commençant par définir l'être incréé...
"I. Le bien que les hommes désirent ordinairement
1. L'expérience m'ayant appris à reconnaître que tous les événements ordinaires de la vie commune sont choses vaines et futiles, et que tous les objets de nos craintes n'ont rien en soi de bon ni de mauvais et ne prennent ce caractère qu'autant que l'âme en est touchée, j'ai pris enfin la résolution de rechercher s'il existe un bien véritable et capable de se communiquer aux hommes, un bien qui puisse remplir seul l'âme tout entière, après qu'elle a rejeté tous les autres biens, en un mot, un bien qui donne à l'âme, quand elle le trouve et le possède, l'éternel et suprême bonheur.
2. Je dis que j'ai pris enfin cette résolution, parce qu'il me semblait au premier aspect qu'il y avait de l'imprudence à renoncer à des choses certaines pour un objet encore incertain. Je considérais en effet les avantages qu'on se procure par la réputation et par les richesses, et il fallait y renoncer, si je voulais m'occuper sérieusement d'une autre recherche. Or, supposé que la félicité suprême consiste par hasard dans la possession de ces avantages, je la voyais s'éloigner nécessairement de moi ; et si au contraire elle consiste en d'autres objets et que je la cherche où elle n'est pas, voilà qu'elle m'échappe encore.
3. Je méditais donc en moi-même sur cette question : est-il possible que je parvienne à diriger ma vie suivant une nouvelle règle, ou du moins à m'assurer qu'il en existe une, sans rien changer toutefois à l'ordre actuel de ma conduite, ni m'écarter des habitudes communes ? chose que j'ai souvent essayée, mais toujours vainement. Les objets en effet qui se présentent le plus fréquemment dans la vie, et où les hommes, à en juger par leurs œuvres, placent le souverain bonheur, se peuvent réduire à trois, les richesses, la réputation, la volupté. Or, l'âme est si fortement occupée tour à tour de ces trois objets qu'elle est à peine capable de songer à un autre bien.
4. La volupté surtout enchaîne l'âme avec tant de puissance qu'elle s'y repose comme en un bien véritable, et c'est ce qui contribue le plus à éloigner d'elle toute autre pensée ; mais après la jouissance vient la tristesse, et si l'âme n'en est pas possédée tout entière, elle en est du moins troublée et comme émoussée. Les honneurs et les richesses n'occupent pas non plus faiblement une âme, surtout quand on recherche toutes ces choses pour elles-mêmes[2], en s'imaginant qu'elles sont le souverain bien.
5. La réputation occupe l'âme avec plus de force encore ; car l'âme la considère toujours comme étant par soi-même un bien, et en fait l'objet suprême où tendent tous ses désirs. Ajoutez que le repentir n'accompagne point la réputation et les richesses, comme il fait la volupté ; plus au contraire on possède ces avantages, et plus on éprouve de joie, plus par conséquent on est poussé à les accroître ; que si nos espérances à cet égard viennent à être trompées, nous voilà au comble de la tristesse. Enfin, la recherche de la réputation est pour nous une forte entrave, parce qu'il faut nécessairement, pour l'atteindre, diriger sa vie au gré des hommes, éviter ce que le vulgaire évite et courir après ce qu'il recherche.
6. C'est ainsi qu'ayant considéré tous les obstacles qui m'empêchaient de suivre une règle de conduite différente de la règle ordinaire, et voyant l'opposition si grande entre l'une et l'autre qu'il fallait nécessairement choisir, je me voyais contraint de rechercher laquelle des deux devait m'être plus utile, et il me semblait, comme je disais tout à l'heure, que j'allais abandonner le certain pour l'incertain. Mais quand j'eus un peu médité là-dessus, je trouvai premièrement qu'en abandonnant les avantages ordinaires de la vie pour m'attacher à d'autres objets, je ne renoncerais véritablement qu'à un bien incertain, comme on le peut clairement inférer de ce qui précède, pour chercher un bien également incertain, lui, non par sa nature (puisque je cherchais un bien solide), mais quant à la possibilité de l'atteindre.
7. Et bientôt une méditation attentive me conduisit jusqu'à reconnaître que je quittais, à considérer le fond des choses, des maux certains pour un bien certain. Je me voyais en effet jeté en un très-grand danger, qui me faisait une loi de chercher de toutes mes forces un remède, même incertain ; à peu près comme un malade, attaqué d'une maladie mortelle, qui prévoyant une mort certaine s'il ne trouve pas un remède, rassemble toutes ses forces pour chercher ce remède sauveur, quoique incertain s'il parviendra à le découvrir ; et il fait cela, parce qu'en ce remède est placée toute son espérance. Et véritablement, tous les objets que poursuit le vulgaire non-seulement ne fournissent aucun remède capable de contribuer à la conservation de notre être, mais ils y font obstacle ; car ce sont ces objets mêmes qui causent plus d'une fois la mort des hommes qui les possèdent et toujours celle des hommes qui en sont possédés.
8. N'y a-t-il pas plusieurs exemples d'hommes qui à cause de leurs richesses ont souffert la persécution et la mort même, ou qui se sont exposés pour amasser des trésors à tant de dangers qu'ils ont fini par payer de leur vie leur folle avarice ! Et combien d'autres qui ont souffert mille maux pour faire leur réputation ou pour la défendre ! Combien enfin, par un excessif amour de la volupté, ont hâté leur mort !
9. Or voici quelle me paraissait être la cause de tout le mal : c'est que notre bonheur et notre malheur dépendent uniquement de la nature de l'objet que nous aimons ; car les choses qui ne nous inspirent point d'amour n'excitent ni discordes ni douleur quand elles nous échappent, ni jalousie quand elles sont au pouvoir d'autrui, ni crainte, ni haine, en un mot, aucune passion ; au lieu que tous ces maux sont la suite inévitable de notre attachement aux choses périssables, comme sont celles dont nous avons parlé tout à l'heure.
10. Au contraire, l'amour qui a pour objet quelque chose d'éternel et d'infini nourrit notre âme d'une joie pure et sans aucun mélange de tristesse, et c'est vers ce bien si digne d'envie que doivent tendre tous nos efforts. Mais ce n'est pas sans raison que je me suis servi de ces paroles : à considérer les choses sérieusement ; car bien que j'eusse une idée claire de tout ce que je viens de dire, je ne pouvais cependant bannir complètement de mon cœur l'amour de l'or, des plaisirs et de la gloire.
II. Le bien véritable et suprême
11. Seulement je voyais que mon esprit, en se tournant vers ces pensées, se détournait des passions et méditait sérieusement une règle nouvelle ; et ce fut pour moi une grande consolation ; car je compris ainsi que ces maux n'étaient pas de ceux qu'aucun remède ne peut guérir. Et bien que, dans le commencement, ces moments fussent rares et de courte durée, cependant, à mesure que la nature du vrai bien me fut mieux connue, ils devinrent et plus longs et plus fréquents, surtout lorsque je vis que la richesse, la volupté, la gloire, ne sont funestes qu'autant qu'on les recherche pour elles-mêmes, et non comme de simples moyens ; au lieu que si on les recherche comme de simples moyens, elles sont capables de mesure, et ne causent plus aucun dommage ; loin de là, elles sont d'un grand secours pour atteindre le but que l'on se propose, ainsi que nous le montrerons ailleurs.
12. Ici je veux seulement dire en peu de mots ce que j'entends par le vrai bien, et quel est le souverain bien. Or, pour s'en former une juste idée, il faut remarquer que le bien et le mal ne se disent que d'une façon relative, en sorte qu'un seul et même objet peut être appelé bon ou mauvais, selon qu'on le considère sous tel ou tel rapport ; et de même pour la perfection et l'imperfection. Nulle chose, considérée en elle-même, ne peut être dite parfaite ou imparfaite, et c'est ce que nous comprendrons surtout quand nous saurons que tout ce qui arrive, arrive selon l'ordre éternel et les lois fixes de la nature.
13. Mais l'humaine faiblesse ne saurait atteindre par la pensée à cet ordre éternel ; l'homme conçoit une nature humaine de beaucoup supérieure à la sienne, où rien, à ce qu'il lui semble, ne l'empêche de s'élever ; il recherche tous les moyens qui peuvent le conduire à cette perfection nouvelle ; tout ce qui lui semble un moyen d'y parvenir, il l'appelle le vrai bien ; et ce qui serait le souverain bien, ce serait d'entrer en possession, avec d'autres êtres, s'il était possible, de cette nature supérieure. Or, quelle est cette nature? nous montrerons, quand il en sera temps, que ce qui la constitue, c'est la connaissance de l'union de l'âme humaine avec la nature tout entière.
14. Voilà donc la fin à laquelle je dois tendre : acquérir cette nature humaine supérieure, et faire tous mes efforts pour que beaucoup d'autres l'acquièrent avec moi ; en d'autres termes, il importe à mon bonheur que beaucoup d'autres s'élèvent aux mêmes pensées que moi, afin que leur entendement et leurs désirs soient en accord avec les miens ; pour cela[4], il suffit de deux choses, d'abord de comprendre la nature universelle autant qu'il est nécessaire pour acquérir cette nature humaine supérieure ; ensuite d'établir une société telle que le plus grand nombre puisse parvenir facilement et sûrement à ce degré de perfection.
15. On devra veiller avec soin aux doctrines morales ainsi qu'à l'éducation des enfants ; et comme la médecine n'est pas un moyen de peu d'importance pour atteindre la fin que nous nous proposons, il faudra mettre l'ordre et l'harmonie dans toutes les parties de la médecine ; et comme l'art rend faciles bien des choses difficiles et nous profite en épargnant notre temps et notre peine, on se gardera de négliger la mécanique.
16. Mais, avant tout, il faut chercher le moyen de guérir l'entendement, de le corriger autant qu'il est possible dès le principe, afin que, prémuni contre l'erreur, il ait de toute chose une parfaite intelligence. On peut déjà voir par là que je veux ramener toutes les sciences à une seule fin, qui est de nous conduire à cette souveraine perfection de la nature humaine dont nous avons parlé ; en sorte que tout ce qui, dans les sciences, n'est pas capable de nous faire avancer vers notre fin doit être rejeté comme inutile ; c'est-à-dire, d'un seul mot, que toutes nos actions, toutes nos pensées doivent être dirigées vers cette fin.
III. Règles de vie
17. Mais, tandis que nous nous efforçons d'y atteindre et de mettre l'intelligence dans la bonne voie, il nous faut vivre cependant ; et c'est pourquoi nous devons convenir de certaines règles de conduite que nous supposerons bonnes, savoir, les suivantes :
I. Mettre ses paroles à la portée du vulgaire et consentir à faire avec lui tout ce qui n'est pas un obstacle à notre but. Car nous avons de grands avantages à retirer du commerce des hommes, si nous nous proportionnons à eux, autant qu'il est possible, et nous préparons ainsi à la vérité des oreilles bienveillantes.
II. Ne prendre d'autres plaisirs que ce qu'il en faut pour conserver la santé.
III. Ne rechercher l'argent et toute autre chose qu'autant qu'il est nécessaire pour entretenir la vie et la santé, et pour nous conformer aux mœurs de nos concitoyens en tout ce qui ne répugne pas à notre objet.
IV. Les différents modes de perception
18. Ces règles posées, je commence par ce qui doit être fait avant tout le reste, et j'essaye de réformer l'entendement, et de le disposer à concevoir les choses de la manière dont elles doivent être conçues pour qu'il nous soit possible d'atteindre notre fin. Or, pour cela, l'ordre naturel exige que je résume les différents modes de perception sur la foi desquels jusqu'ici j'ai affirmé et nié sans crainte de me tromper, afin de choisir le meilleur et tout ensemble de commencer à connaître et mes forces et cette nature que je me propose de perfectionner.
19. A y regarder de près, tous nos modes de perception peuvent se ramener à quatre :
I. Il y a une perception que nous acquérons par ouï-dire, ou au moyen de quelque signe que chacun appelle comme il lui plaît.
II. Il y a une perception que nous acquérons à l'aide d'une certaine expérience vague, c'est-à-dire d'une expérience qui n'est point déterminée par l'entendement, et qu'on n'appelle de ce nom que parce qu'on a éprouvé que tel fait se passe d'ordinaire ainsi, que nous n'avons à lui opposer aucun fait contradictoire, et qu'il demeure, pour cette raison, solidement établi dans notre esprit.
III. Il y a une perception dans laquelle nous concluons une chose d'une autre chose, mais non d'une manière adéquate. C'est ce qui arrive[6] lorsque nous recueillons une cause dans un certain effet, ou bien lorsque nous tirons une conclusion de quelque fait général constamment accompagné d'une certaine propriété.
IV. Enfin il y a une perception qui nous fait saisir la chose par la seule vertu de son essence, ou bien par la connaissance que nous avons de sa cause immédiate..."

1663 - "Principes de la philosophie de Descartes", suivis des "Pensées métaphysiques"
Ecrit de circonstance, composé en quinze jours pour l'éducation d'un jeune homme (les deux premières parties des Principes de Descartes démontrées géométriquement) paru en 1663, par les soins de Louis Meyer, qui fit à Spinoza une solide réputation dans le monde des philosophes, et lui valut en 1673 l'offre d'une chaire à l'Université de Heidelberg, qu'il déclina pour ne pas compromettre la tranquillité de sa vie et le progrès de sa méditation solitaire.
"Par quels modes de penser nous retenons les choses.
Que, d'ailleurs, il existe certains modes de penser nous servant à retenir les choses plus fermement et facilement et à nous les rappeler à l'esprit, quand nous voulons, ou à les maintenir dans l'esprit, c'est ce qui est assez certain pour ceux qui usent de cette règle bien connue de la Mémoire : pour retenir une choses tout à fait nouvelle et l'imprimer dans la mémoire, nous avons recours à une autre chose qui nous est familière et qui s'accorde avec la première soit seulement par le nom, soit en réalité. C'est de semblable façon que les Philosophes ont ramené toutes les choses naturelles à de certaines classes auxquelles ils ont recours quand quelque chose de nouveau s'offre à eux et qu'ils appellent genre, espèce, etc.
Par quels modes de penser nous expliquons les choses.
Pour expliquer une chose, nous avons aussi des mode de penser ; nous la déterminons par comparaison avec une autre. Les modes de penser dont nous usons à cet effet s'appellent temps, nombre, mesure, et peut-être y en a-t-il d'autres.
De ceux que j'indique l'un, le temps, sert à l'explication de la durée ; le nombre, à celle de la quantité discrète ; la mesure, à celle de la quantité continue.
Par quels modes de penser nous imaginons les choses.
Comme enfin nous avons accoutumé, toutes les fois que nous connaissons une chose, de la figurer aussi par quelque image dans notre imagination, il arrive que nous imaginons positivement, comme des êtres, des non-êtres. L'âme humaine, en effet, considérée en elle seule, en tant que chose pensante, n'a pas un pouvoir plus grand d'affirmer que de nier ; mais comme imaginer n'est rien d'autre que sentir les traces laissées dans le cerveau par le mouvement des esprits, excité lui-même dans les sens par les objets, une telle sensation ne peut être qu'une affirmation confuse. Et ainsi advient-il que nous imaginons comme des êtres tous ces modes dont l'esprit use pour nier, tels par exemple que la cécité, l'extrémité ou la fin, le terme, les ténèbres etc.
Pourquoi les Êtres de Raison ne sont pas des Idées de choses et sont cependant tenues pour telles.
Il est clair par ce qui précède que ces modes de penser ne sont pas des idées de choses et ne peuvent être du tout rangés parmi les idées ; aussi n'ont-ils aucun objet qui existe nécessairement ou puisse exister. Mais la cause qui fait que ces modes de penser sont pris pour des idées de choses est qu'ils proviennent et naissent des idées de choses assez immédiatement pour être très aisément confondus avec elles à moins de l'attention la plus diligente ; c'est pourquoi on leur a appliqué des noms comme pour désigner des êtres situés en dehors de notre esprit et on a appelé ces Êtres ou plutôt ces Non-Êtres, Êtres de Raison.
Fausseté de la division de l'Être en Être réel et Être de Raison.
Il est facile de voir par ce qui précède combien déraisonnable est cette division par où l'Être est divisé entre Être réel et Être de Raison : on divise ainsi l'Être en Être et non-Être ou en Être et mode de Penser. Je ne m'étonne pas cependant que les Philosophes attachés aux mots ou à la grammaire soient tombés dans des erreurs semblables ; car ils jugent des choses par les noms, et non des noms par les choses...."

1663 - Correspondance de Spinoza, lettres 12 et 12bis, de Spinoza à Meyer
L’ouvrage classique de Koenraad Oege Meinsma, "Spinoza et son cercle" (1896), a montré, en opposition à une légende tenace, que la philosophie spinoziste, loin de se développer dans les conditions exceptionnelles de l’isolement où se serait enfermé un penseur de génie, s’est formée en communication avec tout un milieu culturel, Van den Enden, son professeur de latin, exécuté par Louis XIV pour avoir voulu instaurer la république en France; ses amis collégiants Louis Meyer et Jarig Jelles; Koerbagh, mort en prison pour avoir défendu le spinozisme. La traduction de l’ouvrage de Louis Meyer, "Philosophia S. Scripturae Interpres", publié anonymement à Amsterdam en 1666, aborde certaines des questions traitées par Spinoza lui-même dans son Tractatus theologico-philosophicus quatre ans plus tard et se situe ainsi dans l’horizon de la pensée spinoziste, avec laquelle L. Meyer était plus que toute autre familier...
"La question de l’infini a toujours paru à tous très difficile, sinon inextricable [inexplicable] du fait qu’ils n’ont pas distingué entre cela qui est infini par une conséquence de sa nature, autrement dit par la force de sa définition ; et ce qui n’a pas de limites, non certes par la force de son essence mais par la force de sa cause. Et aussi parce qu’ils n’ont pas distingué entre cela qui est dit infini parce que n’ayant pas de limites, et cela, bien qu’ayant un maximum et un minimum, dont nous ne pouvons atteindre et développer [expliquer] les parties par aucun nombre. Ensuite parce qu’ils n’ont pas distingué entre ce que nous pouvons seulement comprendre mais non imaginer, et ce que nous pouvons aussi imaginer. Et s’ils y avaient prêté attention, dis-je, jamais ils n’auraient été submergés d’une aussi grande foule de difficultés. Car ils auraient clairement compris quel infini ne peut être divisé en aucunes parties, autrement dit n’a aucunes parties, et lequel à l’inverse le peut, et cela sans contradiction. Ensuite ils auraient compris quel infini peut être conçu plus grand qu’un autre infini sans aucun embarras, et lequel non. Ce qui apparaîtra clairement de ce que je vais dire. Mais d’abord je vais exposer brièvement les quatre points suivants : la substance, le mode, l’éternité et la durée.
En ce qui concerne la substance, voici ce que je voudrais qu’on considère :
1°) à son essence appartient l’existence, c’est-à-dire sa seule essence et définition a pour conséquence qu’elle existe, ce que, si j’ai bonne mémoire, je t’ai auparavant démontré de vive voix sans le secours d’autres propositions ;
2°) ce premier point a pour conséquence que la substance n’est pas multiple, mais qu’il n’en existe qu’une de même nature ;
3°) toute substance ne peut être comprise si ce n’est infinie.
Les affections de la substance, je les appelle modes, dont la définition, puisqu’elle n’est pas définition de substance, ne peut impliquer aucune existence. C’est pourquoi, même si elles existent, nous pouvons les concevoir comme non existantes ; d’où la seconde conséquence que nous, quand nous prêtons attention à la seule essence des modes, mais non à l’ordre de toute la nature [matière], nous ne pouvons en conclure que, de ce qu’ils existent maintenant, ils existeront plus tard ou pas, ou ont existé auparavant ou pas ; d’où il apparaît clairement que nous concevons l’existence de la substance comme complètement différente de l’existence des modes.
De cela naît la différence entre éternité et durée. Par la durée en effet nous pouvons expliquer seulement l’existence des modes ; mais celle de la substance par l’éternité, c’est-à-dire la fruitio [jouissance, fruition] infinie d’exister, autrement dit, en dépit du latin, d’être.
Il en ressort clairement que, quand c’est à la seule essence des modes mais non à l’ordre de la nature que nous prêtons attention, nous pouvons à notre gré, sans détruire le concept que nous en avons, en déterminer (délimiter) l’existence et la durée, en concevoir un plus grand et un plus petit et les diviser en parties ; mais que l’éternité et la substance, puisqu’elles ne peuvent être conçues qu’infinies, ne peuvent en rien pâtir de ces choses sans que nous en détruisions en même temps le concept.
C’est pourquoi ils jacassent complètement, pour ne pas dire déraisonnent (délirent), ceux qui pensent que la substance étendue est une combinaison de parties, ou corps, réellement distinctes les unes des autres. C’est comme si quelqu’un, de la seule addition ou réunion de cercles, cherchait à combiner un carré ou un triangle ou autre chose de différent par toute son essence. C’est pourquoi tout ce fatras d’arguments par lesquels ils [des philosophes] s’occupent [communément] à montrer que la substance étendue est finie s’effondre de lui-même : car tous ces arguments supposent la substance corporelle combinée de parties. De même, d’autres, après s’être persuadés que la ligne est composée de points, ont pu trouver de nombreux arguments par lesquels ils ont montré que la ligne [n’]était [pas] divisible à l’infini.
Mais si tu demandais pourquoi nous sommes poussés par nature à diviser la substance étendue, je te répondrais que nous concevons la quantité de deux façons : abstraitement, autrement dit superficiellement, telle que, avec l’aide des sens, nous l’avons dans l’imagination ; ou comme substance, ce qui ne se fait que par l’entendement seul. C’est pourquoi (D’où), si nous prêtons attention à la quantité telle qu’elle est dans l’imagination, ce qui se fait le plus souvent et le plus facilement, nous la découvrons divisible, finie et composée de parties. Mais si nous prêtons attention au seul entendement (si nous y prêtons attention telle qu’elle est dans l’entendement) et que la chose est perçue comme elle est en soi, ce qui est très difficile, alors, comme je te l’ai assez démontré auparavant, nous la découvrons infinie, indivisible et unique.
En outre, de ce que nous pouvons déterminer la durée et la quantité à notre gré, quand nous concevons celle-ci abstraite de la substance et que nous séparons celle-là de la façon dont elle découle des choses éternelles, naissent le temps et la mesure ; en fait le temps sert à déterminer la durée et la mesure la quantité pour que nous les imaginions facilement, autant que faire se peut. Ensuite, de ce que nous séparons de la substance même les affections de la substance et les rangeons en classes pour que nous les imaginions facilement autant que faire se peut, naît le nombre, par quoi nous les déterminons. Et cela nous fait clairement voir que la mesure, le temps et le nombre ne sont que des façons de penser ou plutôt d’imaginer. Il n’est donc pas étonnant que tous ceux qui se sont efforcés de comprendre la marche de la nature par des notions semblables, et en plus en fait mal comprises, se soient prodigieusement empêtrés, de sorte qu’ils n’ont pu s’en dépêtrer qu’en brisant tout et en admettant (soutenant) les pires des absurdités.
En effet, comme il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons atteindre par aucune imagination mais par le seul entendement, ainsi la substance, l’éternité, etc., si quelqu’un s’efforce de les expliquer par de semblables notions, qui sont seulement des auxiliaires de l’imagination, il ne fait rien d’autre que s’appliquer à délirer avec son imagination.
En outre, les modes de la substance, si on les confond avec de tels êtres de raison ou d’imagination, ne pourront jamais être compris correctement. Car, ce faisant, nous les séparons de la substance et de la façon dont ils découlent de l’éternité, sans lesquelles pourtant on ne peut les comprendre correctement. Pour voir cela plus clairement, prends cet exemple : si quelqu’un a conçu abstraitement la durée et entrepris, la confondant avec le temps, de la diviser en parties, il ne pourra jamais comprendre par quelle raison une heure, par exemple, peut s’écouler. En effet, pour qu’une heure s’écoule, devra nécessairement s’en écouler d’abord la moitié, puis la moitié du reste, puis la moitié restante de ce reste ; et ainsi de suite indéfiniment [infiniment], il soustraira la moitié du reste et ne pourra jamais parvenir à la fin de l’heure. Car ils sont nombreux ceux qui, ne s’étant pas habitués à distinguer les êtres de raison des réels, ont osé affirmé que la durée se compose de moments. Ils sont ainsi tombés en Scylla, désirant éviter Charybde. En effet, c’est une même chose que la durée se compose de moments et le nombre de l’addition de zéros.
En outre, de ce qui vient d’être dit, il est assez évident que ni le nombre ni la mesure ni le temps, puisqu’ils ne sont que des auxiliaires de l’imagination, ne peuvent être infinis, car sinon le nombre ne serait pas le nombre, ni la mesure la mesure, ni le temps le temps. D’où on voit clairement pourquoi beaucoup, ayant confondu ces trois points avec les choses [mêmes], ont nié l’infini en acte. Mais ils ont raisonné misérablement, en jugent les mathématiciens, que des arguments de cette farine n’ont pas empêché de s’appliquer aux choses perçues par eux clairement et distinctement. Car, outre qu’ils ont trouvé beaucoup de choses qui ne peuvent s’expliquer par aucun nombre, ce qui prouve assez le défaut de nombres pour tout déterminer, il y en a aussi beaucoup qui ne peuvent être atteintes par aucun nombre, mais qui surpassent tout nombre possible, ce qu’ils n’ont pas conclu de la multitude des parties, mais de ce que la nature de la chose ne peut admettre un nombre sans contradiction manifeste. Par exemple, toutes les inégalités de Lettre 12.jpgl’espace compris entre deux cercles AB et CD et toutes les variations que la matière mue en lui doit admettre, surpassent tout nombre. Et cela ne se conclut pas de l’extrême grandeur de cet espace car, aussi petite que nous en prenions une portion, ses petites portions inégales surpasseront cependant tout nombre. Et, pour la même raison, cela ne se conclut pas non plus, comme il arrive dans d’autres cas, de ce que nous n’avons ni maximum ni minimum, car dans notre exemple, nous avons les deux : un maximum, AB, et un minimum, CD , dont nous pouvons conclure seulement que la nature de l’espace compris entre les deux cercles, à centre différent, ne peut rien admettre de tel. Et par là, si quelqu’un voulait déterminer toutes ces inégalités par un nombre précis, il devrait en même temps faire qu’un cercle ne soit plus un cercle.
Ainsi encore, pour revenir à notre propos, si quelqu’un voulait déterminer tous les mouvements de la matière qui ont eu lieu jusqu’à aujourd’hui, en les ramenant eux et leur durée à un nombre et un temps précis, il ne chercherait [s’efforcerait à] rien d’autre que priver la substance corporelle, que nous ne pouvons concevoir qu’existante, de ses affections et faire qu’elle n’ait pas la nature qu’elle a, ce que je pourrais démontrer clairement, ainsi que beaucoup d’autres points que j’ai abordés dans cette lettre, si je ne le jugeais superflu. De tout ce que je viens de dire, on voit clairement :
— que certaines choses sont infinies par leur nature – et elles ne peuvent être conçues finies en aucune façon ;
— que certaines le sont par la force de la cause à laquelle elles sont liées – et pourtant, une fois conçues abstraitement, elles peuvent être divisées en parties et considérées finies ;
— que certaines enfin sont dites infinies ou, si tu préfères, indéfinies, parce qu’elles ne peuvent être atteintes par aucun nombre et cependant se concevoir plus grandes ou plus petites, leur égalité n’étant pas une condition nécessaire pour qu’elles ne puissent être atteintes par aucun nombre, ce qui est assez manifeste de l’exemple ci-dessus et de beaucoup d’autres.
Bref, j’ai mis brièvement sous les yeux les causes des erreurs et des confusions nées autour de la question de l’infini, et je les ai toutes expliquées, si je ne me trompe, de sorte que je pense qu’il ne demeure aucune question touchant l’infini que je n’aurais abordée ou qui ne puisse être très aisément résolue à partir de ce qui a été dit. C’est pourquoi je ne pense pas qu’il vaille la peine de t’entretenir plus longtemps de ces points.
Mais je voudrais encore ajouter en passant que les péripatéticiens plus récents, à ce que je pense, ont mal compris la démonstration des Anciens par laquelle ils ont tenté de montrer l’existence de Dieu. En effet, la voici en gros telle que je la trouve chez un Juif appelé Rab Ghasdaj [Jaçdaj] : s’il y a suite de causes à l’infini, toutes les choses qui sont seront également causées, or à rien de ce qui est causé n’appartient d’exister nécessairement par la force de sa nature, donc il n’y a rien dans la nature à l’essence de quoi appartient d’exister nécessairement. Mais ceci est absurde, donc cela l’est aussi. La force de l’argument ne se situe pas en ce qu’il est impossible qu’il y ait infini en acte ou progression des causes à l’infini, mais surtout en ce qu’on suppose que les choses qui n’existent pas nécessairement par leur nature ne sont pas déterminées à exister par une chose existant nécessairement par sa nature.
Je passerais bien maintenant à ta deuxième lettre car le temps me pousse à me hâter, mais je pourrai répondre à son contenu plus commodément quand tu viendras me voir. Aussi je te demande de venir dès que possible, car je vais bientôt partir. Voilà. Porte-toi bien et souviens-toi de moi, qui suis etc."

En avril 1663, Spinoza quitte Rhynsburg et s'installe chez le peintre Daniel Tydemann, à Voorhurg, près de La Haye, afin d'échapper aux visiteurs que lui attirait sa réputation croissante. Il se lie alors avec le grand pensionnaire Jean de Witt (1625-1672), qui lui assura, dit-on, une pension de 200 florins, et il s'entretient avec lui de questions politiques, de liberté, de tolérance, contre la tyrannie que faisait régner l'Église calviniste. De là, sans doute, naquit chez lui l'idée de définir les rapport de l'Église et de l'État : ce qu'il fit dans le "Tractatus Theologico-politicus" (1670) et dans le Tractatus politicus" (1679), qui étudient les principes de la constitution de l'État, le droit naturel et le droit civil, le droit du souverain, la fin dernière que la société peut avoir en vue, la paix et la liberté de penser, les rapports de la raison avec la foi et la théologie, la manière de concilier avec la monarchie la liberté des citoyens, et d'assurer le salut à ceux-là mêmes qui n'ont pas su dépasser la simple obéissance aux notions communes.
Le Traité théologico-politique parut, sans nom d'auteur, en 1670, et suscita de violents orages parmi les calvinistes et les ennemis de la cause républicaine, aussi bien que parmi les théologiens et les philosophes qui taxèrent d'athéisme son auteur. Condamné par tous les synodes des Pays-Bas, Spinoza dut se réfugier à La Haye, sous la protection du Grand Pensionnaire, et là, dans les conditions de vie les plus modestes, logé chez la veuve van Velden sur le Veerkay, puis chez le peintre en bâtiment van der Spyck, il travailla, autant que le lui permettait une santé fort languissante, à l'achèvement de son Éthique. Toute la démarche de Spinoza est désormais sous-tendue par les idées essentielles, Dieu ou la Nature est la seule réalité ; il n'y a rien de contingent dans la Nature ; la béatitude consiste dans la connaissance de Dieu atteinte par la raison et dans l'amour de Dieu, c'est-à-dire de la nécessité divine....

1670 - "Traité théologico-politique", "contenant plusieurs dissertations où l'on fait voir que la liberté de philosopher non seulement est compatible avec le maintien de la piété et la paix de l'État mais même qu'on ne peut la détruire sans détruire en même temps et la paix de l'État et la piété elle-même"
Seul ouvrage à avoir été publié du vivant de Spinoza, mais anonymement et sous un faux nom d`éditeur, le Traité théologíco-politique est une œuvre véritablement révolutionnaire : l'ouvrage se présente globalement comme une défense de la liberté de penser, un éloge de la tolérance et une apologie de la démocratie. Spinoza y critique la théologie quand celle-ci étend son pouvoir hors de son domaine, élabore une théorie nouvelle du pouvoir politique et soumet le récit biblique, comme tout autre livre, à la critique historique : Ia méthode d`interprétation de la Bible est la même que celle de la Nature. Grâce à cette lecture rationnelle. nul besoin d'une lumière surnaturelle...
Ainsi Spinoza va-t-il rompre un des fondements de la pensée issue du Moyen Age et du christianisme. Spinoza décrit clairement sa démarche dans la préface de l'ouvrage où tout commence, non pas par une critique de la religion, mais de la superstition, déviation du sentiment religieux travestissant la religion authentique et créant de faux devoirs et des craintes vaines...
"La superstition est le moyen le plus efficace de gouverner la multitude
[1] Si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu’ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l’espérance et la crainte, pour des biens incertains qu’ils ne savent pas désirer avec mesure, leur esprit s’ouvre alors à la plus extrême crédulité ; il chancelle dans l’incertitude ; la moindre impulsion le jette en mille sens divers, et les agitations de l’espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance. Du reste, observez-le en d’autres rencontres, vous le trouverez confiant dans l’avenir, plein de jactance et d’orgueil.
[2] Ce sont là des faits que personne n’ignore, je suppose, bien que la plupart des hommes, à mon avis, vivent dans l’ignorance d’eux-mêmes ; personne, je le répète, n’a pu voir les hommes sans remarquer que lorsqu’ils sont dans la prospérité, presque tous se targuent, si ignorants qu’ils puissent être, d’une telle sagesse qu’ils tiendraient à injure de recevoir un conseil. Le jour de l’adversité vient-il les surprendre, ils ne savent plus quel parti choisir : on les voit mendier du premier venu un conseil, et si inepte, si absurde, si frivole qu’on l’imagine, ils le suivent aveuglément. Mais bientôt, sur la moindre apparence, ils recommencent à espérer un meilleur avenir ou à craindre les plus grands malheurs. Qu’il leur arrive en effet, tandis qu’ils sont en proie à la crainte, quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passés, ils en augurent aussitôt que l’avenir leur sera propice ou funeste ; et cent fois trompés par l’événement, ils n’en croient pas moins pour cela aux bons et aux mauvais présages. Sont-ils témoins de quelque phénomène extraordinaire et qui les frappe d’admiration, à leurs yeux c’est un prodige qui annonce le courroux des dieux, de l’Être suprême ; et ne pas fléchir sa colère par des prières et des sacrifices, c’est une impiété pour ces hommes que la superstition conduit et qui ne connaissent pas la religion. Ils veulent que la nature entière soit complice de leur délire, et, féconds en fictions ridicules, ils l’interprètent de mille façons merveilleuses.
[3] On voit par là que les hommes les plus attachés à toute espèce de superstition, ce sont ceux qui désirent sans mesure des biens incertains ; aussitôt qu’un danger les menace, ne pouvant se secourir eux-mêmes, ils implorent le secours divin par des prières et des larmes ; la raison (qui ne peut en effet leur tracer une route sûre vers les vains objets de leurs désirs), ils l’appellent aveugle, la sagesse humaine, chose inutile ; mais les délires de l’imagination, les songes et toutes sortes d’inepties et de puérilités sont à leurs yeux les réponses que Dieu fait à nos vœux. Dieu déteste les sages. Ce n’est point dans nos âmes qu’il a gravé ses décrets, c’est dans les fibres des animaux. Les idiots, les fous, les oiseaux, voilà les êtres qu’il anime de son souffle et qui nous révèlent l’avenir. Tel est l’excès de délire où la crainte jette les hommes.
[4] La véritable cause de la superstition, ce qui la conserve et l’entretient, c’est donc la crainte. Que si l’on n’est pas satisfait des preuves que j’en ai données, et qu’on veuille des exemples particuliers, je citerai Alexandre, qui ne devint superstitieux et n’appela auprès de lui des devins que lorsqu’il conçut des craintes sur sa fortune aux portes de Suse (voyez Quinte-Curce, liv. V. ch. 4). Une fois Darius vaincu, il cessa de consulter les devins, jusqu’au moment où la défection des Bactriens, les Scythes qui le pressaient et sa blessure qui le retenait au lit, vinrent de nouveau jeter dans son âme la terreur. " Alors, dit Quinte-Curce (liv. VII, chap. 7), il se replongea dans les superstitions, ces vains jouets de l’esprit des hommes ; et plein d’une foi crédule pour Aristandre, il lui donna l’ordre de faire des sacrifices pour y découvrir quel serait le succès de ses affaires. " Je pourrais citer une infinité d’autres exemples qui prouvent de la façon la plus claire que la superstition n’entre dans le cœur des hommes qu’avec la crainte, et que tous ces objets d’une vaine adoration ne sont que des fantômes, ouvrage d’une âme timide que la tristesse pousse au délire, enfin que les devins n’ont obtenu de crédit que durant les grandes calamités des empires et qu’alors surtout ils ont été redoutables aux rois. Mais tous ces exemples étant parfaitement connus, je ne crois pas nécessaire d’insister davantage.
[5] De l’explication que je viens de donner de la cause de la superstition, il résulte que tous les hommes y sont naturellement sujets (quoi qu’en disent ceux qui n’y voient qu’une marque de l’idée confuse qu’ont tous les hommes de la Divinité). Il en résulte aussi qu’elle doit être extrêmement variable et inconstante, comme tous les caprices de l’âme humaine et tous ses mouvements impétueux, enfin qu’il n’y a que l’espérance, la haine, la colère et la fraude qui la puissent faire subsister, puisqu’elle ne vient pas de la raison, mais des passions et des passions les plus fortes. Ainsi donc, autant il est facile aux hommes de se laisser prendre à toutes sortes de superstitions, autant il leur est difficile de persister dans une seule ; ajoutez que le vulgaire, étant toujours également misérable, ne peut jamais rester en repos ; il court toujours aux choses nouvelles et qui ne l’ont point encore trompé ; et c’est cette inconstance qui a été cause de tant de tumultes et de guerres. Car ainsi que nous l’avons déjà fait voir, et suivant l’excellente remarque de Quinte-Curce (liv. VI, ch. 18) ; " Il n’y a pas de moyen plus efficace que la superstition pour gouverner la multitude. " Et voilà ce qui porte si aisément le peuple, sous une apparence de religion, tantôt à adorer ses rois comme des dieux, tantôt à les détester comme le fléau du genre humain.
[6] Pour obvier à ce mal, on a pris grand soin d’entourer la religion, vraie ou fausse, d’un grand appareil et d’un culte pompeux, pour lui donner une constante gravité et imprimer à tous un profond respect ; ce qui, pour le dire en passant, a parfaitement réussi chez les Turcs où la discussion est un sacrilège et où l’esprit de chacun est rempli de tant de préjugés que la saine raison n’y a plus de place et le doute même n’y peut entrer.
II. Objet de ce traité : montrer la dépendance entre liberté et paix de l'État
[7] Mais si le grand secret du régime monarchique et son intérêt principal, c’est de tromper les hommes et de colorer du beau nom de religion la crainte où il faut les tenir asservis, de telle façon qu’ils croient combattre pour leur salut en combattant pour leur esclavage, et que la chose du monde la plus glorieuse soit à leurs yeux de donner leur sang et leur vie pour servir l’orgueil d’un seul homme, comment concevoir rien de semblable dans un État libre, et quelle plus déplorable entreprise que d’y répandre de telles idées, puisque rien n’est plus contraire à la liberté générale que d’entraver par des préjugés ou de quelque façon que ce soit le libre exercice de la raison de chacun ! Quant aux séditions qui s’élèvent sous prétexte de religion, elles ne viennent que d’une cause, c’est qu’on veut régler par des lois les choses de la spéculation, et que dès lors des opinions sont imputées à crime et punies comme des attentats. Mais ce n’est point au salut public qu’on immole des victimes, c’est à la haine, c’est à la cruauté des persécuteurs. Que si le droit de l’État se bornait à réprimer les actes, en laissant l’impunité aux paroles, il serait impossible de donner à ces troubles le prétexte de l’intérêt et du droit de l’État, et les controverses ne se tourneraient plus en séditions.
[8] Or ce rare bonheur m’étant tombé en partage de vivre dans une république où chacun dispose d’une liberté parfaite de penser et d’adorer Dieu à son gré, et où rien n’est plus cher à tous et plus doux que la liberté, j’ai cru faire une bonne chose et de quelque utilité peut-être en montrant que la liberté de penser, non-seulement peut se concilier avec le maintien de la paix et le salut de l’État, mais même qu’on ne pourrait la détruire sans détruire du même coup et la paix de l’État et la piété elle-même. Voilà le principe que j’ai dessein d’établir dans ce Traité. Mais pour cela j’ai jugé nécessaire de dissiper d’abord divers préjugés, les uns, restes de notre ancien esclavage, qui se sont établis touchant la religion, les autres qu’on s’est formés sur le droit des pouvoirs souverains. Nous voyons en effet certains hommes se livrer avec une extrême licence à toutes sortes de manœuvres pour s’approprier la plus grande partie de ce droit et, sous le voile de la religion, détourner le peuple, qui n’est pas encore bien guéri de la vieille superstition païenne, de l’obéissance aux pouvoirs légitimes, afin de replonger de nouveau toutes choses dans l’esclavage. Quel ordre suivrai-je dans l’exposition de ces idées, c’est ce que je dirai tout à l’heure en peu de mots ; mais je veux expliquer avant tout les motifs qui m’ont déterminé à écrire.
III. Comment la religion a-t-elle pu se pervertir ?
[9] Je me suis souvent étonné de voir des hommes qui professent la religion chrétienne, religion d’amour, de bonheur, de paix, de continence, de bonne foi, se combattre les uns les autres avec une telle violence et se poursuivre d’une haine si farouche, que c’est bien plutôt par ces traits qu’on distingue leur religion que par les caractères que je disais tout à l’heure. Car les choses en sont venues au point que personne ne peut guère plus distinguer un chrétien d’un Turc, d’un juif, d’un païen que par 1a forme extérieure et le vêtement, ou bien en sachant quelle église il fréquente, ou enfin qu’il est attaché à tel ou tel sentiment, et jure sur la parole de tel ou tel maître. Mais quant à la pratique de la vie, je ne vois entre eux aucune différence.
En cherchant la cause de ce mal, j’ai trouvé qu’il vient surtout de ce qu’on met les fonctions du sacerdoce, les dignités, les devoirs de l’Église au rang des avantages matériels, et que le peuple s’imagine que toute la religion est dans les honneurs qu’il rend à ses ministres. C’est ainsi que les abus sont entrés dans l’Église, et qu’on a vu les derniers des hommes animés d’une prodigieuse ambition de s’emparer du sacerdoce, le zèle de la propagation de la foi se tourner en ambition et en avarice sordide, le temple devenir un théâtre où l’on entend non pas des docteurs ecclésiastiques, mais des orateurs dont aucun ne se soucie d’instruire le peuple, mais seulement de s’en faire admirer, de le captiver en s’écartant de la doctrine commune, de lui enseigner des nouveautés et des choses extraordinaires qui le frappent d’admiration. De là les disputes, les jalousies ; et ces haines implacables que le temps ne peut effacer. Il ne faut point s’étonner, après cela, qu’il ne soit resté de l’ancienne religion que le culte extérieur (qui en vérité est moins un hommage à Dieu qu’une adulation), et que la foi ne soit plus aujourd’hui que préjugés et crédulités. Et quels préjugés, grand Dieu ? des préjugés qui changent les hommes d’êtres raisonnables en brutes, en leur ôtant le libre usage de leur jugement, le discernement du vrai et du faux, et qui semblent avoir été forgés tout exprès pour éteindre, pour étouffer le flambeau de la raison humaine.
La piété, la religion, sont devenues un amas d’absurdes mystères, et il se trouve que ceux qui méprisent le plus la raison, qui rejettent, qui repoussent l’entendement humain comme corrompu dans sa nature, sont justement, chose prodigieuse, ceux qu’on croit éclairés de la lumière divine. Mais en vérité, s’ils en avaient seulement une étincelle ils ne s’enfleraient pas de cet orgueil insensé ; ils apprendraient à honorer Dieu avec plus de prudence, et ils se feraient distinguer par des sentiments non de haine, mais d’amour ; enfin, ils ne poursuivraient pas avec tant d’animosité ceux qui ne partagent pas leurs opinions, et si en effet ce n’est pas de leur fortune, mais du salut de leurs adversaires qu’ils sont en peine, ils n’auraient pour eux que de la pitié.
J’ajoute qu’on reconnaîtrait à leur doctrine qu’ils sont véritablement éclairés de la lumière divine. Il est vrai, je l’avoue, qu’ils ont pour les profonds mystères de l’Écriture une extrême admiration ; mais je ne vois pas qu’ils aient jamais enseigné autre chose que les spéculations de Platon ou d’Aristote, et ils y ont accommodé l’Écriture, de peur sans doute de passer pour disciples des païens. Il ne leur a pas suffi de donner dans les rêveries insensées des Grecs, ils ont voulu les mettre dans la bouche des prophètes ; ce qui prouve bien qu’ils ne voient la divinité de l’Écriture qu’à la façon des gens qui rêvent ; et plus ils s’extasient sur les profondeurs de l’Écriture, plus ils témoignent que ce n’est pas de la foi qu’ils ont pour elle, mais une aveugle complaisance. Une preuve nouvelle, c’est qu’ils partent de ce principe (quand ils commencent l’explication de l’Écriture et la recherche de son vrai sens) que l’Écriture est toujours véridique et divine. Or, c’est là ce qui devrait résulter de l’examen sévère de l’Écriture bien comprise ; de façon qu’ils prennent tout d’abord pour règle de l’interprétation des livres sacrés ce que ces livres eux-mêmes nous enseigneraient beaucoup mieux que tous leurs inutiles commentaires.
IV. Plan du traité
[10] Ayant donc considéré toutes ces choses ensemble, savoir, que la lumière naturelle est non-seulement méprisée, mais que plusieurs la condamnent comme source de l’impiété, que des fictions humaines passent pour des révélations divines, et la crédulité pour la foi, enfin que les controverses des philosophes soulèvent dans l’Église comme dans l’État les passions les plus ardentes, d’où naissent les haines, les discordes, et à leur suite les séditions, sans parler d’une foule d’autres maux qu’il serait trop long d’énumérer ici ; j’ai formé le dessein d’instituer un examen nouveau de l’Écriture et de l’accomplir d’un esprit libre et sans préjugés, en ayant soin de ne rien affirmer, de ne rien reconnaître comme la doctrine sacrée que ce que l’Écriture elle-même m’enseignerait très-clairement. Je me suis formé à l’aide de cette règle une méthode pour l’interprétation des livres sacrés, et une fois en possession de cette méthode, je me suis proposé cette première question : qu’est-ce que la prophétie ? et puis, comment Dieu s’est-il révélé aux prophètes ? pourquoi Dieu les a-t-il choisis ? est-ce parce qu’ils avaient de sublimes idées de Dieu et de la nature, ou seulement à cause de leur piété ?
Les chapitres I à XV prennent comme objet d'étude l'Écriture biblique, laquelle ne fournit pas le fondement des institutions politiques. Spinoza replace systématiquement les faits bibliques dans leur contexte historique, et montre, par une analyse rationnelle, que toutes les révélations contenues dans les livres saints sont adaptées à la nature et aux capacités de ceux qui doivent les recevoir. Sous l'apparence des faits et des paroles révélées, Spinoza souligne que l'on retrouve toujours les lois de la nature telles que peut les dévoiler la raison.
"... Il suit de la définition que j'ai-donnée, qu'on peut appeler Prophétie la connaissance naturelle. Car ce que nous connaissons par la lumière naturelle dépend de la seule connaissance de Dieu et de ses décrets éternels. Toutefois cette connaissance naturelle étant commune à tous les hommes, car elle dépend de principes communs à tous, le vulgaire toujours assoiffé de raretés et d'étrangetés, méprisant les dons naturels, n'en fait pas grand cas; il entend donc l'exclure quand il parle de la connaissance prophétique. La naturelle n'en a pas moins tout autant de droit qu'une autre, quelle qu'elle soit, à s'appeler divine, puisque c'est la nature de Dieu en tant que nous en participons, et les décrets divins qui nous la dictent en quelque sorte. Elle diffère d'ailleurs de celle que tous nomment divine, en ce point seulement que cette dernière s'étend au delà des limites de la première et ne peut s'expliquer par les lois de la nature humaine considérée en elle-même; mais à l'égard de la certitude qu'enveloppe la connaissance naturelle et de la source d'où elle découle (qui est Dieu), elle ne le cède aucunement à la prophétique. A moins qu'on ne veuille entendre ou plutôt rêver que les prophètes ont bien eu un corps d'homme, mais non une âme humaine et que, par suite, leurs sensations et leur conscience étaient d'une tout autre nature que les nôtres...."
Deux chapitres sont consacrés aux prophéties et aux prophètes, la prophétie correspond à une connaissance vague et inconstante portée par des prophètes doués du pouvoir d'imaginer. Au fond, toute religion ou loi divine ne se résume que dans un unique précepte, aimer Dieu comme un bien souverain, et non par crainte d'un supplice ou d'un châtiment. Pour aborder le problème de la loi divine à la lumière de la raison, il faut considérer Dieu comme agissant et dirigeant toutes choses par la seule nécessité de sa nature et de sa perfection. Dans le chapitre V, Spinoza explore ensuite la raison pour laquelle des cérémonies ont été instituées ...
"... Nous avons montré dans le chapitre précédent que la loi divine qui donne aux hommes la véritable béatitude et leur enseigne la vie vraie, est commune à tous les hommes; bien mieux, nous l'avons déduite de la nature humaine de façon qu'on doit l'estimer innée à l'âme humaine et comme écrite en elle. Au contraire, les cérémonies du culte, celles au moins qui se trouvent dans l'Ancien Testament, ont été instituées pour les Hébreux seulement et adaptées à leur État de telle sorte que pour la plus grande part elles n'ont pu être célébrées que par la communauté entière, non par les individus isolés. Il est donc certain qu'elles n'ont point trait à la loi divine et ne contribuent en rien à la béatitude et à la vertu, mais concernent uniquement l'élection des Hébreux, c'est-à-dire la seule félicité temporelle des corps et la tranquillité de l'État, puisqu'elles ne pouvaient être d'aucun usage sinon pendant la durée de l'État. Si donc, dans l'Ancien Testament, ces cérémonies sont rapportées à la loi de Dieu, c'est seulement parce qu'elles ont été instituées en vertu d'une révélation ou tirées de principes révélés. Toutefois comme un raisonnement, si solide qu'il soit, n'a guère de force aux yeux des Théologiens ordinaires, il convient de confirmer par l'autorité de l'Écriture ce que nous venons de montrer; nous ferons voir ensuite, pour rendre la chose plus claire, pour quelle raison et comment les cérémonies servaient au maintien et à la conservation de l'Etat des Juifs..."
Dans le chapitre VI, le problème des Miracles est abordé : en fait, contrairement à ce que peut en penser le vulgaire, on perçoit mieux Dieu par l'ordre de la Nature, et le récit des miracles peut être attribué à la méconnaissance des causes naturelles. Il y a plus profondément contradiction à poser Dieu et, en même temps, le miracle. Puis vient au chapitre VII le problème de la méthode d'interprétation de l'Écriture, méthode qui en fait ne diffère en rien de celle observée dans l'interprétation de la Nature. Il faut acquérir de l'Ecriture une exacte connaissance historique. « La règle universelle à poser dans l'interprétation de l'Écriture est donc de ne lui attribuer d'autres enseignements que ceux que l'enquête historique nous aura très clairement montré qu'elle a donnés". Spinoza repousse ainsi la nécessité d'une Lumière surnaturelle pour interpréter l'Ecriture, la Raison seule s'avère suffisante. Dans le chapitre XII, Spinoza se défendra d'avoir porté atteinte à l'Ecriture et à la parole de Dieu. Ce qu'il attaque, c'est la dégradation de la religion en superstition..
"Dans le chapitre Il de ce Traité, nous avons montré que les Prophètes ont eu une faculté singulière d'imaginer seulement, mais non de connaître, que Dieu ne leur a nullement révélé les arcanes de la philosophie, mais des choses de la plus grande simplicité et qu'il s'est adapté à leurs opinions préconçues. Nous avons montré en second lieu au chapitre V que l'Écriture dans ses commandements a voulu rendre ses communications et ses enseignements aussi faciles à percevoir que possible pour un chacun; qu'en conséquence elle n'a point suivi la méthode déductive, partant d'axiomes et de définitions et enchaînant les vérités, mais les a simplement énoncées, et, pour les rendre croyables, les a confirmées par l'expérience seule, c'est-à-dire par des miracles et des récits historiques, qu'enfin dans ces récits mêmes elle use des phrases et du style le plus propres à émouvoir l'âme de la foule; voyez sur ce point ce qui Aa été démontré en troisième lieu au chapitre VI. Enfin dans le chapitre VII nous avons montré que la difficulté d'entendre l'Écriture consiste dans la langue seule, non dans la hauteur du sujet. A quoi s'ajoute que les Prophètes n'ont pas prêché pour les habiles, mais pour tous les Juifs absolument, et que les Apôtres avaient accoutumé d'enseigner la doctrine évangélique dans les Eglises où se tenait l'assemblée commune. De tout cela il suit que la doctrine de l'Écriture n'est pas une philosophie, ne contient pas de hautes spéculations, mais seulement des vérités très simples et qui sont aisément percevables à l'esprit le plus paresseux. Je ne puis donc assez admirer la complexion d'esprit de ces hommes, dont j'ai parlé plus haut, qui voient dans l'Écriture de si profonds mystères qu'on ne peut les expliquer en aucune langue, et qui ont ensuite introduit dans la Religion tant de philosophie et de spéculations que l'Église semble devenue Académie, la Religion une science, ou plutôt une controverse. Quoi d'étonnant cependant si des hommes qui se vantent d'avoir une lumière supérieure à la naturelle ne veulent pas le céder en connaissance aux philosophes réduits à la naturelle? ..."
Les chapitres XIII à XV constituent une transition vers le problème du politique, noyau de la seconde partie du Tractatus. "L'Evangile n'enseigne rien que la Foi simple : croire en Dieu et le révérer, ou, ce qui revient au même obéir à Dieu". Le chapitre XV distingue la philosophie de la théologie, aucune des deux ne devant être la servante de l'autre...
"Entre ceux qui ne séparent pas la Philosophie de la Théologie, il y a discussion sur le point de savoir si l'Écriture doit être la servante de la Raison, ou la Raison de l'Écriture; c'est-à-dire si le sens de l'Écriture doit se plier à la Raison, ou la Raison se plier à l'Écriture. Cette dernière thèse est celle des Sceptiques, lesquels nient la certitude de la Raison; la première est soutenue par les Dogmatiques. Il est constant, par ce qui a déjà été dit, que les uns et les autres errent de toute l'étendue du ciel. Que nous suivions en effet une manière de voir ou l'autre, la Raison ou l'Écriture est nécessairement corrompue. Nous avons montré en effet que l'Écriture n'enseigne pas la philosophie, mais la piété seulement, et que tout son contenu a été adapté à la compréhension et aux opinions préconçues du vulgaire. Qui donc veut la plier à la Philosophie attribuera certainement par fiction aux Prophètes beaucoup de pensées qu'ils n'ont pas eues même en rêve et interprétera très faussement leur pensée. Qui au contraire fait de la Raison et de la Philosophie les servantes de la Théologie est tenu d'admettre comme choses divines les préjugés du vulgaire des temps anciens, préjugés qui occuperont et aveugleront sa pensée. Ainsi l'un et l'autre, l'un sans la Raison, l'autre avec elle, déraisonneront."
En séparant le champ de la foi (théologie) et le champ de la raison (philosophie), Spinoza défend la liberté de penser et la liberté de philosopher en un chapitre qui devient la clef de l'ouvrage : le but principal du Tractatus est bien de défendre la liberté de philosopher...
"Jusqu'à présent notre souci a été de séparer la Philosophie de la Théologie et de montrer la liberté de philosopher que la Théologie reconnait à tous. Il est temps maintenant de nous demander jusqu'où doit s'étendre, dans l'État le meilleur, cette liberté laissée à l'individu de penser et de dire ce qu'il pense. Pour examiner cette question avec méthode, il nous faut éclaircir la question des fondements de l'État et en premier lieu traiter du Droit Naturel de l'individu sans avoir égard pour commencer à l'État et à la Religion.
Par Droit et Institution de la Nature, je n'entends autre chose que les règles de la nature de chaque individu, règles suivant lesquelles nous concevons chaque être comme déterminé à exister et à se comporter d'une certaine manière. Par exemple les poissons sont déterminés par la Nature à nager, les grands poissons à manger les petits; par suite les poissons jouissent de l'eau, et les grands mangent les petits, en vertu d'un droit naturel souverain. Il est certain en effet que la Nature considérée absolument a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire que le Droit de la Nature s'étend aussi loin que s'étend sa puissance; car la puissance de la Nature est la puissance même de Dieu qui a sur toutes choses un droit souverain. Mais la puissance universelle de la Nature entière n'étant rien en dehors de la puissance de tous les individus pris ensemble, il suit de là que chaque individu a un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir, autrement dit que le droit de chacun s'étend jusqu'où s'étend la puissance déterminée qui lui appartient. Et la loi suprême de la Nature étant que chaque chose s'efforce de persévérer dans son état, autant qu'il est en elle, et cela sans tenir aucun compte d'aucune autre chose, mais seulement d'elle-même, il suit que chaque individu a un droit souverain de persévérer dans son état, c'est-à-dire d'exister et de se comporter comme il est naturellement déterminé à le faire. Nous ne reconnaissons ici nulle différence entre les hommes et les autres individus de la Nature, non plus qu'entre les hommes doués de Raison et les autres qui ignorent la vraie Raison; entre les imbéciles, les déments et les gens sains d'esprit. Tout ce que fait une chose agissant suivant les lois de la nature, en effet, elle le fait d'un droit souverain, puisqu'elle agit comme elle y est déterminée par la Nature et ne peut agir autrement. C'est pourquoi, parmi les hommes, aussi longtemps qu'on les considère comme vivant sous l'empire de la Nature seule, aussi bien celui qui n'a pas encore connaissance de la Raison, ou qui n'a pas encore l'état de vertu, vit en vertu d'un droit souverain soumis aux seules lois de l'Appétit, que celui qui dirige sa vie suivant les lois de la Raison. C'est-à-dire, de même que le sage a un droit souverain de faire tout ce que la Raison commande, autrement dit, de vivre suivant les lois de la Raison, de même l'ignorant, et celui qui n'a aucune force morale, a un droit souverain de faire tout ce que persuade l'Appétit, autrement dit de vivre suivant les lois de l'Appétit. C'est la doctrine même de Paul qui ne reconnaît pas de péché avant la loi, c'est-à-dire tant que les hommes sont considérés comme vivant sous l'empire de la Nature.
Le Droit naturel de chaque homme se définit donc non par la saine Raison, mais par le désir et la puissance. Tous en effet ne sont pas déterminés naturellement à se comporter suivant les règles et lois de la Raison ; tous au contraire naissent ignorants de toutes choses et, avant qu'ils puissent connaître la vraie règle de vie et acquérir l'état de vertu, la plus grande partie de leur vie s'écoule..."
Les chapitres XVI à XIX en viennent aux bases de l'Etat, qui doit être laïque. En effet, "Il est temps maintenant de nous demander jusqu'où doit s'étendre, dans l'Etat le meilleur, cette liberté laissée à l'individu de penser et de dire ce qu'il pense"? Spinoza part du Droit naturel de l'individu. "Par Droit et Institution de la Nature, je n'entends pas autre chose que les règles de la nature de chaque individu, règles suivant lesquelles nous concevons chaque être comme déterminé à exister et à se comporter d'une certaine manière"...
"Voici maintenant la condition suivant laquelle une société peut se former sans que le Droit naturel y contredise le moins du monde, et tout pacte peut être observé avec la plus grande fidélité ; il faut que l'individu transfère à la société toute la puissance qui lui appartient, de façon qu'elle soit seule à avoir sur toutes choses un droit souverain de Nature, c'est-à-dire une souveraineté de commandement à laquelle chacun sera tenu d'obéir, soit librement, soit par crainte du dernier supplice. Le droit d'une société de cette sorte est appelé Démocratie et la Démocratie se définit ainsi : l'union des hommes en un tout qui a un droit souverain collectif sur tout ce qui est en son pouvoir. De là cette conséquence que le souverain n'est tenu par aucune loi et que tous lui doivent obéissance pour tout; car tous ont dû, par un pacte tacite ou exprès, lui transférer toute la puissance qu'ils avaient de se maintenir, c'est-à-dire tout leur droit naturel. Si, en effet, ils avaient voulu conserver pour eux-mêmes quelque chose de ce droit, ils devaient en même temps se mettre en mesure de le défendre avec sûreté; comme ils ne l'ont pas fait, et ne pouvaient le faire, sans qu'il y eût division et par suite destruction du commandement, par là même ils se sont soumis à la volonté, quelle qu'elle fût, du pouvoir souverain. Nous y étant ainsi soumis, tant parce que la nécessité (comme nous l'avons montré) nous y contraignait que par la persuasion de la Raison elle-même, à moins q ue nous ne voulions être des ennemis du Pouvoir établi et agir contre la Raison qui nous persuade de maintenir cet établissement de toutes nos forces, nous sommes tenus d'exécuter absolument tout ce qu'enjoint le souverain, alors même que ses commandements seraient les plus absurdes du monde; la Raison nous ordonne de le faire parce que c'est choisir de deux maux le moindre..."
La fin de la Démocratie est de soustraire les hommes à la domination de l'Appétit et de les maintenir dans les limites de la Raison. Spinoza définit également la justice. À chacun son dû selon le droit civil, c'est-à-dire selon la liberté qu'a l'individu de se conserver dans son état : telle est la justice. Mais un droit civil qui dépend entièrement du souverain, qu'il soit ou non conforme a la vérité révélée de Dieu. Seul l'Etat rationnel permet la liberté et qu'être libre, c'est obéir à un Etat fondé sur la raison. Spinoza, se référant à l'Etat des Hébreux qu'il prend comme exemple, montre que le culte religieux extérieur doit se régler sur la paix de l'Etat, c'est donc bien le souverain qui possède le droit de régler les choses sacrées. Dans le chapitre XVII, Spinoza tempèrera l'absolutisme découlant de la définition de la Démocratie, qui pourrait déboucher sur la tyrannie. Comme on ne peut enlever à chaque individu la totalité de sa puissance, aucun souverain ne peut être en état de tout exécuter comme il le voudra...
Le chapitre XX établit enfin que tout Etat doit concéder aux individus la liberté de penser : tel est le principe démocratique fondamental. La fin dernière de cet Etat n'est pas la domination du souverain, mais la liberté et la sécurité de l'individu. On ne peut retirer aux sujets la liberté de penser et d'exprimer leur pensée...
"Des fondements de l'État tels que nous les avons expliqués ci-dessus, il résulte avec la dernière évidence que sa fin dernière n'est pas la domination; ce n'est pas pour tenir l'homme par la crainte et faire qu'íl appartienne à un autre que l'Etat est institué ; au contraire, c'est pour libérer l'individu de la crainte, pour qu'il vive autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve, aussi bien qu'il se pourra, sans dommage pour autrui, son droit naturel d'exister et d'agir. Non, je le répète, la fin de l'Etat n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'êtres raisonnables à celle de bêtes brutes ou d'automates, mais au contraire il est institué pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une Raison libre, pour qu'ils ne luttent point de haine, de colère ou de ruse, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. La fin de l'État est donc en réalité la liberté. Nous avons vu aussi que, pour former l'État, une seule ,chose est nécessaire : que tout le pouvoir de décréter appartienne soit à tous collectivement, soit à quelques-uns, soit à un seul. Puisque, en effet, le libre jugement des hommes est extrêmement divers, que chacun pense être seul à tout savoir et qu'il est impossible que tous opinent pareillement et parlent d'une seule bouche, ils ne pourraient vivre en paix si l'individu n'avait renoncé à son droit d'agir suivant le seul décret de sa pensée. C'est donc seulement au droit d'agir par son propre décret qu'il a renoncé, non au droit de raisonner et de juger; par suite nul à la vérité ne peut, sans danger pour le droit du souverain, agir contre son décret, mais il peut avec une entière liberté opiner et juger et en conséquence aussi parler, pourvu qu'il n'aille pas au delà de la simple parole ou de l'enseignement, et qu'il défende son opinion par la Raison seule, non par la ruse, la colère ou la haine, ni dans l'intention de changer quoi que ce soit dans l'État de l'autorité de son propre décret. Par exemple, en cas qu'un homme montre qu'une loi contredit à la Raison, et qu'il exprime l'avis qu'elle doit être abrogée, si, en même temps, il soumet son opinion au jugement du souverain (à qui seul il appartient de faire et d'abroger des lois) et qu'il s'abstienne, en attendant, de toute action contraire à ce qui est prescrit par cette loi, certes il mérite bien de l'État et agit comme le meilleur des citoyens; au contraire, s'il le fait pour accuser le magistrat d'iniquité et le rendre odieux, ou tente séditieusement d'abroger cette loi malgré le magistrat, il est du tout un perturbateur et, un rebelle. Nous voyons donc suivant quelle règle chacun, sans danger pour le droit, et l'autorité du souverain c'est-à-dire pour la paix de l'Etat, peut dire et enseigner ce qu'il pense; c'est à la condition qu'il laisse au souverain le soin de décréter sur toutes actions, et s'abstienne d'en accomplir aucune contre ce décret, même s'il lui faut souvent agir en opposition avec ce qu'il juge et professe qui est bon. Et il peut le faire sans péril pour la justice et la piété; je dis plus, il doit le faire, s'il veut se montrer juste et pieux; car, nous l'avons montré, la justice dépend du seul décret du du souverain et, par suite, nul ne peut être juste s'il ne vit pas selon les décrets rendus par le souverain. Quant à la piété, la plus haute sorte en est (d'après ce que nous avons montré dans le précédent chapitre) celle qui s'exerce en vue de la paix et de la tranquillité de l'État; or elle ne peut se maintenir si chacun doit vivre selon le jugement particulier de sa pensée..."

1672 - Le Dernier des barbares (Ultimi Barbarorum), titre de l'affiche que rédigea Spinoza pour protester contre le massacre des frères de Witt par les partisans monarchistes de Guillaume d'Orange. Ce meurtre marquait la défaite des républicains ou "parti de la liberté", dirigé par Jean de Witt, dont Spinoza avait été l'ami et le conseiller, car, représentant les intérêts de la bourgeoisie marchande contre l'aristocratie terrienne. Ils défendaient tous deux la tolérance religieuse et la liberté de pensée contre les prétentions « intégristes » des monarchistes. Le propriétaire de Spinoza, Hendrik van der Speijk, prévoyant que le philosophe serait la prochaine victime du lynchage, l'avait enfermé dans sa chambre et l'avait ainsi sauvé. Une autre connaissance de Spinoza, Adriaan Koerbagh (1633-1669), montre les limites de la fameuse tolérance du siècle d'or néerlandais. Celui-ci, avec son frère, furent des membres à part entière de la frange radicale d'Amsterdam, tant sur le plan politique que théologique, au milieu des années 1660, lorsque Spinoza se rendit dans cette ville, et furent particulièrement sensible au monisme du philosophe. Adriaan Koerbagh, auteur de "Een Ligt Schijnende in Duystere Plaatsen" (Une lumière qui brille dans les lieux sombres), fut jugé coupable de blasphème et condamné en 1668 à dix ans de détention et mourut en prison quelques mois après, en octobre 1669, à l'âge de 37 ans. Le Traité théologico-politique (1670) fut suscité par ses différents épisodes...

1677 - "Traité politique" (Tractatus politicus), dans lequel on démontre de quelle manière on doit instituer une Société où le gouvernement monarchique est en vigueur, de même que celle où les Grands gouvernent, pour qu'elle ne dégénère pas en tyrannie, et que la Paix et la Liberté des citoyens demeurent inviolées.
Inachevé mais publié quelques mois après la mort de Spinoza, avec l'Ethique et le Traité de la réforme de l'entendement, le Traité politique entendait défendre la politique de Jean de Witt, Grand Pensionnaire de la province de Hollande de 1653 à 1672, face à la maison d'Orange. Mais, en 1672, profitant de son incapacité à arrêter l'invasion française dans les Provinces-Unies, Guillaume III, stathouder et prince d'Orange, provoquera le soulèvement de la population de La Haye, qui massacre Jean de Witt et son frère Cornelis.
La réalité est conçue comme un tout rationnel régi par un système de lois en vertu duquel s'affirme chaque élément qui le compose. Le droit naturel qui est le droit d'autoconservation de chaque élément s'applique donc à tous les êtres naturels et n'a d'autre limite que sa propre force, une force entendue comme une réalité effective, pour se maintenir. On sait qu' "il n’est pas au pouvoir de tout homme d’user toujours de la droite raison et de s’élever au faîte de la liberté humaine, que tout homme cependant fait toujours effort, autant qu’il est en lui, pour conserver son être, enfin que tout ce qu’il tente de faire et tout ce qu’il fait (son droit n’ayant d’autre mesure que sa puissance), il le tente et le fait, sage ou ignorant, en vertu du droit suprême de la nature. Il suit de là que le droit naturel, sous l’empire duquel tous les hommes naissent et vivent, ne défend rien que ce que personne ne désire ou ne peut faire ; il ne repousse donc ni les contentions, ni les haines, ni la colère, ni les ruses, ni rien enfin de ce que l’appétit peut conseiller. Et cela n’a rien de surprenant ; car la nature n’est pas renfermée dans les lois de la raison humaine, lesquelles n’ont rapport qu’à l’utilité vraie et à la conservation des hommes ; mais elle embrasse une infinité d’autres lois qui regardent l’ordre éternel de la nature entière, dont l’homme n’est qu’une parcelle, ordre nécessaire par qui seul tous les individus sont déterminés à exister et à agir d’une manière donnée." Quel est le fond de ce droit naturel? "personne dans l’état de nature n’est tenu de se conformer, à moins que ce ne soit de son plein gré, aux volontés d’autrui, ni de trouver bon ou mauvais autre chose que ce que lui-même juge bon ou mauvais selon son caractère, et rien n’est absolument défendu par le droit naturel que ce que nul ne peut faire".
Mais ce droit naturel dont dispose chaque être humain n'est pas un droit réel tant qu'il est isolé: "de même donc que le péché et l’obéissance, pris dans le sens le plus strict, ne se peuvent concevoir que dans la vie sociale, il en faut dire autant de la justice et de l’injustice". Ainsi donc "il est certain que chacun a d’autant moins de puissance, par conséquent d’autant moins de droit, qu’il a un plus grand sujet de crainte. Ajoutez à cela que les hommes sans un secours mutuel pourraient à peine sustenter leur vie et cultiver leur âme. D’où nous concluons que le droit naturel, qui est le propre du genre humain, ne peut guère se concevoir que là où les hommes ont des droits communs, possèdent ensemble des terres qu’ils peuvent habiter et cultiver, sont enfin capables de se défendre, de se fortifier, de repousser toute violence, et de vivre comme ils l’entendent d’un consentement commun". Ce droit naturel ne se réalise donc que lorsque l'individu entre dans une collectivité humaine qui va le garantir. "Si deux individus s’unissent ensemble et associent leurs forces, ils augmentent ainsi leur puissance et par conséquent leur droit ; et plus il y aura d’individus ayant aussi formé alliance, plus tous ensemble auront de droit."
Ce droit, qui est défini par la puissance de la multitude, "on a coutume de l’appeler l’État" : "le droit de l’État ou des pouvoirs souverains n’est autre chose que le droit naturel lui-même, en tant qu’il est déterminé, non pas par la puissance de chaque individu, mais par celle de la multitude agissant comme avec une seule âme ; en d’autres termes, le droit du souverain, comme celui de l’individu dans l’état de nature, se mesure sur sa puissance. D’où il suit que chaque citoyen ou sujet a d’autant moins de droit que l’État tout entier a plus de puissance que lui, et par conséquent chaque citoyen n’a droit qu’à ce qui lui est garanti par l’État." Il ne faut jamais oublier que dans cette logique spinoziste, "la raison n’est jamais contraire à la nature" : "la raison nous prescrit impérieusement de chercher la paix, laquelle n’est possible que si les droits de l’État sont préservés de toute atteinte, et en conséquence plus un homme est conduit par la raison, plus il est libre, plus constamment il maintiendra les droits de l’État et se conformera aux ordres du souverain dont il est le sujet". "Ajoutez à cela que l’ordre social est naturellement institué pour écarter la crainte commune et se délivrer des communes misères, et par conséquent qu’il tend surtout à assurer à ses membres les biens que tout homme, conduit par sa raison, se serait efforcé de se procurer dans l’ordre naturel, mais bien vainement. C’est pourquoi, si un homme conduit par la raison est forcé quelquefois de faire par le décret de l’État ce qu’il sait contraire à la raison, ce dommage est compensé avec avantage par le bien qu’il retire de l’ordre social lui-même. Car c’est aussi une loi de la raison qu’entre deux maux il faut choisir le moindre, et par conséquent nous pouvons conclure qu’en aucune rencontre un citoyen qui agit selon l’ordre de l’État ne fait rien qui soit contraire aux prescriptions de sa raison, et c’est ce que tout le monde nous accordera, quand nous aurons expliqué jusqu’où s’étend la puissance et partant le droit de l’État."
"On peut en effet nous dire : est-ce que l’état social et l’obéissance qu’il requiert de la part des sujets ne détruisent pas la religion qui nous oblige par rapport à Dieu ? A quoi je réponds que si nous pesons bien la chose, tout scrupule disparaîtra. En effet, l’âme, en tant qu’elle use de la raison, n’appartient pas aux pouvoirs souverains, mais elle s’appartient à elle-même. Par conséquent, la vraie connaissance et l’amour de Dieu ne peuvent être sous l’empire de qui que ce soit, pas plus que la charité envers le prochain; et si nous considérons, en outre, que le véritable ouvrage de la charité, c’est de procurer le maintien de la paix et l’établissement de la concorde, nous ne douterons pas que celui-là n’accomplisse véritablement son devoir qui porte secours à chacun dans la mesure compatible avec les droits de l’État, c’est-à-dire avec la concorde et la tranquillité. Pour ce qui est des cultes extérieurs, il est certain qu’ils ne peuvent être ni un secours, ni un obstacle à la vraie connaissance de Dieu et à l’amour qui en résulte nécessairement ; d’où il suit qu’il ne faut pas y attacher assez d’importance pour compromettre à cause d’eux la paix et la tranquillité publiques. Il est certain, du reste, que moi, simple particulier, je ne suis pas, en vertu du droit naturel, c’est-à-dire en vertu du décret divin, je ne suis pas, dis-je, le défenseur de la religion ; car je n’ai point, comme l’avaient autrefois les disciples du Christ, le pouvoir de chasser les esprits immondes et de faire des miracles ; or ce pouvoir est tellement nécessaire pour propager la religion aux lieux où elle est interdite, que sans lui non-seulement l’huile et la peine, comme on dit, sont perdues, mais encore on s’expose à être molesté de mille façons, ce dont tous les siècles ont vu les exemples les plus funestes. Tout homme donc, en quelque lieu qu’il soit, peut s’acquitter envers Dieu des obligations de la religion vraie et veiller à faire son propre salut, ce qui est le devoir d’un particulier. Quant au soin de propager la religion, cela regarde Dieu lui-même ou les pouvoirs souverains, seuls chargés des intérêts de la chose publique...."
"Mais il y a ici une question qu’on a coutume de poser : le souverain est-il soumis aux lois ? peut-il pécher ?
Je réponds que les mots de loi et de péché n’ayant point seulement rapport à la condition sociale, mais aussi aux règles communes qui gouvernent toutes les choses naturelles et particulièrement aux règles de la raison, on ne peut pas dire d’une manière absolue que l’État ne soit astreint à aucune loi et qu’il ne puisse pas pécher. Si, en effet, l’État n’était astreint à aucune loi, à aucune règle, pas même à celles sans lesquelles l’État cesserait d’être l’État, alors l’État dont nous parlons ne serait plus une réalité, mais une chimère. L’État pèche donc quand il fait ou quand il souffre des actes qui peuvent être cause de sa ruine, et, dans ce cas, en disant qu’il pèche, nous parlons dans le même sens où les philosophes et les médecins disent que la nature pèche ; d’où il suit qu’on peut dire à ce point de vue que l’État pèche quand il agit contre les règles de la raison. Nous savons, en effet que l’État est d’autant plus son maître qu’il agit davantage selon la raison ; lors donc qu’il agit contre la raison, il se manque à lui-même, il pèche. Et tout cela pourra être mieux compris, si nous considérons que lorsqu’il est dit que chacun peut faire d’une chose qui lui appartient tout ce qu’il veut, ce pouvoir doit être défini, non par la seule puissance de l’agent, mais encore par l’aptitude du patient lui-même. Quand j’affirme, par exemple, que j’ai le droit de faire de cette table tout ce que je veux, assurément je n’entends pas que j’aie le droit de faire que cette table se mette à brouter l’herbe. De même donc, bien que nous disions que les hommes dans l’ordre social ne s’appartiennent pas à eux-mêmes, mais appartiennent à l’État, nous n’entendons pas pour cela que les hommes perdent la nature humaine et en prennent une autre, ni par conséquent que l’État ait le droit de faire que les hommes aient des ailes, ou, ce qui est la même chose, qu’ils voient avec respect ce qui excite leur risée ou leur dégoût ; mais nous entendons qu’il existe un ensemble de circonstances, lesquelles étant posées, il en résulte pour les hommes des sentiments de respect et de crainte à l’égard de l’État ; lesquelles au contraire étant supprimées, la crainte et le respect s’évanouissent et l’État lui-même n’est plus. Par conséquent, l’État, pour s’appartenir à lui-même, est tenu de conserver les causes de crainte et de respect ; autrement il cesse d’être l’État. Car que le chef de l’État coure, ivre et nu, avec des prostituées, à travers les places publiques, qu’il fasse l’histrion, ou qu’il méprise ouvertement les lois que lui-même a établies, il est aussi impossible que, faisant tout cela, il conserve la majesté du pouvoir, qu’il est impossible d’être en même temps et de ne pas être. Ajoutez que faire mourir, spolier les citoyens, ravir les vierges et autres actions semblables, tout cela change la crainte en indignation et par conséquent l’état social en état d’hostilité...."
Puisque l'être humain s’appartient d’autant plus à lui-même qu’il est plus gouverné par la raison, et en conséquence que l’Etat le plus puissant et qui s’appartient le plus à lui-même, c’est celui qui est fondé et dirigé par la raison, on vient à évoquer, après avoir traiter du droit de l'Etat en général, du meilleur usage possible de ce pouvoir et donc du meilleur gouvernement, parmi ceux relevant de la monarchie, de l'aristocratie ou de la démocratie. Le meilleur des Etats est celui où les êtres humains vivent en accord mutuel et qui garantit le plus la paix et la sécurité de l'existence. "Lors donc que je dis que le meilleur gouvernement est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde, j’entends par là une vie humaine, une vie qui ne se définit point par la circulation du sang et autres fonctions communes à tous les animaux, mais avant tout par la véritable vie de l’âme, par la raison et la vertu." Ainsi, si "la condition d’un État se détermine aisément par son rapport avec la fin générale de l’État qui est la paix et la sécurité de la vie", "le meilleur État, c’est celui où les hommes passent leur vie dans la concorde et où leurs droits ne reçoivent aucune atteinte" : "si tout cela se fait par une assemblée sortie de la masse du peuple, l’État s’appelle démocratie ; si c’est par quelques hommes choisis, l’État s’appelle aristocratie ; par un seul enfin, monarchie." Spinoza traite ainsi de la Monarchie, de l'Aristocratie, et ne terminera pas le chapitre consacré à la Démocratie....
"C’est l’opinion commune des philosophes que les passions dont la vie humaine est tourmentée sont des espèces de vices où nous tombons par notre faute, et voilà pourquoi on en rit, on en pleure, on les censure à l’envi ; quelques-uns même affectent de les haïr, afin de paraître plus saints que les autres. Aussi bien ils croient avoir fait une chose divine et atteint le comble de la sagesse, quand ils ont appris à célébrer en mille façons une prétendue nature humaine qui n’existe nulle part et à dénigrer celle qui existe réellement. Car ils voient les hommes, non tels qu’ils sont, mais tels qu’ils voudraient qu’ils fussent. D’où il est arrivé qu’au lieu d’une morale, le plus souvent ils ont fait une satire, et n’ont jamais conçu une politique qui pût être réduite en pratique, mais plutôt une chimère bonne à être appliquée au pays d’Utopie ou du temps de cet âge d’or pour qui l’art des politiques était assurément très-superflu. On en est donc venu à croire qu’entre toutes les sciences susceptibles d’application la politique est celle où la théorie diffère le plus de la pratique, et que nulle sorte d’hommes n’est moins propre au gouvernement de l’État que les théoriciens ou les philosophes.
1-2
Tout au contraire, les politiques passent pour plus occupés à tendre aux hommes des embûches qu’à veiller à leurs intérêts, et leur principal titre d’honneur, ce n’est pas la sagesse, mais l’habileté. Ils ont appris à l’école des faits qu’il y aura des vices tant qu’il y aura des hommes. Or, tandis qu’ils s’efforcent de prévenir la malice humaine à l’aide des moyens artificiels depuis longtemps indiqués par l’expérience et dont se servent d’ordinaire les hommes que la crainte gouverne plutôt que la raison, ils ont l’air de rompre en visière à la religion, surtout aux théologiens, lesquels s’imaginent que les souverains doivent traiter les affaires publiques selon les mêmes règles de piété qui obligent un particulier. Mais cela n’empêche pas que cette sorte d’écrivains n’aient mieux réussi que les philosophes à traiter les matières politiques, et la raison en est simple, c’est qu’ayant pris l’expérience pour guide, ils n’ont rien dit qui fût trop éloigné de la pratique.
1-3
Et certes, quant à moi, je suis très-convaincu que l’expérience a déjà indiqué toutes les formes d’État capables de faire vivre les hommes en bon accord et tous les moyens propres à diriger la multitude ou à la contenir en certaines limites ; aussi je ne regarde pas comme possible de trouver par la force de la pensée une combinaison politique, j’entends quelque chose d’applicable, qui n’ait déjà été trouvée et expérimentée. Les hommes, en effet, sont ainsi organisés qu’ils ne peuvent vivre en dehors d’un certain droit commun ; or la question des droits communs et des affaires publiques a été traitée par des hommes très-rusés, ou très-habiles, comme on voudra, mais à coup sûr très-pénétrants, et par conséquent il est à peine croyable qu’on puisse concevoir quelque combinaison vraiment pratique et utile qui n’ait pas été déjà suggérée par l’occasion ou le hasard, et qui soit restée inconnue à des hommes attentifs aux affaires publiques et à leur propre sécurité.
1-4
Lors donc que j’ai résolu d’appliquer mon esprit à la politique, mon dessein n’a pas été de rien découvrir de nouveau ni d’extraordinaire, mais seulement de démontrer par des raisons certaines et indubitables ou, en d’autres termes, de déduire de la condition même du genre humain un certain nombre de principes parfaitement d’accord avec l’expérience ; et pour porter dans cet ordre de recherches la même liberté d’esprit dont on use en mathématiques, je me suis soigneusement abstenu de tourner en dérision les actions humaines, de les prendre en pitié ou en haine ; je n’ai voulu que les comprendre. En face des passions, telles que l’amour, la haine, la colère, l’envie, la vanité, la miséricorde, et autres mouvements de l’âme, j’y ai vu non des vices, mais des propriétés, qui dépendent de la nature humaine, comme dépendent de la nature de l’air le chaud, le froid, les tempêtes, le tonnerre, et autres phénomènes de cette espèce, lesquels sont nécessaires, quoique incommodes, et se produisent en vertu de causes déterminées par lesquelles nous nous efforçons de les comprendre. Et notre âme, en contemplant ces mouvements intérieurs, éprouve autant de joie qu’au spectacle des phénomènes qui charment les sens.
1-5
Il est en effet certain (et nous l’avons reconnu pour vrai dans notre Éthique[2]) que les hommes sont nécessairement sujets aux passions, et que leur nature est ainsi faite qu’ils doivent éprouver de la pitié pour les malheureux et de l’envie pour les heureux, incliner vers la vengeance plus que vers la miséricorde ; enfin chacun ne peut s’empêcher de désirer que ses semblables vivent à sa guise, approuvent ce qui lui agrée et repoussent ce qui lui déplaît. D’où il arrive que tous désirant être les premiers, une lutte s’engage, on cherche à s’opprimer réciproquement, et le vainqueur est plus glorieux du tort fait à autrui que de l’avantage recueilli pour soi. Et quoique tous soient persuadés que la religion nous enseigne au contraire à aimer son prochain comme soi-même, par conséquent à défendre le bien d’autrui comme le sien propre, j’ai fait voir que cette persuasion a peu d’empire sur les passions. Elle reprend, il est vrai, son influence à l’article de la mort, alors que la maladie a dompté jusqu’aux passions mêmes et que l’homme gît languissant, ou encore dans les temples, parce qu’on n’y pense plus au commerce et au gain ; mais au forum et à la cour, où cette influence serait surtout nécessaire, elle ne se fait plus sentir. J’ai également montré que, si la raison peut beaucoup pour réprimer et modérer les passions, la voie qu’elle montre à l’homme est des plus ardues[3], en sorte que, s’imaginer qu’on amènera la multitude ou ceux qui sont engagés dans les luttes de la vie publique à régler leur conduite sur les seuls préceptes de la raison, c’est rêver l’âge d’or et se payer de chimères.
1-6
L’État sera donc très-peu stable, lorsque son salut dépendra de l’honnêteté d’un individu et que les affaires ne pourront y être bien conduites qu’à condition d’être dans des mains honnêtes. Pour qu’il puisse durer, il faut que les affaires publiques y soient ordonnées de telle sorte que ceux qui les manient, soit que la raison, soit que la passion les fasse agir, ne puissent être tentés d’être de mauvaise foi et de mal faire. Car peu importe, quant à la sécurité de l’État, que ce soit par tel ou tel motif que les gouvernants administrent bien les affaires, pourvu que les affaires soient bien administrées. La liberté ou la force de l’âme est la vertu des particuliers ; mais la vertu de l’État, c’est la sécurité.
1-7
Enfin, comme les hommes, barbares ou civilisés, s’unissent partout entre eux et forment une certaine société civile, il s’ensuit que ce n’est point aux maximes de la raison qu’il faut demander les principes et les fondements naturels de l’État, mais qu’il faut les déduire de la nature et de la condition commune de l’humanité ; et c’est ce que j’ai entrepris de faire au chapitre suivant...."

Dans la retraite, cependant, où Spinoza cherchait à se faire oublier en évitant tout ce qui eût pu aliéner ou compromettre son indépendance, beaucoup venaient le trouver en secret. Leibniz lui rendit visite. Saint-Evremond, qui, depuis le procès du surintendant Fouquet, à la fin de 1661, partageait son temps entre la Hollande et l'Angleterre, vint le voir en sa petite maison de Stelle Veerkade, à La Haye, lors des missions qu'il y accomplit de 1666 à 1670, puis au début de 1672, et l'on peut conjecturer sans chance d'erreur que c'est par son intermédiaire que le nom et la doctrine du philosophe hollandais furent révélés aux libertins de France. A la fin de juillet 1673, le grand Condé, alors le prince des libertins, retenu à Utrecht par une crise de goutte, demanda à voir Spinoza et, par l'entremise de Saint-Evremond, il put, semble-t-il, s'entretenir avec celui en qui les libertins voyaient un anti-Pascal. De ces entretiens, le colonel Stouppe, familier du grand Condé, nous a laissé un curieux écho dans son pamphlet sur "La religion des Hollandais" (1673), dont Condé faisait sa lecture, ainsi que des "livres rares" des Arminiens et des Sociniens que Stouppe lui faisait parvenir à Chantilly peu de temps encore avant la conversion d'avril 1685 célébrée par Bossuet. Ainsi se préparait dès le XVIIe siècle la "philosophie" du XVIIIe, dont Spinoza sera le dieu, et dont Saint-Evremond aura été le prophète (Jacques Chevalier, in extenso)...
Cependant, ainsi que nous l'apprennent ses biographes, Spinoza, outre qu'il n'était pas de complexion fort robuste, avait été affaibli par sa trop grande application à l'étude; ses veilles étaient devenues presque continuelles, par la malignité d'une fièvre lente qu'il avait contractée à la suite de ses ardentes méditations, si bien qu'après avoir langui durant les dernières années de sa vie, il la finit au milieu de sa course. Miné par la phtisie dont il était atteint depuis des années, en dépit des ménagements, du repos et de la sobriété dont il s'était fait une règle, Spinoza voyait venir la mort, sans cesser de se conformer à son précepte "que la philosophie n'est pas la méditation de la mort, mais de la vie" (Eth. V, 67), et que notre devoir est de bannir en tout la tristesse. Il mourut le 21 février 1677....
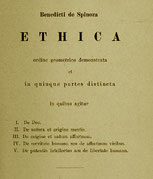
1661-1675 - "Ethique", démontrée suivant l'ordre géométrique
Rédigé entre 1661 et 1675, cet ouvrage central de la philosophie spinoziste se présente sous la forme d'un système mathématique, - tant l'hégémonie des mathématiques est une réalité en ce XVIIe siècle - , puisque présenté ordine geometrco, avec définitions, axiomes, postulats et propositions démontrées qui s'en déduisent. Spinoza y traite du vrai Dieu, être absolu et infini, mais aussi de la sagesse humaine, liée au désir de la joie, à la connaissance véritable et à l'amour intellectuel de Dieu, apportant la béatitude. Mais le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu traditionnel, celui d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob, que l'on retrouve chez Pascal, mais le Dieu des philosophes et des savants, un Dieu qui ne se révèle pas via des prophètes, des mots et des images, mais d'esprit à esprit : "m'accusez-vous d'arrogance et d'orgueil parce que j'use de ma raison et me repose en ce véritable Verbe de Dieu qui est dans l'âme et ne peut jamais être altéré ni corrompu" (Ep.76). La nécessité et le déterminisme dominent la démarche du philosophe dont le dessein est de nous amener au salut et à la béatitude par l'acceptation rationnelle de la nécessité de la Nature, c'est-à-dire par l'amour intellectuel de Dieu (ou la Nature), substance éternelle et infinie, dont tout découle nécessairement. "Il s'en faut que mon opinion sur la nécessité des choses ne puisse être entendue sans les démonstrations de l'Ethique; celles-ci, au contraire, ne peuvent être entendues que si cette opinion a été préalablement comprise" (lettre à G.de Blyenbergh, 3 juin 1665). La seule véritable caractéristique de l'être humain est d'être une partie de l'entendement fini de Dieu, et il peut espérer, s'il a reçu de la Nature les capacités nécessaires, atteindre la béatitude par l'usage de sa raison. La liberté qui ici envisagée est celle de la fusion avec la totalité...
Le premier livre, "De Dieu", vise donc à déduire de Dieu l'univers en l'identifiant à lui, comme la Nature naturée à la Nature naturante. Il part de la définition de la substance, cause de soi et de celle de Dieu, cette unique substance, et prouve l'existence de Dieu, qui existe nécessairement (Première partie). La mathématisation de l'univers et du discours sur l'univers permet de concevoir un monde d'une unité parfaite, fermé sur lui-même et explicable de bout en bout, mais faut-il encore rapprocher ce monde de la matière du monde de la pensée humaine, lui aussi mathématiquement explicable par ses lois propres. Ces deux mondes isolés, étendue et pensée, auquel aboutit le cartésianisme, n'est pas celui de Spinoza qui, en plongeant Dieu dans l'univers, fusionne ces deux mondes comme deux attributs de l'infinité de Dieu. Toute pensée particulière est une idée et non une perception, car elle n'est pas produite par les corps, mais par la pensée universelle, par Dieu...
La Première partie de l'Éthique est donc consacrée à l'idée de Dieu, idée première et parfaite ("J'entends par Dieu un être absolument c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie") , elle commence par une série de définitions, en particulier, celles de la cause de soi, de la substance, de l'attribut, du mode et de Dieu, suivent sept axiomes puis trente et une propositions qui convergent vers la proposition XI qui affirme l'existence nécessaire d'un Dieu unique.
Proposition XI
"Dieu, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie, existe nécessairement.
Démonstration : Si vous niez Dieu, concevez, s'il est possible, que Dieu n'existe pas. Son essence n'envelopperait donc pas l'existence (par l'axiome 7). Mais cela est absurde (par la proposition 7). Donc Dieu existe nécessairement. C.Q.F.D.
Autre Démonstration : Pour toute chose, on doit pouvoir assigner une cause ou raison qui explique pourquoi elle existe ou pourquoi elle n'existe pas. Par exemple, si un triangle existe, il faut qu'il y ait une raison, une cause de son existence. S'il n'existe pas, il faut encore qu'il y ait une raison, une cause qui s'oppose à son existence, ou qui la détruise. Or, cette cause ou raison doit se trouver dans la nature de la chose, ou hors d'elle. Par exemple, la raison pour laquelle un cercle carré n'existe pas est contenue dans la nature même d'une telle chose, puisqu'elle implique contradiction. Et de même, si la substance existe, c'est que cela résulte de sa seule nature, laquelle enveloppe l'existence (voyez la proposition 7). Au contraire, la raison de l'existence ou de la non-existence d'un cercle ou d'un triangle n'est pas dans la nature de ces objets, mais dans l'ordre de la nature corporelle tout entière ; car il doit résulter de cet ordre, ou bien que déjà le triangle existe nécessairement, ou bien qu'il est impossible qu'il existe encore. Ces principes sont évidents d'eux-mêmes. Or, voici ce qu'on en peut conclure : c'est qu'une chose existe nécessairement quand il n'y a aucune cause ou raison qui l'empêche d'exister. Si donc il est impossible d'assigner une cause ou raison qui s'oppose à l'existence de Dieu ou qui la détruise, il faut dire que Dieu existe nécessairement. Or, pour qu'une telle cause ou raison fût possible, il faudrait qu'elle se rencontrât soit dans la nature divine, soit hors d'elle, c'est-à-dire dans une autre substance de nature différente ; car l'imaginer dans une substance de même nature, ce serait accorder l'existence de Dieu. Maintenant, si vous supposez une substance d'une autre nature que Dieu, n'ayant rien de commun avec lui, elle ne pourra (par la proposition 2) être cause de son existence ni la détruire. Puis donc qu'on ne peut trouver hors de la nature divine une cause ou raison qui l'empêche d'exister, cette cause ou raison doit donc être cherchée dans la nature divine elle-même, laquelle, dans cette hypothèse, devrait impliquer contradiction. Mais il est absurde d'imaginer une contradiction dans l'être absolument infini et souverainement parfait. Concluons donc qu'en Dieu ni hors de Dieu il n'y a aucune cause ou raison qui détruise son existence, et partant que Dieu existe nécessairement.
Autre Démonstration :
Pouvoir ne pas exister, c'est évidemment une impuissance ; et c'est une puissance, au contraire, que de pouvoir exister. Si donc l'ensemble des choses qui ont déjà nécessairement l'existence ne comprend que des êtres finis, il s'ensuit que des êtres finis sont plus puissants que l'être absolument infini, ce qui est de soi parfaitement absurde. Il faut donc, de deux choses l'une, ou qu'il n'existe rien, ou, s'il existe quelque chose, que l'être absolument infini existe aussi. Or nous existons, nous, ou bien en nous-mêmes, ou bien en un autre être qui existe nécessairement (voir l'axiome 4 et la proposition 7). Donc l'être absolument infini, en d'autres termes (par la définition 6) Dieu existe nécessairement. C.Q.F.D.
Scolie de la proposition 11
Dans cette dernière démonstration, j'ai voulu établir l'existence de Dieu a posteriori, afin de rendre la chose plus facilement concevable ; mais ce n'est pas à dire pour cela que l'existence de Dieu ne découle a priori du principe même qui a été posé. Car, puisque c'est une puissance que de pouvoir exister, il s'ensuit qu'à mesure qu'une réalité plus grande convient à la nature d'une chose, elle a de soi d'autant plus de force pour exister ; et par conséquent, l'Etre absolument infini ou Dieu a de soi une puissance infinie d'exister, c'est-à-dire existe absolument. Et toutefois plusieurs peut-être ne reconnaîtront pas aisément l'évidence de cette démonstration, parce qu'ils sont habitués à contempler exclusivement cet ordre de choses qui découlent de causes extérieures, et à voir facilement périr ce qui naît vite, c'est-à-dire ce qui existe facilement, tandis qu'au contraire ils pensent que les choses dont la nature est plus complexe doivent être plus difficiles à faire, c'est-à-dire moins disposées à l'existence. Mais pour détruire ces préjugés, je ne crois pas avoir besoin de montrer ici en quel sens est vraie la maxime : Ce qui naît aisément périt de même, ni d'examiner s'il n'est pas vrai qu'à considérer la nature entière, toutes choses existent avec une égale facilité. Il me suffit de faire remarquer que je ne parle pas ici des choses qui naissent de causes extérieures, mais des seules substances, lesquelles (par la proposition 6) ne peuvent être produites par aucune cause de ce genre. Les choses, en effet, qui naissent des causes extérieures, soit qu'elles se composent d'un grand nombre ou d'un petit nombre de parties, doivent tout ce qu'elles ont de perfection ou de réalité à la vertu de la cause qui les produit, et par conséquent leur existence dérive de la perfection de cette cause, et non de la leur. Au contraire, tout ce qu'une substance à de perfection, elle ne le doit à aucune cause étrangère, et c'est pourquoi son existence doit aussi découler de sa seule nature et n'être autre chose que son essence elle-même. Ainsi donc la perfection n'ôte pas l'existence, elle la fonde ; c'est l'imperfection qui la détruit, et il n'y a pas d'existence dont nous puissions être plus certains que de celle d'un être absolument infini ou parfait, savoir, Dieu ; car son essence excluant toute imperfection et enveloppant la perfection absolue, toute espèce de doute sur son existence disparaît, et il suffit de quelque attention pour reconnaître que la certitude qu'on en possède est la plus haute certitude.
En dehors de Dieu, il n'y a rien, comme l'affirme la proposition XIV : nulle substance en dehors de Dieu ne peut être donnée ni conçue. Proposition XV : "Tout ce qui est, est en Dieu, et rien ne peut être, ni être conçu sans Dieu". Dans les Propositions XVI à XVIII sont abordées la puissance et la causalité divine, Dieu est cause immanente au monde, il n'est pas cause transitive, c'est-à-dire extérieure à son effet. Ce qui signifie que le monde contient en lui-même la cause des effets divins. La Proposition XIX établit l'éternité de Dieu, ce qui a pour conséquence que la contingence, liée à notre ignorance, est éliminée de notre monde : "Il n'est rien donné de contingent dans la nature, mais tout y est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à produire quelque effet d'une certaine manière." Les dernières propositions s'attachent à la conséquence de cette nécessité sur l'entendement et à la volonté pris en eux-mêmes.
Dans la Seconde partie, "De la nature et de l'origine de l'âme", Spinoza étudie la nature et l'origine de l'âme, traite des relations de l'âme et du corps ("Nous avons montré que l'idée du Corps et le Corps, c'est-à-dire l'Âme et le Corps, sont un seul et même individu qui est conçu tantôt sous l'attribut de la Pensée, tantôt sous celui de l'Etendue") et de la théorie de la connaissance. Elle aussi débute par un ensemble de définitions et d'axiomes. Dans les propositions XXVII à XXXV, Spinoza va s'attacher à définir les idées inadéquates et l'erreur, ) des propositions XXXVI à XLIX, traiter de la pensée rationnelle discursive, procédant par entendement et se rapportant au système d'idées adéquates, ayant toutes les propriétés de l'idée vraie. Dans le scolie II de la proposition XL, Spinoza distingue les trois genres de connaissance, par imagination, idées adéquates et intuition prenant pour objet la substance divine. Enfin, dans les propositions XLVIII et XLIX, Spinoza remet en question la conception classique de la volonté libre et voit en cette dernière une faculté identique à l'entendement. Prop. XLVIII : "Il n'y a point dans l'âme de volonté absolue ou libre ; mais l'âme est déterminée à vouloir ceci ou cela par une cause, qui elle-même est déterminée par une autre, et celle-ci encore par une autre, et ainsi à l'infini". Et pour conclure que la volonté et l'entendement sont une seule et même chose....
"Il ne me reste plus qu'à montrer combien la connaissance de cette théorie de l'âme humaine doit être utile pour la pratique de la vie. Il suffit pour cela des quelques observations que voici :
1° suivant cette théorie, nous n'agissons que par la volonté de Dieu, nous participons de la nature divine, et cette participation est d'autant plus grande que nos actions sont plus parfaites et que nous comprenons Dieu davantage ; or, une telle doctrine, outre qu'elle porte dans l'esprit une tranquillité parfaite, a cet avantage encore qu'elle nous apprend en quoi consiste notre souveraine félicité, savoir, dans la connaissance de Dieu, laquelle ne nous porte à accomplir d'autres actions que celles que nous conseillent l'amour et la piété. Par où il est aisé de comprendre combien s'abusent sur le véritable prix de la vertu ceux qui, ne voyant en elle que le plus haut degré de l'esclavage, attendent de Dieu de grandes récompenses pour salaire de leurs actions les plus excellentes ; comme si la vertu et l'esclavage en Dieu n'étaient pas la félicité même et la souveraine liberté.
2° Notre système enseigne aussi comment il faut se comporter à l'égard des choses de la fortune, je veux dire de celles qui ne sont pas en notre pouvoir, en d'autres termes, qui ne résultent pas de notre nature ; il nous apprend à attendre et à supporter d'une âme égale l'une et l'autre fortune ; toutes choses en effet résultent de l'éternel décret de Dieu avec une absolue nécessité, comme il résulte de l'essence d'un triangle que ses trois angles soient égaux en somme à deux droits.
3° Un autre point de vue sous lequel notre système est encore utile à la vie sociale, c'est qu'il apprend à être exempt de haine et de mépris, à n'avoir pour personne ni moquerie, ni envie, ni colère. Il apprend aussi à chacun à se contenter de ce qu'il a et à venir au secours des autres, non par une vaine pitié de femme par préférence, par superstition, mais par l'ordre seul de la raison, et en gardant l'exacte mesure que le temps et la chose même prescrivent.
4° Voici enfin un dernier avantage de notre système, et qui se rapporte à la société politique ; nous faisons profession de croire que l'objet du gouvernement n'est pas de rendre les citoyens esclaves, mais de leur faire accomplir librement les actions qui sont les meilleures."
Dans la Troisième partie, "De l'origine et de la nature des affections", ayant montré que Dieu est la totalité du réel et que l'être humain est un mode de cette Nature divine, Spinoza peut en venir aux passions humaines, qu'il explique à travers une sorte de « mécanique », comme s'il était question de surfaces et de solides : l'être humain ne fait que suivre les lois communes de la Nature. Spinoza va comprendre la diversité des affections humaines à partir des trois "affects " fondamentaux que sont le désir, la joie et la tristesse. Les objets extérieurs peuvent nous affecter de joie ou de tristesse. Mais d'autres affections ont aussi leur cause en nous-mêmes. Ainsi Spinoza décrit-il l'enchaînement des passions tristes : haine, envie, pitié, jalousie, honte, colère, vengeance, espoir, crainte. D'une manière générale, l'homme peut saisir son existence comme accroissement de l'être ou dévier vers un moindre être, d'où les passions tristes. Les propositions LVIII et LIX expriment ces affects soutenus par la joie, le dynamisme et l'activíté. C'est ici que nous voyons régresser les affects passifs mêlés de tristesse : apparaissent des joies et des désirs où l'âme conçoit sa puissance d'agir et se trouve joyeuse...
"Quand on lit la plupart des philosophes qui ont traité des affects et de la conduite des hommes, on dirait qu'il n'a pas été question pour eux de choses naturelles, réglées par les lois générales de l'univers, mais de choses placées hors du domaine de la nature. Ils ont l'air de considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un autre empire. A les en croire, l'homme trouble l'ordre de l'univers bien plus qu'il n'en fait partie ; il a sur ses actions un pouvoir absolu et ses déterminations ne relèvent que de lui-même. S'il s'agit d'expliquer l'impuissance et l'inconstance de l'homme, ils n'en trouvent point la cause dans la puissance de la nature universelle, mais dans je ne sais quel vice de la nature humaine ; de là ces plaintes sur notre condition, ces moqueries, ces mépris, et plus souvent encore cette haine contre les hommes ; de là vient aussi que le plus habile ou le plus éloquent à confondre l'impuissance de l'âme humaine passe pour un homme divin. Ce n'est pas à dire que des auteurs éminents (dont j'avoue que les travaux et la sagacité m'ont été très-utiles) n'aient écrit un grand nombre de belles choses sur la manière de bien vivre, et n'aient donné aux hommes des conseils pleins de prudence ; mais personne que je sache n'a déterminé la véritable nature des affects, le pouvoir qu'ils ont sur l'âme et celui dont l'âme dispose à son tour pour les modérer. Je sais que l'illustre Descartes, bien qu'il ait cru que l'âme a sur ses actions une puissance absolue, s'est attaché à expliquer les affects humains par leurs causes premières, et à montrer la voie par où l'âme peut arriver à un empire absolu sur ses affects ; mais, à mon avis du moins, ce grand esprit n'a réussi à autre chose qu'à montrer son extrême pénétration, et je me réserve de prouver cela quand il en sera temps.
Je reviens à ceux qui aiment mieux prendre en haine ou en dérision les affects et les actions des hommes que de les comprendre. Pour ceux-là, sans doute, c'est une chose très-surprenante que j'entreprenne de traiter des vices et des folies des hommes à la manière des géomètres, et que je veuille exposer, suivant une méthode rigoureuse et dans un ordre raisonnable, des choses contraires à la raison, des choses qu'ils déclarent à grands cris vaines, absurdes, dignes d'horreur. Mais qu'y faire ? cette méthode est la mienne. Rien n'arrive, selon moi, dans l'univers qu'on puisse attribuer à un vice de la nature. Car la nature est toujours la même ; partout elle est une, partout elle a même vertu et même puissance ; en d'autres termes, les lois et les règles de la nature, suivant lesquelles toutes choses naissent et se transforment, sont partout et toujours les mêmes, et en conséquence, on doit expliquer toutes choses, quelles qu'elles soient, par une seule et même méthode, je veux dire par les règles universelles de la nature.
Il suit de là que les affects, tels que la haine, la colère, l'envie, et autres de cette espèce, considérés en eux-mêmes, résultent de la nature des choses tout aussi nécessairement que les autres choses singulières ; et par conséquent, ils ont des causes déterminées qui servent à les expliquer ; ils ont des propriétés déterminées tout aussi dignes d'être connues que les propriétés de telle ou telle autre chose dont la connaissance a le privilège exclusif de nous charmer.
Je vais donc traiter de la nature des affects, de leur force, de la puissance dont l'âme dispose à leur égard, suivant la même méthode que j'ai précédemment appliquée à la connaissance de Dieu et de l'âme, et j'analyserai les actions et les appétits des hommes, comme s'il était question de lignes, de plans et de solides."
La partie III se termine avec les définitions des Affections, qui systématisent l'ensemble : la joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection et la tristesse, le passage à une moindre perfection. Etonnement, amour, haine, aversion, espoir, crainte, désespoir, commisération, envie, orgueil, repentir, etc., se trouvent strictement définis.
Dans la Quatrième partie, "De la servitude de l'homme", Spinoza examine la servitude de l'homme soumis aux passions. "J'appelle Servitude l'impuissance de l'homme à gouverner et réduire ses affections". Poussé par des causes extérieures dont il ne saisit pas la nature, il vit seulement au hasard, écrasé par des forces aveugles. La Préface définit cette servitude...
"Ce que j'appelle esclavage, c'est l'impuissance de l'homme à gouverner et à contenir ses affects. L'homme en effet, quand il est soumis à ses affects, ne se possède plus ; livré à la fortune, il en est dominé à ce point que tout en voyant le mieux il est souvent forcé de faire le pire. J'ai dessein d'exposer dans cette quatrième partie la cause de cet esclavage, et de dire aussi ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais dans les affects. Mais avant d'entrer en matière, il convient de dire quelques mots sur la perfection et l'imperfection, ainsi que sur le bien et le mal.
Celui qui après avoir résolu de faire un certain ouvrage est parvenu à l'accomplir, à le parfaire, dira que son ouvrage est parfait, et quiconque connaît ou croit connaître l'intention de l'auteur et l'objet qu'il se proposait dira exactement comme lui. Par exemple, si une personne vient à voir quelque construction (et je la suppose inachevée) et qu'elle sache que l'intention de l'architecte a été de bâtir une maison, elle dira que cette maison est imparfaite ; elle l'appellera parfaite, au contraire, aussitôt qu'elle reconnaîtra que l'ouvrage a été conduit jusqu'au point où il remplit la destination qu'on lui voulait donner. Admettez maintenant que cette personne ait devant les yeux un ouvrage tel qu'elle n'en a jamais vu de semblable et qu'elle ne connaisse pas l'intention de l'ouvrier ; elle ne pourra dire si cet ouvrage est achevé ou inachevé, parfait ou imparfait. Voilà quelle a été, à ce qu'il semble, la première signification de ces mots.
Mais quand les hommes ont commencé à se former des idées universelles, à concevoir des types divers de maisons, d'édifices, de tours, etc., et à mettre certains types au-dessus des autres, il est arrivé que chacun a donné à un ouvrage le nom de parfait, quand il lui a paru conforme à l'idée universelle qu'il s'était formée, et celui d'imparfait, au contraire, quand il ne lui a pas paru complètement conforme à l'exemplaire qu'il avait conçu ; et cela, bien que cet ouvrage fût aux yeux de l'auteur parfaitement accompli. Telle est, à n'en pas douter, la raison qui explique pourquoi l'on donne communément le nom de parfaites ou d'imparfaites aux choses de la nature, lesquelles ne sont pourtant pas l'ouvrage de la main des hommes. Car les hommes ont coutume de se former des idées universelles tant des choses de la nature que de celles de l'art, et ces idées deviennent pour eux comme les modèles des choses. Or, comme ils sont persuadés d'ailleurs que la nature ne fait rien que pour une certaine fin, ils s'imaginent qu'elle contemple ces modèles et les imite dans ses ouvrages. C'est pourquoi, quand ils voient un être se former dans la nature, qui ne cadre pas avec l'exemplaire idéal qu'ils ont conçu d'un être semblable, ils croient que la nature a été en défaut, qu'elle a manqué son ouvrage, qu'elle l'a laissé imparfait.
Nous voyons donc que l'habitude où sont les hommes de donner aux choses le nom de parfaites ou d'imparfaites est fondée sur un préjugé plutôt que sur une vraie connaissance de la nature. Nous avons montré, en effet, dans l'appendice de la première partie, que la nature n'agit jamais pour une fin. Cet être éternel et infini que nous nommons Dieu ou nature agit comme il existe, avec une égale nécessité. La nécessité qui le fait être est la même qui le fait agir (proposition 16, partie 1). La raison donc ou la cause par laquelle il agit, et par laquelle il existe, est donc une seule et même raison, une seule et même cause. Or, comme il n'existe pas à cause d'une certaine fin, ce n'est pas non plus pour une fin qu'il agit. Il est lui-même le principe de l'action comme il est celui de l'existence, et n'a rien à voir avec aucune fin. Cette espèce de cause, qu'on appelle finale, n'est rien autre chose que l'appétit humain, en tant qu'on le considère comme le principe ou la cause principale d'une certaine chose. Par exemple, quand nous disons que la cause finale d'une maison c'est de se loger, nous n'entendons rien de plus par là sinon que l'homme, s'étant représenté les avantages de la vie domestique, a eu le désir de bâtir une maison. Ainsi donc cette cause finale n'est rien de plus que le désir particulier qu'on vient de dire, lequel est vraiment la cause efficiente de la maison ; et cette cause est pour les hommes la cause première, parce qu'ils sont dans une ignorance commune des causes de leurs appétits. Ils ont bien conscience, en effet, comme je l'ai souvent répété, de leurs actions et de leurs désirs, mais ils ne connaissent pas les causes qui les déterminent à désirer telle ou telle chose.
Quant à cette pensée du vulgaire, que la nature est quelquefois en défaut, qu'elle manque son ouvrage et produit des choses imparfaites, je la mets au nombre de ces chimères dont j'ai traité dans l'appendice de la première partie. Ainsi donc la perfection et l'imperfection ne sont véritablement que des façons de penser, des notions que nous sommes accoutumés à nous faire en comparant les uns aux autres les individus d'une même espèce ou d'un même genre, et c'est pour cela que j'ai dit plus haut (définition 6, partie 2) que réalité et perfection étaient pour moi la même chose. Nous sommes habitués en effet à rapporter tous les individus de la nature à un seul genre, auquel on donne le nom de généralissime, savoir, la notion de l'être qui embrasse d'une manière absolue tous les individus de la nature. Quand donc nous rapportons les individus de la nature à ce genre unique, et qu'en les comparant les uns aux autres nous reconnaissons que ceux-ci ont plus d'entité ou de réalité que ceux-là, nous disons qu'ils ont plus de perfection ; et quand nous attribuons à certains individus quelque chose qui implique une négation, comme une limite, un terme, une certaine impuissance, etc., nous les appelons imparfaits, par cette seule raison qu'ils n'affectent pas notre âme de la même manière que ceux que nous nommons parfaits ; et ce n'est point à dire pour cela qu'il leur manque quelque chose qui soit compris dans leur nature, ou que la nature ait manqué son ouvrage. Rien en effet ne convient à la nature d'une chose que ce qui résulte nécessairement de la nature de sa cause efficiente, et tout ce qui résulte nécessairement de la nature d'une cause efficiente se produit nécessairement.
Le bien et le mal ne marquent non plus rien de positif dans les choses considérées en elles-mêmes, et ne sont autre chose que des façons de penser, ou des notions que nous formons par la comparaison des choses. Une seule et même chose en effet peut en même temps être bonne ou mauvaise ou même indifférente. La musique, par exemple, est bonne pour un mélancolique qui se lamente sur ses maux ; pour un sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Mais, bien qu'il en soit ainsi, ces mots de bien et de mal, nous devons les conserver. Désirant en effet nous former de l'homme une idée qui soit comme un modèle que nous puissions contempler, nous conserverons à ces mots le sens que nous venons de dire. J'entendrai donc par bien, dans la suite de ce traité, tout ce qui est pour nous un moyen certain d'approcher de plus en plus du modèle que nous nous formons de la nature humaine ; par mal, au contraire, ce qui nous empêche de l'atteindre. Et nous dirons que les hommes sont plus ou moins parfaits, plus ou moins imparfaits suivant qu'ils se rapprochent ou s'éloignent plus ou moins de ce même modèle.
Il est important de remarquer ici que quand je dis qu'une chose passe d'une moindre perfection à une perfection plus grande, ou réciproquement, je n'entends pas qu'elle passe d'une certaine essence, d'une certaine forme, à une autre (supposez, en effet, qu'un cheval devienne un homme ou un insecte : dans les deux cas, il est également détruit) ; j'entends par là que nous concevons la puissance d'agir de cette chose, en tant qu'elle est comprise dans sa nature, comme augmentée ou diminuée. Ainsi donc, en général, j'entendrai par perfection d'une chose sa réalité ; en d'autres termes, son essence en tant que cette chose existe et agit d'une manière déterminée. Car on ne peut pas dire d'une chose qu'elle soit plus parfaite qu'une autre parce qu'elle persévère pendant plus longtemps dans l'existence. La durée des choses, en effet, ne peut se déterminer d'après leur essence ; l'essence des choses n'enveloppe aucune durée fixe et déterminée ; mais chaque chose, qu'elle soit plus parfaite ou qu'elle le soit moins, tend à persévérer dans l'être avec la même force par laquelle elle a commencé d'exister ; de façon que sous ce point de vue toutes choses sont égales."
C'est enfin dans la Cinquième partie que Spinoza formule progressivement une sagesse. Tout nous conduit à cet homme libre, connaissant Dieu et l'universelle nécessité : il expérimente la béatitude, qui n'est pas la récompense de la vertu, mais cette vertu elle-même. A partir de la Proposition 65, "Entre deux biens, la raison nous fait choisir le plus grand ; et entre deux maux, le moindre", de la proposition 66, "La raison nous fera préférer un plus grand bien à venir à un moindre bien présent, et désirer un moindre mal présent qui est la cause d'un plus grand bien à venir", Spinoza montre que la raison peut faire ce que réalise la passion. Ce qui signifie que nous pouvons prendre la raison pour guide. D'où une description de l'homme libre, à partir de la proposition LXVII (67) :
"La chose du monde a laquelle un homme libre pense le moins, c'est la mort, et sa sagesse n'est point la méditation de la mort, mais de la vie.
Démonstration : L'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit suivant les seuls conseils de la raison, n'est point dirigé dans sa conduite par la peur de la mort (par la proposition 63, partie 4), mais il désire directement le bien (par le corollaire de la même proposition), en d'autres termes (par la proposition 24, partie 4), il désire agir, vivre, conserver son être d'après la règle de son intérêt propre ; et par conséquent, il n'est rien à quoi il pense moins qu'à la mort, et sa sagesse est la méditation de la vie. C.Q.F.D.
Proposition 68
Si les hommes naissaient libres, ils ne se formeraient aucune idée du bien ou du mal tant qu'ils garderaient cette liberté.
Démonstration : J'ai appelé libre celui qui se gouverne par la seule raison. Quiconque, par conséquent, naît libre et reste libre n'a d'autres idées que des idées adéquates, et partant il n'a aucune idée du mal (par le corollaire de la proposition 64, partie 4), ni du bien (puisque le bien et le mal sont choses corrélatives). C.Q.F.D.
Cet homme Libre, conduit par la raison (LXVIII) est plus libre dans la Cité où il vit selon le décret commun que dans la solitude (LXXIII).
"Proposition 73
L'homme qui se dirige d'après la raison est plus libre dans la cité où il vit sous la loi commune, que dans la solitude où il n'obéit qu'à lui-même.
Démonstration : L'homme qui se dirige d'après la raison n'obéit point à la loi par peur (par la proposition 63, partie 4), mais en tant qu'il s'efforce de conserver son être suivant la raison, c'est-à-dire (par le scolie de la proposition 66, partie 4) de vivre libre, il désire se conformer à la règle de la vie et de l'utilité communes (par la proposition 37, partie 4), et conséquemment (comme on l'a montré dans le scolie 2 de la proposition 37, partie 4), il désire vivre selon les lois communes de la cité. Ainsi donc l'homme qui se dirige d'après la raison désire, pour vivre plus libre, se conformer aux lois de la cité. C.Q.F.D.
Scolie de la proposition 73
Toutes ces qualités de l'homme libre que nous venons d'exposer se rapportent à la force d'âme, c'est-à-dire (par le scolie de la proposition 59, partie 3) au courage et à la générosité. Et je ne crois pas nécessaire d'expliquer l'une après l'autre toutes les propriétés de la force d'âme, bien moins encore de faire voir que l'homme fort n'a pour personne ni haine, ni colère, ni envie, ni indignation, ni mépris, et qu'il ne se laisse point exalter par l'orgueil. Car tout cela se déduit facilement des propositions 37 et 46, partie 4, ainsi que tout ce qui concerne la vie véritable et la religion. Je veux dire que la haine doit être vaincue par l'amour, et que tout homme que la raison conduit désire pour les autres ce qu'il désire pour soi-même. Ajoutez que l'homme fort, ainsi que nous l'avons remarqué déjà dans le scolie de la proposition 50, partie 4, et dans plusieurs autres endroits, médite sans cesse ce principe, que toutes choses résultent de la nécessité de la nature divine, et en conséquence, que tout ce qu'il juge mauvais et désagréable, tout ce qui lui semble impie, horrible, injuste et infâme, tout cela vient de ce qu'il conçoit les choses avec trouble et confusion, et par des idées mutilées ; et dans cette conviction, il s'efforce par-dessus tout de comprendre les choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, et d'écarter les obstacles qui nuisent à la vraie connaissance, comme la haine, la colère, l'envie, la moquerie, l'orgueil, et autres affects mauvais que nous avons expliqués plus haut. L'homme fort s'efforce donc, par cela même, autant qu'il est en lui, de bien agir et de vivre heureux. Mais jusqu'à quel point l'humaine vertu peut-elle atteindre ces avantages, et quelle est sa puissance ? c'est ce que j'expliquerai dans la partie suivante...."
La Préface montre à travers des exemples bien concrets combien la puissance humaine est très limitée, et combien la puissance des causes extérieures la surpasse infiniment. Il ne faut donc pas doter l'âme d'un libre arbitre imaginaire, et l'unique moyen de se libérer est la connaissance...
Cinquième et ultime partie, « De la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme", comment donc devenir un être libre et raisonnable, comment conduire cette libération qui mène du même coup, à la béatitude....
"Je passe enfin à cette partie de l'Éthique qui a pour objet de montrer la voie qui conduit à la liberté. J'y traiterai de la puissance de la raison, en expliquant quel est l'empire qu'elle peut exercer sur les affects ; je dirai ensuite en quoi consistent la liberté de l'âme et son bonheur ; on pourra mesurer alors la différence qui sépare le savant de l'ignorant. Quant à la manière de perfectionner son esprit et de gouverner son corps pour le rendre propre aux fonctions qu'il doit remplir, cela n'est pas de notre sujet, et rentre dans la médecine et dans la logique. Je ne traite ici, encore un coup, que de la puissance de l'âme ou de la raison, et avant tout, de la nature et de l'étendue de l'empire qu'elle exerce pour réprimer et gouverner nos affects.
Nous avons déjà démontré que cet empire n'est pas absolu. Les stoïciens ont voulu soutenir que nos affects dépendent entièrement de notre volonté, et que nous pouvons les gouverner avec une autorité sans bornes ; mais l'expérience les a contraints d'avouer, en dépit de leurs principes, qu'il ne faut pas peu de soins et d'habitude pour contenir et régler nos affects..."
Les propositions I à XX vont alors étudier les moyens de devenir un être libre et raisonnable. "Un affect qui est une passion cesse d'être une passion aussitôt que nous nous en formons une idée claire et distincte", énonce la proposition III, "Il n'y a pas d'affection du corps dont nous ne puissions former quelque concept clair et distinct", ajoute la proposition IV, "En tant que l'âme comprend toutes choses comme nécessaires, elle a sur ses affects une plus grande puissance : en d'autres termes, elle en pâtit moins", complète le proposition VI, "A mesure qu'une image est jointe à un plus grand nombre d'autres images, elle se réveille plus souvent dans notre âme", énonce la proposition 13, pour aboutir à cette proposition 20 par laquelle "Cet amour de Dieu ne peut être souillé par aucun affect d'envie ni de jalousie, et il est entretenu en nous avec d'autant plus de force que nous nous représentons un plus grand nombre d'hommes comme unis avec Dieu de ce même lien d'amour".
Les propositions XXI à XL nous entraîne sur le chemin de la connaissance intuitive où "Alors même que nous ne saurions pas que notre âme est éternelle, nous ne cesserions pas de considérer comme les premiers objets de la vie humaine la piété, la religion, en un mot, tout ce qui se rapporte, ainsi qu'on l'a montré dans la quatrième partie, à l'intrépidité et à la générosité de l'âme.". Tout culmine avec la Béatitude, XLI et XLII, "La béatitude n'est pas le prix de la vertu, c'est la vertu elle-même, et ce n'est point parce que nous contenons nos désirs charnels que nous la possédons, c'est parce que nous la possédons que nous sommes capables de contenir nos désirs charnels."
"Scolie de la proposition 42
J'ai épuisé tout ce que je m'étais proposé d'expliquer touchant la puissance de l'âme sur ses affects et la liberté de l'homme. Les principes que j'ai établis font voir clairement l'excellence du sage et sa supériorité sur l'ignorant qui est uniquement conduit par ses désirs charnels. Celui-ci, outre qu'il est agité en mille sens divers par les causes extérieures, et ne possède jamais la véritable paix de l'âme, vit dans l'oubli de soi-même, et de Dieu, et de toutes choses ; et pour lui, cesser de pâtir, c'est cesser d'être. Au contraire, l'âme du sage peut à peine être troublée. Possédant par une sorte de nécessité éternelle la conscience de soi-même et de Dieu et des choses, jamais il ne cesse d'être ; et la véritable paix de l'âme, il la possède pour toujours. La voie que j'ai montrée pour atteindre jusque-là paraîtra pénible sans doute, mais il suffit qu'il ne soit pas impossible de la trouver. Et certes, j'avoue qu'un but si rarement atteint doit être bien difficile à poursuivre ; car autrement, comment se pourrait-il faire, si le salut était si près de nous, s'il pouvait être atteint sans un grand labeur, qu'il fût ainsi négligé de tout le monde ? Mais tout ce qui est beau est aussi difficile que rare."
