- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino

Boom latinoamericano - Mario Vargas Llosa (1936, Per.), "La ciudad y los perros" (La Ville ret les chiens, 1963), "La casa verde" (1966), "Conversacion en la catédral" (1969), "La orgia perpetua" (1975), "La tia Julia y el escribidor" (1977), "La fiesta del chivo" (2000) - ...
Last update: 03/11/2017

L’année 1962 fut une année de référence non seulement dans l’histoire de la littérature hispano-américaine mais pour toute la littérature écrite de part ce monde : le Péruvien Mario Vargas Llosa était primé pour "La Ville et les Chiens", le Mexicain Carlos Fuentes publiait "La mort d’Artemio Cruz", le Cubain "Alejo Carpentier" faisait paraître son chef d’œuvre, "Le Siècle des Lumières". Comment expliquer cette soudaine maturation littéraire qui s’exprime par la publication d’œuvres résolument modernes et capables de plus de trouver un nouveau public. Et l'on peut continuer, autant d'oeuvres déjà évoquées ici même, "Marelle" de l’Argentin Julio Cortazar, "Cent ans de solitude" du Colombien Gabriel Garcia Marquez, "Trois tristes tigres" du Cubain Guillermo Cabrera Infante, "Ramasse-Vioques" de l’Uruguayen Juan Carlos Onetti, "Paradiso" du Cubain José Lezama Lima, "Héros et tombes" de l’Argentin Ernesto Sabato, "Ce lieu sans limites" du Chilien José Donoso, "La trahison de Rita Hayworth" de l’Argentin Manuel Puig. Ils n'appartiennent pas tous à une même génération, ils n’empruntent pas tous les mêmes voies, malgré des convergences occasionnelles, deux d’entre eux recevront le prix Nobel de littératurel, Garcia Marquez et Vargas Llosa....
Et parmi leurs prédécesseurs, le Mexicain Juan Rulfo, précurseur du « réalisme magique », avait déjà cessé d’écrire et l’Argentin Jorge Luis Borges sa réputation internationale. On ne le répètera jamais assez, les littératures hispano-américaines ne peuvent être décrites comme une simple juxtaposition de littératures, voire de cultures, propres à chacune des nations qui forment l'Amérique hispanique. Il y a fondamentalement une même "nature" latino-américaine, ..
Ainsi Mario Vargas Llosa qui dans ses livres (La ciudad y los perros, 1963; La casa verde, 1966; Conversacion en la catédral, 1969) entend dénoncer par la fiction le triomphe de la corruption au Pérou et la résignation à la survie au jour le jour des non-possédants, mais plus encore ne cesse de s'interroger tout au long de son oeuvre romanesque : à quelle époque
a commencé la décadence du Pérou ? Est-elle récente, due aux exactions d'un gouvernement qui a pourri toute la structure sociale du pays ? Ou bien est-elle lointaine, et vient-elle de l'être humain lui-même dont toutes les idéologies sont discutables tant il est médiocre et ne peut donc vivre que résigné ? Un raisonnement, des interrogations que l'on peut tenir pour l'ensemble de l'Amérique latine, mais au fond, peut-être pas que ...
David Alfaro Siqueiros - Nuestra imagen actual (1947, Museo de Arte Moderno, México)


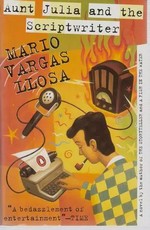


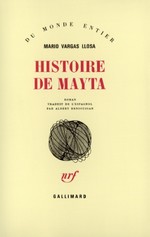

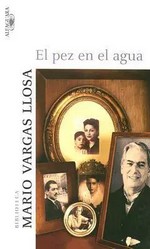
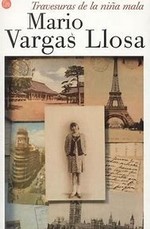






Mario Vargas Llosa (1936) et Jorge Luis Borges (1899) sont deux géants de la littérature latino-américaine, mais leurs visions politiques, esthétiques et philosophiques ont souvent été opposées. Ils se sont croisés à plusieurs reprises dans les années 1960-70, notamment à des conférences. Borges, alors presque aveugle et âgé, dialoguait avec un Vargas Llosa jeune et fougueux – un symbole de la transmission littéraire malgré leurs divergences...
Borges appartenait à la génération des avant-gardes du début du XXᵉ siècle (surréalisme, ultraïsme). Vargas Llosa a émergé dans les années 1960 avec le Boom latino-américain (aux côtés de García Márquez, Cortázar, etc.). Vargas Llosa a découvert Borges adolescent et l'a d'abord admiré avant de s'en distancier politiquement. Borges, déjà une légende vivante quand Vargas Llosa publie ses premiers romans, voyait en lui un "jeune talent" sans partager ses engagements.
Borges a vécu les deux guerres mondiales, le péronisme, et la dictature argentine, et se révèlera un conservateur sceptique, méfiant envers les idéologies et les masses. Il a critiqué le péronisme (ce qui lui a valu des ennuis sous son régime), mais aussi le communisme. La posture aristocratique et littéraire lui sied mieux que celle du politique. Il a qualifié la démocratie de "superstition" et voyait le monde comme un jeu intellectuel ...
Vargas Llosa fut marqué par la Guerre froide, les révolutions cubaines et les dictatures des années 1970-80. Libéral convaincu, défenseur de la démocratie et critique des régimes autoritaires (de gauche comme de droite), il a soutenu des positions anti-castristes et anti-peronistes, s'est présenté à la présidence du Pérou en 1990. Admirateur précoce de la Révolution cubaine, il a ensuite viré vers le libéralisme économique (influence de penseurs comme Hayek).
En littérature, Vargas Llosa est un romancier social, influencé par Flaubert et Faulkner, mêlant critique politique et analyse psychologique (La ville et les chiens, La guerre de la fin du monde). Il croyait au roman comme outil de compréhension du réel.
Borges est un écrivain minimaliste, préférant les contes philosophiques aux grands récits (Fictions, L'Aleph). Fasciné par les labyrinthes, les miroirs, les univers parallèles, sa littérature est déconnectée du réalisme social.
Malgré leurs différences, ils se sont mutuellement admirés sur le plan littéraire : Vargas Llosa a reconnu l'influence de Borges sur sa prose (notamment dans La vérité par le mensonge). Et Borges appréciait l'érudition de Vargas Llosa, bien qu'il dédaignât son engagement politique.
Dans les années 1960-70, ils ont débattu de littérature lors de conférences. Borges moquait le "réalisme balzacien" de Vargas Llosa, qui lui répondait que la littérature devait "affronter la boue du monde"....

Mario Vargas Llosa (1936)
"El género novelesco no ha nacido para contar verdades, éstas, al pasar a la ficción, se vuelven siempre mentiras" (Le genre romanesque n’est pas né
pour raconter des vérités, celles-ci, en passant à la fiction, deviennent toujours des mensonges) - Natif d'Arequipa, au sud du Pérou, Mario Vargas Llosa vit une enfance et une jeunesse aussi
lourdes familialement (marquée notamment par la mésentente avec un père violent et le collège militaire de Leoncio Prado) que socialement (le général Manuel Odria exerce une dictature étouffante
entre 1948 et 1956), suit des études littéraires dans la vieille université de San Marcos, à Lima. Dès 1958, il est en Europe, à Madrid, où il publie un recueil de nouvelles, "Los Jefes" (1959,
Les Caïds). Puis à Paris : c'est là, qu'il poursuit la rédaction de l'ouvrage qui lui donne une renommée immédiate, "La ciudad y los perros" (1963, La Ville et les chiens), puis "La Casa verde"
(1967), "Conversacion en la Catedral" (1969), enfin en 1974, "La tia Julia y el escribidor" : c'est à cette date qu'il regagne le Pérou, alors fait désormais partie intégrante du panthéon des
écrivains de ce pays, succédant à Ricardo Palma, César Vallejo, José María Argüedas ou Ciro Alegría. Gagné en partie à une idéologie marxiste et révolutionnaire (1953-1971), sensible à Sartre et
d'une vaste culture littéraire, de Flaubert à Faulkner, il s'orientera progressivement vers la défense de la démocratie contre toutes les formes de dictature, de terrorisme, de fanatisme ou
d'intégrisme : contesté par tout un pan de la critique latino-américaine pour son revirement idéologique, candidat, sans succès, à la présidence de la République du Pérou en 1990, il se détourne
de toute action politique et acquiert la nationalité espagnole en 1994...

"El pez en el agua" (1993, "La Llamada de la tribu" (2018)
Dans "Le poisson dans l'eau" (Éditions Gallimard, 1995), la première partie de son autobiographie, Mario Vargas Llosa partageait avec ses lecteurs deux périodes décisives de son existence : d'une part, le temps de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse; d'autre part, les trois années qu'il a consacrées à parcourir le Pérou, entre 1987 et 1990, en tant que candidat à l'élection présidentielle...
Avec "L'appel de la tribu" (Editions Gallimard, 2021), il va reprendre ce récit pour nous livrer une autre partie de son autobiographie. Mais, à la différence de la précédente, qui reposait sur un récit factuel, il propose ici un autoportrait intellectuel, dont le but est de nous aider à mieux comprendre l'évolution de sa pensée politique. Nous sommes ainsi invités à découvrir les sept auteurs qui ont marqué son passage du marxisme le plus orthodoxe au libéralisme, grâce à une analyse de leurs œuvres....
"Je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais lu, voici plus de vingt ans, "La gare de Finlande", d'Edmund Wilson. Cet essai fascinant raconte l'évolution de l'idée socialiste à partir du moment où l'historien français Jules Michelet, intrigué par une citation, se mit à apprendre l'italien afin de lire Giambattista Vico, jusqu'à l'arrivée, le 3 avril 1917, en gare de Finlande, à Saint-Pétersbourg, de Lénine, qui allait diriger la révolution russe. J'ai pensé alors à un livre sur le libéralisme qui ressemblerait à ce que le critique américain avait fait sur le socialisme : un essai qui, démarrant à la naissance d'Adam Smith dans le village écossais de Kirkcaldy en 1723, rapporterait l'évolution des idées libérales à travers ses principaux représentants, ainsi que les événements historiques et sociaux qui les répandirent dans le monde. Toutes proportions gardées, telle est l'origine lointaine de "L'appel de la tribu".
En dépit des apparences, il s'agit d'un livre autobiographique qui retrace ma propre histoire intellectuelle et politique, le parcours qui m'a mené du marxisme et de l'existentialisme sartrien de ma jeunesse au libéralisme de ma maturité, en passant par la revalorisation de la démocratie que je dois à mes lectures d'écrivains tels qu'Albert Camus, George Orwell et Arthur Koestler. J'ai été poussé ensuite vers le libéralisme par certaines expériences politiques et, surtout, par les idées des sept auteurs à qui ces pages sont consacrées : Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von Hayek, Karl Popper, Isaiah Berlin, Raymond Aron et Jean-François Revel.
J'ai découvert la politique au Pérou à douze ans, en octobre 1948, lors du coup d'État militaire du général Manuel Apolinario Odría qui renversa le président José Luis Bustamante y Rivero, apparenté à ma famille maternelle. C'est, je crois, pendant les huit années odriistes qu'est née chez moi la haine des dictateurs de tout poil, l'une des rares constantes de mon attitude politique. Mais je n'ai pris conscience du problème social, je veux dire conscience d'un Pérou plein d'injustices où une minorité de privilégiés exploitait abusivement l'immense majorité, qu'en lisant dans ma dernière année de lycée, en 1952, "Sans patrie ni frontières" de Jan Valtin. Ce livre m'a amené à m'opposer à ma famille, qui voulait que j'entre à l'Université catholique - celle des fils à papa -, en m'inscrivant à San Marcos, l'université publique, populaire et réfractaire à la dictature militaire où, j'en étais sûr, je pourrais adhérer au parti communiste. La répression odriiste l'avait presque laminé quand je suis entré à San Marcos en 1953, inscrit en lettres et droit, après avoir emprisonné, supprimé ou banni ses dirigeants ; et le parti essayait de se reconstruire avec le Groupe Cahuide, où j'ai milité un an.
C'est là que j'ai reçu mes premières leçons de marxisme, dans des groupes d'étude clandestins où l'on lisait José Carlos Mariátegui, Georges Politzer, Marx, Engels ou Lénine, et l'on avait d'intenses discussions sur le réalisme socialiste et le gauchisme, "la maladie infantile du communisme". La grande admiration que j'avais pour Sartre, que je lisais religieusement, me défendait contre le dogme - nous, les communistes péruviens, étions alors, selon l'expression de Salvador Garmendia, "en petit nombre mais parfaitement sectaires" - et m'amenait à soutenir dans ma cellule, selon la thèse sartrienne, la croyance au matérialisme historique et à la lutte des classes sans adhérer au matérialisme dialectique, ce qui me valut, lors d'une de ces discussions, d'être qualifié de « sous-homme ›› par mon camarade Félix Arias Schreiber.
J'ai pris mes distances avec le Groupe Cahuide à la fin de l'année 1954, tout en restant, je crois, socialiste, du moins dans mes lectures, position qui, ensuite, avec la lutte de Fidel Castro et ses barbus dans la Sierra Maestra et la victoire de la révolution cubaine aux derniers jours de 1958, allait notablement se raviver. Pour ma génération, et pas seulement en Amérique latine, ce qui s'était produit à Cuba fut décisif, déterminant un avant et un après idéologique. Beaucoup, comme moi, ont vu dans la geste fidéliste non seulement une aventure héroïque et généreuse, celle de combattants idéalistes qui voulaient en finir avec une dictature corrompue comme celle de Batista, mais aussi un socialisme non sectaire qui aurait permis la critique, la diversité, voire la dissidence. Nous étions nombreux à le croire et cela a contribué à donner à la révolution cubaine, dans ses premières années, une si grande assise dans le monde entier ..."

"La ciudad y los perros" (1963, La Ville et les chiens)
Ce roman, touffus, classique et d'avant-garde, impose la renommée de Vargas Llosa. Il y retrace la vie (deux ans de sa vie inspire ce récit) des cadets du
collège militaire Leoncio-Prado, à Lima, univers dont la brutalité, la stupidité et l'ignorance sont exacerbées par la réclusion. Les "Chiens" sont les cadets de ce collège militaire où règnent
brimades, sévices, dénonciations, exactions.
A sa sortie, le livre échappa de peu à la censure pour sa dénonciation des pratiques de l'école où Vargas Llosa passa deux ans de sa vie , mais aussi celles des institutions militaires en général et plus largement d'un Etat qui compte sur l'armée pour maintenir l'ordre - comme ce fut le cas du Pérou entre les années 1930 et 1980...
L'un des cadets les plus violents, le Jaguar, orchestre le vol des sujets d'examen de fin d'année. Mais ce vol est dénoncé par l'Esclave, le souffre-douleur de ses camarades. Quelque temps après, l'Esclave, au cours de manœuvres de tir, est tué d'une balle perdue. Auparavant, il s'était confié à l'un de ses amis, Alberto Fernández, lequel écrit des romans pornographiques, qui circulent en secret parmi les adolescents. Fernández voudrait dénoncer à ses chefs l'origine de la mort apparemment accidentelle de l'Esclave. Un terrible chantage empêchera la vérité d'éclater. Quelques années plus tard, Alberto Fernández et le Jaguar se rencontreront de nouveau. À la lumière de leur éducation de jeunes cadres de la nation, ils essaieront de confronter leurs expériences et d'éclairer les valeurs morales qui fondent la société dont ils sont désormais les otages et les complices...
(...) "Una semana después, media sección la conocía y el nombre de Pies Dorados comenzó a resonar en los oídos de Alberto como una música familiar. Las referencias feroces, aunque vagas, que escuchaba en boca de los cadetes, estimulaban su imaginación. En sueños, el nombre se presentaba dotado de atributos carnales, extraños y contradictorios, la mujer era siempre la misma y distinta, una presencia que se desvanecía cuando iba a tocarla o lo sumía en una ternura infinita y entonces creía morir de impaciencia.
Alberto era uno de los que más hablaba de la Pies Dorados en la sección. Nadie sospechaba que sólo conocía de oídas el jirón Huatica y sus contornos porque él multiplicaba las anécdotas e inventaba toda clase de historias. Pero ello no lograba desalojar cierto desagrado íntimo de su espíritu; mientras más aventuras sexuales describía ante sus compañeros, que reían o se metían la mano al bolsillo sin escrúpulos, más intensa era la certidumbre de que nunca estaría en un lecho con una mujer, salvo en sueños, y entonces se deprimía y se juraba que la próxima salida iría a Huatica, aunque tuviese que robar veinte soles, aunque le contagiaran una sífilis....
Une semaine plus tard, la moitié de la section la connaissait et le nom de Pies Dorados commençait à résonner aux oreilles d'Alberto comme une musique familière. Les allusions féroces, quoique vagues, qu'il entendait de la bouche des cadets stimulent son imagination. En rêve, le nom apparaissait doté d'attributs charnels étranges et contradictoires, la femme était toujours la même et différente, une présence qui s'évanouissait lorsqu'il allait la toucher ou qui le plongeait dans une tendresse infinie et alors il croyait mourir d'impatience.
Alberto était l'un des Pies Dorados dont on parlait le plus dans la section. Personne ne soupçonnait qu'il ne connaissait le bouge de Huatica et ses environs que par ouï-dire car il multipliait les anecdotes et inventait toutes sortes d'histoires. Mais cela ne parvenait pas à déloger de son esprit un certain malaise intime ; plus il décrivait d'aventures sexuelles à ses compagnons, qui riaient ou mettaient sans scrupules la main à la poche, plus intense était la certitude qu'il ne serait jamais au lit avec une femme, sauf en rêve, et alors il déprimait et se jurait que la prochaine fois qu'il sortirait, il irait à Huatica, même s'il devait voler vingt soles, même s'il devait attraper la syphilis...
D'abord intitulé "La Demeure du héros" (La morada del héroe), puis "Les Imposteurs" (Los impostore), "La ciudad y los perros" (LA VILLE ET LES CHIENS) évoque donc l'enfer quasi carcéral du collège Leoncio Prado de Lima, où Vargas Llosa fut interne de 1950 à 1952. "Chiens" est le surnom donné au collège aux élèves de première année, contraints d'obéir à la discipline de fer des enseignants et, plus servilement encore, par tradition, aux caprices et persécutions des aînés. Pour contrecarrer les brimades, quatre "chiens" décident de former un clan secret, "le Cercle", lequel répondra à la violence par la violence, à l`intransigeance du règlement par la fraude, développant ainsi les vices qui caractérisent l'établissement : vols, mensonges, masturbation, alcool. Avec "le Jaguar", - leur chef -, "le Boa ", "le Frisé" et "Porfirio Cava" deviennent les maîtres des "chiens" et choisissent en particulier pour souffre-douleur un garçon plus tendre. traumatisé par la violence d'un père retrouvé alors qu`il avait
huit ans. Ricardo Araña dit "l`Esclave". Pourtant, l'Esclave n'est pas tout à fait seul. ll a un ami - lui aussi en désaccord avec un père ivrogne et débauché - un camarade que les petits récits pornographiques qu'il écrit pour ses condisciples ont fait surnommer "le Poète ".
Le drame éclate le jour où le Cercle, pour faciliter son succès à l'examen de fin de troisième année, charge Porfirio Cava de dérober les questions de chimie. Témoin du vol, l`Esclave dénonce son auteur aux autorités. Peu après, au cours d'exercices de tir, il est blessé d'une balle dans la tête et meurt à l`hôpital.
Rage, remords ou désarroi? Le Poète révèle le nom de l`assassin : le Jaguar, et aussi les jeux et plaisirs défendus des cadets du collège. Craignant le discrèdit aux yeux de l'opinion publique, les autorités préfèrent défendre la thèse du suicide par imprudence, en même temps qu`elles contraignent le Poète au silence en exhibant sa littérature compromettante. Les rapports obstinés du lieutenant Gamboa, officier dur mais intègre, se heurtent à la volonté de mutisme des chefs.
L`épilogue est la sanction de cette détérioration morale : Gamboa accepte en militaire son déplacement dans la solitude des hauts plateaux: le Poète s`abandonne aux joies de l`amour avec une jeune fille de la bonne société; le Jaguar épouse son amie d`enfance, Teresa la délaissée, et continue de fréquenter les mauvais garçons avec lesquels il a "travaillé" quand il était écolier.
Si l'on tient compte du fait que toutes les régions. tous les secteurs, toutes les classes sociales du Pérou sont représentés au collège Leoncio Prado qui forme les cadres de la nation, c'est donc le procès de l'éducation de tout un pays qui est fait ici. Le contenu social du roman était explosif et a été souvent comparé à celui des "Désarroís de I 'élève Törless" de Robert Musil. Quand il parut, professeurs, officiers et cadets du collège visé brûlèrent solennellement l`ouvrage. (Trad. Gallimard, 1966).

"La casa verde" (1965, La Maison verte)
La "Casa verde" est le bordel de Piura, ville du Nord, entouré d'une immense forêt vierge, centre de plusieurs intrigues sans lien nécessaire entre elles si
ce n'est de tenter d'exprimer un monde dans la totalité de sa vie et ce jusqu'au plus infime détail : "histoire de Bonifacia, une petite Indienne recueillie par les religieuses de la mission
catholique et qui deviendra la locataire du lupanar ; histoire du bandit Fushia ; histoire des habitants de la forêt vierge et de leurs démêlés avec les Blancs."
"La casa verde", de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa s`organise autour de deux lieux, Piura, - la ville jaune du nord, située au bord du désert et sur laquelle le vent de sable s'abat implacablement toutes les nuits -, et Santa-María-de-Nieva, - la bourgade verte agrippée au bassin du haut Marañon, en pleine forêt amazonienne. Piura, que l`on voit se développer au cours du roman, représente en quelque sorte la civilisation : elle a ses boutiques, ses rues pavées, sa cathédrale, et sa population y est accueillante malgré le fanatisme de son curé et les ragots de ses bigotes. Santa-Maria-de-Nieva, elle, incarne la société primitive, avec ses cabanes, ses bambous, ses moustiques, ses pluies, ses pilotes, sa petite garnison de militaires et ses tribus d'Indiens à l'état sauvage. Pourtant, et puisque rien n'est simple en ce monde, Piura a aussi ses "barbares" et Santa-María ses "civilisés"...
Piura, l'accueillante Piura, a recueilli un jour don Anselmo, et celui-ci a construit sur ses sables la Maison verte, un bordel qui ne tarde pas à transformer la mentalité de la ville ; dans la cité naguère silencieuse, l'écho de sa harpe et de ses guitares retentit jusqu'à l`aube, mêlé aux cris et aux rires de ses nombreux visiteurs.
Un jour, le père García, au cours d'une incursion avec ses bigotes, brûle la Maison verte, mais celle-ci renaîtra sous l`impulsion d`Anselmo, encouragé par les "indomptables", les voyous du quartier populaire de la Mangacheria. A Santa-María-de-Nieva, en revanche, la civilisation est présente sous la forme d'une mission où une poignée de religieuses éduquent dans le catholicisme les petites Indiennes arrachées par les militaires à leurs parents païens. Deux protagonistes incarnent plus particulièrement ce conflit : dans le climat primitif de Santa-Maria, le sergent Lituma est un homme probe, l'époux - presque - modèle de Bonifacia, la timide Indienne élevée par les sœurs de la mission. Mais quand il revient à Piura la civilisée, il retrouve le milieu de son enfance, celui des "indomptables ", et connaît la déchéance et la prison. Bonifacia, elle, se prostitue à la Maison verte sous le nom de la Sauvage.
Entre les deux lieux et les deux âges, le fleuve constitue le lien naturel, humain et commercial, avec ses pilotes, ses aventuriers, ses trafiquants, ses policiers et ses indigènes dont les destins se croisent, se mêlent ou s`affrontent. C'est un monde complexe. constitué comme tous les mondes de purs et d'impurs, de bons et de méchants, quand ils ne sont pas
les deux à la fois. On y trouve entre autres Fushia, le bandit poursuivi qui, rongé par la maladie, raconte à Aquilino, le pilote qui le transporte, son trafic clandestin, ses démêlés avec son rival Reátegui et ses amours avec Lalita, et les Indiennes; Nieves, le pilote, qui a enlevé Lalita à Fushia, et qui, après des années de commerce intègre, a fini par rendre
service aux aventuriers, ce qui l'a perdu; les Indiens aussi, les Huambisas et les Agmarunas, avec leurs chefs, tour à tour alliés aux trafiquants ou traqués par eux, dans un imbroglio d'intérêts qu'ils ne comprennent pas.

"Conversacion en la Catedral" (1969, Conversation à la "Cathédrale")
"À la fourrière où il est allé rechercher son chien, dans les faubourgs de Lima, Santiago Zavala rencontre le Noir Ambrosio, ancien chauffeur de son père,
Don Fermín, et l'invite à boire un verre à La Cathédrale, taverne locale. Ils restent ensemble quatre heures durant : Santiago veut faire parler Ambrosio sur un passé qui l'obsède. Il repartira,
ivre, sans avoir rien appris. Mais cette conversation à La Cathédrale déclenche le processus selon lequel dix années de passé vont s'éclairer aux yeux de Santiago, en même temps qu'elles seront
présentées au lecteur dans leur totalité, à la fois avec leurs énigmes et avec l'élucidation de ces énigmes. Ainsi, toutes époques mêlées, se construit le récit, dont le lecteur lui-même tient le
fil." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Pérou) par Sylvie Léger et Bernard Sesé).
"Conversación en la Catedral", de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, a pour cadre Lima, à l'époque de la dictature du général Manuel Apolinario Odria (1948-1956). En allant récupérer son chien enlevé par la fourrière, le journaliste Santiago Zavala rencontre Ambrosio le Noir, l'ancien chauffeur de son père, et bavarde longuement avec lui dans un bar populaire, "La Cathédrale". Les souvenirs des deux hommes qui surgissent par bribes et les questions multiples que pose Zavala évoquent de nombreux personnages liés à leur vie et appartenant à tous les milieux : domestiques, comme Amelia, Pamie d'Ambrosio, renvoyée pour s'être prêtée aux jeux sexuels de Santiago et de son frère; ouvriers chômeurs, comme le mari d'Amelia, battu par la police et abandonné moribond près de l'hôpital; policiers, comme Cayo Bermúdez, homme de confiance du Président, tortionnaire, spécialiste de la répression et du trafic avec les trusts étrangers s`installant dans le pays; prostituées, comme la Muse, entretenue par Bermúdez et finalement assassinée à l'instigation de don Fermín, aristocrate hypocrite et dépravé, père de Santiago...
Tous les épisodes, souvent violents, abusifs, misérables, auxquels les deux protagonistes ont été mêlés, révèlent l'intention de l'auteur : dénoncer par la fiction le triomphe de la corruption au Pérou et la résignation à la survie au jour le jour des non-possédants. Une interrogation est ici posée qui deviendra un leitmotiv dans l'œuvre romanesque de Vargas Llosa, à quelle époque a commencé la décadence du Pérou et quelles en sont les causes ? Des interrogations qui seront en particulier reprises et illustrées par l'échec révolutionnaire du guérillero Mayta dans "Histoire de Mayta" (1984) - (Trad. Gallimard, 1973).

"La tia Julia y el escribidor" (1979, La tante Julia et le scribouillard)
"Lorsque la table du déjeuner familial est desservie et que s'annonce un après-midi sans surprise et sans sorties, que faire? En Amérique latine, des
millions d'hommes – et surtout de femmes – attendent alors le moment de tourner le bouton de la radio pour absorber leur dose quotidienne de rire, de larmes et de rêve. C'est derrière les feux de
cette rampe-là, faussement clinquante, que le grand romancier péruvien nous mène : acteurs vieillis dont seule la voix séduit encore, tâcherons de l'écriture dévorés par le halo d'une gloire
illusoire, requins de l'audio-visuel artisans de la misère de leurs «créateurs». Pedro Camacho, un as du feuilleton radio, arrive alors à Lima. Il n'a d'autre vie que celle de ses personnages et
de leurs intrigues. Enfermé jour et nuit dans la loge de l'immeuble de la radio, il manipule les destinées de ces êtres imaginaires qui font battre le cœur des auditeurs. Mais voilà que, au
comble de la gloire, son esprit s'embrume : comme des chevaux fous, ses héros franchissent les barrières, font irruption dans des histoires qui ne sont pas les leurs et engendrent une avalanche
de catastrophes : les auditeurs affolés portent plainte... En contrepoint, nous est contée l'histoire de «Varguitas» : à dix-huit ans, il poursuit, mollement, des études de droit, comme l'exige
son père. Installé dans un cagibi, il gagne quelques sous en rédigeant les bulletins de nouvelles pour la radio de Lima et rêve de faire publier les nouvelles qu'il écrit à ses (nombreux) moments
perdus. Pour la première fois, Mario Vargas Llosa parle ici à la première personne et raconte son histoire : «Varguitas» n'est autre que lui et la tante Julia, fraîchement divorcée, de quinze ans
son aînée, a bien existé. Malgré l'opprobre familial et le rocambolesque bureaucratique, il finira par l'épouser. Il est difficile de mieux conjuguer le rétro, le kitsch et le mélo que Mario
Vargas Llosa le fait dans ce livre, l'un des plus éblouissants témoignages sur ce qu'est aujourd'hui le vécu, le ressenti, le rêvé de l'homme moyen en Amérique latine." (Editions Gallimard, Trad.
de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan).
"La tía Julia y el escribidor", de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, est une fiction partiellement autobiographique traitée avec humour et sous le signe d`une passion littéraire, "Madame Bovary" de Flaubert. Un étudiant de dix-huit ans, Mario Varguitas, dirige un programme d'informations à la radio et rêve de devenir écrivain. Deux nouveaux
venus vont bouleverser sa vie : Pedro Camacho, un auteur à succès de feuilletons radiophoniques, arrivé de Bolivie pour travailler avec Mario; et la tante Julia, la femme divorcée d`un de ses oncles, débarquée à Lima avec sa franchise et sa séduisante gaieté.
De quinze ans l`aînée de Mario, la tante Julia aime comme madame Bovary les petits romans sentimentaux où l'on verse toutes les larmes de son corps et raffole des mélos cinématographiques mexicains. Mario, qui souffre du complexe d`OEdipe. s`éprend de la tante Julia et vit une liaison qui a toutes les apparences rocambolesques d`un roman-feuilleton : réactions hostiles de la famille dont il faut mille fois déjouer les pièges, rendez-vous ardents dans le réduit où travaille Mario, complicité d'une jeune cousine dont l`ami de Mario est amoureux, courroux du père qui menace de tuer son fils quand il apprend son mariage.
Puis c`est le départ pour Paris, autre rêve de Mario. Il s'y installe avec Julia et devient véritablement écrivain. Quand, finalement, il divorce pour épouser sa cousine Patricia, il a résolu son complexe d'OEdipe, du point de vue affectif mais aussi littéraire car, n`imitant plus les autres mais créant de vrais personnages, "ses" personnages, il perpétue le "meurtre du père" en faisant naître et en tuant ses modèles. (Trad. Gallimard, 1979).

"Pantaleon y las visitadoras" (1973, Pantaleon Et Les Visiteuses)
Le capitaine Pantaleon Pantoja a le génie de l’organisation, l’amour de l’obéissance et une seule mystique : l’efficacité de l’institution militaire. Il met toutes ses vertus au service d’une mission dont le chargent ses supérieurs, et qui consiste a and “pacifier and ” sexuellement les troupes isolées de l’Amazonie péruvienne. Son travail acharne et ses talents lui permettent de monter rapidement le S.V.G.P.F.A. (Service de Visiteuses pour Garnisons, Postes Frontières et Assimiles), qui a son hymne, ses couleurs, et devient une florissante affaire…

"La orgia perpetua" (L'orgie perpétuelle, 1975)
"La orgía perpetua" est un essai de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa qui, en 1959, débarque à Paris, découvre Flaubert et s'éprend de Madame Bovary. Il a vingt-trois ans. Il a publié quelques nouvelles qui l'ont révélé et est, avouera-t-il, un "lecteur cannibale de romans" : "Une poignée de personnages littéraires ont marqué ma vie de façon plus durable qu'une bonne partie des êtres en chair et en os que j'ai connus", affirme-t-il, en précisant "mais aucun avec qui j'aie eu une relation plus clairement passionnelle qu'Emma Bovary". Elle sera "obsession" et "modèle" : "Je savais désormais quel écrivain j'aurais aimé être et je savais dès lors et jusqu'à ma mort que je vivrais amoureux d'Emma Bovary"...
Après avoir étudié tous les romans de Flaubert et sa correspondance, le jeune écrivain venu du lointain Pérou proclame et démontre que celui-ci est à la fois le père du nouveau roman, l`un des principaux fondateurs de la sensibilité moderne et un freudien avant la lettre. Entrecoupée de souvenirs personnels, cette lecture de Flaubert est une subtile suite de variations sur la phrase écrite par l'auteur de "Salammbó" à Mlle Leroyer de Chantepie, le 4 septembre 1858, et citée en exergue par Vargas Llosa : « Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s`étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle" (Trad. Gallimard, 1978).
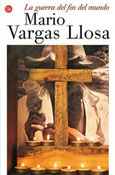
"La Guerra del fin del mundo" (1981, La Guerre de la fin du monde)
Ce huitième roman de Vargas Llosa aborde encore les différentes faces du mal, dans un récit
remarquable et apocalyptique. Cet ouvrage est un tournant dans l'œuvre de I'auteur péruvien, qui abandonne son pays natal pour raconter des événements réels, qui se déroulèrent au Brésil à la fin du XIXe siècle. Il relate l'expérience messianique d'Antonio Consejero, un saint homme visionnaire qui prêcha contre la République et la modernité, se faisant le porte-parole des dépossédés du Nord-Est brésilien. ll défie le gouvernement républicain, qui lui envoie l'armée. Celle-ci détruit Canudas, la ville dans laquelle Consejero et ses adeptes espéraient instaurer un royaume pour mille ans...
Vargas Llosa a créé un roman méticuleusement documenté - l'ascension, la carrière et la destruction d'un monstre fascinant et d'une expédition punitive criminelle de la "civilisation" -, inspiré par une œuvre qu'il considère comme fondamentale, "Hautes Terres" (Os Sertoes), de l'écrivain brésilien Euclides da Cunha (1866-1909), un ouvrage que le poète américain Robert Lowell, préférait au "Guerre et paix" de Tolstoï....
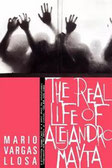
"Historia de Mayta" (1984)
Souvent sous-estimé, ce roman va bien au-delà des lectures politiques qui, à l’époque, en ont réduit la portée. Mario Vargas Llosa nous entraîne dans le sillage de Mayta, protagoniste d’une tentative révolutionnaire trotskyste qui se déroule en 1958. La reconstitution de l’histoire de ce personnage se fait à travers les témoignages de ceux qui l’ont connu et la confrontation ultérieure de ce récit chargé de subjectivisme avec la réalité. Le résultat ne pourra avoir qu’un arrière-goût amer et tragicomique, Mayta n'est-il pas le fils d’une période de passions politiques et de conflits idéologiques, mais il incarne aussi un moment clé dans le devenir de l’Amérique latine, un temps de revendication violente des désirs et des droits ...

"¿Quién mató a Palomino Molero ?" (1987, Qui a tué Palomino Molero ?)
"Le corps d'un jeune homme affreusement mutilé, accroché à un arbre, a été découvert par un jeune chevrier. L'enquête conduit le lieutenant Silva et le sergent Lituma dans l'univers préservé d'une base militaire dirigée par le colonel Mindreau, et dans le labyrinthe de la petite ville de Talara organisée autour de la gargote de Doña Adriana. D'un côté, le monde secret de l'armée, de l'autre toute une population haute en couleur, pitoyable, mesquine, truculente. Qui, dans tout cela, a tué Palomino Molero ?
Au suspense sans faille d'un véritable roman policier, Mario Vargas Llosa greffe une rigoureuse analyse des problèmes sociaux du Pérou et une dénonciation ironique, implicite, des mécanismes du pouvoir." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan).

"Lituma en los Andes" (1993)
Dans le camp minier de Naccos dans les montagnes du Pérou, trois hommes ont disparu. Le caporal Lituma, affecté à cette zone, est accablé par le mystère des disparitions et ne cesse de chercher les responsables de ces morts. Avec leur adjoint Tomas, ils sont plongés dans un climat de méfiance généralisée et hostile, où se fondent mythe et réalité sous la menace constante des guérilleros maoïstes du Sentier lumineux. En contrepoint à ce drame collectif se trouve l’histoire intime de ces personnages, en particulier celle d’un ancien amour de Tomas, qu’il narre sous forme d’épisodes entrecoupés qui se déroulent les nuits de sommeil et de conversations avec son supérieur. L’encouragement mythique de la Narracion, dans laquelle on entrevoit beaucoup d’autres silhouettes énergiquement tracées, insuffle une vie extraordinaire à des réalités qui s’observent d’une manière implacable et minutieuse, faisant de ce roman un Clasico....

"La fiesta del chivo" (La Fête au bouc, 2000)
Le romancier péruvien Mario Vargas Llosa, auteur bien connu de "Conversacion en la Catedral, 1969) dénonce le terrorisme du "Sendero Luminoso" des années 1980 dans "Lituma en los Andes" (Lituma dans les Andes, 1993), armée sans visage génératrice d'angoisse dans un pays qui ne semble pas pouvoir échapper à une violence native, puis la dictature de Trujillo (1930-1961) en République Dominicaine dans "La fiesta del chivo".
"Que vient chercher à Saint-Domingue cette jeune avocate new-yorkaise après tant d'années d'absence ? Les questions qu'Urania Cabral doit poser à son père mourant nous projettent dans le labyrinthe de la dictature de Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961), au moment charnière de l'attentat qui lui coûta la vie en 1961.
Dans des pages inoubliables - et qui comptent parmi les plus justes que l'auteur nous ait offertes -, le roman met en scène le destin d'un peuple soumis à la terreur et l'héroïsme de quatre jeunes conjurés qui tentent l'impossible : le tyrannicide. Leur geste, longuement mûri, prend peu à peu tout son sens à mesure que nous découvrons les coulisses du pouvoir : la vie quotidienne d'un homme hanté par un rêve obscur et dont l'ambition la plus profonde est de faire de son pays le miroir fidèle de sa folie. Jamais, depuis Conversation à «La Cathédrale», Mario Vargas Llosa n'avait poussé si loin la radiographie d'une société de corruption et de turpitude. Son portrait de la dictature de Trujillo, gravé comme une eau-forte, apparaît, au-delà des contingences dominicaines, comme celui de toutes les tyrannies - ou, comme il aime à le dire, de toutes les «satrapies»."
(Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan)
(...)
Al bajar del auto oficial, los ayudantes lo escoltaron hasta el despacho del Benefactor, sin que nadie lo registrara. Los oficiales debían tener instrucciones precisas; apenas la inconfundible vocecita chillona respondió «Adelante», el teniente primero Roberto Figueroa Carrión y su campanero se apartaron, dejándolo entrar solo. El despacho se hallaba en semipenumbra, debido a los postigos medio cerrados de la ventana que daba al jardín. El Generalísimo, en su escritorio, lucía un uniforme que Antonio no recordaba: guerrera blanca y larga, de faldones, con abotonadura de oro y grandes charreteras de dorados flecos sobre la pechera, de la cual pendía un multicolor abanico de medallas y condecoraciones. Llevaba un pantalón azul claro, de franela, con'una raya blanca perpendicular. Se dispondría a asistir a alguna ceremonia militar. La luz de la lamparilla iluminaba la cara ancha, cuidadosamente rasurada, los cabellos grises bien asentados y el bigotito mosca, imitado de Hitler (a quien, le había oído decir alguna vez Antonio, el jefe admiraba «no por sus ideas, sino por su manera de llevar el uniforme y presidir los desfiles»). Aquella mirada fija, directa, clavó a Antonio en el sitio apenas cruzó el umbral. Trujillo se dirigió a él después de observarlo un buen rato:
Lorsqu'il descendit de la voiture officielle, les assistants l'escortèrent jusqu'au bureau du Bienfaiteur, sans que personne ne le fouille. Les officiers devaient avoir des instructions précises, car dès que la petite voix stridente et reconnaissable a répondu "Adelante", le premier lieutenant Roberto Figueroa Carrión et son sonneur se sont écartés, le laissant entrer seul. Le bureau est dans la pénombre, en raison des volets mi-clos de la fenêtre donnant sur le jardin. Le généralissime, assis à son bureau, portait un uniforme dont Antonio ne se souvenait pas : une longue veste blanche à jupe, avec un boutonnage doré et de grandes épaulettes à franges dorées sur le plastron, d'où pendait un éventail multicolore de médailles et de décorations. Il porte un pantalon de flanelle bleu clair avec une bande blanche perpendiculaire. Il s'apprête à assister à une cérémonie militaire. La lumière de la lampe éclaire son large visage rasé, ses cheveux gris bien attachés et sa petite moustache, imitation d'Hitler (dont Antonio avait entendu dire un jour que le chef l'admirait "non pas pour ses idées, mais pour la façon dont il portait son uniforme et présidait les défilés"). Ce regard fixe et direct cloue Antonio sur place dès qu'il franchit le seuil de la porte. Trujillo se tourne vers lui après l'avoir longuement observé :
–Ya sé que crees que a Octavio lo mandé matar y que lo de su suicidio es una farsa, montada por el Servicio de Inteligencia. Te he hecho venir para decirte personalmente que te equivocas. Octavio era hombre del régimen. Siempre fue leal, un trujillista. Acabo de nombrar una comisión, presidida por el procurador general de la República, licenciado Francisco Elpidio Beras. Con poderes amplísimos para interrogar a todo el mundo, militares y civiles. Si lo de su suicidio es mentira, los culpables lo pagarán.
Le hablaba sin animosidad y sin inflexiones, mirándolo a los ojos de la manera directa y perentoria con que hablaba siempre a subordinados, amigos y enemigos. Antonio permanecía inmóvil, más decidido que nunca a saltar sobre el farsante y apretarle el pescuezo, sin darle tiempo a pedir ayuda. Como para facilitarle la tarea, Trujillo se puso de pie y avanzó hacia él, a pasos lentos, solemnes. Sus zapatos negros brillaban más todavía que las enceradas maderas del despacho.
–También autoricé al FBI a venir a investigar aquí la muerte de ese tal Murphy -añadió, con el mismo tonito agudo-. Es una violación de nuestra soberanía, por supuesto. ¿Permitirían los gringos que nuestra policía fuera a investigar el asesinato de un dominicano en New York, Washington o Miami? Que vengan. Que el mundo sepa que no tenemos nada que ocultar.
-Je sais que vous croyez que j'ai fait tuer Octavio et que son suicide est une farce, mise en scène par l'Intelligence Service. Je vous ai fait venir ici pour vous dire personnellement que vous vous trompez. Octavio était un homme du régime. Il a toujours été loyal, un partisan de Trujillo. Je viens de nommer une commission, présidée par le procureur général de la République, Francisco Elpidio Beras. Avec des pouvoirs très étendus pour interroger tout le monde, militaires et civils. Si l'histoire de son suicide est un mensonge, les coupables le paieront.
Il lui parle sans animosité et sans inflexion, en le regardant dans les yeux de la manière directe et péremptoire avec laquelle il s'adresse toujours à ses subordonnés, amis et ennemis. Antonio resta immobile, plus déterminé que jamais à sauter sur le faussaire et à lui serrer la gorge, sans lui laisser le temps d'appeler à l'aide. Comme pour lui faciliter la tâche, Trujillo se leva et s'avança vers lui, à pas lents et solennels. Ses chaussures noires brillaient encore plus que le bois ciré du bureau.
J'ai également autorisé le FBI à venir ici pour enquêter sur la mort de ce Murphy, ajouta-t-il sur le même ton aigu. Les gringos autoriseraient-ils notre police à enquêter sur le meurtre d'un Dominicain à New York, Washington ou Miami ? Qu'ils viennent. Que le monde sache que nous n'avons rien à cacher.
Estaba a un metro de distancia. Antonio no podía resistir la mirada quieta de Trujillo y pestañeaba sin cesar.
–A mí no me tiembla la mano cuando tengo que matar -añadió, después de una pausa -. Gobernar exige, a veces, mancharse de sangre. Por este país, he tenido que hacerlo muchas veces. Pero, soy un hombre de honor. A los leales, les hago justicia, no los mando matar. Octavio era leal, hombre del régimen, un trujillista probado. Por eso, me jugué para que no fuera a la cárcel cuando se le fue la mano en Londres y mató a Luis Bernardino. La muerte de Octavio será investigada. Tú y tu familia pueden participar en los trabajos de la comisión.
Dio media vuelta y de la misma manera calmosa regresó a su escritorio. ¿Por qué no saltó sobre él cuando lo tuvo tan cerca? Se lo preguntaba todavía, cuatro años y medio después. No porque creyera una palabra de lo que decía. Aquello era parte de la farsa a la que Trujillo era tan propenso y que la dictadura superponía a sus crímenes, como un suplementario sarcasmo a los hechos luctuosos sobre los que se levantaba. ¿Por qué, entonces? No por miedo a morir, porque, entre todos los defectos que se reconocía, nunca figuró el miedo a la muerte. Desde que era un alzado y con una pequeña tropa de horacistas combatió a tiros al dictador, se había jugado la vida muchas veces. Era algo más sutil e indefinible que el miedo: esa parálisis, el adormecimiento de la voluntad, del raciocinio y del libre albedrío que aquel personajillo acicalado hasta el ridículo, de vocecilla aflautada y ojos de hipnotizador, ejercía sobre los dominicanos pobres o ricos, cultos o incultos, amigos o enemigos, lo que lo tuvo allí, mudo, pasivo, escuchando aquellos embustes, espectador solitario de esa patraña, incapaz de convertir en acción su voluntad de saltar sobre él y acabar con el aquelarre en que se había convertido la historia del país.
J’étais à un mètre de là. Antonio ne pouvait pas résister au regard immobile de Trujillo et clignait des yeux sans cesse.
– Je ne tremble pas quand je dois tuer, a-t-il ajouté, après une pause. Gouverner exige parfois de se salir de sang. Pour ce pays, j’ai dû le faire plusieurs fois. Mais, je suis un homme d’honneur. Je rends justice aux loyaux, je ne les fais pas tuer. Octave était loyal, un homme du régime, un trujilliste prouvé. C’est pourquoi j’ai pris des risques pour qu’il n’aille pas en prison quand il a perdu la main à Londres et a tué Luis Bernardino. La mort d’Octavio fera l’objet d’une enquête. Vous et votre famille pouvez participer aux travaux de la commission.
Pourquoi n'a-t-il pas sauté dessus alors qu'il était si près du but ? se demande-t-il encore, quatre ans et demi plus tard. Non pas parce qu'elle croyait un mot de ce qu'il disait. Cela faisait partie de la farce à laquelle Trujillo était si enclin et que la dictature superposait à ses crimes, comme un sarcasme supplémentaire aux tristes faits sur lesquels elle était bâtie. Pourquoi, alors ? Pas par peur de mourir, car, parmi tous les défauts qu'il reconnaissait, la peur de la mort ne figurait jamais. Depuis qu'il avait été rebelle et qu'avec une petite troupe d'Horacistas, il avait combattu le dictateur à coups de fusil, il avait risqué sa vie à de nombreuses reprises. C'était quelque chose de plus subtil et indéfinissable que la peur : cette paralysie, cet engourdissement de la volonté, de la raison et du libre arbitre que ce petit personnage, prétentieux jusqu'au ridicule, à la voix chantante et aux yeux hypnotisants, exerçait sur les Dominicains, riches ou pauvres, éduqués ou non, amis ou ennemis, et qui le tenait sous son emprise, amis ou ennemis, qui le maintenaient là, muet, passif, écoutant ces mensonges, spectateur solitaire de ce canular, incapable de convertir en action sa volonté de lui sauter dessus et de mettre fin à cette foire qu'était devenue l'histoire du pays.
(...)
Les livres sur les dictateurs ne sont pas rares en Amérique latine, mais Mario Vargas Llosa, dans "La fiesta del chivo" sait entraîner ses lecteurs dans la rue pour y partager avec eux tant les espoirs des conspirateurs et le dîner des victimes que l'exposé de Rafael Trujillo du dernier jour d'une dictature tyrannique qui dura trente et une années en République dominicaine. Le roman dénoue trois récits entremêlés : celui d'Urania, qui représente la mémoire collective des citoyens dominicains, de leurs souffrances à leur foi aveugle dans le régime et de leur complicité avec ce régime qui les a tant compromis; le deuxième récit est celui des conspirateurs, qui furent un temps des fidèles de Trujillo; et finalement, le récit de Trujillo lui-même, obsédé par son problème urinaire qui perturbe tant la discipline de son personnage public et l'oblige, lui aussi à des compromis. Llosa dit qu'en faisant le portrait de Trujillo, il dépeignait tous les dictateurs, mais la vérité perturbante de son roman vient sans doute de ses enquêtes minutieuses faites dans les rues dominicaines, interrogeant des individus en chair et en os pour écrire son roman ...

"Travesuras de la niña mala" (2006, Tours et détours de la vilaine fille)
¿Cuál es el verdadero rostro del amor? Quel est le vrai visage de l’amour ? Ricardo voit accompli, à un très jeune âge, le rêve qu’il nourrissait dans sa Lima natale depuis qu’il avait raison : vivre à Paris. Mais la rencontre avec un amour d’adolescence va tout changer. La jeune femme, non-conformiste, aventurière, pragmatique et inquiète, le traînera hors du petit monde de ses ambitions. Une danse de rencontres et de désaccords qui parvient à faire progresser l’intensité du récit page par page, jusqu’à atteindre ce qui semble une véritable fusion du lecteur avec l’univers émotionnel des protagonistes. Une fiction pour libérer une histoire où l’amour se montre indéfinissable, incarnant mille visages, comme celui la mauvaise fille, quel est le vrai visage de l’amour?, traduit par Albert Bensoussan, Paris, Gallimard.
Les petites Chiliennes - (...) Les vagues sur la plage de Miraflores se brisaient à deux reprises au large, d'abord à deux cents mètres du sable, et nous, les cœurs vaillants, allions là-bas les affronter à poitrine nue en nous laissant drosser pendant cent mètres, sur la crête, où les vagues ne mouraient que pour reconstituer d'arrogants rouleaux et se briser derechef, en un second déferlement qui faisait glisser les surfeurs jusqu'aux petits galets de la plage.
Cet été prodigieux, aux soirées de Miraflores, le mambo fit table rase des valses, corridos, blues, boléros et autres guarachas. Le mambo, un séisme qui fit sauter, bondir, se tortiller et déhancher tous les couples enfantins, adolescents et mûrs du quartier. Il en allait sûrement de même hors les murs de Miraflores, au-delà du monde et de la vie, dans les quartiers de Lince, Brena, Chorrillos, ou ceux, encore plus exotiques, de La Victoria, au centre de Lima, du Rimac et de Porvenir, où nous, les Miraflorins, n'avions mis ni ne pensions jamais mettre les pieds.
Et tout comme on était passés des valses créoles et des guarachas, des sambas et des polkas au mambo, on était aussi passés des patins et de la trottinette au vélo, et certains même, tels Tato Monje et Tony Espejo, à la moto, voire à la bagnole, comme Luchin, le malabar de la bande, qui volait parfois la Chevrolet décapotable de son père et nous emmenait faire un tour sur le front de mer, depuis le Terrazas jusqu'au ruisseau d'Armendariz, à cent à l'heure.
Mais ce qui marqua vraiment cet été-là fut l'irruption à Miraflores, en provenance du lointain Chili, de deux sœurs à la présence tapageuse dont l'inimitable façon de parler, à toute allure, escamotant le bout des mots pour finir sur un « pfeuhhh », exclamation ou soupir, nous tourneboula tous, nous qui venions d'échanger nos culottes courtes contre des pantalons. Et moi, plus que tous les autres.
La cadette ressemblait à l'aînée et vice versa. La plus âgée s'appelait Lily et était un peu moins grande que Lucy, plus jeune d’une année. Lily devait avoir tout au plus quatorze ou quinze ans, et Lucy treize ou quatorze. L’adjectif « tapageuse » semblait avoir été inventé pour elles, mais, sans laisser de l'être, Lucy l'était moins que sa sœur, non seulement parce que ses cheveux étaient moins blonds et plus courts et qu'elle s'habillait plus sobrement que Lily, mais parce qu'elle était plus silencieuse et qu'en dansant, déhanchée elle aussi et ployant la taille avec une audace qu'aucune Miraflorine n'aurait affichée, elle avait l'air réservée, complexée et presque insipide, en comparaison de cette toupie virevoltante, de cette flamme au vent, de ce feu follet de Lily qui, sitôt le disque de mambo sur le pick-up, s'élançait sur la piste." (trad. Gallimard, 2006)
