- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

The "Lost generation" (1920-1930) - William Faulkner (1897-1962) - The story of Yoknapatawpha County - "Sartoris" (Sartoris, 1929), "The Sound and the Fury" (Le Bruit et la fureur, 1929), "As I Lay Dying" {Tandis que j'agonise, 1930), "Light in August" (Lumière d'août,
1932), "Absalom, Absalom!" (1936) - ....
Last update: 11/11/2016

The "Lost generation" (1920-1930)
William Faulkner (1897-1962) dispose d'une aire géographique et culturelle nettement moins vaste qu'Hemingway pour ses ouvrages et profondément ancrés dans le sud profond. Un grand nombre de ses romans se passent à Jefferson et dans le comté du Yoknapatawapha, largement basés sur ses terres familières d'Oxford et du comté de Lafayette, dans le Mississipi. Nombre de ses personnages apparaissent dans des ouvrages successifs. Malgré l'isolement de sa contrée rurale et son aversion pour la compagnie d'autres écrivains, Faulkner contribua beaucoup à l'évolution de la littérature vers le modernisme. Son premier ouvrage important fut "The Sound and the Fury" (Le Bruit et la fureur, 1929), où il employa le fameux "stream of consciousness", un narrateur peu fiable, des techniques de changement de temps, qui, à la fin, laisse sciemment le lecteur sur sa faim. Il nous conte l'histoire d'une famille autrefois prestigieuse, descendante d'un héros de la guerre civile, la famille Compson, une famille qui symbolise la dégénérescence des valeurs du Sud, qui perdra sa fortune, ses convictions religieuses et sa position sociale...
Faulkner publia ensuite "As I Lay Dying" {Tandis que j'agonise, 1930), qui se situe également à Yoknapatawpha, mais dans le contexte d'une famille blanche et pauvre. ll y utilise la technique du "stream of consciousness" et des points de vue multiples (avec quinze narrateurs différents). Vint ensuite "Sanctuary" (Sanctuaire, 1931) que Faulkner affirma avoir écrit pour l'argent. Non seulement ce roman fut un succès financier (malgré le thème du viol), mais il attira en outre l'attention de la critique sur son auteur. Fort de ce succès, Faulkner écrivit ensuite "Light in August" (Lumière d'août, 1932), sur l'identité personnelle et la race, puis "Pylon" (Pylône, 1935) sur un groupe de brillants pilotes. En 1936, Faulkner publia "Absalom, Absalom!", vraisemblablement son meilleur roman, dans lequel il remit en scène la famille Compson. Comme dans "Le Bruit et la fureur", cet œuvre est une allégorie de l'histoire du Sud. Différents narrateurs y exposent leurs versions des évènements et, ce faisant. ils perpétuent la tradition du Sud de se répandre sur le passé et sur la mauvaise tournure des choses. Ces différents récits contribuent à entretenir le processus du mythe, en éloignant toujours davantage l'histoire de la réalité vers le royaume de l'imaginaire....
Faulkner, a-t-on souvent dit, nous montre l’homme face à ses démons et lire Faulkner, c’est naviguer dans un fleuve de mots où se noie et renaît le sens : chaînon manquant entre Dostoïevski et Pynchon, sans lui, la littérature contemporaine n’aurait pas la même audace.
Que lui devoir,
- L’invention d’un territoire littéraire : le Yoknapatawpha
Faulkner a créé de toutes pièces un comté fictif du Mississippi, microcosme de l’Amérique profonde, où se déroulent la plupart de ses romans (Le Bruit et la Fureur, Lumière d’août, Absalon, Absalon !). Ce territoire, inspiré de son Oxford natal, devient une allégorie de la condition humaine, explorant la décadence du Sud, le poids de l’histoire, et les traumatismes raciaux.
- Une révolution narrative ...
Monologues intérieurs et flux de conscience, Faulkner fracture la linéarité du récit pour plonger dans les pensées de ses personnages (Le Bruit et la Fureur est partiellement raconté par Benjy, un handicapé mental). Il manipule le temps comme un matériau malléable (Absalon, Absalon ! reconstruit le passé par bribes, comme une enquête obsessionnelle) et raconte une même histoire sous différents angles, soulignant la relativité de la vérité (Tandis que j’agonise).
- Une plongée dans les abîmes de l’âme ...
Des personnages tourmentés , ses héros (comme Quentin Compson) incarnent la culpabilité, la folie, ou la quête désespérée de rédemption.
- Un style baroque, entre souffle biblique et réalisme cru, sa prose est comparée à celle de Melville ou Joyce. Faulkner utilise des paragraphes de plusieurs pages, mêlant lyrisme et brutalité, comme dans cette phrase célèbre d’ "Absalon, Absalon !", Peut-être rien ne se produit-il une seule fois et est-il à jamais irrémédiable…

William Faulkner vécut dans le sud des États-Unis presque toute sa vie, en reclus, pour y construire l'histoire humaine de son comté mythique du Yoknapatawpha, image d'un terroir entré en décadence depuis la la fin de la Guerre de Sécession et livré aux violences raciales; refusant par l'écriture la possible fin de cet homme dont il retrace la chronique des comportements dans leurs avatars les plus divers, les plus extrêmes et les plus violents. Enfin et surtout, il incarne à sa manière la volonté extrême de disparaître au profit de l'écriture, de la littérature, de son oeuvre : "It is my ambition to be, as a private individual, abolished and voided from history, leaving it markless, no refuse save the printed books; I wish I had enough sense to see ahead thirty years ago, and like some of the Elizabethans, not signed them. It is my aim, and every effort bent, that the sum and history of my life, which in the same sentence is my obit and epitaph too, shall be them both: He made the books and he died." ("Mon ambition, écrit William Faulkner en 1949 à Malcom Cowley, est d'être aboli, de disparaître de l'histoire en tant qu'individu ; de la laisser intacte, sans restes sinon les livres imprimés ; il y a trente ans, j'aurais dû être assez clairvoyant pour ne pas les signer, comme le firent certains élisabéthains. Mon but, et tous mes efforts y concourent, est que la somme et l'histoire de ma vie figurent dans la même phrase qui sera tout à la fois mon acte de décès et mon épitaphe : il a fait des livres et il est mort.").

William Faulkner (1897-1962)
Issu d'une ancienne famille du Mississippi, Falkner, et d'un arrière-grand-père haut en couleur, colonel, banquier, homme de loi, entrepreneur de chemin de
fer, deux fois accusé de meurtre et finalement assassiné, William Faulkner s'engage en 1918 dans la R.A.F. britannique, mais la guerre se termine avant qu'il ait achevé son instruction de pilote.
Il passe deux ans à l'université du Mississippi, publie des poèmes, mais quitte l'université sans diplôme, pour devenir employé des postes, puis peintre en bâtiment. En décembre 1924, il publie à
compte d'auteur un recueil de vers, "The Marble Faun" sous le pseudonyme de Faulkner, qu'il gardera.
En 1925, il s'embarque pour l'Europe, visite l'Italie, la Suisse, puis Paris où il reste isolé, ne fréquentant ni Hemingway, ni Fitzgerald, ni Dos Passos, ni Gertrude Stein.
À son retour aux États-Unis, il rencontre, à La Nouvelle-Orléans, Sherwood Anderson, qui le confirme dans sa vocation d'écrivain. "Voilà, écrit Faulkner, un homme qui s'enfermait toute la matinée à travailler. Puis l'après-midi il sortait et on se promenait en discutant. Et le soir encore, avec une bouteille. Et puis le lendemain il s'enfermait de nouveau. Sur quoi je me dis : si c'est cela être écrivain, voilà le métier qu'il me faut." Faulkner écrit en six semaines son premier roman. "Soldier's Pay" (Monnaie de singe).
Mais c'est "Sartoris", écrit en 1927, qui marque le début de l'œuvre originale de Faulkner et de la chronique du Yoknapatawpha, suivis de "The Sound and the Fury" : tous ces romans sont refusés par les éditeurs. Il compose alors, pour gagner de l'argent, "Sanctuary", parodie de roman réaliste noir : "Sartoris" et "The Sound and the Fury" sont enfin publiés en 1929 et ,"Sanctuary" en 1931 fait un succès de scandale et apporte l'aisance à son auteur. Faulkner s'installe à Oxford, dans une vieille villa, "Rowanoak", où il vivra retiré jusqu'à sa mort, à l'exception de deux séjours alimentaires à Hollywood. En 1932, il travaille pour la Metro-Goldwyn-Mayer à neuf scénarios, dont l'adaptation de Sanctuaire (The Story of Temple Drake, 1933) et pour la Twentieth Century Fox.
Il obtient enfin la reconnaissance du milieu littéraire en recevant le Prix Pulitzer et le National Book Award à deux reprises, ainsi que le Prix Nobel de littérature en 1949, mais c'est en Europe qu'il connut véritablement la notoriété. Ses quelque vingt-cinq romans et sept à huit douzaines de nouvelles livrent une vision profondément personnelle de l'expérience humaine avec une langue reconnaissable par son intensité ("tout dire en une phrase") qui éclaire subtilement la signification profonde d'événements que le temps ordinaire peut obscurcir dans les apparences. "A partir de son Sud natal, il a peu à peu constitué, de roman en roman, plus qu'une comédie humaine : une théologie, une cosmogonie, où la superbe alliance du réalisme et de l'imaginaire enlumine les réactions archétypales des hommes devant les problèmes de la mort, de l'identité, du destin.". "Le Bruit et la fureur" (1929), "Absalon ! Absalon !" (1936), et "Descends, Moïse" (1942) constituent les trois sommets de son oeuvre. "On n'échappe pas au Sud, écrit-il, on ne guérit pas de son passé.."
La chronique du Yoknapatawpha avec ses plus de 15000 personnages, leurs arbres généalogiques et une géographie du Sud détaillée avec minutie, retrace la décadence des grandes familles, la défaite du Sud pendant la guerre de Sécession, le délabrement des plantations, l'embâtardisation de ces familles en quatre générations : "Chez les Compson, le fils doit hypothéquer les terres, et le petit-fils les vendre ; la quatrième génération, dans le Bruit et la fureur, se compose de Benjy, l'idiot, de Caddy, une traînée, et de Quentin, qui se suicide. Chez les Sartoris, c'est la même déchéance. Chez les Sutpen, le métissage aggrave la déchéance sociale ; dans "Absalon ! Absalon !", Henry tue son demi-frère, qui est à la fois demi-noir et amant de sa demi-sœur, sans qu'on sache si l'horreur de l'inceste l'emporte sur celle du métissage. Quand Sutpen, tel Agamemnon, rentre de la guerre, il trouve son fils noir mort, son fils blanc en fuite, sa fille vouée au célibat. Pour s'assurer une descendance, il séduit la fille d'un de ses fermiers, qui tue Sutpen, sa fille, leur enfant et lui-même. Quant à Henry, seul survivant de cette tragédie du sang, terré à demi fou pendant vingt ans chez une Noire, il se fait brûler vif." Malgré sa nostalgie du vieux Sud, Faulkner livre un Sud corrompu par l'esclavage des Noirs, par la spoliation des Indiens et l'argent des Blancs. "Vous vous retournez, écrit Faulkner, et, abaissant vos regards, vous embrassez tout le Yoknapatawpha, qui s'étend à vos pieds aux derniers feux du jour. Et vous demeurez là, maître solitaire, dominant la somme entière de votre vie qui se déroule sous ce vol incessant d'éphémères étincelles. Comme le Seigneur au-dessus de Bethléem, vous planez en cet instant au-dessus de votre berceau, des hommes et des femmes qui vous ont fait ce que vous êtes, de ces archives, de ces chroniques de votre terre natale offertes à votre examen en mille cercles concentriques pareils à ceux qui rident l'eau vive sous laquelle votre passé dort d'un sommeil sans rêves ; vous trônez alors, inaccessible et serein au-dessus de ce microcosme des passions, des espoirs et des malheurs de l'homme, ambitions, terreurs, appétits, courage, abnégation, pitié, honneur, orgueil et péchés, tout cela lié pêle-mêle en un faisceau précaire, retenu par la trame et par la chaîne du frêle réseau de fer de sa rapacité, mais tout cela voué aussi à la réalisation de ses rêves."

Monnaie de singe (Soldier's Pay, 1926)
First Sentence : "LOWE, Julian, number -, late a Flying Cadet, Umptieth Squadron, Air Service, known as "One Wing" by the other embryonic aces of his flight, regarded the world with a yellow and disgruntled eye."
Faulkner écrit en six semaines son premier roman. "Soldier's Pay", sur les désillusions d'après guerre. Donald Mahon, jeune pilote de chasse pendant la guerre de 1914-1918, rentre dans son petit village de Géorgie, escorté par un vétéran et la veuve d'un soldat mort dans le conflit. Gravement blessé au visage, quasiment sourd et aveugle, la trame du récit mêle la guerre à l'amour et le passé retrouvé découvre d'autres combats inconscients, autour de sa fiancée particulièrement infidèle en son absence et du désir de la veuve à son égard…
"Lowe Julian, matricule..., hier cadet d’aviation. Nième escadrille de l’Air, surnommé « N’a qu’une aile » par les autres as en herbe de son escadrille, considérait le monde d’un œil jaune et maussade. Il souffrait de la même jaunisse que celle dont étaient atteints de plus galonnés que lui, depuis les commandants d’escadrille, en passant par les généraux, jusqu’aux délicieux lieutenants (sans parler de ce curieux animal des champs que les Français appellent si joliment aspirant aviateur). C’était fini : on l’avait privé de sa guerre.
C’est ainsi que, triste et dégoûté au point d’être insensible aux avantages du Pullman, il se tenait assis en faisant tourner sur son pouce sa casquette agrémentée de sa maudite bande blanche.
- « T’as un petit coup dans le nez, hein, petit gars ? dit Yaphank qui retournait chez lui et empestait d’une lieue le mauvais whisky.
- Ah ! fïchez-moi la paix, fit l’autre aigrement, et Yaphank ôta sa casquette martyrisée.
- Bien, Général - ou dois-je dire : Lieutenant ? Excusez-moi Madame. J’ai été gazé en faisant la corvée de cuisine et ma vue n’est plus la même depuis. A Berlin ! C’est sûr qu’on est sur sa piste, à Berlin ! Je suis sur ta piste, Berlin ! Ton compte est bon. Zéro fois mille, zéro fois cent, zéro fois zéro. Simple soldat, oh ! très simple, Joe Gilligan, en retard pour l’exercice, en retard pour la corvée, en retard pour le petit déjeuner quand le petit déjeuner est en retard. La statue de la Liberté ne m’a jamais vu et si elle me voyait, elle ferait demi-tour. »
Le cadet Lowe leva un œil blasé : « Dites-moi, qu’est-ce qu’on va boire ?
- Mon pote, j’en sais rien. Le type qui a fabriqué ça a reçu mardi dernier une médaille du Congrès. Il avait un plan pour faire cesser la guerre. Enrôler tous les Boches dans notre armée et leur en faire boire tant et plus pendant quarante jours. Tu comprends ? Finie la guerre ! Tu piges ?
- Ah ! oui, ils ne sauront plus si c’est une guerre ou un bal.
- Exactement. Toutes les femmes danseront. Ecoutez un peu. J’étais avec une petite femme très chic. Elle me dit : « Bon sang, mais tu ne sais pas danser. — Bien sûr que si, que je lui réponds. » On était en train de danser et elle fait : « Mais alors, qu’est-ce que tu fais dans la guerre ? — Qu’est-ce que cela peut bien te faire? Je danse aussi bien qu’un général, un commandant ou même un sergent, puisque je viens de ramasser quatre cents dollars au poker. » Elle me dit : « C’est vrai ? — Parole, que je lui réponds. Reste avec moi, ma biche. — Où qu’ tu les as mis ? » qu’elle me dit. Seulement je ne voulais pas les lui montrer, et alors le type il s’amène et lui demande : « Tu veux danser celle-là ? — Pour sûr, qu’elle répond, c’t oiseau-là, il danse pas. » C’était un sergent, le plus gros que j’aie jamais vu, dans le genre de ce type de l’Arkansas qui avait eu des histoires avec un nègre. Un de ses copains lui disait : « J’ai appris que tu as tué un nègre hier. — Oui, qu’il répond, il pesait deux cents livres. » Comme pour un ours.
Il s’abandonna aux cahots du train : « N... de D... ! fit le cadet Lowe.
- Tout à fait de votre avis, dit l’autre. Mais ça ne vous fera pas de mal. Je l’ai expérimentée. Mon chien n’en voudrait pas, pour sûr, mais c’est qu’il a pris de mauvaises habitudes en rôdant autour de l’Etat-Major de la brigade. C’est le seul trophée que j’aie rapporté de la guerre, la seule chose qui ne m’ait pas été arrachée des mains par un de ces petits sous-lieutenants que j’avais oublié de saluer. Ne voulez-vous pas en goûter un peu pour chasser l’humidité somnifère de ce maudit pays ? Tout l’honneur est pour moi et ça ne vous fera plus grand-chose après les deux premières gorgées. Cela me donne le mal du pays. Comme de voir un garage. Vous avez déjà travaillé dans un garage ? »
Yaphank avait avec lui un compagnon qui, assis par terre entre deux sièges, essayait de rallumer un cigare informe et mouillé. C’est comme la France dévastée, pensa le cadet Lowe en se rappelant les ronflements nocturnes du capitaine Bleyth, un pilote de la R.A.F. qu’on avait délégué pour raffermir provisoirement leur démocratie.
- « Pauvre soldat ! dit Yaphank avec des larmes dans la voix. Seul, tout seul dans le no man’s land et pas d’allumettes ! N’est-ce pas un enfer, la guerre ? Je vous le demande. » Il essaya de repousser l’autre avec sa jambe et il finit par lui donner des coups de pied, posément : « Bouge un peu, toi, le vieux marin, bouge..."

Moustiques (Mosquitoes, 1927)
En 1927, Faulkner écrit "Mosquitoes", satire des milieux artistiques de La Nouvelle-Orléans et pleine de ses souvenirs et de ses promenades avec
Sherwood Anderson. "Sur le pont du Nausicaa, au large de la Nouvelle-Orléans, les amis de Mrs Maurier complotent, aiment, jalousent et bavardent inlassablement. Mrs Maurier se pique d'aimer et de
soutenir les arts : outre son neveu et sa nièce, ses hôtes sont des artistes et des intellectuels, sculpteurs, romanciers, critiques... Les alliances, les secrets et les médisances s'échangent et
se confondent en un joyeux bourdonnement. William Faulkner brocarde ainsi la futilité et la médiocrité ordinaires de ces petits "moustiques" blancs, bourgeois et racistes." (Editions
Gallimard)
Une bourgeoise américaine, entichée de mécénat, a invité à une croisière sur son yacht plusieurs artistes de ses relations. Condamnés à l'oisiveté et à la vie en commun dans l'univers étroit et clos du navire, les protagonistes se cherchent et s`affrontent. Mais leurs quêtes amoureuses, leurs discussions et leurs inimitiés ne réussissent pas à les faire sortir d`eux-mêmes ni des conventions. Dans le roman de Steinbeck, "Les Naufragés de l 'autocar", comme dans "Moustiques", des personnages qui ne se connaissent pas se voient brusquement forcés de vivre ensemble sans possibilité d'évasion. Mais alors que les héros de Steinbeck s'aiment, se méprisent ou se détestent avec passion et portent en eux le germe de drames qui ne peuvent manquer d'éclater, les personnages de "Moustiques" ne vont jamais jusqu'au bout de leurs désirs. Leurs velléités débouchent sur des actes manqués, des occasions perdues, des malentendus. Hormis la fugue dans les marais, qui justifie objectivement le titre, il ne se passe rien, finalement, au cours de la croisière. Les chapitres sont courts, l'auteur passe sans cesse d'un héros à l'autre, des leitmotive, de nombreuses élisions donnent au roman un rythme vif malheureusement gâté, parfois, par de longs dialogues théoriques sur l'art de la création, où Faulkner, très marqué par des contemporains, comme Aldous Huxley ou James Joyce, essaie de faire le point de ses propres conceptions.

Sartoris (Sartoris, 1929)
L'oeuvre par laquelle Faulkner pensait acquérir une réputation d'écrivain. Il déchanta. "Avec Sartoris, écrit Faulkner, je découvris que le timbre-poste de mon sol natal méritait qu'on en fasse un livre et que je ne vivrais jamais assez longtemps pour l'épuiser, et je vis aussi qu'en sublimant le réel en universel, j'aurais toute liberté d'exercer ce que je pouvais avoir de talent. Une mine d'or s'ouvrait à moi, et c'est ainsi que je créais un monde qui m'appartint." C'est la première étape de sa communauté imaginaire de Yoknapatawpha, dans le Mississippi. Pour pénétrer dans l'univers du vieux Sud qui hante l'œuvre de Faulkner, la meilleure introduction est sans doute "Sartoris". On y trouve le grand thème social de la décadence, après la guerre de Sécession, a brutalité innée et la tension raciale. Dans une atmosphère lourde de cauchemars, pleine de souvenirs du passé et de mystères jamais élucidés, apparaissent les principaux personnages de la saga faulknérienne et, au premier rang, ces Sartoris, héroïques et fanfarons, dont aucun, de mémoire de vivant, n'est mort de façon naturelle.
On compte cinq parties au long de cette première saga, toutes centrées sur le jeune Bayard, de retour de la Première Guerre mondiale, descendant du colonel John Sartoris, l'archétype des pionniers prestigieux et violents du Sud, proche du propre arrière grand-père de l'auteur qui fit une belle carrière pendant la guerre de Sécession. C'est dans "L'Invaincu" que Faulkner fera un portrait complet de ce dernier. Ici nous suivons l'histoire de Bayard au travers d'évènement clé : taciturne, obsédé par la mort inutile mais glorieuse de son frère jumeau, John, dans le ciel de France. Bayard fait par la suite une brutale chute de cheval, puis a un premier et grave accident en automobile, un second accident, fatal à son grand-père et finit par se tuer lui-même dans un avion conçu pour l'acrobatie. Cependant il s'est marié, épousant celle qui adorait secrètement son frère jumeau, un fils lui naît le jour même de sa mort.
L'un des moments les plus connus est le chapitre IV, où est décrit le séjour hivernal de Bayard chez les Mac Callum, dans la montagne, sans femmes, dont le symbolisme est proche de L'Adieu aux armes publié par Hemingway en septembre de la même année...
"... Chaque fois qu’il respirait, son haleine, dont il pouvait presque apercevoir la pâle fumée, le lui réchauffait un peu ; mais chaque fois qu’il aspiraït, il avait la sensation que ses narines gelaient de nouveau. Il lui semblait toucher aux planches du plafond incliné qui s’appuyait sur le mur le plus bas du côté de Buddy, sentir le contact de l’atmosphère comprimée dans le coin surbaissé, viciée, glaciale, épaisse au point d’en être irrespirable, comme une bourbe invisible, et qu’il gisait là-dessous.. Il percevait sous lui le crissement sec des cosses de maïs. Il s’aperçut également que sa respiration devenait oppressée, pénible, et il fut pris d’une envie folle d’être debout, de remuer, devant du feu, à la lumière, n’importe où, n’importe où. Buddy, couché près de lui sous la masse à demi congelée de ce froid angoissant, parlait de la guerre dans son jargon confus et lent. C’était une histoire vague, décousue, sans commencement ni fin, surchargée d’oiseuses références à des lieux dont il écorchait effroyablement les noms. Elle vous laissait l’impression de gens, de pauvres êtres sans initiative, sans passé ni avenir, perdus dans un labyrinthe de préoccupations personnelles et contradictoires, et s’en allant, pour ainsi dire, donner de la tête contre un cauchemar inévitable et incompréhensible.
(..)
Buddy continuait de respirer régulièrement paisiblement, dans l’obscurité. Bayard entendait aussi sa propre respiration, mais dominée, entourée, englobée par cette autre respiration. Comme s’il n’eût été qu’une chose respirant, avec des efforts pénibles et contenus, au-dedans de lui-même dont la respiration s’identifiait avec celle de Buddy, absorbant l’air au point que la chose la plus petite devait faire effort pour en trouver.
Pendant ce temps, la chose la plus grande respirait profondément, calmement, inconsciente, endormie et lointaine, eh !... morte peut-être. Peut-être morte, et il se rappela ce matin-là, le revécut intensément, depuis le moment où il avait aperçu la fumée de la première balle traçante, jusqu’à celui où, du sommet de son virage sur l'aile, il avait vu le feu jaillir, comme le claquement joyeux d’une rouge oriflamme, de l’avant du Camel de John, le geste familier de son frère, et, - soudain, son corps qui plongeait maladroitement, à plat ventre, déséquilibré au milieu de l’air. Il revécut ce matin-là, comme on pourrait parcourir une histoire imprimée et souvent lue, s’efforçant de se rappeler, d’éprouver la sensation d’une balle pénétrant dans son propre corps ou dans sa tête, et qui aurait pu le tuer au même instant. Voilà qui faisait comprendre, qui expliquait tout : lui aussi était mort et, présentement, dans l'enfer, où il errait pour l’éternité, avec une illusion de vitesse, à la recherche de son frère qui, de son côté, était quelque part à sa recherche, et, tous deux, pour ne se rencontrer jamais. Il se recoucha sur le dos ; les cosses firent entendre sous lui un froissement semblable à un rire sarcastique.
La maison était pleine de bruits. Pour sa sensibilité à vif, le silence en était peuplé : craquement du bois sec dans la nuit glaciale, cliquetis des cosses à chaque respiration, l’atmosphère même, semblable, sous l’étau du froid, à de la neige fondue, et qui lui comprimait les poumons. Il avait froid aux pieds et les jambes en sueur, et, tout autour de son cœur brûlant, son corps était roidi et frissonnant. Il sortit ses bras nus de la couverture et resta ainsi un instant, sentant le froid ce peser sur lui comme une chape de plomb. Et, pendant tout temps, il entendait la calme respiration de Buddy et son propre souffle contenu et haletant, tous deux anonymes quoique intimement. mêlés l’un à l'autre ..."
C'est dans Sartoris que Faulkner raconte le plus directement sa propre histoire. Lorsque le jeune Bayard Sartoris revient dans la ville du Mississippi qu'il a quittée lorsqu'il est parti à la guerre, il cherche désespérément à savoir quoi faire. Il sait que quelque chose en lui ne va pas, mais il n'est pas vraiment sûr de la maladie ni de son traitement. Il erre dans la ville et dans la campagne environnante, parlant avec les gens, se disputant parfois avec eux. Il boit de l'alcool d'autant plus volontiers que la nation a adopté la loi sur la prohibition et que l'alcool est désormais illégal. L'alcool, cependant, ne lui procure qu'un oubli temporaire. Le désespoir est toujours là. Dans une section clé de ce roman de Faulkner, nous suivons Bayard Sartoris au cours d'une journée désespérée et futile. Il se saoule dans l'arrière-boutique du magasin local. Puis il va avec un ami voir des chevaux et voit un étalon très fougueux. Il saute dessus, le cheval s'emballe et Bayard est assommé par une branche d'arbre. Au début de notre premier extrait, il fait nuit et, la tête bandée, Bayard doit passer la nuit. Il est accompagné d'un vendeur nommé Hub, d'un agent de fret nommé Mitch et de trois Noirs, un trio musical, amené pour jouer la sérénade avec leurs instruments. Ils montent tous dans l'automobile de Bayard. C'est un groupe divers. Hub et Mitch sont tous deux blancs mais beaucoup plus bas dans l'échelle sociale que Bayard, et ils le savent. Les Noirs sont au bas de l'échelle. Comme Faulkner les traite, ils sont anonymes mais sont décrits avec sympathie. Dans ses œuvres ultérieures, Faulkner a intégré dans ses romans certains de ces Afro-Américains les plus mémorables de la littérature américaine. Bien qu'ils soient généralement présentés du point de vue du Sud, Faulkner est parfaitement conscient que ce sont des êtres humains comme lui, mais qui ont beaucoup souffert à cause de la couleur de leur peau. Il les traite avec plus de sympathie dans ses livres qu'il ne traite les blancs pauvres, qu'il montre parfois sous un jour très défavorable. Les pires blancs de son œuvre, créés comme les membres d'une famille nommée Snopes, sont presque inhumains dans leur énergie maléfique. Il ne les avait pas encore créés lorsqu'il a écrit Sartoris. Ils apparaissent dans certains de ses romans ultérieurs, où ils évincent les gens comme les Sartoris, les aristocrates futiles. Hub et Mitch dans Sartoris, cependant, sont des hommes décents, rien à voir avec le clan des Snopes.
Dans cet extrait de Sartoris , les six hommes boivent et conduisent à travers la campagne au clair de lune. Dans une ville voisine, ils s'arrêtent et demandent aux trio afro-américains de chanter la sérénade aux filles qui vivent dans un collège...
"Later they returned for the jug in Bayard’s car, Bayard and Hub and a third young man, freight agent at the railway station, with three negroes and a bull fiddle in the rear seat. But they drove no farther than the edge of the field above the house and stopped there while Hub went on afoot down the sandy road toward the barn. The moon stood pale and cold overhead, and on all sides insects shrilled in the dusty undergrowth. In the rear seat the negroes murmured amog themselves.
“Fine night.,” Mitch, the freight agent, suggested. Bayard made no reply. He smoked moodily, his head closely helmeted in its white bandage. Moon and insects were one, audible and visible, dimmensionless and without source.
After a while Hub materialized against the dissolving vagueness of the road, crowned by the silver slant of his hat, and he came up and swung the jug on to the door and removed the stopper. Mitch pas- sed it to Bayard.
“Drink,” Bayard said, and Mitch did so. The others drank.
“We ain’t got nothin’ for the niggers to drink out of,” Hub said.
“That’s so,” Mitch agreed. He turned in his seat. “Ain’t one of you boys got a cup or something?” The negroes murmured again, questioning one another in mellow consternation.
“Wait,” Bayard said. He got out and lifted the hood and removed the cap from the breather-pipe. “It’ll taste a little like oil for a drink or two. But you boys won’t notice it after that.”
“Naw, suh,” the negroes agreed in chorus. One took the cup and wiped it out with the corner of his coat, and they too drank in turn, with smacking expulsions of breath. Bayard replaced the cap and got in the car.
“Anybody want another right now?” Hub asked, poising the corn cob .
“Give Mitch another,” Bayard directed. “He’ll have to catch up.”
Mitch drank again. Then Bayard took the jug and tilted it. The others watched him respectfully.
“Dam’f he don’t drink it,” Mitch murmured. “I’d be afraid to hit it so often, if I was you.”
“It’s my damned head.’’ Bayard lowered the jug and passed it to Hub. “I keep thinking another drink will ease it off some.”
“Doc put that bandage on too tight,” Hub said. “Want it loosened some?”
“I don’t know.” Bayard lit another cigarette and threw the match away. “I believe I’ll take it off. It’s been on there long enough.” He raised his hands and fumbled at the bandage.
“You better let it alone,” Mitch warned him. But he continued to fumble at the fastening; then he slid his fingers beneath a turn of the cloth and tugged at it savagely. One of the negroes leaned forward with a pocket knife and severed it, and they watched him as he stripped it off and flung it away.
“You ought not to done that,” Mitch told him.
“Ah, let him take it off if he wants.” Hub said. “He’s all right.” He got in and stowed the jug away between his knees, and Bayard turned the car about. The sandy road hissed beneath the broad tires of it and rose shaling into the woods again where the dappled moonlight was intermittent, treacherous with dissolving vistas. Invisible and sourceless among the shifting patterns of light and shade, whippoorwills were like flutes tongued liquidly. The road passed out of the woods and descended, with sand in shifting and silent lurches, and they turned on to the valley road and away from town.
The car went on, on the dry hissing of the closed muffler. The negroes murmured among themselves with mellow snatches of laughter whipped like scraps of torn paper away behind. They passed the iron gates and Bayard’s home serenely in the moonlight among its trees, and the silent, box-like flag station and the metal-roofed cotton gin on the railroad siding.
The road rose at last into hills. It was smooth and empty and winding, and the negroes fell silent as Bayard increased speed. But still it was not anything like what they had anticipated of him. Twice more they stopped and drank, and then from an ultimate hilltop they looked down upon another cluster of lights like a clotting of beads upon the pale gash where the railroad ran. Hub produced the breather-cap and they drank again.
Through streets identical with those at home they moved slowly, toward an identical square. People on the square turned and looked curiously after them. They crossed the square and followed another street and went on between broad lawns and shaded windows, and presently beyond an iron fence and well back among black-and-silver trees, lighted windows hung in ordered tiers like rectangular lanterns strung among the branches.
They stopped here, in shadow. The negroes descended and lifted the bass viol out, and a guitar. The third one held a slender tube frosted over with keys upon which the intermittent moon glinted in pale points, and they stood with their heads together, murmuring among themselves and touching plaintive muted chords from the strings. Then the one with the clarinet raised it to his lips.
The tunes were old tunes. Some of them were sophisticated tunes and formally intricate, but in the rendition this was lost, and all of them were imbued instead with a plaintive similarity, a slurred and rhythmic simplicity; and they drifted in rich, plaintive chords upon the silver air, fading, dying in minor reiterations along the treacherous vistas of the moon. They played again, an old waltz. The college Cerberus came across the dappled lawn to the fence and leaned his arms upon it, a lumped listening shadow among other shadows. Across the street, in the shadows there, other listeners stood. A car approached and slowed to the curb and shut off engine and lights, and in the tiered windows heads leaned, aureoled against the lighted rooms behind, without individuality, feminine, distant, delicately and divinely young.
They played "Home, Sweet Home" and when the rich minor died away, across to them came a soft clapping of slender palms. Then Mitch sang “Good Night, Ladies” in his true, oversweet tenor, and the young hands were more importunate, and as they drove away the slender heads leaned aureoled with bright hair in the lighted windows and the soft clapping drifted after them for a long while, fainter and fainter in the silver silence and the moon’s infinitude. . ."
Dans ce deuxième extrait, la sérénade terminées, les voici de retour dans leur propre ville. Le marshal local les arrête lorsqu'ils atteignent la place de la ville. Avec une fermeté bienveillante, il veille à ce que les Afro-Américains regagnent leur logement et suggère à Mitch et Hub de faire de même. Il reste Bayard, encore étourdi par la boisson, toujours agité, toujours désespéré. Mais il sait que le marshal a raison de vouloir l'empêcher de conduire. Lorsque le marshal l'emmène dans la petite prison locale, il donne à Bayard son propre lit pour dormir. À la fin de la scène, la nuit au clair de lune est complètement calme, sauf pour Bayard....
"The moon stood well down the sky. Its light was now a cold silver on things, spent and a little wearied, and the world was empty as they rolled without lights along a street lifeless and fixed in black and silver as any street in the moon itself. Beneath stippled intermittent shadows they went, passed quiet intersections dissolving away, occasionally a car motionless at the curb before a house. A dog crossed the street ahead of them trotting, and went on across a lawn and so from sight, but saving this there was no movement anywhere.
The square opened spaciously about the absinthe-cloudy mass of elms that surrounded the courthouse. Among them the round spaced globes were more like huge, pallid grapes than ever. Above the exposed vault in each bank burned a single bulb; inside the hotel lobby, before which a row of cars was aligned, another burned. Other lights there were none.
They circled the courthouse, and a shadow moved near the hotel door and de- tached itself from shadow and came to the curb, a white shirt glinting within a spread coat; and as the car swung slowly toward another street, the man hailed them. Bayard stopped and the man came through the blanched dust and laid his hand on the door.
“Hi, Buck,” Mitch said. “You’re up pretty late, ain’t you?”
The man had a sober, good-natured horse’s face. He wore a metal star on his unbuttoned waistcoat. His coat humped slightly over his hip. “What you boys doin’?’’ he asked. “Been to a dance?” “Serenading,” Bayard answered. “Want a drink, Buck?”
“No, much obliged.” He stood with his hand on the door, gravely and good- naturedly serious. “Ain’t you fellers out kind of late, yo’selves?”
“It is gettin’ on , Mitch agreed. The marshal lifted his foot to the running-board. Beneath his hat his eyes were in shadow. “We’re going home now,” Mitch said. The other pondered quietly, and Bayard added:
“Sure; we’re on our way home now.” The marshal moved his head slightly and spoke to the negroes. “I reckon you boys are about ready to turn in, ain’t you?”
“Yes, suh,” the negroes answered, and they got out and lifted the viol out. Bayard gave Reno a bill and they thanked him and said good night and picked up the viol and departed quietly down a side street. The marshal turned his head again.
“Ain’t that yo’ car in front of Rogers’ cafe, Mitch?” he asked.
“Reckon so. That’s where I left it.” “Well, suppose you run Hub out home, lessen he’s goin’ to stay in town tonight. Bayard better come with me.”
“Aw, hell, Buck,” Mitch protested. “What for? Bayard demanded.
“His folks are worried about him,” the other answered. “They ain’t seen hide nor hair of him since that stallion throwed him. Where’s yo’ bandage, Bayard?”
“Took it off,” he answered shortly. “See here, Buck, we’re going to put Mitch out and then Hub and me are going straight home.”
“You been on yo’ way home ever since fo’ o’clock, Bayard,” the marshal replied soberly, “but you don’t seem to git no nearer there. I reckon you better come with me tonight, like yo’ aunt said.”
“Did Aunt Jenny tell you to arrest me?” “They was worried about you, son. Miss Jenny just phoned and asked me to kind of see if you was all right until mawnin’. So I reckon we better. You ought to went on home this evening’.”
“Aw, have a heart , Buck,” Mitch protested.
“I ruther make Bayard mad than Miss Jenny,” the other answered patiently. “You boys go on, and Bayard better come with me.”
Mitch and Hub got out and Hub lifted out his jug and they said good night and went on to where Mitch’s car stood before the restaurant. The marshal got in beside Bayard. The jail was not far. It loomed presently above its walled court, square and implacable, its slitted upper windows brutal as saber-blows. They turned into an alley, and the marshal descended and opened a gate, and Bayard drove into the grassless and littered compound and stopped while the other went on ahead to a small garage in which stood a Ford. He backed this out and motioned Bayard forward. The garage was built to the Ford’s dimensions and about a third of Bayard’s car stuck out the door of it.
“Better’n nothin’, though,” the marshal said. “Come on.” They entered through the kitchen, into the jailkeeper’s living-quarters, and Bayard waited in a dark passage until the other found a light. Then he entered a bleak, neat room, containing spare conglomerate furnishings and a few scattered articles of masculine apparel.
“Say,” Bayard objected, “aren’t you giving me your bed?”
“Won’t need it befo’ mawnin’,” the other answered. “You’ll be gone, then. Want me to he’p you off with yo’ clothes?”
“No. I’m all right.” Then, more graciously: “Good night, Buck. And much obliged.”
“Good night,” the marshal answered.
He closed the door behind him and Bayard removed his coat and shoes and his tie and snapped the light off and lay on the bed. Moonlight seeped into the room impalpably, refracted and sourceless; the night was without any sound. Beyond the window a cornice rose in a succession of shallow steps against the opaline and dimensionless sky. His head was clear and cold; the whisky he had drunk was completely dead. Or rather, it was as though his head were one Bayard who lay on a strange bed and whose alcohol-dulled nerves radiated like threads of ice through that body which he must drag forever about a bleak and barren world with him. “Hell,” he said, lying on his back, staring out the window where nothing was to be seen, waiting for sleep, not knowing if it would come or not, not caring a particular damn either way. Nothing to be seen, and the long, long span of a man’s natural life. Three score and ten years to drag stub-born body about the world and cozen its insistent demands. Three score and ten, the Bible said. Seventy years. And he was only twenty-six. Not much more than a third through it. Hell. . ."
L'aspect conflictuel dans ce roman n'est pas, comme il le sera dans les romans ultérieurs de Faulkner, entre les générations, les classes ou les races, mais entre l'homme et son environnement, et entre l'homme et lui-même. Ici Faulkner écrit avec clarté, parfois d'une manière simple et poétique. Bien qu'il passe fréquemment d'une petite scène à une autre, le roman n'a rien à voir avec le style complexe de ses dernières années...
Faulkner hésite encore sur la voie à prendre, qu'il trouvera deux ans plus tard avec "Le Bruit et la Fureur", l'oeuvre qui marque l'édification de l'univers faulknérien que connaissons, quatre chef d'oeuvre en quelques quatre années, 1929-1932, Le Bruit et la Fureur, Tandis que j'agonise, Sanctuaire, Lumière d'août ...

Le bruit et la fureur (The Sound and the Fury, 1929)
"When the shadow of the sash appeared in the curtains it was between seven and eight oclock and then I was in time again, hearing the watch. It was Grandfather’s and when Father gave it to me he said I give you the mausoleum of all hope and desire; it’s rather excrutiatingly apt that you will use it to gain the reducto absurdum of all human experience which can fit your individual needs no better than it fitted his or his father’s. I give it to you not that you may remember time, but that you might forget it now and then for a moment and not spend all your breath trying to conquer it. Because no battle is ever won he said. They are not even fought. The field only reveals to man his own folly and despair, and victory is an illusion of philosophers and fools."
Nous sommes dans l'Etat du Mississipi, dans une de ces vieilles familles du Sud, jadis riches et hautaines, aujourd'hui tombées dans la misère et l'abjection. Trois générations qui se déchirent, Jason Campon et sa femme Caroline, née Bascomb; leur fille Candace (Caddy), et leurs trois fils, Quentin, Jason et Maury (Benjy); et Quentin, la fille de Caddy. Autour d'eux, trois générations d'afro-américains, Dilsey et son mari, Roskus; leurs enfants, Versh, T.P. et Frony; et plus tard, Luster, le fils de Frony.
William Faulkner établit pour son récit une chronologie de base, mais qu'il va par la suite quelque peu brouillée : la première partie se passe le 7avril 1928; la seconde, dix-huit ans auparavant, le 2 juin 1910, la troisième, le 6 avril 1928, et la quatrième, deux jours après, le 8 avril. Les événements, présents ou passés, nous parviennent à travers une série de monologues intérieurs, la dernière partie étant seule un récit direct ou, par suite, apparaitra la description physique des personnages (Caroline Compson, Jason, Dilsey, Benjy) dont le caractère nous a peu à peu été révélé au cours des monologues précédents..
L'enchaînement du récit s'articule autour de quatre grands blocs de destins individuels, tous menés par une même inéluctable et sombre dramaturgie, Caddy, Quentin, Benjy, Jason. Caddy, opiniâtre et sensuelle, a pris un amant, Dalton Ames. Le jour où elle découvre enceinte, elle accompagne sa mère à French Lick, station thermale dans l'État d'Indiana, pour y trouver un mari. Le 25 avril 1910, elle épouse Sidney Herbert Head. Quentin, qu 'un attachement incestueux (mais platonique) rattache morbidement à sa sœur, se suicide de jalousie, le 2 juin 1910, à l'université Harvard où il était allé faire ses études. Un an plus tard, Caddy, chassée par son mari, abandonne à ses parents la petite fille qu 'elle vient de mettre au monde et, qu'en souvenir de son frère, elle a appelée Quentin. C'est ensuite la mort du père, qui sombre dans l'alcoolisme, laissant sa femme ruínée avec leurs deux fils survivants, Jason et Benjamin, et le bébé que Caddy n'a même plus la permission de voir. Jason est un monstre de fourberíe et de sadisme, Benjamin est idiot. Un jour, s'étant échappé du jardin, il a tenté de violer une fillette. Par prudence, on l'a fait châtrer. Depuis lors, inoffensif, il erre comme une bête et ne s'exprime que par des cris. Quentin, la fille de Caddy, a grandi. Au moment où débute "The Sound and the Fury", elle a dix-sept ans, et, comme autrefois sa mère, elle se donne déjà aux jeunes gens de la ville, Son oncle Jason la poursuit de sa haine, et c'est la vraiment tout le sujet du livre, la haine de Jason au cours des journées du 6, 7 et 8 avril 1928....
C'est avec cet ouvrage que William Faulkner fut révélé au public et à la critique. Auteur de la moiteur étouffante du sud des États-Unis, Faulkner a réellement bouleversé l'académisme narratif en plaçant son récit sous le signe du monologue intérieur, un monologue d'abord "confié" à un simple d'esprit passablement dépassé par les événements qui se déroulent autour de lui. Sur un rythme oppressant, monologues diffus et descriptions objectives s'entrelaçant selon un schéma musical, trois frères (un débile châtré, un suicidé par amour de sa sœur, un demi-malin vite trompé) racontent le moment décisif de leur vie.
C'est un incontournable jalon dans l'histoire littéraire non seulement américaine mais mondiale - jalon qui n`aurait sans doute pas vu le jour sans l'U!ysse de Joyce ; mais c'est aussi un livre sans lequel une bonne partie de la litterature moderne ne serait pas ce
qu'elle est. Le titre en est emprunte à Shakespeare, qui donne à la fin de Macbeth cette définition de la vie : "C'est une histoire que conte un idiot, une histoire pleine de bruit et de fureur, mais vide de signification." (Life’s but a walking shadow, a poor player / That struts and frets his hour upon the stage / And then is heard no more: it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, . Signifying nothing. - Act 5, Scene 5)

Sept Avril 1928
"Through the fence, between the curling flower spaces, I could see them hitting. They were coming toward where the flag was and I went along the fence. Luster was hunting in the grass by the flower tree. They took the flag out, and they were hitting. Then they put the flag back and they went to the table, and he hit and the other hit. Then they went on, and I went along the fence. Luster came away from the flower tree and we went along the fence and they stopped and we stopped and I looked through the fence while Luster was hunting in the grass..."
L'être humain qui prend la parole au début du livre est bel et bien un idiot. Il a trente-trois ans. Il s'appelait Maury, mais on lui a donne le nom de Benjy (diminutif de Benjamin) parce que Maury est aussi le prénom de son oncle et qu'avoir un tel homonyme n'eût pas été
flatteur pour ce dernier. Qu'un idiot puisse conter une histoire semble dénué de signification à ceux qui estiment qu'un homme de lettres qui prend la plume, délivre à chaque mot un message d'importance. Le jour où on écoute parler cet idiot est le 7 avril 1928, mais il ne nous entretient pas seulement de ce qu'il fait ou voit ce jour-là {en fait pas grand-chose). A chaque instant. il bute sur un détail qui vient lui remettre en mémoire, d'une façon très intense et souvent très douloureuse, un lambeau du passé. Luster, le jeune Noir chargé
de veiller sur lui, ne comprend pas ce phénomène. Croyant que cela va le distraire, il le laisse s'approcher d'un terrain de golf. Un des joueurs appelle le caddie. Or la sœur de l'idiot, qui maintenant vit au loin, se nommait Caddy. Le malheureux se souvient qu'elle
l'aimait bien et s'occupait de lui. ll hurle jusqu`à ce que Luster ait trouvé un moyen de le distraire. D`une manière générale, l`atmosphère qui règne autour de lui ce 7 avril l'angoisse. Confusément, il la sent lourde d'un drame latent. Cela lui rappelle des journées semblables : l'enterrement de sa grand-mère alors qu`il était tout enfant et. plus tard, le mariage de Caddy. Il reste incapable de raconter avec un minimum de logique et de cohérence les événements auxquels il a été mêlé comme témoin ou comme acteur. Ces événements, qui à eux tous constituent l`histoire tragique et mouvementée, pleine de passion. de folie et de sang de la famille Compson, il nous les donne seulement à entrevoir. Faulkner sait par son écriture nous faire entrer dans son jeu, dans un monologue qui sait créer un climat trouble et lourd. Mais soudain l'idiot se tait. À sa façon, il a dit ce qu`il savait ...
I went along the fence, to the gate, where the girls passed with their booksatchels. “You, Benjy.” Luster said. “Come back here."
You cant do no good looking through the gate, T. P. said. Miss Caddy done gone long ways away. Done got married and left you. You cant do no good, holding to the gate and crying. She cant hear you.
What is it he wants, T. P. Mother said. Cant you play with him and keep him quiet.
He wants to go down yonder and look through the gate, T. P. said.
Well, he cannot do it. Mother said. It's raining. You will just have to play with him and keep him quiet. You, Benjamin.
Aint nothing going to quiet him, T. P. said. He think if he down to the gate. Miss Caddy come hack.
Nonsense, Mother said.
I could hear them talking. I went out the door and I couldn’t hear them, and I went down to the gate, where the girls passed with their booksatchels. They looked at me, walking fast, with their heads turned. I tried to say, but they went on, and I went along the fence, trying to say, and they went faster. Then they were run- ning and I came to the comer of the fence and I couldn’t go any further, and I held to the fence, looking after them and trying to say.
“You, Benjy." T. P. said. “What you doing, slipping out. Dont you know Dilsey whip you.”
“You cant do no good, moaning and slobbering through the fence.” T. P. said, “You done skeered them chillen. Look at them, walking on the other side of the street."
How did he get out. Father said. Did you leave the gate unlatched when you came in, Jason.
Of course not, Jason said. Dont you know I've got better sense than to do that. Do you think I wanted anything like this to happen. This family is bad enough, God knows. I could have told you,all the time. I reckon you'll send him to Jackson, note. If Mrs Burgess dont shoot him first.
Hush, Father said.
I could have told you, all the time, Jason said.
It was open when I touched it, and I held to it in the twilight. I wasn't crying, and I tried to stop, watching the girls coming along in the twilight. I wasn't crying.
‘‘There he is,"
They stopped.
“He cant get out. He wont hurt anybody, anyway. Come on."
Tm scared to. I'm scared. I'm going to cross the street."
“He cant get out."
I wasn’t crying.
“Don't be a 'fraid cat. Come on."
They came on in the twilight. I wasn't crying, and I held to the gate. They came slow.
“I'm scared.”
“He wont hurt you. I pass here every day. He just runs along the fence."
They came on. I opened the gate and they stopped, turning. I was trying to say, and I caught her, trying to say, and she screamed and I was trying to say and trying and the bright shapes began to stop and I tried to get out. I tried to get it off of my face, but the bright shapes were going again. They were going up the hill to where it fell away and I tried to cry. But when I breathed in, I couldn't breathe out again to cry, and I tried to keep from falling off the hill and I fell off the hill into the bright, whirling shapes.
Here, loony, Luster said. Here come some. Hush your slobbering and moaning, now.
They came to the flag. He took it out and they hit, then he put the flag back.
“Mister," Luster said.
He looked around. “What." he said.
“Want to buy a golf ball." Luster said.
"... J'ai longé la barrière jusqu'à la grille où les petites filles passaient avec leurs cartables. - Eh, Benjy, dit Luster, revenez ici.
(Ça ne vous avance a rien de regarder par la grille, dit T. P. Il y a beau temps que miss Caddy est partie. Elle s'est mariée et elle vous a laissé. Ça ne vous avance à rien de rester à crier comme ça, devant cette grille. Elle ne peut pas vous entendre.
Qu'est-ce qu'il veut, T. P. ? dit maman. Tu ne peux pas jouer avec lui et le faire tenir tranquille ?
Il veut aller là-bas, regarder à travers la grille, dit T. P.
Eh bien, ça n'est pas possible, dit maman. Il pleut. Tu n'as qu'à jouer avec lui et le faire tenir tranquille, Benjamin, voyons.
On ne pourra pas le calmer, dit T. P. Il croit que s'il va à la grille ça fera venir miss Caddy.
C'est absurde, dit maman.)
Je pouvais les entendre parler. J'aí franchi la porte et je n'ai plus pu les entendre, et je suis allé à la grille où les petites filles passaient avec leurs cartables. Elles m'ont regardé en marchant vite, la tête tournée. J'ai essayé de leur dire, mais elles ont continué, et j'aí longé
la grille, m'efforçant de leur dire, et elles ont marché plus vite. Et puis, elles se sont mises à courir, et je suis arrivé au coin de la barrière, et je n'ai pas pu aller plus loin, et je me suis cramponné aux barreaux. Je les regardais, j'essayaís de leur dire.
- Benjy, dit T. P. En voilà une idée de se sauver comme ça. Vous savez bien que Dilsey vous fouettera.
- Ça ne vous avancera à rien de gémir et de pleurnicher devant cette barrière, dit T. P. Vous avez fait peur à ces enfants. Regardez. Elles passent de l'autre côté de la route.
(Comment a-t-il pu sortir? dit papa. As-tu laissé la grille ouverte quand tu es entré, Jason ?
Mais non, dit Jason. Je ne suis tout de même pas si bête que ça. Pensez-vous que j'aurais voulu qu 'il arrive une chose pareille? Dieu sait qu 'il y avait déjà assez de saleté dans notre famille. Il y a longtemps que je l'avais prévu. Je suppose que vous allez le mettre à Jackson après ça. A moins qu 'auparavant Mrs Burgess ne lui envoie un coup de fusil.
Chut, dit papa.
Il y a longtemps que je l'avais prévu, dit Jason.)
Elle était ouverte quand je l'aí touchée, et je me suis cramponné dans le crépuscule. Je ne criais pas, et j'essayais de m'arrêter en regardant les petites filles qui arrivaient dans le crépuscule. Je ne pleuraís pas.
- Le voilà !
Elles se sont arrêtées.
- Il ne peut pas sortir. Du reste, il ne pourrait pas nous faire de mal. Viens.
- J'ose pas. J'aí peur. Je vais passer de l'autre côté de la route.
- Il ne peut pas sortir.
Je ne criais pas.
- Poule mouillée! Viens donc.
Elles approchaient dans le crépuscule. Je ne criais pas et je me tenais à la grille. Elles arrivaient lentement.
- J 'ai peur.
- Il ne te fera pas de mal. Je passe ici tous les jours. Il se contente de courir le long de la barrière.
Elles sont arrivées. J'ai ouvert la grille et elles se sont arrêtées, la tête tournée. J'essayais de leur dire, et je l'ai saisie, j'essayais de dire, et elle a hurlé, et j'essayais de dire, j'essayais, et les formes lumineuses ont commencé à s'arrêter, et j'ai essayé de sortir. J'essayais
d'en débarrasser mon visage, mais les formes lumineuses étaient reparties. Elles grimpaient la colline ou tout a disparu, et j'ai essayé de crier. Mais, après avoir aspiré, je n'ai plus pu expirer pour crier et j'ai essayé de m'empêcher de tomber du haut de la colline, et je suis tombé du haut de la colline parmi les formes lumineuses et tourbillonnantes.
(Ici, maboul, dit Luster. Venez un peu ici. Finissez vos plaintes et vos pleurnícheries.)
Ils sont arrivés au drapeau. Il l'a enlevé, et ils ont frappé, et puis ils ont remis le drapeau.
- Monsieur, dit Luster.
Il s'est retourné. - Quoi? dit-il.
- Vous ne voudriez pas acheter une balle de golf? dit Luster...."
(traductions M.E.Coindreau, Gallimard)
"Here I done built you a fire, and you wont even look at it,”
Your name is Benjy, Caddy said. Do you hear, Benjy, Benjy,
Dont tell him that. Mother said. Bring him here,
Caddy lifted me under the arms.
Get up, Mau, I mean Benjy, she said.
Dont try to carry him. Mother said. Cant you lead him over here. Is that too much for you to think of.
I can carry him, Caddy said, “Let me carry him up, Dilsey.”
"Go on. Minute.” Dilsey said. "You aint big enough to tote a flea. You go on and be quiet, like Mr Jason said.”
There was a light at the top of the stairs. Father was there, in his shirt sleeves. The way he looked said Hush. Caddy whispered,
"Is Mother sick.”
Versh set me down and we went into Mother's room. There was a fire. It was rising and falling on the walls. There was another fire in the mirror. I could smell the sickness. It was a cloth folded on Mother's head. Her hair was on the pillow. The fire didn't reach it, but it shone on her hand, where her rings were jumping.
"Come and tell Mother goodnight." Caddy said. We went to the bed. The fire went out of the mirror. Father got up from the bed and lifted me up and Mother put her hand on my head.
"What time is it.” Mother said. Her eyes were closed.
"Ten minutes to seven.” Father said.
"It's too early for him to go to bed.” Mother said. "Hell wake up at daybreak, and I simply cannot bear another day like today.”
"There, there.” Father said. He touched Mother's face.
"I know Tm nothing but a burden to you.” Mother said. "But I'll be gone soon. Then you will be rid of my bothering.”

Deux Juin 1910
"When the shadow of the sash appeared on the curtains it was between seven and eight oclock and then I was in time again, hearing the watch. It was Grandfather s and when Father gave it to me he said, Quentin, I give you the mausoleum of all hope and desire; it's rather excrutiating-ly apt that you will use it to gain the reducto absurdum of all human experience which can fit your individual needs no better than it fitted his or his father’s. I give it to you not that you may remember time, but that you might forget it now and then for a moment and not spend all your breath trying to conquer it. Because no battle is ever won he said. They are not even fought. The field only reveals to man his own folly and despair, and victory is an illusion of philosophers and fools.."
Le frère de Benjy, Quentin, va prendre le relais et nous révèler comment et pourquoi, le 2 juin 1910. alors qu`il était etudiant à Harvard, il en est venu à se donner la mort, en se noyant dans la James River, à Cambridge. Il est certes plus clair et plus explicite que Benjy, mais il a honte de ce qu'il y a en lui et n'ose en parler. À cause de cela, son personnage s`entoure d'un certain halo de mystère qui ne se dissipe que peu à peu. Comme l'idiot, il aime sa soeur Caddy. Mais, tandis que l'attachement de celui-ci restait innocent, Quentin éprouvait une vraie passion d`homme. Sans doute eût-il sufiî que sa sœur l'encourageât un tout petit peu pour que les scrupules qui le paralysaient s'évanouissent. En revanche, alors que le jeune homme demeurait indifférent aux autres femmes, elle ne s'est pas fait faute de prendre des amants puis, enceinte, un mari. La jalousie de Quentin s`est exacerbée. Non seulement il lui en veut. mais il en veut à ceux de ses camarades qui jouent les Don Juan et en retirent un visible bonheur. Ce 2 juin 1910, un peu plus d'un mois après le mariage de Caddy, Quentin sèche ses cours, va acheter des fers à repasser, les cache sous un pont. à quelque distance de la ville. C'est cette promenade que Faulkner raconte. avec tantôt une grande minutie. tantôt de savantes ellipses. En utilisant des moyens très différents, il réussit à creer une atmosphère poignante et plus musicalement nostalgique que celle du monologue de Benjy ..
" ... il pouvait bien de temps à autre offrir le gîte et le couvert à l'oncle Maury et lui prêter un peu d'argent lui qui entretenait si chaudement la croyance de son père en l'origine céleste de sa race alors maman pleurait et disait que papa se considérait comme d'une essence supérieure à la sienne et qu'il tournait l'oncle Maury en ridicule pour nous faire partager ses vues elle ne pouvait pas comprendre que papa nous enseignait que les hommes ne sont que des poupées bourrées de son puisé au tas de détritus où ont été jetées toutes les poupées du passé le son s'écoulant de blessures dans des flancs qui n'avaient pas souffert la mort pour moi. Il m'arrivait de me représenter la mort comme un homme dans le genre de grand-père un de ses amis une espèce d'ami particulier personnel comme nous nous représentions le bureau de grand-père ne pas y toucher ni même parler haut dans la pièce où il se trouvait je me les imaginais toujours tous les deux ensemble quelque part attendant perpétuellement que le colonel Sartoris descendit s'asseoír avec eux attendant sur une haute colline par-delà les cyprès le colonel Sartoris était sur une colline encore plus haute d'où il regardait quelque chose au loin et ils attendaient qu'il eût fini de regarder et qu'il descendît Grand-père portait son uniforme et nous pouvions entendre le murmure de
leurs voix qui nous arrivait par-derrière les cyprès ils parlaient toujours et grand-père avait toujours raison
Moins le quart se mit à sonner. La première note vibra, mesurée et tranquille, sereine et péremptoire, vidant le lent silence pour faire place à la note suivante c'est ça si les gens pouvaient toujours s'interchanger comme ça émerger quelques secondes comme une
flamme tourbillonnante puis proprement s'éteindre dans la fraîcheur de la nuit éternelle au lieu de rester étendu luttant pour oublier le hamac jusqu'au moment où tous les cyprès dégageaient cette odeur poignante et morte de parfum dont Benjy avait tant horreur. Rien
qu'en imaginant le bouquet d'arbres il me semblait entendre des murmures des désirs secrets sentir le battement du sang chaud sous des chairs sauvages et offertes regarder contre des paupières rougies les porcs lâches par couples se précipiter accouplés dans la mer et lui il faut se tenir éveillé pour voir le mal s'accomplir pendant quelques instants ce n'est pas tous les jours que et moi il ne faut même pas si longtemps pour un homme courageux et lui tu considères donc cela comme du courage et moi certainement pas vous et lui tout homme est l'arbitre de ses propres vertus le fait qu'on estime qu'un acte est courageux ou non est plus important que l'acte lui-même qu'aucun acte sans quoi on ne pourrait jamais être sincère et moi vous ne me croyez pas sérieux et lui je crois que tu es trop sérieux pour me donner de vraies raisons de m'inquiéter autrement tu n'aurais pas été poussé à recourir à l'expédient de me dire que tu avais commis un inceste et moi je ne mentais pas je ne mentais pas et lui tu désirais sublimer en une chose horrible un peu de la folie naturelle aux humains et puis l'exorciser au moyen de la vérité et moi c'était pour isoler Caddy de ce monde bruyant et le forcer ainsi à nous renier et le son en serait alors comme si cela n'avait jamais été et lui as-tu essayé de le lui faire faire et moi j'avais peur de le faire peur qu'elle n'acceptât peut-être et alors c'eût été inutile mais en vous disant que nous l'avions fait la chose devenait positive et les autres eussent été différents et le monde se serait enfui avec fracas et lui quant à l`autre sujet là encore tu ne mens pas maintenant mais tu ne vois pas encore ce qu'il y a en toi cette part de vérité générale la succession d'évènements naturels et leurs causes qui obscurcit le front de tous les hommes même de Benjy tu ne penses pas à une chose finie tu contemples une apothéose dans laquelle un état d'esprit temporaire deviendra symétrique au-dessus de la chair et conscient à la fois de sa propre existence ainsi que de la chair il ne te mettra pas entièrement de côté ne sera même pas mort et moi temporaire et lui tu ne peux pas supporter la pensée qu'un jour tu ne souffriras plus comme ça maintenant nous arrivons au point tu sembles ne voir en tout cela qu'une aventure qui te fera blanchir les cheveux en une nuit si j'ose dire sans modifier en rien ton apparence tu ne le feras pas dans ces conditions-là ce sera une chance à courir et ce qu'il y a d'étrange c'est que l'homme conçu accidentellement et dont chaque respiration n'est qu'un nouveau coup de dés truqués à son désavantage ne veut pas affronter cette étape finale qu'il sait d'avance avoir à affronter sans essayer d'abord des expédients qui vont de la violence aux chicaneries mesquines expédients qui ne tromperaient pas un enfant et un beau jour poussé à bout par le dégoût il risque tout sur une carte retournée à l'aveuglette un homme ne fait jamais cela sous la première impulsion du désespoir du remords ou du deuil il ne le fait qu'après avoir compris que même le désespoir le remords et le deuil n'ont pas grande importance pour le sombre jeteur de dés et moi temporaire et lui on croit difficilement qu'un amour un chagrin ne sont que des obligations achetées sans motif ultérieur et qui viennent à terme qu'on le désire ou non et sont remboursées sans avertissement préalable pour être remplacées par l`emprunt quel qu'il soit que les dieux se trouvent lancer à ce moment-là non tu ne feras pas
cela avant d'avoir compris que même elle ne valait peut-être pas un si grand désespoir et moi je ne ferai jamais cela personne ne sait ce que je sais et lui je crois qu'il vaudrait mieux que tu partes tout de suite pour Cambridge tu pourrais aller passer un mois dans le Maine tes moyens te le permettent si tu fais attention ça te serait peut-être très bon surveiller de près ses dépenses a cicatrisé plus de blessures que Jésus et moi et si j'avais déjà compris ce que vous pensez que je comprendrai là-bas la semaine prochaine ou le mois prochain et lui alors il faudra te rappeler que t'envoyer à harvard a été le rêve de ta mère depuis le jour de ta naissance et un compson n'a jamais désappointé une dame et moi temporaire ça vaudra mieux pour moi et pour nous tous et lui tout homme est l'arbitre de ses propres vertus mais il ne faut jamais laisser un homme prescrire à un autre ce qu'il croit devoir lui convenir et
moi temporaire et lui était le plus triste de tous les mots il n'y a rien d'autre en ce monde ce n'est pas le désespoir jusqu'à ce que le temps ce n`est même pas le temps jusqu'à ce qu'on puisse dire était.
La dernière note résonna. Les vibrations s'arrêtèrent enfin et les ténèbres reprirent leur immobilité. J'entrai dans la pièce qui nous servait de salon et j'allumai la lumière. Je mis mon gilet. L'odeur d'essence était très faible maintenant, à peine perceptible et, dans le miroir, la tache ne se voyait pas. Pas tant que mon œil en tout cas. Je mis mon veston. J'entendis le froissement de la lettre de Shreve à travers l'étoffe. Je la pris et en examinai l'adresse puis je la mis dans ma poche de côté. Ensuite je posai la montre dans la chambre de Shreve et je la mis dans son tiroir puis j'allaí dans ma chambre, j'y pris un mouchoir propre et j'allai à la porte et je mis la main sur l'interrupteur électrique. Je me rappelai alors que je ne m'étais pas lavé les dents et je dus rouvrir ma valise. Je trouvai ma brosse et pris un peu de la pâte de Shreve, puis je sortis et me brossai les dents. Je séchai la brosse en la pressant le plus possible et je la remis dans ma valise que je refermai. Et je me dirigeai de nouveau vers la porte. Avant d'éteindre la lumière je regardai partout pour voir s'il n'y avait plus rien et je vis que j'avais oublié mon chapeau. Il me faudrait passer par la poste et j'étais sûr d'en rencontrer et ils me prendraient pour l'étudiant typique de Harvard qui veut jouer au senior. J'avais oublié aussi de le brosser, mais Shreve avait une brosse et je n`eus pas à rouvrir ma valise, .."

Six Avril 1928
"Once a bitch always a bitch, what I say. I says you're lucky if her playing out of school is all that worries you. I says she ought to be down there in that kitchen right now, instead of up there in her room, gobbing paint on her face and waiting for six niggers that cant even stand up out of a chair unless they’ve got a pan full of bread and meat to balance them, to fix breakfast for her. And Mother says,
“But to have the school authorities think that I have no control over her, that I cant —
“Well,” I says, “You cant, can you? You never have tried to do anything with her,” I says, “How do you expect to begin this late, when she’s seventeen years old?” ...
Le ton change encore avec Jason, le troisième frère. Lui aussi est un jaloux, ou plus précisément un aigri et un envieux, regrettant d'avoir vu son père vendre un pré pour se procurer l`argent nécessaire à l'éducation de Quentin à Harvard, et n'avoir rien fait pour lui. Il comptait de plus sur le mari de Caddy pour trouver une situation lucrative, mais celui-ci, vite lassé par la conduite de sa femme, l'a abandonnée et ne s'est plus soucié de Jason. Au moment où il parle (nous revenons en avril 1928, mais cette fois-ci nous sommes le 6, alors qu`au début du livre Benjy nous avait fait vivre la journée du 7). Jason travaille - à contrecoeur - chez un quincaillier et subvient aux besoins de presque toute sa famille, c'est-à-dire sa mère (le père, alcoolique, est mort entre 1910 et 1928), Benjy, quelques domestiques noirs et la fille de Caddy qui, comme son oncle défunt, s`appelle Quentin. ll est vrai qu'il confisque (en faisant semblant devant sa mère de les refuser et de les lui retourner) les chèques que Caddy envoie à sa fille, pour l'entretien de celle-ci et à titre d'argent de poche. ll se sert de cet argent pour traficoter en Bourse. mais fulmine contre les "Juifs de New York", qui le volent et le renseignent mal. Cependant, il a caché dans sa chambre une somme assez rondelette.
Durant cette journée du 6, nous le voyons, fourbe, menteur et sadique, courir çà et là à ses diverses affaires et essayer de surveiller sa nièce, qui sèche l'école pour traîner en compagnie d'un comédien, venu en ville avec un théâtre ambulant. Telle mère, telle fille. Le
comédien n`est pas le premier. Malin et relativement perspicace, Jason voit fort bien que sa nièce est malheureuse, ce qui, avec la famille et en particulier l`oncle qu'elle a, est compréhensible. ll devine qu'elle rêve d'évasion...

APRIL 8, 1928
The day dawned bleak and chill. A moving wall of grey light out of the northeast which, instead of dissolving into moisture, seemed to disintegrate into minute and venomous particles, like dust that, when Dilsey opened the door of the cabin and emerged, needled laterally into her flesh, precipitating not so much a moisture as a substance partaking of the quality of thin, not quite congealed oil. She wore a stiff black straw hat perched upon her turban, and a maroon velvet cape with a border of mangy and anonymous fur above a dress of purple silk, and she stood in the door for awhile with her myriad and sunken face lifted to the weather, and one gaunt hand flac-soled as the belly of a fish, then she moved the cape aside and examined the bosom of her gown.
"Le jour se levait, triste et froid, mur mouvant de lumière grise qui sortait du nord-est et semblait, au lieu de se fondre en vapeurs humides, se désagréger en atomes ténus et vénéneux, comme de la poussière, précipitant moins une humidité qu'une substance
voisine de l'huile légère, incomplètement congelée. Quand Dilsey, ayant ouvert la porte de sa case, apparut sur le seuil, elle eut l'impression que des aiguilles lui transperçaient la chair latéralement. Elle portait un chapeau de paille noire, perché sur son madras, et, sur une robe de soie violette, une cape en velours lie de vin, bordée d'une fourrure anonyme et pelée. Elle resta un moment sur le seuil, son visage creux insondable levé vers le temps, et une main décharnée, plate et flasque comme un ventre de poisson, puis elle écarta sa cape et examina son corsage.
Sa robe, de teinte royale et moribonde, lui tombait des épaules en plis mous, recouvrait les seins affaissés, se tendait sur le ventre pour retomber ensuite légèrement ballonnée par-dessus les jupons qu'elle enlevait un à un suivant la marche du printemps et des jours
chauds. Elle avait été corpulente autrefois, mais, aujourd'hui, son squelette se dressait sous les plis lâches d'une peau vidée qui se tendait encore sur un ventre presque hydropique. On eût dit que muscles et tissus avaient été courage et énergie consumés par les jours, par les ans, au point que, seul, le squelette invincible était resté debout, comme une ruine ou une borne, au-dessus de l'imperméabilité des entrailles dormantes. Ce corps était surmonté d'un visage affaissé où les os eux-mêmes semblaient se trouver en dehors de la chair, visage qu'elle levait vers le jour commençant avec une expression fataliste et surprise à la fois, comme un visage d'enfant désappointé, jusqu'au moment où, s'étant retournée, elle rentra dans sa case dont elle ferma la porte.
Aux abords immédiats de la porte, la terre était nue. Elle avait pris une sorte de patine, comme au contact de générations de pieds nus, et rappelait le vieil argent ou les murs des maisons mexicaines badigeonnés à la main. Trois mûriers ombrageaient la maison en été, et
les feuilles duvetées, qui plus tard deviendraient larges et placides comme des paumes de main, ondulaient, flottant à plat sur l'air mouvant. Deux geais, sortis du vide, tourbillonnèrent dans la bourrasque comme des bouts d'étoffe ou de papier aux couleurs vives, puis allèrent se percher dans les mûriers où ils se balancèrent dans un va-et-vient guttural, jacassant aux souffles du vent qui déchirait leurs cris aigus et les éparpillait comme des bouts de papier ou des lambeaux d'étoffe. Puis il en vint trois autres et, avec de grands cris, ils se balancèrent, oscillèrent un moment dans les branches tordues. La porte de la case s'ouvrit, et Dilsey apparut de nouveau, coiffée cette fois d'un feutre d'homme, et revêtue d'une capote de soldat dont les pans éraillés laissaient apercevoir une robe de guingan bleu qui bouffait en plis inégaux et s'affolait autour d'elle, tandis qu'elle traversait la cour et montait les marches qui conduisaient à la cuisine.
Elle ressortit un peu plus tard, cette fois avec un parapluie ouvert qu'elle inclina dans le vent. Elle se rendit au tas de bois et posa le parapluie par terre sans le fermer. Tout de suite elle l'attrapa, l'arrêta, le maintint un instant tout en regardant autour d'elle. Puis elle le ferma et le posa à terre, et elle empila des bûches dans le creux de son bras, contre sa poitrine, et, ramassant son parapluie, elle l'ouvrit enfin et retourna vers les marches où elle maintint son bois en équilibre instable tout en luttant pour refermer le parapluie qu'elle appuya dans le coin, juste derrière la porte. Elle laissa tomber les bûches dans le coffre, derrière le fourneau. Puis elle enleva sa capote et son chapeau et, prenant un tablier sale qui pendait au mur, elle s'en ceignit et se mit en devoir d'allumer le fourneau. Cependant, tandis qu'elle en raclait la grille et en faisait cliqueter les rondelles, Mrs Compson l'appela du haut de l'escalier.
Elle était vêtue d'une robe de chambre piquée, en satin noir, qu'elle maintenait d'une main, serrée autour de son cou. Dans l'autre main, elle tenait une bouillotte en caoutchouc rouge et, du haut de l'escalier, elle appelait "Dilsey!" à intervalles réguliers, d'une voix uniforme dans la cage d'escalier qui descendait dans l'obscurité complète avant de s'ouvrir à nouveau, là où une fenêtre grise la traversait. "Dilsey!" appelait-elle, sans inflexion, sans insistance ni hâte, comme si elle n'espérait point de réponse.
"Dilsey!"
Dilsey répondit et s'arrêta de fourgonner, mais elle n'avait pas encore traversé la cuisine que Mrs Compson l'appelait de nouveau, et une autre fois encore avant qu'elle eût traversé la salle à manger et avancé la tête à contre-jour dans la tache grise de la fenêtre...."
Huit Avril 1928
Vient donc le matin du 8 avril. L'auteur, renonçant à la technique du monologue, raconte objectivement la fin de son histoire, en privilégiant la figure cle Dilsey, la gouvernante noire. On sait déjà que Benjy, le soir du 7, a aperçu Quentin filant subrepticernent par une fenétre. Aussi n'est-on pas surpris en constatant avec Jason qu'elle a disparu, emportant le magot qu'il cachait. Il se lance à sa poursuite. mais se rend compte, dès le début de l'après-midi, qu'il ne la retrouvera pas.
"... Ben’s voice roared and roared. Queenie moved again, her feet began to clop-clop steadily again, and at once Ben hushed. Luster looked quickly back over his shoulder, then he drove on. The broken flower drooped over Ben’s fist and his eyes were empty and blue and serene again as cornice and facade flowed smoothly once more from left to right; post and tree, window and doorw'ay, and signboard, each in its ordered place."
Un roman particulièrement touffu mais fascinant tant il parvient à exprimer l'inexprimé au travers de ses personnages auxquels il confère une présence obsédante; des êtres humains tragiquement impuissants devant la fatalité de leurs passions; dans une société qui ne peut lutter contre la fatalité du temps qui s'écoule. Seuls les Afro-Américains restent épargnés par cette décadence, exprimant une relative, très relative, sérénité..

Tandis que j’agonise (As I Lay Dying, 1930)
C'est peut-être l'oeuvre la plus célèbre de FauIkner, réécrit entièrement pour en faire un livre "honnête", sur le moment un succès relatif, mais Hollywood commence à s'intéresser à lui. "Tandis que j'agonise" est un roman paradoxal. Paradoxal, d'abord au vu du faible succès public qu'il rencontra, alors qu'il allait marquer un grand nombre d'écrivains ou d'artistes tel Jean-Louis Barrault qui fit du roman une de ses premières pièces (Autour d'une mère). L'autre paradoxe veut que l'auteur se soit peu investi dans la rédaction de ce texte. Faulkner l'aurait écrit en six semaines, entre minuit et quatre heures du matin, au fond d'une soute à charbon (sans doute vrai dans l'esprit non dans les faits). Un véritable tour de force, dont, à n'en pas douter, il était plutôt fier. Totalement novateur, le récit allie farce grotesque et tragédie humaine. Anse Bundren et sa famille entreprennent un voyage funéraire pour aller enterrer la femme de ce dernier, quelque part dans le Mississippi. Sous la chaleur de juillet, le corps se décompose, les mulets se perdent, un des fils se casse une jambe, l'autre perd la raison, tandis que le père ne pense qu'au nouveau dentier qu'il va s'acheter. Autour du cadavre de la mère, les monologues intérieurs recomposent les vies de chacun, jusqu'au point final. Quand, venant tout juste d'enterrer son épouse, Anse Bundren, muni de son nouveau dentier, se présente devant ses fils avec une nouvelle femme, il dit comme ça : "Je vous présente Mrs Bundren." Et le convoi mortuaire retourne à son désert." (Gallimard). Un roman excellement servi par la traduction de Maurice-Edgar Coindreau. "Un roman de mœurs rurales", annoncera Valéry Larbaud dans sa préface...
La solitude de l'être humain face à sa propre expérience. Au début, la scène se passe dans la ferme d`une famille de pauvres Blancs perchée sur une colline du Mississippi, à quarante miles de Jefferson, la capitale du comté. Addie Bundren, l’épouse d’Anse Bundren et la matriarche d’une pauvre famille du sud, qui compte quatre fils, Cash. Darl. Jewel et Vardaman, et une fille Dewey Dell. Addie est mourante. Son fils aîné, Cash, met tous ses talents de menuisier dans la préparation de son cercueil, qu’il construit juste devant la fenêtre de la chambre de sa mère. Bien que la santé d’Addie se détériore rapidement, deux de ses autres fils, Darl et Jewel, quittent la ville pour faire une livraison au voisin des Bundrens, Vernon Tull, dont la femme et les deux filles s’occupent d’Addie. Peu après le départ de Darl et Jewel, Addie meurt. Le plus jeune enfant de Bundren, Vardaman, associe la mort de sa mère à celle d’un poisson qu’il avait pêché et nettoyé plus tôt dans la journée. Avec un peu d’aide, Cash complète le cercueil juste avant l’aube. Vardaman est troublé par le fait que sa mère est clouée enfermée dans une boîte, et pendant que les autres dorment, il creuse des trous dans le couvercle, dont deux passent par le visage de sa mère. Un service funèbre a lieu le lendemain, où les femmes chantent des chansons à l’intérieur de la maison des Bundren tandis que les hommes se tiennent dehors sur le porche en train de se parler.
Darl, qui raconte une grande partie de cette première section, revient avec Jewel quelques jours plus tard, et la présence de buses au-dessus de leur maison leur fait savoir que leur mère est morte. En voyant ce signe, Darl rassure sardoniquement Jewel, qui est largement perçu comme ingrat et insensible, qu’il peut être sûr que son cheval bien-aimé n’est pas mort. Addie a fait promettre à Anse qu’elle sera enterrée dans la ville de Jefferson, et bien que cette demande soit une proposition bien plus compliquée que de l’enterrer chez elle, le sens des obligations d’Anse, combiné avec son désir d’acheter une paire de fausses dents, l’oblige à réaliser le dernier souhait d’Addie. Cash, qui s’est cassé la jambe sur un chantier, aide la famille à soulever le cercueil mais c’est Jewel qui finit par réaliser cette tâche et se tient par la suite à l'écart du reste de la famille.
Sur la route de Jefferson, deux épreuves attendent les Bundren, l'eau et le feu. Cinquante-neuf monologues séparés vont s'enchaîner, chacun intitulé du nom d'un personnage. Celui d`Addie intervient singulièrement bien après sa mort, au centre du livre. Chaque membre de la famille, ou presque, a une raison secrète et dérisoire d'atteindre Jefferson : le père pour acquérir un ratelier, la fille pour se faire avorter, le petit pour manger des bananes. En conséquence, toutes les conversations, scènes et descriptions sont rapportées - donc déformées -, par un personnage. Darl est celui qui parle le plus, voyant demi-fou qui provoquera l'incendie de la grange où s'arrêtera la famille après l'épuisante traversée de la rivière en crue, et sera envoyé à l'asile de l'Etat. Mais c'est par sa bouche que s'exprime avec le plus de force et de lyrisme les évocations du Sud, la violence inhérente à ses paysages, à l'aspect cataclysmique que y peuvent prendre les phénomènes naturels, et pour toute dire la dimension dérisoire des gestes humains...
La première nuit de ce singulier voyage, les Bundrens séjournent dans la maison d’une généreuse famille locale, qui considère avec scepticisme la mission des Bundrens. En raison de graves inondations, les ponts principaux qui franchissent la rivière locale ont été inondés ou emportés, et les Bundrens sont forcés de faire demi-tour et de tenter de traverser la rivière au-dessus d’un gué de fortune. Dans cette lutte avec les éléments qui voit sous l'effet de la pluie, se mêler l'eau et la terre, en une sorte de boue originelle qui évoque le chaos matriciel. la cellule familiale prend peu à peu dimension symbolique de l'humanité luttant pour perpétuer un rite, le passage de la rivière vaut bien des interprétations psychanalytiques. Cora, la femme de Tull, se souvient de l’inclination peu chrétienne d’Addie à respecter son fils Jewel plus que Dieu. Addie elle-même, parlant à partir de son cercueil ou de son lit de mort, rappelle des événements de sa vie : son mariage sans amour avec Anse, sa liaison avec le ministre local, Whitfield, qui a conduit à la conception de Jewel, et la naissance de ses divers enfants. Whitfield se rappelle s’être rendu à la maison des Bundrens pour confesser l’affaire à Anse, et sa décision éventuelle de ne rien dire après tout.
La famille parvient à continuer son chemin. Dans la ville de Mottson, les habitants réagissent avec horreur à la puanteur provenant du chariot Bundren. Pendant que la famille est en ville, Dewey Dell essaie d’acheter un médicament qui lui permettra d'avorter, mais le pharmacien refuse de la lui vendre, et conseille plutôt le mariage. Avec le ciment que la famille a acheté en ville, Darl crée un moulage de fortune pour la jambe cassée de Cash, ce qui ne fait qu’augmenter la douleur de Cash. Les Bundrens passent ensuite la nuit dans une ferme locale appartenant à un homme nommé Gillespie. Darl, sceptique sur l'intérêt de ce périple, brûle la grange Gillespie avec l’intention d’incinérer le cercueil et le cadavre pourrissant d’Addie. Jewel sauve les animaux dans la grange, puis risque sa vie pour sortir le cercueil d’Addie. Darl se couche sur le cercueil de sa mère et pleure.
Le lendemain, les Bundrens arrivent à Jefferson et enterrent Addie. Plutôt que de faire face à un procès pour l’incendie de la grange criminelle de Darl, les Bundrens dénoncent la démence de Darl qui est interné dans un établissement psychiatrique de Jackson. Dewey Dell tente à nouveau un avortement médicamenteux et est abusé par l'employé d'une pharmacie locale qui prétend être médecin. Le lendemain matin, les enfants sont accueillis par leur père, qui arbore une nouvelle paire de fausses dents et, avec un mélange de honte et de fierté, les présente à sa nouvelle épouse, une femme du coin qu’il a rencontré tout en empruntant des pelles pour enterrer Addie.

Sanctuaire (Sanctuary, 1931)
La découverte du mal. "Temple ne vit pas, n'entendit pas s'ouvrir la porte de sa chambre. Au bout d'un instant, elle tourna par hasard les yeux de ce côté et y aperçut Popeye, son chapeau sur le coin de la figure. Sans bruit, il entra, ferma la porte, poussa le verrou, se dirigea vers elle. Tout doucement, elle se renfonça dans le lit, remontant jusqu'au menton les couvertures, et resta ainsi, anxieusement attentive aux gestes de Popeye. Il s'approcha, la regarda. Elle sentit son corps se contracter insensiblement, se dérober dans un isolement aussi absolu que si elle eût été attachée sur le clocher d'une église. Elle sourit à Popeye d'un pauvre sourire humble et gauche, découvrant l'émail de ses dents." L'introduction du livre par Faulkner est restée célèbre : "ce livre fut écrit en trois ans. Pour moi, c'est une idée sans valeur, parce que je l'ai délibérément conçue pour faire de l'argent". C'est en effet une époque où Faulkner désespère de son métier. L'écrivain utilise une anecdote inventée de toutes pièces, - le viol d'une collégienne par un avorton impuissant et pervers -, pour procéder à une profonde exploration de la question du mal...
"Sanctuaire, c'est l'intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier" - Reprenons la préface d'André Malraux et sa remarque sur le "monde", selon Faulkner, un "Monde où l'homme n'existe qu'écrasé" : "Il n'y a pas d' " homme" de Faulkner, ni de valeurs, ni même de psychologie, malgré les monologues intérieurs de ses premiers livres. Mais il y a un Destin dressé, unique, derrière tous ces êtres différents et semblables, comme la mort derrière une salle des incurables. Une obsession intense broie en les heurtant ses personnages, sans qu'aucun d'eux l'apaise; elle reste derrière eux, toujours la même, et les appelle au lieu d'être appelée par eux.
Un tel monde fut longtemps matière de conte; même si les échos américains ne nous répétaient complaisamment que l'alcool fait partie de la légende personnelle de M. Faulkner, le rapport entre son univers et celui d'Edgar Poe ou d'Hoffmann serait évident. Matériel psychanalytique semblable, haines, chevaux, cercueils, obsessions semblables. Ce qui sépare Faulkner de Poe, c'est la notion qu'ils ont l 'un et l'autre de l'œuvre d'art; plus exactement, c'est que l'œuvre d'art existait pour Poe, et primait la volonté d'expression - sans doute est-ce là ce qui provisoirement l'écarte le plus de nous. Il créait des objets. Le conte, terminé, prenait pour lui l'existence indépendante et limitée du tableau de chevalet.
Je vois dans l'affaiblissement de l'importance accordée aux objets l'élément capital de la transformation de notre art. En peinture, il est clair qu'un tableau de Picasso est de moins en moins "une toile", de plus en plus la marque d'une découverte, le jalon laissé par le passage d'un génie crispé. En littérature, la domination du roman est significative, car, de tous les arts (et je n'oublie pas la musique), le roman est le moins gouverné, celui ou le domaine de la volonté se trouve le plus limité. Combien "Les Karamazoff", "Les Illusions perdues", dominent Dostoïewsky et Balzac, on le voit de reste en lisant ces livres après les beaux romans paralysés de Flaubert.
Et l'essentiel n'est pas que l'artiste soit dominé, mais que depuis cinquante ans il choisisse de plus en plus ce qui le domine, qu'il ordonne en fonction de cela les moyens de son art. Certains grands romans furent d'abord pour leur auteur la création de la seule chose qui pût le submerger. Et, comme Lawrence s'enveloppe dans la sexualité, Faulkner s'enfouit dans
l'irrémédiable.
Une force sourde, parfois épique, se déclenche chez lui dès qu'il parvient à affronter un de ses personnages et l'irrémédiable. Et peut-être I'irrémédiable est-il son seul vrai sujet, peut-être ne s'agit-il jamais pour lui que de parvenir à écraser l'homme. Je ne serais nullement surpris qu'il pensât souvent ses scènes avant d'imaginer ses personnages, que l'œuvre fût pour lui, non une histoire dont le déroulement détermine des situations tragiques, mais bien, à l'opposé, qu'elle naquit du drame, de l'opposition ou de l'écrasement de personnages inconnus, et que l'imagination ne servit qu'à amener logiquement des personnages à cette situation conçue d'abord. C'est, soit d'une impuissance d'esclave pleinement ressentie (la jeune fille dans la maison des gangsters), soit de l'absurde irrémédiable (le viol avec l'épi de maïs, l'innocent brûlé, Popeye en fuite mais stupidement condamné pour un délit qu'il n'a pas commis; dans "Tandis que j'agoníse" le fermier qui soigne son genou malade en l'enrobant de ciment, le magnifique monologue de haine) que jaillit chez Faulkner l'exaltation tendue qui fait sa force, et c'est l'absurdité qui donne à ses personnages secondaires, presque comiques (la maîtresse du bordel avec ses chiens), une intensité
comparable a` celle de Chtchédrine. Je ne dirai pas de Dickens; car, même autour de tels personnages rôde le sentiment qui fait la valeur de l'œuvre de Faulkner : la haine...."
"Caché derrière l’écran des broussailles qui entouraient la source, Popeye regardait l’homme boire. Un vague sentier venant de la route aboutissait à la source. Popeye avait vu l’homme, un grand sec, tête nue, en pantalon de flanelle grise fatigué, sa veste de tweed sur le bras, déboucher du sentier et s’agenouiller pour boire à la source.
La source jaillisait à la racine d’un hêtre et s’écoulait sur un fond de sable tout ridé par l’empreinte des remous. Tout autour s’était développée une épaisse végétation de roseaux et de ronces, de cyprès et de gommiers, à travers lesquels les rayons d’un soleil invisible ne parvenaient que divisés et diffus. Quelque part, caché, mystérieux, et pourtant tout proche, un oiseau lança trois notes, puis se tut. A la source l’homme buvait, son visage affleurant le reflet brisé et multiplié de son geste. Lorsqu’il se releva, il découvrit au milieu de son propre reflet, sans avoir pour cela entendu aucun bruit, l’image déformée du canotier de Popeye. En face de lui, de l’autre côté de la source, il aperçut une espèce de gringalet, les mains dans les poches de son veston, une cigarette pendant sur son menton. Son complet était noir : veston cintré à taille haute, pantalon au repli encroûté de boue tombant sur des chaussures crottées. Son visage au teint étrange, exsangue, semblait vu à la lumière électrique. Sur ce fond de silence et de soleil, avec son canotier sur le coin de l’œil et ses mains sur les hanches, il avait la méchante minceur de l’étain embouti. Derrière lui, l’oiseau chanta de nouveau, trois mesures monotones, constamment répétées : un chant à la fois dépourvu de sens et profond, qui s’éleva du silence plein de soupirs et de paix dans lequel le lieu semblait s’isoler, et d’où surgit, l’instant d’après, le bruit d’une automobile qui passa sur la route et mourut dans le lointain.
Ayant bu, l’homme restait à genoux près de la source. « C’est un revolver que tu as dans cette poche ? » fit l’autre.
De l’autre côté de la source, les yeux de Popeye fixaient l’homme, semblables à deux boutons de caoutchouc noir et souple. « Je te parle, tu entends, reprit Popeye. Qu’est-ce que tu as dans ta poche? »
L’homme avait toujours son veston sur le bras. Il allongea une main vers le veston. D’une poche dépassait un chapeau de feutre bouchonné, et de l’autre un livre. « Laquelle? dit-il.
— Inutile de me faire voir, fit Popeye, suffit de me le dire. »
La main s’arrêta dans son geste. « C’est un livre.
— Quel livre ? demanda Popeye.
— Un livre, simplement. Un livre comme tout le monde en lit. Il y a des gens qui lisent.
— Tu lis des livres? » dit Popeye.
La main de l’homme s’était figée au-dessus du veston. Leurs regards se croisaient de part et d’autre de la source. La mince volute de la cigarette se tordait devant la figure de Popeye que la fumée faisait grimacer d’un côté, comme un masque où le sculpteur eût représenté deux expressions simultanées.
De sa poche-revolver, Popeye sortit un mouchoir crasseux qu’il déploya sur ses talons. Puis il s’accroupit, face à l’homme, de l’autre côté de la source. C’était un après-midi de mai ; il était environ quatre heures. Accroupis de part et d’autre de la source, ils restèrent ainsi pendant deux heures. Par intervalle, derrière, dans le marécage, l’oiseau chantait, comme actionné par un mécanisme d’horlogerie. Deux fois encore d’invisibles autos passèrent sur la grand- route et moururent dans le lointain. De nouveau, l’oiseau chanta.
« Et, naturellement, fit l’homme de l’autre côté de la source, vous ne savez pas son nom. Vous ne seriez pas capable de reconnaître un oiseau, à moins qu’il ne chante en cage dans le hall d’un hôtel ou ne vaille quatre dollars sur un plat. » Popeye ne répondit pas. Il restait accroupi, dans son complet noir étriqué, sa poche droite déformée par une bosse contre son flanc, à tortiller et pincer des cigarettes entre ses minuscules mains de poupée, tout en crachant dans la source. Sa peau était d’une pâleur terreuse, cadavérique, son nez légèrement aquilin ; il n’avait pas de menton du tout. Le bas de son visage coulait littéralement, comme celui d’une poupée de cire que l’on eût oubliée auprès d’un feu ardent. Une chaîne de platine barrait son gilet, comme une toile d’araignée. « Dites donc, dit l’autre, je suis Horace Benbow, avocat à Kinston. Avant, j'habitais là-bas..."

Une Rose pour Emily (A Rose for Emily) et autres nouvelles (1931)
Au centre des plus célèbres nouvelles de William Faulkner, trois portraits de femmes denses et profonds : la tragique Miss Emily, cloîtrée dans sa maison
comme dans ses souvenirs ; Minnie Cooper, vieille fille tourmentée par l'indifférence des hommes jusqu'au meurtre, et Nancy, la blanchisseuse noire abandonnée par son mari, dont le jeune Quentin
raconte les peurs et les superstitions. "La renommée de Faulkner romancier a trop souvent obscurci un aspect pourtant capital de l'œuvre de celui qui fut l'un des plus grands écrivains de notre
siècle : les nouvelles. A ce titre, ce recueil, le premier qu'il publia aux Etats-Unis en septembre 1931, aussitôt après "Sanctuaire", est particulièrement précieux. Dédié à sa femme et à son
premier enfant qu'il devait perdre en bas âge, il comporte, entre autres, la plus célèbre nouvelle de Faulkner, "Une rose pour Emily". On interprète généralement cette nouvelle comme une
allégorie de la décadence, construite autour de la vie d'une vieille fille de Jefferson, Miss Emily Grierson. On peut voir dans ce texte une image de la séduction du Sud aristocratique (Miss
Emily) par le Nord, vigoureux et entreprenant (Homer Barron). "Une rose pour Emily" fut aussi, avec "Septembre ardent", le premier texte de Faulkner à paraître en français, dans l'hiver
1931-1932. (Gallimard)
1932, fin d'une période pour Faulkner après six années de création littéraire continue et dont "Le Bruit et la Fureur" fut le sommet d'une "foi ardente et généreuse"...

Lumière d’août (Light in August, 1932)
"La main allait, lente et calme, le long du flanc invisible. Il ne répondit pas tout de suite. Non qu'il essayât de l'intriguer. Il avait l'air de ne pas se rappeler qu'il devait en dire davantage. Elle répéta la question. Alors, il lui dit : - J'ai du sang noir. Elle resta étendue, parfaitement immobile, mais d'une immobilité différente. Mais il ne parut point s'en apercevoir. Il était couché, calme aussi et, de sa main, doucement lui caressait le flanc."
Faulkner a épousé Estelle Odham et au début de 1931, le couple a une première fille qu'il nomme Alabama, mais la petite meurt au bout de cinq jours. C'est à la suite de ce drame qu'il écrit "Lumière d'août" : "en août, dans le Mississipi, , il y a quelques jours vers le milieu du mois pendant lesquels , soudain, on a un avant-goût de l'automne". L'image de Lena Grove, enceinte, marchant le long d'une route du Mississipi est le fil conducteur par lequel on accède à l'histoire de Joe Christmas dont la tragédie est de ne pas savoir ce qu'il ou ce qu'il deviendra, et qui sera conduit au crime et à la castration..
"Assise sur le bord de la route, les yeux fixés sur la charrette qui monte vers elle, Lena pense : « J’arrive de l’Alabama : un bon bout de route. A pied de l’Alabama jusqu’ici. Un bon bout de route. » Tout en pensant il n’y a pas encore un mois que je me suis mise en route et me voilà déjà en Mississipi. Jamais je ne m’étais trouvée si loin de chez nous. Jamais, depuis l’âge de douze ans, je ne m’étais trouvée si loin de la scierie de Doane
Elle n’avait même jamais été à la scierie de Doane avant la mort de son père et de sa mère. Cependant, sept ou huit fois par an, le samedi, elle allait à la ville dans la charrette. Vêtue d’une petite robe de confection, elle posait ses pieds nus à plat sur le fond de la charrette, et ses souliers, sur le siège, auprès d’elle, enveloppés dans un morceau de papier. Elle mettait ses souliers juste au moment d’arriver à la ville. Quand elle fut plus grande, elle demandait à son père d’arrêter la charrette aux abords de la ville afin qu’elle pût descendre et continuer à pied. Elle ne disait pas à son père pourquoi elle désirait marcher au lieu d’aller en voiture. Il croyait que c’était à cause des rues bien unies, à cause des trottoirs. Mais c’était avec l’idée qu’en la voyant à pied, les gens qui la croisaient seraient tentés de croire qu’elle aussi habitait la ville.
Elle avait douze ans quand son père et sa mère moururent, le même été, dans une maison en rondins composée de trois pièces et d’un vestibule. Il n’y avait pas de moustiquaires aux fenêtres. La chambre où ils moururent était éclairée par une lampe à pétrole qu’enveloppait un vol d’insectes tourbillonnants ; plancher nu, poli comme du vieil argent par le frottement des pieds nus. Elle était la plus jeune des enfants vivants. Sa mère mourut la première : « Prends soin du père », dit-elle. Et Lena le fit. Puis, un jour, son père lui dit : « Tu vas aller à la scierie de Doane avec McKinley. Prépare-toi à partir. Sois prête quand il arrivera. » Et il mourut. McKinley, le frère, arriva dans une charrette. On enterra le père, un après-midi, sous les arbres, derrière une église de campagne, et on posa une planche de sapin en guise de pierre tombale. Le lendemain matin, elle partit pour la scierie de Doane, dans la charrette, avec McKinley. Et, peut-être, à ce moment-là, ne soupçonnait-elle pas qu’elle s’en allait pour toujours. La charrette avait été prêtée, et le frère avait promis de la rendre à la tombée de la nuit.
Le frère travaillait à la scierie. Tous les hommes du village travaillaient à la scierie ou pour elle. On y sciait des sapins. Il y avait sept ans qu’elle était là, et, dans sept ans, toute la région se trouverait déboisée. Alors, une partie du matériel et la plupart des hommes qui la faisaient marcher, n’existant que pour elle ou à cause d’elle, seraient chargés dans des wagons de marchandises et transportés ailleurs. Mais une partie du matériel serait laissée sur place, car on pouvait toujours acheter des pièces de rechange en paiements échelonnés — grandes roues immobiles, décharnées, fixant le ciel avec un air d’étonnement profond, parmi des monceaux de briques, de ronces embroussaillées; Chaudières calcinées, dressant d’un air entêté, surpris et hébété, leurs tuyaux qui ne fumaient plus et se rouillaient au milieu d’un paysage hérissé de souches d’arbres, paysage de désolation, calme, paisible, inculte, terre tombée en friche, où, lentement, des ravines engorgées et rougeâtres se creusent sous les longues pluies tranquilles de l’automne et la fureur galopante des équinoxes de printemps. Et le jour viendrait où le hameau qui, même au temps de sa prospérité, ne figurait pas sur l’annuaire des P. T. T., finirait par être oublié même par les accapareurs pouilleux qui auront achevé de démolir les hangars pour les brûler dans les fourneaux de leurs cuisines et, l’hiver, dans leurs cheminées.
Il n’y avait guère plus de cinq familles à l’époque où Lena arriva. Il y avait une voie de chemin de fer et une gare qu’un train mixte, une fois par jour, traversait en hurlant. On pouvait faire arrêter ce train au moyen d’un drapeau rouge, mais, le plus souvent, il sortait des collines déboisées avec la soudaineté d’une apparition et, gémissant comme une âme en peine, il traversait ce petit embryon de village comme la perle oubliée d'un collier brisé. Elle avait vingt ans de moins que son frère..."
... C'est également l'époque où il rencontre l'écrivain de romans noirs Dashiell Hammet, grand buveur comme lui : les deux hommes deviennent amis....

Parabole (A Fable)
Les critiques ont compris dès sa parution que cette œuvre constituait l'effort le plus ambitieux de son auteur, 437 pages dans sa version originale, neuf années d'écriture, une "cathédrale", a-t-on dit. En octobre 1948, Faulkner notait à propos de "Parabole" : "C'est l'histoire du Christ dans l'armée française, un caporal et une escouade de douze hommes, un général qui est l'Antéchrist, et qui l'attire au sommet d'une colline pour lui offrir le monde. Symbolique et irréel... Le corps du caporal est choisi pour celui du soldat inconnu. Le Christ revit dans la" foule."
"Parabole" est une métaphore : «Quand le dernier glas du destin aura sonné et disparu du dernier et dérisoire rocher suspendu inamovible dans le dernier couchant rouge", disait Faulkner en parlant de l'homme, "il y aura quand même un bruit, un seul : celui de sa petite et inépuisable voix, parlant encore.» Faulkner tente ici l'impossible : élever cette «petite voix» de l'écrivain perdu dans un siècle d'aliénation à la puissance des grandes orgues de l'humanisme. Lorsqu`on visite sa maison à Oxford, Mississippi, on voit sur un mur six grandes colonnes qui représentent les six journées du livre, dont Faulkner avait dû inscrire de haut en bas les événements majeurs, comme à plat dans leur ordre chronologique. Ce n`était pas son genre et on peut estimer que Faulkner se trouvait ici aux prises avec un problème nouveau pour lui, celui de la conception du livre, grandiose au point de lui faire courir le risque d`un échec retentissant. Rappelons au passage qu'il avait déjà mis à contribution l'histoire du Christ et, plus particulièrement, les événements de la Semaine Sainte, dans Le Bruit et la Fureur, dans Lumière d'août et dans Descends, Moïse : "Si Jésus revenait aujourd`hui, nous devrions aussitôt le crucifier pour nous défendre. pour justifier et préserver la civilisation que nous avons créée et perfectionnée à l`image de l`homme au prix deux fois millénaire de notre labeur, de nos souffrances, de notre mort dans les cris et les blasphèmes de rage, d'impuissance et de terreur" (Les Palmiers sauvages). On a pu écrire qu'en un sens, "Parabole est la dramatisation explicite du célèbre discours de réception du prix Nobel, prononcé le 10 décembre 1950 à Stockholm..."
A un premier niveau, Parabole, comme Moby Dick, raconte une histoire : c`est celle de la mutinerie dont le caporal est l'instigateur. C'est elle qui commande la structure du livre. Au chapitre I (un mercredi de mai 1917), des camions amènent au grand quartier général allié, à Chaulnesmont dans l'est de la France, les trois mille hommes du régiment mutin. Au chapitre IX, l`avant-dernier (Vendredi), le caporal est exécuté entre deux larrons. Le dernier chapitre, intitulé "Demain", raconte la recherche, par une nouvelle escouade de douze hommes commandée cette fois par un sergent, d'un corps à Valaumont (Douaumont) pour l'Arc de Triomphe : c`est, naturellement. après une aventure dans le style comico-macabre, celui du caporal qui est finalement transporté à Paris. Les deux scènes de foule qui ouvrent et ferment le livre sont remarquables. Cependant, du fait de la mutinerie, le front entier, des Alpes à Boulogne, connaît une trêve de vingt-quatre heures, source de combines sordides pour sauver la face - et la guerre ! - et du côté des combattants, d`espoirs fous et de tragiques ironies.
On assiste ainsi à une puissante démystification de la guerre envisagée moins sous son angle historique (encore qu'en 1951 Faulkner ait tenu à visiter les champs de bataille auxquels il n`avait pas eu accès en 14-18) que du point de vue de l'éternelle et cosmique récurrence des conflits humains dont elle est à la fois la manifestation extrême et le symbole rituel. Faulkner procède, par grandes boucles narratives, à la récupération du passé qui expliquera le présent ; et celui-ci, pour la première fois explicitement, recevra un prolongement dans l`avenir : c`est le "Demain" du dernier chapitre. L'enjeu de la Passion est bien celui de l'avenir de l'humanité, cet avenir appartient-il à l'autorité qui représente la tradition, l'ordre militaire (ou social), le respect d'un code ou la révolte, la guerre ou la paix...

Pylône (Pylon, 1935)
"Elle était arrivée au sol avec sa robe, que le vent avait déchirée ou libérée des courroies du parachute, remontée jusqu'aux aisselles, et elle avait été traînée le long du terrain jusqu'à ce qu'elle fût rejointe par une foule hurlante d'hommes et de jeunes gens, au centre de laquelle elle était maintenant étendue à terre, vêtue seulement, des pieds à la ceinture, de boue, des courroies du parachute et de ses bas."
"Pylon", son huitième roman, fut peu apprécié à sa sortie aux Etats-Unis, mais en France porté aux nues par Albert Camus. Un roman qui évoque le vol et la motivation de ceux qui volent, le « pylône » du titre étant cette tour ou poteau d’acier autour duquel un pilote doit tourner lorsqu’il participe à une course dans une foire aérienne. Le roman est situé à la Nouvelle-Orléans pendant la semaine de Mardi Gras. L’intrigue du roman peut être résumée assez simplement, une équipe de pilotage, désespérément à court d’argent, espèrent gagner au moins un lots lors d’un spectacle aérien. Ils ne vivent que de leurs gains, ce qui signifie que souvent ils n’ont pas d’endroit où rester, peu à manger et pas d’argent pour aller de ville en ville. On y parle de leurs conditions de vie et de la difficulté de leurs métiers, mais comme les spectateurs, les journalistes on s'interrogent sur leur motivation et leur sentiment de survie, des êtres humains se mesurant entre eux et risquant leur vie sur un arrière-fond de foule, de cris, de haut-parleurs, de musique, de moteurs, d'éphémère. Toute l'équipe Shumann est venue à New Valois afin de participer aux courses d'avions organisées pour l`inauguration de l`aéroport : Roger Shumann et le parachutiste Laverne la femme, "leur" femme, l'enfant, et Jiggs, le mécano. Un homme les regarde, regarde leurs gestes et leur visage qui semblent
avoir troqué l'humain pour il ne sait quelle qualité attrapée à courir le ciel d`un bout de l'Amérique à l'autre et d`un bout à l`autre du temps ; un homme sans nom, un "reporter", un être qu`on aurait dit "évadé du placard d`un médecin", un "être à l`air penaud, véhément et pataud", "squelettique, dégingandé, impondérable, impétueux", qui suit l'équipe Shumann, fasciné par les rapports qui lient ces gens, engagé dans une sorte d'épopée minable et grandiose, il les aime ; en silence, peureusement, il aime Laverne qui les résume ou les unit. Il boit avec eux qui sont inaccessibles ; il se traîne sur leurs pas ; il ronge pour eux son avenir en hypothéquant une, deux, trois, dix semaines de son salaire afin de les aider. Mais quel espoir pour lui qui n'appartient qu`à la foule misérable des passants ? Il aide Shumann à se procurer un autre avion, le sien ayant été accidenté, et Shumann se tue avec cet avion. Le parachutiste, Laverne et l'enfant repartent vers l'inconnu, convertissent en espace la distance qui les séparait quand ils étaient face à face. Un article-épitaphe pour Shumann, un cri de révolte contre les Autres, les immobiles, les assis, puis il s`efface, "épave morale et spirituelle clamant son débile Que suis-je ? dans le désert du hasard et de la déroute". Il était ce fouineur qui essayait de faire le bien, mais qui finit par ne créer que la destruction ..

Douglas Sirk, "The Tarnished Angels" (La Ronde de l'aube), 1957,
avec Rock Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone, Jack Carson, et Robert Middleton

Avec le chef d'oeuvre que constitue "Absalon, Absalon !", Faulkner en termine avec la première période la plus faste de son inspiration. Lors de son premier séjour à Hollywood, Faulkner travaille successivement pour la MGM, puis pour la Twentieth Century Fox. À cette époque, il a une liaison avec la secrétaire d'Howard Hawks, Meta Carpenter qui sera le grand amour (plus tard trahi) de sa vie. Son travail de scénariste ne l'empêche pas de publier romans et nouvelles et non des moindres puisque l'année 1936 voit notamment la publication d'Absalon, Absalon ! et l'année 1940 celle du roman Le Hameau premier tome de ce qui deviendra, avec La Ville (1954) et Le Domaine (1959) : la trilogie des Snopes.
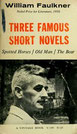
William Faulkner, "The Bear" (1935)
L’influence du passé, les relations entre les hommes et les difficultés engendrées par le changement sont autant de thèmes récurrents dans les romans et histoires de Faulkner, «The Bear» est un bon exemple reprenant ces thèmes. Publié en 1935, "L'Ours" est révisé en 1942 et inclus dans "Go Down, Moses". Dans ses sept histoires, "Go Down, Moïse" raconte de nombreux événements de la vie d’Isaac (Ike) McCaslin, membre de l’une des trois familles les plus importantes de Yoknapatawpha (les autres familles, dont les représentants apparaissent dans « L’ours », sont les Compsons et les Sutpens). Il est bien difficile de parvenir à déterminer les relations familiales de ces personnages tant les généalogies de ces familles du Sud sont souvent enchevêtrées , en particulier celles impliquant des enfants illégitimes, progéniture d’hommes blancs et de femmes esclaves. Ike McCaslin, le personnage principal, est le petit-fils de l’un des colons et fondateurs de Yoknapatawpha, Carothers McCaslin. Les fils de Carothers comprennent l’oncle Buck et l’oncle Buddy, qui, à la mort de leur père en 1837, emménagent dans une cabane en rondins sur leur terrain de plantation et déplacent les esclaves de la plantation dans la «big house». Plus tard, l’oncle Buck épouse Sophonsiba Beauchamp et donnent naissance à Ike en 1867. Carothers a également une fille mariée à un Edmonds, qui est soit le père soit le grand-père (Faulkner ne dit pas) de McCaslin « Cass » Edmonds. Cass, dix-sept ans de plus qu’Ike, devient en fait le père d’Ike après la mort d’oncle Buck. Dans « L’ours », nous voyons Ike et Cass ensemble à travers une grande partie de l’histoire, et dans la quatrième section Cass enseigne Ike beaucoup de secrets de la famille et une grande partie de son histoire. Les autres personnages de « L’ours » comprennent le général Compson et le major d’Espagne, deux des principaux citoyens de Yoknapatawpha; Sam Fathers, un guide de chasse d’origine chickasaw, et Boon, un autre membre de l’équipe de chasse, et Ash, le cuisinier noir de l’équipe de chasse.
"There was a man and a dog too this time. Two beasts, counting Old Ben, the bear, and two men, counting Boon Hogganbeck, in whom some of the same blood ran which ran in Sam Fathers, even though Boon s was a plebeian strain of it and only Sam and Old Ben and the mongrel Lion were taintless and incorruptible.
He was sixteen. For six years now he had been a man's hunter. For six years now he had heard the best of all talking. It was of the wilderness, the big woods, bigger and older than any recorded document; — of white man fatuous enough to believe he had bought any fragment of it, of Indian ruthless enough to pretend that any fragment of it had been his to convey; bigger than Major de Spain and the scrap he pretended to, knowing better; older than old Thomas Sutpen of whom Major de Spain had had it and who knew better; older even than old Ikkemotubbe, the Chickasaw chief, of whom old Sutpen had had it and who knew better in his turn. It was of the men, not white nor black nor red but men, hunters, with the will and hardihood to endure and the humility and skill to survive, and the dogs and the bear and deer juxtaposed and relicfed against it, ordered and compelled by and within the wilderness in the ancient and unremitting contest according to the ancient and immitigable rules which voided all regrets and brooked no quarter; — the best game of all, the best of all breathing and forever the best of all listening, the voices quiet and weighty and deliberate for retrospection and recollection and exactitude among the concrete trophies — the racked guns and the heads and skins — in the libraries of town houses or the offices of plantation houses or (and best of all) in the camps themselves where the intact and still-warm meat yet hung, the men who had slain it sitting before the burning logs on hearths when there were houses and hearths or about the smoky blazing of piled wood in front of stretched tarpaulins when there were not. There was always a bottle present.."
L’histoire raconte la traque d'Old Ben, un vieil ours rusé qui « ravage la campagne ». Nous voyons la chasse à travers les yeux d’Ike, et la première partie de l’histoire se déplace dans le temps à travers la première expédition d’Ike avec la partie de chasse, en 1877, au voyage de 1883 dans lequel Old Ben est finalement tué. Bien que le meurtre de Old Ben soit le point culminant de l’action de l’histoire, ce n’est pas le sujet de l’histoire. Au lieu de cela, dans la première moitié de l’histoire, nous sommes confrontés à l’histoire d’un garçon qui grandit en apprenant les anciennes façons de chasser. Lors de son premier voyage, le garçon n’est pas autorisé à tirer avec son arme. Lors de sa deuxième chasse, Sam Fathers enseigne à Ike qu’il doit faire partie de la nature sauvage avant d’obtenir le droit de tuer quoi que ce soit. Cette année-là, Ike jette son arme et part à la recherche de Ben. Incapable d’attirer l’ours hors de sa cachette, Ike laisse derrière lui les attributs de la civilisation, sa montre et sa boussole, et est récompensé par un aperçu du vieil ours. En 1881, Sam capture un chien sauvage, qu’il nomme « Lion », dans l’espoir qu’il les aidera à le coincer. Enfin, en 1883, Lion et les chasseurs coincent l’ours. Ben tue le chien, mais en même temps Boon saute sur le dos de l’ours et le poignarde mortellement. Alors que la fête se prépare à retourner en ville, Sam meurt, et Ike soupçonne que Boon n'est pas étranger à cela. Après la mort de Sam, le récit change. Les phrases deviennent extrêmement longues, une technique Faulkner caractéristique, et le narrateur commence à discuter de l’histoire du comté et de sa famille, le conduisant à sa décision de renoncer à son héritage. Le passé et le présent en viennent à coexister presque sans différenciation ...

Absalon, Absalon ! (Absalom, Absalom! ,1936)
"Absalon, Absalon ! " est tout d'abord l’ascension et la chute de Thomas Sutpen, un homme blanc né dans la pauvreté dans l’ouest de la Virginie, gagnant le Mississippi avec le double objectif de devenir riche en créant une plantation et d'y établir une dynastie pérenne en sacrifiant tout, conventions sociales et scrupules moraux, mais le voici rattrapé par son passé et les grandes mythologies du Sud des petits blancs, ramené à son impuissance originaire dans une société où pouvoir, prestige et loisir appartiennent à la classe des planteurs. Jamais l'écriture de Faulkner n'y a été plus incantatoire : la première phrase du premier chapitre dure un espace de douze ligne, et la seconde de dix-sept.... Quentin Compson y joue ici le rôle d'enquêteur, le héros est mort quarante ans avant ce jour de septembre 1909, et Quentin reçoit les premiers éléments de cette ténébreuse reconstitution de la bouche de la vieille Rosa Coldfield, la seule des quatre narrateurs successifs à avoir effectivement participé au drame évoqué...
En 1833, un homme brutal et imposant nommé Thomas Sutpen vient à Jefferson, Mississippi, avec un groupe d’esclaves et un architecte français. Il achète cent milles carrés de terre à une tribu indienne, élève un manoir, plante du coton, et épouse la fille d’un marchand local, et en quelques années a gagné son rang parmi l’aristocratie locale. Sutpen a un fils et une fille, Henry et Judith, qui grandissent dans cette campagne du nord du Mississipp et dans un milieu assez frustre. Henry entre au collège de l’Université du Mississippi en 1859 et rencontre un jeune homme de bonne culture nommé Charles Bon, ils se lient d’amitié, il le ramène chez lui pour Noël. Charles fait la connaissance de Judith, et au fil du temps, se tisse entre eux une relation partagée. Mais Sutpen se rend compte que Bon est en fait son propre fils — le demi-frère d’Henry et de Judith — d’un mariage antérieur qu’il a abandonné lorsqu’il a découvert que sa femme avait du sang noir. Il dit à Henry que les fiançailles ne peuvent être imaginées, et que Bon est son propre frère ; Henry, surpris et indigné, se refuse à croire que Bon connaissait ce secret depuis le début et s’est sciemment fiancé à sa propre sœur. Henry répudie son droit d’aînesse, et lui et Bon s’enfuient à la Nouvelle-Orléans. Lorsque la guerre de Sécession éclate, ils s’enrôlent et passent quatre années difficiles à se battre pour la Confédération alors que le Sud s’écroule autour d’eux. A la fin de la guerre, Sutpen retrouve son fils et lui révèle que non seulement Bon est son demi-frère et celui de Judith, mais qu'il est aussi, en partie, un homme noir. C'est cette révélation plus encore que celle de l'inceste qui révolte Henry et lorsque Bon en vient à épouser Judith, Henry le tue devant les portes de la plantation de Sutpen. Celui-ci, brisé, va glisser lentement dans l’alcoolisme, mais fidèle à cette énergie dévastatrice qui l'habite, commencer une liaison avec une jeune fille blanche de quinze ans nommée Milly : jusqu’à ce que, après la naissance de sa fille, il tous soit assassiné par le grand-père de Milly, Wash Jones, en 1869, un squatter compagnon de beuverie de Thomas Sutpen.
Des décennies plus tard, en 1909, Quentin Compson, vingt ans, le petit-fils du premier ami de Sutpen dans le pays (le général Compson), se prépare à quitter Jefferson pour aller à Harvard. Il est convoqué par Mlle Rosa Coldfield, la sœur de l’épouse de Sutpen, Ellen (et brièvement la fiancée de Sutpen), pour entendre l’histoire de Sutpen qui a détruit sa famille et la sienne. Au cours des semaines et des mois qui suivent, Quentin est entraîné de plus en plus profondément dans l’histoire de Sutpen, en discutant avec son père, en y réfléchissant, et plus tard en la racontant en détail à son colocataire de Harvard, Shreve. L’histoire est gravée dans son cerveau la nuit où il va avec Mlle Rosa à la plantation de Sutpen, où ils trouvent Henry Sutpen, devenu un vieil homme, qui n'attend que de mourir. Des mois plus tard, Rosa tente de revenir pour sauver Henry, mais Clytie, la fille de Thomas Sutpen et esclave, maintenant vieille femme flétrie, met le feu au manoir, se tuant elle-même et Henry, et signant la fin de la dynastie des Sutpen ...

Idylle au désert et autres nouvelles
"Un bon tiers des nouvelles de ce recueil sont des textes de jeunesse (c'est-à-dire d'avant le premier roman, Monnaie de singe) : la plus longue, «Portrait
d'Elmer», est même une version courte tirée par l'auteur vers 1935 d'un véritable «roman de formation» inachevé, datant du premier et décisif séjour à Paris, en 1925, et intitulé Elmer. Le
caractère autobiographique de certaines de ces nouvelles ne fait guère de doute. Mais ce n'est pas seulement parce que, contrairement aux grandes œuvres des années trente, on voit encore ici
Faulkner se raconter, que ces nouvelles nous intéressent. C'est peut-être surtout parce que notre lecture nécessairement rétrospective de ces œuvres de jeunesse nous permet de discerner le pire
dans le meilleur, nous obligeant même à nous poser la question : malgré quels défauts, ou même de quels défauts, devaient naître les qualités ? C'est dans l'atelier de l'artiste que nous sommes
invités. Ou plutôt, c'est un petit musée privé que constituent ces vingt-cinq textes qui disent tous quelque chose sur le travail d'un écrivain qui fut l'un des plus grands du siècle."
(Gallimard)

L’invaincu (The Unvanquished, 1938)
Six nouvelles publiées de septembre 1934 à avril 1935, accompagnée d'une septième non publiée jusque-là, "Une odeur de verveine", le tout formant une structure de roman. Une véritable porte d'entrée de l'oeuvre, quoique mineure. Un roman d'initiation et la clé de la maturité qui nous fait découvrir que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Sud, la figure d'Abraham Snopes.
Nous sommes, au début, en 1863, à la chute de Vicksburg. Bayard, le héros (le fils du vieux colonel et le futur grand-père du jeune Bayard de Sartoris), ainsi d'ailleurs que Ringo, son double Noir, ont douze, treize et quatorze ans, et ne voient la guerre que dans le halo déformant de la légende, fondée d`ailleurs, pour beaucoup, sur les apparitions prestigieuses du cavalier empoussiéré qu'est son père. De même, les actions para-militaires que mènent les deux adolescents en compagnie de la grand-mère de Bayard, et qui consistent à récupérer sur les Yankees des régiments de mulets qu'un Snopes, fâcheux allié de la vieille Mrs. Millard, leur revend ensuite. appartiennent à la légende.
Mais "Riposte en tierce", le chapitre suivant, au titre ironique, marque le tournant dramatique de l'œuvre. Les nuages s`amoncellent; la guerre, mais aussi le jeu vont finir. A la suite d'une nouvelle opération, relativement moins risquée que les autres puisqu'elle est montée aux dépens d'un de ces pauvres Blancs chefs de bandes qui profitent cyniquement de la guerre et sont l'autre ennemi des loyaux Sudistes, Mrs. Millard est assassinée. Alors commence, avec le déroulement inéluctable de la vendetta selon le code séculaire des clans traditionnels, l'effet de l'exemple de Mrs. Millard sur le jeune Bayard. C'est lui qui, à quinze ans, après une poursuite épique de près de deux mois, règle son compte à Grumby, l'assassin, et dépose rituellement sa main coupée sur la tombe de sa grand-mère.
"Vendée", le titre de ce chapitre, est manifestement emprunté à Balzac, que Faulkner admirait profondément. Mais c`est aussi Bayard qui, à vingt-quatre ans, saura échapper à la dialectique de la vengeance dans laquelle voudraient le plonger ses appartenances, son milieu et la tradition sudiste. Dans "Une odeur de verveine", Faulkner montre bien comment, grâce à sa maturation psychologique et morale, Bayard peut refuser le meurtre du meurtrier de son père : il le laisse tirer deux coups de feu, puis, dans le silence de la communauté tout entière, s'éloigner pour ne plus jamais revenir. La phrase clé du livre est celle qu'il dit à sa grand-tante, Mrs. DuPre, qui a aussitôt pris la place de Mrs. Millard : "Il me faut vivre avec moi-même, comprenez-vous" ...

William Faulkner, "The Wild Palms" (1939)
Célèbre recueil de deux nouvelles se nourrissant l'une l'autre, "two stories by chance, perhaps necessity", toutes deux déroulant l'allégorie du conflit entre un certaine "respectabilité sociale" et les forces incontrôlable de la "nature" , "If I Forget Thee Jerusalem" et "Old Man".
En 1937, à la Nouvelle-Orléans, Harry Wilbourne, jeune médecin, et Charlotte Rittenmeyer, mariée, rejettant toute convenance sociale, se jettent dans une passion tumultueuse, "sacrificed everything for love, and then lost that", écrira Faulkner. L'un des personnages illustrera cette sorte de "dégénérescence de la respectabilité" devenue morale : « Si Jésus revenait aujourd’hui, nous devrions le crucifier rapidement pour notre propre défense, pour justifier et préserver la civilisation que nous avons travaillé, souffert et mort… pendant deux mille ans pour créer et perfectionner à l’image de l’homme" (If Jesus returned today we would have to crucify him quick in our own defense, to justify and preserve the civilization we have worked and suffered and died…for two thousand years to create and perfect in man’s own image). Charlotte et Harry tentent d’échapper à cet univers, s'abandonnant à la passion physique. Mais la crainte de retomber dans la "respectabilité" tourne à l'obsession, et Charlotte mourra des effets d’un avortement que Harry lui impose.
Dix ans plus tôt, dans le Mississippi, un détenu, dont nous ignorons l'identité, traverse les eaux tumultueuses du Mississipi en crue, risquant sa propre survie pour sauver une femme enceinte abandonnée par son mari...

Descends, Moïse (Go down, Moses, 1942)
Après les grandes œuvres tragiques des années 30 et avec Le Hameau, qui le précède de deux ans seulement, Faulkner a écrit là le deuxième et dernier chef-d'œuvre de sa maturité. Il compose ici une œuvre romanesque à l'aide de huit textes, initialement des nouvelles publiées en magazine au cours des années 1940-1942), incorporés, non sans quelques modifications, dans le livre, avec leur titre originel. Le titre de l'ensemble est emprunté au début d'un negro spiritual dont la suite fournit son thème au livre, " Let my People go". Il s'agit tout du long des sept parties, de liberté, depuis la chasse bouffonne à l'esclave du prologue intitulé "Autre temps", jusqu'à la coda ironique et brutale qui porte le titre du livre et qui le clôt. Les autres textes sont 'Le Feu et le Foyer", lui-même composé de trois parties; "Le deuil sied au bouffon", un texte paru séparément, parfaitement autonome; "Gens de jadis", histoire d'initiation à la chasse qui sert de prologue à "L'Ours"; "Lion", nouvelle qui parut en 1935, qui constitue le germe de "L'Ours", narrée à la première personne par le jeune initié, lequel a pour nom, non pas Isaac McCaslin, mais Quentin Compson : ainsi s'établit le lien entre "Descends, Moire" et "Le Bruit et la Fureur"; enfin, "Automne dans le delta" et "Descends, Moïse", nouvelle éponyme où l'on voit la boucle bouclée et la longue histoire des McCaslin se dénouer dans le contemporain, sous une lumière à la fois tragique et dérisoire. Les McCaslin, une vieille famille de pionniers dont la double descendance, blanche (les deux cousins Cass et Ike) et noire (Lucas Beauchamp, qui sera le héros de L'Intrus, et sa femme Mollie), assume toute la vie déchirée de ce pays où la rivalité des sangs n'empêche pas le partage d'une même terre, d'une même douleur et d'un même et fatal péché originel. Ce péché, c”est la double et impardonnable faute commise par l'ancêtre, Carothers McCaslin, celui par qui un double scandale est arrivé - le double scandale qui hante déjà la conscience des héritiers de Thomas Sutpen dans "Absalon ! Absalon!", la puissance fantasmatique de l'image de la relation sexuelle du maître blanc avec l'esclave noire, mais aussi l'inceste, avec la fille qu'il a eue de la Noire avec laquelle il a couché. C'est ce qui est révélé à son descendant à la suite d'une scène mémorable, la laborieuse et
haletante lecture à deux (Ike McCaslin et son cousin Cass) des registres de la plantation (la parole de l'histoire) ... Isaac McCaslin, horrifié par ce qui vient de lui être révélé de son passé, aura beau renoncer à son héritage et choisir de vivre, tel le Christ, une vie de menuisier, il n'empêchera que sa solution ne doive être relativisée face à celle de Cass, le cousin, presque en âge d'être son père, qui, lui, assume l'héritage et gère la plantation. Ni l'un ni l'autre n'empêcheront d'ailleurs que l'histoire ne se manifeste in fine par un de ses plus cinglants retournements ironiques....
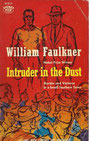
L’intrus (Intruder in the Dust, 1948)
Le quatorzième ouvrage de Faulkner aura un grand retentissement à cause de la question raciale qui est abordée. C'est aussi le premier à paraître après un silence de six années de l'auteur. L'intrus, c'est Lucas Beauchamp qui se laisse accuser du meurtre d'un Blanc, et offre ainsi à la communauté l'occasion de le voir comme un Noir. La foule blanche prend corps dans toute sa violence au chapitre IX, et qui disparaît, faute de victime, laissant la ville vide, aussi irréelle qu'un cauchemar. Lucas disparu, il n'y a plus de Sud...
"... Puis tout à coup la rue déserte fut pleine d'hommes. Pourtant ils n'étaient pas très nombreux à peine deux douzaines surgis brusquement et sans bruit on ne savait d'où. Mais ils avaient l'air d'emplir la rue, de l'obstruer, de l'interdire soudain, non pas de façon que personne ne pût passer à travers eux, passer par la rue, en user comme d'une rue, mais que personne n'osât, n'approchât même assez près pour tenter le gambit, de même que les gens se tiennent à l'écart d'une pancarte sur laquelle on lit Haute Tension ou Explosifs. Il les connaissait, il les reconnut tous; certains d`entre eux qu`il avait vus et entendus deux heures plus tôt chez le coiffeur - les jeunes ou les hommes au-dessous de quarante ans, célibataires, les sans-foyer qui, le samedi et le dimanche, allaient prendre des bains au salon de coiffure - des chauffeurs de camions et mécanos de garages, le graisseur de l'égreneuse à coton, un serveur du drugstore et ceux qu'on pouvait voir à longueur de semaine dans la salle de billard ou aux alentours, qui pour autant qu'on le sût, ne faisaient rien, mais possédaient des autos et, dépensaient en week-end, dans les bordels de Memphis ou de La Nouvelle-Orléans, un argent dont personne ne savait exactement comment ils le gagnaient - des hommes tels, disait son oncle, qu'il y en avait dans toutes petites villes du Sud, qui jamais ne se mettaient réellement à la tête des manifestations, n'en étaient même pas les instigateurs, mais, par suite de leur propension à suivre les masses, en étaient toujours le noyau. Puis il aperçut la voiture : il la reconnut, lui aussi, même à distance, sans e rendre compte ou se demander pourquoi elle s'arrêtait ; lui-même, sortant de dessous l'auvent qui le dissimulait, descendit dans la rue, puis la traversa, se dirigeant vers les lisières de l'attroupement, qui ne faisait aucun bruit, mais restait la, barrant le trottoir auprès de l'entrée de la prison et refluant dans la rue pendant que la voiture arrivait, pas vite, tout à fait posément, presque solennellement, comme devrait aller une voiture le dimanche matin, puis rasait le trottoir devant la prison, et s'arrêtait. Un agent la conduisait. Il ne fit pas mine de descendre. Puis la porte de derrière s ouvrit , et le shérif apparut : un homme énorme, formidable, sans graisse, avec de petits yeux pâles et durs dans une figure impassible, affable et presque vide; sans même leur accorder un coup d'oeil, il se retourna et maintint la porte ouverte.
Alors Lucas sortit, lentement, avec raideur, exactement comme un homme qui vient de passer la nuit enchaîné au pied d'un lit, la démarche quelque peu chancelante, se cognant ou du moins se raclant la tête contre le haut de la porte, si bien qu'en sortant son chapeau écrasé tomba de sa tête sur la chaussée presque sous ses pieds. Et ce fut la première fois qu'il eût Jamais aperçu Lucas sans son chapeau, et, dans le même instant il se rendit compte que, sauf peut-être Edmonds, ceux qui étaient dans la rue à le regarder étaient probablement les seuls Blancs du comté qui l'eussent jamais vu nu-tête : à le regarder, tandis que Lucas, toujours penché en avant tel qu'il était sorti de la voiture, cherchait avec raideur à atteindre son chapeau. Mais déjà, d'un grand geste étonnamment souple, le shérif s'était baissé, avait ramassé le chapeau et le remettait dans la main de Lucas qui, toujours courbé, avait l'air, lui aussi, de chercher maladroitement son couvre-chef. Mais, presque immédiatement, le chapeau fut retapé à sa forme habituelle, et Lucas, fut debout, très raide sauf la tête et les traits du visage, et le chapeau passa et repassa contre la manche de son avant-bras, d'un mouvement rapide, léger et adroit, comme on repasse un rasoir. Puis Lucas releva la tête et, d'un geste un peu moins ample, il remit son chapeau sur sa tête, à l'inclinaison habituelle, que le chapeau sembla prendre de lui-même, comme si Lucas l'avait simplement lancé en l'air, et, très droit maintenant dans son costume noir chiffonné par la nuit, quelle qu'elle fût, qu'il avait passée (il y avait une longue trace malpropre d'un bout à l''autre d'un des côtés, de l'épaule à la cheville, comme s'iI était resté couché sur un plancher non balayé dans la même position sans pouvoir en changer), Lucas les regarda pour la première fois, et Charles pensa Maintenant. Il va me voir maintenant, puis il se dit. Il m'a vu. Et c'est tout et il ajouta Il n'a vu personne car le visage ne les regardait même pas, il regardait seulement dans leur direction, arrogant et calme, n'exprimant pas plus d'hostilité que de crainte : détaché, impersonnel, presque rêveur, intraitable et impassible, les yeux clignotant légèrement dans la lumière du soleil, même après que le bruit, un souffle suspendu, se fut élevé de quelque part dans la foule et qu'une voix isolée eut dit:
"Fais-lui sauter ça, Hope. Et sa tête aussi, cette fois.
- Vous, les gars, foutez-moi le camp d'ici, dit le shérif. Retournez chez le coiffeur." Et, se tournant, il dit à Lucas : "Ça va. Allez, viens".
Et ce fut tout ; le visage, pendant un instant encore, regarda non pas eux, mais simplement dans leur direction, le shérif se dirigeant déjà vers la porte de la prison, quand Lucas se tourna enfin pour le suivre ; et en se pressant un peu, il pouvait encore seller Highboy et être sorti du pré avant que sa mère ne s'avisât d'envoyer Aleck Sander le chercher pour lui dire de venir déjeuner. Puis il vit Lucas s`arrêter et se retourner, et il se trompait, parce que Lucas savait où il était dans la foule, le regardant bien droit, avant même d'avoir fait demi-tour, s'adressant à lui :
"Vous, jeune homme, fit Lucas. Dites à votre oncle que je voudrais le voir". Puis il se retourna et reprit sa marche à la suite du shérif, toujours un peu raide dans son costume noir sali, le chapeau arrogant et clair dans le soleil, tandis que la voix dans la foule disait :
"Au diable l'avocat. Il n'aura même pas besoin d'un croque-mort cette nuit quand les Gowrie lui auraient fait son affaire." Lucas continuant son chemin et passant devant le shérif qui, lui-même, s'était arrêté à présent et se retournait pour les regarder en en déclarant de sa voix douce, impassible et froide :
"Je vous ai déjà dit une fois de foutre le camp. Je ne vous le répéterai pas."
(Traduction R-N.Raimbault)

Clarence Brown, "Intruder in the Dust", 1949 (L'Intrus)
avec David Brian, Claude Jarman Jr. et Juano Hernandez.
Mississippi, un homme a été assassiné, une sirène, une grande foule d’hommes blancs se rassemblant autour du bureau des shérifs pour voir ce qui se passe, le shérif Hampton sort Lucas Beauchamp, un afro-américain, de l’arrière de sa voiture, la foule se tait, tendue, haineuse, l'homme est connu pour son arrogance face aux Blancs, un adolescent blanc, qui découvre le racisme avec ses yeux d'enfants, et une vieille dame se chargeront de le disculper...

1950, la publication de ses Collected Stories et le "Portable Faulkner" de Malcom Cowley de 1946, impose, tardivement, Faulkner comme un des maîtres de la littérature aux Etats-Unis. Le 10 novembre 1949, il recevait le prix Nobel et sa vie devient "publique"...

Requiem pour une nonne (Requiem for a Nun, 1951)
"Sanctuaire, l'un des romans les plus célèbres de Faulkner, racontait l'aventure scandaleuse d'une jeune collégienne américaine, Temple Drake, séquestrée
dans une maison close par un gangster dégénéré, Popeye. Elle était libérée par l'arrestation de son «protecteur», condamné quelques mois plus tard et exécuté pour meurtre. Sept ans après, Temple
Drake est devenue une bourgeoise américaine, mariée au jeune homme qui fut le responsable de son infamie, et mère de deux enfants. Elle a à son service une négresse, ancienne prostituée, Nancy
Mannigoe. Survient un louche individu qui possède sur la vie passée de Temple des renseignements compromettants (des lettres écrites à son frère qui fut l'amant de Temple Drake, quand elle était
pensionnaire du bordel de Memphis) et qui la fait chanter. Temple est-elle amoureuse de cet homme, ou bien reprise par le goût du vice ? Elle décide de s'enfuir du domicile conjugal. Pour la
retenir, Nancy Mannigoe imagine un horrible forfait : de ses propres mains elle tue l'un des enfants confiés à sa charge. Nancy est condamnée à mort. Mais Temple, sous la pression de son oncle
Gavin, avocat de la criminelle, se rend chez le gouverneur pour arracher la grâce de la coupable. Elle ne peut y parvenir, mais trouve au moins l'occasion de confesser sa propre turpitude et de
se racheter par l'humiliation, première station du long calvaire qui l'attend. Telle est l'étrange et dramatique histoire que conte le grand romancier dans cet ouvrage, sorte de roman dialogué
dont Albert Camus a tiré une pièce." (Gallimard)

La trilogie des Snopes sont trois romans du genre "southern gothic" écrits par William Faulkner : Le Hameau, La Ville, Le Domaine. La genèse du projet s'intitule "Le Père Abraham", et n'est constituée que d'une cinquantaine de feuillet restés à l'état de projet de roman avorté (1927). Dans la note qui figure en ouverture du "Domaine", l'auteur dit avoir eu l'idée de la chronique à partir de 1925. La trilogie unifiée paraît en trois volumes sous le titre "Snopes" : "A Trilogy" en 1964 chez Random House, puis paraît en 1994 en un seul volume une édition préfacée par John Garrett, et enfin, traduite en français, elle paraît en 1994 chez Gallimard en novembre 2007.
Les Snopes (Le Hameau - La Ville - Le Domaine)
Les convulsions que subit le comté de Yoknapatawpha, Mississippi, se propagent à partir d'une horde d'intrus rusés et opportunistes, les Snopes, ces canailles de petits blancs sans foi ni loi, dont l'ascension et la multiplication mettent en péril l'identité du Sud. Une fois l'onde de choc appréciée à sa juste mesure, le vieux Sud sort de sa léthargie et relève le gant. Une guerre inavouée, pernicieuse et sauvage, sorte de pendant de la guerre de Sécession....
William Faulkner, "Le Hameau" (The Hamlet, 1940)
"Flem Snopes, métayer sans fortune, s'introduit dans la famille Warner. Secret et rusé, il parvient à épouser Eula, la fille du vieux Will Warner, supplantant son rival Labove, qui a tenté d'abuser d'elle. Sur le triomphe de Snopes, qui roule tout le monde, et qui symbolise l'avilissement du Sud, s'achève ce premier acte d'une trilogie romanesque qui se poursuivra avec "Le domaine" et "La ville" (traduction R.Hilleret, Gallimard). Pour se résumer, "c'est l'histoire d'un pauvre Blanc qui arrive dans une petite ville du Sud et y répand la corruption", le tout dans un festival de langage, de dialogue-dialecte des paysans madrès du Mississipi...
William Faulkner, "La Ville" (The Town, 1957)
La ville met en scène l’ascension de Flem Snopes, avide de considération plus encore que de richesse, qui, parti d’une gargote sordide, va s’élever lentement dans la hiérarchie de la ville. Mais cette chronique d’un bourg du Mississippi, dévoilée à travers le prisme de trois narrateurs, est aussi une grande et pathétique histoire d’amour dont Eula Snopes, une nonchalante et fatale beauté, est l’héroïne. «J’ai pensé à toute cette histoire d’un seul coup, comme un éclair fulgurant illumine le paysage et que vous apercevez tout, mais il faut le temps de l’écrire. J’ai cette histoire en tête depuis environ trente ans.» William Faulkner.
William Faulkner, "Le Domaine" (The Mansion, 1959)
"Qui a lu "Le hameau" n'a pas oublié le meurtre de Jack Houston par Mink Snopes, le paysan borné qui se venge d'une humiliation, et la longue nuit où l'assassin lutte contre le chien de sa victime avant d'enfouir le cadavre dans le tronc d'un arbre. Dans "Le domaine", troisième et dernier volume de la trilogie des Snopes après "Le hameau" et "La ville", nous avons une nouvelle version du crime de Mink, vu cette fois par l'assassin: la lente montée du ressentiment dans la cervelle obtuse de cette brute. Un désir de vengeance qui le place dans la galerie des monstres habités par une seule pensée..."
("Le Hameau", "Eula", chapitre I, cinq années de la vie d'Eula Varner, de l’arrivée de Flem Snopes dans le Domaine français (Frenchman's Bend), - elle n'a pas tout à fait treize ans -, de l'obsession de Labove et de la tentative de celui-ci envers la jeune fille, jusqu'à son départ pour Jefferson quand elle n'a "pas encore dix-huit"....
"Lorsque Flem Snopes arriva comme commis dans la boutique du père d'Eula Varner, celle-ci n'avait pas tout à fait treize ans. Elle était la dernière de seize enfants, le bébé, bien qu'elle eût rattrapé et dépassé sa mère, par la taille, dès sa dixième année. Et maintenant, n'ayant pas encore treize ans, elle était déjà plus forte que la plupart des femmes adultes et ses seins mêmes n'étaient plus ces petits cônes durs, ardents, pointus de la puberté, ni même ceux d'une jeune fille : au contraire, son aspect tout entier suggérait un certain symbolisme tiré des anciens temps dionysiaques : du miel au soleil, des raisins éclatés, du sang pressé coulant de la vigne féconde qu'écrase le sabot dur et avide de la chèvre. Elle semblait non pas faire partie intégrante du monde contemporain, mais plutôt vivre dans un vide prolifique dans lequel défilaient ses jours, comme si elle écoutait, derrière une vitre insonore, dans un morne hébétement, avec une sagesse blasée fondée sur la prescience de sa maturité féminine, se développer ses propres organes. Comme son père, c'était une paresseuse incurable. Toutefois ce qui était en lui une paresse constante, joyeuse, affairée, était en elle une force réelle, invincible et même impitoyable....
(...)
Elle grandit, de la petite enfance à l'âge de huit ans, dans des fauteuils, allant de l'un à l'autre dans la maison, selon les exigences du balayage et du nettoyage des pièces; l'heure des repas la forçait à sortir de son terrier. Sur les instances de sa mère, Varner continuait à lui faire faire des ustensiles de ménage par le forgeron des balais, un vrai petit poêle - espérant en faire un amusement un peu utile; mais tout ça, individuellement ou collectivement, était à peu près à ses yeux ce qu'un pot de thé froid peut être pour un ivrogne. Elle n'avait pas de compagnes de jeux, pas d'amie inséparable. Elle n'en avait pas besoin. Elle ne forma jamais une de ces associations intimes passionnées, et parfois éphémères, où deux fillettes forment une cabale secrète, un rempart contre leurs contemporains masculins et aussi contre le monde adulte. Elle ne faisait rien. Elle aurait aussi bien pu rester fœtus. C'était comme si une moitié seulement d'elle-même était née, que sa mentalité et son corps se fussent complètement séparés ou, au contraire, irrémédiablement mêlés, ou qu'un seul des deux fût sorti ou que celui-là fût sorti, sans l'autre, mais comme gros de l'autre. "Peut-être bien que ce sera un garçon manqué, disait son père.
(..)
Ce fut son frère, Jody, qui se dressa presque violemment, quand elle fut dans son huitième printemps, comme champion de l'érudition et, trois mois après, il eut à le regretter amèrement. Il ne regretta pas d'avoir insiste pour qu'elle allât à l'école. Son regret était
qu'il était toujours convaincu, et savait qu'il resterait convaincu, de la nécessité de ce qu'il payait si cher maintenant. Car elle refusa d`aller à pied à l'école. Elle ne refusait pas d'aller à l'école, d'être à l'école, mais elle refusait d'y aller à pied. Ce n'était pas loin. Ce n'était pas à un demi-mile de la maison des Varner. Et, cependant, pendant les cinq années où elle la fréquenta (ce qui, si cela avait été compté en heures basées sur ce qu'elle y faisait, quand elle y était, n'aurait pas été mesuré en années, pas même en mois, mais en jours), elle y alla à cheval à l'aller comme au retour. Tandis que d'autres enfants qui habitaient quatre ou cinq fois plus loin faisaient l'aller et retour à pied par tous les temps, elle allait à cheval. Elle refusa tranquillement et tout uniment de marcher. Elle n'eut pas recours aux larmes et ne résista même pas en faisant appel aux sentiments, elle résista encore moins physiquement. Elle resta simplement assise, et immobile, sans penser même, apparemment. Elle exhalait une indécence scandaleuse et intangible, comme une pouliche racée et rétive encore trop jeune pour avoir une grande valeur, mais qui pourrait l'avoir dans une année ou deux et que pour cette raison son propriétaire furieux et en rage n'ose pas fouetter..."
(Eula fréquenta l'école de huit à quatorze ans, puis celle-ci ferma, faute de maître : entre en jeu Labove qui accepte de la réouvrir, convaincu par Varner, tout en achevant ses études de droit à l'Université (Oxford) et jouant dans l'équipe de football. Il semble, après son diplôme, sur le point de quitter sa charge de maître et partir du village, mais la présence d'Eula n'est pas sans impact sur le jeune homme solitaire...)
"Et puis, un jour il découvrit qu'il s'était menti à lui-même depuis près de deux ans....
"Dans sa chambre, enfin, il se rendit compte qu'il devait partir tout de suite, partir à l'instant, même à pied. Il la voyait, il la sentait même, assise sur les marches de l'école, mangeant sa patate, tranquillement, mâchant, avec cette terrible faculté d'exister non seulement irrémédiablement et inconsciemment indépendamment de ses vêtements, mais d'être nue et de ne pas même s'en douter. Il savait maintenant que ce n'était pas sur les marches de l'école, mais dans son esprit, qu'elle était constamment depuis deux ans, que ce n'était pas de la rage du tout, mais de la terreur..."
(Labove, totalement possédé, accepte de faire la classe une année de plus, et finit par rester trois longues années...)
".. Il était devenu le moine et cette école glacée, ce petit village désert étaient sa montagne, son Gethsemani, et il le savait son Golgotha aussi. Il était l'anachorète viril d'autrefois. La mansarde sans feu était sa cellule déserte, le lit et sa mince paillasse, sur le plancher de bois de charpente, la couche de pierres sur laquelle il gisait couché à plat ventre, suant par les dures nuits glacées d'hiver, nu, rigide, avec ses dents serrées dans sa face studieuse et ses jambes velues comme celles d'un faune. Et puis le jour venait et il pouvait se lever, s'habiller et manger une nourriture qu'il ne voulait même pas goûter. D'ailleurs il n'avait jamais bien fait attention à ce qu'il mangeait, mais maintenant il ne voulait pas toujours savoir qu'il l'avait mangé.
Puis, il allait ouvrir l'école et s'asseoir derrière son bureau en attendant qu'elle passe entre les bancs. Il avait longtemps pensé a l'épouser, attendant qu'elle eût l'âge de la demander en mariage, d'essayer tout au moins, et il avait écarté cette idée. D'abord il n'avait pas besoin d'une femme, certainement pas encore, et probablement jamais. Et il ne voulait pas d'elle comme femme, il la voulait une fois, comme un homme qui a une main ou un pied gangrené désire ardemment le coup de hache qui lui rendra une intégrité relative. Toutefois, il aurait volontiers payé même ce prix, pour être délivré de son obsession, mais il savait que cela ne pouvait pas être, non seulement parce que son père, à elle, n'y consentirait jamais, mais à cause d'elle-même, de cette faculté qu'elle avait d'abolir absolument toute valeur d'échange d'une promesse de vie intime ou d`une capacité de dévouement, maigre prix demandé par un homme contre ce qu'il est convenu d'appeler son amour. Il pouvait presque imaginer le mari qu'elle aurait un jour. Ce serait un nain, un gnome, sans glandes ni désirs, qui ne serait pas plus un facteur physique dans sa vie à elle, que le nom du possesseur d'un livre sur la feuille de garde...
(..)
Ainsi c'était terminé. Et pourtant il restait là. Il restait là pour avoir le plaisir d'attendre que la dernière classe eût été renvoyée et que la salle fût vide, pour se lever et se diriger avec sa figure maudite, impassible, vers le banc, poser sa main sur le bois encore chaud où elle s'était assise, s'agenouiller même et poser sa figure sur le banc, la frotter tout contre, en étreignant le bois dur, insensible, jusqu'à ce que la chaleur s'en soit évaporée. Il était fou. Il le savait. Il y avait des fois ou il n'avait même pas envie de faire l'amour avec elle, mais de lui faire mal, de voir son sang jaillir et couler, de voir ce visage serein grimacer dans une expression indélébile de terreur, d'angoisse, sous son propre visage, d'y laisser quelque marque indélébile de lui-même et aussi de lui voir perdre l'aspect de face humaine. Et puis il s'exorcisait. Il chassait cette vision de son esprit et alors les situations se retournaient. C'était lui qui était harcelé, prostré devant ce visage qui, malgré ses quatorze ans, supposait une connaissance blasée qu'il n'atteindrait jamais, un écœurement, une satiété de toutes les
expériences perverses. Il était comme un enfant devant cette science. Il était comme une fillette, une vierge folle, étonnée, prise au piège, non par un séducteur mûr et expérimenté, mais par des forces intérieures aveugles et impitoyables avec lesquelles elle avait vécu depuis des années, sans savoir qu'elles étaient en elle et dont elle s'apercevait maintenant. Il se trainait dans la poussière devant le banc ..."
(...)
"Un après-midi il trouva sa hache. Il continua de couper, avec une espèce de spasme joyeux, les nerfs et les tendons qui pendaient des membres gangrenés, longtemps après le premier coup maladroit. Il n'avait pas entendu de bruit. Les derniers pas s'étaient éteints et la porte s'était refermée pour la dernière fois. Il ne l'entendit pas se rouvrir et cependant quelque chose lui fit relever la tête, qu'il frottait sur le banc. La fille était rentrée dans la salle et le regardait. Il comprit que non seulement elle reconnaissait la place devant laquelle il était agenouillé, mais qu'elle savait pourquoi. Il est possible qu'à ce moment il crut qu'elle l'avait toujours su, parce qu'il se rendit compte tout de suite qu'elle n'était pas effrayée et qu'elle ne riait pas de lui, mais que, simplement, cela lui était égal. Et elle ne savait pas non plus qu'elle regardait un meurtrier en puissance. Elle lâcha tranquillement la porte et, passant dans l`allée, alla jusqu'à l'endroit où était le poêle. "Joddy est point encore là, dit-elle, y fait froid dehors. Qu`est-ce que vous faites là par terre?" Il se releva. Elle s'approcha sans appréhension, toujours avec son cartable en toile cirée, qu'elle portait depuis cinq ans maintenant et qu'elle savait n'avoir jamais ouvert, hors de la salle de classe, que pour y mettre ses patates froides. Il fit un pas vers elle.
Elle s'arrêta, l'observant.
- N'aie pas peur, dit-il. N'aie pas peur!
- Peur? dit-elle. Peur de quoi? `
Elle recula d'un pas, puis s'arrêta, observant la figure de Labove. Elle n'avait pas peur. «Elle n'en est pas encore là», pensait-il, et puis un sentiment de fureur froide, de renoncement et de frustration à la fois, surgit en lui, bien que rien ne parût sur son visage, qui restait légèrement souriant, tragique, désespéré, satanique.
- C'est bien ça, dit-il, c'est bien le malheur. Tu n'as pas peur. C'est ça qu'il faut que tu apprennes. C'est quelque chose que je vais t'apprendre, en tout cas.
Il lui avait enseigné autre chose, bien qu'il ne s'en rendit pas compte tout de suite. Elle l'avait en effet appris durant ces cinq années d'école, et elle allait passer un examen là-dessus. Il s'approcha d'elle. Elle ne reculait toujours pas. Alors, il l'étreignit. Il agissait rapidement et impitoyablement, comme si elle avait été un ballon de rugby ou comme s'il avait la balle et qu'elle fût l'obstacle entre lui et la ligne blanche finale qu'il haïssait et qu`il devait atteindre. Il l'étreignit brutalement, les deux corps se heurtèrent violemment, parce qu'elle n'avait même pas eu le temps de l'éviter et encore moins de se préparer à lui résister.
Elle paraissait momentanément hypnotisée par la surprise, complètement inerte, forte, immobile, presque aussi grande que lui, ses yeux à hauteur des siens, tandis que son corps, en apparence toujours étranger à ses vêtements, et qui, à son insu, avait fait un sabbat
priapique de ce à quoi, au prix de trois ans de sacrifice et de peine et de flagellations et de combats incessants avec son propre sang inapaisable, il avait acheté le privilège de dédier sa vie, semblait aussi fluide et sans consistance qu'un lait miraculeusement pur.
Et puis ce corps se ramassa sur lui-même en une furieuse et silencieuse résistance, qu'il aurait pu même alors discerner ne pas être de la peur, ni même de la pudeur outragée, mais simplement de la surprise et de l'agacement. Elle était forte. Il s'y attendait. II le désirait même et l'espérait. Ils luttaient furieusement.
Il souriait toujours, murmurant même :
- C'est ça, disait-il, résiste. Défends-toi. C'est tout à fait ça, un homme et une femme qui luttent l'un contre l'autre.
La haine! Tuer, mais le faire de telle façon que l'autre devra savoir pour toujours, ensuite,
que l'un ou l'autre est mort, lui ou .elle : pas mort et couché tranquillement, parce que pour toujours, il faudra qu'ils soient deux dans cette tombe et ces deux-là ne pourront jamais être couchés tranquillement ensemble n`importe où, et aucun des deux ne pourra jamais être couché quelque part solitaire et tranquille jusqu'à ce que l'autre soit mort.
Il ne la tenait pas étroitement serrée, pour mieux sentir la sauvage résistance de ses os et de ses muscles, la maintenant juste assez pour l'empêcher de l'atteindre à la face. Elle n'avait pas fait de bruit, bien que son frère, qui n'était jamais en retard pour venir la chercher, dût se trouver maintenant dehors, près du bâtiment. Labove n'y pensait pas. Cela lui aurait été égal probablement. Il la tenait toujours un peu mollement, toujours souriant, en chuchotant un fatras de bouts de vers latins et grecs et des obscénités du Mississipi américain, quand tout à coup elle réussit à dégager un de ses bras, et avec le coude lui frappa violemment le menton. Il en fut déséquilibré, et avant qu'il eut pu recouvrer son aplomb, elle le frappa d'un coup de poing en pleine figure. Il recula en chancelant, heurta un banc et tomba presque dessous. Elle se pencha sur lui, respirant profondément, mais non essoufflée; elle n'était même pas décoiffée.
- Ne recommencez pas à me tripoter, dit-elle, vous, espèce de vieil abruti sans cervelle.
Quand ses pas se furent éloignés et que la porte se fut refermée, il entendit la pendule bon marché qu'il avait rapportée de sa chambre à l'Université qui faisait, dans le silence, un bruit métallique, comme celui de petits grains de plomb tombant dans une boîte en fer; mais il ne s'était pas encore relevé que la porte s'ouvrit à nouveau et, toujours assis sur le plancher, il la vit passer entre les bancs :
- Où est mon..., dit-elle. Alors, elle aperçut son cartable, le ramassa et quitta la salle. Il entendit à nouveau la porte. "Elle ne lui a pas encore dit", songea-t-il. Il connaissait bien le frère. Il n'aurait pas attendu de la reconduire d'abord à la maison. Il serait entré tout de suite, se vengeant enfin de cinq années de forte et insupportable conviction. Ça serait déjà quelque chose de toute façon. Ça ne serait pas la possession bien sûr, mais ça serait la même chair ..."
(II - Mais la vie continue, l'incident est bientôt oublié, Eula commence à susciter un certain intérêt, puis un homme fit son apparition dans le village, un commis voyageur, un jeune citadin plein d'assurance et d'insistance, il se nommait Snopes..)
"Elle le connaissait bien. Elle le connaissait si bien qu'elle n'eut jamais plus à le regarder. Elle le connaissait depuis son quatorzième printemps, quand les gens disaient qu`il avait supplante son frère. Ils ne le lui dirent pas à elle. Elle ne les aurait pas entendus.
Cela lui aurait été égal. Elle le voyait presque tous les jours, parce qu'à son quinzième printemps, il prit l'habitude de venir à la maison même apres le souper. Il s'asseyait près du père, dans la véranda, non pas pour parler, mais pour écouter, en crachant proprement par dessus la barre d'appui. Parfois, le dimanche après-midi, il venait s'accroupir contre un arbre près du hamac en bois où le père était couché en chaussettes, toujours sans dire un mot, toujours chiquant. Elle l'apercevait de l'endroit où elle était assise dans la véranda, entourée cette année-là de la foule en folie de ses galants du dimanche. Elle avait alors appris à reconnaître le crissement muet de ses chaussures de tennis sur les planches de la véranda; sans se lever, sans même tourner la tête, elle appelait à l'intérieur de la maison : "Papa, voilà cet homme", ou bien : "Voilà l'homme", "Papa, voilà encore l'homme!" Cependant, elle disait quelquefois : M. Snopes, du même ton qu'elle eût dit : M. le Chien.
L'été suivant, dans sa seizième année, non seulement elle ne le regardait pas, mais elle ne le voyait plus, parce qu'il habitait la même maison, mangeait à la même table, utilisait le cheval de selle de son frère pour aller avec son père à leurs affaires interminables. Il passait devant elle dans le vestibule, où son frère la tenait, habillée pour monter dans le buggy, tandis que de sa main rageuse, il la tâtait pour se rendre compte qu'elle portait bien un corset, et elle ne le voyait pas. Elle lui faisait face à table, aux repas, deux fois par jour, parce qu'elle prenait son petit déjeuner dans la cuisine, à n'importe quelle heure de la matinée quand sa mère finissait par la faire lever, bien qu'une fois levée, il n'était pas difficile de la faire mettre à table. Chassée enfin de la cuisine par la servante noire ou par sa mère, une moitié de son biscuit dans la main, et la figure pas encore lavée, elle semblait, dans le somptueux déshabillé de ses cheveux dénoués et de ses vêtements négligés, pas toujours propres, qu'elle avait ramassés en hâte entre son lit et la table de la cuisine, avoir été arrachée à une couche d'amour illicite par un raid de police. Elle passait dans le hall devant lui, qui allait déjeuner, comme s'il n'avait jamais existé.
Puis, un jour ils la collèrent dans ses vêtements du dimanche, mirent le reste de ses affaires - les robes de chambre et chemises de nuit voyantes qu'elle avait achetées, les chaussures légères, bon marché et tous les objets de toilette qui lui appartenaient - dans l'énorme valise et l'emmenèrent à la ville, où ils la marièrent à cet homme.
Ratliff était à Jefferson ce lundi après-midi, lui aussi. Il les vit tous les trois traverser la place, de la banque au greffe du palais de justice et il les suivit. Il passa devant la porte du bureau du greffier et les vit à l'intérieur. Il aurait pu attendre, les voir aller du palais de justice au greffier ambulant et être témoin du mariage, mais il ne le fit pas.
Il n'en eut pas besoin. Il savait ce qui se passait maintenant et il était déjà reparti pour la gare, pour attendre, pendant une heure, son train. Il ne se trompait pas. Il vit la valise en paille et le grand sac à soufflets dans la salle d`attente, côte à côte, comme un incroyable scandale; il vit une fois encore, à travers une vitre mouvante, le beau masque calme, sous le chapeau des dimanches, ne regardant rien, et ce fut tout...."
(trad. R.Hilleret, Gallimard)
Martin Ritt, "The Long, Hot Summer" (Les Feux de l'été), 1958,
avec Orson Welles, Paul Newman, Lee Remick et Joanne Woodward.
Le scénario, écrit par Irving Ravetch et Harriet Frank Jr., reprend en partie trois œuvres de William Faulkner, la nouvelle de 1931 "Spotted Horses", la nouvelle de 1939 "Barn Burning" et le roman de 1940 "The Hamlet". A cela s'ajoutent des personnages inspirés par la pièce de 1955 de Tennessee Williams, "Cat on a Hot Tin Roof", dont une adaptation cinématographique sortira cinq mois plus tard...


Les Larrons (The Reivers (1962)
"Les larrons est le dernier roman de William Faulkner. Il s'agit là d'une histoire heureuse, d'un éclat de rire qui succède à la douloureuse intensité d'une
œuvre presque exclusivement dramatique. En 1905, le grand-père de Lucius Priest achète une automobile qui sera parmi les premières à apparaître dans la ville de Jefferson. Pendant une absence de
son grand-père, le petit garçon et le chauffeur s'emparent de la voiture et partent pour Memphis. Un passager clandestin apparaît en cours de route : Ned, un domestique noir de la famille.
Arrivés à Memphis, Lucius et Boon, le chauffeur, s'installent dans une étrange «pension de famille», dont la tenancière est la Miss Reba de Sanctuaire. Mille péripéties les guettent. Ce roman est
une sorte de conte de l'âge d'or, un adieu souriant aux personnages qui, pendant tant d'années, ont été les compagnons de chaque jour du grand romancier." (Gallimard)

"Rowan Oak", la maison de William Faulkner,
... une grande demeure de bois, bâtie avant la Guerre de Sécession, demeure-musée située à Oxford, Old Taylor Road, Mississipi, USA.
"Je crois que l'homme ne se contentera pas d'endurer, mais qu'il vaincra. Il est immortel, non pas parce que lui seul, parmi les créatures, possède une voix inépuisable, mais parce qu'il a une âme, un esprit capable de compassion, de sacrifice et d'endurance. Le devoir du poète, de l'écrivain, est d'écrire sur ces choses. C'est son privilège d'aider l'homme à endurer en élevant son cœur, en lui rappelant le courage, l'honneur, l'espoir, la fierté, la compassion, la pitié et le sacrifice qui ont fait la gloire de son passé". La voix du poète peut être l'un des piliers de l'être humain pour l'aider à tout endurer : "I believe that man will not merely endure; he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance. The poet’s, the writer’s duty is to write about these things. It is his privilege to help man endure by lifting his heart, by reminding him of the courage and honor and hope and pride and compassion and pity and sacrifice which have been the glory of his past. The poet’s voice need not merely be the record of man, it can be one of the props, the pillars to help him endure and prevail." (extrait de son discours prononcé le 10 décembre 1950 à Stockholm, en Suède, lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature)



