- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci - Lukacs
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Hesse
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Cassirer
- Harlem - Langston Hughes
- Lovecraft
- Zamiatine
- Svevo - Pirandello
- TS Eliot
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Oscar Wilde (1854–1900) , "The Picture of Dorian Gray" (1891), "De Profundis" (1897) - "A Woman of no Importance" (1893), "The Importance of being Earnest" (1895), "The Ballad of Reading Goal" (1898) - .....
Last update: 18/12/2016

Dans les années 1870, le personnage de l'"esthète" est associé à des idées "malsaines", mêlant l'amour sensuel, la luxure, la cruauté, en rupture totale avec les valeurs de la société victorienne. Dans les années 1880, les "esthètes" aux longs cheveux, aux discours précieux, vêtus de velours deviennent l'objet d'une satire plus compréhensive. Oscar Wilde (1854-1900) va donc adopter habilement cette posture et accéder à la notoriété par des conférences sur les idéaux de l'Aesthetic Movement. A tel point que sa chute en 1895, lorsqu'il sera condamné à deux ans de prison pour homosexualité au terme d'un procès retentissant, discréditera l'Aesthetic Movement pour toute une génération. Il aura, entretemps, fait sienne l'inspiration d'un Swinburne, chez qui "on rencontre pour la première fois le cri de la chair tourmentée par le désir et le souvenir, la jouissance et le remords, la fécondité et la stérilité" (lettre de Wilde à E. de Goncourt, 17 décembre 1891).
"Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d’y céder"
" The only way to get rid of a temptation is to yield to it"
C'est dans "The Picture of Dorian Gray", que lord Henry résume le principe de l'esthétisme et entraîne Dorian Gray dans un quête de la sensualité, de la beauté, mais de la destruction, son corolaire : car c'est avec le déclin de l'Empire britannique, parce que l'emprise de la morale bourgeoise sur l'existence semble se désagréger, que l'art, l'artiste, la beauté, la sensualité ne sont plus asservis à quelques grands idéaux, et qu'une nouvelle sensation du monde peut enfin librement s'exprimer, au risque de se perdre...
"And yet," continued Lord Henry, in his low, musical voice, and with that graceful wave of the hand that was always so characteristic of him, and that he had even in his Eton days, "I believe that if one man were to live out his life fully and completely, were to give form to every feeling, expression to every thought, reality to every dream--I believe that the world would gain such a fresh impulse of joy that we would forget all the maladies of mediaevalism, and return to the Hellenic ideal--to something finer, richer than the Hellenic ideal, it may be. But the bravest man amongst us is afraid of himself. The mutilation of the savage has its tragic survival in the self-denial that mars our lives. We are punished for our refusals. Every impulse that we strive to strangle broods in the mind and poisons us. The body sins once, and has done with its sin, for action is a mode of purification. Nothing remains then but the recollection of a pleasure, or the luxury of a regret. The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Resist it, and your soul grows sick with longing for the things it has forbidden to itself, with desire for what its monstrous laws have made monstrous and unlawful. "
"Et encore, continua la voix musicale de lord Henry sur un mode bas, avec cette gracieuse flexion de la main qui lui était particulièrement caractéristique et qu’il avait déjà au collège d’Eton, je crois que si un homme voulait vivre sa vie pleinement et complètement, voulait donner une forme à chaque sentiment, une expression à chaque pensée, une réalité à chaque rêve, je crois que le monde subirait une telle poussée nouvelle de joie que nous en oublierions toutes les maladies médiévales pour nous en retourner vers l’idéal grec, peut-être même à quelque chose de plus beau, de plus riche que cet idéal! Mais le plus brave d’entre nous est épouvanté de lui-même. Le reniement de nos vies est tragiquement semblable à la mutilation des fanatiques. Nous sommes punis pour nos refus. Chaque impulsion que nous essayons d’anéantir, germe en nous et nous empoisonne. Le corps pèche d’abord, et se satisfait avec son péché, car l’action est un mode de purification. Rien ne nous reste que le souvenir d’un plaisir ou la volupté d’un regret. Le seul moyen de se débarrasser d’une tentation est d’y céder. Essayez de lui résister, et votre âme aspire maladivement aux choses qu’elle s’est défendues; avec, en plus, le désir pour ce que des lois monstrueuses ont fait illégal et monstrueux."

Oscar Wilde (1854-1900)
Né à Dublin, fils d'un chirurgien réputé et d'une femme de lettres engagée dans la lutte irlandaise, Jane Francesa Elgee, qui l'influencera
considérablement, Oscar Wilde passe une enfance sans histoire, fréquente la bonne société et les meilleures écoles, goûte une vie d'étudiant aisé à Oxford, découvre l'Aesthetic Movement de Ruskin
et de Walter Horatio Pater, se fait remarquer par ses tenues extravagantes, écrit poèmes et essais, voyage en Italie (1875), en Grèce (1877), à Paris (1883). Il se lance à la conquête de
Londres, affermit son personnage déjà esquissé à Oxford, ne négligeant rien pour se singulariser, s'imposant rapidement et dépensant sans compter ("les beaux péchés, comme les beaux objets, sont
le privilège du riche"; "le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans la vie moderne.."). Pour Wilde, écrire "débute par un embellissement abstrait, un travail purement imaginatif
et agréable appliqué à ce qui est réel et non existant, se montre pour les faits d'une indifférence absolue, invente, imagine, rêve et garde entre lui et la réalité l'impénétrable barrière du
beau style, de la méthode décorative ou idéale" (Intentions,1891).

En 1884, il épouse Constance Lloyd, s’installe à Chelsea dans une demeure où défilera toute la société artistique londonienne. Le couple aura deux fils en
1885 et 1886, mais Wilde semble déserter souvent le domicile conjugal au profit d’hôtel où il retrouve des jeunes gens qu’il entretient. De 1887 à 1889, il est rédacteur du magazine The Woman’s
World et écrit pour ses enfants un certain nombre de contes.
- Le Fantôme de Canterville (The Canterville Ghost) (1887)
- Le Crime de Lord Arthur Savile (Lord Arthur Savile's Crime) (1887)
- Le portrait de Mr. W.H. (The Portrait of Mr. W.H.) (1889)
En 1891, Wilde publie son premier et unique roman, "Le Portrait de Dorian Gray" mais, alors qu'il acquiert enfin une réelle notoriété, c'est à cette époque
que débute sa liaison passionnée avec le jeune Lord Alfred Douglas, fils du huitième marquis de Queensberry, de seize ans son cadet, dit "Bosie" et que Shaw appelait "Childe Alfred". Dès lors,
Oscar Wilde verse dans le scandale public et précipite sa chute inexorable : "de telles adorations sont pleines de danger : danger de les perdre, danger non moindre de les garder". Son
personnage et son oeuvre sont irrémédiablement affectés : le public anglais, écrit-il à E.de Goncourt, hypocrite, prude et philistin, "confond toujours l'homme avec ses
productions".
Il séjourne à Paris en 1891, y rencontre Mallarmé, Pierre Louÿs et André Gide. Ses brillantes comédies mondaines renouvellent le théâtre anglais mais ne parviennent guère à s'imposer : "Lady Windermere's Fan" (1892), "A Woman of No Importance" (1893), considérée comme la plus spirituelle des pièces en langue anglaise avec "The Importance of Being Earnest" (1895), "An Ideal Husband" (1895). Ces quatre contes de "The House of Pomegranates" (1891) – "The Young King", "The Birthday of the Infanta", "The Fisherman and his soul" et "The Star-Child" –, sont considérés comme les plus caractéristiques de l'esthétique d'Oscar Wilde, mêlant son amour de la beauté sous toutes ses formes et le sens du dialogue, un l'humour à base de "nonsense", parfois jugé artificiel, toujours léger, souvent cynique.
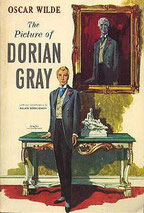
Le Portrait de Dorian Gray
(The Picture of Dorian Gray, 1891)
Londres 1866. Basil Hallward peint le portrait d'un séduisant jeune homme, Dorian Gray, incarnation du snobisme fin de siècle. Ce dernier s'amourache de
Sybil Vane, une chanteuse de cabaret mais les conventions rigides de son milieu le font rompre et elle se suicide. En rentrant chez lui, le héros voit son portrait se déformer sous le poids de
ses vices, tandis que lui-même conserve une jeunesse parfaite. Miné par cette dépossession, il en vient à haïr le tableau, qu'il frappe et déchire : l'œuvre retrouve sa beauté, le modèle
meurt.
"The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn..."
"L’atelier était plein de l’odeur puissante des roses, et quand une légère brise d’été souffla parmi les arbres du jardin, il vint par la porte ouverte,
la senteur lourde des lilas et le parfum plus subtil des églantiers.
D’un coin du divan fait de sacs persans sur lequel il était étendu, fumant, selon sa coutume, d’innombrables cigarettes, lord Henry Wotton pouvait tout
juste apercevoir le rayonnement des douces fleurs couleur de miel d’un aubour dont les tremblantes branches semblaient à peine pouvoir supporter le poids d’une aussi flamboyante splendeur ; et de
temps à autre, les ombres fantastiques des oiseaux fuyants passaient sur les longs rideaux de tussor tendus devant la large fenêtre, produisant une sorte d’effet japonais momentané, le faisant
penser à ces peintres de Tokio à la figure de jade pallide, qui, par le moyen d’un art nécessairement immobile, tentent d’exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des
abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d’un chèvrefeuille isolé, faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le
sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d’un orgue éloigné.
Au milieu de la chambre sur un chevalet droit, s’érigeait le portrait grandeur naturelle d’un jeune homme d’une extraordinaire beauté, et en face, était
assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant, avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de
conjectures.
Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et
parut s’y attarder. Mais il tressaillit soudain, et fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s’il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de
se réveiller.
— Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, dit lord Henry languissamment. Il faut l’envoyer l’année
prochaine à l’exposition Grosvenor. L’Académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j’y suis allé, il y avait là tant de monde qu’il m’a été impossible de voir les tableaux, ce qui
était épouvantable, ou tant de tableaux que je n’ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable...
— Je ne crois pas que j’enverrai ceci quelque part, répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses
amis d’Oxford. Non, je n’enverrai ceci nulle part.
Lord Henry leva les yeux, le regardant avec étonnement à travers les minces spirales de fumée bleue qui s’entrelaçaient fantaisistement au bout de sa
cigarette opiacée.
— Vous n’enverrez cela nulle part ? Et pourquoi mon cher ami ? Quelle raison donnez-vous ? Quels singuliers bonshommes vous êtes, vous autres peintres ?
Vous remuez le monde pour acquérir de la réputation ; aussitôt que vous l’avez, vous semblez vouloir vous en débarrasser. C’est ridicule de votre part, car s’il n’y a qu’une chose au monde pire
que la renommée, c’est de n’en pas avoir. Un portrait comme celui-ci vous mettrait au-dessus de tous les jeunes gens de l’Angleterre, et rendrait les vieux jaloux, si les vieux pouvaient encore
ressentir quelque émotion.
— Je sais que vous rirez de moi, répliqua-t-il, mais je ne puis réellement l’exposer. J’ai mis trop de moi-même là-dedans.
Lord Henry s’étendit sur le divan en riant...
— Je savais que vous ririez, mais c’est tout à fait la même chose.
— Trop de vous-même !... Sur ma parole, Basil, je ne vous savais pas si vain ; je ne vois vraiment pas de ressemblance entre vous, avec votre rude et
forte figure, votre chevelure noire comme du charbon et ce jeune Adonis qui a l’air fait d’ivoire et de feuilles de roses. Car, mon cher, c’est Narcisse lui-même, tandis que vous !... Il est
évident que votre face respire l’intelligence et le reste... Mais la beauté, la réelle beauté finit où commence l’expression intellectuelle. L’intellectualité est en elle-même un mode
d’exagération, et détruit l’harmonie de n’importe quelle face. Au moment où l’on s’assoit pour penser, on devient tout nez, ou tout front, ou quelque chose d’horrible. Voyez les hommes ayant
réussi dans une profession savante, combien ils sont parfaitement hideux ! Excepté, naturellement, dans l’Église. Mais dans l’Église, ils ne pensent point. Un évêque dit à l’âge de quatre-vingts
ans ce qu’on lui apprit à dire à dix-huit et la conséquence naturelle en est qu’il a toujours l’air charmant. Votre mystérieux jeune ami dont vous ne m’avez jamais dit le nom, mais dont le
portrait me fascine réellement, n’a jamais pensé. Je suis sûr de cela. C’est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes, et nous
rafraîchir l’intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basil : vous ne lui ressemblez pas le moins du monde.
— Vous ne me comprenez point, Harry, répondit l’artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas ; je le sais parfaitement bien. Je serais même fâché
de lui ressembler. Vous levez les épaules ?... Je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles, cette sorte de fatalité qui suit à la piste à travers
l’histoire les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laids et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s’asseoir à
leur aise et bâiller au spectacle. S’ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre, sans être troublés, indifférents et
tranquilles. Ils n’importunent personne, ni ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu’il est, mon art aussi imparfait qu’il puisse être,
Dorian Gray avec sa beauté, nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné, nous souffrirons terriblement...
— Dorian Gray ? Est-ce son nom, demanda lord Henry, en allant vers Basil Hallward.
— Oui, c’est son nom. Je n’avais pas l’intention de vous le dire.
— Et pourquoi ?
— Oh ! je ne puis vous l’expliquer. Quand j’aime quelqu’un intensément, je ne dis son nom à personne. C’est presque une trahison. J’ai appris à aimer le
secret. Il me semble que c’est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu’un nous la cache. Quand je
quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais : en le faisant, je perdrais tout mon plaisir. C’est une mauvaise habitude, je l’avoue, mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une
part de romanesque... Je suis sûr que vous devez me croire fou à m’entendre parler ainsi ?..."
Reprenons le récit. Un jeune aristocrate anglais qui, jaloux d'un portrait qu'un ami peintre, Basil Hallward, a fait de lui, exprime le souhait que le jeune homme du tableau vieillisse à sa place et voit son vœu exaucé. Au fil des ans, le portrait s'enlaidit de tous les péchés commis par Dorian Gray, et celui-ci, qui y voit sa conscience et le reflet de son âme, finit par se suicider en croyant anéantir son double accusateur. Le personnage de lord Henry Wotton, qui révèle Dorian à sa propre noirceur plutôt qu'il ne le corrompt, incarne l'attrait d'une vie débarrassée de toute sentimentalité et dominée par les seules considérations esthétiques. Son double inversé, Basil HallWard, qui a fait de Dorian Gray son idéal et dont le désir homosexuel est à peine masqué, n'est pas moins responsable de la chute de Dorian Gray, qui, à l'instar de son créateur, s'insurge contre l'idéalisme.
Ainsi Wilde écrira-il : "Basil Hallward est ce que je crois être; lord Henry ce que le monde croit que je suis; Dorian est ce que je voudrais être en d'autres temps, peut-être." Dédoublement toujours, au suicide de Dorian fait écho celui de Sybil Vane, une jeune actrice dont il s'est épris : Dorian périt pour avoir préféré l'illusion de l'art à la vie, Sybil meurt pour avoir choisi de vivre l'amour plutôt que de l`incarner. Conte fantastique et parabole, Dorian Gray est autant une pierre angulaire des débats éthiques et esthétiques de son époque qu'un texte sans âge sur les rapports qu'entretiennent le bien et le beau, l'art et la vie, l'âme et le corps. Si Wilde y rend un hommage ambigu aux décadents français en faisant d` "A rebours" de Huysmans le livre qui, de l`aveu même de l`auteur, corrompt Dorian Gray, Mallarmé lui retourne le compliment en lui écrivant : "J 'achève "Le Portrait de Dorian Gray", un des seuls qui puissent émouvoir, vu que d'une rêverie essentielle et des parfums d'âmes les plus étranges s'est fait son orage. Redevenir poignant à travers l'inouï raffinement d'intellect, et humain, en une pareille perverse atmosphère de beauté, est un miracle que vous accomplissez et selon quel emploi de tous les arts de l'écrivain!"....
Chapitre XII
"C’était le neuf novembre, la veille de son trente-huitième anniversaire, comme il se le rappela souvent plus tard. Il sortait vers onze heures de chez lord Henry où il avait dîné, et était enveloppé d’épaisses fourrures, la nuit étant très froide et brumeuse. Au coin de Grosvenor Square et de South Audley Street, un homme passa tout près de lui dans le brouillard, marchant très vite, le col de son ulster gris relevé. Il avait une valise à la main. Dorian le reconnut. C’était Basil Hallward.
Un étrange sentiment de peur qu’il ne put s’expliquer l’envahit.
Il ne fit aucun signe de reconnaissance et continua rapidement son chemin dans la direction de sa maison...
Mais Hallward l’avait vu. Dorian l’aperçut s’arrêtant sur le trottoir et l’appelant. Quelques instants après, sa main s’appuyait sur son bras.
– Dorian ! quelle chance extraordinaire ! Je vous ai attendu dans votre bibliothèque jusqu’à neuf heures. Finalement j’eus pitié de votre domestique fatigué et lui dit en partant d’aller se coucher. Je vais à Paris par le train de minuit et j’avais particulièrement besoin de vous voir avant mon départ. Il me semblait que c’était vous, ou du moins votre fourrure, lorsque nous nous sommes croisés. Mais je n’en étais pas sûr. Ne m’aviez-vous pas reconnu ?
– Il y a du brouillard, mon cher Basil ? je pouvais à peine reconnaître Grosvenor Square, je crois bien que ma maison est ici quelque part, mais je n’en suis pas certain du tout. Je regrette que vous partiez, car il y a des éternités que je ne vous ai vu. Mais je suppose que vous reviendrez bientôt.
– Non, je serai absent d’Angleterre pendant six mois ; j’ai l’intention de prendre un atelier à Paris et de m’y retirer jusqu’à ce que j’aie achevé un grand tableau que j’ai dans la tête. Toutefois, ce n’était pas de moi que je voulais vous parler. Nous voici à votre porte. Laissez-moi entrer un moment ; j’ai quelque chose à vous dire.
– J’en suis charmé. Mais ne manquerez-vous pas votre train ? dit nonchalamment Dorian Gray en montant les marches et ouvrant sa porte avec son passe-partout.
La lumière du réverbère luttait contre le brouillard ; Hallward tira sa montre.
– J’ai tout le temps, répondit-il. Le train ne part qu’à minuit quinze et il est à peine onze heures. D’ailleurs j’allais au club pour vous chercher quand je vous ai rencontré. Vous voyez, je n’attendrai pas pour mon bagage ; je l’ai envoyé d’avance ; je n’ai avec moi que cette valise et je peux aller aisément à Victoria en vingt minutes.
Dorian le regarda et sourit.
– Quelle tenue de voyage pour un peintre élégant ! Une valise gladstone et un ulster ! Entrez, car le brouillard va envahir le vestibule. Et songez qu’il ne faut pas parler de choses sérieuses. Il n’y a plus rien de sérieux aujourd’hui, au moins rien ne peut plus l’être.
Hallward secoua la tête en entrant et suivit Dorian dans la bibliothèque. Un clair feu de bois brillait dans la grande cheminée. Les lampes étaient allumées et une cave à liqueurs hollandaise en argent tout ouverte, des siphons de soda et de grands verres de cristal taillé étaient disposés sur une petite table de marqueterie.
– Vous voyez que votre domestique m’avait installé comme chez moi, Dorian. Il m’a donné tout ce qu’il me fallait, y compris vos meilleures cigarettes à bouts dorés. C’est un être très hospitalier, que j’aime mieux que ce Français que vous aviez. Qu’est-il donc devenu ce Français, à propos ?
Dorian haussa les épaules.
– Je crois qu’il a épousé la femme de chambre de lady Radley et l’a établie à Paris comme couturière anglaise. L’anglomanie est très à la mode là-bas, parait-il. C’est bien idiot de la part des Français, n’est-ce pas ? Mais, après tout, ce n’était pas un mauvais domestique. Il ne m’a jamais plu, mais je n’ai jamais eu à m’en plaindre. On imagine souvent des choses absurdes. Il m’était très dévoué et sembla très peiné quand il partit. Encore un brandy-and-soda ? Préférez-vous du vin du Rhin à l’eau de seltz ? J’en prends toujours. Il y en a certainement dans la chambre à côté.
– Merci, je ne veux plus rien, dit le peintre ôtant son chapeau et son manteau et les jetant sur la valise qu’il avait déposée dans un coin. Et maintenant, cher ami, je veux vous parler sérieusement. Ne vous renfrognez pas ainsi, vous me rendez la tâche plus difficile...
– Qu’y a-t-il donc ? cria Dorian avec sa vivacité ordinaire, en se jetant sur le sofa. J’espère qu’il ne s’agit pas de moi. Je suis fatigué de moi-même ce soir. Je voudrais être dans la peau d’un autre.
– C’est à propos de vous-même, répondit Hallward d’une voix grave et pénétrée, il faut que je vous le dise. Je vous tiendrai seulement une demi-heure.
Dorian soupira, alluma une cigarette et murmura :
– Une demi-heure !
– Ce n’est pas trop pour vous questionner, Dorian, et c’est absolument dans votre propre intérêt que je parle. Je pense qu’il est bon que vous sachiez les choses horribles que l’on dit dans Londres sur votre compte.
– Je ne désire pas les connaître. J’aime les scandales sur les autres, mais ceux qui me concernent ne m’intéressent point. Ils n’ont pas le mérite de la nouveauté.
– Ils doivent vous intéresser, Dorian. Tout gentleman est intéressé à son bon renom. Vous ne voulez pas qu’on parle de vous comme de quelqu’un de vil et de dégradé. Certes, vous avez
votre situation, votre fortune et le reste. Mais la position et la fortune ne sont pas tout. Vous pensez bien que je ne crois pas à ces rumeurs. Et puis, je ne puis y croire lorsque je vous vois. Le vice s’inscrit lui-même sur la figure d’un homme. Il ne peut être caché. On parle quelquefois de vices secrets ; il n’y a pas de vices secrets. Si un homme corrompu a un vice, il se montre de lui-même dans les lignes de sa bouche, l’abaissement de ses paupières, ou même dans la forme de ses mains. Quelqu’un – je ne dirai pas son nom, mais vous le connaissez – vint l’année dernière me demander de faire son portrait. Je ne l’avais jamais vu et je n’avais rien entendu dire encore sur lui ; j’en ai entendu parler depuis. Il m’offrit un prix extravagant, je refusai. Il y avait quelque chose dans le dessin de ses doigts que je haïssais. Je sais maintenant que j’avais parfaitement raison dans mes suppositions : sa vie est une horreur. Mais vous, Dorian, avec votre visage pur, éclatant, innocent, avec votre merveilleuse et inaltérée jeunesse, je ne puis rien croire contre vous.
Et cependant je vous vois très rarement ; vous ne venez plus jamais à mon atelier et quand je suis loin de vous, que j’entends ces hideux propos qu’on se murmure sur votre compte, je ne sais plus que dire. Comment se fait-il Dorian, qu’un homme comme le duc de Berwick quitte le salon du club dès que vous y entrez ? Pourquoi tant de personnes dans Londres ne veulent ni aller chez vous ni vous inviter chez elles ? Vous étiez un ami de lord Staveley. Je l’ai rencontré à dîner la semaine dernière. Votre nom fut prononcé au cours de la conversation à propos de ces miniatures que vous avez prêtées à l’exposition du Dudley. Staveley eût une moue dédaigneuse et dit que vous pouviez peut-être avoir beaucoup de goût artistique, mais que vous étiez un homme qu’on ne pouvait permettre à aucune jeune fille pure de connaître et qu’on ne pouvait mettre en présence d’aucune femme chaste. Je lui rappelais que j’étais un de vos amis et lui demandai ce qu’il voulait dire. Il me le dit. Il me le dit en face devant tout le monde. C’était horrible !
Pourquoi votre amitié est-elle si fatale aux jeunes gens ? Tenez... Ce pauvre garçon qui servait dans les Gardes et qui se suicida, vous étiez son grand ami. Et sir Henry Ashton qui dût quitter l’Angleterre avec un nom terni ; vous et lui étiez inséparables. Que dire d’Adrien Singleton et de sa triste fin ? Que dire du fils unique de lord Kent et de sa carrière compromise ? J’ai rencontré son père hier dans St-James Street. Il me parut brisé de honte et de chagrin. Que dire encore du jeune duc de Porth ? Quelle existence mène-t-il à présent ? Quel gentleman en voudrait pour ami ?
– Arrêtez, Basil, vous parlez de choses auxquelles vous ne connaissez rien, dit Dorian Gray se mordant les lèvres.
Et avec une nuance d’infini mépris dans la voix :
– Vous me demandez pourquoi Berwick quitte un endroit où j’arrive ? C’est parce que je connais toute sa vie et non parce qu’il connaît quelque chose de la mienne. Avec un sang comme celui qu’il a dans les veines, comment son récit pourrait-il être sincère ? Vous me questionnez sur Henry Ashton et sur le jeune Perth. Ai-je appris à l’un ses vices et à l’autre ses débauches ! Si le fils imbécile de Kent prend sa femme sur le trottoir, y suis-je pour quelque chose ? Si Adrien Singleton signe du nom de ses amis ses billets, suis-je son gardien ? Je sais comment on bavarde en Angleterre. Les bourgeois font au dessert un étalage de leurs préjugés moraux, et se communiquent tout bas, ce qu’ils appellent le libertinage de leurs supérieurs, afin de laisser croire qu’ils sont du beau monde et dans les meilleurs termes avec ceux qu’ils calomnient. Dans ce pays, il suffit qu’un homme ait de la distinction et un cerveau, pour que n’importe quelle mauvaise langue s’acharne après lui. Et quelles sortes d’existences mènent ces gens qui posent pour la moralité ? Mon cher ami, vous oubliez que nous sommes dans le pays natal de l’hypocrisie.
– Dorian, s’écria Hallward, là n’est pas la question. L’Angleterre est assez vilaine, je le sais, et la société anglaise a tous les torts. C’est justement pour cette raison que j’ai besoin de vous savoir pur. Et vous ne l’avez pas été. On a le droit de juger un homme d’après l’influence qu’il a sur ses amis : les vôtres semblent perdre tout sentiment d’honneur, de bonté, de pureté. Vous les avez remplis d’une folie de plaisir. Ils ont roulé dans des abîmes ; vous les y avez laissés. Oui, vous les y avez abandonnés et vous pouvez encore sourire, comme vous souriez en ce moment. Et il y a pire. Je sais que vous et Harry êtes inséparables ; et pour cette raison, sinon pour une autre, vous n’auriez pas dû faire du nom de sa sœur une risée.
– Prenez garde, Basil, vous allez trop loin !...
– Il faut que je parle et il faut que vous écoutiez ! Vous écouterez !... Lorsque vous rencontrâtes lady Gwendoline, aucun souffle de scandale ne l’avait effleurée. Y a-t-il aujourd’hui une seule femme respectable dans Londres qui voudrait se montrer en voiture avec elle dans le Parc ? Quoi, ses enfants eux-mêmes ne peuvent vivre avec elle ! Puis, il y a d’autres histoires : on raconte qu’on vous a vu à l’aube, vous glisser hors d’infâmes demeures et pénétrer furtivement, déguisé, dans les plus immondes repaires de Londres. Sont-elles vraies, peuvent-elles être vraies, ces histoires ?...
« Quand je les entendis la première fois, j’éclatai de rire. Je les entends maintenant et cela me fait frémir. Qu’est-ce que c’est que votre maison de campagne et la vie qu’on y mène ?...
Dorian, vous ne savez pas ce que l’on dit de vous. Je n’ai nul besoin de vous dire que je ne veux pas vous sermonner. Je me souviens d’Harry disant une fois, que tout homme qui s’improvisait prédicateur, commençait toujours par dire cela et s’empressait aussitôt de manquer à sa parole. Moi je veux vous sermonner. Je voudrais vous voir mener une existence qui vous ferait respecter du monde. Je voudrais que vous ayez un nom sans tache et une réputation pure. Je voudrais que vous vous débarrassiez de ces gens horribles dont vous faites votre société.
Ne haussez pas ainsi les épaules... Ne restez pas si indifférent... Votre influence est grande ; employez-là au bien, non au mal. On dit que vous corrompez tous ceux qui deviennent vos intimes et qu’il suffit que vous entriez dans une maison, pour que toutes les hontes vous y suivent. Je ne sais si c’est vrai ou non. Comment le saurais-je ? Mais on le dit. On m’a donné des détails dont il semble impossible de douter. Lord Gloucester était un de mes plus grands amis à Oxford. Il me montra une lettre que sa femme lui avait écrite, mourante et isolée dans sa villa de Menton. Votre nom était mêlé à la plus terrible confession que je lus jamais. Je lui dis que c’était absurde, que je vous connaissais à fond et que vous étiez incapable de pareilles choses. Vous connaître ! Je voudrais vous connaître ? Mais avant de répondre cela, il aurait fallu que je voie votre âme.
– Voir mon âme ! murmura Dorian Gray se dressant devant le sofa et pâlissant de terreur...
– Oui, répondit Hallward, gravement, avec une profonde émotion dans la voix, voir votre âme... Mais Dieu seul peut la voir !
Un rire d’amère raillerie tomba des lèvres du plus jeune des deux hommes.
– Vous la verrez vous-même ce soir ! cria-t-il, saisissant la lampe, venez, c’est l’œuvre propre de vos mains. Pourquoi ne la regarderiez-vous pas ? Vous pourrez le raconter ensuite à tout le monde, si cela vous plaît. Personne ne vous croira. Et si on vous croit, on ne m’en aimera que plus. Je connais notre époque mieux que vous, quoique vous en bavardiez si fastidieusement. Venez, vous dis-je ! Vous avez assez péroré sur la corruption. Maintenant, vous allez la voir face à face !...
Il y avait comme une folie d’orgueil dans chaque mot qu’il proférait. Il frappait le sol du pied selon son habituelle et puérile insolence. Il ressentit une effroyable joie à la pensée qu’un autre partagerait son secret et que l’homme qui avait peint le tableau, origine de sa honte, serait toute sa vie accablé du hideux souvenir de ce qu’il avait fait.
– Oui, continua-t-il, s’approchant de lui, et le regardant fixement dans ses yeux sévères. Je vais vous montrer mon âme ! Vous allez voir cette chose qu’il est donné à Dieu seul de voir, selon vous !
Hallward recula...
– Ceci est un blasphème, Dorian, s’écria-t-il. Il ne faut pas dire de telles choses ! Elles sont horribles et ne signifient rien...
– Vous croyez ?... Il rit de nouveau.
– J’en suis sûr. Quant à ce que je vous ai dit ce soir, c’est pour votre bien. Vous savez que j’ai toujours été pour vous un ami dévoué.
– Ne m’approchez pas !... Achevez ce que vous avez à dire...
Une contraction douloureuse altéra les traits du peintre. Il s’arrêta un instant, et une ardente compassion l’envahit. Quel droit avait-il, après tout, de s’immiscer dans la vie de Dorian Gray ? S’il avait fait la dixième partie de ce qu’on disait de lui, comme il avait dû souffrir !... Alors il se redressa, marcha vers la cheminée, et se plaçant devant le feu, considéra les bûches embrasées aux cendres blanches comme givre et la palpitation des flammes.
– J’attends, Basil, dit le jeune homme d’une voix dure et haute.
Il se retourna..."

"The Importance of being Earnest" (1895)
“I hope you have not been leading a double life, pretending to be wicked and being really good all the time. That would be hypocrisy.” (J'espère que vous n'avez pas mené une double vie, en prétendant être méchant et en étant vraiment bon tout le temps. Ce serait de l'hypocrisie) - Cecily to Algernon - Oscar Wilde, sans doute un esprit qui dépasse infiniment la stature de chacune de ses œuvres. "Earnest", une pièce pétillante qui ne demande rien d'autre qu'une suspension de notre logique rationnelle, car l'intrigue accumule absurdité sur absurdité tandis que les personnages échangent noms et identités avec des figures imaginaires hors scène, mêlant farce, parodie et comédie de mœurs dans une attaque vigoureuse contre toutes les postures qui soutiennent les conventions sociales. Sous-titrée à l'origine "A Trivial Comedy for Serious People", la pièce a été jouée le jour de la Saint-Valentin, en 1895, trois mois seulement avant l'arrestation fatidique de Wilde pour homosexualité. Le procès qui s'ensuivit conduisit Wilde à l'emprisonnement avec travaux forcés, à la faillite, à l'exil et à la fin de sa carrière. "The Importance of Being Earnest" est la dernière comédie qu'il a écrite. Elle lui aura valu une place de premier plan dans l'histoire du théâtre humoristique anglais (aux côtés de Congreve et de Sheridan) : les critiques furent unanimes à déclarer que jamais encore l'Angleterre n'avait autant ri.
ACT ONE - SCENE
Morning-room in Algernon’s flat in Half-Moon Street. The room is luxuriously and artistically furnished. The sound of a piano is heard in the adjoining room.
[Lane is arranging afternoon tea on the table, and after the music has ceased, Algernon enters.]
Algernon. Did you hear what I was playing, Lane?
Lane. I didn’t think it polite to listen, sir.
Algernon. I’m sorry for that, for your sake. I don’t play accurately — any one can play accurately — but I play with wonderful expression. As far as the piano is concerned, sentiment is my forte. I keep science for Life.
Lane. Yes, sir.
Algernon. And, speaking of the science of Life, have you got the cucumber sandwiches cut for Lady Bracknell?
Lane. Yes, sir. [Hands them on a salver.]
Algernon. [Inspects them, takes two, and sits down on the sofa.] Oh! . . . by the way, Lane, I see from your book that on Thursday night, when Lord Shoreman and Mr. Worthing were dining with me, eight bottles of champagne are entered as having been consumed.
Lane. Yes, sir; eight bottles and a pint.
Algernon. Why is it that at a bachelor’s establishment the servants invariably drink the champagne? I ask merely for information.
Lane. I attribute it to the superior quality of the wine, sir. I have often observed that in married households the champagne is rarely of a first-rate brand.
Algernon. Good heavens! Is marriage so demoralising as that?
Lane. I believe it is a very pleasant state, sir. I have had very little experience of it myself up to the present. I have only been married once. That was in consequence of a misunderstanding between myself and a young person.
Algernon. [Languidly.] I don’t know that I am much interested in your family life, Lane.
Lane. No, sir; it is not a very interesting subject. I never think of it myself.
Algernon. Very natural, I am sure. That will do, Lane, thank you.
Lane. Thank you, sir. [Lane goes out.]
Algernon. Lane’s views on marriage seem somewhat lax. Really, if the lower orders don’t set us a good example, what on earth is the use of them? They seem, as a class, to have absolutely no sense of moral responsibility.
[Enter Lane.]
Lane. Mr. Ernest Worthing.
Le titre est fondé sur un jeu de mots intraduisible - ("earnest", sérieux, et "Ernest", se prononçant en anglais de la même manière : Ernest est en effet le nom que John Worthing est obligé de prendre pour gagner l'amour de Gwendolen Fairfax. D'autre part, son ami Algernon Moncrieff, amoureux de Cécile Cardew, la charmante pupille de John, se fait
passer pour un frère débauche que John a inventé au cours de ses imbroglios amoureux, mais qui n`existe pas. Lorsque John est obligé de déclarer qu'il n'a jamais eu de frère et qu'il ne peut plus feindre de s'appeler Ernest, les choses semblent se précipiter pour les deux amis: mais, à la suite du tour imprévu que prennent les évènements, on découvre qu`Algernon et John sont en réalité frères et que le vrai nom de baptême de John est bien Ernest. La comédie se termine sur l'étonnement des deux hommes qui s`aperçoivent qu`ils n'ont pas dit la vérité. alors que c'était l'unique fois dans leur vie qu'ils croyaient faire un aveu sincère; elle prend fin sur une note joyeuse, le triple mariage d`Algernon et de Cécile, de Gwendolen et de John. de miss Prism (la gouvernante de Cécile) et du révérend Chasuble. Ce n'est pas tant l'intrigue que l'humour intraduisible du dialogue et le jeu des mots et des actions qui font le charme de cette comédie. Wilde s'y montre non seulement libre de toute préoccupation en ce qui concerne son public, mais débarrassé des préciosités "décadentes" que l'on trouve parfois dans ses œuvres de jeunesse. Une gaieté claire, spontanée, jaillit des situations qui se suivent. rapides et changeantes.
C`est le dernier chapitre heureux de la vie de Wilde, un jeu au cours duquel son esprit s'épanouit dans un feu d`artifice de gaieté, de malice, d'humour lucide, à la veille de la catastrophe qui déjà le guette dans l'ombre...
En 1895, le père de son amant, le Marquis de Queensberry accuse Wilde de sodomie, celui-ci le poursuit en diffamation, mais l'affaire se retourne contre lui et Oscar Wilde est condamné le 25 mai à la peine maximale, deux ans de travaux forcés, pour délit d’homosexualité. Il purgera cette peine notamment à la prison de Reading, au sud de l’Angleterre.
En 1896, la première de "Salomé", mélodrame symboliste écrite en 1891 et dont la correction française fut assurée par Pierre Louÿs, est donné à Paris, avec Sarah Bernhardt dans le rôle principal.
En 1897, il y écrit "De Profundis" ("minuit toujours au fond du cœur, et le crépuscule dans le cachot"), sa fameuse "Lettre à Lord Alfred Douglas" dans laquelle il évoque l’affaire, les conditions de sa détention et dresse le bilan de sa relation avec Douglas : au fond, rien ne saura empêcher que s'accomplisse la prémonition de Dorian Gray, emportant avec lui les stigmates de ses tentations ..

À sa libération, le 19 mai, Wilde, ruiné, s’exile en France, prend le nom de Sebastian Melmoth, souvenir du héros de "Melmoth the Wanderer", roman gothique écrit en 1820 par un oncle de sa mère, tandis que sa femme s’est expatriée en Allemagne avec ses fils qui ont changé de nom. Il renoue un temps avec "Childe Alfred" ("je ne peux vivre sans l'atmosphère de l'amour ; je dois aimer et être aimé, quel que soit le prix que je paye […] Quand les gens me critiquent de revenir à Bosie, dites-leur qu'il m'a offert l'amour – et que dans ma solitude et ma disgrâce je me suis, après trois mois de lutte contre un hideux monde philistin, tourné vers lui", lettre à R. Ross, 21 septembre 1897). Mais il regagne Paris, y vit misérablement pendant trois ans malgré l’aide de ses amis, notamment d'André Gide, et meurt d’une méningite, vraisemblablement consécutive à sa syphilis chronique, dans sa chambre de l’hôtel d’Alsace, 13 rue des Beaux-Arts à Paris, le 30 novembre 1900...

De Profundis (1897)
De Profundis est une longue lettre qu'Oscar Wilde a écrite à son jeune amant, Lord Alfred Douglas, depuis la prison de Reading, et c'est sans doute dans son écriture qu'il trouve les ressources qui vont lui permettre de ne pas sombrer. Si le propos de Wilde est bien connu, "J'ai mis mon génie dans ma vie et mon talent dans mes œuvres", peut-être ne se rend pas assez compte à quel point il fut rongé intellectuellement et affectivement par un jeune homme égocentrique et violent, qui l'entraîna dans tous ses excès et parvint à le convaincre, aveuglé par la haine qu'il éprouvait à l'égard de son père, à l'attaquer en justice, ce qui provoqua sa perte.
"For us there is only one season, the season of sorrow. The very sun and moon seem taken from us. Outside, the day may be blue and gold, but
the light that creeps down through the thickly-muffled glass of the small iron-barred window beneath which one sits is grey and niggard. It is always twilight in one's cell, as it is always
twilight in one's heart.
And in the sphere of thought, no less than in the sphere of time, motion is no more. The thing that you personally have long ago forgotten, or can easily forget, is happening to me now, and
will happen to me again to-morrow. Remember this, and you will be able to understand a little of why I am writing, and in this manner writing. . . . "
"... Je commencerai par te dire que je me blâme terriblement. Dans cette sombre cellule, en tenue de forçat, déshonoré et ruiné, je me blâme. Durant ces nuits d’angoisse troublées et agitées, durant ces monotones et longues journées de souffrance, je me blâme. Je me blâme d’avoir laissé une amitié sans affinité intellectuelle, une amitié dont le but essentiel n’était pas la création et la contemplation des belles choses dominer entièrement ma vie. Dés le début, il y avait entre nous un trop grand fossé. Tu avais été paresseux à l’école et pis que paresseux à l’université. Tu n’as pas compris qu’un artiste, et particulièrement l’artiste que je suis, c’est-à-dire celui chez qui la qualité de l’œuvre dépend de l’intensification de la personnalité, exige, pour le développement de son art, une communauté d’idées, une atmosphère intellectuelle, le calme, la paix et la solitude. Tu admirais mon œuvre lorsqu’elle était achevée, tu prenais plaisir aux brillants succès de mes premières et aux brillants banquets qui les suivaient. Tu étais fier, et tout naturellement, d’être l’ami intime d’un artiste aussi distingué, mais tu ne pouvais comprendre les conditions requises pour la production d’un travail artistique. Je n’use pas de phrases d’une exagération rhétorique, mais de termes d’une vérité absolue : si je te rappelle que, pendant tout le temps que nous avons été ensemble, je n’ai jamais pu écrire une seule ligne, n’est-ce pas un fait positif ? […]
Je ne parle pas à présent des effroyables résultats de mon amitié avec toi. Je pense simplement à sa qualité pendant le temps qu’elle a duré.
Intellectuellement, elle était pour moi dégradante. Tu possédais les éléments d’un tempérament artistique en germe. Mais je t’ai rencontré ou trop tard ou trop tôt, je ne sais lequel des deux.
Quand tu étais absent, je me sentais parfaitement bien. Je n’ai jamais pu retrouver les dispositions d’esprit qui les avaient inspirées. Maintenant que tu as publié toi-même un volume de vers, tu
seras à même de reconnaître la vérité de mes paroles. Mais, que tu le puisses ou non, elle demeurera une hideuse vérité au cœur même de notre amitié. Ta présence auprès de moi a été la ruine
absolue de mon art, et je m’attribue entièrement et la honte et le blâme de t’avoir laissé t’immiscer continuellement entre mon art et moi. Tu ne pouvais savoir, tu ne pouvais comprendre, tu ne
pouvais apprécier. Je n’avais aucun droit de l’escompter de ta part. Ton intérêt se bornait à tes repas et à tes caprices. Tes désirs se réduisaient à des amusements, à des plaisirs ordinaires ou
moins qu’ordinaires. Ils étaient ce dont ton tempérament avait besoin, ou croyait avoir besoin selon les impulsions du moment. J’aurais dû t’interdire ma maison et mes appartements, à moins de
t’y avoir formellement invité. Je me blâme sans réserve de ma faiblesse. Ce n’était là que faiblesse. Une demi-heure avec l’Art a toujours été pour moi plus qu’une éternité avec toi. A aucune
période de ma vie rien n’a jamais eu pour moi la moindre importance comparé à l’Art. Mais, pour un artiste, la faiblesse n’est rien moins qu’un crime quand c’est une faiblesse qui paralyse
l’imagination. Je me blâme de t’avoir laissé me conduire à la ruine financière complète et dégradante. […]
Dans notre cas, il me fallait ou m’abandonner à toi ou t’abandonner. Il n’y avait pas d’autre choix. A cause de mon affection pour toi, profonde, bien
que mal placée, à cause de ma grande pitié pour tes défauts de caractère, à cause de mon indulgence proverbiale et de mon indolence celtique, à cause d’une aversion artistique pour les scènes et
les mots grossiers, à cause de cette incapacité qui me caractérisait alors d’éprouver la moindre rancune, à cause de ma répugnance à voir la vie rendue amère et ingrate par ce qui, avec mes yeux
fixés sur d’autres choses, me paraissait de pures bagatelles trop futiles pour mériter plus qu’une pensée ou un intérêt d’un moment, pour toutes ces raisons, si simples qu’elles puissent sembler,
je te cédais toujours. Il en résulta naturellement que tes exigences, tes tentatives de domination, tes exactions devinrent de plus en plus déraisonnables. Tes mobiles les plus mesquins, tes
appétits les plus bas, tes passions les plus vulgaires devenaient pour toi des lois sur lesquelles les autres devaient toujours guider leur vie et auxquelles, si c’était nécessaire, ils devaient
être sacrifiés sans scrupule. Sachant qu’en faisant une scène tu arrivais toujours à tes fins, il était tout naturel que tu en vinsses, presque inconsciemment, j’en suis sûr, à tous les excès
d’une violence vulgaire. A la fin, tu ne savais vers quel but tu te hâtais ni quel objet tu avais en vue. Ayant tiré tout ce que tu pouvais de mon génie, de ma volonté et de ma fortune, tu
exigeais, dans l’aveuglement d’une intarissable avidité, mon existence entière. Tu l’as prise. Au moment suprêmement et tragiquement critique de toute ma vie, juste avant ma lamentable décision
d’intenter cette action absurde, ton père m’attaquait d’un côté par d’odieuses cartes déposées à mon club et tu m’attaquais de l’autre côté par des lettres non moins répugnantes. Celle que j’ai
reçue de toi le matin du jour où je t’ai laissé m’emmener au commissariat pour demander contre ton père ce ridicule mandat d’arrêt est l’une des pires que tu aies jamais écrites, et pour la plus
indigne raison. Entre vous deux, j’avais perdu la tête. Mon jugement me fit défaut. La terreur prit sa place. Je ne vis, je puis le dire franchement, aucun moyen d’échapper ni à l’un ni à
l’autre. Je titubai aveuglément, comme un bœuf à l’abattoir. Je commis une gigantesque erreur psychologique. J’avais toujours cru que te céder dans les petites choses était sans importance, que
lorsqu’un grand moment viendrait, je pourrais réaffirmer ma volonté dans sa supériorité naturelle. Il n’en fut pas ainsi. Au grand moment, ma volonté me fit complètement défaut. Dans la vie, il
n’y a vraiment ni grande ni petite chose. Toutes choses sont d’égale valeur et d’égale dimension. Mon habitude de toujours te céder, due, au début surtout, à l’indifférence, avait fini peu à peu
par faire partie intégrante de ma nature. […] Je t’avais laissé saper ma force de caractère et, pour moi, la formation d’une habitude avait abouti non seulement à un échec, mais tout simplement à
la ruine. Moralement, tu as été pour moi plus destructif encore qu’artistiquement..."

The Ballad of Reading Gaol (1898)
Lorsqu'il sort de prison en mai 1897, Oscar Wilde est un homme brisé. Il a perdu sa prolixité d’antan et n'écrit désormais qu'avec peine. Avant de mourir, il trouve néanmoins la force d'écrire la "Ballade de la geôle de Reading", long poème funèbre, où il se replace lui-même parmi les condamnés et les déchus de la Terre.
"... There is no chapel on the day
On which they hang a man:
The Chaplain's heart is far too sick,
Or his face is far to wan,
Or there is that written in his eyes
Which none should look upon.
So they kept us close till nigh on noon,
And then they rang the bell,
And the Warders with their jingling keys
Opened each listening cell,
And down the iron stair we tramped,
Each from his separate Hell.
Out into God's sweet air we went,
But not in wonted way,
For this man's face was white with fear,
And that man's face was grey,
And I never saw sad men who looked
So wistfully at the day.
I never saw sad men who looked
With such a wistful eye
Upon that little tent of blue
We prisoners called the sky,
And at every careless cloud that passed
In happy freedom by.
But their were those amongst us all
Who walked with downcast head,
And knew that, had each go his due,
They should have died instead:
He had but killed a thing that lived
Whilst they had killed the dead.
For he who sins a second time
Wakes a dead soul to pain,
And draws it from its spotted shroud,
And makes it bleed again,
And makes it bleed great gouts of blood
And makes it bleed in vain! ..."
"... Pas d’office dans la chapelle
Le jour où un homme est pendu.
L’aumônier a le coeur trop faible
Ou le visage trop tendu,
Ou ce qui s’écrit dans ses yeux
Par aucun ne doit être lu.
On nous boucle jusqu’à midi,
Puis on sonne la cloche vive.
Des gardiens la clef sonore ouvre
Les cellules trop attentives.
Pour prendre l’escalier de fer
De son Enfer chacun s’esquive.
Dans l’air pur de Dieu nous sortons,
Mais pas comme à l’accoutumée,
Car un visage est blanc de peur,
Gris l’autre visage levé,
Mais dans des yeux ouverts au jour
Jamais ne vis tant de regret.
Tant de regret jamais ne vis
Dans les yeux des hommes, levés
Vers la petite tente bleue
Qu’est le ciel pour les prisonniers,
Vers chaque nuage qui passe
Dans une heureuse liberté.
Parmi nous, il y avait ceux
Qui avançaient tête baissée.
Ils savaient qu’une vraie justice
Aurait dû les exécuter.
Il n’avait tué qu’un vivant.
Eux, c’est le mort qu’ils avaient tué.
Car celui qui pèche deux fois
Livre une âme morte aux tourments,
L’extrait de son linceul taché,
Fait à nouveau couler son sang,
Fait couler d’énormes caillots,
Et la fait saigner vainement ! ..."
