- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

The "Age of Sensibility" (1745–1785) - Samuel Richardson (1689–1761), "Paméla ou la Vertu récompensée" (1740) - Henry Fielding (1707–1754), "The History of Tom Jones" (1749) - Joseph Highmore (1692-1780) - William Hogarth (1697-1764) - Francis Hayman (1708-1776), - ..
Last update 10/10/2021

L'Angleterre, en pleine évolution démocratique de son royaume, voit le règne de George II, 1727-1760, et instruire une période charnière de son histoire : la mise en place de la monarchie constitutionnelle....
Début des années 1740, Robert Walpole cède le pouvoir tandis que l'ère du pacifisme whig s'achève. Robert Walpole (1676-1745) avait jusque-là dominé la vie politique anglaise, de 1721 à 1742, à une époque où la jeune dynastie de Hanovre craignait le jacobitisme et se méfier des tories. Il était alors un chef de parti et de gouvernement usant sans scrupules de toutes les formes de la corruption pour la plus grande prospérité du royaume et à une époque où les souverains se désintéressaient le plus souvent des affaires anglaises (George II sera roi de 1727 à 1760).
En mai 1744, la guerre éclate entre la France et l'Angleterre et le mois suivant, le prétendant Charles-Édouard, petit-fils de Jacques II, débarque en Écosse. Il faut attendre la défait à Culloden, 1er 16 avril 1746, du prétendant Stuart, et et la paix d'Aix-la-Chapelle (1748) qui met temporairement fin à la guerre franco-anglaise, pour que l'Angleterre souffle quelque peu. Mais pour très peu de temps : en mai 1756, la guerre éclate à nouveau, avec le début de la guerre de Sept ans (qui se termine en 1763 par le traité de Paris aux termes duquel Louis XV renonce à la plus grande partie de l'empirer colonial français), l'Angleterre essuie toute une série de revers en Europe, aux Indes et en Amérique. C'est alors que, malgré l'antipathie du roi, le bouillant William Pitt va se hisser au gouvernement avec l'appui de l'opinion publique (1757), concentrer entre ses mains tous les pouvoirs et renverser la situation (il démissionnera en 1761 et sera rappelé au pouvoir de 1766 à 1768). Sous son impulsion despotique, le général James Wolfe enlève Québec, le général Robert Clive s'empare des Indes, la victoire anglaise de Plassey (Calcutta) sur le nabab du Bengale débute la conquête du sous-continent indien (juin 1757), la Prusse triomphe à Rossbach, la flotte française est vaincue, Belle-Île occupée. L'Angleterre, sauvée, renforce son hégémonie maritime et coloniale. La popularité de Pitt rejaillit sur le monarque, qui meurt entouré du respect et de l'affection de son peuple, en 1760...
Francis Hayman (1708-1776), "Samuel Richardson, the Novelist, Seated, Surrounded by his Second Family" (1740-1741, Tate), illustrateur de "Pamela" (Richardson), de "Lost Paradise" (Milton), de la traduction de Don Quichotte par Tobias Smollett et d'autres œuvres célèbres...
- "The Age of Sensibility" (1745–1785), en Angleterre - Contrepartie de l'Empfindsamkeit qui devient, en Allemagne, en 1740-1790, un mouvement esthétique avec Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769), Johann Timotheus Hermes (1738-1821) et Sophie de La Roche (1730-1807), débute et s'impose en Angleterre une nouvelle époque littéraire, "the Age of Sensibility", qui couvre les règnes de George II (1727-1760) et une part du règne de George III (1760-1820), jusqu'au Traité de Paris, par lequel la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance de ses treize colonies d'Amérique du Nord....
En 1739-1740, David Hume publie son "Treatrise of Human Nature". En 1740, la littérature franchit une nouvelle étape, une extraordinaire décennie pour le roman anglais qui exprime toutes les frustrations d'une élite sociale, sans pouvoir, à travers ses querelles d'auteurs, emportées tour à tour par les forces sociales et les exigences profondes tant sentimentales que morales et religieuses que traversent les nouvelles individualités qui se forgent alors, avec Samuel Richardson, "Pamela, or Virtue Rewarded" (1740), Henry Fielding, "The History of Tom Jones, a Foundling" (1749), Laurence Sterne, "Tristram Shandy" (1759 -1767), Tobias Smollett (1721–1771), "The Adventures of Peregrine Pickle" (1751), Eliza Haywood (The Anti-Pamela, 1741). Et les poètes William Cowper (1731-1800) et Thomas Percy (1729-1811). Les "Pensées nocturnes" (Night Thoughts , 1742) d' Edward Young (1683-1765) inaugurent la poésie sépulcrale, ainsi que la fameuse "Élégie écrite dans un cimetière de campagne" ( Elegy Written in a Country Churchyard , 1750), de Thomas Gray (1716-1771).
L'âge de la sensibilité (parfois appelé l'âge de Johnson) est aussi l'époque d'Edmund Burke (1729-1797), dont la gloire atteindre son zénith avec les "Réflexions sur la Révolution française", parues dès novembre 1790, Edward Gibbon (1737-1794), l'auteur de "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire", Hester Lynch Thrale (1741-1821), James Boswell (1740-1795) et Samuel Johnson (1709-1784) qui, sans avoir écrit des oeuvres d'importances, domine son siècle de sa réputation et de son autorité...
Mais alors que Defoe plaçait ses romans dans des cadres exotiques, Richardson et Fielding adoptent un regard plus introverti et décrivirent des problèmes intérieurs, personnels, plus privés, mais avec une nuance décisive : Samuel Richardson souhaitait que ses romans soient lus comme des manuels de moralité, Fielding souhaite rendre compte de la vie avec plus de précision, et ce désir impose par définition la conception de personnages imparfaits, ce qui ne signifie pas non dénués de moralité...
"Pamela" (Pamela ou la vertu récompensée 1740), "Clarissa" (Clarissa, 1747-1748) et "Sir Charles Grandison" (Sir Charles Grandison, 1753-1754), les romans épistolaires de Samuel Richardson, reflètent ce retour à la sphère intime dans leurs descriptions des individus confrontés à des défis personnels au sein de la société britannique. Les personnages de Richardson sont obnubilés par l'amour et les idylles, ce qui fit de "Pamela" la quintessence du roman sentimental. Certains contemporains de Richardson désapprouvent son sentimentalisme, un Henry Fielding, par exemple, publie un roman parodique et critique de Pamela, "Shamela" (1741), dans lequel il objecte le fait que l'héroïne de Pamela repousse les avances de son maître pour finalement mieux l'épouser à la fin du roman. Vu d'aujourd'hui, nous considérerions néanmoins Richardson comme l'écrivain le plus moderne, en raison de son approche de la complexité psychologique - Paméla, par exemple, se livre sur des centaines de pages à un examen minutieux d'elle-même avant que sa "vertu" ne soit "récompensée". En outre, les explorations perpétuelles de la forme du roman par Richardson sont mises en évidence par la transition de "Paméla", que l'on peut qualifier de "comédie", à "Clarissa", une tragédie plus complexe...

Samuel Richardson (1689–1761)
Samuel Richardson naquit dans une famille nombreuse et peu aisée dans le Derbyshire, une région du centre de l'Angleterre, puis celle-ci vint s'installer dans l'est de Londres en 1700. Il y reçut une brève éducation dans une école secondaire, pieux et studieux, voulait être ecclésiastique ; son père, simple charpentier d'intérieur, ne pouvant financer ses études, décida d'être imprimeur en espérant, comme il le dira plus tard à son traducteur néerlandais, que "cela assouvirait ma soif de lecture". Il commence son apprentissage en 1706 et le poursuit pendant sept ans tout en devenant sans doute l'un des grands autodidactes de la littérature anglaise. Il lisait en effet beaucoup, mais peu de classiques, d'où son écriture aux tournures familières, maniant plus la spontanéité que l'ingéniosité, la sincérité plus que l'ironie. Il s'établit à son compte en 1719 et en 1721, il épouse la fille de son maître, Martha Wilde, mais des six enfants aucun ne dépassera l'âge de trois ans. Peu après la mort de Martha, en 1731, Richardson épouse Elizabeth Leake, qui lui donnera six autres enfants, dont quatre survivront jusqu'à l'âge adulte.
La qualité de son travail et ses relations d'amitié dans les milieux littéraire et parlementaire font de lui un bourgeois prospère, un puritain industrieux, dont l'activité d'écrivain est d'abord orientée vers des fins pragmatiques : à la demande d'amis, il rédige en 1739 un recueil de lettres-modèles à l'usage de toutes les circonstances de la vie, "Letters Written to and for Particular Friends, on the Most Important Occasions".
De là va naître l'idée de "Paméla ou la Vertu récompensée" (1740), roman épistolaire qui connaît aussitôt un succès énorme dans l'Europe entière, grâce à son réalisme social qui donnera naissance au roman de mœurs bourgeois et à l'expression des mouvements complexes de l'âme et du sentiment. Livrée innocente au fils libertin de sa maîtresse qui vient de mourir, une servante défend et fait valoir sa vertu : elle finira par épouser le comte de Belfart.
Exploitant la même veine, "Clarisse Harlowe" (7 vol., 1747-1748) exalte la vertu de la jeune fille avec un érotisme discret : Clarisse, éprise de l'ignoble Lovelace, est quasiment droguée et violée. L' "Histoire de sir Charles Grandison" (7 vol., 1753-1754) offre un portrait du gentleman idéal.
Si Paméla suscita en Angleterre les parodies de Fielding, notamment à cause de sa morale ambiguë et de la technique selon laquelle les personnages sont censés décrire les événements «en direct» dans leurs lettres, l'œuvre de Richardson fut au contraire l'objet d'un véritable culte sur le continent. En 1742, l'abbé Prévost traduisait Paméla ; en 1761, Diderot écrivait un dithyrambique Éloge de Richardson ; Sade en dit le plus grand bien dans Idée sur les romans ; et Crébillon fils avouait à lord Chesterfield que, sans Paméla, on ne saurait, en France, que dire et que faire. Le roman anglais n'accepta l'oeuvre que plus tard et l'on reconnut que Richardson était un peintre délicat et minutieux des moeurs, des événements et des passions de la classe moyenne, et reproduisait admirablement l'esprit de puritanisme mitigé qui dominait alors en Angleterre. Certes, ce n'était plus le fier et rude fanatisme des Pym et des Harrisson, mais une atmosphère de pruderie grave, reflet de toute une bourgeoisie moitié commerçante, moitié dévote, qui s'est évertuée à enfermer, pendant cent cinquante années, la masse active et triomphante de la société anglaise.
La célébrité ne modifiera pas le mode de vie de Richardson comme on aurait pu s'y attendre, il poursuivit son activité d'imprimeur et ses passe-temps habituels, comme l'écriture de lettres. La seule évolution notable fut les relations qu'il cultiva avec des membres de l'aristocratie, - ce contact avec la noblesse pouvait répondre à un besoin social de toute une vie. Vers la fin de sa vie, et pendant quelques décennies après sa mort, Richardson jouissait d'un prestige international sans équivalent chez les écrivains anglais contemporains. Dans les derniers temps de sa vie, il a souffert d'une maladie nerveuse qui pourrait être la maladie de Parkinson. Il est mort d'une attaque à l'âge de 71 ans.

Joseph Highmore (1692-1780), homme de lettres, fut peintre, on lui doit deux portraits de Samuel Richardson, en 1747 et 1750, et une série de 12 scènes consacrées à 'Pamela" (The Fitzwilliam Museum) vers 1744-1745, comparables aux Progresses de Hogarth du milieu des années 1730. Il travailla avec le graveur Hubert-François Gravelot (1699-1773) et fut célèbre pour son tableau "Mr. Oldham et ses amis' (v. 1740, Londres, Tate Gal.). Il sera souvent opposé par son style au satiriste William Hogarth (1697-1764)....
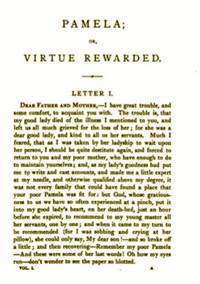
Samuel Richardson, "Pamela, or Virtue rewarded" (1740)
Premier ouvrage d'un écrivain de cinquante ans, Pamela a dû sa popularité principalement à la forme adoptée par l’auteur, qui est celle de lettres écrites par les personnages eux-mêmes, au plus fort de leurs passions et de leurs épreuves : avec un risque, celui d'être artificiel, invraisemblable ou trop long, mais un avantage, celui de placer le lecteur en rapport immédiat avec les personnages, dans leur intimité, leur permettant de connaître jusqu’à leurs les plus secrètes pensées. L’efficacité de la forme épistolaire, une innovation qui sera source de grande fierté pour Richardson, et qui dévoile l’intrigue au travers des lettres rédigées par la protagoniste, contribuera à rendre l’histoire acceptable à la bourgeoisie ascendante du XVIIIe siècle. Ajoutons à cela la nature édifiante de l’histoire. Mais les opposants au sentimentalisme exagéré de Pamela eurent beau jeu de dénoncer un moralisme qui n'est pas sans duplicité, l’ouvrage semble en fin de compte cautionner le parcours d'une jeune intrigante qui tente d’atteindre un statut social plus élevé en se faisant épouser par un noble. Henry Fielding en fit une parodie débridée, premier exercice de littérature qu'il se donna avant de produire deux chef d'oeuvre, "Joseph Andrews" et "Tom Jones"...

PAMELA, Letters I through X..
L`œuvre est considérée comme le premier roman de mœurs bourgeoises . Pamela Andrews est une humble et honnête jeune fille de 15 ans placée chez une noble dame qui, au moment de mourir, la confie à son fils, le squire B., âgé de 25 ou 26 ans. Ce dernier, qui n'est qu'un jeune libertin, la prenant par la main, lui promet d'être son ami et de l'employer à l'entretien de son linge. Il distribue ensuite des vêtements de deuil et un an de salaire à tous les domestiques ; à Pamela, qui n'a jamais reçu de salaire dans ce ménage, il accorde quatre guinées d'or et la menue monnaie de la poche de sa mère, quatre guinées que Pamela s'empresse d'envoyer à ses parents. Un post-scriptum à cette première lettre que Pamela destine à ses parents nous apprend que M. B. l'a surpris dans la loge de sa maîtresse, ce qui amène Pamela à dissimuler la lettre dans sa poitrine. M. B. a bien noté le geste et demande à en prendre connaissance, et, après l'avoir lue, fait l'éloge de son dévouement envers ses parents, complimente ses mains délicates et sa bonne orthographe, et lui offre l'usage de la bibliothèque de sa mère. Pamela est flattée et reconnaissante ; elle conclut à nouveau en vantant M. B. comme "le meilleur des gentlemen".
En réponse, John et Elizabeth Andrews à Pamela craignent désormais que la faveur de M. B., plaçant Pamela au-dessus de son rang, ne la conduise au vice ou à l'abandon de la chasteté, rien n'est plus dégradant qu'une femme entretenue. Son père l'encourage désormais à se méfier des marques de faveur qu'elle a reçues et lui dit que si M. B. tente quoi que ce soit avec elle, Pamela devrait partir et rentrer directement chez elle. Dans la Lettre III, Pamela exprime son inquiétude face aux soupçons de son père, que Pamela elle-même partage en partie. Elle affirme cependant avoir l'espoir raisonnable que M. B. ne la traitera jamais de façon déshonorante. Par-dessus tout, elle est indignée que ses parents semblent douter de son engagement envers la chasteté ; elle jure qu'elle "mourra de mille morts" plutôt que de commettre la moindre infraction sexuelle. Depuis la mort de la vieille dame, un nouvel univers se met en place autour de Pamela, mais il lui faut apprendre à décoder le sens caché des intentions du jeune libertin, ce qu'elle ne peut encore imaginer, si ce n'est à écouter la petite musique de la méfiance que ses parents tentent d'interpréter à distance.
Dans la lettre de IV de Pamela à sa mère, on apprend que Mme Jervis pense que Pamela est "trop jolie pour vivre dans une maison de bateleur", ce qui incite la fille de la vieille dame, Lady Davers, à suggérer que Pamela vienne vivre chez eux, ce que dit accepter M.B. Mais un projet dont on entend plus parler dans la lettre suivante alors que Pamela rassure ses parents. Dans les lettres suivantes, pourtant, M.B. poursuit sa stratégie, Lettre VI, M. B. offre à Pamela une garde-robe composée de vieux vêtements de sa mère. Mrs. Jervis est présente lors de la présentation des vêtements, afin que la vertu de Pamela ne soit pas mise en danger; Lettre VII, M. B. offre à Pamela d'autres cadeaux, dont des bas, avec une Mme Jervis qui est cette fois absente mais qui la rassurera sur les intentions du jeune maître : "Tout ce qui arrive est pour notre bien". Lettre IX, nous apprenons que le projet de voir Pamela rejoindre les Davers est abandonné, Pamela rapportant avec innocence l'embarras de Lady Davers vis-à-vis de son frère.
LETTER X
DEAR MOTHER,
You and my good father may wonder you have not had a letter from me in so many weeks; but a sad, sad scene, has been the occasion of it. For to be sure, now it is too plain, that all your cautions were well grounded. O my dear mother! I am miserable, truly miserable!--But yet, don't be frightened, I am honest!--God, of his goodness, keep me so!
O this angel of a master! this fine gentleman! this gracious benefactor to your poor Pamela! who was to take care of me at the prayer of his good dying mother; who was so apprehensive for me, lest I should be drawn in by Lord Davers's nephew, that he would not let me go to Lady Davers's: This very gentleman (yes, I must call him gentleman, though he has fallen from the merit of that title) has degraded himself to offer freedoms to his poor servant! He has now shewed himself in his true colours; and, to me, nothing appear so black, and so frightful. I have not been idle; but had writ from time to time, how he, by sly mean degrees, exposed his wicked views; but somebody stole my letter, and I know not what has become of it. It was a very long one. I fear, he that was mean enough to do bad things, in one respect, did not stick at this. But be it as it will, all the use he can make of it will be, that he may be ashamed of his part; I not of mine: for he will see I was resolved to be virtuous, and gloried in the honesty of my poor parents.
I will tell you all, the next opportunity; for I am watched very narrowly; and he says to Mrs. Jervis, This girl is always scribbling; I think she may be better employed. And yet I work all hours with my needle, upon his linen, and the fine linen of the family; and am, besides, about flowering him a waistcoat.--But, oh! my heart's broke almost; for what am I likely to have for my reward, but shame and disgrace, or else ill words, and hard treatment! I'll tell you all soon, and hope I shall find my long letter.
La Lettre X de Pamela à sa mère marque un premier degré dans la progression du climat moral de cette maisonnée. Conformément aux pressentiments de M. et Mme Andrews, M. B. s'est finalement "dégradé pour offrir des libertés à son pauvre serviteur", on ne sait encore de quoi il s'agit car la lettre a disparu, mais cela signifie au moins que M. B. peut voler des lettres. De plus Pamela a entendu M. B. dire à Mme Jervis : "Cette fille est toujours en train de gribouiller", l'écriture vient s'opposer aux intentions du jeune libertin. M. B. veut maintenant occuper Pamela à broder un gilet pour lui, afin qu'elle ait moins de temps pour écrire. Mais que s'est-il effectivement passé?
Dans cette première partie, Pamela tente de décrire ce qu'elle vit au fil des mises en garde de ses parents concernant sa vertu, elle enregistre des faits, l'écriture, les vêtements et l'intimité constitue son monde, mais on ne sait effectivement si elle ressent ce qu'elle restitue. La Lettre XI va changer insensiblement les perspectives....

PAMELA, Letters XI through XVIII
"Well may I forget that I am your servant, when you forget what belongs to a master..." - La Lettre XI de Pamela à sa mère décrit en détails la première agression de M. B. : celui-ci surprend Pamela dans la maison d'été et l'embrasse en lui disant qu'il fera d'elle une dame de compagnie si elle accepte de rester dans sa maison plutôt que de rejoindre celle de Lady Davers. Pamela manque de s'évanouir de terreur, et sa vulnérabilité permet à M. B. de lui infliger deux ou trois autres baisers. Elle le réprimande pour son comportement envers elle, lui nie toute intention lubrique, affirmant que ses avances n'avaient pour but que de tester sa vertu. Il lui propose de l'argent en échange de son secret, mais elle le refuse et quitte la maison d'été. La lettre se termine par une promesse de continuer l'histoire bientôt et une reconnaissance que Pamela n'a pas encore quitté la maison de M. B., malgré le fait qu'elle soit devenue un lieu "d'angoisse et de terreur".
Le récit se poursuit avec la Lettre XII, Pamela dit envisager de quitter la maison de M. B., mais les raisons qui s'y opposent sont pour le moins singulières, elle ne sait si et comment elle doit emporter les vêtements que M. B. lui a donnés, elle ne sait si elle doit se confier à Mme Jervis ou suivre l'ordre de M. B. de garder le secret dans l'espoir qu'il ne tentera plus jamais de commettre un acte aussi dépravé. Mme Jevis la conforte dans cette dernière opinion. Et la lettre se termine par le souhait de Pamela de ne pas avoir quitté la pauvreté de sa famille pour les dangers liés à l'exposition à la haute société.
"LETTER XI - DEAR MOTHER,
Well, I can't find my letter, and so I'll try to recollect it all, and be as brief as I can. All went well enough in the main for some time after my letter but one. At last, I saw some reason to suspect; for he would look upon me, whenever he saw me, in such a manner, as shewed not
well; and one day he came to me, as I was in the summer-house in the little garden, at work with my needle, and Mrs. Jervis was just gone from me; and I would have gone out, but he said, No don't go, Pamela; I have something to say to you; and you always fly me when I come near you, as if you were afraid of me.
I was much out of countenance, you may well think; but said, at last, It does not become your good servant to stay in your presence, sir, without your business required it; and I hope I shall always know my place. Well, says he, my business does require it sometimes; and I have a mind you should stay to hear what I have to say to you.
I stood still confounded, and began to tremble, and the more when he took me by the hand; for now no soul was near us.
My sister Davers, said he, (and seemed, I thought, to be as much at a loss for words as I,) would have had you live with her; but she would not do for you what I am resolved to do, if you continue faithful and obliging. What say'st thou, my girl? said he, with some eagerness;
had'st thou not rather stay with me, than go to my sister Davers? He looked so, as filled me with affrightment; I don't know how; wildly, I thought.
I said, when I could speak, Your honour will forgive me; but as you have no lady for me to wait upon, and my good lady has been now dead this twelvemonth, I had rather, if it would not displease you, wait upon Lady Davers, because - I was proceeding, and he said, a little hastily--Because you are a little fool, and know not what's good for yourself. I tell you I will
make a gentlewoman of you, if you be obliging, and don't stand in your own light; and so saying, he put his arm about me, and kissed me!
Now, you will say, all his wickedness appeared plainly. I struggled and trembled, and was so benumbed with terror, that I sunk down, not in a fit, and yet not myself; and I found myself in his arms, quite void of strength; and he kissed me two or three times, with frightful
eagerness. -- At last I burst from him, and was getting out of the summer-house; but he held me back, and shut the door.
I would have given my life for a farthing. And he said, I'll do you no harm, Pamela; don't be afraid of me. I said, I won't stay. You won't, hussy! said he: Do you know whom you speak to? I lost all fear, and all respect, and said, Yes, I do, sir, too well!--Well may I forget that I
am your servant, when you forget what belongs to a master.
I sobbed and cried most sadly. What a foolish hussy you are! said he: Have I done you any harm? Yes, sir, said I, the greatest harm in the world: You have taught me to forget myself and what belongs to me, and have lessened the distance that fortune has made between us, by demeaning yourself, to be so free to a poor servant. Yet, sir, I will be bold to say, I am honest, though poor: and if you was a prince, I would not be otherwise.
He was angry, and said, Who would have you otherwise, you foolish slut! Cease your blubbering. I own I have demeaned myself; but it was only to try you. If you can keep this matter secret, you'll give me the better opinion of your prudence; and here's something, said he, putting some gold in my hand, to make you amends for the fright I put you in. Go,
take a walk in the garden, and don't go in till your blubbering is over: and I charge you say nothing of what is past, and all shall be well, and I'll forgive you.
I won't take the money, indeed, sir, said I, poor as I am I won't take it. For, to say truth, I thought it looked like taking earnest, and so I put it upon the bench; and as he seemed vexed and confused at what he had done, I took the opportunity to open the door, and went out of the summer-house. He called to me, and said, Be secret; I charge you, Pamela; and don't go
in yet, as I told you.
O how poor and mean must those actions be, and how little must they make the best of gentlemen look, when they offer such things as are unworthy of themselves, and put it into the power of their inferiors to be greater than they!
I took a turn or two in the garden, but in sight of the house, for fear of the worst; and breathed upon my hand to dry my eyes, because I would not be too disobedient. My next shall tell you more.
Pray for me, my dear father and mother: and don't be angry I have not yet run away from this house, so late my comfort and delight, but now my terror and anguish. I am forced to break off hastily.
Your dutiful and honest DAUGHTER.
Lettre XIII : Son père et sa mère à Pamela.
M. et Mme Andrews exhortent Pamela à fuir la maison de M. B. au premier signe de poursuite de sa part. Ils méditent sur l'utilité des tentations dans la culture de la connaissance de soi et expriment leur confiance dans la capacité de Pamela, avec l'aide de son " éducation vertueuse ", à résister aux tentations de M. B. Dans l'ensemble, cependant, ils proposent que Pamela fasse mieux de rentrer chez elle. "My DEAREST CHILD, Our hearts bleed for your distress, and the temptations you are exposed to. You have our hourly prayers; and we would have you flee this evil great house and man, if you find he renews his attempts. You ought to have done it at first, had you not had Mrs. Jervis to advise with. We can find no fault in your conduct hitherto: But it makes our hearts ache for fear of the worst. O my child! temptations are sore things,--but yet, without them, we know not ourselves, nor what we are able to do...."
La Lettre XIV de Pamela à son père et à sa mère, nous révèle un M. B. sur la défensive qui accuse Pamela, devant Mrs. Jervis, d'avoir interprété d'innocentes marques de faveur, ajoutant, ainsi que retranscrit dans la Lettre XV, que trop d'indiscrétions déplacées sont rapportées dans ces fameuses lettres, ce qui signifie bien entendu pour Pamela qu'il en a lu certaines.
C'est en pleurs que Pamela se défend face à M. B. La réponse de celui-ci est sans équivoque, il l'invite à s'asseoir sur ses genoux, et malgré ses réticences, l'embrasse et la caresse, ce qui l'amène à se précipiter vers la porte et la pièce voisine. M. B. parvient à arracher un morceau de sa robe avant que Pamela ne puisse s'enfermer dans la pièce, où elle tombe en pâmoison. M. B. appelle Mme Jervis, l'aide à enfoncer la porte, enjoint la gouvernante à garder le secret et laisse les deux femmes seules. Tomber en pâmoison chaque fois que son maître l'approche avec des intentions lubriques devient un comportement fréquent de Pamela, un comportement qui a pour effet immédiat de diminuer la libido du Squire.
Première conclusion de nouvelle progression des tentatives de M. B : M. B. revient plus tard pour défendre sa conduite auprès de Mme Jervis, insistant sur son innocence. Il met en doute l'authenticité des évanouissements de Pamela et organise une rencontre le lendemain entre Mme Jervis, Pamela et lui-même. Après le départ de M. B., Pamela fait part à Mme Jervis de sa détermination à quitter la maison mais nuance cette résolution en disant qu'elle saura mieux quoi faire après la réunion du lendemain. On ne quitte pas un maître aussi aisément dans l'Angleterre du XVIIIe siècle sans que cela n'ait de conséquence sur son existence à venir...
Nous sommes donc en attente de cette fameuse réunion et la Lettre XVI de Pamela à ses parents nous apprend que tous les trois se livrent à une restitution de la scène de la veille, - Mme Jervis affirme que Pamela a dit que M. B. l'a attirée sur ses genoux et l'a embrassée. Pamela objecte que Mme Jervis n'a pas raconté le pire, puisqu'elle a passé sous silence le fait que Pamela s'attendait à ce que son maître, s'il pouvait prendre de telles libertés avec une servante, ait probablement eu d'autres intentions. M. B. réaffirme bien entendu son innocence, regrette que Pamela se soit fourvoyée dans son interprétation et qu'elle puisse se présenter dans ses lettres comme un modèle de vertu et lui, "son maître et bienfaiteur", comme un "diable incarné". Il déclare sa résolution de renvoyer Pamela à sa famille et à leur pauvreté.
C'est ainsi que Pamela transmet à ses parents son espoir de retourner chez eux et de subvenir à ses besoins en faisant des travaux d'aiguille, bien qu'un post-scriptum l'avertisse qu'une autre semaine pourrait s'écouler avant qu'elle puisse remplir ses responsabilités à l'égard du linge de M. B.. Cette discussion nous en apprend beaucoup sur Pamela, ca ce qui est en jeu n'est pas seulement le respect que quelque précepte moral, du calvinisme anglican du XVIIIe siècle, mais aussi de la relation du maître, de l'aristocratie foncière, au serviteur, il a le devoir de protéger Pamela, tout comme elle a le devoir de lui obéir. Rigidité morale ou fierté que l'on retrouve dans la fougueuse Elizabeth Bennet, personnage de Jane Austen, grande lectrice de Richardson, et l'une des nombreuses descendantes de Pamela dans la tradition du roman anglais.
Evidemment, dès la Lettre XVIII, ces projets de départ tournent court. Pamela annonce à ses parents que Mme Jervis prédit, à nouveau, que M. B. ne tentera plus d'abuser de la vertu de Pamela et suggère qu'elle pourrait rester à la maison si elle le demandait comme une faveur à M. B. La discussion s'engage entre les deux femmes, Pamela résiste toujours, il nous faut attendre la Lettre XIX pour y voir plus clair...


PAMELA, Letters XIX through XXIV
La Lettre XIX, de Pamela à son père et à sa mère, poursuit les discussions entre M.B. et Mme Jervis, celle-ci lui conseille à nouveau de s'humilier devant son maître et de demander à rester à son service. Mais Pamela ne cesse de revenir au comportement qu'elle juge inacceptable de M. B., ce qui conduit la gouvernante à étoffer la défense de son maître : suggérant qu'il est irrité contre lui-même d'être incapable de surmonter son amour pour Pamela, socialement inférieure. Le raisonnement que tient alors Pamela révèle bien des choses sur sa personnalité : elle imagine par exemple que si elle devenait la maîtresse de M. B., il l'abandonnerait dès qu'elle commencerait à montrer les mauvais effets de leur relation.
Les discussions se poursuivent sur la probabilité éventuelle d'une amélioration de la conduite de M. B. mais Mrs. Jervis pense que jamais il n'emploiera la force. Pamela, au terme de cet échange, est toujours prête à partir mais consent à rester pour terminer son travail de broderie sur le gilet de M. B., qu'elle considère comme le plus beau travail d'aiguille qu'elle ait jamais réalisé, et qu'elle fait des heures supplémentaires pour le terminer, afin de pouvoir rentrer chez elle au plus vite.
Tandis que Pamela déclare à ses parents se préparer à partir (Lettre XX), les discussions se poursuivent entre Mrs. Jervis et Pamela (Lettre XXI) : M. B. aurait dit à la sa gouvernante que s'il connaissait une dame de noble naissance, identique à Pamela "en personne et en esprit", il l'épouserait immédiatement. Pamela de répliquer que si elle était une dame de noble naissance, elle n'accepterait peut-être pas la proposition de M. B., étant donné son comportement antérieur à son égard. Mme Jervis trouve la rigidité de Pamela exaspérante. La conversation languit alors que les deux femmes se brident, puis se termine par leur réconciliation. La lettre se termine par l'espoir de Pamela d'avoir terminé le gilet de M. B., d'ici deux jours.
Lettre XXII, "I don’t want such idle Sluts to stay in my House", lance M. B. à Pamela qu'il rencontre dans un couloir et lui demande jusqu'à quand elle compte ainsi rester, parole dure alors que tous les autres domestiques semblent lui témoigner beaucoup de considération. La Lettre XIV nous décrit un dîner organisé par M. B. au cours duquel toutes les dames expriment le désir de voir Pamela, qui a acquis la réputation d'être "the greatest Beauty in the Country". M. B. minimise les attraits de Pamela et donne son avis sur le fait que la véritable distinction de Pamela réside dans son humilité et sa capacité à inspirer la loyauté parmi ses compagnons de service. Les dames ne se découragent pas pour autant et décident de rendre visite à Pamela. Celle-ci termine sa lettre en réfléchissant à l'affinité paradoxale de l'amour et de la haine et termine en indiquant son projet de surprendre Mme Jervis en apparaissant dans sa nouvelle tenue de campagne...
Lettre XXIII : Pamela à son père et sa mère.
M. B. reçoit les voisins à dîner. Les dames expriment le désir de voir Pamela, qui a acquis la réputation d'être " la plus grande beauté du pays ". M. B. minimise les attraits de Pamela et donne son avis sur le fait que la véritable distinction de Pamela réside dans son humilité et sa capacité à inspirer la loyauté parmi ses compagnons de service. Les dames ne se découragent pas pour autant et décident de rendre visite à Pamela.
Elles s'approchent bientôt de Pamela, légèrement irritée, qui supporte leur examen et garde pour elle ses réponses sarcastiques. Les dames s'en vont finalement, en chantant les louanges de Pamela et en supposant qu'elle doit avoir un milieu aisé.
Pamela, écrivant, exprime son espoir de pouvoir partir jeudi. Elle réfléchit à l'affinité paradoxale de l'amour et de la haine et termine en indiquant son projet malicieux de surprendre Mme Jervis en apparaissant dans sa nouvelle tenue de campagne. Le jeu se poursuit entre le maître et sa servante, Pamela réfléchit avec un certain regret au Maître qu'elle va bientôt quitter, M. B., tout en ayant aperçu Pamela et la reconnaissant profite du prétexte d'un bref anonymat pour lui faire des avances (Lettre XIV) et comme toujours les relations restent tendues et au bord de la rupture.

Lettre XX, un intermède d'intérêt : Je sais, écrit Pamela à ses parents, que vous gardez mes lettres et que vous les relisez sans cesse tant votre gentillesse vous fait aimer tout ce qui vient de votre pauvre fille, et comme cela pourrait me faire un petit de bonheur de les lire moi-même, quand je viendrai vous voir, pour me rappeler ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, et combien la bonté de Dieu a été grande pour moi : pour toutes ces raisons, j'écrirai au fur et à mesure que j'aurai le temps et que les choses se produiront, et selon les événements. Je vais donc commencer là où je me suis arrêtée, à propos de la conversation entre Mme Jervis et moi, c'est alors la question des vêtements qui devient la plus essentielle dans le dilemme qui se noue dans la pensée de Pamela..
Unknown to Mrs. Jervis, I put a project, as I may call it, in practice. I thought with myself some days ago, Here I shall go home to my poor father and mother, and have nothing on my back, that will be fit for my condition; for how should your poor daughter look with a silk night-gown, silken petticoats, cambric head-clothes, fine holland linen, laced shoes that were my lady's; and fine stockings! And how in a little while must these have looked, like old cast-offs, indeed, and I lookedso for wearing them! And people would have said, (for poor folks are envious as well as rich,) See there Goody Andrews's daughter, turned home from her fine place! What a tawdry figure she makes! And how well that garb becomes her poor parents' circumstances! -- And how would they look upon me, thought I to myself, when they should come to be threadbare and worn out? And how should I look, even if I could purchase homespun clothes, to dwindle into them one by one, as I got them? -- May be, an old silk gown, and a linsey-woolsey petticoat, and the like. So, thought I, I had better get myself at once equipped in the dress that will become my condition; and though it may look but poor to what I have been used to wear of late days, yet it will serve me, when I am with
you, for a good holiday and Sunday suit; and what, by a blessing on my industry, I may, perhaps, make shift to keep up to.
So, as I was saying, unknown to any body, I bought of farmer Nichols's wife and daughters a good sad-coloured stuff, of their own spinning, enough to make me a gown and two petticoats; and I made robings and facings of a pretty bit of printed calico I had by me...

PAMELA, Letters XXV through XXXI
La Lettre XXV de Pamela à ses parents comporte l'épisode si singulier du placard. Pamela et Mme Jervis sont dans la chambre de cette dernière discutent de part et d'autre du lit en se déshabillant pour la nuit, le sujet de conversation est tant l'attitude de la jeune femme rt de ses toilettes que celle de la gouvernante soupçonnée d'exposer Pamela aux avances sexuelles de M. B.. Mais voici que Pamela entend un bruit dans le placard et découvre M. B. qui se précipite sur elle, habillé pour la "conquérir dans une riche robe du matin en soie et argent". Elle se réfugie dans le lit, où M. B. la suit. Lorsque Mme Jervis prend la défense de Pamela, M. B. menace de jeter la gouvernante par la fenêtre et de la renvoyer de son emploi. Il caresse Pamela, qui tombe alors dans une série d'évanouissements qui durent les trois heures suivantes. M. B. laisse Mme Jervis et une autre domestique, Rachel, s'occuper d'elle...
"... Hush! said I, Mrs. Jervis, did you not hear something stir in the closet? No, silly girl, said she, your fears are always awake. -- But indeed, said I, I think I heard something rustle.--May be, says she, the cat may be got there: but I hear nothing. I was hush; but she said, Pr'ythee, my good girl, make haste to bed. See if the door be fast. So I did, and was thinking to look into the closet; but, hearing no more noise, thought it needless, and so went again and sat myself down on the bed-side, and went on undressing myself. And Mrs. Jervis being by this time undressed, stepped into bed, and bid me hasten, for she was sleepy.
I don't know what was the matter, but my heart sadly misgave me: Indeed, Mr. Jonathan's note was enough to make it do so, with what Mrs. Jervis had said. I pulled off my stays, and my stockings, and all my clothes to an under-petticoat; and then hearing a rustling again in the closet, I said, Heaven protect us! but before I say my prayers, I must look into this closet. And so was going to it slip-shod, when, O dreadful! out rushed my master in a rich silk and silver morning gown. I screamed, and ran to the bed, and Mrs. Jervis screamed too; and he said, I'll do you no harm, if you forbear this noise; but otherwise take what follows.
Instantly he came to the bed (for I had crept into it, to Mrs. Jervis, with my coat on, and my shoes); and taking me in his arms, said, Mrs. Jervis, rise, and just step up stairs to keep the maids from coming down at this noise: I'll do no harm to this rebel.
O, for Heaven's sake! for pity's sake! Mrs. Jervis, said I, if I am not betrayed, don't leave me; and, I beseech you, raise all the house. No, said Mrs. Jervis, I will not stir, my dear lamb; I will not leave you. I wonder at you, sir, said she; and kindly threw herself upon my coat,
clasping me round the waist: You shall not hurt this innocent, said she: for I will lose my life in her defence. Are there not, said she, enough wicked ones in the world, for your base purpose, but you must attempt such a lamb as this?
He was desperate angry, and threatened to throw her out of the window; and to turn her out of the house the next morning. You need not, sir, said she; for I will not stay in it. God defend my poor Pamela till to-morrow, and we will both go together.--Says he, let me but
expostulate a word or two with you, Pamela. Pray, Pamela, said Mrs. Jervis, don't hear a word, except he leaves the bed, and goes to the other end of the room. Ay, out of the room, said I; expostulate to-morrow, if you must expostulate!
I found his hand in my bosom; and when my fright let me know it, I was ready to die; and I sighed and screamed, and fainted away. And still he had his arms about my neck; and Mrs. Jervis was about my feet, and upon my coat. And all in a cold dewy sweat was I. Pamela! Pamela! said Mrs. Jervis, as she tells me since, O--h, and gave another shriek, my poor Pamela is dead for certain! And so, to be sure, I was for a time; for I knew nothing more of the matter, one fit following another, till about three hours after, as it proved to be, I found myself in bed, and Mrs. Jervis sitting upon one side, with her wrapper about her, and Rachel on the other; and no master, for the wicked wretch was gone. But I was so overjoyed, that I hardly could believe myself; and I said, which were my first words, Mrs. Jervis, Mrs. Rachel, can I be sure it is you? Tell me! can I? -- Where have I been? Hush, my dear, said Mrs. Jervis; you have been in fit after fit. I never saw any body so frightful in my life!.." Pray for Your distressed DAUGHTER, conclut Pamela...
On sait toujours demander comment une jeune femme aussi sensible avait pu fournir à ses parents autant de détails et de précisions sur la tentative sexuelle de son maître. La supposée hypocrisie de son personnage n'est peut-être pas en cause, mais peut-être la maîtrise imparfaite de Richardson dans la forme qu'il a choisie, le lettre. Lorsqu'il écrira "Clarissa", cinq ans plus tard, Richardson se décide à inclure davantage de textes épistolaires d'autres participants à l'intrigue...
Dans les lettres suivantes, tandis que M. B. tente de calmer le jeu, tout en précisant une nouvelle fois qu'il ne peut pas autoriser Pamela à rester, en raison de sa "Freedom of Speech" séditieuse et de "her Letter-writing of all the Secrets of my Family", et qu'il la considère également comme intolérablement "pert".
Pamela se prépare toujours à partir, il est convenu enfin que Mme Jervis ne sera pas renvoyée. " I have finished all that lay upon me, and only wait the good time of setting out."
Lettre XXIX, Pamela avoue quelques regrets sur ce que fut sa vie passée, il lui semble que tout ce qu'elle a pu apprendre, à chanter, à fleurir, à dessiner, et à "faire du bon travail avec son aiguille", à quoi sert tout cela tant les choses mal tourné, "ni plus ni moins que je suis comme la sauterelle de la fable, que j'ai lue dans le livre de madame,..." . La voici donc discutant avec la gouvernante des différentes affaires qu'elle compte conserver, les séparant en différents paquets, une énumération qui a pu trouver écho auprès des lectrices dont la vie était alors presque entièrement consacrée aux affaires domestiques, un ensemble particulièrement important pour le roman au XVIIIe siècle, car elles n'avaient généralement pas encore l'éducation nécessaire pour lire et apprécier les textes classiques dans lesquels les hommes privilégiés avaient reçu leur éducation. Mais de telles conversations ne peuvent se dérouler sans la présence du maître qui ne cesse d'exercer son pouvoir, M. B. a assisté à la conversation avec l'accord de Mme Jervis...
Et la Lettre XXX relance l'intrigue. Voici le maître se proposant d'améliorer la situation de M. Andrews, se disant impressionné par les preuves du caractère moral de Pamela, et confirmant qu'il l'aime jusqu'à l' "extravagance" : il souhaite ainsi qu'elle reste une semaine ou deux de plus pendant qu'il s'arrange pour aider sa famille. Pensant avoir obtenu son consentement, il quitte la pièce. Pamela ne semblait attendre que cela, se demande si elle doit rester, mais bien qu'elle souhaite vivement que M. B. rende la vie de ses parents plus confortable, elle craint que la nouvelle gentillesse de son maître ne soit une plus grande menace pour sa vertu que ne l'a jamais été son agressivité. Finalement, Pamela décide de ne pas faire confiance à M. B. et de retourner chez ses parents.
Devant la persistance de son refus, M. B. fait appel à de nouveaux arguments : il lui offre cinquante guinées, qu'elle refuse, et lui propose ensuite de lui trouver un mari distingué, le pasteur M. Williams du Lincolnshire, qui l'élèvera socialement et la protégera des hommes prédateurs (Lettre XXXI). Pamela feint d'être intéressée...

Pamela’s Journal, through the 35th Day of her Imprisonment...
Commence une toute nouvelle partie, mais l'éditeur nous prévient que les épreuves de Pamela ne sont pas terminées pour autant. M. B. a fait appel à Robin, le cocher de son domaine, pour transporter la jeune femme dans le Lincolnshire. Le choix de la région est significative, plus au nord que le Bedfordshire, le Lincolnshire est synonyme de nature sauvage et de solitude extrême.
L'éditeur révèle également que Jean, le valet de pied, a permis à M. B. de lire toute la correspondance entre Pamela et ses parents. Il nous est montré une lettre de M. B. à M. Andrews dans laquelle le Squire prétend expliquer pourquoi Pamela ne rentre pas à la maison. Il accuse Pamela d'inventer des histoires romantiques sur les projets de M. B. et prétend qu'elle entretient une liaison à distance avec un jeune ecclésiastique, de sorte que M. B. a jugé bon d'envoyer Pamela à la campagne pour un certain temps afin d'empêcher ce mariage imprudent.
M. Andrews s'apercevra de ce subterfuge et se rendra au domaine mais M. B. lui assurera que Pamela est en sécurité, prétendant qu'elle est partie à Londres au service d'une famille réputée. M. Andrews rentrera chez lui plusieurs jours plus tard, avant l'arrivée d'une lettre de Pamela à Mme Jervis, que l'éditeur nous expose : Pamela rapporte à Mme Jervis que Robin, le cocher, l'a enlevée sur ordre de son maître, mais qu'elle a été bien traitée. Elle demande à Mme Jervis de dire à M. et Mme Andrews qu'elle va bien. Mme Jervis envoie la lettre aux parents de Pamela, qui en tirent un petit réconfort mais n'ont d'autre recours que la prière.
Enfin apparaît un nouveau personnage central, Mme Jewkes succède à Mme Jervis, décrite comme repoussante, quasiment androgyne et relayant parfaitement son maître dans le processus de surveillance de Pamela..
"Now I will give you a picture of this wretch: She is a broad, squat, pursy, fat thing, quite ugly, if any thing human can be so called; about forty years old. She has a huge hand, and an arm as thick as my waist, I believe. Her nose is flat and crooked, and her brows grow down over her eyes; a dead spiteful, grey, goggling eye, to be sure she has. And her face is flat and broad; and as to colour, looks like as if it had been pickled a month in saltpetre: I dare say she drinks:--She has a hoarse, man-like voice, and is as thick as she is long; and yet looks so deadly strong, that I am afraid she would dash me at her foot in an instant, if I was to vex her.--So that with a heart more ugly than her face, she frightens me sadly: and I am undone to be sure, if God does not protect me; for she is very, very wicked--indeed she is...."
Pamela continue donc à écrire des lettres (XXXII) à ses parents mais, ne sachant si elle pourra les envoyer, ces lettres prennent forme de journal continu de plus de 400 pages, jour par jour, mais sans préciser la date...
Et Pamela commence à planifier son évasion , prenant le pasteur M. Williams comme seul allié probable. Celui-ci tente en vain d'obtenir son soutien auprès de la noblesse locale, qui soupçonne ses motivations et celles de Pamela, soupçons qui semblent se confirmer lorsque l'ecclésiastique finit par suggérer que Pamela et lui se marient. M. B. enverra le pasteur en prison pour dette et Pamela, désormais livrée à elle-même, c'est un tournant, tentera de s'échapper, manquera de se noyer dans l'étang du jardin, sera sauvée par quelque singulière providence et se retrouvera inconsciente et blessée dans une dépendance de la propriété. La jeune femme vient de franchir une étape, atteignant une sorte d'équilibre spirituel. Nous sommes au 36e jour de son internement...
“Monday, Tuesday, the 25th and 26th Days of [her] heavy Restraint.”
Two letters have arrived from Mr. B., one for Pamela and one for Mrs. Jewkes, but with their addresses switched so that each woman reads the other’s letter. In Mrs. Jewkes’s letter, Mr. B. accuses Mr. Williams of “perfidious Intrigue” with Pamela and reveals that he has arranged to send the clergyman to prison for debt. Of Pamela he declares, “I now hate her perfectly,” and he plans to be in Lincolnshire in three weeks, at which time he will take his “Revenge” for her alleged intrigue with Mr. Williams.
Mrs. Jewkes appears, takes her letter from Pamela, and gives Pamela her own letter from Mr. B. After taking a few minutes to recover from what she has already read, Pamela reads what Mr. B. intended for her eyes. He accuses her of hypocrisy in standing on her purity while intending to run away with a clergyman she barely knows. He concludes that, while once he considered her innocence worth preserving, now “my Honor owes you nothing” and he will soon make clear the low regard in which he holds her.
Pamela laments that she now receives accusations of duplicity, simply because she strives to preserve her integrity. She asks Mrs. Jewkes to warn Mr. Williams of the impending action against him for debt, but the housekeeper insists that any such action would violate her duty toward Mr. B. Mrs. Jewkes then takes Pamela downstairs and introduces her to Monsieur Colbrand, a monstrous Swiss man whom Mr. B. has sent to keep watch over Pamela. His appearance appalls Pamela, who dreams that night of Mr. B. and Colbrand approaching her bedside with nefarious designs.
“Wednesday, the 27th Day of [her] Distress.”
Mr. Williams has been arrested for debt, and Pamela regrets it for both his sake and her own. Judging that the time for desperate measures has arrived, Pamela hatches a plan to escape through the window while Mrs. Jewkes is sleeping. Once outside, she will fake her own suicide by throwing her petticoat into the pond, thereby creating a diversion that will occupy the household while she gets away. She will bury her writings in the garden, because she expects to be searched thoroughly if she fails to escape.
Pamela overhears Mrs. Jewkes telling Colbrand that the waylaying of Mr. Williams was a contrivance of the housekeeper to acquire Pamela’s letters.
“Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the 28th, 29th, 30th, and 31st Days of [her] Distress.”
On Wednesday night, once Mrs. Jewkes has fallen asleep, Pamela squeezes through the window bars and drops to the roof beneath her and thence to the ground. She buries her papers under a rose bush, tosses her petticoat and some other items into the pond, and runs to the door that leads from the garden into the pasture. She finds, however, that Mrs. Jewkes has changed the locks, so that Pamela’s key will not work. She tries climbing the wall but falls when the mortar crumbles, injuring her head, shins, and ankle. She seeks a ladder, but in vain.
Pamela’s next thought is to drown herself in earnest. She creeps toward the pond, sits on the bank, and reflects on her situation. She envisions the remorse of her persecutors upon the discovery of her corpse and rises to throw herself in. Her bruises slow her, however, and give her a chance to consider what purposes providence may have for subjecting her to such afflictions. She reasons that God would not try her beyond her strength and that even Mr. B. may undergo a change of heart. She chastises herself for presuming to shorten the life and trials God has given her and recognizes the folly of keeping herself free of sin for so many months, only to commit the unforgivable sin in the end.
Too maimed to reach the house, Pamela takes refuge in an outhouse, where she lies until Nan finds her in the morning. The servants, having been fooled by Pamela’s suicide diversion, are glad to find her alive. They carry Pamela to her bed, where Mrs. Jewkes and Nan tend to her injuries. Pamela remains in bed until Saturday morning, when Mrs. Jewkes reveals that Mr. B., who is a Justice of the Peace, has provided the housekeeper with a warrant for the apprehension of Pamela in the case of her escape, so that Pamela would almost certainly not have gotten far even had she made it over the wall.

Pamela’s Journal, The 42nd Day of her Imprisonment through the 4th of her Freedom.
Quelques jours plus tard, M. B. arrive dans le Lincolnshire, offre à Pamela les conditions de de devenir sa maîtresse, et après plusieurs tentatives et autant d'échecs, décide d'avoir avec elle un entretien à cœur ouvert, lui expliquant qu'il a fini par admirer son caractère et qu'en fait, il l'aime profondément, mais que son aversion pour le mariage l'empêche de lui faire une proposition honnête. Pamela est émue par cet aveu et espère ardemment qu'il est sincère. Mais l'intrigue est à nouveau relancée lorsqu'une voyante gitane avertit Pamela que B. en fait prépare un faux mariage.
L'essentiel n'est sans doute pas là, c'est bien la quasi obsession du maître pour les écrits de sa servante qui constitue la trame obsessionnelle de leur relation. C'est alors que Mme Jewkes s'empare d'un paquet de lettres qui contient tout, du dimanche 17e jour de son emprisonnement au mercredi 27e jour, Pamela la supplie de ne pas montrer ces papiers à M. B., mais en vain. À neuf heures, le samedi, M. B. convoque Pamela à ce qu'il appelle son "procès" (Trial). Il a lu ses papiers, et il décrit sa correspondance avec M. Williams comme des " lettres d'amour", refusant de croire que ses efforts pour décourager l'ecclésiastique étaient sincères, il demande à voir les premières lettres de Pamela, mais celles-ci sont maintenant entre les mains de son père, ainsi que ses toutes dernières, cachés dans ses vêtements. Lorsqu'il menace de la fouiller pour voir les derniers écrits, elle supplie qu'on lui permette d'aller les chercher à l'étage, où elle prétend les avoir cachés. De son placard, elle envoie à M. B. un mot demandant un délai jusqu'à demain matin pour examiner les papiers. Il lui accorde ce délai. Le Dimanche matin, Pamela rencontre M. B. dans le jardin et lui remet ses papiers. Il s'assied avec elle près de l'étang et passe au récit de la tentative d'évasion de Pamela et de son quasi-suicide. Tout en lisant, il se promène dans le jardin aux différents endroits que Pamela mentionne dans son récit, qu'il déclare "être un conte très émouvant" et promet de se racheter. Pamela craint cependant toujours le mariage blanc et demande à nouveau à retourner chez ses parents. Son empressement à partir met en colère M. B., mais dans l'après-midi, Mme Jewkes demande à Pamela de se préparer à retourner chez ses parents sur-le-champ.
Le dimanche soir, Pamela quitte donc le domaine de M. B. dans le Lincolnshire mais découvre combien elle est contrariée par le renvoi de Squire l'ait mise à la porte. Avec Robin, le cocher, et Monsieur Colbrand, elle atteint, à la nuit tombée, une taverne dans un étrange village. Robin lui remet une lettre de Monsieur B. dans laquelle le Squire révèle qu'il était sur le point de la demander en mariage lorsqu'il l'a renvoyée. Pamela est bouleversée par l'impact émotionnel de cette lettre et s'avoue à elle-même qu'elle est tombée amoureuse de Monsieur B. Nous venons de franchir le premier jour de libération de Pamela...
Observez les merveilleuses voies de la Providence ! Les choses mêmes que je redoutais le plus qu'il voie ou sache, le contenu de mes papiers, m'ont permis d'atteindre le bonheur tant espéré! "But see the wonderful ways of Providence! The very things that I most dreaded his seeing or knowing, the contents of my papers, have, as I hope, satisfied all his scruples, and been a means to promote my happiness." Face au maître, la domestique ne cesse pas pour autant de faire état de son indignité..
Pamela et ses compagnons arrivent à l'auberge appartenant à la famille de Mme Jewkes, une nouvelle de M. B. lui apprend qu'il continue la lecture de son journal et que les preuves de son caractère sont si impressionnantes qu'il souhaite maintenant que Pamela retourne dans le Lincolnshire et, implicitement, qu'il l'épouse.
De retour, Pamela rend visite à M. B., malade dans son lit, mais qui ordonne à Mme Jewkes de la laisser entièrement libre. Il montre à la jeune fille une lettre de sa soeur qui le réprimande pour son badinage avec Pamela : Lady Davers pense que son frère doit avoir l'intention de garder Pamela soit comme maîtresse, soit comme épouse, mais que l'une ou l'autre de ces liaisons serait déshonorante. Le maître explique à la servante qu'en effet une telle union provoquerait bien des oppositions. Il sonde en fait l'attitude de Pamela sur ce point, et celle-ci se déclare indifférente à l'opinion de la haute société. Pamela apprend d'autre part que le mot reçu de la gitane est en faite de la main de M. Longman et que M. B. envisageait bien un mariage blanc.
Le maître, après avoir pris possession de l'esprit de Pamela, via ses Lettres, conservées au plus de près son intimité, va s'emparer de son corps...
De nouvelles relations se mettent insensiblement en place. La noblesse voisine, qui avait refusé d'aider Pamela à s'échapper, vient maintenant dîner et inspecter la fiancée de M. B.. Pamela impressionne tout le monde par sa beauté et son raffinement relatif. Le même jour, M. Andrews arrive, s'attendant, d'après une lettre qu'il a reçue, à trouver sa fille devenue maîtresse totalement corrompue du Squire. Les retrouvailles sont extraordinaires, et deux semaines après le début des fiançailles,
Pamela et M. B. se marient dans la chapelle familiale. M. Williams préside la cérémonie et Mme Jewkes assiste la mariée.
"My dear father was a little uneasy about his habit, for appearing at chapel next day, because of Misses Darnford and the servants, for fear, poor man, he should disgrace my master; and he told me, when he was mentioning this, of my master's kind present of twenty guineas for clothes, for you both; which made my heart truly joyful. But oh! to be sure, I can never deserve the hundredth part of his goodness! -- It is almost a hard thing to be under the weight of such deep obligations on one side, and such a sense of one's own unworthiness on the other.--O! what a Godlike power is that of doing good! -- I envy the rich and the great for nothing else...."
Le ton aura été moralisateur tout au long du récit et relève d'un solide sens pratique, mais reste passablement équivoque. En dépit de ses larmes et de sa sensibilité délicate, Paméla est, à son insu ou pas, une fille de tête qui sait admirablement se tirer d`affaire. La Providence divine et le respect de la hiérarchie sociale aidant.
Dans une deuxième partie, Pamela aura à s'imposer dans sa nouvelle vie. La première opposante qu'elle affrontera sera Lady Davers, la soeur aînée de B., hostile dans un premier temps à toute mésalliance, tout un pan de la vie passée de B. surgit ainsi, dont la liaison qu'il eut jadis avec une certaine Sally Godfrey, avec laquelle il eut une fille, Miss Goodwin, qui vit dans un pensionnat local....

Pamela’s Journal, The 7th Day of her Happiness through the 14th...
“Wednesday, the Seventh.
Pamela visits Lady Davers in the morning, and they discuss the trials Pamela experienced before marriage. They then discuss Mr. B.’s character, with Lady Davers enumerating his virtues and faults: she says that “he is noble in his Spirit; hates little dirty Actions; he delights in doing Good: But does not pass over a wilful Fault easily. He is wise, prudent, sober, and magnanimous; and will not tell a Lye, nor disguise his Faults.” Pamela says she anticipates that “it will not be an easy Task to behave unexceptionably to him: For he is very nice and delicate in his Notions.
Lady Davers asks to see Pamela’s journal, saying that she will love Pamela more if the journal convinces her that the marriage is no more than a suitable reward for Pamela’s virtue. She then inquires into the character of Mr. and Mrs. Andrews, and Pamela tells the story of her brothers’ plunging their parents into debt and Mr. Andrews’s failing as a schoolmaster. Pamela praises her parents’ honest, cheerful poverty and their success in educating their daughter in virtue. Lady Davers professes herself quite won over. Pamela refrains from asking her about Sally Godfrey, though she remains intensely curious..."
Pamela continue son intégration dans la gentry locale, prend acte d'une lettre de son père dans laquelle il accepte le projet de M. B. de l'établir comme gérant du domaine dans le Kent, quant aux dettes de ses parents, elles se révèlent moins lourdes que prévues. Pamela dit à son père qu'elle cesse désormais toute "activité servile". Le retour triomphal de Pamela dans le Bedfordshire représentera le point culminant de sa transformation en conte de fées ou en personnage modèle du moralisme façon Richardson...
"... Let the desponding heart be comforted by the happy issue which the troubles and trials of PAMELA met with, when they see, in her case, that no danger nor distress, however inevitable, or deep to their apprehensions, can be out of the power of Providence to obviate or relieve; and which, as in various instances in her story, can turn the most seemingly grievous things to its own glory, and the reward of suffering innocence; and that too, at a time when all human prospects seem to fail..."

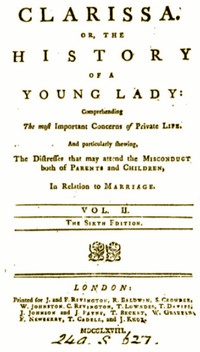
Samuel Richardson, "Clarisse; or the History of a Young Lady" (1747-1748)
"Clarisse Harlowe", roman épistolaire en sept volumes, les quatre premiers volumes en 1747, les quatre derniers en 1748, et au cours des années suivantes, donnèrent à Richardson une réputation européenne. Comme "Pamela", l'histoire elle-même est assez mince et simple, mais les personnages sont dessinés avec une touche plus audacieuse et plus sûre que son précédent roman, avec une multiplicité des points de vue qui évite les quelques contradictions ou invraisemblances de "Pamela". Les lettres de Clarissa sont en effet écrites par quatre personnages différents. Mais en l'absence d'un narrateur central guidant le lecteur, il peut être difficile de savoir quel personnage ne fabule pas ou déguise la réalité, et Richardson ne put empêcher de nombreuses interprétations qui n'allaient guère dans son sens...
Clarissa, une jeune femme belle et vertueuse que la perversité de son entourage, conduit à la tragédie. La beauté de Clarissa est ici vécue par ses proches comme une menace. Clarissa Harlowe, dix-huit ans, est universellement aimée et admirée, considérée comme une jeune femme exemplaire par tous ceux qui l'approchent. Elle vit dans une famille, les Harlowe, en pleine ascension sociale, représentatif de la gentry anglaise du XVIIIe, riche mais sans racines, loin, très loin de cette aristocratie tant révérée, ici l'égocentrisme, l'égoïsme et la cupidité est le moteur de chacun. Clarissa n'en est pas exempte, elle a ses accès de fureur et ses motivations ne sont pas toujours évidentes, mais chacun des Harlowe nous est présenté sous des traits essentiellement négatifs. M. Harlowe est dominateur, Mme Harlowe passive et craintive, Arabella mesquine, James impétueux et cruel...
Les problèmes commencent pour Clarissa lorsque Richard Lovelace, un libertin sans scrupules, vient faire la cour à Arabella, la sœur de Clarissa : mais en fait, ne désire que Clarissa. Jalousie d'Arabella et ressentiment de leur frère, James, qui en veut à Lovelace depuis le collège, et dresse la famille contre lui. Un duel entre les deux jeunes gens, au cours duquel Lovelace blesse James mais lui épargne la vie, va cristalliser leur haine.
- "Letters 1–32" - trois mois d'écriture et plus de cent pages, le seul élément majeur de l'intrigue y est le duel entre James et Lovelace, avant le début véritable du livre...
- "January 15. The moment, my dear, that Mr. Lovelace's visits were mentioned to my brother on his arrival from Scotland he expressed his disapprobation, declaring he had ever hated him since he had known him at college, and would never own me for a sister if I married him.
"This antipathy I have heard accounted for in this manner:
"Mr. Lovelace was always noted for his vivacity and courage, and for the surprising progress he made in literature, while for diligence in study he had hardly his equal. This was his character at the university, and it gained him many friends, while those who did not love him, feared him, by reason of the offence his vivacity made him too ready to give, and of the courage he showed in supporting it. My brother's haughtiness could not bear a superiority..."-,
.. l'action se déroule principalement dans l'esprit des personnages et dans leurs conversations écrites et orales, ici principalement Clarissa et Anna. Richardson nous rappellera dans sa préface que la forme épistolaire se prête plus à un roman psychologique, qu'à un roman axé sur l'intrigue et l'action, donc un roman plus long qu'un roman narratif, toute lettre contient des réflexions et des spéculations de personnages sur les événements qui se sont déroulés...

La famille se méfie de Clarissa, à vrai dire son intérêt pour Lovelace peut sembler suspect, on lui interdit donc de de correspondre avec ce dernier et on lui ordonne d'épouser un horrible homme, riche bien entendu, Roger Solmes : Clarissa refuse, et refusera,
- "MISS CLARISSA HARLOWE, TO MISS HOWE SUNDAY MORNING, MARCH 26. -O my dear! what a degree of patience, what a greatness of soul, is required in the wife, not to despise a husband who is more ignorant, more illiterate, more low-minded than herself!--The wretch, vested with
prerogatives, who will claim rule in virtue of them (and not to permit whose claim, will be as disgraceful to the prescribing wife as to the governed husband); How shall such a husband as this be borne, were he, for reasons of convenience and interest, even to be our CHOICE?" -,
.. entretient une correspondance clandestine avec Lovelace mais aussi avec sa meilleure amie, Anna Howe.
Littéralement recluse dans sa chambre, elle finit par s'enfuir, aidée par un Lovelace qui en profite pour la faire tomber progressivement sous son emprise. La réputation de Clarisse est désormais ruinée, sa famille refuse de lui pardonner, Lovelace aura toute latitude pour entraîner la jeune femme dans sa toile, la compromettre, salir sa réputation et obtenir un contrôle total sur elle...
-"Letters 33–78" - Des Lettres qui nous rendent compte d'abord des échanges entre Clarissa et Solmes, et de toute une famille se liguant pour la pousser au mariage. Clarissa s'explique sur son rejet et tout au long de ces échanges, c'est la personnalité de Solmès qui se découvre. Et par contraste celle de Lovelace, qui prend de l'ampleur, qui lui sait écrire, qui lui est un noble et n'a pas besoin de se battre pour l'argent ou le prestige. Mais Lovelace est un homme d'intrigues, il engage un certain Joseph Leman pour espionner les Harlow et les manipuler. Montrant qu'il ne recherche pas seulement à gagner le coeur de Clarissa (Lovelace to Belford, "I knew that the whole stupid family were in a combination to do my business for me. I told thee that they were all working for me, like so many ground moles; and still more blind than the moles are said to be, unknowing that they did so. I myself, the director of their principal motions; which falling in with the malice of their little hearts, they took to be all their own..), et si je pensais qu'il y eut l'ombre d'un doute dans son esprit quant à savoir si elle qu'elle me préfère à tout autre homme vivant, je n'aurais aucune pitié pour elle (idem, "... Let me rejoice, that she has passed the rubicon: that she cannot return: that, as I have ordered it, the flight will appear to the implacables to be altogether with her own consent: and that if I doubt her love, I can put her to trials as mortifying to her niceness, as glorious to my pride. - For, let me tell thee, dearly as I love her, if I thought there was but the shadow of a doubt in her mind whether she preferred me to any man living, I would shew her no mercy")...
- "Letters 79–110" - La fuite de Clarissa devient ici le moteur principal des échanges. Les stylos, l'encre et le papier de Clarissa ont été confisqués, mais elle continue d'écrire avec sa réserve cachée. Lovelace menace d'intervenir si Clarissa est emmenée chez son oncle et suggère qu'elle s'enfuie chez ses parents. Anna écrit que sa mère a refusé d'accueillir Clarissa chez elle. Elle suggère à Clarissa de s'enfuir à Londres, où elle pourra se cacher jusqu'à ce que le cousin Morden arrive et propose de l'accompagner. En fait Clarissa ne fait pas le choix de partir, ce sont les circonstances et les intrigues qui vont progressivement l'y mener ("That I have no way to avoid the determined resolution of my friends in behalf of Mr. Solmes, but by abandoning this house by his assistance"). Clarissa, après avoir été hébergée à St. Albans, est persuadée par Lovelace qu'elle sera plus à l'abri de sa famille à Londres. Les échanges entre Clarissa et Lovelace vont gagner en ambiguïté pour nous lecteurs, ils sont désormais en contact direct, et les manipulations de Lovelace se font plus précises....

Sans se douter du piège qui se referme sur elle, Clarissa accompagne donc Lovelace à Londres, où il l'héberge chez Mme Sinclair, en insistant sur la convenance d'apparaître comme marié. Clarissa ne sait pas qu'il s'agit d'une maison close et que les femmes qu'elle y rencontre sont des prostituées qu'il connaît parfaitement. Lovelace décrit son arrivée au port tant espéré, le" logis" de Mme Sinclair, il va ainsi pouvoir loger sous le même toit que Clarissa, et l'atmosphère aidant...
LETTER LXII - MR. LOVELACE, TO JOHN BELFORD, ESQ. WEDN. APRIL 26.
At last my lucky star has directed us into the desired port, and we are safely landed.--Well says Rowe:--
The wise and active conquer difficulties,
By daring to attempt them. Sloth and folly
Shiver and shrink at sight of toil and hazard,
And make th' impossibility they fear.
But in the midst of my exultation, something, I know not what to call it, checks my joys, and glooms over my brighter prospects: if it be not conscience, it is wondrously like what I thought so, many, many years ago.
Surely, Lovelace, methinks thou sayest, thy good motions are not gone off already! Surely thou wilt not now at last be a villain to this lady!
I can't tell what to say to it. Why would not the dear creature accept of me, when I so sincerely offered myself to her acceptance? Things already appear with a very different face now I have got her here. Already have our mother and her daughters been about me: - 'Charming lady! What a complexion! What eyes! What majesty in her person! - O Mr. Lovelace, you are a happy man! You owe us such a lady!' - Then they remind me of my revenge, and of my hatred to her whole family.
Sally was so struck with her, at first sight, that she broke out to me in these lines of Dryden: Fairer to be seen / Than the fair lily on the flow'ry green! / More fresh than May herself in blossoms new!
I sent to thy lodgings within half an hour after our arrival, to receive thy congratulation upon it, but thou wert at Edgeware, it seems. My beloved, who is charmingly amended, is retired to her constant employment, writing. I must content myself with the same amusement, till she shall be pleased to admit me to her presence: for already have I given to every one her cue.
And, among the rest, who dost thou think is to be her maid servant? Deb. Butler.
Ah, Lovelace! And Ah, Belford!--It can't be otherwise. But what dost think Deb's name is to be? Why, Dorcas, Dorcas Wykes. And won't it be admirable, if, either through fear, fright, or good liking, we can get my beloved to accept of Dorcas Wykes for a bed-fellow?
In so many ways will it be now in my power to have the dear creature, that I shall not know which of them to choose! But here comes the widow with Dorcas Wykes in her hand, and I am to introduce them both to my fair-one?
Why, joy of my nuptials. Know then, that said, is done, with me, when I have a mind to have it so; and that we are actually man and wife! only that consummation has not passed: bound down to the contrary of that, by a solemn vow, till a reconciliation with her family take place. The women here are told so. They know it before my beloved knows it; and that, thou wilt say, is odd.
But how shall I do to make my fair-one keep her temper on the intimation? Why, is she not here? At Mrs. Sinclair's?--But if she will hear reason, I doubt not to convince her, that she ought to acquiesce..."
Les premières lettres de Clarissa montraient, malgré quelques petits détails, un certain contentement de se retrouver dans cette "pension libertine". Elle pense que le bonheur est possible, mais voici que Lovelace, stimulé par la gente féminine qui l'entoure, entreprend de débaucher la jeune femme ou du moins d'en tester ses limites possibles en matière de libertinage : dans une suite de lettres à son amie miss Howe, Clarisse lui confiera son infortune et sa lutte épuisante contre son séducteur...
LETTER VIII - MISS CLARISSA HARLOWE, TO MISS HOWE
MONDAY MIDNIGHT.
I am very much vexed and disturbed at an odd incident. Mrs. Sinclair has just now left me; I believe in displeasure, on my declining to comply with a request she made me: which was, to admit Miss Partington to a share in my bed, her house being crowded by her nieces's guests and by their attendants, as well as by those of Miss Partington.
There might be nothing in it; and my denial carried a stiff and ill-natured appearance. But instantly, upon her making the request, it came into my thought, 'that I was in a manner a stranger to every body in the house: not so much as a servant I could call my own, or of whom I had any great opinion: that there were four men of free manners in the house, avowed supporters of Mr. Lovelace in matters of offence; himself a man of enterprise; all, as far as I knew, (and as I had reason to think by their noisy mirth after I left them,) drinking deeply: that Miss Partington herself is not so bashful a person as she was represented to me to be: that officious pains were taken to give me a good opinion of her: and that Mrs. Sinclair made a greater parade in prefacing the request, than such a request needed. To deny, thought I, can carry only an appearance of singularity to people who already think me singular. To consent may possibly, if not probably, be attended with inconveniencies. The consequences of the alternative so very disproportionate, I thought it more prudent to incur the censure, than to risque the inconvenience.
I told her that I was writing a long letter: that I should choose to write till I were sleepy, and that a companion would be a restraint upon me, and I upon her.
She was loth, she said, that so delicate a young creature, and so great a fortune as Miss Partington, should be put to lie with Dorcas in a press-bed. She should be very sorry, if she had asked an improper thing. She had never been so put to it before. And Miss would stay up with her till I had done writing.
Alarmed at this urgency, and it being easier to persist in a denial given, than to give it at first, I said, Miss Partington should be welcome to my whole bed, and I would retire into the dining-room, and there, locking myself in, write all the night.
The poor thing, she said, was afraid to lie alone. To be sure Miss Partington would not put me to such an inconvenience. She then withdrew,--but returned--begged my pardon for returning, but the poor child, she said, was in tears.--Miss Partington had never seen a young lady she so much admired, and so much wished to imitate as me. The dear girl hoped that nothing had passed in her behaviour to give me dislike to her.--Should she bring her to me?
I was very busy, I said: the letter I was writing was upon a very important subject. I hoped to see the young lady in the morning, when I would apologize to her for my particularity. And then Mrs. Sinclair hesitating, and moving towards the door, (though she turned round to me again,) I desired her, (lighting her,) to take care how she went down.
Pray, Madam, said she, on the stairs-head, don't give yourself all this trouble. God knows my heart, I meant no affront: but, since you seem to take my freedom amiss, I beg you will not acquaint Mr. Lovelace with it; for he perhaps will think me bold and impertinent.
Now, my dear, is not this a particular incident, either as I have made it, or as it was designed? I don't love to do an uncivil thing. And if nothing were meant by the request, my refusal deserves to be called uncivil. Then I have shown a suspicion of foul usage by it, which surely dare not be meant. If just, I ought to apprehend every thing, and fly the house and the man as I would an infection. If not just, and if I cannot contrive to clear myself of having entertained suspicions, by assigning some other plausible reason for my denial, the very staying here will have an appearance not at all reputable to myself.
I am now out of humour with him,--with myself,--with all the world, but you. His companions are shocking creatures. Why, again I repeat, should he have been desirous to bring me into such company? Once more I like him not.--Indeed I do not like him!
- "Letters 111–172" - Lovelace face à la vertu de Clarissa. La vertu constante de Clarissa semble en capacité de conquérir Lovelace, et ce d'autant plus la malédiction de son père plonge la jeune femme dans le chagrin et la maladie. Bien qu'il soit convaincu que le mariage est la meilleure des solutions, Lovelace reconnaît son incapacité à renoncer à ses intrigues libertines. Son éventuelle résolution de s'assagir est rapidement mise à l'épreuve lorsqu'il se rend chez Mme Sinclair : la maison close réanime ses pires intentions. La cruauté des femmes, remarque Lovelace, n'a pas de limites, alors que celle des hommes s'arrête quelque part. Clarissa d'instinct sait résister au mal, mais la malédiction des Harlow qui lui interdisent de revenir et refusent de l'aider financièrement accroit sa dépendance à l'égard de Lovelace...
- "Letters 173–242" - Lovelace promet toujours d'épouser Clarissa et de rétablir sa réputation, mais en vain. Pendant ce temps les tractations et revirements ne cessent entre les deux protagonistes, Anna et d'autres personnes tentent d'intervenir pour trouver une solution. Alors que Lovelace, déchiré entre bien et mal, semble rechercher les conditions d'un mariage, que Belford défend la cause de Clarissa, l'épisode de l'incendie vient jeter le trouble et poser la question d'une éventuelle première tentative de viol à l'encontre de la jeune femme. Suspectant enfin les intentions de Lovelace, Clarissa s'échappe, prend un logement à Hampstead, mais Lovelace découvre son refuge et envoie deux femmes, qu'il prétendent être de sa famille, Lady Betty et Lady Sarah, qui la ramène chez de Mme Sinclair : la voici droguée et violée alors qu'inconsciente. Ce viol va déterminer l'issue finale de l'intrigue....

- "Letters 243–273" - L'instant de la tragédie, singulier abîme de silence ... La confession de Lovelace à Belford sur ce viol est particulièrement brève dans un roman qui n'est pourtant pas avare de détails. C'est pourtant la menace et la tension autour de cette menace qui courent tout au long de la majeure partie des premiers chapites du roman, et ce sont les conséquences de cet événement qui vont déterminer toute l'intrigue de la dernière partie. Monstre au coeur sauvage, lui demande Belford, qu'as-tu fait? Et si tu n'es pas un démon, essaie de réparer ton mal!
Lovelace pensait pouvoir d'emparer de Clarissa par le viol, c'est ainsi qu'il fonctionne, semble-t-il, mais ayant été droguée, il ne peut tenter de l'enfermer dans un quelconque et tortueux sentiment de culpabilité. A son réveil, Clarissa n'a pas abandonnée pour autant ses principes, sa vertu et sa volonté sont pour elle intactes.. Pendant l'absence de Lovelace à Londres, Clarissa réussit à s'échapper de chez Mme Sinclair et se réfugie dans la maison de Mme Smith, qui tient une ganterie dans King Street, Covent Garden. Sa santé est maintenant menacée, Belford découvre sa retraite et la protège de Lovelace.
LETTER XII
MR. LOVELACE, TO JOHN BELFORD, ESQ. TUESDAY MORNING, JUNE 13.
And now, Belford, I can go no farther. The affair is over. Clarissa lives. And I am
Your humble servant, R. LOVELACE.
LETTER XIII
MR. BELFORD, TO ROBERT LOVELACE, ESQ. WATFORD, WEDN. JAN. 14.
O thou savage-hearted monster! What work hast thou made in one guilty hour, for a whole age of repentance! I am inexpressibly concerned at the fate of this matchless lady! She could not have fallen into the hands of any other man breathing, and suffered as she has done with thee.
I had written a great part of another long letter to try to soften thy flinty heart in her favour; for I thought it but too likely that thou shouldst succeed in getting her back again to the accursed woman’s. But I find it would have been too late, had I finished it, and sent it away. Yet cannot I forbear writing, to urge thee to make the only amends thou now canst make her, by a proper use of the license thou hast obtained.
Poor, poor lady! It is a pain to me that I ever saw her. Such an adorer of virtue to be sacrificed to the vilest of her sex; and thou their implement in the devil’s hand, for a purpose so base, so ungenerous, so inhumane!—Pride thyself, O cruellest of men! in this reflection; and that thy triumph over a woman, who for thy sake was abandoned of every friend she had in the world, was effected; not by advantages taken of her weakness and credulity; but by the blackest artifice; after a long course of studied deceits had been tried to no purpose.
I can tell thee, it is well either for thee or for me, that I am not the brother of the lady. Had I been her brother, her violation must have been followed by the blood of one of us.
Excuse me, Lovelace; and let not the lady fare the worse for my concern for her. And yet I have but one other motive to ask thy excuse; and that is, because I owe to thy own communicative pen the knowledge I have of thy barbarous villany, since thou mightest, if thou wouldst, have passed it upon me for a common seduction.
CLARISSA LIVES, thou sayest. That she does is my wonder: and these words show that thou thyself (though thou couldst, nevertheless, proceed) hardly expectedst she would have survived the outrage. What must have been the poor lady’s distress (watchful as she had been over her honour) when dreadful certainty took place of cruel apprehension!—And yet a man may guess what must have been, by that which thou paintest, when she suspected herself tricked, deserted, and betrayed, by the pretended ladies.
That thou couldst behold her phrensy on this occasion, and her half-speechless, half-fainting prostration at thy feet, and yet retain thy evil purposes, will hardly be thought credible, even by those who know thee, if they have seen her.
Poor, poor lady! With such noble qualities as would have adorned the most exalted married life, to fall into the hands of the only man in the world, who could have treated her as thou hast treated her!—And to let loose the old dragon, as thou properly callest her, upon the before-affrighted innocent, what a barbarity was that! What a poor piece of barbarity! in order to obtain by terror, what thou dispairedst to gain by love, though supported by stratagems the most insidious!
O LOVELACE! LOVELACE! had I doubted it before, I should now be convinced, that there must be a WORLD AFTER THIS, to do justice to injured merit, and to punish barbarous perfidy! Could the divine SOCRATES, and the divine CLARISSA, otherwise have suffered?
But let me, if possible, for one moment, try to forget this villanous outrage on the most excellent of women. I have business here which will hold me yet a few days; and then perhaps I shall quit this house for ever. I have had a solemn and tedious time of it. I should never have known that I had half the respect I really find I had for the old gentleman, had I not so closely, at his earnest desire, attended him, and been a witness of the tortures he underwent.
This melancholy occasion may possibly have contributed to humanize me: but surely I never could have been so remorseless a caitiff as thou hast been, to a woman of half this lady’s excellence. But pr’ythee, dear Lovelace, if thou’rt a man, and not a devil, resolve, out of hand, to repair thy sin of ingratitude, by conferring upon thyself the highest honour thou canst receive, in making her lawfully thine.
But if thou canst not prevail upon thyself to do her this justice, I think I should not scruple a tilt with thee, [an everlasting rupture at least must follow] if thou sacrificest her to the accursed women.
La teneur des lettres et notes que Clarissa écrit après le viol, ses "mad papers", offre un contraste particulier avec celle qui anima toute la première moitié du roman: on y décelait alors une réflexion minutieuse, une logique imparable et sereine. De plus, cette vision du viol ne se concentre pas uniquement sur Lovelace mais aussi sur la figure terrifiante et monstrueuse de Mme Sinclair, sans la dernière personne que Clarissa ait vue lorsqu'elle était consciente, et elle incarne à elle seule l'esprit malfaisant qui agite Lovelace. Qu'en est-il de cette vie heureuse que j'espérais (Paper VI), que n'es-tu que ette chenille pernicieuse, qui s'attaque à la belle feuille de la vierge, et empoisonne les feuilles que tu ne peux pas dévorer (Paper VII)...
PAPER VI
What now is become of the prospects of a happy life, which once I thought opening before me? — Who now shall assist in the solemn preparations? Who now shall provide the nuptial ornaments, which soften and divert the apprehensions of the fearful virgin? No court now to be paid to my smiles! No encouraging compliments to inspire thee with hope of laying a mind not unworthy of thee under obligation! No elevation now for conscious merit, and applauded purity, to look down from on a prostrate adorer, and an admiring world, and up to pleased and rejoicing parents and relations!
PAPER VII
Thou pernicious caterpillar, that preyest upon the fair leaf of virgin fame, and poisonest those leaves which thou canst not devour! Thou fell blight, thou eastern blast, thou overspreading mildew, that destroyest the early promises of the shining year! that mockest the laborious toil, and blastest the joyful hopes, of the painful husbandman!
Thou fretting moth, that corruptest the fairest garment!
Thou eating canker-worm, that preyest upon the opening bud, and turnest the damask-rose into livid yellowness!
If, as religion teaches us, God will judge us, in a great measure, by our benevolent or evil actions to one another—O wretch! bethink thee, in time bethink thee, how great must be thy condemnation.
Le plus célèbre des papiers de la folie est le dernier, le papier X, entièrement composé de citations, tirées de poètes anglais bien connus, dont Otway, Dryden, William Shakespeare, Abraham Cowley et Samuel Garth. La page elle-même est frappante car les fragments de poésie y sont éparpillés à des angles différents. En mettant en scène la folie de Clarissa, Richardson montre également ses talents d'imprimeur...
PAPER X
Lead me, where my own thoughts themselves may lose me;
Where I may dose out what I’ve left of life,
Forget myself, and that day’s guile!
Cruel remembrance! —how shall I appease thee?
[Death only can be dreadful to the bad; To innocence ’tis like a bugbear dress’d
To frighten children. Pull but off the mask, And he’ll appear a friend.]
—Oh! you have done an act
That blots the face and blush of modesty;
Takes off the rose
From the fair forehead of an innocent love,
And makes a blister there!
Then down I laid my head,
Down on cold earth, and for a while was dead;
And my freed soul to a strange somewhere fled!
Ah! sottish soul! said I,
When back to its cage again I saw it fly;
Fool! to resume her broken chain,
And row the galley here again!
Fool! to that body to return,
Where it condemn’d and destin’d is to mourn!...

La mort... Clarissa parvient ainsi à fuir un Lovelace désarçonné, tente, sans succès de se rapprocher de sa famille, et trouve en Belford, un ami de Lovelace, un protecteur et un confident. Toujours aussi déterminé, lié à la jeune femme par une relation dont il ne s'explique pas lui-même l'intensité, Lovelace poursuit Clarissa et entend toujours l'épouser : mais le destin est déjà tout tracé, elle a préparé sa mort dès le lendemain de son viol, elle se laissera mourir dans un hospice de Londres (Letters 471–537)....
LETTER XXXVIII - MR. BELFORD, TO ROBERT LOVELACE, ESQ.
WEDNESDAY, AUG. 30.
I have a conversation to give you that passed between this admirable lady and Dr. H. which will furnish a new instance of the calmness and serenity with which she can talk of death, and prepare for it, as if it were an occurrence as familiar to her as dressing and undressing.
As soon as I had dispatched my servant to you with my letters of the 26th, 28th, and yesterday the 29th, I went to pay my duty to her, and had the pleasure to find her, after a tolerable night, pretty lively and cheerful. She was but just returned from her usual devotions; and Doctor H. alighted as she entered the door.
After inquiring how she did, and hearing her complaints of shortness of breath, (which she attributed to inward decay, precipitated by her late harasses, as well from her friends as from you,) he was for advising her to go into the air.
What will that do for me? said she: tell me truly, good Sir, with a cheerful aspect, (you know you cannot disturb me by it,) whether now you do not put on the true physician; and despairing that any thing in medicine will help me, advise me to the air, as the last resource?--Can you think the air will avail in such a malady as mine?
He was silent.
I ask, said she, because my friends (who will possibly some time hence inquire after the means I used for my recovery) may be satisfied that I omitted nothing which so worthy and skilful a physician prescribed?
The air, Madam, may possibly help the difficulty of breathing, which has so lately attacked you.
But, Sir, you see how weak I am. You must see that I have been consuming from day to day; and now, if I can judge by what I feel in myself, putting her hand to her heart, I cannot continue long. If the air would very probably add to my days, though I am far from being desirous to have them lengthened, I would go into it; and the rather, as I know Mrs. Lovick would kindly accompany me. But if I were to be at the trouble of removing into new lodgings, (a trouble which I think now would be too much for me,) and this only to die in the country, I had rather the scene were to shut up here. For here have I meditated the spot, and the manner, and every thing, as well of the minutest as of the highest consequence, that can attend the solemn moments. So, Doctor, tell me truly, may I stay here, and be clear of any imputations of curtailing, through wilfulness or impatiency, or through resentments which I hope I am got above, a life that might otherwise be prolonged? - Tell me, Sir; you are not talking to a coward in this respect; indeed you are not! - Unaffectedly smiling.
La Conclusion n'est pas une lettre, mais une note censée être écrite par Belford, synthèse du destin des personnages restants. M. et Mme Harlowe meurent peu après, James et Arabella font un mariage malheureux, Lovelace est tué en duel par Morden, le cousin de Clarissa. Clarissa a constitué des paquets de lettres, classés par date, pour que Belford les ouvre après sa mort. Celui-ci entreprend de les rassembler pour raconter l'histoire de la vie de Clarissa, afin qu'elle puisse servir d'exemple pour protéger d'autres femmes qui pourraient connaître un destin similaire....
Ce roman fut rapidement célèbre pour sa connaissance approfondie de la psychologie humain et la vivante description des différentes personnalités qui s'y croisent. L'abbé Prévost en a donnera en France une traduction assez libre (1751) sous forme de roman du genre "larmoyant", dont la vogue a duré plus d`un siècle. En 1845, Jules Janin l'a traduit en français, mais en le réduisant à deux tomes pour en rendre la lecture plus aisée.

Samuel Richardson, "The History of Sir Charles Grandisson" (1753)
"Sir Charles Grandison, and the Honourable Miss Byron, in a Series of Letters", une série de lettres publié en 1753, le troisième et dernier roman de Samuel Richardson, et comme ses prédécesseurs, d'une longueur équivalente, sept volumes. Après la paysanne, la bourgeoise. Il restait à Richardson, pour compléter sa trilogie, à aborder la peinture de la haute société. Cette fois, il donna le beau rôle à un homme, sir Charles Grandison, et l'arma de toutes les perfections qui peuvent rendre la vertu ennuyeuse et ridicule, "le grand monde tel qu'un libraire peut le peindre", "l'amour tel qu'un ministre méthodiste peut se l'imaginer", commentera avec ironie Horace Walpole. Mais ce portrait, long, d'un "homme d'honneur", a suscité le plus grand enthousiasme au XVIIIe siècle, de nos jours on retiendra peut-être le personnage de Miss Byron..
La charmante jeune fille orpheline de bonne famille, Miss Harriet Byron, écrit à sa parente Lucy Selby des lettres détaillées sur son séjour à Londres dans la famille de son cousin Archibald Reeves. Très courtisée, elle entretient une cour d'admirateurs qu'elle repousse, préférant sa liberté, et fréquente bals et divertissements. Archibald Reeves entre en correspondance et fait part d'un terrible malheur, Harriet Byron a été enlevée à son retour d'une mascarade. Les soupçons se portent sur John Greville, un prétendant qu'elle a éconduit, mais quelques jours plus tard les véritables circonstances de l'incident sont éclaircies, la famille Reeves reçoit une lettre signée par Charlotte Grandison affirmant que la jeune fille se trouve chez eux et trop affaiblie pour écrire. Le cousin Reeves se rend immédiatement chez les Grandison et découvre les circonstances de l'enlèvement auprès de l'homme qui a sauvé Harriet Byron, Sir Charles Grandison. Le véritable coupable de l'enlèvement est le baronnet, Sir Hargrave Polkofen.
L`amitié qui va naître entre Harriett et lui se transforme rapidement en amour. Cependant Charles n`est plus maître de son destin; les engagements qu'iI a pris en Italie vis-à-vis de Clémentine della Porretta, jeune personne qui s`est éprise de lui, l'empêchent de s'abandonner à la joie de ce nouvel amour.
En effet, Clémentine est tombée, depuis le départ de Charles, dans la plus profonde mélancolie ; de telle sorte que ses parents pressent Charles de revenir et sont tout disposés à consentir au mariage. Charles se sent des obligations assez fortes pour rejoindre Bologne, laissant derrière lui Harriet en larmes, et bien que ses sentiments pour Clémentine n'aient jamais dépassé le stade de l'affection. ll écrit d`ltalie à son ami le docteur Barlet, pour lui rendre minutieusement compte des menées de la famille Della Porretta. Quand ces intrigues sont près d`aboutir, et qu'il va se lier à Clémentine, la jeune fille se rend compte qu`elle ne peut, en définitive, unir sa vie à celle d'un homme qui ne partage pas sa religion. Elle décide de prendre le voile et incite Charles à épouser Harriet.
La description des fiançailles, des félicitations, des noces, et d`autres épisodes tels que la mort d`Hargrave Pollexfen remplit deux volumes. Et pour que toute la joie d`une idylle menée à son heureux terme ne soit pas troublée par la tristesse de Clémentine, cette dernière sort du couvent, gagne l'Angleterre et épouse le comte Belvédère, son ancien prétendant.
Si faible que soit le personnage du héros, on ne peut cependant se tenir d'admirer, avec Walter Scott, la perspicacité peu commune de Richardson dans l`analyse des âmes féminines ; et surtout lorsqu'il se libère de toute arrière-pensée de moraliste et qu`il considère les personnages en eux-mêmes.
Johann Karl August Musaüs (1735-1787) s`attaqua à la vogue dont jouissait Richardson. dans Le Second Grandison [Grandison der Zweite, 1760-1762]. L`abbé Prévost (1697-1763) a traduit ce roman sous le titre de Nouvelles lettres anglaises, ou Histoire du chevalier Grandisson (Paris. 1784). Dans un avertissement. l'abbé Prévost a pris soin de nous avertir que "l`ouvrage anglais ayant été fini sur de faux Mémoires. qui en rendent la conclusion fort insipide. on s'en est heureusement procuré de plus fidèles et de plus intéressants... Les soins que cette recherche a demandés. surtout dans un temps de guerre. sont une assez bonne excuse pour le délai de la publication"...



William Hogarth (1697-1764)
Peintre et graveur satiriste et réaliste, William Hogarth fut souvent considéré comme un grand moraliste, - mais est-ce de la morale ou simplement de l'immoralité ? -, aussi acerbe que Swift, mais du peintre qui passa son existence dans une sorte de "demi-laisser-aller" que l'on reprocha à Rembrandt dans ses dernières années. On peut reprendre cette citation selon laquelle s'il a ridiculisé le vice, c'est que dans son monde si détestable, la vertu ne pouvait pas séjourner. Mais il sait, dans le détail, rendre le reflet de l’expression d'un visage et le contraste de la lutte des sentiments de chacun des différents personnages en scène, le mépris, le rire, la pitié, mais une façon d’envisager la vie qui manque de grandeur et d’amour, acerbe, intransigeant ...
Il a dessiné l'un des meilleurs portraits de Fielding. Une amitié et une admiration semblent avoir toujours existé entre les deux hommes. Fielding parlait en termes élogieux tant des dessins que des écrits de Hogarth...



A Harlot's Progress (La Carrière d'une prostituée), produite en 1730, contait l'histoire de Moll Hackabout, une jeune femme venue de la campagne qui, arrivée à Londres, devient prostituée, puis meurt en très peu de temps, il ne reste qu'une gravure ayant échappée à un incendie en 1755...
"A Rake's Progress", une série de huit scènes produites et gravées en 1732-1734, imprimées en 1735, contant l'histoire fictive de Tom Rakewell, le destin d'un jeune libertin, un jeune héritier glissant peu à peu dans la débauche, l'arrivisme, la grandeur et la déchéance , alors que tout commence par un bel héritage, et finit dans la misère d'un asile d'aliénés, le fameux Bethlem Royal Hospital, après la non moins célèbre prison de la Fleet...: The Rake Taking Possession Of His Estate (O Vanity of age, untoward), The Rake's Levée (Prosperity, (with Horlot's smiles...), The Rake at the Rose Tavern (O Vanity of youthfull blood...), The Rake Arrested, Going to Court, The Rake Marrying an Old Woman, The Rake at The Gaming House, The Rake in Prison, The Rake in Bedlam.
Les 4 parties des "Four Times of the Day“ gravées, postérieurement, sont de 1738.
"Marriage A-la-Mode", série de six tableaux peints entre 1743 et 1745, satire des mariages arrangés, des alliances du commerce et de l'aristocratie, et des jeux de famille viciés par l'argent, saisis par la débauche, la maladie et la mort : The Marriage Settlement, The Tête à Tête, The Inspection, The Bagnio, The Lady's Death...
En 1747, Hogarth donne l’estampe "The Stage Coach" et la série appelée "Industry and Idleness", qui "nous montrent deux apprentis, camarades, dont l’un prenant la bonne voie et s’appliquant aux connaissances en vue desquelles il a été mis en apprentissage, devient un homme de valeur, ornement de son pays, tandis que l’autre, se laissant aller à la paresse tombe dans la misère, et cela de la façon la plus basse, la plus fatale, ainsi qu’il est dit dans la dernière estampe"...




Henry Fielding (1707–1754)
On l'a dit, Henry Fielding est un produit de la squirearchy, d'une Angleterre gouvernée par l'aristocratie et les propriétaires terriens, mais sa position est quelque peu décentrée, il n'héritera ni de terres, ni de titres, et gagnera sa vie comme magistrat, romancier, dramaturge, journaliste, fréquentant tous les milieux de l'Angleterre de Walpole et acquérant une expérience étendue de la nature humaine, des vices et abus d'une société dont il ne conteste pas les fondements, mais qu'il voudrait rendre moins imparfaite.
L'œuvre romanesque de Fielding s'étale sur dix ans de 1741 à 1751, de trente-quatre à quarante-quatre ans : An Apology for the Life of Mrs Shamela Andrews (Shamela) (1741), The History of the Adventures of Joseph Andrews and his Friend, Mr. Abraham Abrams (Joseph Andrews) (1742), The Life and Death of Jonathan Wild, the Great (Histoire de la Vie de Feu Mr Jonathan Wild le Grand) publié comme volume III des Miscellanies (1743), The History of Tom Jones, a Foundling (Histoire de Tom Jones, enfant trouvé) (1749) et Amelia (1751).
Henry Fielding est né près de Glastonbury, dans le sud de l'Angleterre, et a grandi dans la ferme de ses parents, dans le Dorset. Ses origines ne sont pas opulentes, mais elles sont résolument aristocrates, Le premier comte de Denbigh, William Fielding, était un ancêtre direct, tandis que le père d'Henry, le colonel Edmund Fielding, avait servi sous les ordres de John Churchill, duc de Marlborough, un général du début du XVIIIe siècle, "avec beaucoup de bravoure et de réputation". Sa mère était une fille de Sir Henry Gould, un juge du Queen's Bench, dont elle a hérité d'une propriété à East Stour, dans le Dorset, où la famille a déménagé lorsque Fielding avait trois ans. Sa mère meurt juste avant son onzième anniversaire. Son père s'étant remarié, Fielding est envoyé au collège d'Eton, il y acquiert une connaissance de la littérature classique qui influencera sa conception du roman.
En 1728, Fielding se rend à Londres et, sur les conseils de sa cousine Lady Mary Wortley Montagu, se lance dans une carrière littéraire, écrivant des poèmes et des pièces qui font la satire de l'artifice, de l'imposture et de la corruption politique. La même année, il entre à l'université de Leyde, aux Pays-Bas, mais ses études classiques y prennent fin lorsque son père cesse de lui verser une allocation.
"N'ayant, comme il l'a dit, pas d'autre choix que d'être un écrivain ou un cocher de fiacre, il choisit la première solution et s'installera comme auteur dramatique, à Londres, en 1730, où il dirige des théâtres et écrit quelque 25 pièces dont la célèbre "Tragedy of Tragedies, or, The Life and Death of Tom Thumb the Great", "The Author's Farce" (1730), qui montre les absurdités des écrivains et des éditeurs, "Rape upon Rape" (1730) qui fait la satire des injustices de la loi et des avocats. Sa cible était souvent la corruption politique de l'époque. Pendant cette période, il mène une existence débridée qui pourrait inspirer la biographie du personnage de Wilson dans "Joseph Andrews" ; cette vie de dissipation prend fin, cependant, lorsqu'il s'enfuit en novembre 1734 avec Charlotte Cradock, la femme et l'épouse dont l'image inspirera les héroïnes de ses derniers romans, Sophia Western dans Tom Jones et Amelia dans le roman du même nom...
Partisan du parti d'opposition de l'époque, Fielding continue de faire la satire du gouvernement du Premier ministre de facto Robert Walpole. En 1737, il produit au Little Theatre in the Hay (le futur Haymarket Theatre), à Londres, son Historical Register, For the Year 1736, dans lequel le premier ministre, Sir Robert Walpole, est représenté pratiquement sans fard et impitoyablement ridiculisé. Walpole riposte cependant avec le Theatrical Licensing Act de 1737, en vertu duquel aucune nouvelle pièce ne peut être produite avant d'avoir été autorisée par le Lord Chamberlain. Cette loi rend la satire théâtrale pratiquement impossible et met fin à la carrière de Fielding au théâtre, le laissant avec une femme, deux enfants et aucun revenu. Contraint de chercher une autre voie, Fielding étudie le droit au Middle Temple et termine un cursus de six ans en trois ans. Il commence à pratiquer le droit en 1740.
Entre-temps, événement décisif tant dans la vie de Fielding que dans l'histoire du roman, la publication en 1740 de "Pamela" de Samuel Richardson, ouvrage extrêmement populaire et controversé, qui raconte l'histoire de la résistance d'une servante vertueuse aux avances sexuelles de son maître, qui en vient à reconnaître peu à peu sa vertu et la récompense en l'épousant, "ayant jugé bon d'en faire sa femme".
La sentimentalité du roman et son code moral ont stimulé l'esprit de Fielding, qui a donc publié "Shamela", une parodie anonyme, en 1741. puis en 1742, un "Joseph Andrews" plus étoffé et beaucoup plus original. En 1743, Fielding publie ses Miscellanies en plusieurs volumes, qui comprennent le roman "Jonathan Wild", une satire sombre des "grands hommes", du parti Whig et du système de droit pénal, entre autres choses. À cette époque, l'existence de Fielding reste difficile, sa femme et sa fille sont mourantes, il souffre lui-même d'une goutte invalidante et ses finances sont sombres. Pendant les deux années qui suivent, il n'écrit plus rien, que ce soit sous forme de livre ou de périodique, se consacrant plutôt à sa pratique du droit et à ses efforts pour rétablir la santé de sa femme. Ces efforts sont vains et Charlotte meurt dans la station balnéaire de Bath en 1744, laissant Fielding fou de chagrin.
Fielding reprend sa carrière littéraire en 1745, inspiré par l'opposition à la rébellion jacobite, dans laquelle les partisans de la lignée des Stuart font pression sur le prince Charles-Édouard, descendant de Jacques II. Les raisons pour lesquelles Fielding s'opposait aux Jacobites étaient doubles, à la fois religieuses et politiques. Le monarque anglais était le chef suprême de l'Église d'Angleterre, et Charles-Édouard était catholique ; son accession aurait donc été gênante pour la plus étatiste des Églises, et Fielding était un fervent partisan de l'Establishment anglican. Politiquement, Fielding était un Whig - c'est-à-dire un partisan de la succession hanovrienne - et maintenant que le détesté Walpole avait été remplacé par un autre Premier ministre Whig, Fielding pouvait quitter l'opposition et devenir un défenseur du gouvernement d'établissement. En conséquence, en tant qu'éditeur d'un journal politique de 1745 à 1746, il dénonça les Jacobites et leurs alliés tories, et même après la défaite des Jacobites, il continua à faire l'apologie du gouvernement. Sa récompense fut de recevoir des nominations en tant que juge de paix pour Westminster en 1748 et pour le comté de Middlesex en 1749. Ces postes l'installent dans un palais de justice qui lui sert également de résidence, dans Bow Street, à Londres.
En 1747, Fielding avait épousé l'ancienne servante de Charlotte, Mary Daniel, qui était enceinte de lui. Cette décision l'avait rendu ridicule, mais Fielding décrira plus tard sa seconde femme comme "une amie fidèle, une compagne aimable et une tendre infirmière". En 1749, il publie "Tom Jones", sa plus grande œuvre, un roman picaresque sur un enfant trouvé qui fait fortune. "Amelia", qui suit en 1751, témoigne d'un côté plus sombre. L'activité de magistrat de Fielding à Bow Street le plonge dans un désordre social des plus divers qui requiert analyses, jugements et condamnations, et parfois workhouse et potence : signe d'un tournant par rapport à l'éthique de tolérance large et joviale qui imprègne "Joseph Andrews" et "Tom Jones". Fielding était cependant tout aussi sévère avec lui-même, et malgré le fait que son travail de juge de paix ne lui rapportait aucun salaire, il se distinguait des autres magistrats de l'époque par son refus de tout pot-de-vin. Il a aussi grandement contribué à la suppression de la criminalité à Londres en organisant les Bow-Street Runners, une escouade de "voleurs", la première force de police professionnelle de Londres, dit-on.
En plus de ses vocations sociales et politiques, Fielding a également soutenu les ambitions littéraires de sa jeune sœur, Sarah Fielding. Elle a publié un roman en 1744 intitulé "The Adventures of David Simple", suivi d'un texte supplémentaire en 1747, "Familiar Letters Between The Principal Characters in David Simple". Henry Fielding a écrit les préfaces de ces textes. On pense que Sarah a également eu une influence sur Fielding en l'aidant à développer certains aspects de ses principaux personnages féminins, on pense à Mrs. Miller et à Mrs. Western, dans Tom Jones.
L'asthme, l'hydropisie et une goutte sévère obligent Fielding à prendre sa retraite en 1754, et il part en convalescence au Portugal. Son "Journal of a Voyage to Lisbon", publié à titre posthume en 1755, relate la lenteur des voyages, l'incompétence des médecins, les abus de pouvoir, ainsi que le courage et la bonne humeur de Fielding face à ces maux. Il est mort à Lisbonne en octobre 1754....

Henry Fielding, "An Apology for the Life of Mrs. Shamela Andrews" (1741)
Fielding écrit, en 1741 une antithèse de "Paméla ou la Vertu récompensée" de Samuel Richardson, "Défense de la vie de Mme Shamela Andrews", de forme tout autant épistolaire : l'héroïne, Shamela, dont la ressemblance euphonique avec la vertueuse Pamela vaut toutes les introductions, est ici fille d'un voleur et d'une "orange wench", une prostituée vendant des oranges pendant les représentations des opéras ballades. Shamela entend faire grande fortune par sa vertu, va se laisse courtiser par Squire Booby, son employeur, puis prendre un amant en la personne du pasteur Williams. Une Shamela Andrews qui trouve que le jeune Squire a bien l'air bête quand il l'embrasse...
LETTER II.
Shamela Andrews to Henrietta Maria Honora Andrews. Dear Mamma,
O what News, since I writ my last! the young Squire hath been here, and as sure as a Gun he hath taken a Fancy to me; Pamela, says he, (for so I am called here) you was a great Favourite of your late Mistress’s; yes, an’t please your Honour, says I; and I believe you deserved it, says he; thank your Honour for your good Opinion, says I; and then he took me by the Hand, and I pretended to be shy: Laud, says I, Sir, I hope you don't intend to be rude; no, says he, my Dear, and then he kissed me, 'till he took away my Breath—and I pretended to be Angry, and to get away, and then he kissed me again, and breathed very short, and looked very silly; and by Ill-Luck Mrs .Jervis came in, and had like to have spoiled Sport.— How troublesome is such Interruption! You shall hear now soon, for I shall not come away yet, so I rest, Your affectionate Daughter, Shamela.
LETTER III.
Henrietta Maria Honora Andrews to Shamela Andrews. Dear Sham,
Your last Letter hath put me into a great hurry of Spirits, for you have a very difficult Part to act. 1 I hope you will remember your Slip with Parson Williams, and not be guilty of any more such Folly. Truly, a Girl who hath once known what is what, is in the highest Degree inexcusable if she respects her Digressions ; 2 but a Hint of this is sufficient. When Mrs. Jervis thinks of coming to Town, I believe I can procure her a good House, and fit for the Business; so I am,
Your affectionate Mother, Henrietta Maria Honora Andrews.
LETTER IV.
Shamela Andrews to Henrietta Maria Honora Andrews.
Marry come up, good Madam, the Mother had never looked into the Oven for her Daughter, if she had not been there herselt. I shall never have done if you upbraid me with having had a small One by Arthur Williams, when you yourself—but I say no more. O! What fine Times when the Kettle calls the Pot. Let me do what I will, 1 say my Prayers as often as another, and I read in good Books, as often as I have Leisure; and Parson William says, that will make amends.—So no more, but I rest
Your afflicted Daughter, S-.
LETTER VI.
Shamela Andrews to Henrietta Maria Honora Andrews.
O Madam, I have strange Things to tell you! As I was reading in that charming Book about the Dealings, in comes my Master—to be sure he is a precious One. Pamela, says he, what Book is that, I warrant you Rochester’s Poems. —No, forsooth, says I, as pertly as I could; why how now Saucy Chops, Boldface, says he—Mighty pretty Words, says I, pert again.—Yes (says he) you are a d...d, impudent, stinking, cursed, confounded Jade, and I have a great Mind to kick your A... . You, kiss-says I. A-gad, says he, and so I will; with that he caught me in his Arms, and kissed me till he made my Face all over Fire. Now this served purely you know, to put upon the Fool for Anger. O! What precious Fools Men are! And so I flung from him in a mighty Rage, and pretended as how I would go out at the Door; but when I came to the End ol the Room, I stood still, and my Master cryed out, Hussy, Slut, Sauce-box, Boldface, come hither — Yes to be sure, says I; why don’t you come, says he; what should I come for says I; if you don’t come to me, I'll come to you, says he; I shan’t come to you I assure you, says I. Upon which he run up, caught me in his Arms, and flung me upon a Chair, and began to offer to touch my Under-Petticoat. Sir, says I, you had better not offer to be rude; well, says he, no more I won’t then; and away he went out of the Room. I was so mad to be sure I could have cry’d. Oh what a prodigious Vexation it is to a Woman to be made a Fool of...."

Henry Fielding, "The History of the Adventures of Joseph Andrews and his Friend Mr. Abraham Adams" (1742)
Toujours dans la suite du succès de Paméla, Henry Fielding imagine avec le personnage de Joseph Andrews, un frère de Pamela (Pamela Booby, née Andrews, l'héroïne de Richardson, est ici la domestique d'un petit noble qui finira par l'épouser, confondu par sa chasteté), un être au physique avantageux mais dénué de toute ambition et luttant tout autant qu'elle pour sa vertu : mais le roman, qualifié de "comic romance" (roman sentimental comique) dépasse la simple parodie, et deux personnages entrent dans la légende, Mme Slipslop et Parson Adams..
"Ecrit à la manière de Cervantès ", pour reprendre les mots de Fielding, le protagoniste principal en est un serviteur, Joseph Andrews, qui court le danger perpétuel d'être violé par sa maîtresse, Lady Booby, veuve de sir Thomas, et par la repoussante Mlle Slipslop, sa dame de compagnie. Joseph se rend à pied au village où vit Fanny Goodwill, sa fiancée, petite laitière de dix-neuf tout autant innocente que lui, mais il est maltraité et volé par des malandrins qui l'emmènent dans une auberge. Il y rencontre le deuxième grand personnage de ce roman, le vicaire Adams (Parson Adams), un ecclésiastique simple d'esprit du dix-huitième siècle comme on n'en fera plus. Les deux hommes décident de voyager ensemble et vont connaître de nombreuses et totalement ridicules aventures. Le roman se terminera sur une conclusion fort gaie, tout à fait puritaine. Au milieu de la joie générale, on célèbrera le mariage d'Andrews, dont on découvrira l'origine noble, quant à sa jolie fiancée, Fanny, elle est tout simplement la fille de ses propres parents adoptifs.
La longue préface qui précède le roman est vu comme un véritable manifeste littéraire et l'un des documents théoriques majeurs des débuts du genre romanesque en Angleterre: comme il est possible, écrit-il, que le simple lecteur anglais ait une idée du romantisme différente de celle de l'auteur de ces petits volumes, et qu'il s'attende par conséquent à une sorte de divertissement que l'on ne trouvera pas, et qui n'était même pas prévu, dans les pages qui suivent, il n'est peut-être pas inopportun de commencer par quelques mots sur ce genre d'écriture, que je ne me souviens pas d'avoir vu jusqu'ici tenté dans notre langue....
I.--The Virtues of Joseph Andrews
Mr. Joseph Andrews was esteemed to be the only son of Gaffer and Gammer Andrews, and brother to the illustrious Pamela.
At ten years old (by which time his education was advanced to writing and reading) he was bound an apprentice to Sir Thomas Booby, an uncle of Mr. Booby's by the father's side. From the stable of Sir Thomas he was preferred to attend as foot-boy on Lady Booby, to go on her errands, stand behind her chair, wait at her tea-table, and carry her prayer-book to church; at which place he behaved so well in every respect at divine service that it recommended him to the notice of Mr. Abraham Adams, the curate, who took an opportunity one day to ask the young man several questions concerning religion, with his answers to which he was wonderfully pleased.
Mr. Abraham Adams was an excellent scholar, a man of good sense and good nature, but at the same time entirely ignorant of the ways of the world.
At the age of fifty he was provided with a handsome income of twenty-three pounds a year, which, however, he could not make any great figure with, because he was a little encumbered with a wife and six children. Adams had no nearer access to Sir Thomas or my lady than through Mrs. Slipslop, the waiting-gentlewoman, for Sir Thomas was too apt to estimate men merely by their dress or fortune, and my lady was a woman of gaiety, who never spoke of any of her country neighbours by any other appellation than that of the brutes.
Mrs. Slipslop, being herself the daughter of a curate, preserved some respect for Adams; she would frequently dispute with him, and was a mighty affecter of hard words, which she used in such a manner that the parson was frequently at some loss to guess her meaning.
Adams was so much impressed by the industry and application he saw in young Andrews that one day he mentioned the case to Mrs. Slipslop, desiring her to recommend him to my lady as a youth very susceptible of learning, and one whose instruction in Latin he would himself undertake, by which means he might be qualified for a higher station than that of footman. He therefore desired that the boy might be left behind under his care when Sir Thomas and my lady went to London.
"La, Mr. Adams," said Mrs. Slipslop, "do you think my lady will suffer any preambles about any such matter? She is going to London very concisely, and I am confidous would not leave Joey behind on any account, for he is one of the genteelest young fellows you may see in a
summer's day; and I am confidous she would as soon think of parting with a pair of her grey mares, for she values herself on one as much as the other. And why is Latin more necessitous for a footman than a gentleman? I am confidous my lady would be angry with me for mentioning it, and I shall draw myself into no such delemy."
So young Andrews went to London in attendance on Lady Booby, and became acquainted with the brethren of his profession. They could not, however, teach him to game, swear, drink, nor any other genteel vice the town abounded with. He applied most of his leisure hours to music, in which he greatly improved himself, so that he led the opinion of all the other footmen at an opera. Though his morals remain entirely uncorrupted, he was at the same time smarter and genteeler than any of the beaus in town either in or out of livery.
At this time an accident happened, and this was no other than the death of Sir Thomas Booby, who left his disconsolate lady closely confined to her house. During the first six days the poor lady admitted none but Mrs. Slipslop and three female friends, who made a party at cards; but on the seventh she ordered Joey, whom we shall hereafter call Joseph, to bring up her teakettle.
Lady Booby's affection for her footman had for some time been a matter of gossip in the town, but it is certain that her innocent freedoms had made no impression on young Andrews. Now, however, he thought my lady had become distracted with grief at her husband's death, so strange was her conduct, and wrote to his sister Pamela on the subject.
If madam be mad, I shall not care for staying long in the
family, so I heartily wish you could get me a place at some
neighbouring gentleman's. I fancy I shall be discharged very
soon, and the moment I am I shall return to my old master's
country seat, if it be only to see Parson Adams, who is the
best man in the world. London is a bad place, and there is so
little good fellowship that the next-door neighbours don't
know one another. Your loving brother,
JOSEPH ANDREWS.
The sending of this letter was quickly followed by the discharge of the writer. To Lady Booby's open declarations of love, Joseph replied that a lady having no virtue was not a reason against his having any.
"I am out of patience!" cries the lady, "did ever mortal hear of a man's virtue? Will magistrates who punish lewdness, or parsons who preach against it, make any scruple of committing it? And can a boy have the confidence to talk of his virtue?"
"Madam," says Joseph, "that boy is the brother of Pamela, and would be ashamed that the chastity of his family, which is preserved in her, should be stained in him. If there are such men as your ladyship mentions, I am sorry for it, and I wish they had an opportunity of reading my sister Pamela's letters; nor do I doubt but such an example would amend them."
"You impudent villain!" cries the lady in a rage. "Get out of my sight, and leave the house this night!"
Joseph having received what wages were due, and having been stripped of his livery, took a melancholy leave of his fellow-servants and set out at seven in the evening.

Henry Fielding, "The History of Tom Jones, a Foundling" (1749)
En 1749, l'écrivain Henry Fielding, peu de temps après sa nomination comme juge de paix de Westminster, quitte l'épopée comique en prose et la parodie cinglante pour le roman réaliste dont il devient l'initiateur en Angleterre. En dix-huit livres réunis en six volumes, inspiré du Don Quichotte de Cervantès (1615), du Gil Blas de Lesage, de La Vie de Marianne (1731-1738) et du Paysan parvenu (1734-1735) de Marivaux, "L'histoire de Tom Jones, un enfant trouvé" porte une quarantaine de personnages dans une société anglaise du XVIIIe siècle dominée par les conflits de classe et la domination du gentleman campagnard (squire) bruyant, dominateur et tyrannique. Face à Tom Jones, bâtard généreux et expansif, élevé par le philanthrope et bienveillant Allworthy, se dressent Master Blifil, le fils de Bridget Allworthy et du capitaine Blifil, et Squire Western, une caricature du gentleman campagnard conservateur et brutal. Dans sa façon de conduire son récit, Fielding met en place progressivement tout au long du premier livre des histoires personnelles plus qu' "une histoire". Et au lieu de s'évertuer à sonder la psychologie de ses personnages, comme le ferait un roman plus traditionnel, insistera pour présenter des "scènes" au lecteur , des transcriptions fidèles de leurs actions et dialogues qui se lisent comme des faits historiques. Enfin, pour nous accompagner dans une véritable EXPERIENCE DE LECTURE sans cesse renouvelée au fil des quelques dix-huit livres, chacun de ceux-ci est précédé d'une petite réflexion sur les différents types d'écriture dont usera notre narrateur comme d'une palette infinie permettant d'appréhender dans sa diversité la nature humaine...
Fils adoptif de Mister Allworthy, un riche philanthrope, Tom Jones a été élevé avec le neveu de celui-ci, Blifil, âme hypocrite et vénale. Tom est l'élu de cœur de la belle Sophia Western, que Blifil voudrait bien conquérir. Or Tom est en fait épris de Molly Seagrim, la fille d'un garde-chasse qu'il veut épouser. Mais après qu'il s'est aperçu que Molly n'est inspirée que par le démon de la coquetterie, Tom devient beaucoup plus sensible à l'amour de Sophie.
Soutenu par la tante de Sophie, Blifil calomnie Tom et parvient à le faire chasser par Allworthy.
Obligé de mener une vie errante en compagnie d'un maître d'école nommé Partridge, Tom va de tribulations en surprises. Sophie ne l'a pas oublié et, après avoir envoyé de l'argent à Tom, elle n'hésite pas à quitter le toit paternel. Un jour, elle entre dans une auberge où se trouve celui qu'elle aime. Mais Tom y conte fleurette à Miss Waters, une aventurière qu'il vient de sauver des brigands. Sophie s'enfuit en oubliant son mouchoir, unique trace de sa fugitive présence et de son désespoir.
Dès lors, l'intrigue se complique : Sophie demande asile à lady Bellaston, une cousine qui s'ingénie à lui faire épouser un certain lord Fellamar, gentilhomme aux mœurs plus que légères. Tom, s'étant mis à la recherche de Sophie, rencontre lady Bellaston et ne résiste pas à l'envie de lui faire la cour. Il finit par obtenir un rendez-vous nocturne et, nouveau rebondissement, trouve Sophie à la place de lady Bellaston qui arrive un peu plus tard– d'où une suite de scènes typiques de l'humour de Fielding.
Mais, pour avoir blessé quelqu'un alors qu'il était en état de légitime défense, Tom Jones est jeté en prison. Dépité et abandonné, il finira cependant par contrarier l'acharnement du destin : on découvre qu'il est le fils illégitime de la sœur d'Allworthy. Mais l'ignoble Blifil avait intercepté la lettre que celle-ci avait écrite à son frère juste avant de mourir.
Tom devient finalement l'héritier d'Allworthy et peut épouser Sophie : « Pour en finir, non seulement on ne pourrait trouver un homme et une femme plus estimables que cet amoureux couple, mais on n'en saurait imaginer de plus heureux.» Fielding, qui ne se targue pas de psychologie, fonde sa morale sur la bonté naturelle du cœur et aime particulièrement ces fins édifiantes...

The History of Tom Jones - BOOK I
chap. I. - "An author ought to consider himself, not as a gentleman who gives a private or eleemosynary treat, but rather as one who keeps a public ordinary, at which all persons are welcome for their money. In the former case, it is well known that the enter- tainer provides what fare he pleases; and though this should be very indifferent, and utterly disagreeable to the taste of his company, they must not find any fault; nay, on the contrary, good breeding forces them outwardly to approve and to com- mend whatever is set before them. Now the contrary of this happens to the master of an ordinary. Men who pay for what they eat will insist on gratifying their palates, however nice and whimsical these may prove; and if everything is not agreeable to their taste, will challenge a right to censure, to abuse, and to d — n their dinner without controul..."
Le narrateur débute son chapitre en se présentant comme un restaurateur, son travail comme un " festin ", le lecteur comme son client, et le type de cuisine qu'il peut servir n'est autre que la "nature humaine". Il a l'intention d'imiter la cuisine d'Héliogabale, un empereur romain qui initiait ses invités avec des plats simples, pour arriver lentement à des mets plus sophistiqués. Après avoir servi son plat simple de personnages de la campagne, le narrateur présentera au lecteur le "haut assaisonnement français et italien d'affection et de vice que les cours et les villes offrent".
BOOK I, Chapitre II-III - Dans l'ouest de l'Angleterre vit un gentleman retraité, M. Allworthy, de belle apparence et d'une santé robuste, un altruiste qui possède l'un des domaines les plus prospères du comté de Somersetshire. Cinq ans avant le début de l'histoire, la belle et vertueuse épouse d'Allworthy est décédée, suivie de leurs trois enfants, morts en bas âge. Allworthy, cependant, se considère toujours comme marié et vit avec sa sœur bien-aimée, Miss Bridget Allworthy, trente ans et toujours célibataire. Un jour, rentrant de voyage, il découvre chez lui, dans son lit, un petit garçon qu'il décide de garder et d'élever, et le confie à sa servante de toujours, Mme Deborah Wilkins. Au chapitre IV, Allworthy, après une promenade matinale à la mi-mai, dans sa propriété, au cours de laquelle il réfléchit à la noble question de savoir comment il peut "se rendre le plus agréable à son Créateur en faisant le plus de bien à ses Créatures", présente le petit garçon à Miss Bridget qui accepte de s'occuper de l'enfant. Chapitre VI et VII, une certaine Jenny Jones est soupçonnée d'être en fait la mère de l'enfant, Tom, et après un discours moralisateur, Allworthy accepte de garder l'enfant et de ne pas connaître son père. Chapitre X, une romance naît entre Miss Bridget et le le Dr Blifil qui a peu pratiqué mais accumulé une très petite fortune, mais ce bon docteur est déjà marié et propose à la jeune femme son frère, le capitaine Blifil, âgé de trente-cinq ans, bien bâti, au comportement rude mais "ni malsain, ni totalement dépourvu d'esprit".
"As Mr. Allworthy, therefore, had declared to the doctor that he never intended to take a second wife, as his sister was his nearest relation, and as the doctor had fished out that his in- tentions were to make any child of hers his heir, which indeed the law, without his interposition, would have done for him; the doctor and his brother thought it an act of benevolence to give being to a human creature, who would be so plentifully provided with the most essential means of happiness. The whole thoughts, therefore, of both the brothers were how to engage the afifections of this amiable lady. But fortune, who is a tender parent, and often doth more for her favourite offspring than either they deserve or wish, had been so industrious for the captainj that whilst he was laying schemes to execute his purpose, the lady conceived the same desires with himself, and was on her sid5 contriving how to give the captain proper encouragement, without appearing too for- ward ; for she was a strict observer of all rules of decorum. In this, however, she easily succeeded; for as the captain was always on the look-out, no glance, gesture, or word escaped him."
"M. Allworthy avait déclaré qu’il ne se remarierait jamais ; et , comme miss Bridget était sa plus proche parente, ce respectable gentilhomme avait encore confié au docteur, que son intention serait d’instituer pour ses héritiers les enfants de sa sœur, si elle en avait jamais : ce que la loi aurait fort bien fait sans qu’il s’en mêlât. Les deux frères regardèrent donc comme une œuvre méritoire de donner le jour à une créature humaine qui serait si abondamment pourvue de tout ce qui fait le bonheur. Aussi ne songèrent-ils plus qu'aux moyens de se concilier l'affection de cette aimable dame. Mais la fortune , cette tendre mère , qui fait souvent pour ses favoris plus qu’ils ne méritent ou qu’ils ne désirent , avait si bien travaillé en faveur du capitaine, que, pendant qu’il avisait aux moyens d’exécuter son projet , miss Bridget se livrait aux mêmes désirs que lui , cl cherchait de son côté une manière décente et convenable de l’encourager ; car elle observait strictement toutes les règles du décorum : elle y réussit aisément; le capitaine étant toujours aux aguets, aucun mot, aucun geste, aucun regard, ne lui échappait.
Chapitre XI, le capitaine Blifil s'éprend donc de Miss Bridget, qui le lui rend bien, mais aussi du domaine de M. Allworthy...
"The captain likewise very wisely preferred the more solid enjoyments he expected with this lady, to the fleeting charms of person. He was one 6f those wise men who regard beauty in the other sex as a very worthless and superficial qualificationor, to speak more truly, who rather chuse to possess every convenience of life with an ugly woman, than a handsome one without any of those conveniences. And having a very good appetite, and but little nicety, he fancied he should play his part very well at the matrimonial banquet, without the sauce of beauty."
"De même que sa maîtresse , le capitaine préférait à des charmes fugitifs les jouissances plus solides qu’il espérait goûter avec elle. C’était un de ces hommes de bon sens qui regardent la beauté d’une femme comme une qualité superficielle et ne méritant aucune attention, ou pour parler plus vrai, qui aiment mieux posséder tous les avantages de la vie avec une femme laide , qu’une belle femme sans ces avantages. Joignant à un grand appétit un goût peu délicat , il pensa qu’il remplirait fort bien son rôle au banquet conjugal sans l’assaisonnement de la beauté..."
Et M. Allworthy, après un discours de circonstance, donnera son consentement...
(Chap. XII) - "Dans toutes les circonstances, qu’il s’agisse de se battre , de se marier ou de toute autre affaire semblable, il ne faut que peu de cérémonies préalables pour mener les choses à terme , quand les deux parties le veulent sérieusement. C’était le cas présent, et, en moins d’un mois, le capitaine et miss Bridget furent mari et femme. Le grand embarras était d’apprendre cette nouvelle à M. Allworthy. Le docteur se chargea de ce soin.
Un jour donc que M. Allworthy se promenait dans son jardin, le docteur vint à sa rencontre et lui dit d’un air très- grave, et en donnant à ses traits une expression de tristesse et d'abattement :
— Je viens, Monsieur, vous faire part d’une nouvelle de la plus haute importance; mais comment vous dire une chose à laquelle je ne puis penser sans presque perdre la raison ?
— A cet exorde succédèrent les diatribes les plus amères contre les hommes et les femmes, accusant les uns de n’avoir en vue que leur intérêt, et les autres d’être tellement portées au vice, qu’on ne pouvait jamais les laisser en sûreté avec une personne de l’autre sexe.
— Aurais-je pu me douter, Monsieur, continua-t-il , qu’une dame pourvue de tant de prudence, de jugement et d’instruction, put s’abandonner à une passion aussi indiscrète? Aurais-je pu m’imaginer que mon propre frère — Mais pourquoi l’appeler ainsi? Il n’est plus mon frère.
— Mais il l’est, quoi que vous en disiez, dit M. Allworthy, et il est aussi le mien.
— Juste ciel! s’écria le docteur; vous savez donc cette affaire épouvantable ?
— Ecoutez-moi, docteur, répondit le digne homme, la maxime constante de toute ma vie a toujours été de prendre les choses du meilleur côté. (Quoique ma sœur soit plus jeune que moi de plusieurs années , elle a du moins atteint l’âge de discrétion. Si votre frère eût cherché à séduire un enfant , j’aurais eu plus de peine à lui pardonner; mais on doit supposer qu’une femme qui a passé trente ans sait ce qui peut la rendre heureuse. Elle a épousé un homme bien élevé, quoiqu’il ne soit peut-être pas son égal du côté de la fortune, et s’il possède à ses yeux quelques perfections qui puissent suppléer à ce qui lui manque à cet égard , je ne vois pas pourquoi je trouverais mauvais le choix qu’elle a fait pour assurer son propre bonheur; je ne pense pas plus qu’elle qu’il consiste uniquement dans la richesse. Après lui avoir déclaré bien des fois que je souscrirais à peu près à tous ses désirs, j’aurais pu m’attendre à être consulté en cette circonstance ; mais de pareils sujets sont d’une nature fort délicate , et peut-être n’a-t-elle pu vaincre les scrupules de la modestie, (pliant à votre frère, il n’a point à craindre mon ressentiment; il ne me devait rien , et je ne crois pas qu’il fût dans la nécessité de me demander mon consentement, puisque, comme je l’ai déjà dit , la femme qu’il a choisie est sui juris, et d’un âge à ne répondre de sa conduite qu’à elle-même.
Le docteur reprocha à M. Allworthy sa trop grande indulgence, répéta ses déclamations contre son frère, et déclara que rien ne pourrait jamais le décider soit à le revoir, soit à le reconnaître pour son parent. Il entreprit ensuite un long panégyrique de la bonté de M. Allworthy, lui protesta hautement qu’il attachait le plus grand prix à sou amitié, et finit par dire qu’il ne pardonnerait jamais à son frère de lui avoir fait courir le risque de la perdre.
— Si la conduite de votre frère m’avait inspiré du ressentiment, répondit Allworthy, je ne le ferais pas retomber sur celui qui n’est pas coupable; mais je vous assure que je ne suis nullement indisposé contre lui. Votre frère me paraît un homme de bon sens et d’honneur. Je ne blâme pas le goût de ma sœur, et je ne doute pas qu’elle ne soit aussi l’objet de son inclination. J’ai toujours pensé que l’amour était la seule base du bonheur dans le mariage , car seul il peut produire celte vive et tendre amitié qui doit toujours être le ciment d’une telle union. A mon avis, tous les mariages contractés par d’autres motifs sont très criminels. C’est une profanation de l’acte le plus solennel , et la misère et les remords viennent tôt ou tard en expiation de ce sacrilège. Car n’est-ce pas un sacrilège odieux que de faire de cette institution sacrée un sacrifice à la débauche et à la cupidité ? Et peut-on caractériser autrement ces mariages auxquels nous détermine l’appât de la fortune ou de la beauté? Contestera la beauté le pouvoir de flatter agréablement la vue, d’inspirer même quelque admiration, ce serait mensonge et folie. Beau est une épithète souvent employée dans les saintes Ecritures , et toujours dans un sens honorable. Moi-même j’eus assez de bonheur pour épouser une femme que le monde trouvait belle, et, je l’avoue sans rougir, je ne l’en aimais que mieux. Mais, ne rechercher que la beauté dans le mariage, en être à ce point aveuglé qu’on n’aperçoive aucunes imperfections morales, ou la convoiter d’une manière assez absolue pour dédaigner la religion, la vertu et le bon sens, qui sont, par leur nature, des qualités plus essentielles que les agréments de la physionomie, voilà une conduite incompatible avec les devoirs d’un homme sage et d’un chrétien ; c’est peut-être se montrer trop charitable que de conclure que de telles personnes n’ont, en se mariant, d’autre but que de se procurer des jouissances physiques , dont l’institution du mariage n’a pas été le but.
— Quant à la fortune , la prudence exige sans doute qu'on la prenne en considération , et je ne condamnerai pas cette précaution d’une manière positive et absolue. Dans l’état actuel de la société , les dépenses occasionnées par le mariage , et les soins que nous devons donner à nos enfants, nous font une loi de ne pas négliger entièrement la question d’argent. Mais la folie et la vanité portent ces dépenses bien au-delà du nécessaire; elles créent infiniment plus de besoins que la nature. Un équipage pour la femme et une dot considérable pour les enfants sont inscrits par l’usage au nombre des objets de première nécessité , et pour se les procurer, on néglige, on oublie tout ce qui est véritablement bon et solide, la vertu et la religion. Je veux parler ici de ces hommes qui, triomphant même de leur répugnance , épousent des femmes sans esprit et sans moralité, afin d’accroître une fortune déjà plus que suffisante pour payer tous leurs plaisirs. De tels hommes , pour ne pas être accusés de démence, doivent convenir ou qu’ils sont incapables de sentir les douceurs de l’amour, ou qu’ils sacrifient le plus grand bonheur qu’ils puissent jamais goûter aux lois vaines et ridicules d’une absurde opinion qui tire de la folie son origine et sa force.
Allworthy termina ici son sermon. Le docteur l’avait écouté avec la plus profonde attention, quoiqu’il eût eu quelquefois fie la peine à déguiser l’altération des traits de son visage. Il fit cependant l’éloge de chaque période qu’il venait d’entendre , avec la chaleur d’un jeune théologien qui a l’honneur de dîner chez un évêque le jour même où Son Eminence est montée en chaire."..
Et chapitre XIII, dès lors que le capitaine posséda Miss Bridget et son argent, tout le monde remarqua combien il traitait désormais son frère avec le plus grand dédain.
Ayant planté le premier décor et ses personnages de fond, Fielding nous entraîne dès lors dans une toute autre étape de son "Histoire"...

The History of Tom Jones - Book II
- "... as I am, in reality, the founder of a new province of writing, so I am at liberty to make what laws I please therein", Fieilding revendique ici son autonomie d'écrivain pleine et entière, mais non parler pour parler de lui mais pour mieux relayer et traduire leur existence.
Huit mois après le mariage de Miss Bridget et du capitaine Blifil, Miss Bridget a donné naissance à un garçon, un héritier, mais une naissance qui ne vient pas diminuer pour autant toute l'affection que M. Allworthy témoigne à l'enfant qu'il a recueilli et qu'il a appelé Thomas, comme lui. Allworthy exige de plus que les deux garçons soient élevés ensemble. Le véritable visage des uns et des autres commence à se révéler. Au chapitre III, le narrateur nous explique l'histoire de la mère de Tom, Jenny Jones, et du maître d'école, M. Partridge, bien que celui-ci soit déjà marié, que Mme Partridge avait tout fait pour sélectionner les servantes les moins attirantes. En fait la situation est plus compliquée que cela, Jenny, chassée, protestera de son innocence, M. Partridge se satisfera de ce départ se sentant de plus en plus intellectuellement dépassé par Jenny et pour gagner les faveurs de sa femme lui fera l'amour. Le chapitre IV nous laissera une scène de ménage très particulière entre Mme Partridge et son mari, toujours soupçonné d'adultère, en pleine boutique d'épicier...
On a toujours trouvé un grand plaisir à connaître et à commenter les actions d’autrui. Aussi , à toutes les époques, chez tous les peuples, y a-t-il eu des lieux de rendez-vous publics où les citoyens se rencontrant trouvaient de quoi satisfaire leur curiosité. Entre autres lieux de réunion , les boutiques de barbier jouirent toujours d’une prééminence méritée. Chez les Grecs, des nouvelles de barbier était une expression proverbiale , et Horace, dans une de ses épitres, accorde, sous ce rapport, une mention honorable aux barbiers de Rome. On sait que ceux d’Angleterre ne le cèdent en rien à leurs devanciers grecs ou romains. On discute dans leurs boutiques les affaires étrangères presque aussi bien que dans les cafés ; et les événements domestiques s’y traitent beaucoup plus à fond et plus librement ; mais ces sortes de boutiques sont exclusivement pour les hommes. Or , comme les femmes de ce pays , particulièrement celles des basses classes , ont des rapports beaucoup plus fréquents entre elles que celles des autres nations, nos institutions publiques seraient en défaut , si on ne leur avait pas aussi ménagé quelque endroit pour se livrer aux jouissances d’une curiosité qui égale pour le moins celle de l’autre moitié de l’espèce humaine. Grâce à cette attention , les belles d’Angleterre doivent se regarder comme les plus heureuses de toutes les femmes , car je ne me souviens pas d’avoir lu dans l’histoire , ou d’avoir vu dans mes voyages , quelque chose de semblable. Ce lieu de rendez-vous n’est autre que la boutique de l'épicier, entrepôt bien connu de toutes les nouvelles , ou , comme on le dit communément . de tout le commérage de chaque paroisse d’Angleterre.
Un jour que mistress Partridge se trouvait à cette réunion de femmes , une de ses voisines lui demanda si elle avait entendu parler depuis peu de Jenny Jones. La femme du maître d’école lui répondit que non. Sur quoi l’autre lui répliqua en souriant que la paroisse lui avait beaucoup d'obligation d’avoir chassé Jenny.
Mistress Partridge , dont la jalousie, comme le lecteur le sait déjà , était guérie depuis longtemps , et qui n’avait point d’autre grief contre son ancienne servante, répondit qu’elle ne savait pas pourquoi la paroisse pouvait lui en avoir quelque obligation , car elle pensait que Jenny n’avait pas laissé sa pareille. - Vraiment, dit la commère, je l’espère bien, quoique nous ayons chez nous assez de filles dégourdies; vous ne saviez donc pas qu’elle était accouchée de deux bâtards ; mais comme ils ne sont pas nés dans la paroisse, mon mari et l’autre administrateur des pauvres disent que nous ne serons pas obligés de les nourrir.
- Deux bâtards! s’écria vivement mistress Partridge; vous me surprenez. Je ne sais si la paroisse sera obligée de les nourrir ; mais ce dont je suis sûre , c’est qu’ils y ont été faits , car il n’y a pas neuf mois que la coquine en est partie.
Rien de si prompt , rien de si soudain que les opérations de l’esprit surtout quand il est en proie à la jalousie , avec son cortège ordinaire, l’espérance et la crainte. Mistress Partridge se souvint aussitôt que Jenny ne sortait presque jamais de la maison pendant tout le temps qu’elle avait été à son service. Son mari penché sur sa chaise , Jenny se levant tout émue, les mots latins , le sourire , mille autres circonstances s’offrent en même temps à sa mémoire. La satisfaction que M. Partridge avait montrée du départ de Jenny lui parut à la fois feinte et sincère, alors même elle confirma sa jalousie, car elle l'attribua à la satiété et à toute autre cause non moins condamnable; en un mot, elle fut convaincue du crime de son mari, et elle quitta sur-le-champ l’assemblée , toute confuse...
"..Nothing can be so quick and sudden as the operations of the mind, especially when hope, or fear, or jealousy, to which the two others are but journeymen, set it to work. It occurred instantly to her, that Jenny had scarce ever been out of her own house while she lived 'with her. The leaning over the chair, the sudden starting up, the Latin, the smile, and many other things, rushed upon her all at once. The satisfaction her hus- band expressed in the departure of Jenny, appeared now to be only dissembled ; again, in the same instant, to be real ; but yet to confirm her jealousy, proceeding from satiety, and a hundred other bad causes. In a word, she was convinced of her husband's guilt, and immediately left the assembly in confusion..."
...Comme une jeune chatte, qui n'a pas dégénéré des branches aînées de sa race , inférieure en force mais égale en cruauté au tigre royal lui-même , quand la souris qu’elle a longtemps tourmentée en jouant, s'est échappée de ses griffes, s’irrite, gronde, frémit et jure ; mais si l’on enlève la boite ou le coffre derrière lequel la souris se cache , elle tombe sur sa proie comme un éclair, mord, égratigne, mutile , déchire le faible animal ; telle et non moins furieuse , mistress Partridge se jette sur le pauvre pédagogue : ses injures, ses dents, ses mains, tombent à la fois sur lui ; en un instant sa perruque est arrachée, sa chemise déchirée ; et cinq ruisseaux de sang qui coulent de son visage attestent le nombre de griffes dont la nature a malheureusement armé son ennemie.
M. Partridge se borna quelque temps à lu défensive, ne cherchant qu’à se garantir la figure avec les mains ; mais quand il vit que la fureur de son antagoniste ne perdait rien de sa violence , il crut qu’il pouvait du moins chercher à la désarmer, c’est-à-dire à lui tenir les bras.
Dans cette lutte, le bonnet de mistress Partridge tomba, ses cheveux, trop courts pour atteindre ses épaules, se dressèrent sur sa tète, le faible ruban qui attachait son corset se rompit , et sa gorge volumineuse prit une direction contraire à celle de ses cheveux : son visage était teint du sang de son mari , ses dents grinçaient de rage , et le l'eu lui sortait des yeux comme les étincelles qu’on voit jaillir de la fournaise d’un forgeron ; en sorte que cette amazone aurait pu terrifier un homme plus hardi que M. Partridge.
"Mr. Partridge acted for some time on the defensive only; indeed he attempted only to guard his face with his hands; but as he found that his antagonist abated nothing of her rage, he thought he might, at least, endeavour to disarm her, or rather to confine her arms; in doing which her cap fell off in the struggle, and her hair being too short to reach her shoulders, erected itself on her head ; her stays likewise, which were laced through one single hole at the bottom, burst open; and her breasts, which were much more redundant than her hair, hung down below her middle ; her face was likewise marked with the blood of her husband: her teeth gnashed with rage; and fire, such as sparkles from a smith’s forge, darted from her eyes. So that, altogether, this Amazonian heroine might have been an object of terror to a much bolder man than Mr. Partridge."
Il eut enfin le bonheur, en s’emparant de ses bras, de rendre inutiles les armes qu’elle portait au bout des doigts. Dès qu’elle s’en aperçut, la douceur de son sexe l’emporta sur la colère , elle fondit en larmes, et finit par s’évanouir. Le peu de présence d’esprit que M. Partridge avait conservé durant cette scène horrible dont la cause lui était inconnue , l’abandonna alors tout à fait. Il se précipita dans la rue , criant à tue-tête que sa femme était à l’agonie , et conjurant ses voisines de venir à son secours en toute hâte. Quelques femmes accoururent à ses cris , entrèrent dans sa maison, employèrent les remèdes usités en pareil cas , et enfin mistress Partridge , à la grande joie de son mari , revint à elle.
Dès qu’elle eut repris l’usage de ses sens , et qu’elle se fut un peu restaurée avec un cordial , elle raconta à la compagnie combien elle avait sujet de se plaindre de son mari , qui ne s’était pas contenté , dit-elle , de violer la foi conjugale; mais quand elle lui avait adressé de justes reproches, il l’avait traitée avec toute la cruauté possible, lui avait arraché son bonnet , et même ses cheveux , déchiré son corset et donné des coups dont elle porterait les marques jusqu’au tombeau.
Le pauvre homme, qui avait lui-même sur la figure des preuves visibles et multipliées de la colère de sa femme, demeura stupéfait à cette accusation qui, j’en appelle au témoignage du lecteur, n’avait rien de fondé , car il ne l’avait pas frappée une seule fois. Mais ce silence fut interprété par toute la cour comme un aveu du fait , et toutes les commères se mirent, un à voce, à l’accabler de reproches et d’injures, s’écriant qu’il n’y avait qu’un lâche qui pût frapper une femme...."
Dès lors la culpabilité et la paternité de Mr. Partridge devient source de bien des conflits et de rumeur, tandis que le mariage du capitaine Blifil et de Bridget commence à tourner à la haine, alimenté par l'affection d'Allworthy pour Tom qui ne cesse de croître. Mais voici que le capitaine Blifil meurt d'apoplexie (chapitre IX). C'est alors que Fielding nous révèle l'un des moteurs de l'intrigue, l'innocence et incapacité d'Allworthy à déceler les machinations qu'ourdissent bien des intrigants à l'ombre de sa fortune...

The History of Tom Jones - Book III -
Peu de chose ou rien, Fielding introduit toujours ses histoires le plus singulièrement du monde : "The reader will be pleased to remember, that, at the beginning of the second book of this history, we gave him a hint of our intention to pass over several large periods of time, in which nothing happened worthy of being recorded in a chronicle of this kind.
In so doing, we do not only consult our own dignity and ease, but the good and advantage of the reader: for besides that by these means we prevent him from throwing away his time, in reading without either pleasure or emolument, we give him, at all such seasons, an opportunity of employing that wonderful sagacity, of which he is master, by filling up these vacant spaces of time with his own conjectures; for which purpose we have taken care to qualify him in the preceding pages.
For instance, what reader but knows that Mr. Allworthy felt, at first, for the loss of his friend, those emotions of grief, which on such occasions enter into all men whose hearts are not com- oosed of flint, or their heads of as solid materials ? ..."
C'est au chapitre II que Tom nous est enfin présenté, et bien singulièrement, par ses nombreux défauts, dont le principal est sa passion pour le vol, tandis que le fils du défunt capitaine Blifil, Maître Blifil abonde en "vertus" et aussi loué par le voisinage que Tom est méprisé. Deux personnages entrent en scène, Square, un philosophe qui vit avec Allworthy et s'intéressera particulièrement à la fougueuse Molly Seagrim, Thwackum, le précepteur, particulièrement retors, de Blifil et Tom, qui bat constamment Tom et fait l'éloge de Blifil. La question de la religion et du péché originel est l'un des grands débats de Square et de Thwackum, auquel participe le narrateur. Chapitre VII, alors que Tom grandit, il va rejoindre dans le coeur de Bridget les deux autres prétendants qui l'assiègent, Square et Thwackum. Ce livre III voit donc la maturation du héros du roman, Tom Jones, de quatorze à dix-neuf ans, en opposition avec Maître Blifil, sans se prononcer véritablement sur les supposées vices ou vertus de l'un ou de l'autre.

The History of Tom Jones - Book IV -
La vérité distinguera, j’espère, nos ouvrages de ces romans remplis d’extravagances, produit de cerveaux dérangés, et qu'un critique habile recommande d’envoyer à l’épicier, "As truth distinguishes our writings from those idle romances which are filled with monsters, the productions, not of nature, but of distempered brains; and which have been therefore recommended by an eminent critic to the sole use of the pastry- cook ; so, on the other hand, we would avoid any resemblance to that kind of history which a celebrated poet seems to think is no less calculated for the emolument of the brewer, as the reading it should be always attended with a tankard of good ale ..." -
Un nouveau personnage entre en scène, Mlle Sophia Western, la fille du brutal Squire Western, et dans un premier temps, le narrateur se refuse à nous dresser son portrait, "most of all, she resembled one whose Image never can depart from my Breast, and whom if thou dost remember, thou hast then, my Friend, an adequate Idea of Sophia". La belle et généreuse héroïne de Fielding, à dix-huit ans, aime son père plus que tout autre être vivant, et a quelque penchant pour Tom plus que pour Blifil et furent tous trois compagnons de jeu lorsqu'ils étaient enfants. Chapitre V, Sophia se rend compte que Tom n'a d'autre ennemi au monde que lui-même, tandis que Blifil a peu d'ennemis mais n'aime que lui-même. Revenue auprès de son après avoir vécu et étudié chez sa tante pendant plus de trois ans, elle entend bien des histoires, celle du garde-forestier Black George et de la perdrix, Tom a maintenant vingt ans, et a acquis la réputation d'être un "bien joli compagnon" auprès de toutes les dames du quartier, aussi Sophia commence-t-elle à s'intéresser au jeune homme, mais Tom est trop jeune pour le remarquer, et Squire Western est trop absorbé par ses animaux et ses sports. Et sans se douter de rien, le Squire Western permet ainsi à Tom et Sophia de passer beaucoup de temps seuls ensemble. Mais le chapitre VI nous apprend que Tom apprécie particulièrement la deuxième aîné des cinq enfants de Black George, Molly Seagrim, l'une des plus belles filles du pays...
" Molly, comme nous l’avons dit, passait généralement pour une fort belle fille : elle l’était véritablement ; mais sa beauté n'était pas du genre le plus aimable. Elle n’avait presque rien de féminin, et aurait convenu à un homme tout aussi bien qu’à une femme. Pour tout dire, la fleur de la jeunesse et la force de la santé faisaient en grande partie la beauté de Molly. Son moral tenait aussi peu de son sexe que son physique ; car si elle était grande et robuste, ses manières étaient libres et hardies; elle avait si peu de modestie que Tom avait pour sa vertu plus d'égards qu’elle-même. Comme elle aimait probablement notre héros autant qu’elle en était aimée , elle ne craignit pas de faire les avances dès qu’elle s’aperçut de ses scrupules, et voyant qu’il avait entièrement cessé de venir chez son père, elle trouva le moyen de se jeter sur son passage, et se comporta de telle sorte qu’il eût fallu que notre jeune homme fût le plus grand des héros pour que ses manœuvres restassent sans succès. En un mot , elle triompha bientôt de toutes les résolutions vertueuses de Tom Jones. A la fin , il est vrai , elle opposa toute la résistance convenable ; mais je ne lui en attribue pas moins les honneurs du triomphe, puisque ce fut son plan qui réussit.
Au total, Molly joua si bien son rôle dans toute cette affaire, que Jones s’attribua la victoire , et se persuada que la jeune fille avait cédé aux attaques violentes de la passion qu’il avait pour elle , et à la force irrésistible de l’amour qu'elle éprouvait pour lui. Le lecteur conviendra que cette dernière supposition n’avait rien qui ne fût naturel et probable, s’il n'a point oublié ce que nous lui avons dit de la beauté peu commune de Tom : c’était, dans le fait, un charmant cavalier.
Il existe des hommes, comme maître Blifil, qui n’éprouvant d’affection que pour une seule personne , ne considèrent que son intérêt et ses plaisirs, et ne s’inquiètent du bien et du mal qui arrivent aux autres, qu’autant que cette personne peut en retirer avantage ou satisfaction : il en est d’autres heureusement qui trouvent dans l’intérêt personnel une source de vertu. Ils ne ressentent aucun plaisir sans aimer ceux auxquels ils le doivent, et sans se faire un besoin de leur bonheur.
Notre héros était de ce nombre. Il regardait cette pauvre Molly comme un être dont le bonheur ou le malheur dépendait de lui seul. Sa beauté était encore l’objet de ses désirs; mais une beauté nouvelle et parfaite les eût sans doute excités davantage; si la jouissance avait refroidi son ardeur, ce refroidissement était plus que compensé par l’affection qu’elle paraissait avoir pour lui et la situation où il l’avait mise, ce qui fit naître en son cœur la reconnaissance et la compassion. Ces deux sentiments, joints aux désirs qu’elle lui inspirait , entretenaient chez lui une passion qu’on pouvait nommer amour : je ne sais toutefois si , dans l’origine, ce mot eût pu trouver sa place.
Telle était la véritable raison de l'insensibilité de Jones pour les charmes de Sophie, et pour des prévenances qu’il aurai! pu avec assez de raison interpréter comme un encouragement. S’il ne pouvait abandonner Molly, pauvre et sans ressources, il pouvait encore moins concevoir l’idée de trahir une personne telle que Sophie. En se livrant à la passion que cette jeune personne était faite pour inspirer, il se serait rendu coupable de l'un ou de l’autre de ces deux crimes, et digne, par conséquent, du destin qui lui avait été prédit , comme je l’ai rapporté au commencement de cette histoire." (chapitre VI).
Il cède donc, et Mme Seagrim sera la première à remarquer que Molly est enceinte. Tom assume et empêche Allworthy d'envoyer Molly en prison en admettant qu'il est le père de l'enfant...

The History of Tom Jones - Book V -
Fielding fonde ce qu'il appelle l' "écriture prosaï-comi-épique" (prosai-comi-epic writing), "peradventure there may be no parts in this prodigious work which will give the reader less pleasure in the perusing, than those which have given the author the greatest pains in composing", et ses chapitres d'introduction sont destinés à fournir un contraste, dans leur sérieux, ils savent ainsi attirent le lecteur vers les passages les plus comiques.
Le Chapitre II s'ouvre sur Tom et Squire Western écoutant Sophia jouer du clavecin, Tom a le bras cassé après avoir sauvé Sophia d'une chute de cheval. Et voici qu'au fil de ces chapitres, Tom, d'abord insensible aux charmes et à la beauté de Sophia, va tomber profondément amoureux d'elle et commence à éprouver du ressentiment à l'égard de ses liens avec Molly. Pourtant, reste-t-il avec Molly par honneur. L'engagement de Tom envers Molly prend fin lorsqu'il découvre qu'elle a eu des liaisons, dont Square qu'il découvre dans sa chambre, ce qui signifie que Tom n'est pas le père de son enfant et le libère pour qu'il avoue ses sentiments à Sophia. Le chapitre VII nous relate la maladie d'Allworthy, le voici prononçant un long discours sur le caractère inévitable de la mort et exposant le contenu de son testament, l'ensemble des biens iront à Blifil, et une petite somme de 500 livres par an sera réservée à Tom. Seuls Mme Wilkins, Thwackum et Square ne se montrent gère satisfaits de leur héritage. Mais miracle, Allworthy guérit soudainement. Par contre est bien annoncée la mort de Bridget, la soeur d'Allworthy. La maladie d'Allworthy et la réaction des autres personnages à cette maladie constituera le cœur du livre V, tout comme l'amour naissant de Tom pour Sophia.

The History of Tom Jones - Book VI -
"In our last book we have been obliged to deal pretty much with the passion of love ; and in our succeeding book shall be forced to handle this subject still more largely...", et le narrateur nous précise ce qu'il retenu de l'amour, premièrement, il existe des esprits qui ne connaissent pas l'amour, deuxièmement, l'amour ne peut pas être gouverné par la luxure, troisièmement, l'amour recherche l'auto-satisfaction, et enfin, lorsque l'amour agit envers une personne du sexe opposé, il fait appel à la luxure pour l'entretenir. Le narrateur pense de plus qu'il existe de nombreuses personnes qui aiment donner du bonheur aux autres et que c'est la forme la plus élevée de l'amour.
De retour chez Western, tout le monde célèbre la guérison d'Allworthy, à l'exception de Sophia, et Mme Western a devinée que celle-ci est tombée amoureuse, mais pense-t-elle, à tort, de M. Blifil. Western est furieux mais donne son approbation du Squire tout en craignant un refus d'Allworthy. Celui-ci propose donc ce mariage à Blifil, qui avoue qu'il n'a pas envisagé une seule fois d'épouser Sophia. Ses appétits, confie le narrateur, sont si modérés qu'ils peuvent facilement être supplantés par la philosophie ou l'étude. Mais il n'est pas insensible à la fortune de Sophia. Allworthy et Western, par lettre, décident d'organiser une rencontre amoureuse pour les supposés jeunes amoureux. Sophia ne révèle toujours pas sa passion pour Tom tandis que Blifil et Western semblent penser que l'affaire est conclue. Voyant que son père est si heureux, Sophia décide que c'est le meilleur moment pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Confirmant d'abord que son père "place toute sa joie dans le bonheur de sa Sophia", Sophia le supplie de ne pas la forcer à épouser un homme qu'elle méprise totalement. M. Western accuse Sophia et menace de la chasser de la maison. Il accepte de laisser Tom essayer de faire entendre raison à la jeune fille.
Le chapitre VIII est au coeur de la tourmente. Sophia tremble de peur lorsque Tom apparaît dans sa chambre. Tom se plaint d'avoir été envoyé par M. Western pour faire l'éloge de Blifil auprès de Sophia. Il lui déclare son amour pour elle et laisse entendre qu'il espère en avoir en retour. Sophia, cependant, l'avertit des terribles répercussions qu'entraînerait le fait de contrarier son père. Ce sera la ruine de Tom, et donc d'elle-même. Tom dit qu'il ne craint rien d'autre que de perdre Sophia....
- Mon père vous a envoyé près de moi ! répéta-t-elle. Quel songe vous abuse ?
- Plût au ciel que ce ne fût qu’un songe ! Oui , Sophie , votre père m’a envoyé ici pour plaider la cause de mon odieux rival, pour vous solliciter en sa faveur. J’aurais saisi tous les moyens d’arriver jusqu’à vous. Oh ! parlez-moi , Sophie ! Guérissez les blessures d’un cœur brisé. Jamais amour ne fut égal au mien. N’ayez pas la cruauté de me retirer cette main si douce , cette main si chère. Bientôt, peut-être, vous nous serez arrachée pour toujours. Il ne fallait , je crois , rien moins que cette. cruelle occasion pour me faire oublier le respect que vous m’avez inspiré.
Elle rougit et garda un moment le silence; puis, levant sur Jones un œil timide , elle s’écria : - Eh , monsieur que voulez-vous que je vous dise ?
— Oh ! promettez-moi seulement de ne vous donner jamais à Blifil?
— Ne prononcez pas ce nom détesté ! soyez sûr que je ne lui donnerai rien de ce qu’il est en mon pouvoir de lui refuser.
— Puisque vous êtes si généreuse, de grâce, dites un mot encore; ajoutez que je puis espérer — Hélas, monsieur Jones ! où voulez-vous en venir? Quelle espérance puis-je vous donner ? Vous connaissez les intentions de mon père.
— Mais je sais aussi qu’il ne peut vous forcer à vous y soumettre.
— Et quelles seraient les suites de ma désobéissance? Ma propre ruine est ce qui m'inquiète le moins; mais je ne puis supporter l'idée de causer le malheur de mon père.
— C’est lui-même qui en est la cause, s’écria Jones, en exerçant sur vous un pouvoir que la nature ne lut a pas donné. Pensez à tout ce que j'aurai moi-même à souffrir, si je dois vous perdre, et voyez de quel côté la pitié doit faire pencher la balance.
— Que j’y pense ! reprit Sophie ; pouvez-vous imaginer que je sois assez aveugle pour ne pas voir que je ferais aussi votre malheur si je cédais à vos désirs ? C’est cette pensée qui me donne la force de vous conjurer de me fuir pour toujours, et de ne pas courir à votre perte.
— Je ne crains que de perdre Sophie. Si vous voulez m’épargner les tourments les plus affreux , révoquez cette sentence cruelle. Non, je ne vous quitterai jamais, non : cet effort m’est impossible.
Les deux amans, tremblants tous deux , gardèrent alors un profond silence ; Sophie hors d’état de retirer la main que Jones tenait toujours, et Jones presque aussi incapable de la retenir dans ln sienne.
Mais cette scène, que quelques lecteurs trouvent peut-être assez longue, fut interrompue par une autre d’un genre si différent , que nous la réserverons peur un autre chapitre...."
(The lovers now stood both silent and trembling, Sophia being unable to withdraw her hand from Jones, and he almost as unable to hold it; when the scene, which I believe some of my readers will think had lasted long enough, was interrupted by one of so different a nature, that we shall reserve the relation of it for a different chapter)...
Chapitres IX-X, Mme Western divulgue le secret de Sophia au Squire Western, qui ne peut pas comprendre que Sophia tombe amoureuse d'un bâtard et homme pauvre : les mariages basés sur la fortune sont courants à l'époque de Fielding, et sont tolérés à la fois par Mme Western et par M. Allworthy. Et la piété filiale de Sophia renforce cette contrainte sociale. Chapitre XI, Allworthy en fin de compte à changer d'attitude, gagné par la mauvaise foi de tous les protagonistes qui se liguent contre Tom. Le bannissement de celui-ci à la fin du livre VI préfigure un changement dans le milieu de l'histoire, qui passe de la description statique de deux ménages campagnards à l'environnement en constante évolution qu'apportent les voyages. Chapitre XII, Tom reçoit en retour une lettre de Sophia, qui lui promet qu'elle n'épousera personne d'autre. Tom lit et embrasse la lettre cent fois, puis quitte le domaine, tandis qu'au Chapitre XIV, Mme Western réprimande son frère pour avoir incarcéré Sophia...
Les préoccupations de Fielding semblent s'élargir dans le livre VI, comme en témoignent ses fréquentes références aux conflits politiques de l'époque. Le personnage de Western est une satire du gentilhomme campagnard conservateur qui s'oppose au nouveau gouvernement hanovrien dirigé par le roi George II. Au chapitre II, Squire Western lit le London Evening-Post, un journal tory qui critique le gouvernement whig, et que Fielding a critiqué dans certains de ses autres écrits. Mrs. Western est la "femme de la ville" typique, Squire Western est le "campagnard" typique - faisant de ce couple une caricature de la rivalité entre la ville et la campagne qui prévalait à l'époque de Fielding. Leurs interactions donnent également un aperçu de la relation entre les hommes et les femmes de l'époque. Le Squire affirme que "les jupons ne devraient pas se mêler" des affaires politiques, tandis que Mrs. Western prétend avoir un "mépris souverain" pour le sexe masculin. Au chapitre XIV, elle remarque : "Les femmes anglaises, mon frère, je remercie le ciel, ne sont pas des esclaves. Nous ne devons pas être enfermées comme les épouses espagnoles et italiennes. Nous avons autant de droit à la liberté que vous." La tension entre les méthodes violentes du Squire à l'égard de Sophia et les conversations douces et diplomatiques de Mme Western avec sa nièce deviendra un point de discorde tout au long du roman.

The History of Tom Jones - Book VII
- Chapitre I - Le narrateur expose l'analogie entre le monde et la scène, "le monde a été souvent comparé à un théâtre ; de grands écrivains et des poètes ont considéré la vie humaine comme un grand drame, semblable, jusque dans ses moindres détails, à ces représentations théâtrales dont Thespis fut, dit- on, l’inventeur, et qu’ont accueillies les applaudissements de tous les peuples civilisés. Cette comparaison a été poussée si loin , elle est devenue si générale, que quelques expression» propres au théâtre, et dans le principe appliquées au monde par métaphore , sont employées de nos jours indifféremment et dans le sens littéral, pour tous deux.". Le récit se transforme en un récit d'aventure. Tom est sur la route et va devoir affronter de nombreux obstacles qui nécessiteront un héroïsme plus manifeste pour les surmonter. Aux teintes pastorales des premiers Livres succèdent des maisons publiques et des soldats, et ce changement se poursuivra pendant la majeure partie du roman. Le monde auquel Tom est confronté est beaucoup plus vaste, et Fielding a donc encore plus d'occasions d'explorer les différents niveaux de la nature humaine.
Alors que Squire Western rumine sa propre expérience du mariage et qu'avec sa sœur ils font tous deux pression sur Sophia, celle-ci est prête à tout pour échapper à ce mariage.
(chapitre IX) " Ces transports d’amour paternel produisirent une profonde impression sur le cœur aimant de Sophie ; il lui vint une pensée que ni les sophismes de sa tante, ni les menaces de son père n’avaient pu faire naître dans son esprit. Elle avait pour M. Western un respect si pieux, un attachement si passionné , qu’elle n’avait jamais goûté de plus grand plaisir que de contribuer à son amusement , de lui procurer même une jouissance plus vive et plus fréquente encore, celle d’entendre faire l’éloge de sa fille. Elle ne put se défendre d’une vive émotion à l’idée du bonheur que causerait à son père son consentement au mariage qu’il lui proposait. Elevée dans des sentiments de religion, elle trouvait une sorte de piété dans le dévouement qu’exigeait un tel acte d'obéissance. Enfin quand elle vint à réfléchir à ce que lui coûte- rait de peine le sacrifice qu’elle ferait à l’amour filial et à son devoir, elle sentit en elle le doux frémissement de certaine petite passion qui , sans avoir une affinité directe avec la religion et la vertu , est quelquefois assez obligeante pour se prêter à l’exécution de leurs desseins.
Charmée de l’action héroïque qu’elle méditait, Sophie se félicitait déjà de son courage lorsque Cupidon , qui se tenait caché dans son manchon , apparut tout-à-coup, et comme Polichinelle sur le théâtre des marionnettes , balaya tout devant lui. Dans le fait (nous ne voulons ni tromper nos lecteurs , ni relever le caractère de notre héroïne en attribuant ses actions à un pouvoir surnaturel ) , l'image de son cher Jones , et quelques espérances éloignées dont il était l’objet , détruisirent en un instant l’édifice que la tendresse filiale, la piété et l’amour-propre réunis avaient si pénible- ment construit. Mais avant d’aller plus loin avec Sophie, il faut retourner à Jones..."
Pendant ce temps, Tom Jones, en route vers les mers, s'égare sur la route de Bristol, décide de passer la nuit dans une auberge, rencontre un quaker, qui pleure le mariage récent de sa fille avec un homme pauvre. Mais lorsque le propriétaire entend que Tom est un bâtard, il lui refuse une chambre car il n'est pas un gentleman. Mais arrive un groupe de soldats arrive et Tom propose de payer leur note et de voyager avec eux. Il est invité à dîner avec le lieutenant et ses officiers, se bat avec Northerton, un enseigne grandiloquent et mal éduqué, qui parvient à s'enfuir. L'influence corruptrice de l'argent est dans toutes ces pages une constante.

The History of Tom Jones - Book VIII -
"Nous commençons un livre où , pour suivre le cours de notre histoire , nous serons obligés de raconter des évènements plus étranges et plus surprenants que tous ceux qui se sont présentés jusqu'ici. Il n’est donc pas hors de propos, dans ce chapitre servant de prolégomènes ou d’introduction, de dire quelques mots de ce qu’on appelle le merveilleux. C’est un genre dont nous voudrions fixer les limites dans notre intérêt comme dans celui des autres." Fielding estime donc non seulement qu'un écrivain doit défier les attentes du lecteur afin de maintenir son attention, mais qu'il se doit d'élargir la compréhension du public en "montrant de nombreuses personnes et choses qui n'auraient peut-être jamais été connues d'une grande partie de ses lecteurs".
Le livre VIII retrace le voyage de Tom de Bristol à Gloucester, et témoigne du début de sa relation avec Partridge, qui devient son domestique. L'abondance de personnages et de scènes introduits dans ce chapitre est encore compliquée par le fait que Partridge, lorsqu'il rencontre Jones pour la première fois, vit sous le pseudonyme de "petit Benjamin". Fielding utilise ce stratagème d'enchevêtrement des noms et des histoires de personnes plus tard dans le roman pour amplifier l'intrigue du roman. Un Partridge choqué d'apprendre qu'Allworthy a banni Tom, car il est convaincu que Tom est le propre fils d'Allworthy, mais aussi un Partridge qui soutient rébellion jacobite, tandis que les préférences de Tom vont au roi George.
Les cinq derniers chapitres sont dominés par l'histoire de l'homme de la colline (The Man of the Hill), c'est la plus longue des déviations du narrateur par rapport au récit central. Ces digressions permettent de rapprocher Fielding et Tom Jones du roman de Laurence Sterne, Tristram Shandy, qui rejette de manière consciente toute narration cohérente et linéaire. A cela près toutefois que que Fielding considère son œuvre comme une épopée par ailleurs bien ancrée dans une réalité multiple. L'Homme de la Colline relate donc son histoire, né dans le village de Mark-in-Somersetshire en 1657, fils cadet d'un "Gentleman Farmer" et de sa "mégère de femme". Le frère aîné de l'Homme de la Colline ne s'intéresse qu'à la chasse. L'Homme de la Colline, cependant, avance rapidement dans ses études et attire l'attention des hommes érudits du voisinage. Il est envoyé à Exeter College à Oxford où il rencontre un homme riche et débauché, Sir George Gresham, qui le corrompt. Il devient si rebelle qu'il est presque expulsé par le vice-chancelier. Son père refuse de lui prêter plus d'argent, alors il vole quarante guinées à un ami. L'homme de la colline échappe à la punition en s'enfuyant avec une dame à Londres, où il poursuit une vie débridée. Cette dame le dénonce et il est bientôt jeté en prison, où il réfléchit à son comportement. Il est autorisé à retourner à Oxford, où il découvre que son ami a abandonné les charges. Partridge l'interrompt et raconte l'histoire d'un homme qui a été pendu pour avoir volé un cheval et qui est revenu sous forme de fantôme pour tourmenter le plaignant.
Chapitre XIII, l'homme de la colline reprend son histoire, retrouve un vieil ami d'Oxford, Watson, avec qui il mène une existence de joueur, mais une nuit porte secours à un homme qui se révèle être son père, qui le ramène chez lui et le plonge dans la philosophie et les Écritures. Quatre ans plus tard, son père meurt, il repart, rencontre à nouveau son vieil ami Watson, l'aide financièrement, mais tous deux se retrouvent opposés dans le conflit jacobite en cours. L'homme de la colline décide à l'avenir d'éviter tous les humains et évoque ses voyages dans toute l'Europe. Partridge s'est endormi pendant ces discussions et le narrateur invite le lecteur à se reposer, car c'est la fin du huitième livre.

The History of Tom Jones - BOOK IX -
C'est l'un des livres les plus courts du roman. Le narrateur nous rappelle que les chapitres préliminaires qu'il travaille en début de chacun des livres ont été insérés pour permettre aux lecteurs de faire le tri entre "ce qui est vrai et authentique dans ce genre historique d'écriture, et ce qui est faux et contrefait". Le narrateur se présente comme un "Historien". Ce genre d'auteur exige du génie, de l'érudition, de la conversation, et de l'humanité. Le livre IX se concentre sur le sauvetage de Mme Waters par Tom auprès de Northerton. La réapparition de Northerton, qui s'est engagé dans l'armée avec Tom dans le livre VIII, reflète la structure imbriquée des récits de Fielding.
L'homme de la colline anime encore le livre IX, mais c'est Mme Waters qui accapare dans un premier temps notre attention. Mrs. Waters est de ces femme qui sollicite Tom et dont il ne peut refuser les avances, à l'instar de Lady Bellaston ou de Molly Seagrim. Tom et l'homme de la colline se promènent donc au chapitre II lorsqu'ils entendent une femme crier, son assaillant est identifié comme étant Northerton, l'homme qui s'était engagé dans l'armée avec Tom dans le livre VIII. Il prend la fuite et Tom emmène la malheureuse à Upton, la ville la plus proche, une Mme Waters qui n'a pas froid aux yeux et marche les seins nus lorsqu'elle escortée jusqu'à l'auberge et qui déchaînera toute son "artillerie d'amour" sur lui alors qu'il est surtout occupé à manger. "Elle pouvait, nous dit-il, festoyer de bon cœur à la table de l'amour, sans penser qu'un autre avait déjà festoyé, ou pourrait le faire plus tard, avec le même repas". Entre-temps, le narrateur nous a demandé d'attendre de plus amples détails sur la relation entre Northerton et la dame. Compte tenu de leur peu de condition sociale, le propriétaire de l'auberge et la tenancière refusent dans un premier temps le groupe, une bagarre s'ensuit, une fois de plus. C'est que la dame en détresse a été reconnue comme étant l'épouse du capitaine Waters, ce qui en fait une femme respectable, ce qui n'empêche pas Tom de finalement céder aux tentations de la dame...
Le narrateur nous rappelle que ses héros sont beaucoup plus mortels que divins, le sergent nous révèle que Mme Waters n'est pas réellement mariée au capitaine Waters, bien qu'ils aient vécu ensemble pendant un certain temps, et qu'elle connaît bien Northerton, le chapitre VIII nous éclaire sur leurs relations plus que trouble, et le narrateur met en garde le lecteur contre le fait de juger tous les militaires selon les critères de Northerton, en disant que la plupart sont dignes et honorables. Et Tom se languit à nouveau de Sophia. La vertu version Fielding n'est pas celle de Samuel Richardson....

The History of Tom Jones - BOOK X -
Le narrateur compare les critiques à des reptiles et demande au lecteur de ne pas juger l'œuvre trop tôt. Entre-temps, Fielding joue avec le langage, - chapitre 2, "in plain English, it was now midnight" -, et ses personnages, ou du moins nous indique qu'il en a la capacité.
Dans ce livre X, nous assistons à une véritable convergence des personnages à l'auberge d'Upton, qui prend forme de comédie délirante des erreurs. Tom, Sophia, Mme Waters, Fitzpatrick et Western vont ainsi se retrouver dans le même espace physique sans pour autant se rencontrer.
Un gentleman arrive à l'auberge (chap.II) et demande à Susan (la servante) si une dame est arrivée récemment. Susan pense immédiatement à Mme Waters et conduit le gentilhomme à sa chambre. Il enfonce la porte et trouve la dame au lit avec Tom Jones. Mme Waters hurle à l'intrusion des deux hommes, un homme dans la pièce voisine se réveille et intervient dans le chaos, on découvre alors que le gentleman en question est M. Fitzpatrick, à la recherche de sa femme, Harriet Fitzpatrick, la cousine de Sophia, et bien sûr que Mme Waters n'est pas son épouse. Un bref historique de M. Fitzpatrick est donné. Il s'est marié pour l'argent et a dépensé la fortune de sa femme, puis l'a si mal traitée qu'elle s'est enfuie de chez lui. La propriétaire, malgré les explications des uns et des autres, reste choquée par la scène scandaleuse de ces trois hommes dans la chambre de Mme Waters. Cette scène est un excellente exemple de satire d'une comédie de mœurs....
"Chapter II.
Containing the arrival of an Irish gentleman, with very extraordinary adventures which ensued at the inn. Now the little trembling hare, which the dread of all her numerous enemies, and chiefly of that cunning, cruel, carnivorous animal, man, had confined all the day to her lurking-place, sports wantonly o'er the lawns; now on some hollow tree the owl, shrill chorister of the night, hoots forth notes which might charm the ears of some modern connoisseurs in music; now, in the imagination of the half-drunk clown, as he staggers through the churchyard, or rather charnelyard, to his home, fear paints the bloody hobgoblin; now thieves and ruffians are awake, and honest watchmen fast asleep; in plain English, it was now midnight; and the company at the inn, as well those who have been already mentioned in this history, as some others who arrived in the evening, were all in bed. Only Susan Chambermaid was now stirring, she being obliged to wash the kitchen before she retired to the arms of the fond expecting hostler.
In this posture were affairs at the inn when a gentleman arrived there post. He immediately alighted from his horse, and, coming up to Susan, enquired of her, in a very abrupt and confused manner, being almost out of breath with eagerness, Whether there was any lady in the house?
The hour of night, and the behaviour of the man, who stared very wildly all the time, a little surprized Susan, so that she hesitated before she made any answer; upon which the gentleman, with redoubled eagerness, begged her to give him a true information, saying, He had lost his wife, and was come in pursuit of her. “Upon my shoul,” cries he, “I have been near catching her already in two or three places, if I had not found her gone just as I came up with her. If she be in the house, do carry me up in the dark and show her to me; and if she be
gone away before me, do tell me which way I shall go after her to meet her, and, upon my shoul, I will make you the richest poor woman in the nation.” He then pulled out a handful of guineas, a sight which would have bribed persons of much greater consequence than this poor wench to much worse purposes.
Susan, from the account she had received of Mrs Waters, made not the least doubt but that she was the very identical stray whom the right owner pursued. As she concluded, therefore, with great appearance of reason, that she never could get money in an honester way than by restoring a wife to her husband, she made no scruple of assuring the gentleman that the lady he wanted was then in the house; and was presently afterwards prevailed upon (by very liberal promises, and some earnest paid into her hands) to conduct him to the bedchamber of Mrs Waters.
It hath been a custom long established in the polite world, and that upon very solid and substantial reasons, that a husband shall never enter his wife's apartment without first knocking at the door. The many excellent uses of this custom need scarce be hinted to a reader who hath any knowledge of the world; for by this means the lady hath time to adjust herself, or to remove any disagreeable object out of the way; for there are some situations in which nice and delicate women would not be discovered by their husbands.
To say the truth, there are several ceremonies instituted among the polished part of mankind, which, though they may, to coarser judgments, appear as matters of mere form, are found to have much of substance in them, by the more discerning; and lucky would it have been had the custom above mentioned been observed by our gentleman in the present instance. Knock, indeed, he did at the door, but not with one of those gentle raps which is usual on such occasions. On the contrary, when he found the door locked, he flew at it with such violence, that the lock immediately gave way, the door burst open, and he fell headlong into the room.
He had no sooner recovered his legs than forth from the bed, upon his legs likewise, appeared--with shame and sorrow are we obliged to proceed--our heroe himself, who, with a menacing voice, demanded of the gentleman who he was, and what he meant by daring to burst open his chamber in that outrageous manner.
The gentleman at first thought he had committed a mistake, and was going to ask pardon and retreat, when, on a sudden, as the moon shone very bright, he cast his eyes on stays, gowns, petticoats, caps, ribbons, stockings, garters, shoes, clogs, &c., all which lay in a
disordered manner on the floor. All these, operating on the natural jealousy of his temper, so enraged him, that he lost all power of speech; and, without returning any answer to Jones, he endeavoured to approach the bed.
Jones immediately interposing, a fierce contention arose, which soon proceeded to blows on both sides. And now Mrs Waters (for we must confess she was in the same bed), being, I suppose, awakened from her sleep, and seeing two men fighting in her bedchamber, began to scream in the most violent manner, crying out murder! robbery! and more frequently rape! which last, some, perhaps, may wonder she should mention, who do not consider that these words of exclamation are used by ladies in a fright, as fa, la, la, ra, da, &c., are in music, only as the vehicles of sound, and without any fixed ideas.
Next to the lady's chamber was deposited the body of an Irish gentleman who arrived too late at the inn to have been mentioned before. This gentleman was one of those whom the Irish call a calabalaro, or cavalier. He was a younger brother of a good family, and, having no fortune at home, was obliged to look abroad in order to get one; for which purpose he was proceeding to the Bath, to try his luck with cards and the women.
This young fellow lay in bed reading one of Mrs Behn's novels; for he had been instructed by a friend that he would find no more effectual method of recommending himself to the ladies than the improving his understanding, and filling his mind with good literature. He no
sooner, therefore, heard the violent uproar in the next room, than he leapt from his bolster, and, taking his sword in one hand, and the candle which burnt by him in the other, he went directly to Mrs Waters's chamber.
If the sight of another man in his shirt at first added some shock to the decency of the lady, it made her presently amends by considerably abating her fears; for no sooner had the calabalaro entered the room than he cried out, “Mr Fitzpatrick, what the devil is the maning of this?” Upon which the other immediately answered, “O, Mr Maclachlan! I am rejoiced you are here.--This villain hath debauched my wife, and is got into bed with her.”--“What wife?” cries Maclachlan; “do not I know Mrs Fitzpatrick very well, and don't I see that the lady, whom the gentleman who stands here in his shirt is lying in bed with, is none of her?”
Fitzpatrick, now perceiving, as well by the glimpse he had of the lady, as by her voice, which might have been distinguished at a greater distance than he now stood from her, that he had made a very unfortunate mistake, began to ask many pardons of the lady; and then,
turning to Jones, he said, “I would have you take notice I do not ask your pardon, for you have bate me; for which I am resolved to have your blood in the morning.”
Jones treated this menace with much contempt; and Mr Maclachlan answered, “Indeed, Mr Fitzpatrick, you may be ashamed of your own self, to disturb people at this time of night; if all the people in the inn were not asleep, you would have awakened them as you have me.
The gentleman has served you very rightly. Upon my conscience, though I have no wife, if you had treated her so, I would have cut your throat.”
Jones was so confounded with his fears for his lady's reputation, that he knew neither what to say or do; but the invention of women is, as hath been observed, much readier than that of men. She recollected that there was a communication between her chamber and that of Mr Jones; relying, therefore, on his honour and her own assurance, she answered, “I know not what you mean, villains! I am wife to none of you. Help! Rape! Murder! Rape!”--And now, the landlady coming into the room, Mrs Waters fell upon her with the utmost virulence, saying, “She thought herself in a sober inn, and not in a bawdy-house; but that a set of villains had broke into her room, with an intent upon her honour, if not upon her life; and both, she said, were equally dear to her.”
The landlady now began to roar as loudly as the poor woman in bed had done before. She cried, “She was undone, and that the reputation of her house, which was never blown upon before, was utterly destroyed.” Then, turning to the men, she cried, “What, in the devil's name, is the reason of all this disturbance in the lady's room?” Fitzpatrick, hanging down his head, repeated, “That he had committed a mistake, for which he heartily asked pardon,” and then retired with his countryman. Jones, who was too ingenious to have missed the hint given him by his fair one, boldly asserted, “That he had run to her assistance upon hearing the door broke open, with what design he could not conceive, unless of robbing the lady; which, if they intended, he said, he had the good fortune to prevent.” “I never had a robbery committed in my house since I have kept it,” cries the landlady; “I would have you to know, sir, I harbour no highwaymen here; I scorn the word, thof I say it. None but honest, good gentlefolks, are welcome to my house; and, I thank good luck, I have always had enow of such customers; indeed as many as I could entertain. Here hath been my lord--,” and then she repeated over a catalogue of names and titles, many of which we might, perhaps, be guilty of a breach of privilege by inserting.
Jones, after much patience, at length interrupted her, by making an apology to Mrs Waters, for having appeared before her in his shirt, assuring her “That nothing but a concern for her safety could have prevailed on him to do it.” The reader may inform himself of her
answer, and, indeed, of her whole behaviour to the end of the scene, by considering the situation which she affected, it being that of a modest lady, who was awakened out of her sleep by three strange men in her chamber. This was the part which she undertook to perform; and, indeed, she executed it so well, that none of our theatrical actresses could exceed her, in any of their performances, either on or off the stage.
And hence, I think, we may very fairly draw an argument, to prove how extremely natural virtue is to the fair sex; for, though there is not, perhaps, one in ten thousand who is capable of making a good actress, and even among these we rarely see two who are equally able to
personate the same character, yet this of virtue they can all admirably well put on; and as well those individuals who have it not, as those who possess it, can all act it to the utmost degree of perfection.
When the men were all departed, Mrs Waters, recovering from her fear, recovered likewise from her anger, and spoke in much gentler accents to the landlady, who did not so readily quit her concern for the reputation of the house, in favour of which she began again to number the many great persons who had slept under her roof; but the lady stopt her short, and having absolutely acquitted her of having had any share in the past disturbance, begged to be left to her repose, which, she said, she hoped to enjoy unmolested during the remainder of the night. Upon which the landlady, after much civility and many courtsies, took her leave.
Voici qu'un autre carrosse se présente, transportant une dame et sa servante: son identité nous est dissimulée par l'auteur dans un premier temps, mais la servante de la dame s'appelle Abigail Honour et apprend que Tom Jones séjourne à l'auberge. L'enchaînement de l'action prend forme à nouveau, Partridge, qui est fatigué et ivre, répond à Honour que Tom est au lit avec une "gueuse", Susans apprend à la "dame", qui est Sophia, que Partridge claironne à tout le monde que Sophia est follement amoureuse de Tom, et que celui-ci part se battre à la guerre pour lui échapper. Sophia, plus bouleversée et en colère parce que Tom a mentionné son nom à des inconnus que pour son infidélité (c'est que les hommes "bien élevés" étaient alors autorisés à faire bien des "choses" sans perdre pour autant leur réputation) se venge en enlevant son gant et le faisant épingler sur le lit, vide, de Tom Jones (chap. V), comme "une punition pour ses fautes", et s'enfuit...
Tom Jones apprend l'incident et est totalement anéanti tandis que l'on continue de rechercher l'épouse de M. Fitzpatrick. A la fin du chapitre, un gentleman arrive à l'auberge, c'est Squire Western, à la recherche de Sophia et une brève bagarre oppose à nouveau ce joli monde. Tom et Partridge partent à la recherche de Sophia, tandis que Mme Waters console M. Fitzpatrick, qui n'a toujours pas retrouvé sa femme. Les chapitre VII et VIII reviennent sur la découverte par Squire Western de la disparition de sa fille, et nous explique comment Sophia s'était échappée la nuit et s'est retrouvée à l'auberge. Mme Western se lancera dans un grand discours dans lequel elle reprochera à son frère la disparition de sa fille et affirmera que les femmes anglaises ne doivent pas être malmenées de la sorte.

The History of Tom Jones - BOOK XI -
Nous avons traité auparavant ce formidable groupe d'hommes que l'on appelle critiques avec plus de liberté qu'il ne nous convient, puisqu'ils exigent, et même reçoivent généralement, une grande condescendance de la part des auteurs (In our last initial chapter we may be supposed to have treated that formidable set of men who are called critics with more freedom than becomes us; since they exact, and indeed generally receive, great condescension from authors). Pourquoi une telle conduite? Ce mot critique est d'origine grecque, et signifie jugement, ce qui semble relever d'une connotation juridique, dans le sens de "condamnation", d'autant que nombre de ces critiques sont avocats : "désespérant peut-être de s'élever jamais au banc de Westminster-hall, ils se sont placés sur les bancs du théâtre, où ils ont exercé leur capacité judiciaire, et ont rendu des jugements, c'est-à-dire condamné sans pitié". Mais "pourquoi un critique, qui lit avec la même vue malveillante, ne devrait-il pas être qualifié de calomniateur de la réputation des livres ?" (If a person who prys into the characters of others, with no other design but to discover their faults, and to publish them to the world, deserves the title of a slanderer of the reputations of men, why should not a critic, who reads with the same malevolent view, be as properly stiled the slanderer of the reputation of books?).
Sur le chemin de Londres, Sophia rencontre incidemment sa cousine Harriet, qui est aussi la femme de Fitzpatrick, toutes deux en fuite, de son père ou de son mari. Le groupe arrive dans un premier temps dans une auberge, et le propriétaire en vient à soupçonner que Sophia est une certaine Jenny Cameron, l'amante, selon les Wighs, de Bonnie Prince Charlie, chef de la rébellion jacobite. C'est que le propriétaire ne peut pas croire que Sophia est une gentlewoman tant elle est courtoise envers les gens de toutes les classes, et bien que ne soutenant pas les Jacobites, ont entendu parler de la progression des rebelles à Londres.
Sophia et Harriet reprennent leurs conversations, évoquent leurs souvenirs d'enfance puis chacune se raconte l'une à l'autre, à commencer par Mme Fitzpatrick, dont le mariage fut essentiellement financier (chap.V). Sophia raconte ensuite son histoire (chap. VIII), en omettant Tom Jones et remarque au passage que sa cousine cherche un remplaçant à son mari. Chapitre X, Sophia arrive à Londres et loge chez Lady Bellaston, une parente de Sophia, dont la personnalité passionnée et lascive la conduira à se lancer dans nombre d'intrigues. Elle mènera une lutte vengeresse contre Tom et Sophia avec la plus grande allégresse...

The History of Tom Jones - BOOK XII -
Le narrateur discute de son utilisation d'allusions, de références et de citations dans l'œuvre, qui pourraient avantager les érudits, mais il n'est pas interdit de braconner auprès de ces grands écuyers. Le livre XII est l'un des livres les plus mouvementés du roman, rempli des aventures de Tom et Partridge : tandis que Squire Western poursuit sa quête, quittant l'auberge et désespéré, Tom décide de redevenir soldat, et Partridge le soupçonne d'être devenu fou; puis croise un mendiant qui lui propose un livre de poche qu'il a trouvé et qui porte le nom de Sophia; les voici rencontrant un spectacle de marionnettes qui donne lieu à divers incidents, la présence de rebelles jacobites en route pour Londres accompagne le récit.
Chapitre IX, Tom et Partridge sur le chemin de Londres rencontrent M. Dowling, l'avocat que Tom a rencontré lorsqu'il vivait avec Allworthy, puis au chapitre XII un groupe de gitans célébrant un mariage. Le roi des gitans leur explique combien son peuple est bien gouverné, parce qu'il a abandonné le système des seigneurs et rendu tout le monde égal, explique que leur société n'utilise pas la peine capitale, mais se fie à la honte comme moyen de dissuasion.
Pendant qu'ils discutent, Partridge se laisse tenter par les sollicitations d'une gitane, dont le mari remarque l'échange et exige alors qu'il soit puni. Le roi en déduit sagement que toute l'affaire était un piège pour soutirer de l'argent à Partridge, et le mari est condamné à porter des cornes sur la tête pendant un mois, tandis que sa femme est qualifiée de putain. Le roi explique le mode de fonctionnement des gitans et des non-gitans - "mes gens volent vos gens, et vos gens volent l'un l'autre".
Le narrateur vante les vertus d'une monarchie absolue et affirme que les qualités nécessaires à un monarque efficace sont la modération, la sagesse et la bonté. Il concède qu'il est difficile de trouver un homme qui possède toutes ces qualités. Il affirme que le bonheur des bohémiens est fondé sur leur absence de prétentions entre eux.
Partridge et Tom reprennent leur route, s'arrêtent à St. Albans, suivant les traces de Sophia, et se battent avec un apprenti voleur auquel Tom fait finalement l'aumône.

The History of Tom Jones - BOOK XIII -
"Come, bright love of fame, inspire my glowing breast: not thee I will call, who, over swelling tides of blood and tears, dost bear the heroe on to glory, while sighs of millions waft his spreading sails.." - Le livre XIII inaugure la scène de la ville qu'incarne à sa manière la puissante et impitoyable Lady Bellaston, des extravagantes mascarades aux tentations financières et sexuelles. Jones et Partridge, qui ne sont jamais allés à Londres auparavant, recherchent la maison de l'Irlandais qui aurait amené Sophia à Londres, et retrouvent Mme Fitzpatrick qui en fait complote pour rendre la jeune femme à son père, afin de s'attirer les faveurs de Mme Western et du Squire Western. Mme Fitzpatrick a également un lien de parenté éloigné avec Lady Bellaston, à qui elle demande de l'aide pour dissuader Sophia de poursuivre Tom. Lady Bellaston la reçoit et lui demande si Tom est aussi beau que le lui a dit sa maîtresse de maison. Mme Fitzpatrick répond qu'il l'est, si bien que Lady Bellaston commence à le considérer comme "une sorte de miracle de la nature". Fielding sait utiliser les contrastes féminins, entre Lady Bellaston, la prédatrice, Mme Fitzpatrick, si complexe, et la douce innocence de Sophia.
En attendant de parvenir à remonter jusqu'à Sophia, Tom et Partridge se logent dans une maison de Bondstreet. Un jeune homme, Nightingale, réside au premier étage, un de ces "hommes d'esprit et de plaisir" privilégiés qui passent leurs jours et leurs nuits dans les coffee-shops. Cette nuit-là, Jones vient au secours de Nightingale et de Nancy, la fille de la propriétaire de la pension de famille. Tom se rend vite compte que Nancy et lui sont amoureux. Nancy tombe enceinte et Tom convaincra Nightingale de l'épouser. Et Fielding tient à nous rappeler au passage combien son intrigue n'est pas qu'une simple histoire, nous prévenant de l'importance de Mme Miller en tant que personnage, "Le lecteur peut donc en conclure que cette excellente femme apparaîtra dans l'avenir comme un personnage important de notre histoire"...
Chapitre VI, Partridge annonce à Jones que Mme Fitzpatrick a quitté sa maison, et qu'il ne sait pas où elle est allée. Jones ne peut cacher sa déception au petit déjeuner, où la conversation tourne autour de l'amour. Une servante arrive avec un colis pour Tom - il contient un masque de domino et un ticket de mascarade. Nightingale déclare que Tom a une admiratrice. Bref épisode des jeux de mascarades et occasions de brèves liaisons qui amusent tant la haute société, mais auxquels cèdent tout autant les classes moins favorisées, les gens sont ce qu'ils sont.
Et c'est ainsi chapitre VII Jones rencontre une dame portant un masque de Domino qui lui demande de mettre fin à sa liaison avec Sophia. Mais Tom maintient que son amour est désintéressé. Elle se démasquera plus tard, c'est Lady Bellaston qui lui promet d'arranger une entrevue avec Sophia s'il promet encore et toujours d'abandonner toute pensée pour elle. Tandis que Jones tente d'aider financièrement Mme Miller, qui se révèle la femme de celui qui avait tenté désespérément de les voler sur la route de Londres, que Partridge court Londres à la recherche de Sophia, Lady Bellaston referme son piège sur Tom Jones...
Mais le chapitre XI apporte sa note, Tom arrive tôt chez Lady Bellaston et attend dans le salon: elle a été retenue à l'autre bout de la ville. Sophia surgit, ignorant que quelqu'un d'autre se trouve dans le salon, s'approche d'un miroir et contemple son visage, ... et remarque Tom Jones, qui s'est figé dans un coin. A genoux, Tom lui demande pardon pour sa mauvaise conduite à Upton avec Mme Waters et pour avoir abusé de son nom. Sophia lui répond qu'elle ne peut pas désobéir à son père, lorsque surgit dans la pièce Lady Bellaston. Les deux dames jouent alors de ruse l'une envers l'autre, Sophia prétend qu'il s'agit d'un gentleman venu par hasard lui rendre son livre, et Lady Bellaston prétend ne pas le reconnaître. Tom quant lui prend congé et demande à lui rendre visite le lendemain. Mais Lady Bellaston est une menteuse plus expérimentée, elle n'est pas encore malveillante, que Sophia; quant à Tom, ayant accepté de l'argent de Lady Bellaston, sait-il quelque part vendu à elle...

The History of Tom Jones - BOOK XIV -
À partir du livre XIV, le roman fait place à un nouveau mode d'écriture, il devient en partie épistolaire, rempli des lettres de Lady Bellaston, Sophia et Tom Jones. Les lettres remplacent -elles désormais les personnes? (chap.II) Jones reçoit deux lettres de Lady Bellaston. La première lui demande s'il a prévu de rencontrer Sophia dans le salon de sa maison. Elle le prévient qu'elle peut haïr aussi passionnément qu'elle peut aimer. La seconde l'exhorte à venir la voir chez elle immédiatement. Alors que Jones s'apprête à partir, Lady Bellaston entre, sa robe en désordre. Elle demande si Jones l'a trahie, et il lui promet à genoux que non. Soudain, Partridge entre dans la pièce en annonçant l'arrivée de Mme Honour. Tom cache Lady Bellaston derrière son lit avant que Honor n'entre. Celle-ci raconte que Lady Bellaston rencontre des hommes dans une maison où elle paie le loyer de la propriétaire. Puis elle remet à Jones une lettre de Sophia. Après le départ d'Honour, Lady Bellaston émerge de derrière le lit, furieuse d'avoir été "méprisée pour une fille de la campagne". Lady Bellaston réalise maintenant que Sophia occupera toujours la première place dans l'affection de Jones, mais se résigne à être le second prix.
Dame infiniment respectable, Mme Miller demande à Tom, très courtoisement, de quitter sa maison, car elle n'approuve pas qu'il reçoive des femmes étrangères dans sa chambre, mais tous deux se racontent l'un l'autre leur histoire autour d'une tassé de thé. Et bien que Lady Bellaston soit toujours présente dans le livre XIV, le narrateur fait un détour pour suivre l'histoire de Nancy et de Nightingale, un Nightingale, né et élevé à la ville, qui va devoir apprendre et adopter le code d'honneur de Tom avant de pouvoir atteindre le bonheur conjugal. Pour l'heure, il a pris la fuite et abandonnée Nacy enceinte avec une lettre de justification qui laisse Nancy, Mme Miller et Betty totalement désemparées. C'est Jones qui rend l'affaire en main, rencontre Nightingale puis le père et l'oncle de celui-ci qui l'a engagé auprès d'une autre femme. Tout semble se dénouer favorablement dans le dernier chapitre, qui laisse planer bien des questions, l''oncle semble avoir l'intention d'empêcher ce mariage, et Mme Honour annonce à Jones qu'elle a de terribles nouvelles concernant Sophia....

The History of Tom Jones - BOOK XV -
Certains auteurs affirment que "la vertu est la voie certaine du bonheur" (virtue is the certain road to happiness), mais quand on observe combien Tom, tout essayant d'agir vertueusement en unissant Nancy et Nightingale, n'est pas parvenu à améliorer sa situation vis-à-vis de Sophia, on peut légitimement s'interroger.
Voici donc, dès le chapitre II, que Lady Bellaston fait entrer en scène Lord Fellamar qui, tombé amoureux de Sophia, va tout tenter pour la conquérir. Lady Bellaston est membre d'une société appelée Little World, où les membres racontent des mensonges qui deviennent ensuite des rumeurs, et notamment l'histoire d'un jeune homme nommé Jones qui aurait tué quelqu'un en duel. Sophia entend l'histoire mais ne cède pas pour autant, c'est alors que Lady Bellaston suggère à Lord Fellamar de l'obliger à avoir des rapports sexuels, après quoi elle sera tenue de l'épouser (chap.IV). Sophia est train de lire une pièce intitulée "The Fatal Marriage", de Thomas Southerne, lors que Lord Fellamar entre et s'impose à elle, elle pousse de grands cris, mais surgit le châtelain Western qui la sauve et s'empare d'elle à nouveau. C'est que Squire Western a été entretemps informé du lieu où se trouvait sa fille par Mme Fitzpatrick. Chapitre VII, Honour se rend chez Mme Miller pour raconter à Tom ce qui s'est passé, mais surgit Lady Bellaston tente de séduire le jeune homme, puis un Nightingale totalement ivre, la confusion aidant, Honour sait maintenant qui est réellement Lady Bellaston.
Les chapitres VII et VIII permettent au lecteur de reprendre son souffle, Nightingale et Nancy sont mariés, Nightingale a pu échapper à la colère de son oncle, reste à Tom Jones de tenter de retourner à ses propres affaires. Pour le sortir de la dangereuse attraction de Lady Bellaston, Nightingale suggère à Tom de la demander en mariage, puisque c'est une femme qui intrigue avec tous les hommes qu'elle aime (she is a demirep; that is to say a woman who intrigues with every man she likes) : elle lui répondra en le condamnant comme un scélérat.
Le chapitre X nous annonce la venue à Londres d'Allworthy et de Blifil, obligeant Nightingale et Tom à déménager. Tom se rend compte que si Blifil est en ville, son mariage avec Sophia est d'autant plus imminent. Honour écrit à Tom pour lui dire qu'elle ne peut plus l'aider dans son affaire avec Sophia car Lady Bellaston est maintenant son employeur.
Au chapitre XI, Mme Hunt, une riche veuve qui cherche à se remarier, écrit à Tom pour lui proposer de partager sa fortune avec lui s'il lui fait la cour. Bien que Tom soit appauvri, il décline l'offre et contemple le gant de Sophia qu'il a conservé pour lui rappeler son amour. Chapitre XII, Partridge découvre que Black George est en ville avec Allworthy, pour le mariage de Sophia....

The History of Tom Jones - BOOK XVI -
Je crois que bien des malédictions ont été lancées sur la tête de l'auteur qui, le premier, a institué la méthode consistant à faire précéder sa pièce de cette portion de matière qu'on appelle le prologue, et qui, au début, faisait partie de la pièce elle-même, mais qui, ces dernières années, a eu d'ordinaire si peu de rapport avec le drame qu'elle précède, que le prologue d'une pièce pourrait aussi bien servir pour n'importe quelle autre. "Those indeed of more modern date, seem all to be written on the same three topics, viz., an abuse of the taste of the town, a condemnation of all contemporary authors, and an eulogium on the performance just about to be represented..".
Sophia déchirée entre le désir de plaire à son père et l'espoir de son propre bonheur. Le Squire Western presse donc Sophia d'accepter Blifil alors qu'un officier de l'armée arrive pour réitérer la demande de Lord Fellamar. Western répond que sa décision est prise et qu'elle est irrévocable. Sophia promet certes de ne jamais se marier sans le consentement de son père, mais qu'elle ne se mariera pas non plus selon ses désirs. Black George en profite pour glisser un billet de Tom à Sophia qui ne souhaite que son bonheur. Mme Western intervient au chapitre IV, ordonne à son frère de libérer sa fille, on ne peut enfermer une femme, dit-elle. Son frère l'autorise à emmener Sophia chez elle.
Au chapitre V, nous voyons Tom, Partridge, Mme Miller et sa plus jeune fille assister à une représentation de Hamlet, les réactions de Partridge à Fielding de se moquer du théâtre contemporain.
Le refus maintes fois réitérés du mariage par Sophia commence à faire problème tant auprès de Western que d'Allworthy. Mais alors que Mme Western se laisse gagner par le double jeu de Lord Fellamar et de Lady Bellaston, Tom se laisse emporter dans un engrenage qui selble fatal, non pour ses vices ou pour ses vertus, mais tout simplement pour son caractère passionné : recherchant un appui auprès de Mme Fitzpatrick, le chapitre X voit surgir le jaloux M. Fitzpatrick, qui provoque Tom en duel. Celui-ci le touche, sa blessure se révèle mortelle, des hommes au service de Lord Fellamar se saisissent de Tom et le traînent jusqu'au magistrat. Le narrateur révèle que ces hommes font partie de la bande employée par Lord Fellamar. Quant à Sophia, elle a vu sa demande en mariage à Lady Bellaston et ne veut plus entendre parler de lui...

The History of Tom Jones - BOOK XVII -
"When a comic writer hath made his principal characters as happy as he can, or when a tragic writer hath brought them to the highest pitch of human misery, they both conclude their business to be done, and that their work is come to a period". Quand un auteur comique a rendu ses personnages principaux aussi heureux que possible, ou lorsqu'un auteur tragique les a amenés au plus haut degré de la misère humaine, ils peuvent tous deux conclure que leur tâche est terminée. Et si nous avions été d'humeur tragique, le lecteur doit admettre que nous sommes quasiment presque arrivés ce moment tant la position de Tom est désespérée : " Il est maintenant si dépourvu d'amis, et si persécuté par ses ennemis, que nous désespérons presque de pouvoir lui faire du bien".
Mais cependant un quelque chose semble agir, son altruisme, qu'il a tant semé au long du récit sans que nous y prêtions trop d'importance, commence à porter ses fruits. Mme Miller représente sa cause auprès de Sophia et d'Allworthy. De même, Nightingale qui s'interroge sur les circonstances de l'arrestation de Tom. Partridge reste également son fidèle partisan. Même Mme Waters, avec qui il était autrefois si gentil, arrive et espère lui être utile. Bien que le narrateur soit convaincu que la vertu n'assure pas le bonheur, il est intéressé par une fin heureuse (comme il le note dans le prologue de ce livre), mais il l'orchestre avec intelligence en faisant en sorte que le bien puisse découler des actes les plus exemplaires de notre héros.
Et l'intrigue de Fielding va se complexifier à mesure que nous approchons de la fin. Nombre de personnages se trouvent maintenant à Londres, ce qui prépare le terrain pour la résolution finale. Presque tous les personnages sont dans la confusion quant aux motivations des uns et autres.
Le narrateur rappelle donc son œuvre serait presque terminée s'il s'agissait d'une tragédie, mais qu'il est plus difficile d'amener les personnages au bonheur qu'à la détresse. Dans les époques antérieures, les écrivains faisaient appel à des divinités et à des forces surnaturelles pour faciliter la réalisation de leur objectif, mais dans sa forme de fiction historique, on ne peut disposer de tels procédés.
Allworthy et Mme Miller sont donc en train de déjeuner lorsque Blifil arrive. Mme Miller fait l'éloge de Tom, mais Blifil leur apprend que Tom a tué un homme. Arrive le Squire Western avec la nouvelle qu'un autre homme a demandé la main de sa fille. Allworthy s'est rendu compte quant à lui du désintérêt de Sophia pour Blifil et suggère qu'on annule tout projet mariage. On ne peut se marier contre nature. Voici donc Sophia délivrée de Blifil mais livrée à Lord Fellamar. Mme Western ajoute qu'elle rendra Sophia à son père si elle ne consent pas au nouveau mariage proposé. Sophia révèle alors les détails de la tentative de viol, et Mme Western promet de ne plus jamais les laisser seules.
Le chapitre V est un bien singulier tournant : Partridge annonce à Tom que M. Fitzpatrick n'est pas, en fait, mort. Mme Miller accepte de rendre visite à Sophia au nom de Tom, puis rencontre Allworthy, tandis que Nightingale accepte d'enquêter sur les détails du duel pour aider la défense de Tom. Le chapitre IX ne permet d'espérer un règlement favorable pour Tom qui reste en prison tandis que Sophia ne semble pouvoir échapper au scénario de mariage soutenu par Mme Western ...

The History of Tom Jones - BOOK XVIII -
"We are now, reader, arrived at the last stage of our long journey" : " let us behave to one another like fellow-travellers in a stage coach, who have passed several days in the company of each other; and who, notwithstanding any bickerings or little animosities which may have occurred on the road, generally make all up at last, and mount, for the last time, into their vehicle with chearfulness and good humour; since after this one stage, it may possibly happen to us, as it commonly happens to them, never to meet more...."
Les évènements vont donc se précipiter dans cette dernière partie. Partridge entend Tom parler à Mme Waters et réalise qu'elle est la femme avec laquelle il a couché à Upton. Et lorsqu'elle part, il lui annonce une terrible nouvelle, elle est Jenny Jones, sa mère. Sophia est rendue à son père, qui acquiesce à l'insistance d'Allworthy pour qu'elle ne soit pas à nouveau enfermée. Le Squire Western, convaincu que Tom sera pendu, et ne se préoccupe plus guère de lui. Et Sophia réitère sa promesse qu'elle n'épousera personne sans le consentement de son père. Allworthy, quant à lui, découvre à quel point il s'est trompé sur le compte de Tom, c'est bien Black George qui a volé Tom, c'est bien Fitzpatrick qui a provoqué le duel, c'est bien Tom qui fut le seul membre de la famille, à écouter le témoignage de Square, à s'être montré sincèrement inquiet lorsque Allworthy semblait proche de la mort. Au chapitre V, Nightingale découvre que les témoins du duel avaient été employés pour se débarrasser de Tom. Au chapitre VII, Mme Waters explique enfin que le père de Tom était le fils d'un pasteur nommé Summer, qui avait vécu dans la maison d'Allworthy mais était mort de la variole. Elle révèle ensuite que la mère de Tom était en fait la sœur d'Allworthy, Bridget. Bridget, qui a payé Jenny Jones pour qu'elle prenne la responsabilité de l'enfant trouvé.
Le chapitre VIII révèle le rôle central joué par l'avocat Dowling dans toute cette affaire, il fut l'intermédiaire de Blifil dans la poursuite du duel et de Bridget pour dissimuler sa relation vis-à-vis de Tom. Au chapitre IX, après avoir lu une lettre de Tom à Sophia, Allworthy se rend compte de la vertu de leur amour. Allworthy raconte alors à Sophia la trahison qu'il a un neveu qui aimerait lui rendre visite et la courtiser : elle ne sait que répondre jusqu'à ce qu'il révèle que son neveu est Tom. Le Squire Western est quant à lui très heureux d'apprendre que Tom est le véritable héritier d'Allworthy, et est aussi impatient qu'elle puisse épouser Tom. Il faudra attendre le chapitre XII pour espérer une réconciliation totale de tous les protagonistes. Tom et Sophia se marieront en présence d'Allworthy, du Squire Western et de Mme Miller. Blifil disparaîtra avec une bonne rente, le récit se termine en nous faisant part du destin de chacun des principaux protagonistes de l'histoire...

Henry Fielding, "The History of the Life of the Late Mr. Jonathan Wild the Great" (1743)
En 1743, Fielding, en pleine période personnelle particulièrement difficile, - la pauvreté, la maladie de sa femme et ses propres souffrances dues à des crises de goutte, - publie une oeuvre d`une ironie particulièrement mordante, dans ses Mélanges (Miscellanies), "The History of the Life of the Late Mr. Jonathan Wild the Great". Une pièce satirique dont la puissance est souvent rapprochée du "Barry Lyndon" de William Makepeace Thackeray (1844). Ni roman ni biographie quoique s'inspirant d'une histoire réelle d'un voleur de grand chemin notoire, Fielding s'attaque avec l'histoire de "Jonathan Wild" à cette "grandeur totalement dépourvue de bonté" qui frappe par la confusion de son objet le sentiment populaire : "A man may be great without being good, or good without being great."
Chef d'une vaste association de brigands, le véritable Jonathan Wild (1682 ?-l725) fut pendu à Tyburn, et ses exploits inspirèrent à Daniel Defoe (l660-1731), en 1725, "Life and Actions of Jonathan Wild". Fielding prend la voie du pamphlet politique contre un Robert Walpole finissant pour progressivement donner à son roman une signification plus universelle. Il dépeint ainsi un monstrueux brigand, dont les actions sont fondées sur des motifs et sur des calculs, généralement approuvés par les hommes, et qui se plaît à les comparer aux actes des grands de ce monde. L'intrigue repose sur l'attentat du brigand contre son ancien compagnon de classe, le joaillier londonien Heartfree : Jonathan profite de l'honnêteté de ce dernier et de sa confiance pour le pousser à livrer des pierres précieuses à son complice le comte La Ruse, qui prend la fuite une fois les joyaux en sa possession. Plus de la moitié des pierres appartenant à d'autres bijoutiers, Heanfree est ruiné et emprisonné. Entre-temps, Wild a jeté les yeux sur la femme de Heartfree. Sous le prétexte de sauver son mari de la faillite, il la convainc de passer avec lui outre-Manche. Mais lorsque au cours de la traversée il veut abuser d'elle, le capitaine intervient et le brigand est abandonné à la dérive sur une barque. Son échec ne le corrigera pas, il tente de regagner la confiance de Heartfree et de le persuader de s`évader en assassinant ses gardiens. Furieux de son insuccès, il fait accuser sa malheureuse victime de faillite frauduleuse. Heartfree ne doit son salut qu'à l'intervention opportune de sa femme. Un membre de la bande de Wild, Fireslood, découvre le complot et, après avoir vainement tenté de s'empoisonner pour échapper à la potence, le brigand est pendu.
I.-- Mr. Wild's Early Exploits
Mr. Jonathan Wild, who was descended from a long line of great men, was born in 1665. His father followed the fortunes of Mr. Snap, who enjoyed a reputable office under the sheriff of London and Middlesex; and his mother was the daughter of Scragg Hollow, Esq., of Hockley-in-the-Hole. He was scarce settled at school before he gave marks of his lofty and aspiring temper, and was regarded by his schoolfellows with that deference which men generally pay to those superior geniuses who will exact it of them. If an orchard was to be robbed, Wild was consulted; and though he was himself seldom concerned in the execution of the design, yet was he always concerter of it, and treasurer of the booty, some little part of which he would now and then, with wonderful generosity, bestow on those who took it. He was generally very secret on these occasions; but if any offered to plunder of his own head without acquainting Master Wild, and making a deposit of the booty, he was sure to have an information against him lodged with the schoolmaster, and to be severely punished for his pains.
At the age of seventeen his father brought the young gentleman to town, where he resided with him till he was of an age to travel.
Men of great genius as easily discover one another as Freemasons can. It was therefore no wonder that the Count la Ruse--who was confined in Mr. Snap's house until the day when he should appear in court to answer a certain creditor--soon conceived an inclination to an intimacy with our young hero, whose vast abilities could not be concealed from one of the count's discernment; for though the latter was exceedingly expert at his cards, he was no match for Master Wild, who never failed to send him away from the table with less in his pocket than he brought to it. With so much ingenuity, indeed, could our young hero extract a purse, that his hands made frequent visits to the count's pocket before the latter had entertained any suspicion of him. But one night, when Wild imagined the count asleep, he made so unguarded an attack upon him that the other caught him in the act. However, he did not think proper to acquaint him with the discovery he had made, but only took care for the future to button his pockets and to pack the cards with double industry.
In reality, this detection recommended these two prigs to each other, for a wise man--that is to say, a rogue--considers a trick in life as a gamester doth a trick at play. It sets him on his guard, but he admires the dexterity of him who plays it.
When our two friends met the next morning, the count began to bewail the misfortune of his captivity, and the backwardness of friends to assist each other in their necessities.
Wild told him that bribery was the surest means of procuring his escape, and advised him to apply to the maid, telling him at the same time that as he had no money he must make it up with promises, which he would know how to put off.
The maid only consented to leave the door open when Wild, depositing a guinea in the girl's hands, declared that he himself would swear that he saw the count descending from the window by a pair of sheets.
Thus did our young hero not only lend his rhetoric, which few people care to do without a fee, but his money too, to procure liberty for his friend. At the same time it would be highly derogatory from the great character of Wild should the reader not understand that this was done because our hero had some interested view in the count's enlargement.
Intimacy and friendship subsisted between the count and Mr. Wild, and the latter, now dressed in good clothes, was introduced into the best company. They constantly frequented the assemblies, auctions, gaming-tables, and play-houses, and Wild passed for a gentleman of great fortune.
It was then that an accident occurred that obliged Wild to go abroad for seven years to his majesty's plantations in America; and there are such various accounts, one of which only can be true, of this accident that we shall pass them all over. It is enough that Wild went abroad, and stayed seven years.
II.--An Example of Wild's Greatness
The count was one night very successful at the gaming-table, where Wild, who was just returned from his travels, was then present; as was likewise a young gentleman whose name was Bob Bagshot, an acquaintance of Mr. Wild's. Taking, therefore, Mr. Bagshot aside, he advised him to provide himself with a case of pistols, and to attack the count on his way home.
This was accordingly executed, and the count obliged to surrender to savage force what he had in so genteel a manner taken at play. As one misfortune never comes alone, the count had hardly passed the examination of Mr. Bagshot when he fell into the hands of Mr. Snap, who carried him to his house.
Mr. Wild and Mr. Bagshot went together to the tavern, where Mr. Bagshot offered to share the booty. Having divided the money into two unequal heaps, and added a golden snuffbox to the lesser heap, he desired Mr. Wild to take his choice.
Mr. Wild immediately conveyed the larger share of the ready into his pocket, according to an excellent maxim of his --"First secure what share you can before you wrangle for the rest"; and then, turning to his companion, he asked him whether he intended to keep all that sum himself. "I grant you took it," Wild said; "but, pray, who proposed or counselled the taking of it? Can you say that you have done more than execute my scheme? The ploughman, the shepherd, the weaver, the builder, and the soldier work not for themselves, but others; they are contented with a poor pittance--the labourer's hire--and permit us, the great, to enjoy the fruits of their labours. Why, then, should the state of a prig differ from all others? Or why should you, who are the labourer only, the executor of my scheme, expect a share in the profit? Be advised, therefore; deliver the whole booty to me, and trust to my bounty for your reward."
Mr. Bagshot not being minded to yield to these arguments, Wild adopted a fiercer tone, and the other was glad to let him borrow a part of his share. So that Wild got three-fourths of the whole before taking leave of his companion.
Wild then returned to visit his friend the count, now in captivity at Mr. Snap's; for our hero was none of those half-bred fellows who are ashamed to see their friends when they have plundered and betrayed them.
The count, little suspecting that Wild had been the sole contriver of the misfortune which had befallen him, eagerly embraced him, and Wild returned his embrace with equal warmth.
While they were discoursing, Mr. Snap introduced Mr. Bagshot; for Mr. Bagshot had lost what money he had from Mr. Wild at a gaming-table, and was directly afterwards arrested for debt. Mr. Wild no sooner saw his friend than he immediately presented him to the count, who received him with great civility. But no sooner was Mr. Bagshot out of the room than the count said to Wild, "I am very well convinced that Bagshot is the person who robbed me, and I will apply to a justice of the peace."
Wild replied with indignation that Mr. Bagshot was a man of honour, but, as this had no weight with the count, he went on, more vehemently, "I am ashamed of my own discernment when I mistook you for a great man. Prosecute him, and you may promise yourself to be blown up at every gaming-house in the town. But leave the affair to me, and if I find he hath played you this trick, I will engage my own honour you shall in the end be no loser." The count answered, "If I was sure to be no loser, Mr. Wild, I apprehend you have a better opinion of my understanding than to imagine I would prosecute a gentleman for the sake of the public."
Wild having determined to make use of Bagshot as long as he could, and then send him to be hanged, went to Bagshot next day and told him the count knew all, and intended to prosecute him, and the only thing to be done was to refund the money.
"Refund the money!" cried Bagshot. "Why, you know what small part of it fell to my share!"
"How?" replied Wild. "Is this your gratitude to me for saving your life? For your own conscience must convince you of your guilt."
"Marry come up!" quoth Bagshot. "I believe my life alone will not be in danger. Can you deny your share?"
"Yes, you rascal!" answered Wild. "I do deny everything, and do you find a witness to prove it. I will show you the difference between committing a robbery and conniving at it."
So alarmed was Bagshot at the threats of Wild that he drew forth all he found in his pockets, to the amount of twenty-one guineas, which he had just gained at dice.
Wild now returned to the count, and informed him that he had got ten guineas of Bagshot, and by these means the count was once more enlarged, and enabled to carry out a new plan of the great Wild.
III.--Mr. Heartfree's Weakness
By accident, Wild had met with a young fellow who had formerly been his companion at school.
Mr. Thomas Heartfree (for that was his name) was of an honest and open disposition. He was possessed of several great weaknesses of mind, being good-natured, friendly, and generous to a great excess.
This young man, who was about Wild's age, had some time before set up in the trade of a jeweller, in the materials for which he had laid out the greatest part of a little fortune.
He no sooner recognised Wild than he accosted him in the most friendly manner, and invited him home with him to breakfast, which invitation our hero, with no great difficulty, consented to.
Wild, after vehement professions of friendship, then told him he had an opportunity of recommending a gentleman, on the brink of marriage, to his custom, "and," says he, "I will endeavour to prevail on him to furnish his lady with jewels at your shop."
Having parted from Heartfree, Wild sought out the count, who, in order to procure credit from tradesmen, had taken a handsome house, ready-furnished, in one of the new streets. He instructed the count to take only one of Heartfree's jewels at the first interview, to reject
the rest as not fine enough, and order him to provide some richer. The count was then to dispose of the jewel, and by means of that money, and his great abilities at cards and dice, to get together as large a sum as possible, which he was to pay down to Heartfree at the delivery of the set of jewels.
This method was immediately put in execution; and the count, the first day, took only a single brilliant, worth about £300, and ordered a necklace and earrings, of the value of £3,000 more, to be prepared by that day week.
This interval was employed by Wild in raising a gang, and within a few days he had levied several bold and resolute fellows, fit for any enterprise, how dangerous or great soever.
The count disposed of his jewel for its full value, and by his dexterity raised £1,000. This sum he paid down to Heartfree at the end of the week, and promised him the rest within a month. Heartfree did not in the least scruple giving him credit, but as he had in reality procured those jewels of another, his own little stock not being able to furnish anything so valuable. The count, in addition to the £1,000 in gold, gave him his note for £2,800 more.
As soon as Heartfree was departed, Wild came in and received the casket from the count, and an appointment was made to meet the next morning to come to a division of its contents.
Two gentlemen of resolution, in the meantime, attacked Heartfree on his way home, according to Wild's orders, and spoiled the enemy of the whole sum he had received from the count. According to agreement, Wild, who had made haste to overtake the conquerors, took nine-tenths of the booty, but was himself robbed of this £900 before nightfall.
As for the casket, when he opened it, the stones were but paste. For the sagacious count had conveyed the jewels into his own pocket, and in their stead had placed artificial stones. On Wild's departure the count hastened out of London, and was well on his way to Dover when Wild knocked at his door.
Heartfree, wounded and robbed, had only the count's note left, and this was returned to him as worthless, inquiries having proved that the count had run away. So confused was poor Heartfree at this that his creditor for the jewels was frightened, and at once had him arrested for the debt.
Heartfree applied in vain for money to numerous customers who were indebted to him; they all replied with various excuses, and the unhappy wretch was soon taken to Newgate. He had been inclined to blame Wild for his misfortunes, but our hero boldly attacked him for giving credit to the count, and this degree of impudence convinced both Heartfree and his wife of Wild's innocence, the more so as the latter promised to procure bail for his friend. In this he was unsuccessful, and it was long before Heartfree was released and restored to happiness.

Henry Fielding, "Amelia" (1751)
Quatrième et dernier roman de Fielding, "Amelia" apparaît comme très différent de ses oeuvres précédentes, on y trouve l'influence de Richardson, une atmosphère tranquille et le réalisme psychologique d'un milieu bourgeois. Fielding est alors magistrat à Bow Street et conçoit son livre, nous dit-il, "pour promouvoir la cause de la vertu, et exposer certains des maux les plus plus flagrants, tant publics que privés, qui infestent actuellement le pays" ("sincerely designed to promote the cause of virtue, and to expose some of the most glaring evils, as well public as private, which at present infest the country"), la licence des riches "hommes de la ville" (men about town), la corruption de la justice, de l'Etat, de la société, les abus du système pénitentiaire.
Les deux protagonistes, le jeune et bel officier William Booth et Amélie Harris, avec qui il s`est enfui pour l`épouser contre la volonté de sa mère, forment un contraste grâce auquel leurs deux caractères s'éclairent réciproquement. L`homme est fin et impressionnable, la femme. sentimentale, mais constante; le premier est sceptique, la deuxième croyante. La pauvreté de ces deux jeunes gens, l`étourderie et le faible caractère de Booth et la beauté d'Amélie sont la cause de nombreux malheurs et de quelques intrigues, dont le récit constitue la trame du livre, avec au passage, la dénonciation d'un certain nombre de travers et de maux sociaux de l`époque. Enfin, n'oublions que l'auteur avait sa propre femme à l'esprit lorsqu'il a dessiné le portrait d'Amelia, la femme et l'épouse qu'il a aimées plus que tout...
I.--The Inside of a Prison
On the first of April, in the year - , the watchmen of a certain parish in Westminster brought several persons, whom they had apprehended the preceding night, before Jonathan Thrasher, Esq., one of the justices of the peace for that city.
Among the prisoners a young fellow, whose name was Booth, was charged with beating the watchman in the execution of his office, and breaking his lantern. The justice perceiving the criminal to be but shabbily dressed, was going to commit him without asking any further questions, but at the earnest request of the accused the worthy magistrate submitted to hear his defence.
The young man then alleged that as he was walking home to his lodgings he saw two men in the street cruelly beating a third, upon which he had stopped and endeavoured to assist the person who was so unequally attacked; that the watch came up during the affray, and took them all
four into custody; that they were immediately carried to the round-house, where the two original assailants found means to make up the matter, and were discharged by the constable, a favour which he himself, having no money in his pocket, was unable to obtain. He utterly
denied having assaulted any of the watchmen, and solemnly declared that he was offered his liberty at the price of half a crown.
Though the bare word of an offender can never be taken against the oath of his accuser, yet the magistrate might have employed some labour in cross-examining the watchman, or at least have given the defendant time to send for the other persons who were present at the affray; neither of which he did.
Booth and the poor man in whose defence he had been engaged were both dispatched to prison under a guard of watchmen.
Mr. Booth was no sooner arrived in the prison than a number of persons gathered around him, all demanding garnish. The master or keeper of the prison then acquainted him that it was the custom of the place for every prisoner, upon his first arrival there, to give something to the former prisoners to make them drink. This was what they called garnish. Mr. Booth answered that he would readily comply with this laudable custom, were it in his power; but that in reality he had not a shilling in his pocket, and, what was worse, he had not a shilling in the world. Upon which the keeper departed, and left poor Booth to the mercy of his companions, who, without loss of time, stripped him of his coat and hid it.
Mr. Booth was too weak to resist and too wise to complain of his usage. He summoned his philosophy to his assistance, and resolved to make himself as easy as possible under his present circumstances.
On the following day, Miss Matthews, an old acquaintance whom he had not seen for some years, was brought into the prison, and Booth was shortly afterwards invited to the room this lady had engaged. Miss Matthews, having told her story, requested Booth to do the same, and to this he acceded.
II.--Captain Booth Tells His Story
"From the first I was in love with Amelia; but my own fortune was so desperate, and hers was entirely dependent on her mother, a woman of violent passions, and very unlikely to consent to a match so highly contrary to the interest of her daughter, that I endeavoured to refrain from any proposal of love. I had nothing more than the poor provision of an ensign's commission to depend on, and the thought of leaving my Amelia to starve alone, deprived of her mother's help, was intolerable to me.
"In spite of this I could not keep from telling Amelia the state of my heart, and I soon found all that return of my affection which the tenderest lover can require. Against the opposition of Amelia's mother, Mrs. Harris, to our engagement, we had the support of that good man, Dr. Harrison, the rector; and at last Mrs. Harris yielded to the doctor, and we were married. There was an agreement that I should settle all my Amelia's fortune on her, except a certain sum, which was to be laid out in my advancement in the army, and shortly afterwards I was preferred to the rank of a lieutenant in my regiment, and ordered to Gibraltar. I noticed that Amelia's sister, Miss Betty, who had said many ill-natured things of our marriage, now again became my friend.
"At the siege of Gibraltar I was very badly wounded, and in this situation the image of my Amelia haunted me day and night. Two months and more I continued in a state of uncertainty; when one afternoon poorAtkinson, my servant, came running to my room. I asked him what was the matter, when Amelia herself rushed into the room, and ran hastily to me. She gently chided me for concealing my illness from her, saying, 'Oh, Mr. Booth! And do you think so little of your Amelia as to think I could or would survive you?' Amelia then informed me that she had received a letter from an unknown hand, acquainting her with my misfortune, and advising her, if she desired to see me more, to come directly to Gibraltar.
"From the time of Amelia's arrival nothing remarkable happened till my perfect recovery; and then the siege being at an end, and Amelia being in some sort of fever, the governor gave me leave to attend my wife to Montpelier, the air of which was judged to be most likely to restore her to health.
"A fellow-officer, Captain James, willingly lent me money, and, after an ample recovery at Montpelier, and a stay in Paris, we returned to England. It was in Paris we received a long letter from Dr. Harrison, enclosing £100, and containing the news that Mrs. Harris was dead, and had left her whole fortune to Miss Betty. So now it was that I was a married man with children, and the half-pay of a lieutenant.
"Dr. Harrison, at whose rectory we were staying, came to our assistance. He asked me if I had any prospect of going again into the army; if not, what scheme of life I proposed to myself.
"I told him that as I had no powerful friends, I could have but little expectations in a military way; that I was incapable of thinking of any other scheme, for I was without the necessary knowledge or experience, and was likewise destitute of money to set up with.
"The doctor, after a little hesitation, said he had been thinking on this subject, and proposed to me to turn farmer. At the same time he offered to let me his parsonage, which was then become vacant; he said it was a farm which required but little stock, and that little should not be wanting.
"I embraced this offer very eagerly, and Amelia received the news with the highest transports of joy. Thus, you see me degraded from my former rank in life; no longer Captain Booth, but Farmer Booth.
"For a year all went well; love, health, and tranquillity filled our lives. Then a heavy blow befell us, and we were robbed of our dear friend the doctor, who was chosen to attend the young lord, the son of the patron of the living, in his travels as a tutor.
"By this means I was bereft not only of the best companion in the world, but of the best counsellor, and in consequence of this loss I fell into many errors.
"The first of these was in enlarging my business by adding a farm of one hundred a year to the parsonage, in renting which I had also as bad a bargain as the doctor had before given me a good one. The consequence of which was that whereas at the end of the first year I was £80 to the good, at the end of the second I was nearly £40 to the bad.
"A second folly I was guilty of was in uniting families with the curate of the parish, who had just married. We had not, however, lived one month together before I plainly perceived the curate's wife had taken a great prejudice against my wife, though my Amelia had treated her with nothing but kindness, and, with the mischievous nature of envy, spread dislike against us.
"My greatest folly, however, was the purchase of an old coach. The farmers and their wives considered that the setting up of a coach was the elevating ourselves above them, and immediately began to declare war against us. The neighbouring little squires, too, were uneasy to see a poor renter become their equal in a matter in which they placed so much dignity, and began to hate me likewise.
"My neighbours now began to conspire against me. Whatever I bought, I was sure to buy dearer, and when I sold, I was obliged to sell cheaper than any other. In fact, they were all united; and while they every day committed trespasses on my lands with impunity, if any of my cattle escaped into their fields I was either forced to enter into a law-suit or to make amends for the damage sustained.
"The consequence of all this could be no other than ruin. Before the end of four years I became involved in debt to the extent of £300. My landlord seized my stock for rent, and, to avoid immediate confinement in prison, I was forced to leave the country.
"In this condition I arrived in town a week ago. I had just taken a lodging, and had written my dear Amelia word where she might find me; and that very evening, as I was returning from a coffee-house, because I endeavoured to assist the injured party in an affray, I was seized by the watch and committed here by a justice of the peace."
