- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Giacomo Leopardi (1798-1837), "Canzoni" (1824), "Operette morali" (1827), "Canti" (1835), "Appressamento della morte" (1835), "Il Fiore del Deserto" (1836), "Zibaldone" (1817-1832) - ....
Last update: 02/02/2023

Les deux plus importants écrivains italiens de ce premier quart du XIXe siècle furent le poète et romancier Alessandro Manzoni (17851873) et le poète, érudit et philosophe Giacomo Leopardi (1798-1837). Leopardi, un contemporain de Manzoni, écrivit des poèmes d'un lyrisme superbe et des ouvrages philosophiques d'une extraordinaire érudition, Enfant prodige, il fut handicapé par sa mauvaise vue et les difficultés relationnelles avec ses parents. ll exprima ses espoirs et ses amertumes dans des poèmes comme "Appressamento della morte" (Approche de la mort, 1835), une œuvre visionnaire dont l'écriture est inspirée de Pétrarque et de Dante. Son amour non partagé pour sa cousine et la mort d'un proche de la famille lui inspirèrent "Il primo amore" (Premier amour) et "A Silvia", en 1817-1818. Le recueil de poèmes de Leopardi comprend "Canzoni" (Chants, 1824), "Versi"(1826) et "Il canti" (1831).
ll acheva également "Operette Morali" (Petites œuvres morales, 1827), une pièce philosophique sur le désespoir et la nostalgie. Son œuvre finale, et son canto le plus long, fut "La Ginestra", connue également sous le titre "ll Fiore del Deserto" (Le genêt ou La fleur du désert, 1836), qui est considérée comme son testament moral en tant que poète en raison de sa tentative de mise en valeur du pouvoir du pessimisme comme moyen d'incitation au changement...
(Tommaso Minardi (1787-1871), "Self-Portrait", 1803, Galleria d'Arte Moderna, Florence)
All’Italia
O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l’erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! Io chiedo al cielo
E al mondo: dite dite;
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
Che di catene ha carche ambe le braccia;
Sì che sparte le chiome e senza velo
Siede in terra negletta e sconsolata,
Nascondendo la faccia
Tra le ginocchia, e piange.
Piangi, che ben hai donde, Italia mia,
Le genti a vincer nata
E nella fausta sorte e nella ria.
Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive,
Mai non potrebbe il pianto
Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;
Che fosti donna, or sei povera ancella.
Chi di te parla o scrive,
Che, rimembrando il tuo passato vanto,
Non dica: già fu grande, or non è quella?
(...)
"Ma patrie, je vois les murs, les arcs, les colonnes, les statues et les tours désertes de nos aïeux ; mais leur gloire, je ne la vois pas ; je ne vois ni le laurier ni le fer que ceignaient nos pères antiques. Aujourd’hui, désarmée, tu montres un front nu, une poitrine nue. Hélas ! quelles blessures ! quelle pâleur ! que de sang ! Oh ! dans quel état je te vois, femme très belle ! Je demande au ciel et au monde : Dites, dites, qui l’a réduite à ce point ? Et ce qui est pis encore, elle a les deux bras chargés de chaînes. Les cheveux épars et sans voile, elle s’est assise à terre, abandonnée et désespérée : elle cache sa figure entre ses genoux et elle pleure. Pleure, car tu as bien de quoi pleurer, mon Italie, toi qui es née pour vaincre les nations dans la bonne fortune et dans la mauvaise.
« Quand même tes yeux seraient deux sources vives, jamais tes larmes ne pourraient égaler ta misère et ton déshonneur : car tu as été maîtresse et tu es maintenant une pauvre servante. Qui parle de toi, qui écrit sur toi, sans se souvenir de ton passé et dire : elle a été grande jadis et maintenant elle ne l’est plus ? Pourquoi ? pourquoi ? Où est la force antique ? où sont les armes, la valeur et la constance ? Qui t’a arraché ton épée ? Qui t’a trahie ? Quel artifice, quel effort, quelle si grande puissance a pu te dépouiller de ton manteau et de ton bandeau d’or ? Comment et quand es-tu tombée d’une telle hauteur en un lieu si bas ? Personne ne combat pour toi ? aucun des tiens ne te défend ? Des armes ! donnez-moi des armes ! Je combattrai seul, je tomberai seul. Fais, ô Ciel, que mon sang soit du feu pour les poitrines italiennes. ....

Giacomo Leopardi (1798–1837)
Né le 29 juin 1798 à Recanati (États pontificaux), Giacomo fut poète, érudit et philosophe dont les œuvres savantes et philosophiques exceptionnelles et la superbe poésie lyrique le placèrent parmi les grands écrivains du XIXe siècle. Enfant précoce, congénitalement déformé, de parents nobles mais apparemment insensibles, Giacomo épuisa rapidement les ressources de ses tuteurs. À l’âge de 16 ans, il maîtrisait indépendamment d'eux le grec, le latin et plusieurs langues modernes, avait traduit de nombreuses œuvres classiques et avait écrit deux tragédies, de nombreux poèmes italiens et plusieurs commentaires savants. Mais cette étude excessive eut des répercussions physiques et développa une maladie cérébro-spinale qui l’affligea toute sa vie. Contraint de suspendre ses études pendant de longues périodes, blessé par l’insouciance de ses parents et soutenu uniquement par des relations heureuses avec son frère et sa sœur, il a déversé ses espoirs et son amertume dans des poèmes tels que "Appressamento della morte" (écrit en 1816, publié en 1835, « Approche de la mort »), œuvre visionnaire in terza rima, imitative de Pétrarque et de Dante, mais écrite avec un talent poétique considérable et inspirée par un véritable sentiment de désespoir...
LE PREMIER AMOUR. (1831.)
Il me revient à l’esprit, le jour où je sentis pour la première fois l’assaut de l’amour et où je dis : Hélas ! si c’est l’amour, comme il fait souffrir !
Les yeux à toute heure tournés et fixés vers le sol, je regardais celle qui la première et innocemment ouvrit l’entrée de ce cœur.
Ah ! comme tu m’as mal gouverné, amour ! Pourquoi une si douce passion devait-elle apporter avec elle tant de désir, tant de douleur ?
Pourquoi ce plaisir si grand me descendait-il dans le cœur, non pas serein, entier et libre, mais plein de souffrance et de lamentation ?
Dis-moi, tendre cœur, quelle crainte, quelle angoisse éprouvais-tu au milieu de cette pensée auprès de laquelle toute joie t’était un ennui ?
Cette pensée, qui le jour, qui la nuit s’offrait à toi, séductrice, alors que tout paraissait tranquille dans notre hémisphère ;
Inquiète, heureuse et misérable, tu brisais mon corps sur ma couche, et mon cœur palpitait sans trêve.
Et quand triste, fatigué, épuisé, je fermais mes yeux au sommeil, ce sommeil, entrecoupé comme par le délire de la fièvre, me manquait bientôt.
Ô combien vive au milieu des ténèbres surgissait la douce image ! comme mes yeux fermés la contemplaient sous leurs paupières !
Ô quels suaves mouvements se répandaient et se glissaient dans mes os ! Ô comme dans mon âme mille pensées changeantes, confuses,
Se déroulaient. Tel le zéphyr parcourant le feuillage d’une antique forêt en tire un murmure long et incertain.
Et pendant que je me taisais, pendant que je n’agissais pas, que disais-tu, ô mon âme, du départ de celle qui te fit souffrir et palpiter ?
Je ne me sentis pas plutôt brûler de la flamme d’amour, que le vent léger, qui nourrissait cette flamme, s’en alla.
J’étais couché au point du jour, sans penser à rien, et les chevaux qui devaient me rendre solitaire piaffaient sous le logis paternel.
Timide, tranquille et sans expérience, dans l’obscurité je tendais vers le balcon mon oreille avide et mes yeux vainement ouverts,
Pour saisir un mot, s’il devait en sortir de ses lèvres un qui fût le dernier : un mot ! car, hélas ! le ciel m’enlevait tout le reste.
Combien de fois une voix plébéienne frappa mon oreille incertaine, et un frisson me prit et mon cœur se mit à battre au hasard.
Et quand enfin s’éloigna de moi la voix chère à mon cœur et qu’on entendit le bruit des chevaux et des roues ;
Alors resté seul au monde, je me recouchai, et, les yeux fermés, je serrai de ma main mon cœur qui palpitait et je soupirai.
Puis, stupidement, je traînai mes genoux tremblants par la chambre muette. « Quelle autre, disais-je, pourra toucher mon cœur ? »
Alors le souvenir amer se logea dans ma poitrine, et me serrait le cœur à chaque mot, devant chaque visage.
Et un long chagrin me pénétrait le sein, comme quand la pluie du ciel tombe sans interruption et lave mélancoliquement les plaines.
Enfant âgé de deux fois neuf soleils, je ne te connaissais pas, Amour, quand mon cœur né pour pleurer subissait tes premières épreuves,
Quand je méprisais tout plaisir, quand je n’aimais ni le rire des astres, ni le silence de l’aurore tranquille, ni le verdoiement des prés.
Même l’amour de la gloire se taisait alors en moi, qu’il échauffait tant d’ordinaire, au moment où l’amour de la beauté s’y installa.
Je ne tournai plus les yeux vers mes études familières : elles me parurent vaines, elles qui m’avaient fait croire que tout autre désir était vain.
Ah ! comment ai-je été si différent de moi-même ? comment cet amour si grand me fut-il enlevé par un autre amour ? Ah ! combien en vérité nous sommes vains !
Seul mon cœur me plaisait : enseveli dans un perpétuel entretien avec mon cœur, je faisais bonne garde autour de ma douleur.
Le regard fixé sur le sol ou ramené au dedans de moi, je ne souffrais plus qu’il rencontrât, même fugitif et vague, un visage beau ou laid.
L’image immaculée et candide qui était peinte dans mon âme, je craignais de la troubler, comme le vent trouble l’onde d’un lac.
Et ce remords de n’avoir pas joui pleinement, qui alourdit l’âme et change en poison le plaisir qui est passé.
Pendant ces jours lointains me piquait au cœur à tout instant : la honte ne faisait pas encore sa dure morsure dans mon âme.
Au ciel et à vous, âmes nobles, je jure que aucun désir bas ne m’entra dans le cœur, que je brûlai d’un feu pur de toute souillure.
Ce feu vit encore, ma passion vit, et elle respira dans ma pensée la belle image de celle qui ne me donna jamais que des plaisirs célestes,
Et je m’en contente. (...)
"Appressamento della morte" (écrit en 1816, publié en 1835, « Approche de la mort »),
"Era morta la lampa in Occidente,
E queto ’l fumo sopra i tetti e queta
De’ cani era la voce e de la gente:
Quand’i’ volto a cercare eccelsa meta,
Mi ritrova’ in mezzo a una gran landa,
Bella, che vinto è ’ngegno di poeta.
Spandeva suo chiaror per ogni banda
La sorella del sole, e fea d’argento
Gli arbori ch’a quel loco eran ghirlanda.
I rami folti gian cantando al vento,
E ’l mesto rosignol che sempre piagne
Diceva tra le frasche suo lamento.
Chiaro apparian da lungi le montagne,
E ’l suon d’un ruscelletto che correa
Empiea il ciel di dolcezza e le campagne.
Fiorita tutta la piaggia ridea,
E un’ombra vaga ne la valle bruna
Giù d’una collinetta discendea.
Sprezzando ira di gente e di fortuna,
Pel muto calle i’ gia da me diviso,
Cui vestia ’l lume della bianca luna.
Quella vaghezza rimirando fiso,
Sentia l’auretta che gli odori spande,
Mollissima passarmi sopra ’l viso.
Se lieto i’ fossi è van che tu dimande,
Grand’era ’l ben ch’aveva, ed era ’l bene
Onde speme nutria, di quel più grande.
Ahi son fumo quaggiù l’ore serene!
Un momento è letizia, e ’l pianto dura.
Ahi la tema è saggezza, error la spene.
Ecco imbrunir la notte, e farsi scura
La gran faccia del ciel ch’era sì bella,
E la dolcezza in cor farsi paura.
Un nugol torbo, padre di procella,
Sorgea di dietro ai monti e crescea tanto
Che non si vedea più luna né stella.
Io ’l mirava aggrandirsi d’ogni canto,
E salir su per l’aria a poco a poco,
E al ciel sopra mia testa farsi manto.
Veniva ’l lume ad ora ad or più fioco,
E ’ntanto tra le frasche crescea ’l vento,
E sbatteva le piante del bel loco,
E si facea più forte ogni momento
Con tale uno stridor che svolazzava
Tra le fronde ogni augel per lo spavento.
(...)

Deux expériences en 1817 et 1818 privent Leopardi de l’optimisme qu’il lui restait encore : son amour frustré pour sa cousine mariée, Gertrude Cassi (sujet de son journal "Diario d’amore" et de l’élégie « Il primo amore »), et la mort par consomption de Terese Fattorini, jeune fille du cocher de son père, sujet d’une de ses plus grandes paroles, « A Silvia ». Les dernières lignes de ce poème expriment l’angoisse qu’il a ressentie toute sa vie : « O nature, nature, / Pourquoi n'accomplis-tu pas / Ta première belle promesse ? / Pourquoi trompes-tu ainsi / Tes enfants ? » ...
Diario del primo amore
Io cominciando a sentire l’impero della bellezza, da più d’un anno desiderava di parlare e conversare, come tutti fanno, con donne avvenenti, delle quali un sorriso solo, per rarissimo caso gittato sopra di me, mi pareva cosa stranissima e meravigliosamente dolce e lusinghiera; e questo desiderio della mia forzata solitudine era stato vanissimo fin qui. Ma la sera dell’ultimo Giovedì, arrivò in casa nostra, aspettata con piacere da me, né conosciuta mai, ma creduta capace di dare qualche sfogo al mio antico desiderio, una Signora Pesarese nostra parente più tosto lontana, di ventisei anni, col marito di oltre a cinquanta, grosso e pacifico, alta e membruta quanto nessuna donna ch’io m’abbia veduta mai, di volto però tutt’altro che grossolano, lineamenti tra il forte e il delicato, bel colore, occhi nerissimi, capelli castagni, maniere benigne, e, secondo me, graziose, lontanissime dalle affettate, molto meno lontane dalle primitive, tutte proprie delle Signore di Romagna e particolarmente delle Pesaresi, diversissime, ma per una certa qualità inesprimibile, delle nostre Marchegiane....
Journal du premier amour
Comme je commençais à sentir l'influence de la beauté, depuis plus d'un an je désirais parler et converser, comme tout le monde le fait, avec des femmes séduisantes, dont un seul sourire, par le plus grand des hasards, me semblait une chose très étrange et merveilleusement douce et flatteuse ; et ce désir de ma solitude forcée avait été très vain jusqu'à présent. Mais jeudi dernier, dans la soirée, une dame de Pesaro, parente éloignée, âgée de vingt-six ans, avec un mari de plus de cinquante ans, grande et paisible, aussi grande et hérissée qu'aucune femme que j'aie jamais vue, est arrivée chez nous, attendue avec plaisir par moi, inconnue de moi, mais que l'on croyait capable de donner un peu d'essor à mon ancien désir, un visage, cependant, tout sauf grossier, des traits entre forts et délicats, une belle couleur, des yeux très noirs, des cheveux châtains, des manières bénignes, et, à mon avis, gracieuses, très loin de l'affecté, beaucoup moins loin du primitif, tout cela typique des dames de la Romagne et particulièrement des Pesaresi, très différentes, sauf pour une certaine qualité inexprimable, de nos Marchegiane....
À SILVIA (1831)
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?
Sonavan le quiete
stanze, e le vie d’intorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
(...)
Silvia, te souviens-tu du temps de ta vie mortelle, alors que la beauté resplendissait dans tes yeux riants et fugitifs et que, joyeuse et pensive, tu franchissais le seuil de la jeunesse ?
Les chambres tranquilles et les rues à l’entour résonnaient de ton chant perpétuel, alors qu’appliquée aux ouvrages de femme tu étais assise, contente de ce vague avenir que tu avais dans l’esprit. Mai était odorant, et tu avais coutume de passer ainsi le jour.
Moi, laissant quelquefois mes belles études et mes laborieux écrits, où se dépensaient mon premier âge et la meilleure partie de moi, de la terrasse de la maison paternelle je tendais l’oreille au son de ta voix et au bruit de ta main rapide qui parcourait la toile pénible. Je regardais le ciel serein, les rues dorées et les jardins, et, au loin, d’un côté la mer, de l’autre la montagne. Langue mortelle ne dit pas ce que je sentais dans mon cœur.
Quelles pensées suaves, quelles espérances, quels chœurs, ô ma Silvia ! Quelles nous apparaissaient alors la vie et la destinée humaines ! Quand il me souvient de tant d’espérance, je suis oppressé par un sentiment âpre et inconsolable qui me ramène à la douleur de mon infortune. Ô nature, ô nature, pourquoi ne donnes-tu pas ce que tu promets alors ? Pourquoi trompes-tu à ce point tes fils ?
Et toi, avant que l’hiver ne desséchât l’herbe, combattue et vaincue par une maladie intime, tu périssais, ô tendre jeune fille ! et tu ne voyais pas la fleur de tes ans ; et ton cœur n’était pas charmé par le doux éloge ou de ta noire chevelure ou de tes regards amoureux et réservés ; et avec toi tes compagnes aux jours de fête ne causaient pas d’amour.
Bientôt aussi périssait ma douce espérance ; à mes années aussi les destins refusèrent la jeunesse. Ah ! comme, comme tu as passé, chère compagne de mon premier âge, mon espérance pleurée ! C’est donc là ce monde ? ce sont là les plaisirs, l’amour, les œuvres, les événements dont nous nous entretînmes si souvent ? C’est là le sort des races humaines ? À l’apparition de la réalité, tu tombas, malheureuse ; et avec la main tu montrais de loin la froide mort et une tombe nue.
La souffrance intérieure de Leopardi a été soulagée en 1818 par la visite de l’érudit et patriote Pietro Giordani, qui l’a exhorté à résister à la situation douloureuse qui régnait chez lui. Enfin, il se rendit à Rome pour quelques mois, malheureux, (1822-1823), puis retourna chez lui pour une autre période toute aussi douloureuse, éclairée seulement par la publication en 1824 de son recueil de vers, "Canzoni". En 1825, il accepta une offre pour éditer les œuvres de Cicéron à Milan. Pendant les années suivantes, il voyagea entre Bologne, Recanati, Pise et Florence et publia "Versi" (1826), un recueil de poèmes, et "Operette morali" (1827), une exposition philosophique principalement sous forme de dialogue, de sa doctrine du désespoir...

"PETITES PIÈCES MORALES" (Operette morali, 1824-1832)
Ces vingt-quatre morceaux en prose, qui prennent généralement la forme de dialogues philosophiques, ont été composés pour la plupart en 1824, les deux derniers datant de 1832. Ils représentent l'aboutissement d'une période d'intense réflexion et la réorganisation d'une partie des matériaux accumulés dans les notes du "Zibaldone", ainsi qu'un travail de clarification qui dénoue les contradictions latentes d`une pensée en cours d'élaboration.
À l'époque de la composition des premières pièces, Leopardi est de retour dans son village natal après un séjour romain qui n'a fait que le confirmer dans sa conviction que la société de son temps est plongée dans l'immoralité et l'ignorance. Les Romains n'ont plus de leurs ancêtres que le nom et ils épouvantent Leopardi par leur superficialité et leur vulgarité. Il sort de cette expérience aigri, sa veine poétique tarie, mais capable, lui semble-t-il, d'accéder à la lucidité et au détachement du philosophe.
Refait alors surface l'intention, déjà manifestée dans sa jeunesse, de fustiger les mœurs dans des satires en prose dont il trouve les modèles aussi bien chez les Grecs et les Latins que chez les écrivains français du XVIIIe siècle. Les "Petites pièces morales" se détacheront pourtant de leurs modèles en privilégiant les créations fantastiques, les images poétiques et un style très travaillé, voire archaïsant, teinté d`une amère ironie. Avec ce recueil, Leopardi a l'ambition de créer un modèle de prose italienne, à la fois élégante et apte à se plier aux exigences de l'argumentation philosophique.
- Le spectacle d`une société délabrée, égoïste et lâche rend plus douloureux pour Leopardi le sentiment de la perte irréparable de l`intimité avec la nature originelle : les progrès de la raison et du savoir ont dénaturé l'homme et ont détruit les croyances primitives qui lui donnaient l'illusion du bonheur. Illusion, certes, car l'homme, tourmenté par un désir infini et inassouvissable de plaisir, est nécessairement malheureux. Leopardi sourit amèrement devant le ridicule triomphalisme des savants contemporains, persuadés que la science peut rendre l'homme heureux, alors que le pouvoir destructeur de la raison, étouffant l'imagination et les passions généreuses, génère ce sentiment de vide et d'ennui qui est, pour l'homme moderne, la seule alternative à la douleur - "Histoire du genre humain" [Storia del genere umano]. "Dialogue du Tasse et de son génie familier" [Dialogo di T orquato Tasso e del suo Genio familiare].
- Au sage qui reconnaît le caractère mensonger de l'espoir, il ne reste qu'à accepter son sort avec courage en attendant de sombrer dans le néant, la mort seule pouvant le soustraire à l'inutilité et à la douleur de vivre - "Dialogue de Plotin et de Porphyre" (Dialogo di Platino e di Porfiriol). Le seul passage en vers des "Petites pièces morales" est un hymne à la mort - "Cœur des morts" [Coro dei morti].

C'est justement lors de la rédaction de ces "Petites pièces morales" de 1824 que Leopardi trouve une issue à un dilemme qui le tourmentait de plus en plus : pourquoi la nature a-t-elle créé les êtres vivants sensibles à la douleur et capables de désir, c'est-à-dire inévitablement malheureux? Brusquement, il formule un violent réquisitoire contre la nature. responsable du mal universel, et l'accuse d'être une marâtre qui engendre pour détruire, sourde à tout cri de douleur, uniquement occupée à perpétuer la vie de l'univers aux dépens de tous les êtres créés - "Dialogue de la Nature et d'un Islandais" [Dialogo della natura et di un Islandese].
C'est ainsi que Leopardi, s`inspirant à la fois de Straton, de Lucrèce et des matérialistes du XVIIIe siècle, décrit alors l'Univers comme une masse en constante évolution dont l'homme n`est qu`une des productions momentanées - "Cantique du coq sylvestre" [Cantico del gallo silvestre], "Fragment apocryphe de Straton de Lampsaque" [Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaca].
L'homme mène contre la nature un combat inégal, mais s'il ne peut éviter de souffrir, il peut, en refusant d'embrasser d`illusoires doctrines du bonheur. soulager ses compagnons de lutte grâce à ces valeurs purement humaines que sont la pitié, la solidarité, l`amitié, le sens du devoir - "Dialogue de Timandre et d'EIéandre, de Plotin et de Porphyre, de Tristan et d 'un ami"...
Le manque d’argent l’oblige à vivre à Recanati (1828-1830), mais il s’enfuit à nouveau à Florence grâce à l’aide financière d’amis et publie un autre recueil de poèmes, "I canti" (1831). L’amour frustré pour une beauté florentine, Fanny Targioni-Tozzetti, a inspiré certaines de ses paroles les plus tristes. Un jeune exilé napolitain, Antonio Ranieri, est devenu son ami et seul réconfort. Leopardi s’installe à Rome, puis à Florence, et finalement à Naples en 1833, où, entre autres œuvres, il écrivit "Ginestra" (1836), un long poème inclus dans la collection posthume de ses œuvres de Ranieri (1845). La mort qu’il considérait depuis longtemps comme la seule libération lui vint soudainement dans une épidémie de choléra à Naples...
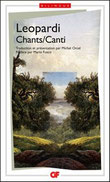
"Canti" (Chants, 1831)
Ce recueil de trente-six poèmes et de quelques fragments du poète Giacomo Leopardi constitue l'un des sommets de la littérature italienne ...
On distingue globalement la composition suivante,
- Dans les neuf premiers chants, écrits entre 1818 et 1823, Leopardi se concentre sur le thème du malheur humain, dû au détachement de l'homme de la nature.
- Suivent cinq idylles, composées entre 1819 et 1821 : L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, Il sogno, La vita solitaria. Leopardi s'y attarde dans un style « vago e indefinito».
- Les canti pisano-recanatesi, composés entre 1828 et 1830, expérimentent l'union du lyrisme et de la philosophie. Ils comprennent : Il risorgimento, A Silvia, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario.
- L'expérience amoureuse à Florence influence plutôt les canti fiorentini, composés entre 1830 et 1831. Font partie de ce groupe : Consalvo, Il pensiero dominante, Amore e Morte, A se stesso.
- C'est à la dernière phase de la vie du poète que remontent les canti napoletani (les deux chants « sépulcraux », la Palinodia, Il tramonto della luna, La ginestra). Dans chaque composition, Leopardi réfléchit à un aspect de sa philosophie, de la mort à la beauté et à la fragilité de la vie.
La première édition portant le titre de "Canti" parut à Florence en 1831 ; une édition augmentée vit le jour à Naples en 1835; l'édition complète, posthume, est de 1845. Parti de sujets patriotiques inspirés par la situation politique italienne ("A l'ItaIie", "Sur le monument de Dante", 1818), Leopardi insère très tôt le thème de la déchéance politique et morale de sa patrie dans une interprétation générale de l`Histoire comme dégradation progressive : l'excès de connaissances de l'homme moderne a troublé à jamais un état d'heureuse ignorance et de communion avec la nature, étouffant les passions génératrices d`actes héroïques et généreux, et révélant le caractère illusoire de la gloire et de la vertu.
"Quoique la paix rassemble nos peuples sous ses blanches ailes, les âmes italiennes ne se délivreront jamais des liens de l’antique sommeil, si cette terre prédestinée ne se retourne vers les exemples paternels de l’âge ancien. Ô Italie, prends à cœur de faire honneur aux hommes du passé : car tes contrées sont veuves aujourd’hui de tels hommes et il n’en est pas qui méritent que tu les honores. Tourne-toi en arrière et regarde, ô ma patrie, cette troupe infinie d’immortels, et pleure et irrite-toi contre toi-même : car désormais la douleur est sotte sans la colère. Tourne-toi, aie honte et éveille-toi : sois une fois mordue par la pensée de nos aïeux et de nos descendants.
Jadis les hôtes curieux, de climat, de génie et de langage différents, cherchaient, sur le sol toscan, où gisait celui dont les vers ont fait que le chantre Méonien n’est plus seul, et, ô honte, ils entendaient dire, non seulement que la cendre froide et les os nus du poète gisaient encore, depuis sa mort, dans l’exil, sous une terre étrangère, mais encore que dans tes murs, Florence, il ne s’élevait pas une pierre en l’honneur de celui dont le génie te fait honorer du monde entier. Hommes pieux ! par vous notre pays lavera un opprobre si triste et si humiliant. Tu as entrepris une belle œuvre, groupe vaillant et courtois, et qui te vaut l’amour de tout cœur que brûle l’amour de l’Italie.
Qu’il vous aiguillonne, l’amour de l’Italie, ô amis, l’amour de cette malheureuse pour qui la pitié est morte désormais dans toute poitrine, parce que le Ciel lui a donné des jours amers après une belle saison. Que votre courage soit accru, que votre œuvre soit couronnée par la miséricorde, ô fils d’Italie, et par la douleur et la colère d’un tel outrage, qui baigne de larmes ses joues et son voile. Mais vous, de quelle parole ou de quel chant doit-on vous parer, vous qui donnerez à cette douce entreprise vos soins et vos conseils, et qui y mettrez votre génie et votre main ? Quels accents vous enverrai-je qui puissent faire naître une nouvelle étincelle dans votre âme enflammée ? La hauteur du sujet vous inspirera ; il vous enfoncera dans le sein d’acres aiguillons. Qui dira les flots et le trouble de votre fureur et de votre immense amour ? Qui peindra l’éclair des yeux ? Quelle voix mortelle peut égaler en la figurant une chose céleste ? Loin, loin d’ici toute âme profane ! Oh ! quelles larmes l’Italie réserve à cette noble pierre ! Comment tombera votre gloire, comment et quand sera-t-elle rongée du temps ? Vous par qui notre mal est adouci, vous vivez toujours, ô arts chers et divins, consolation de notre malheureuse race, vous qui vous appliquez à célébrer les gloires italiennes parmi les ruines italiennes.
Voici que, désireux moi aussi d’honorer notre mère dolente, j’apporte ce que je puis et je mêle mon chant à votre œuvre, m’asseyant au lieu où votre fer donne la vie au marbre. Ô père glorieux du mètre toscan, si quelque nouvelle des choses terrestres et de Celle que tu as placée si haut arrive à vos rivages, je sais bien que pour toi tu n’en ressens pas de joie, que les bronzes et les marbres sont plus fragiles que la cire et le sable au prix de la renommée que tu as laissée de toi ; et si nos mémoires t’ont laissé tomber, si elles te laissent jamais tomber, croisse notre malheur, s’il peut croître, et puisse ta race obscure au monde entier pleurer en des deuils éternels.
Non, ce n’est pas pour toi que tu te réjouis : c’est pour ta pauvre patrie, dans l’espoir qu’un jour l’exemple des aïeux et des pères donne aux fils endormis et malades assez de valeur pour qu’une fois ils lèvent la tête ! Hélas ! de quel long tourment tu la vois affligée celle qui, humble, te saluait quand tu montas de nouveau au paradis ! Tu le vois : elle est aujourd’hui si abattue que, de son temps, elle était heureuse et reine en comparaison. Une telle misère l’étreint, qu’à la voir tu n’en crois peut-être pas tes yeux. J’omets les autres ennemis et les autres deuils, mais non le plus récent malheur et le plus cruel par lequel ta patrie se vit presque à son dernier soir. Tu es heureux, Dante, toi que le destin n’a pas condamné à vivre au milieu de tant d’horreurs ; toi qui n’as pas vu les femmes italiennes aux bras d’un soldat barbare, ni les villes et les maisons pillées et détruites par la lance ennemie et la fureur étrangère, ni les œuvres du génie italien emmenées au delà des Alpes pour une servitude misérable, ni les tristes chemins encombrés d’une foule de chars, ni les âpres commandements, ni la domination superbe ; toi qui n’as pas entendu les outrages et la parole impie de liberté qui nous raillait au bruit des chaînes et des fouets. Qui ne se lamente ? Quelle chose n’avons-nous pas soufferte ? À quoi n’ont-ils pas touché, ces félons ? À quel temple, à quel autel ou à quel crime ?
Pourquoi sommes-nous arrivés à des temps si pervers ? Pourquoi nous as-tu donné de naître ou pourquoi auparavant ne nous as-tu pas donné de mourir, cruel destin ? Nous voyons notre patrie servante et esclave d’étrangers et d’impies, nous voyons une lime mordante ronger sa vertu, et, en aucun point, il ne nous a été donné d’adoucir par quelque secours ou quelque consolation l’impitoyable douleur qui la déchirait. Ah ! tu n’as pas eu notre sang et notre vie, ô chère patrie, et je ne suis pas mort pour ta cruelle fortune. Ici la colère et la pitié abondent dans mon cœur ; un grand nombre de nous ont combattu, sont tombés ; mais ce n’était pas pour la moribonde Italie ; c’était pour ses tyrans...." (SUR LE MONUMENT DE DANTE)
Leopardi exprime le sentiment d'ennui et de douloureuse impuissance que cette découverte engendre dans les vers adressés au philologue Angelo Mai en 1820 ainsi que dans ceux que lui inspirèrent, l'année suivante, respectivement les noces de sa sœur Paolina et la victoire d'un jeune athlète. La nostalgie de l'Antiquité, largement évoquée dans ces poèmes, ne s`explique donc pas seulement par la formation classique de Leopardi et son admiration pour les temps héroïques : la jeunesse de l'humanité correspond pour le poète à une situation idéale d'équilibre ("Au printemps ou des fables antiques", "Hymne aux patriarches", 1922), "C`est pourquoi Brutus" (1821) et "Le Dernier Chant de Sapho" (1823) atteignent une telle intensité tragique : Brutus. qui dénonce avec lucidité le sort cruel que les dieux ont imposé aux hommes, et Sapho, qui constate une rupture dans l`harmonie primitive entre l`homme et l'Univers, vivent la fin du monde antique et l'avènement du règne de la raison; ils accomplissent alors par le suicide le seul geste noble et libre qui est au pouvoir de l'homme.
"... Quelle faute, quel excès sacrilège me souillèrent avant ma naissance, pour que le ciel et la fortune m’aient montré un visage si farouche ? En quoi péché-je toute enfant, à l’âge où l’on ignore le crime, pour qu’ensuite, sans jeunesse, sans fleur, le fil d’airain de ma vie se déroulât ainsi au fuseau de la Parque indomptée ? Mais ta lèvre répand des paroles imprudentes : un dessein obscur meut les événements marqués par le destin. Tout est mystère, hormis notre douleur. Race négligée, nous naissons pour les pleurs et la raison en reste au sein des dieux. Ô soins, ô espérances des vertes années ! Le Père a donné aux apparences, aux agréables apparences une éternelle royauté parmi les nations, et de viriles entreprises, une docte lyre ou un docte chant ne peuvent faire briller la vertu, si son vêtement est humble.
Nous mourrons. Laissant à terre son voile indigne, l’âme s’enfuira nue chez Pluton et corrigera l’erreur cruelle de l’aveugle dispensateur des événements. Et toi, à qui m’attachèrent un long amour, une longue fidélité et la vaine fureur d’un implacable désir, vis heureux, si jamais sur terre vécut heureux un enfant mortel. Jupiter ne m’a pas versé la douce liqueur du tonneau avare, après qu’eurent péri les illusions et le songe de mon enfance. Les jours les plus joyeux de notre vie s’envolent les premiers. Arrivent alors la maladie, la vieillesse et l’ombre de la mort glacée. De tant de palmes espérées et d’erreurs séduisantes, il me reste le Tartare ; et mon génie vaillant appartient à la Divinité du Ténare, à la nuit noire et à la rive silencieuse." (Le Dernier Chant de Sapho)
La condition de l'homme moderne implique pour Leopardi un renouvellement de la poésie : ELLE NE PEUT PLUS NAÎTRE DE L'IMAGINATION MAIS DU SENTIMENT car elle exprime la nostalgie d'une harmonie primordiale, d'un bonheur sans mélange que seul l'enfant peut encore éprouver. La poésie devient repli sur soi, attentive aux mouvements de l'âme et aux effusions du cœur, elle n`est plus description mais évocation, d'où le terme de "chant".
Leopardi réalise cet idéal esthétique dans un groupe de poèmes, sans doute les plus beaux, connus sous le titre d' "IDYLLES" (Piccoli Idilli), composés entre 1819 et 1821, "L'Infini" (L’Infinito), "A la lune" (Alla luna), "Le Soir du jour de fête" (La sera del dì di festa), "La Vie solitaire", La vita solitaria), où il prend ses distances par rapport aux formes fixes traditionnelles, abolit les références mythologiques, et mise au contraire sur la simplicité du langage, la longueur variable des strophes et les enjambements qui donnent au vers une allure spontanée et intimiste. Il applique surtout dans les Idylles les critères qu'il met au point parallèlement dans les notes du "Zibaldane" : l'être humain, être fini aspirant à un bonheur infini, recherche avec avidité tout ce qui lui suggère l'idée de l'immensité et stimule son imagination; un paysage à perte de vue partiellement caché par un objet au premier plan, une lumière incertaine éclairant faiblement les choses, un son qui se perd au loin...
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.
"Toujours chères me furent cette colline déserte et cette haie qui, sur un long espace, cache au regard l’extrême horizon. Mais, m’asseyant et regardant, au delà de la haie j’imagine d’interminables espaces, des silences surhumains, un profond repos où peu s’en faut que le cœur ne s’effraie. Et comme j’entends bruire le vent à travers le feuillage, je vais comparant le silence infini à cette voix : et je me souviens de l’éternité, des siècles morts, du siècle présent et vivant et du bruit qu’il fait. Ainsi dans cette immensité s’anéantit ma pensée et il m’est doux de faire naufrage dans cette mer." (L'Infini)
"L'infiní" illustre pleinement ce bonheur purement négatif, le seul que l'être humain puisse éprouver en supprimant les données de l'expérience et en annihilant la pensée : la conscience du réel étant douloureuse, la poésie en opère la transfiguration.

En 1823, Leopardi compose un seul poème et les années suivantes sont occupées par la rédaction des "Petites pièces morales" qui représentent une issue littéraire à une période d`intense réflexion : Leopardi y expose les conclusions matérialistes auxquelles il est parvenu et une conception de la nature comme force aveugle et destructrice qui soumet l'homme à un hallucinant cycle de création et de destruction. La poésie se pose alors comme alternative au néant : c'est lors d'une période de profond abattement moral que Leopardi compose les "Grandes ídylles" des années 1828-30 ("Grandi Idilli", Le Renouveau, A Silvia, Les Ressouvenirs, Le Passereau solitaire, Le Calme après la tempête (La Quiete dopo la Tempesta), Le Samedi du village (Il Sabato del Villaggio), Le Chant nocturne d'un berger errant de l'Asíe).
La tension de ces poèmes naît du rapport entre réflexion et évocation, entre la contemplation de l' "aride vérité" et la réémergence d'un passé que seul le poète peut se réapproprier par la puissance de suggestion du langage. Leopardi détourne le langage de son usage courant afin de lui rendre tout son dynamisme, exploite la polysémie, privilégie les archaïsmes et les termes vagues et indéfinis car ce sont les plus chargés de sens, joue sur leur résonance. Au-delà de l'évocation d'un passé autobiographique, la poésie du souvenir est une tentative de remonter aux origines et s'oppose ainsi à la marche inexorable de toute chose vers la destruction et la mort. Toute référence personnelle disparaît d'ailleurs du "Chant nocturne", interrogation de l'homme, confronté au mystère des lois cosmiques, sur le sens de son être. Par l'ampleur du discours poétique, servi par une structure très souple, et l'efficace simplicité du langage, le poème devient expression universelle de la douleur de vivre ...
"Canto notturno di un pastore errante dell’Asia"
"Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
Move la greggia oltre pel campo, e vede
Greggi, fontane ed erbe;
Poi stanco si riposa in su la sera:
Altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?
(...)
"Que fais-tu, lune, dans le ciel ? Dis-moi : que fais-tu, silencieuse lune ? Tu te lèves le soir, et tu vas contemplant les déserts ; puis tu te couches. N’es-tu pas encore rassasiée de repasser toujours dans les éternels sentiers ? Le dégoût ne te prend-il pas encore ? Es-tu encore désireuse de regarder ces vallées ? Elle ressemble à ta vie, la vie du pasteur. Il se lève à la première aube ; il fait sortir son troupeau dans la campagne, et voit des troupeaux, des fontaines et des herbes ; puis, fatigué, il se couche le soir ; il n’espère jamais rien d’autre. Dis-moi, ô lune, à quoi sert au berger sa vie, et à quoi vous sert la vôtre ? Dis-moi : quel est le but de mon court passage, et quel est celui de ta course immortelle ?
Un pauvre vieillard blanc, infirme, à demi-vêtu et sans chaussures, avec un lourd fardeau sur les épaules, court à travers les montagnes et les vallées, parmi les rochers aigus, le sable profond, les broussailles, au vent, à la tempête, quand l’heure est brûlante et quand il gèle ; il court haletant, il passe les torrents et les étangs, tombe, se relève et se hâte toujours davantage, sans arrêt, sans repos, déchiré, sanglant, jusqu’à ce qu’il arrive au terme de sa route et de tant de fatigue, à un abîme horrible, immense, où il se précipite et oublie tout. Lune vierge, telle est la vie mortelle.
"... Nasce l’uomo a fatica,
Ed è rischio di morte il nascimento ..."
L’homme naît à regret et la naissance est un risque de mort. La première impression qu’il ressent est de la peine et de la souffrance ; et dès le commencement sa mère et son père entreprennent de le consoler d’être né. Puis, quand il grandit, tous deux le soutiennent, et désormais tous leurs actes et toutes leurs paroles tendent à lui donner du cœur et à le consoler de la condition humaine : c’est le meilleur service que les parents rendent à leurs enfants. Mais pourquoi mettre à la lumière, pourquoi guider dans la vie celui qu’il faut plus tard consoler de la vie ? Si la vie est un malheur, pourquoi dure-t-elle par notre fait ? Lune virginale, tel est l’état mortel. Mais tu n’es pas mortelle, et peut-être n’as-tu guère souci de mon dire ?
Toi cependant, solitaire, éternelle voyageuse, toi si pensive, tu comprends peut-être ce qu’est notre vie terrestre, ce que sont nos souffrances, nos soupirs ; ce qu’est la mort, cette suprême pâleur du visage qui nous fait disparaître de la terre, et ces départs d’avec une société habituelle et aimante. Tu comprends à coup sûr le pourquoi des choses et tu vois le fruit du matin, du soir, de la marche muette et infinie du temps. Tu sais, oui, tu sais, à quel doux amour sourit le printemps, à qui l’été est utile, et quel est le but de l’hiver avec ses glaces. Tu sais mille choses, tu en découvres mille, qui sont cachées au simple berger.
Souvent quand je te regarde ainsi muette et immobile au-dessus de la plaine déserte qui, dans son circuit lointain, confine au ciel, ou quand tu me suis pas à pas dans mon voyage avec mon troupeau et que je vois les étoiles briller au ciel, je me dis dans ma pensée intime : Pourquoi tant de petits flambeaux ? Que font l’air infini et cette infinie et profonde sérénité ?
Que veut dire cette solitude immense ? Et que suis-je, moi ? Ainsi je raisonne en moi-même et sur ce séjour démesuré et sur cette superbe et innombrable famille ; puis sur tant d’activité, sur tant de mouvements de toutes choses célestes et terrestres, qui tournent sans repos pour revenir là d’où elles sont parties : je ne puis deviner quel est l’usage et quel est le fruit de ces choses. Mais toi pour sûr, jeune immortelle, tu connais tout. Tout ce que je sais et je sens, c’est que de mes circuits éternels et de mon être frêle, un autre tirera peut-être quelque bien ou quelque joie : mais, pour moi, la vie m’est un mal.
Ô mon troupeau qui te reposes, oh ! que tu es heureux ! car tu ignores, je crois, ta misère ! Quelle envie je te porte ! non seulement parce que tu oublies aussitôt tout accident, tout dommage, toute crainte, même extrême, mais surtout parce que jamais tu n’éprouves l’ennui. Quand tu te poses à l’ombre, sur l’herbe, tu es tranquille et content et, dans cet état, tu passes sans ennui une grande partie de l’année. Mais moi, quand je me couche sur l’herbe, à l’ombre, un ennui m’assombrit l’âme et un aiguillon me pique, si bien qu’ainsi couché je suis plus loin que jamais de trouver la paix ou la stabilité. Et pourtant je ne désire rien et je n’ai pas jusqu’ici de cause de larmes. Quel est la nature ou le degré de ton plaisir, je ne puis le dire : mais tu es heureux. Et moi j’ai encore peu de plaisir, et ce n’est pas mon seul sujet de plainte. Si tu savais parler, je te demanderais : Dis-moi, pourquoi chaque animal étendu à son aise dans l’oisiveté est-il satisfait, tandis que moi, si je prends du repos, l’ennui m’assaille ?
Peut-être, si j’avais des ailes pour voler au-dessus des nuages et pour compter les étoiles une à une, ou si j’errais comme le tonnerre de sommet en sommet, peut-être serais-je plus heureux, ô mon doux troupeau, peut-être serais-je plus heureux, ô blanche lune ! Peut-être aussi ma pensée erre-t-elle loin du vrai en regardant le sort d’autrui, et peut-être, dans quelque forme, dans quelque condition qu’on se trouve, dans une étable ou dans un berceau, le jour natal est-il funeste à celui qui naît." (CHANT NOCTURNE D’UN BERGER NOMADE DE L’ASIE)
L'être humain ne peut redonner un sens à son existence qu'en vivant pleinement sa condition : s'il critique l'optimisme naïf des catholiques libéraux dans les vers de l'ironique"Palínodie" de 1835,
"Je me suis trompé, candide Gino : je me suis trompé longtemps et de beaucoup. J’ai cru la vie misérable et vaine, et notre siècle plus insensé que les autres. Mon langage parut et fut intolérable à l’heureuse race mortelle, si l’on doit ou si l’on peut dire que l’homme soit mortel. Partagée entre l’étonnement et le dédain, du fond de l’Éden où elle séjourne, la race sublime se mit à rire, et déclara que j’étais un abandonné, un disgracié, incapable ou sans expérience des plaisirs, prenant son propre sort pour le sort commun et attribuant ses maux à l’humanité. Enfin, à travers la fumée odorante des cigares, pendant que l’on croque bruyamment de petits gâteaux, au milieu des cris militaires qui ordonnent le service des glaces et des boissons, parmi les tasses heurtées et les cuillères brandies, la lumière quotidienne des gazettes a brillé toute vive à mes yeux. Je reconnus et je vis la joie publique et la douceur de la destinée mortelle. Je vis le haut état et la valeur des choses terrestres, la carrière humaine toute fleurie, et comme ici-bas il n’est rien qui déplaise, rien qui dure. Je ne connus pas moins les efforts les œuvres étonnantes, l’intelligence, les vertus et le profond savoir de mon siècle, et je vis, du Maroc au Catay, de l’Ourse au Nil et de Boston à Goa, les royaumes, les empires et les duchés courir à l’envi et hors d’haleine sur les traces de la douce félicité, et la saisir déjà par sa chevelure flottante et par l’extrémité de son boa. Voyant ces choses et méditant profondément devant ces vastes feuilles, j’eus honte de ma lourde et vieille erreur et de moi-même.
C’est un siècle d’or que nous filent désormais, ô Gino, les fuseaux des Parques. Tous les journaux, quelle que soit leur langue ou leur format, sur tous les rivages, le promettent au monde à l’unanimité. L’amour universel, les voies ferrées, la multiplication du commerce, la vapeur, l’imprimerie et le choléra rapprochent étroitement les peuples et les climats les plus éloignés ; et il n’y aura rien d’étonnant si le pin et le chêne suent du lait et du miel, ou encore s’ils dansent au son d’une valse, tant s’est accrue jusqu’ici la puissance des alambics, des cornues et des machines, rivales du ciel, et tant elle s’accroîtra dans l’avenir : car de progrès en progrès vole et volera toujours sans fin la descendance de Sem, de Cham et de Japhet.
Cependant, le monde ne mangera certes pas de glands, si la faim ne l’y force : mais il ne déposera pas le fer cruel. Bien des fois il méprisera l’argent et l’or : il se contentera des billets de banque. Elle ne s’abstiendra pas désormais du sang chéri de ses frères, la race généreuse : elle couvrira de carnage et l’Europe et l’autre rive de l’océan Atlantique, cette jeune nourrice de la pure civilisation, chez qui une fatale question de poivre, de cannelle ou d’autre épice, ou bien de canne à sucre, ou tout ce qui se change en or, pousse toujours les bandes fraternelles à entrer en guerre les unes contre les autres. Le vrai mérite, la vertu, la modestie, la bonne foi, l’amour de la justice, seront toujours, dans tout État politique, à l’écart, étrangers aux affaires communes, injuriés et vaincus : parce que la Nature a voulu qu’en tout temps elles fussent au bas des choses. L’audace arrogante, la fraude et la médiocrité règnent toujours : leur destin est de surnager. Quiconque aura la puissance et la force, en abusera, qu’elles soient réunies en un seul ou divisées, dans quelque forme politique que ce soit. C’est la première loi que la Nature et le Destin aient écrite sur le diamant. Ni Volta ni Davy ne la changeront avec leur électricité, ni toute l’Angleterre avec ses machines, ni le siècle nouveau avec un fleuve d’écrits politiques grand comme le Gange. Toujours l’honnête homme sera dans la tristesse ; l’homme vil dans les fêtes et la joie. Tous les mondes seront continuellement en armes et conjurés contre les âmes élevées : le vrai bonheur sera poursuivi par la calomnie, la haine, l’envie ; le faible sera la proie du fort ; le mendiant à jeun sera le serviteur et l’esclave des riches, dans tout genre de gouvernement, près ou loin de l’équateur ou des pôles : il en sera éternellement ainsi, tant que sa propre demeure et la lumière du jour ne manqueront pas à notre race.
Ces légers restes et ces traces du temps passé laisseront forcément des marques dans l’âge d’or qui se lève : car la société humaine a par nature mille principes et mille éléments discordants et contradictoires : et, quant à faire cesser cette discorde, l’intelligence et la force des hommes ne l’ont jamais pu, depuis que naquit notre race illustre, et de notre temps aucun traité ni aucun journal ne le pourra, quelle qu’en soit la sagesse ou la puissance. Mais dans les choses plus importantes, la félicité mortelle deviendra entière et toute nouvelle. Plus souples de jour en jour deviendront les habits ou de laine ou de soie. Les agriculteurs et les artisans laissant à l’envi leurs habits grossiers, couvriront de coton leur peau rude, et leur échine de drap fin. Mieux faits pour l’usage, et, certes, plus beaux à voir, les tapis, les couvertures, les sièges, les canapés, les tabourets et les tables, les lits et tous les meubles orneront les appartements de leur beauté garantie pour un mois ; la cuisine ardente admirera de nouvelles formes de chaudrons et de marmites. De Paris à Calais, de Calais à Londres, de Londres à Liverpool, le chemin ou plutôt le vol sera si rapide qu’on n’ose l’imaginer, et sous le vaste cours de la Tamise s’ouvrira un passage, œuvre hardie, immortelle, qui devait déjà être faite il y a plusieurs années. Les rues les moins fréquentées des cités souveraines seront mieux éclairées la nuit et aussi sûres que les plus grandes rues d’une ville de province ne le sont aujourd’hui. Telles sont les douceurs et l’heureux sort que le ciel destine à la génération qui vient...." (PALINODIE)

Leopardi continue à exalter la vitalité du sentiment amoureux dans les premiers poèmes du cycle d'Aspasie (1831-1835), inspiré par une intense expérience sentimentale qui aboutira à un échec; l'amour n'est que la dernière des illusions, et elle finit par se dissiper aussi. Mais le ton intimiste et douloureux des "Grandes idylles" est remplacé par un style plus dépouillé et percutant, aux accents souvent combatifs : Leopardi revendique la dignité de l'être humain dans sa lutte inégale contre une nature qui l'a fait capable de hautes aspirations mais lui a rendu impossible la satisfaction de ses désirs. Cette méditation sur l''homme et son destin se poursuit dans deux poèmes centrés sur la mort, dont le style épuré et la maîtrise d'une syntaxe complexe marquent une nouvelle étape dans l'é1aboration d'une poésie philosophique qui atteint son expression la plus achevée dans "La ginestra", de tous les poèmes de Leopardi, celui où le poète exprime le plus fortement sa volonté de s'opposer à la négativité du réel par la revendication de ce que l'homme a de sublime : sa capacité de constater le néant et par là même de s`affirmer en face de lui. Comme le genêt fleurissant sur les pentes du volcan destructeur, la poésie jaillit de la profondeur de la douleur, fruit intemporel d'une humanité à laquelle l'immortalité est niée ..
"La ginestra"
Qui su l’arida schiena
del formidabil monte
sterminator Vesevo,
la qual null’altro allegra arbor nè fiore,
tuoi cespi solitari intorno spargi,
odorata ginestra,
contenta dei deserti. Anco ti vidi
de’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
che cingon la cittade
la qual fu donna de’ mortali un tempo,
e del perduto impero
par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
lochi e dal mondo abbandonati amante,
e d’afflitte fortune ognor compagna.
Questi campi cosparsi
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona;
dove s’annida e si contorce al sole
la serpe, e dove al noto
cavernoso covil torna il coniglio;
fur liete ville e colti,
e biondeggiàr di spiche, e risonaro
di muggito d’armenti;
fur giardini e palagi,
agli ozi de’ potenti
gradito ospizio; e fur città famose
che coi torrenti suoi l’altero monte
dall’ignea bocca fulminando oppresse
con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
una ruina involve,
dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola. A queste piagge
venga colui che d’esaltar con lode
il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
è il gener nostro in cura
all’amante natura. E la possanza
qui con giusta misura
anco estimar potrà dell’uman seme,
cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annulla
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente
annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
son dell’umana gente
le magnifiche sorti e progressive.
(...)
"Ici, sur le dos aride du mont formidable, du Vésuve exterminateur, que ne réjouit aucun autre arbre, aucune autre fleur, tu répands autour de toi tes rameaux solitaires, genêt odoriférant, et les déserts te plaisent. Je t’ai vu aussi embellir de tes tiges les contrées solitaires qui entourent la cité autrefois reine des mortels, ces campagnes dont l’aspect grave et taciturne semble attester et rappeler au voyageur l’empire détruit. Je te revois maintenant sur ce sol, amante des lieux tristes et abandonnés du monde, compagne fidèle des fortunes détruites. Ces campagnes couvertes de cendres stériles et recouvertes de lave durcie qui résonne sous le pas du voyageur, où le serpent se niche et se tord au soleil, où le lapin retourne au trou caverneux qu’il habite, furent de joyeuses villas, des champs cultivés ; toutes blondes d’épis, elles retentirent du mugissement des troupeaux ; elles furent des jardins et des palais, refuge agréable des loisirs des puissants ; elles furent des cités fameuses que les torrents de l’altière montagne écrasèrent avec leurs habitants, jaillissant comme la foudre de la bouche de feu. Maintenant une même ruine enveloppe tout aux environs, et où tu es, ô noble fleur, comme si tu avais pitié des infortunes d’autrui, tu envoies au ciel un doux parfum qui console le désert. Qu’il vienne ici, celui qui a coutume de porter aux nues notre condition et qu’il voie quel souci notre race inspire à l’aimante nature. Il pourra apprécier aussi avec une juste mesure la puissance de la race humaine, que sa dure nourrice, quand il craint le moins, détruit en partie d’un léger et rapide mouvement et qu’elle peut anéantir tout entière et tout à coup d’un mouvement encore plus léger. Sur ces rives sont gravées les destinées progressives et magnifiques de l’humanité.
"Qui mira e qui ti specchia,
secol superbo e sciocco,
che il calle insino allora
dal risorto pensier segnato innanti
abbandonasti, e volti addietro i passi, .."
Regarde-toi et mire-toi ici, siècle superbe et sot, qui as abandonné le chemin indiqué jadis par la pensée en sa renaissance, qui retournes en arrière, t’en vantes et appelles cela progresser. Tous les esprits, dont le sort funeste t’a fait père, flattent ton enfantillage, bien que parfois ils se moquent de toi entre eux. Moi je ne descendrai pas sous terre couvert d’une telle honte. Il me serait bien facile d’imiter les autres, de rivaliser de balivernes et de faire ainsi accepter mes chants à tes oreilles. Mais j’aime mieux avoir montré le plus possible le mépris de toi qui se cache dans mon cœur, bien que je sache que l’oubli écrase celui qui déplut trop à son temps. Je me ris jusqu’à présent de ce mal qui me sera commun avec toi. Tu vas rêvant la liberté, et tu veux remettre en esclavage la pensée par laquelle seule nous sortons en partie de la barbarie, qui seule accroît la civilisation et améliore les destins d’un peuple. Ainsi, elle t’a déplu, la vérité sur l’âpre sort et la basse condition que la nature nous a donnés. Tu as lâchement tourné le dos à la lumière qui éclairait cette vérité : tu la fuis, tu appelles vil celui qui la suit et magnanime celui-là seul qui, se moquant de lui-même ou des autres, rusé ou fou, élève jusqu’aux astres la condition des hommes.
" ... Uom di povero stato e membra inferme
che sia dell’alma generoso ed alto,
non chiama se nè stima
ricco d’or nè gagliardo,
e di splendida vita o di valente
persona infra la gente
non fa risibil mostra;
ma se di forza e di tesor mendico
lascia parer senza vergogna, e noma
parlando, apertamente, e di sue cose
fa stima al vero uguale...."
Un homme pauvre et faible de corps, qui a l’âme généreuse et haute, ne se donne ni ne se tient pour riche ni pour vigoureux ; dans le monde, il n’a pas le ridicule de faire parade d’opulence et de santé. Mais il se laisse voir sans honte ce qu’il est, c’est-à-dire dénué de force et d’argent : il avoue sa situation, il en parle ouvertement et il l’estime conformément à la réalité. Pour moi, je ne trouve pas magnanime, mais sot, l’animal qui, né pour mourir, nourri dans la peine, dit : « Je suis fait pour jouir », et qui emplit les journaux de son orgueil odieux, promettant sur terre des destinées sublimes et des félicités nouvelles, ignorées de ce monde et même du ciel, à ces peuples qu’une vague de la mer qui se soulève, qu’un souffle pernicieux, qu’un ébranlement souterrain détruisent si bien que leur souvenir survit à peine. C’est une noble nature, celle qui ose lever ses yeux mortels contre le destin commun, et qui, d’un langage franc, sans rien retrancher de la vérité, avoue le mal qui nous fut donné en partage, et la bassesse, la fragilité de notre condition ; celle qui se montre grande et forte dans la souffrance, qui n’ajoute pas à ses misères les haines et les colères fraternelles, en accusant l’homme de sa douleur, mais qui en accuse la vraie coupable, celle qui est la mère des mortels pour l’enfantement, leur marâtre pour l’affection.
Voilà l’ennemie qu’elle proclame ; elle pense que contre elle fut jadis liguée la société humaine, elle estime que les hommes forment tous une confédération, elle les embrasse tous d’un véritable amour, elle leur donne et elle attend d’eux une aide prompte et forte dans les périls mutuels et les angoisses de la guerre commune. Armer la main de l’homme pour l’offense, tendre des pièges et des embûches à son voisin, elle voit là autant de folie que si, dans un camp entouré d’une armée ennemie, au moment le plus critique de l’assaut, on oubliait les ennemis, on entreprenait des querelles acerbes avec ses amis, et qu’on semât la fuite et qu’on fît briller son épée parmi ses propres compagnons d’armes.
Quand de telles pensées seront connues du vulgaire, comme elles le furent, quand cette horreur, qui unit d’abord les mortels en société contre la nature impie, sera ramenée en partie par le vrai savoir, par l’honnête et loyale politique, la justice et la piété auront alors d’autres racines que ces superbes folies, où on fonde la probité du vulgaire, probité aussi stable que peut être stable ce qui a l’erreur pour fondement.
" .. Sovente in queste rive,
che, desolate, a bruno
veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
seggo la notte; e sulla mesta landa
in purissimo azzurro
veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
cui di lontan fa specchio
il mare, e tutto di scintille in giro
per lo vòto Seren brillar il mondo..."
Souvent sur ces plages désolées et en deuil que revêt le flot durci qui semble ondoyer, je m’assieds pendant la nuit ; et, sur la lande triste, dans l’azur très-pur, je vois en haut flamboyer les étoiles à qui la mer au loin sert de miroir, et dans le vide serein brille tout un monde d’étincelles tournoyantes. Et quand je fixe mes yeux sur ces lumières qui nous semblent n’être qu’un point, et qui sont si immenses que pour elles la terre et la mer sont véritablement un point, et qu’elles ignorent tout à fait non seulement l’homme, mais ce globe où l’homme n’est rien ; quand je regarde ces groupes d’étoiles encore plus éloignées de nous dans l’infini, qui nous paraissent comme un nuage, pour qui non seulement l’homme et la terre, mais encore toutes nos étoiles ensemble, infinies de nombre et de masse, y compris le soleil d’or, sont inconnues ou paraissent être ce que ces groupes eux-mêmes paraissent à la terre, un point de lumière nébuleuse ; — alors que sembles-tu à ma pensée, ô race de l’homme ?
Et me rappelant d’une part ton état d’ici-bas, dont le sol que je foule est l’emblème, d’autre part la croyance que tu as d’être la maîtresse des choses et le but donné au Tout, et combien de fois il t’a plu de créer des fictions, combien de fois sur cet obscur grain de sable qui a nom la terre, tu as fait descendre les auteurs de toute chose, pour converser amicalement avec les tiens ; quand je songe que, renouvelant ces rêves ridicules, tu insultes aux sages jusque dans l’âge présent, qui semble dépasser tous les âges en savoir et en civilisation, quel mouvement alors, malheureuse race mortelle, ou quelle pensée enfin se produit à ton égard dans mon cœur ? Je ne sais lequel prévaut, du rire ou de la pitié.
... Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
cui là nel tardo autunno
maturità senz’altra forza atterra,
d’un popol di formiche i dolci alberghi,
cavati in molle gleba
con gran lavoro, e l’opre
e le ricchezze che adunate a prova
con lungo affaticar l’assidua gente
avea provvidamente al tempo estivo,
schiaccia, diserta e copre
in un punto; così d’alto piombando,
dall’utero tonante
scagliata al ciel, profondo
di ceneri e di pomici e di sassi
notte e ruina, infusa
di bollenti ruscelli,
o pel montano fianco
furiosa tra l’erba
di liquefatti massi
e di metalli e d’infocata arena
scendendo immensa piena,
le cittadi che il mar là su l’estremo
lido aspergea, confuse
e infranse e ricoperse
in pochi istanti: onde su quelle or pasce
la capra, e città nove
sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
son le sepolte, e le prostrate mura
l’arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
dell’uom più stima o cura
che alla formica: e se più rara in quello
che nell’altra è la strage,
non avvien ciò d’altronde
fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.
Comme une petite pomme, tombant d’un arbre vers la fin de l’automne par le seul effet de sa maturité, écrase, dépeuple et recouvre en un instant les douces demeures d’un peuple de fourmis, creusées dans la terre, rendue molle à force de travail, ainsi que les richesses réunies avec une longue émulation de zèle par la gent laborieuse au temps de l’été : de même, une masse noire de cendres, de laves et de pierres brisées mêlées en ruisseaux brûlants, lancée du cratère tonnant jusqu’au fond du ciel et retombant ensuite, ou un immense débordement de masses liquéfiées, de métaux et de sables brûlants descendant avec fureur sur le flanc de la montagne et à travers les prés, bouleversa, brisa et recouvrit les villes que la mer baignait sur l’extrême bord du rivage, et cela en peu d’instants. Sur cet emplacement la chèvre broute maintenant et de nouvelles villes surgissent d’un autre côté, dont les villes ensevelies sont les fondements, elles que le mont élevé foule de ses pieds.
La nature n’a pas plus d’estime ou de souci de l’homme que de la fourmi, et si le carnage des hommes est plus rare que celui des fourmis, l’unique raison c’est que chez ceux-là la reproduction est moins féconde.
" ... Ben mille ed ottocento
anni varcàr poi che spariro, oppressi
dall’ignea forza, i popolati seggi,
e il villanello intento
ai vigneti, che a stento in questi campi
nutre la morta zolla e incenerita, ..."
Il y a bien dix-huit cents ans que ces villes ont disparu, détruites par la force du feu, et le villageois qui travaille ses vignes, à grand peine nourries par la terre morte et pleine de cendre, lève encore son regard défiant vers la cime fatale, qui n’est point adoucie encore et qui, terrible, le menace de ruine lui et ses fils et leur pauvre avoir. Souvent le pauvre homme passe la nuit, couché sans sommeil, en plein air, sur le toit de sa maison rustique, et, bondissant plus d’une fois, il examine le cours du bouillonnement redouté qui descend des entrailles inépuisables sur le flanc sablonneux du Vésuve, et qui éclaire la marine de Capri, le port de Naples et la Mergelline. Et s’il le voit approcher, si au fond de son puits domestique il entend bouillir l’eau, il éveille ses fils, il éveille sa femme en hâte, il fuit avec tout ce qu’il peut emporter de ses biens, et voit de loin son nid familier, et le petit champ, son unique salut contre la faim, devenir la proie du flot enflammé qui arrive en crépitant, et, inépuisable, s’étend pour toujours sur sa maison.
Voici qu’après un si long oubli Pompeï morte revoit la lumière, comme un squelette enseveli que l’avarice ou la piété remet au jour. Du forum désert, entre les files de colonnades tronquées, le voyageur contemple de loin le double sommet et la crête fumante qui menace encore la ruine éparse. Et dans l’horreur de la nuit mystérieuse, par les théâtres déserts, par les temples mutilés et les maisons brisées, où la chauve-souris cache ses petits, comme une torche sinistre qui se promène à travers les palais vides court le bouillonnement de la lave funèbre, qui rougit de loin à travers l’ombre et colore les lieux environnants.
Ainsi, ignorant l’homme, les âges qu’il appelle antiques, et la suite que font les petits-fils après les aïeux, la nature reste toujours verte, ou plutôt elle avance par un chemin si long qu’elle semble rester en place. Les royaumes s’écroulent cependant, les nations et les langues passent ; elle ne le voit pas : et l’homme s’arroge la gloire d’être éternel.
E tu, lenta ginestra,
che di selve odorate
queste campagne dispogliate adorni,
anche tu presto alla crudel possanza
soccomberai del sotterraneo foco,
che ritornando al loco
già noto, stenderà l’avaro lembo
su tue molli foreste. E piegherai
sotto il fascio mortal non renitente
il tuo capo innocente:
ma non piegato insino allora indarno
codardamente supplicando innanzi
al futuro oppressor; ma non eretto
con forsennato orgoglio inver le stelle,
nè sul deserto, dove
e la sede e i natali
non per voler ma per fortuna avesti;
ma più saggia, ma tanto
meno inferma dell’uom, quanto le frali
tue stirpi non credesti
o dal fato o da te fatte immortali.
Et toi, souple genêt, qui de tes branches odorantes ornes ces campagnes dépouillées, toi aussi bientôt tu succomberas à la cruelle puissance du feu souterrain qui, retournant au lieu déjà connu de lui, étendra ses flots avides sur tes tendres rameaux.
Et tu plieras sous le faix mortel ta tête innocente et qui ne résistera pas : mais jusqu’alors tu ne te seras pas courbé vainement, avec de couardes supplications, en face du futur oppresseur ; mais tu ne te seras pas dressé, avec un orgueil forcené, vers les étoiles, sur ce désert où tu habites et où tu es né, non par ta volonté, mais par hasard ; mais tu l’as d’autant plus emporté sur l’homme en sagesse et en force que tu n’as pas cru que tes frêles rejetons aient été rendus immortels ou par le destin ou par toi-même."

"Zibaldone" (1898)
C`est sous ce titre qu`est connu le recueil de pensées du poète italien Giacomo Leopardi, un manuscrit de quelque 4500pages qui constitue une sorte de journal dont la rédaction s'étale de juillet 1817 environ, jusqu'en décembre 1832. « L'énorme tas de brouillons » (immenso scartafaccio) se présente comme un ensemble d`annotations de longueur variable, qui peuvent être de brèves notes pour mémoire (fragments de vers, idées à développer), des citations (et, parmi elles. des moralistes français des XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que de Montesquieu, Voltaire. Mme de Staël ou Lamennais), souvent accompagnées de commentaires, mais surtout des réflexions parfois très développées. que Leopardi note au fil de la plume. Le Zibaldone est ainsi le passionnant témoignage d`une "pensée en mouvement" (S. Solmi) : le style en est souvent touffu et les longues phrases épousant le rythme de la réflexion ...
Leopardi rédige l`essentiel de ses notes entre 1821 et 1823, 3 544 pages qui reflètent un travail quotidien et intense de clarification dont naîtront les "Petites pièces morales" et les derniers "Chants". Avant tout, le Zibaldone est très riche en réflexions sur le langage comme terrain d`étude privilégié pour vérifier la théorie empiriste de la connaissance et une conviction, celle que la jeunesse de l'humanité, comme celle de l`individu, est caractérisée par une intimité avec la nature que l'homme civilisé a perdue par l`effet inhibiteur et réducteur de sa raison. C`est ainsi que l'homme vit dans un état de constante contradiction, écartelé entre les conclusions de sa raison et l'impulsion de ses instincts. Incapable de retrouver un bonheur qu`il a détruit de ses propres mains, il s`enferme dans le cercle vicieux de la recherche du plaisir : capable de concevoir un infini qui n'existe que dans son imagination, l`homme est constamment tendu dans l`inutile effort d'atteindre une jouissance totale qui lui est niée et passe ainsi de la douleur à l`ennui, sensation de vide que l`homme éprouve en l'absence de toute passion, ne pouvant échapper à cette alternative qu'en sombrant dans l'inconscience et la mort. C'est dans ce contexte que Leopardi élabore sa poétique du "vague" et de l` "indéfini" ...
La nostalgie de l`Antiquité et l'interprétation sensualiste du comportement humain impliquent aussi une critique radicale de l`éthique chrétienne, qui étouffe les passions vitales de l`homme et le condamne à la résignation. Parti de réflexions sur la nature du beau, Leopardi aboutit à la négation de tout absolu, et donc de Dieu. En conséquence, l'homme est livré aux lois aveugles et inexorables d`une nature qui n`est plus pour Leopardi qu`un cycle de création et de destruction. Le poète ne recule pas devant cette dernière découverte de sa raison et accuse au contraire son siècle de nier lâchement les acquis du siècle précédent, qui reste pour lui une indispensable référence.
L'ami de Leopardi, Antonio Ranieri, publia peu après sa mort un recueil de cent onze "Pensées" qui exploitent en partie le fond du "Zibaldone", un manuscrit qui n'a été rendu public qu`à partir de 1898 ...
