- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Robert Louis Stevenson (1850-1894), "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" (1886), "Treasure Island" (1883), "The new
Arabian Nights" (1878), "Kidnapped" (1886), "The Black Arrow" (1888), "The Master of Ballantrae" (1889), "The Wrong Box" (Un Mort encombrant, 1889), "In the South Seas" (Dans les mers du Sud,
1890), "The Wrecker" (Le Trafiquant d'esclaves, 1892), "Island Nights'Entertainments" (1893), "Catriona" (1893), "The Ebb-Tide" (Le creux de la vague, 1894) -- John Atkinson Grimshaw (1836-1893) - ...
Last update: 18/12/2016
"Dr Jekyll et M. Hyde"? L'horreur , en 1886, s'introduit dans une bourgeoisie que sa bienséance et son hypocrisie guindée ennuient quelque peu. Mais plus encore, c'est bien dans la littérature mondiale et dans notre subconscient que s'installe et se reproduit de génération en génération cette extraordinaire personnification de la duplicité de la nature humaine, l’intelligence et l’appétit, la retenue et la transgression, la civilité et la brutalité. Jekyll et Hyde, un incontournable de notre scène littéraire imaginé à la fin du XXe siècle, aujourd'hui à peine lu, et dont chaque lecteur potentiel connaît déjà, miraculeusement, le dénouement. En panne d'inventivité, les siècles suivants n'ont guère fait mieux. Ici, Jekyll est à chaque étape, en fait, bel et bien complice du vice et de la violence sauvage de Hyde, son alter ego : le bien s’attache au mal avec un instinct effroyable, et si Hyde est complètement mauvais, il ne s’ensuit pas nécessairement que Jekyll soit entièrement bon. Stevenson nous dit que les horreurs du monde sont humaines et sont les nôtres. Que nul ne puisse contester cette réalité révèle une capacité de la littérature que la science, quoiqu'elle fasse, quoiqu'elle dise, ne peut atteindre ...

L' "étrange cas" de la société victorienne révèle ainsi, avec une acuité jamais égalée, cette thématique du bien et du mal tapie en chacun de nous : "all human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil" (Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde) - A la fin du XVIIIe siècle, le roman gothique s'immisce dans la littérature en faisant surgir des histoires surnaturelles de ruines ou de paysages sauvages. Cette étrange réalité gagne progressivement le coeur des villes. Charles Dickens, dans "La Maison d'Âpre-Vent" (1853), matérialise ce mystère latent dans le brouillard qui gagne bien d'autres de ces romans. Robert Louis Stevenson introduit l'horreur dans l'ennui de la bienséance bourgeoise (Docteur Jekyll et Mister Hyde, 1886). Effectivement les horreurs de Whitechapel dans l'Est Londonien, terre de crime de Jack l'Eventreur en 1888, alimentent les tourments de bien des consciences. Et alors que le développement industriel et technique, que la science semblent nous rassurer en ce monde, bien au contraire portent en eux une terrible contrepartie, la misère, la dépravation se conjuguent à es forces obscures séculaires qui ressurgissent, mythes, légendes, malédictions au coeur même de notre humanité.. Oscar Wilde avec "Le Portrait de Dorian Gray" (1890) montre à quel point la décadence et la mort s'inscrivent au plus profond de notre vie sociale ..

C’est bien cette capacité du mal, sous le visage socialement acceptable de la société, que Hyde représente, mais il est aussi décrit comme un "primitif", – une partie de l’horreur dans l’histoire est la capacité facile de Jekyll à régresser dans cette forme plus primitive. Cela reflète une peur omniprésente de la « dégénérescence » évolutive qui prévaut dans la culture de la fin de l’ère victorienne, une peur que les récits gothiques de l’époque vont pleinement exploiter.......
(Francis Bernard (Frank) Dicksee - 1896 - The Confession)
Aventurier enthousiaste à la santé précaire, Robert Louis Stevenson finira par s'installer aux Samoa en 1890, pour y mourir quatre ans plus tard. Celui que les Polynésiens surnommèrent « Tusitala » (« le conteur d'histoires ») méritait et mérite toujours cet hommage populaire, même si l'écrivain écossais, essayiste, poète et romancier est peu connu de nos jours et laisse à L'Île au trésor et à Dr Jekyll et M. Hyde le soin de perpétuer sa gloire et son nom. On oublie ses autres écrits, pourtant importants et divers. On oublie l'homme aussi qui fut à son heure un révolté contre l'Angleterre victorienne et l'Écosse trop puritaine, un bohème et un grand voyageur et beaucoup plus qu'un dilettante amoureux de l'aventure...
John Atkinson Grimshaw (1836-1893) - a "remarkable and imaginative painter known for his city night-scenes and landscapes ..." (Tate, London)

Robert Louis Stevenson (1850-1894)
Robert Lewis Balfour Stevenson, né à Édimbourg, fils et petit-fils d'ingénieurs spécialisés dans la construction des phares maritimes, écolier intermittent dévorant les romans de Scott et de Dumas, souffrant de tuberculose dès son plus jeune âge, multipliant les voyages et écrivant pour le Cornhill Magazine à partir de 1874. Entre-temps, l'année 1873 conclut une jeunesse totalement dissolue, ayant parcouru les bouges d'Edinburgh, adopté son nom de "Robert Louis Stevenson", abandonné ses études et renoncé au calvinisme de ses aïeux.
Il épouse Fanny Osbourne qu'il a rejoint en 1879 en Californie, voyage entre 1880 et 1887, en Écosse, en Angleterre, à Davos, à Hyères, cherchant un climat bénéfique pour sa santé. La publication de "Kidnapped" puis coup sur un coup deux énormes succès littéraires avec son roman d'aventures "l'Île au trésor" (1883) et le récit fantastique "Docteur Jekyll et M. Hyde" (1886) portent Stevenson au devant de la scène littéraire. En 1887, après le décès de son père,Stevenson gagne à nouveau les États-Unis, puis l'Océanie. Quelque part, ces oeuvres sont celles d'un révolté contre l'Angleterre victorienne et l'Ecosse puritaine. Il ne cessera d'écrire, pour les enfants notamment - "New Arabian Nights (1882), "Kidnapped"(1886), "The Misadventures of John Nicholson" (1887), "The Black Arrow, A Tale of the Two Roses (1888), "The Master of Ballantrae" (1889), "The Wrong Box (1889), "The Wrecker (1892), "Across the Plains" (1892), "Catriona" (1893)..), - et s'installe à Vailima, aux Samoa, en 1890 où le "Tusitala", le conteur d'histoires, meurt brutalement d'hémorragie cérébrale à 44 ans, laissant plusieurs textes inachevés...
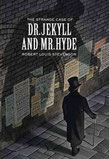
Docteur Jekyll et Mister Hyde
(The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr.Hyde, 1886)
Notaire austère et ami du docteur Jekyll, M. Utterson mène l'enquête sur les agissements nocturnes d'un insaisissable monstre, qui a renversé une petite
fille puis assassiné un honorable médecin de la bonne société londonienne. Cette recherche se joue dans les bas-fonds de Londres, enveloppée dans un épais brouillard qui représente l'envers
du décor victorien. Ce roman, dont la première version, dit-on, surgit d'un rêve que fit Stevenson, est considéré comme une allégorie critique de l'hypocrisie de la société victorienne. La
déchéance du Dr Jekyll n'est pas due à quelque disposition vicieuse d'un protagoniste qui n'apparaît jamais moralement condamnable, mais à une atmosphère sociale qui n'est que respectabilité et
répression. Au niveau de l'individu, Stevenson a particulièrement éprouvé cette dualité du bien et du mal que la société presbytérienne exacerbe paradoxalement par sa recherche constante de toute
trace de la moindre fascination du mal : s'engage en effet une épreuve entre les pulsions maléfiques et la conscience, "si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action,
mais le péché qui est moi", pour reprendre le célèbre argument de Saint-Paul (Epître aux Romains). Tant que la conscience n'éclaire pas toute l'obscurité maléfique de notre nature humaine, nous
demeurons comme le Dr Jekyll un mixte de bien et de mal hanté par la fascination de nos bas instincts : ".. man is not truly one, but truly two. I say two, because the state of my own knowledge
does not pass beyond that point.."
"MR. UTTERSON the lawyer was a man of a rugged countenance, that was never lighted by a smile; cold, scanty and embarrassed in discourse; backward in sentiment; lean, long, dusty, dreary, and yet somehow lovable. At friendly meetings, and when the wine was to his taste, something eminently human beaconed from his eye; something indeed which never found its way into his talk, but which spoke not only in these silent symbols of the after-dinner face, but more often and loudly in the acts of his life. He was austere with himself; drank gin when he was alone, to mortify a taste for vintages; and though he enjoyed the theatre, had not crossed the doors of one for twenty years. But he had an approved tolerance for others; sometimes wondering, almost with envy, at the high pressure of spirits involved in their misdeeds; and in any extremity inclined to help rather than to reprove..."
Robert Louis Stevenson écrivit cette longue nouvelle en 1885, il avait trente-cinq ans, il était à Bournemouth où il essayait de se rétablir. Cette nouvelle naquit du cauchemar d`une nuit d'été, elle fut jetée sur le papier avec une extraordinaire rapidité, c'est l'histoire d`un homme qui, obsédé par la découverte qu`en tout individu cohabitent deux êtres, l'un bon et l`autre mauvais, cherche et trouve le moyen d'un dédoublement physique. Grâce a l`absorption d`une substance chimique de son invention, il peut à son gré être tantôt l`un, tantôt l`autre de ces deux moi. Mais il lui faut prendre pour ce faire prendre d`extrêmes précautions pour que personne dans son entourage ne puisse suspecter quoique ce soit, créant ainsi dans la réalité deux personnages bien distincts, un excès de précautions qui va le perdre. Stevenson ne fut pas satisfait de sa première version et la réécrivit dans la version que nous connaissons : la lutte du bien et du mal tourne à l'avantage du bien puisque Jekyll est constamment assailli de remords et finit par se tuer. L`homme fait un bien mauvais usage de son savoir, et l'intelligence bien est d`essence diabolique, deux conclusions qui semblent s'imposer. L’histoire est racontée dans des récits fragmentaires écrits par un médecin et un avocat, ce qui permet de créer un sentiment de mystère, chaque narrateur étant le témoin d’une série d’événements inexplicables qui ne sont que finalement expliqués que par la propre déclaration posthume de Jekyll relative à ses expériences. Dès sa publication. en 1886, l'œuvre eut un immense succès, on en vendit en quelques semaines plus de quarante mille exemplaires ...


Chap.1 - STORY OF THE DOOR - "Mr. Utterson the lawyer was a man of a rugged countenance that was never lighted by a smile; cold, scanty and embarrassed in discourse; backward in sentiment; lean, long, dusty, dreary and yet somehow lovable. At friendly meetings, and when the wine was to his taste, something eminently human beaconed from his eye; something indeed which never found its way into his talk, but which spoke not only in these silent symbols of the after-dinner face, but more often and loudly in the acts of his life. He was austere with himself; drank gin when he was alone, to mortify a taste for vintages; and though he enjoyed the theatre, had not crossed the doors of one for twenty years. But he had an approved tolerance for others; sometimes wondering, almost with envy, at the high pressure of spirits involved in their misdeeds; and in any extremity inclined to help rather than to reprove..."
"M. Utterson le notaire était un homme d’une mine renfrognée, qui ne s’éclairait jamais d’un sourire ; il était d’une conversation froide, chiche et embarrassée ; peu porté au sentiment ; et pourtant cet homme grand, maigre, décrépit et triste, plaisait à sa façon. Dans les réunions amicales, et quand le vin était à son goût, quelque chose d’éminemment bienveillant jaillissait de son regard ; quelque chose qui à la vérité ne se faisait jamais jour en paroles, mais qui s’exprimait non seulement par ce muet symbole de la physionomie d’après-dîner, mais plus fréquemment et avec plus de force par les actes de sa vie. Austère envers lui-même, il buvait du gin quand il était seul pour réfréner son goût des bons crus ; et bien qu’il aimât le théâtre, il n’y avait pas mis les pieds depuis vingt ans. Mais il avait pour les autres une indulgence à toute épreuve .."
La scène d’ouverture que propose Stevenson contient quelques éléments vaguement surnaturels, en particulier dans l’étrange peur que Hyde inspire, mais il s'agit de faire entrer le lecteur dans un roman qui ne se présenterait que comme une histoire singulière qui, progressivement, conduira vers une vérité apparemment impossible. M. Utterson, avocat riche et respecté de Londres, réservé jusqu'à l'ennui, entretient une amitié très étroite avec M. Enfield, son parent éloigné, tout aussi respectable gentleman de Londres, et tous deux ne peuvent se dispenser de se promener ensemble une fois par semaine, quand bien même ils n'aurait rien à se dire. C'est au cours d'une de ces promenades qu'Enfield conduit leurs pas vers un bâtiment puis une porte, dans une petite rue isolée, et lui explique de quoi il fut témoin, une nuit : un homme courant dans la rue et renversant une petite fille sans même prendre le temps de s'arrêter. " Ce n’était plus un homme que j’avais devant moi, c’était je ne sais quel monstre satanique et impitoyable. J’appelai à l’aide, me mis à courir, saisis au collet notre citoyen, et le ramenai auprès de la fillette hurlante qu’entourait déjà un petit rassemblement. Il garda un parfait sang-froid et ne tenta aucune résistance, mais me décocha un regard si atroce que je me sentis inondé d’une sueur froide. Les gens qui avaient surgi étaient les parents mêmes de la petite ; et presque aussitôt on vit paraître le docteur, chez qui elle avait été envoyée..." L'homme, pour calmer la situation, accepter de payer, ouvre la porte en question, et revient avec un chèque conséquent libellé à un nom honorablement connu.
" “Hm,” said Mr. Utterson. “What sort of a man is he to see?”
“He is not easy to describe. There is something wrong with his appearance; something displeasing, something down-right detestable. I never saw a man I so disliked, and yet I scarce know why. He must be deformed somewhere; he gives a strong feeling of deformity, although I couldn’t specify the point. He’s an extraordinary looking man, and yet I really can name nothing out of the way. No, sir; I can make no hand of it; I can’t describe him. And it’s not want of memory; for I declare I can see him this moment.”
Mr. Utterson again walked some way in silence and obviously under a weight of consideration. “You are sure he used a key?” he inquired at last.
“My dear sir...” began Enfield, surprised out of himself.
“Yes, I know,” said Utterson; “I know it must seem strange. The fact is, if I do not ask you the name of the other party, it is because I know it already. You see, Richard, your tale has gone home. If you have been inexact in any point you had better correct it."
Répondant aux interrogations de Utterson, Enfield répond qu'il n'a pas tenté d'en savoir plus, mais que l'homme en question se nomme Hyde ...

Chap.2 - SEARCH FOR MR. HYDE - " That evening Mr. Utterson came home to his bachelor house in sombre spirits and sat down to dinner without relish. It was his custom of a Sunday, when this meal was over, to sit close by the fire, a volume of some dry divinity on his reading desk, until the clock of the neighbouring church rang out the hour of twelve, when he would go soberly and gratefully to bed. On this night however, as soon as the cloth was taken away, he took up a candle and went into his business room. There he opened his safe, took from the most private part of it a document endorsed on the envelope as Dr. Jekyll’s Will and sat down with a clouded brow to study its contents..."
" Ce soir-là, M. Utterson regagna mélancoliquement son logis de célibataire et se mit à table sans appétit. Il avait l’habitude, le dimanche, après son repas, de s’asseoir au coin du feu, avec un aride volume de théologie sur son pupitre à lecture, jusqu’à l’heure où minuit sonnait à l’horloge de l’église voisine, après quoi il allait sagement se mettre au lit, satisfait de sa journée. Mais ce soir-là, sitôt la table desservie, il prit un flambeau et passa dans son cabinet de travail. Là, il ouvrit son coffre-fort, retira du compartiment le plus secret un dossier portant sur sa chemise la mention : « Testament du Dr Jekyll », et se mit à son bureau, les sourcils froncés, pour en étudier le contenu..."
Enfield et Utterson sont des hommes qui, dans le plus esprit victorien, refusent de se livrer à leurs pensées et sentiments les plus impulsifs, et évitent de discuter de la question de Hyde une fois qu’ils réalisent que cela implique quelqu’un que Utterson pourrait connaître. Le système de valeurs victorien a largement privilégié la réputation sur la réalité. Mais Utterson est d'autant plus troublé que le Dr Jekyll, dont il va être question, lui pose problème. Poussé par sa conversation avec Enfield, il rentre chez lui pour étudier un testament qu’il a rédigé justement pour le Dr. Jekyll. Il stipule qu’en cas de décès ou de disparition de ce dernier, tous ses biens devraient être immédiatement cédés à M. Edward Hyde. Cette volonté étrange avait longtemps troublé Utterson, mais maintenant qu’il connaît le personnage, il en vient à penser que ce Hyde a un pouvoir particulier sur Jekyll.
Cherchant à comprendre, il rend visite au Dr. Lanyon, un ami de Jekyll. Mais Lanyon n’a jamais entendu parler de Hyde et a perdu la communication avec lui à la suite d’un conflit professionnel. Utterson, jusque-là intéressé par le côté intellectuel du problème, voit progressivement son imagination entièrement accaparée par ce qui apparaît de plus en plus comme une affaire des plus mystérieuses. C'est ainsi qu'un sentiment d’étrangeté, d’éléments sombres et troublants entrent par petites touches dans la routine de la vie quotidienne prosaïque ...
"... and thus it was that there sprang up and grew apace in the lawyer’s mind a singularly strong, almost an inordinate, curiosity to behold the features of the real Mr. Hyde. If he could but once set eyes on him, he thought the mystery would lighten and perhaps roll altogether away, as was the habit of mysterious things when well examined. He might see a reason for his friend’s strange preference or bondage (call it which you please) and even for the startling clause of the will..."
(Ce fut de la sorte que naquit et grandit peu à peu dans l’esprit du notaire une curiosité singulièrement forte, quasi désordonnée, de contempler les traits du véritable M. Hyde. Il lui aurait suffi, croyait-il, de jeter les yeux sur lui une seule fois pour que le mystère s’éclaircît, voire même se dissipât tout à fait, selon la coutume des choses mystérieuses quand on les examine bien. Il comprendrait alors la raison d’être de l’étrange prédilection de son ami, ou (si l’on préfère) de sa sujétion, non moins que des stupéfiantes clauses du testament) ...
Bientôt, Utterson commence à passer du temps autour du bâtiment délabré où Enfield a vu Hyde entrer, dans l’espoir d’apercevoir Hyde. Il apparaît finalement, et Utterson s’approche de lui, se présente comme un ami de Henry Jekyll et, comme Enfield avant lui, se sent horrifié par ce qu'il voit mais ne peut pas encore déterminer exactement ce qui rend Hyde si repoussant. La supposée laideur de Hyde n’est pas physique mais métaphysique, elle s’attache à son âme plus qu’à son corps..
Après cette rencontre, Utterson rend visite à Jekyll. Nous apprenons que le bâtiment délabré que Hyde fréquente est en fait un laboratoire attaché à la maison bien entretenue de Jekyll, qui fait face à l’extérieur sur une rue parallèle. Utterson est admis chez Jekyll par le majordome de Jekyll, M. Poole, mais le maître des lieux n'est pas chez lui. Poole lui rapporte que Hyde a une clé du laboratoire et que tous les serviteurs ont ordre de lui obéir à Hyde. L’avocat rentre chez lui, inquiet pour son ami. Il suppose que Hyde fait chanter Jekyll, peut-être pour des actes répréhensibles que Jekyll a commis dans sa jeunesse....

Chap.3 - DR. JEKYLL WAS QUITE AT EASE - " A fortnight later, by excellent good fortune, the doctor gave one of his pleasant dinners to some five or six old cronies, all intelligent, reputable men and all judges of good wine; and Mr. Utterson so contrived that he remained behind after the others had departed. This was no new arrangement, but a thing that had befallen many scores of times. Where Utterson was liked, he was liked well. Hosts loved to detain the dry lawyer, when the light-hearted and loose-tongued had already their foot on the threshold; they liked to sit a while in his unobtrusive company, practising for solitude, sobering their minds in the man’s rich silence after the expense and strain of gaiety. To this rule, Dr. Jekyll was no exception; and as he now sat on the opposite side of the fire — a large, well-made, smooth-faced man of fifty, with something of a stylish cast perhaps, but every mark of capacity and kindness — you could see by his looks that he cherished for Mr. Utterson a sincere and warm affection.
“I have been wanting to speak to you, Jekyll,” began the latter. “You know that will of yours?”
A close observer might have gathered that the topic was distasteful.."
Deux semaines plus tard, Jekyll organise un dîner avec un certain nombre de ses amis dont Utterson. Celui-ci parvient à s'entretenir en tête à tête avec lui, " J’ai éprouvé le besoin de vous parler, Jekyll. Vous vous rappelez votre testament ?", et Jekyll de répondre en soulignant le grand intérêt qu’il porte actuellement à Hyde et son désir de continuer à subvenir à ses besoins. Il fait promettre à Utterson qu’il exécutera sa volonté et son testament.

(Chap.4) - THE CAREW MURDER CASE - " Nearly a year later, in the month of October, 18 — , London was startled by a crime of singular ferocity and rendered all the more notable by the high position of the victim. The details were few and startling."
Environ un an plus tard, la scène s’ouvre sur une domestique qui, assise à sa fenêtre aux petites heures du matin, est témoin d’un meurtre dans la rue en contrebas. Elle voit un petit homme diabolique, qu’elle reconnaît comme M. Hyde, rencontrer un homme poli et âgé, qui le salue : c'est alors que Hyde se retourne soudainement contre lui avec un bâton, le battant à mort. La police trouve une lettre adressée à Utterson sur le cadavre, et ils convoquent donc l’avocat. Il identifie le corps comme Sir Danvers Carew, un député populaire et un de ses clients. Utterson accompagne la police dans un ensemble de chambres situées dans un quartier pauvre et diabolique de la ville et se demande comment un homme qui vit dans une telle misère peut l’héritier de la fortune d’Henry Jekyll. La propriétaire de Hyde laisse entrer les hommes, mais le suspect n’est pas chez lui. La police trouve l’arme du crime et les restes brûlés du chéquier de Hyde. Lors d’une visite ultérieure à la banque, l’inspecteur de police apprend que Hyde a encore un compte là-bas. L’agent suppose qu’il n’a qu’à attendre que Hyde aille retirer de l’argent. Dans les jours et les semaines qui suivent, cependant, on ne relève aucun signe de Hyde ...

(Chap.5) - INCIDENT OF THE LETTER - " It was late in the afternoon, when Mr. Utterson found his way to Dr. Jekyll’s door, where he was at once admitted by Poole, and carried down by the kitchen offices and across a yard which had once been a garden, to the building which was indifferently known as the laboratory or dissecting rooms. The doctor had bought the house from the heirs of a celebrated surgeon; and his own tastes being rather chemical than anatomical, had changed the destination of the block at the bottom of the garden. It was the first time that the lawyer had been received in that part of his friend’s quarters.."
" Il était tard dans l’après-midi lorsque M. Utterson se présenta à la porte du Dr Jekyll, où il fut reçu aussitôt par Poole, qui l’emmena, par les cuisines et en traversant une cour qui avait été autrefois un jardin, jusqu’au corps de logis qu’on appelait indifféremment le laboratoire ou salle de dissection. Le docteur avait racheté la maison aux héritiers d’un chirurgien fameux ; et comme lui-même s’occupait plutôt de chimie que d’anatomie, il avait changé la destination du bâtiment situé au fond du jardin. Le notaire était reçu pour la première fois dans cette partie de l’habitation de son ami.."
Utterson trouve Jekyll dans son laboratoire, visiblement diminué, qui affirme que Hyde est parti et que leur relation a pris fin, que la police ne le retrouvera. Jekyll lui remet une lettre par laquelle Hyde annonce son départ et lui demande conseil, craignant que cela ne nuise à sa réputation s’il la remet à la police. Interrogeant Poole, le majordome, Utterson ne comprend pas comment cette lettre est parvenue jusqu'ici. Un peu plus tard, il effectue une comparaison d'écriture et suggère que que la main de Jekyll aurait pu falsifier une lettre pour un aider un meurtrier. Utterson reste conforme à son personnage, face à la violence d'un Hyde qui tue sans mobile apparent et au milieu d'une rue fréquentée, d'un Hyde que personne ne semble connaître, il joue le détective mais veut éviter tout scandale.

(Chap. 6) - INCIDENT OF DR. LANYON - " Time ran on; thousands of pounds were offered in reward, for the death of Sir Danvers was resented as a public injury; but Mr. Hyde had disappeared out of the ken of the police as though he had never existed. Much of his past was unearthed, indeed, and all disreputable: tales came out of the man’s cruelty, at once so callous and violent; of his vile life, of his strange associates, of the hatred that seemed to have surrounded his career; but of his present whereabouts, not a whisper. From the time he had left the house in Soho on the morning of the murder, he was simply blotted out ..."
"... des milliers de livres étaient offertes en récompense, car la mort de sir Danvers Carew constituait un malheur public ; mais M. Hyde se dérobait aux recherches de la police tout comme s’il n’eût jamais existé. Son passé, toutefois, révélait beaucoup de faits également peu honorables : on apprenait des exemples de la cruauté de cet homme aussi insensible que brutal ; de sa vie de débauche, de ses étranges fréquentations, des haines qu’il avait provoquées autour de lui ; mais sur ses faits et gestes présents, pas le moindre mot. À partir de la minute où il avait quitté sa maison de Soho, le matin du crime, il s’était totalement évanoui..."
La disparition de Hyde semble avoir changé Jekyll qui redevient plus sociable. Il organise un dîner, auquel Utterson et Lanyon assistent, et tous les trois discutent ensemble comme de vieux amis. Mais quelques jours plus tard, quand Utterson appelle Jekyll, Poole rapporte que son maître ne reçoit aucun visiteur. Ce scénario se répète pendant une semaine, alors Utterson se tourne vers Lanyon, espérant apprendre la raison d'une telle attitude : Lanyon semble effondré, prêt à mourir. Il meurt peu de temps après, léguant à Utterson une lettre à lire après sa mort, une lettre dans laquelle se trouve une autre enveloppe marquée pour rester scellée jusqu’à la mort de Jekyll. Utterson surmonte sa curiosité et met l’enveloppe en lieu sûr. Au fil des semaines, il appelle Jekyll de moins en moins souvent, et le majordome continue de lui refuser l’entrée.

(Chap.7) - INCIDENT AT THE WINDOW - " It chanced on Sunday, when Mr. Utterson was on his usual walk with Mr. Enfield, that their way lay once again through the by-street; and that when they came in front of the door, both stopped to gaze on it...."
Un dimanche, comme M. Utterson faisait avec M. Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s’arrêtèrent pour la considérer...
".. IT chanced on Sunday, when Mr. Utterson was on his usual walk with Mr. Enfield, that their way lay once again through the by-street, and that when they came in front of the door, both stopped to gaze on it.
" Well," said Enfield, " that story's at an end at least. We shall never see more of Mr. Hyde."
"I hope not," said Utterson. "Did I ever tell you that I once saw him, and shared your feeling of repulsion?"
" It was impossible to do the one without the other," returned Enfield. " And, by the way, what an ass you must have thought me, not to know that this was a back way to Doctor Jekyll's! It was partly your own fault that I found it out even when I did."
"So you found it out, did you?" said Utterson. " But if that be so, we may step into
the court and take a look at the windows. To tell you the truth, I am uneasy about poor
Jekyll ; and even outside, I feel as if the presence of a friend might do him good."
The court was very cool and a little damp, and full of premature twilight, although the sky, high up overhead, was still bright with sunset. The middle one of the three windows was half-way open, and sitting close beside it, taking the air with an infinite sadness of mien,
like some disconsolate prisoner, Utterson saw Doctor Jekyll.
"What! Jekyll!" he cried. " I trust you are better."
"I am very low, Utterson," replied the doctor, drearily, "very low. It will not last long, thank God."
"You stay too much indoors," said the lawyer. "You should be out, whipping up the circulation like Mr. Enfield and me. (This is my cousin Mr. Enfield Doctor Jekyll.) Come, now; get your hat and take a quick turn with us."
"You are very good," sighed the other.
" I should like to very much ; but no, no, no, it is quite impossible ; I dare not. But indeed, Utterson, J am very glad to see you ; this is really a great pleasure; I would ask you and Mr. Enfield up, but the place is really not fit."
" Why, then," said the lawyer, good-naturedly, " the best thing we can do is to stay down here and speak with you from where we are."
" That is just what I was about to venture to propose," returned the doctor with a smile.
But the words were hardly uttered before the smile was struck out of his face and succeeded by an expression of such abject terror and despair as froze the very blood of the two gentlemen below. They saw it but for a glimpse, for the window was instantly thrust
down; but that glimpse had been sufficient, and they turned and left the court without a
word. In silence, too, they traversed the by-street; and it was not until they had come
into a neighboring thoroughfare, where even upon a Sunday there were still some stirrings
of life, that Mr. Utterson at last turned and looked at his companion. They were both
pale, and there was an answering horror in their eyes.
"God forgive us! God forgive us!" said Mr. Utterson.
But Mr. Enfield only nodded his head very seriously, and walked on once more in silence."
"Un dimanche, comme M. Utterson faisait avec M. Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s’arrêtèrent pour la considérer.
– Allons, dit Enfield, voilà cette histoire-là enfin terminée. Nous ne reverrons plus jamais M. Hyde.
– Je l’espère, dit Utterson. Vous ai-je jamais raconté que je l’ai vu une fois, et que j’ai partagé votre sentiment de répulsion.
– L’un ne pouvait aller sans l’autre, répliqua Enfield. Et entre parenthèses combien vous avez dû me juger stupide d’ignorer que cette porte fût une sortie de derrière pour le Dr Jekyll ! C’est en partie de votre faute si je l’ai découvert par la suite.
– Alors, vous y êtes arrivé, en fin de compte ? reprit Utterson. Mais puisqu’il en est ainsi, rien ne nous empêche d’entrer dans la cour et de jeter un coup d’oeil aux fenêtres. À vous parler franc, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll ; et même du dehors, il me semble que la présence d’un ami serait capable de lui faire du bien.
Il faisait très froid et un peu humide dans la cour, et le crépuscule l’emplissait déjà, bien que le ciel, tout là-haut, fût encore illuminé par le soleil couchant. Des trois fenêtres, celle du milieu était à demi ouverte, et installé derrière, prenant l’air avec une mine d’une désolation infinie, tel un prisonnier sans espoir, le Dr Jekyll apparut à Utterson.
– Tiens ! vous voilà, Jekyll ! s’écria ce dernier. Vous allez mieux, j’espère.
– Je suis très bas, Utterson, répliqua mornement le docteur, très bas. Je n’en ai plus pour longtemps, Dieu merci.
– Vous restez trop enfermé, dit le notaire. Vous devriez sortir un peu, afin de vous fouetter le sang, comme M. Enfield et moi (je vous présente mon cousin, M. Enfield… Le docteur Jekyll). Allons, voyons, prenez votre chapeau et venez faire un petit tour avec nous.
– Vous êtes bien bon, soupira l’autre. Cela me ferait grand plaisir ; mais, non, non, non, c’est absolument impossible ; je n’ose pas. Quand même, Utterson, je suis fort heureux de vous voir, c’est pour moi un réel plaisir ; je vous prierais bien de monter avec M. Enfield, mais la pièce n’est vraiment pas en état.
– Ma foi, tant pis, dit le notaire, avec bonne humeur, rien ne nous empêche de rester ici en bas et de causer avec vous d’où vous êtes.
– C’est précisément ce que j’allais me hasarder à vous proposer, répliqua le docteur avec un sourire.
Mais il n’avait pas achevé sa phrase, que le sourire s’éteignit sur son visage et fit place à une expression de terreur et de désespoir si affreuse qu’elle glaça jusqu’aux moelles les deux gentlemen d’en bas. Ils ne l’aperçurent d’ailleurs que dans un éclair, car la fenêtre se referma instantanément ; mais cet éclair avait suffi, et tournant les talons, ils sortirent de la cour sans prononcer un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue; et ce fut seulement à leur arrivée dans une grande artère voisine, où persistaient malgré le dimanche quelques traces d’animation, que M. Utterson se tourna enfin et regarda son compagnon. Tous deux étaient pâles, et leurs yeux reflétaient un effroi identique.
– Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, répéta M. Utterson.
Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête, et se remit à marcher en silence."
(...)
Tout comme Lanyon refusait de décrire à Utterson ce qu’il avait vu, que Jekyll refusait de discuter de sa relation avec Hyde, Utterson et Enfield, lorsqu'ils vont surprendre le Dr. Jekyll à sa fenêtre, le voir avec un regard de terreur fermer rapidement celle-ci et disparaître, ne se livrer à aucun commentaire, dans le même silence, ils remontèrent la petite rue, M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête, et se remit à marcher ...

(Chap.8) - THE LAST NIGHT - "Mr. Utterson was sitting by his fireside one evening after dinner, when he was surprised to receive a visit from Poole" ( Un soir après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l’étonnement de recevoir la visite de Poole) ...
Poole, le majordome de Jekyll, s'inquiète de ce qu'il a pu advenir de son maître : " La physionomie du domestique confirmait amplement ses paroles ; il n’avait plus aucune tenue ; et à part le moment où il avait d’abord avoué sa peur, il n’avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou, et le regard fixé sur un coin du parquet....". Il conduit rapidement Utterson à la résidence, la nuit est sombre et venteuse, les rues sont désertes. Utterson trouve les serviteurs rassemblés dans le hall principal, ce qui provoque de sa part une réaction de bienséance, "que faites vous ici, votre maître jugerait cela bien déplacé". Poole lui indique la porte du laboratoire, puis une voix, qui n'est pas celle de Jekyll, refuse de recevoir aucun visiteur.
Après quelques hésitations et interrogations, ...
"– Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, dit M. Utterson, mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Poole, est sans nul doute atteint d’une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leur victime ; de là, selon toute probabilité, l’altération de sa voix ; de là le masque et son éloignement de ses amis ; de là son anxiété de trouver ce produit, grâce auquel la pauvre âme garde l’espoir d’une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé ! Voilà mon explication : elle est suffisamment triste, Poole, voire même affreuse à envisager, mais elle est simple et naturelle, elle est cohérente, et elle nous délivre de toutes craintes exagérées.
– Monsieur, dit le maître d’hôtel, envahi d’une pâleur livide, cet être n’était pas mon maître, et voilà la vérité. Mon maître (et ce disant il regarda autour de lui et baissa la voix) est un homme grand et bien fait, et celui-ci était une sorte de nabot."
"Les pas résonnaient furtifs et légers, et quasi dansants malgré leur lenteur : ils différaient complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda ?
– Est-ce qu’on n’entend jamais rien d’autre ?
Poole fit un signe affirmatif, et répondit :
– Si, une fois. Une fois, je l’ai entendu pleurer.
– Pleurer ? Comment cela ? reprit le notaire, envahi tout à coup d’un frisson d’horreur.
– Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, répondit le maître d’hôtel. Quand je suis parti, cela m’est resté sur le cœur, si bien que j’en aurais pleuré aussi."
... la porte du laboratoire est ouverte de force, on trouve à l'intérieur le corps de Hyde étendu sur le sol, une fiole écrasée dans sa main. Il semble s’être empoisonné. Utterson note que Hyde porte un costume qui appartient à Jekyll et qui est beaucoup trop grand pour lui. L'ensemble du bâtiment est fouillé, mais on ne trouve ni trace de Jekyll ni cadavre. On note un grand miroir - ce qui paraît singulier dans un laboratoire scientifique (" Ce miroir a vu d’étranges choses, monsieur, chuchota Poole") -, puis, sur une table, on découvre une grande enveloppe adressée à Utterson qui contient un testament, semblable au précédent mais au bénéfice de Utterson, une note à celui-ci, - datée du jour et qui lui demande de lire la lettre que Lanyon lui a donnée plus tôt -, et enfin, une confession de «Votre ami digne et malheureux, Henry Jekyll» sous forme d'un paquet scellé. Utterson retourne à son bureau pour lire la lettre de Lanyon et le contenu du paquet scellé...
" ... He caught up the next paper; it was a brief note in the doctor’s hand and dated at the top. “O Poole!” the lawyer cried, “he was alive and here this day. He cannot have been disposed of in so short a space; he must be still alive, he must have fled! And then, why fled? and how? and in that case, can we venture to declare this suicide? O, we must be careful. I foresee that we may yet involve your master in some dire catastrophe.”
“Why don’t you read it, sir?” asked Poole.
“Because I fear,” replied the lawyer solemnly. “God grant I have no cause for it!” And with that he brought the paper to his eyes and read as follows:
“My dear Utterson, — When this shall fall into your hands, I shall have disappeared, under what circumstances I have not the penetration to foresee, but my instinct and all the circumstances of my nameless situation tell me that the end is sure and must be early. Go then, and first read the narrative which Lanyon warned me he was to place in your hands; and if you care to hear more, turn to the confession of “Your unworthy and unhappy friend,
“HENRY JEKYLL.” ( Lorsque ce mot tombera entre vos mains, j’aurai disparu, d’une façon que je n’ai pas la clairvoyance de prévoir, mais mon instinct, comme la nature de la situation sans nom dans laquelle je me trouve, me disent que ma fin est assurée et qu’elle ne tardera plus. Adieu donc, et lisez d’abord le récit que Lanyon m’a promis de vous faire parvenir ; puis si vous désirez en savoir davantage passez à la confession de ...)
“There was a third enclosure?” asked Utterson.
“Here, sir,” said Poole, and gave into his hands a considerable packet sealed in several places.
The lawyer put it in his pocket. “I would say nothing of this paper. If your master has fled or is dead, we may at least save his credit. It is now ten; I must go home and read these documents in quiet; but I shall be back before midnight, when we shall send for the police..."

(Chap.9) - DR. LANYON’S NARRATIVE - " On the ninth of January, now four days ago, I received by the evening delivery a registered envelope, addressed in the hand of my colleague and old school companion, Henry Jekyll. I was a good deal surprised by this ..."
C'est enfin dans ce chapitre que Stevenson nous dévoile que le Dr Jekyll et M. Hyde ne sont qu'une seule et même personne. La lettre demande à Lanyon d’aller chez Jekyll et, avec l’aide de Poole, d’entrer par effraction dans le cabinet de son laboratoire, de retirer d'un tiroir spécifique tout son contenu et de retourner chez lui avec celui-ci : puis d’attendre un homme qui viendrait le réclamer précisément à minuit.
A l'heure dite, un petit homme frappe à la porte du médecin, il s'agit de Hyde (mais Lanyon, n’ayant jamais vu cet homme auparavant), ...
".. Cet individu (qui avait ainsi, dès le premier instant de son arrivée, excité en moi une curiosité que je qualifierais volontiers de malsaine) était vêtu d’une façon qui aurait rendu grotesque une personne ordinaire ; car ses habits, quoique d’un tissu coûteux et de bon goût, étaient démesurément trop grands pour lui dans toutes les dimensions : son pantalon lui retombait sur les jambes, et on l’avait retroussé par en bas pour l’empêcher de traîner à terre, la taille de sa redingote lui venait au-dessous des hanches, et son col bâillait largement sur ses épaules. Chose singulière à dire, cet accoutrement funambulesque était loin de me donner envie de rire. Au contraire, comme il y avait dans l’essence même de l’individu que j’avais alors en face de moi quelque chose d’anormal et d’avorté – quelque chose de saisissant, de surprenant et de révoltant – ce nouveau disparate semblait fait uniquement pour s’accorder avec le premier et le renforcer ; si bien qu’à mon intérêt envers la nature et le caractère de cet homme, s’ajoutait une curiosité concernant son origine, sa vie, sa fortune et sa situation dans le monde..."
... et c'est alors le point culminant du roman. Après avoir procédé à la fabrication de son breuvage, Hyde-Jekyll se tourne vers Lanyon et lui demande s'il préfère le laisser repartir ou s'il veut être témoin d'un prodige "capable d’ébranler l’incrédulité de Lucifer". Lanyon, le rationaliste et le matérialiste fervent, par opposition au Dr Jekyll, tourmenté par les secrets de la nature humaine, assiste à la transformation de Hyde en Jekyll et en perd pratiquement la raison ...
" He put the glass to his lips and drank at one gulp. A cry followed; he reeled, staggered, clutched at the table and held on, staring with injected eyes, gasping with open mouth; and as I looked there came, I thought, a change — he seemed to swell — his face became suddenly black and the features seemed to melt and alter — and the next moment, I had sprung to my feet and leaped back against the wall, my arms raised to shield me from that prodigy, my mind submerged in terror.
“O God!” I screamed, and “O God!” again and again; for there before my eyes — pale and shaken, and half fainting, and groping before him with his hands, like a man restored from death — there stood Henry Jekyll!"
" Il porta le verre à ses lèvres et but d’un trait. Un cri retentit ; il râla, tituba, se cramponna à la table, et se maintint debout, les yeux fixes et injectés, haletant, la bouche ouverte ; et tandis que je le considérais, je crus voir en lui un changement… il me parut se dilater… sa face devint brusquement noire et ses traits semblèrent se fondre et se modifier… et un instant plus tard je me dressais d’un bond, me rejetant contre la muraille, le bras levé pour me défendre du prodige, l’esprit confondu de terreur.
– Ô Dieu ! m’écriai-je. Et je répétai à plusieurs reprises : « Ô Dieu ! » car là, devant moi, pâle et défait, à demi évanoui, et tâtonnant devant lui avec ses mains, tel un homme ravi au tombeau, je reconnaissais Henry Jekyll !
" What he told me in the next hour, I cannot bring my mind to set on paper. I saw what I saw, I heard what I heard, and my soul sickened at it; and yet now when that sight has faded from my eyes, I ask myself if I believe it, and I cannot answer. My life is shaken to its roots; sleep has left me; the deadliest terror sits by me at all hours of the day and night; and I feel that my days are numbered, and that I must die; and yet I shall die incredulous. As for the moral turpitude that man unveiled to me, even with tears of penitence, I can not, even in memory, dwell on it without a start of horror. I will say but one thing, Utterson, and that (if you can bring your mind to credit it) will be more than enough. The creature who crept into my house that night was, on Jekyll’s own confession, known by the name of Hyde and hunted for in every corner of the land as the murderer of Carew."
"Ce qu’il me raconta durant l’heure qui suivit, je ne puis me résoudre à l’écrire. Je vis ce que je vis, j’entendis ce que j’entendis, et mon âme en défaillit ; et pourtant à l’heure actuelle où ce spectacle a disparu de devant mes yeux je me demande si j’y crois et je ne sais que répondre. Ma vie est ébranlée jusque dans ses racines ; le sommeil m’a quitté ; les plus abominables terreurs m’assiègent à toute heure du jour et de la nuit ; je sens que mes jours sont comptés et que je vais mourir ; et malgré cela je mourrai incrédule.
Quant à l’abjection morale que cet homme me dévoila, non sans des larmes de repentir, je ne puis, même à distance, m’en ressouvenir sans un sursaut d’horreur.
Je n’en dirai qu’une chose, Utterson, et (si toutefois vous pouvez vous résoudre à y croire) ce sera plus que suffisant.
L’individu qui, cette nuit-là, se glissa dans ma demeure était, de l’aveu même de Jekyll, connu sous le nom de Hyde et recherché dans toutes les parties du monde comme étant l’assassin de Carew Hastie Lanyon."

HENRY JEKYLL’S FULL STATEMENT OF THE CASE - "I was born in the year 18 — to a large fortune, endowed besides with excellent parts, inclined by nature to industry, fond of the respect of the wise and good among my fellowmen, and thus, as might have been supposed, with every guarantee of an honourable and distinguished future. And indeed the worst of my faults was a certain impatient gaiety of disposition, such as has made the happiness of many, but such as I found it hard to reconcile with my imperious desire to carry my head high, and wear a more than commonly grave countenance before the public. Hence it came about that I concealed my pleasures; and that when I reached years of reflection, and began to look round me and take stock of my progress and position in the world, I stood already committed to a profound duplicity of me. Many a man would have even blazoned such irregularities as I was guilty of; but from the high views that I had set before me, I regarded and hid them with an almost morbid sense of shame. It was thus rather the exacting nature of my aspirations than any particular degradation in my faults, that made me what I was, and, with even a deeper trench than in the majority of men, severed in me those provinces of good and ill which divide and compound man’s dual nature. In this case, I was driven to reflect deeply and inveterately on that hard law of life, which lies at the root of religion and is one of the most plentiful springs of distress.
Je suis né en l’an 18… Héritier d’une belle fortune, doué en outre de facultés remarquables, incité par nature au travail, recherchant la considération des plus sages et des meilleurs d’entre mes contemporains, j’offrais de la sorte, aurait-on pu croire, toutes les garanties d’un avenir honorable et distingué. Et de fait, le pire de mes défauts était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de beaucoup, mais que je trouvais difficile de concilier avec mon désir impérieux de porter la tête haute, et de revêtir en public une mine plus grave que le commun des mortels. Il résulta de là, que je ne me livrai au plaisir qu’en secret, et lorsque j’atteignis l’âge de la réflexion, et commençai à regarder autour de moi et à me rendre compte de mes progrès et de ma situation dans le monde, je me trouvais déjà réduit à une profonde dualité d’existence. Plus d’un homme aurait tourné en plaisanterie les licences dont je me rendais coupable ; mais des hauteurs idéales que je m’étais assignées, je les considérais et les dissimulais avec un sentiment de honte presque maladif. Ce fut donc le caractère tyrannique de mes aspirations, bien plutôt que des vices particulièrement dépravés, qui me fit ce que je devins, et, par une rupture plus profonde que dans la majorité des hommes, sépara en moi ces domaines du bien et du mal où se répartit et dont se compose la double nature de l’homme. Dans mon cas particulier, je fus amené à méditer de façon intense sur cette dure loi de l’existence qui se trouve à la base de la religion et qui constitue l’une de nos sources de tourments les plus communes ...
(...)
" I hesitated long before I put this theory to the test of practice. I knew well that I risked death; for any drug that so potently controlled and shook the very fortress of identity, might, by the least scruple of an overdose or at the least inopportunity in the moment of exhibition, utterly blot out that immaterial tabernacle which I looked to it to change. But the temptation of a discovery so singular and profound at last overcame the suggestions of alarm..." Et "par une nuit maudite", Jekyll en vient à combiner les divers éléments qu'il a rassemblé et se décide à absorber son breuvage, après avoir longtemps hésité, nous dit-il. S'il éprouve tout d'abord les tourments les plus affreux, "un broiement dans les os", "une nausée mortelle", les effets ne tardent pas à se dissiper ...
"There was something strange in my sensations, something indescribably new and, from its very novelty, incredibly sweet. I felt younger, lighter, happier in body; within I was conscious of a heady recklessness, a current of disordered sensual images running like a millrace in my fancy, a solution of the bonds of obligation, an unknown but not an innocent freedom of the soul. I knew myself, at the first breath of this new life, to be more wicked, tenfold more wicked, sold a slave to my original evil; and the thought, in that moment, braced and delighted me like wine. I stretched out my hands, exulting in the freshness of these sensations; and in the act, I was suddenly aware that I had lost in stature..."
" Il y avait dans mes sensations un je ne sais quoi d’étrange, d’indiciblement neuf, et aussi, grâce à cette nouveauté même, d’incroyablement exquis. Je me sentais plus jeune, plus léger, plus heureux de corps ; c’était en moi un flot désordonné d’images sensuelles qui couraient comme un moulin à ma fantaisie, un détachement de toutes les obligations du devoir, une liberté de l’âme inconnue mais non pas innocente. Je me sentis, dès le premier souffle de ma vie nouvelle, plus méchant, dix fois plus méchant, livré en esclavage à mes mauvais instincts originels ; et cette idée, sur le moment, m’excita et me délecta comme un vin. Je m’étirai les bras, charmé par l’inédit de mes sensations ; et, dans ce geste, je m’aperçus tout à coup que ma stature avait diminué..."
Puis, c'est l'épisode bien connu du miroir, il lui faut se voir en présence d’Edward Hyde. Les modifications de stature et d'aspect sont expliqués par Stevenson bien singulièrement : le cours de sa vie n'ayant été jusque-là, pour les neuf dixièmes, qu' "une vie de labeur et de contrainte", et donc "soumis à beaucoup moins d’efforts et de fatigues" (in the course of my life, which had been, after all, nine tenths a life of effort, virtue and control, it had been much less exercised and much less exhausted), c'est pour cette raison qu'Edward Hyde semble plus petit, plus mince et plus jeune que Henry Jekyll. Et, tout comme le bien se reflète sur la physionomie de l'un, le mal s’inscrivait en toutes lettres sur les traits de l’autre, un mal qui grave sur son corps une empreinte de difformité et de déchéance (an imprint of deformity and decay). Les amis de Jekyll en témoigneront sans cesse dans le cours du récit, personne ne saurait s'approcher du visage de Hyde sans ressentir un sentiment de rejet et de trouble inexplicable (a visible misgiving of the flesh) : "Ceci provenait, je suppose, de ce que tous les êtres humains que nous rencontrons sont composés d’un mélange de bien et de mal ; et Edward Hyde, seul parmi les rangs de l’humanité, était fait exclusivement de mal..." (This, as I take it, was because all human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil: and Edward Hyde, alone in the ranks of mankind, was pure evil).
Commence une nouvelle expérience d'existence comme peut d'êtres humains ont pu en rêver : Jekyll peut affronter, pour se livrer à tous les plaisirs qu'il peut imaginer, - Stevenson ne s'attarde pas sur ces "plaisirs" ("Mon dessein n’est pas d’entrer dans le détail des ignominies dont je devins alors le complice, car même à cette heure je ne puis guère admettre que je les ai commis") -, les regards sans remettre en question son "indiscutable honorabilité", le premier à pouvoir "se plonger à corps perdu dans l'océan de la liberté" (like a schoolboy, strip off these lendings and spring headlong into the sea of liberty) et cela sans même exister socialement. "Think of it — I did not even exist! Let me but escape into my laboratory door, give me but a second or two to mix and swallow the draught that I had always standing ready; and whatever he had done, Edward Hyde would pass away like the stain of breath upon a mirror; and there in his stead, quietly at home, trimming the midnight lamp in his study, a man who could afford to laugh at suspicion, would be Henry Jekyll..." C'était Hyde le seul coupable, et lui seul ...
Puis Jekyll en vient à évoquer les différents évènements dont fut témoin directement ou indirectement Utterson, et qui débute par un acte de cruauté envers une fillette, "qui attira sur moi la colère d’un passant, que je reconnus l’autre jour en la personne de votre cousin". Mais déjà certains signes montrent que cette transmutation n'est pas sans conséquence.Ce sont ses mains qui constituent la première alerte, alors qu'il est Henry Jekyll, somnolant sur son lit, "je vis alors, sans méprise possible, dans la lumière blafarde d’un matin de plein Londres, cette main reposant à demi fermée sur les draps du lit", elle était "maigre, noueuse, à veines saillantes, d’une pâleur terreuse et revêtue d’une épaisse pilosité. C’était la main d’Edward Hyde ( It was the hand of Edward Hyde) .. M’élançant hors du lit, je courus au miroir. Au spectacle qui frappa mes regards, mon sang se changea en un fluide infiniment glacial et raréfié. Oui, je m’étais mis au lit Henry Jekyll, et je me réveillais Edward Hyde. Comment expliquer cela, me demandais-je ; et puis, avec un autre tressaillement d’effroi : – comment y remédier ?" ( At the sight that met my eyes, my blood was changed into something exquisitely thin and icy. Yes, I had gone to bed Henry Jekyll, I had awakened Edward Hyde. How was this to be explained? I asked myself; and then, with another bound of terror — how was it to be remedied?) ... Se pose irrémédiablement alors une question décisive, la personnalité de Hyde peut-elle progressivement s'imposer à celle de Jekyll. Et c'est bien là le noeud du problème, un affrontement de deux personnalités au sein d'une même nature humaine est-elle réellement tenable, avons-nous en toute conscience la possibilité de vivre une telle dualité, et ce d'autant plus que celle-ci est essentiellement morale, le bien contre le mal dans un contexte social de respectabilité et d'hypocrisie absolues. "Remettre mon sort à Jekyll, c’était mourir à ces convoitises que j’avais toujours caressées en secret et que j’avais depuis peu laissées se développer"(to die to those appetites which I had long secretly indulged and had of late begun to pamper). Le confier à Hyde, c’était mourir à mille intérêts et aspirations, et devenir d’un seul coup et à jamais un homme méprisé et sans amis" (To cast it in with Hyde, was to die to a thousand interests and aspirations, and to become, at a blow and forever, despised and friendless).
" Yes, I preferred the elderly and discontented doctor, surrounded by friends and cherishing honest hopes; and bade a resolute farewell to the liberty, the comparative youth, the light step, leaping impulses and secret pleasures, that I had enjoyed in the disguise of Hyde. I made this choice perhaps with some unconscious reservation, for I neither gave up the house in Soho, nor destroyed the clothes of Edward Hyde, which still lay ready in my cabinet. For two months, however, I was true to my determination; for two months, I led a life of such severity as I had never before attained to, and enjoyed the compensations of an approving conscience. But time began at last to obliterate the freshness of my alarm; the praises of conscience began to grow into a thing of course; I began to be tortured with throes and longings, as of Hyde struggling after freedom; and at last, in an hour of moral weakness, I once again compounded and swallowed the transforming draught..."
" Oui, je préférai être le docteur vieillissant et insatisfait, entouré d’amis et nourrissant d’honnêtes espérances ; et je dis un adieu définitif à la liberté, à la relative jeunesse, à la démarche légère, au sang ardent et aux plaisirs défendus, que j’avais goûtés sous le déguisement de Hyde. Ce choix n’allait peut-être pas sans une réserve tacite, car pas plus que je ne renonçai à la maison de Soho, je ne détruisis les vêtements d’Edward Hyde, qui restaient toujours prêts dans mon cabinet. Durant deux mois cependant, je restai fidèle à ma résolution ; durant deux mois l’austérité de ma vie dépassa tout ce que j’avais réalisé jusque-là, et je goûtai les joies d’une conscience satisfaite. Mais le temps vint peu à peu amortir la vivacité de mes craintes ; les éloges reçus de ma conscience m’apparurent bientôt comme allant de soi, je commençai à être tourmenté d’affres et d’ardeurs, comme si Hyde s’efforçait de reconquérir la liberté ; si bien qu’à la fin, en une heure de défaillance morale, je mixtionnai à nouveau et absorbai le breuvage transformateur."
Mais Jekyll ne résiste pas longtemps, cède à la tentation, cède à un M. Hyde qui implose de fureur et de brutalité, et c'est l'épisode de l’assassinat de sir Danvers, qui marque une rupture, la prise de conscience d'une violence excessive totalement incontrôlable. Ebranlé dans son être même, Jekyll revient sur sa vie, son enfance, un bref instant, ne sachant expliquer ses actes. Il décide alors de tente de revenir une fois de plus à une vie "normale" : " mais je restais sous la malédiction de ma dualité ; et lorsque le premier feu de mon repentir s’atténua, le côté inférieur de mon moi, si longtemps choyé, si récemment enchaîné, se mit à réclamer sa liberté. Ce n’était pas que je songeasse à ressusciter Hyde ; cette seule idée m’affolait ; non, c’était dans ma propre personne que j’étais une fois de plus tenté de biaiser avec ma conscience ; et ce fut en secret comme un vulgaire pécheur, que je finis par succomber aux assauts de la tentation". C'est bien Jekyll qui est à la manoeuvre, c'est bien Jekyll qui entretient le personnage de Hyde en lui, et pour l'avoir une fois extériorisé, pour s'être une fois abandonné à sa liberté sans contrainte morale, ne peut plus rebrousser chemin ..
"... the fall seemed natural, like a return to the old days before I had made my discovery. It was a fine, clear, January day, wet under foot where the frost had melted, but cloudless overhead; and the Regent’s Park was full of winter chirrupings and sweet with spring odours. I sat in the sun on a bench; the animal within me licking the chops of memory; the spiritual side a little drowsed, promising subsequent penitence, but not yet moved to begin. After all, I reflected, I was like my neighbours; and then I smiled, comparing myself with other men, comparing my active good-will with the lazy cruelty of their neglect. And at the very moment of that vainglorious thought, a qualm came over me, a horrid nausea and the most deadly shuddering. These passed away, and left me faint; and then as in its turn faintness subsided, I began to be aware of a change in the temper of my thoughts, a greater boldness, a contempt of danger, a solution of the bonds of obligation. I looked down; my clothes hung formlessly on my shrunken limbs; the hand that lay on my knee was corded and hairy. I was once more Edward Hyde. A moment before I had been safe of all men’s respect, wealthy, beloved — the cloth laying for me in the dining-room at home; and now I was the common quarry of mankind, hunted, houseless, a known murderer, thrall to the gallows."
" C’était par une belle journée limpide de janvier, le sol restait humide aux endroits où le verglas avait fondu, mais on ne voyait pas un nuage au ciel ; Regent’s Park s’emplissait de gazouillements et il flottait dans l’air une odeur de printemps. Je m’installai au soleil sur un banc ; l’animal en moi léchait des bribes de souvenirs ; le côté spirituel somnolait à demi, se promettant une réforme ultérieure, mais sans désir de l’entreprendre. Après tout, me disais-je, je suis comme mes voisins ; et je souriais, en me comparant aux autres, en comparant ma bonne volonté agissante avec leur lâche et vile inertie. Et à l’instant même de cette pensée vaniteuse, il me prit un malaise, une horrible nausée accompagnée du plus mortel frisson. Ces symptômes disparurent, me laissant affaibli ; et puis, à son tour, cette faiblesse s’atténua. Je commençai à percevoir un changement dans le ton de mes pensées, une plus grande hardiesse, un mépris du danger, une délivrance des obligations du devoir.
J’abaissai les yeux ; mes vêtements pendaient informes sur mes membres rabougris, la main qui reposait sur mon genou était noueuse et velue. J’étais une fois de plus Edward Hyde. Une minute plus tôt, l’objet de la considération générale, je me voyais riche, aimé, la table mise m’attendait dans ma salle à manger ; et maintenant je n’étais plus qu’un vil gibier humain, pourchassé, sans gîte, un assassin connu, destiné au gibet.
Ma raison vacilla ..."
Suit le récit que nous connaissons, la nécessité de faire appel à Lanyon et Poole pour pouvoir regagner sa demeure, - "c’était non plus la crainte du gibet, mais bien l’horreur d’être Hyde qui me déchirait" -, mais le processus de transformation semble désormais incontrôlable, à toute heure du jour et de la nuit, "il me suffisait principalement de m’endormir, ou même de somnoler quelques minutes dans mon fauteuil pour m’éveiller immanquablement sous la forme de Hyde" : épuisé par cette lutte entre ces deux natures, dont l'une possède toute la puissance physique de destruction de l'autre, Henry Jekyll compte le temps qui lui reste de pouvoir être ce qu'il est encore, de penser ses propres pensées, de voir dans le miroir son propre visage, jusqu'à son récit qui risque d'être détruit par Hyde s'il s'emparait totalement de sa personnalité ...

Parmi les adaptations cinématographiques, citons,
DR. JEKYLL AND MR. HYDE, Famous Players-Lasky Corp., 1920, réalisé par John S. Robertson. avec John Barrymore, Martha Mansfield, Brandon Hurst, Charles Lane, J. Malcolm Dunn.
DR. JEKYLL AND MR. HYDE, Paramount Publix Corp., 1931, réalisé par Rouben Mamoulian. avec Fredric March, Miriam Hopkins, Rose Hobart, Holmes Herbert, Halliwell Hobbes.
DR. JEKYLL AND MR. HYDE, MGM, 1941, réalisé par Victor Fleming, avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman, Lana Turner, Donald Crisp, Ian Hunter, Barton MacLane.

L'Île au trésor (Treasure Island, 1883)
Louis Stevenson avait déjà publié de nombreux articles, essais, récits de voyages, des poèmes et des nouvelles, mais "l'Île au trésor" est son premier roman, son premier succès et permet enfin son émancipation financière. Devenu un classique de la littérature enfantine, "L'Île au trésor", - on place généralement cette oeuvre entre le "Robinson Crusoé" de Daniel Defoe (le créateur du genre), les récits polynésiens de Melville (Typee, Omoo) et et certains romans de Conrad (Une Victoire) ou de Jack London -, a pourtant été décrite comme un livre en rupture avec le fonds et la forme du roman victorien : pour son intrigue resserrée, la multiplication des points, mais aussi pour sa désinvolture morale, pour son héros qui n'est pas tant Jack Hawkins, que le cuisinier de bord, renégat et scélérat, Long John Silver....
"I remember him as if it were yesterday as he came plodding to the inn door in the high, old tottering voice that seemed to have been tuned and broken at the capstan bars. Then he rapped on the door with a bit of stick like a handspike that he carried, and when my father appeared, called roughly for a glass of rum."
Le récit, dont l'intrigue se déroule au XVIIIe siècle, est supposé écrit par la jeune Jim Hawkins, fils de Ia tenancière d'une auberge. qui habite un petit port anglais près de Bristol dans le sud-ouest de l’Angleterre. Dans la taverne isolée de "L`Amíral Benbow" règne une atmosphère mystérieuse, d`attente anxieuse. Le príncipale client se trouve être un vieux marin au visage balafré, nommé Billy Bones, sur lequel pèse une obscure menace. Celle-ci se précise le jour mystérieux aveugle lui remet l' "emblème noir", emblème tragique qui, dans le monde des pirates. annonce un massacre. Le même jour, Billy. qui est un ivrogne impénitent, meurt. En ouvrant sa malle, Jim et sa mère découvrent une carte sur laquelle est indiquée la cachette d'un fabuleux trésor que la bande du capitaine Flint a enfoui dans une île déserte. En vain les pirates donnent-ils l'assaut à l'auberge afin de s'emparer du document. Jim a déjà pris le large, et comme le docteur Livesey et le chevalier Trelawney, le hobereau du village, s'intéressent à l'affaire, il peut affréter un navire baptisé l' "Hispaniola". Tous se mettent en route pour l'ile au trésor. Mais quelques pirates de la bande de Flint , se sont engagés dans l`expédition, dirigés par John Silver, pittoresque personnage à jambe de bois, mélange d’honneur et de brutalité et qui malgré la violence qu’il dégage et le danger qu'il représente, établit une singulier relation avec le jeune Jim. Aussi le conflit ne tarde-t-il pas à éclater, les mutineries, les meurtres, les trahisons en tout genre se succèdent, et toute l’originalité du livre tient à son incomparable inventivité, créant à lui seul l'image romantique de pirates telle qu'elle sera maintes fois reprises...
Grâce à un procéde narratif qu'affectionne Stevenson et dont Conrad fit également usage, diverses autres aventures sont racontées, non plus par le jeune Hawkins, mais par le docteur Livesey. Le récit peut ainsi s'écarter du sujet principal pour y revenir ensuite. Lorsque l'île est atteinte, la lutte s`engage entre les deux groupes, celui de Silver et celui que commandent Livesey et Trelawney, auquel s'est joint un ancien membre de la bande de Flint, un nommé Benn Gunn, que celle-ci a abandonné depuis trois ans sur l'île. Les chances de succès restent longtemps indécises au cours de divers épisodes dont l'intérêt est sans cesse soutenu. Mais, pour finir, le trésor tombe en de bonnes mains. Silver disparaît et l'Hispaniola reprend la mer avec sa précieuse cargaison ..

"In the South Seas" (Dans les Mers du Sud)
Gravement atteint de tuberculose, Stevenson part en 1888 pour les mers du Sud : une première croisière entreprise avec sa femme sur le Casco le conduit des îles Hawaïennes aux îles Marquises et Tuamotu, puis en 1889 sur la goélette de commerce Equator, visitant Butaritari, Mariki, Apaiang et Abemama dans les îles Gilbert et Kiribati. Il s`établit alors à Samoa, où il retrouva momentanément ses forces, mais où il devait mourir. Dans cet ouvrage, imprimé en 1890 et divisé en quatre parties (The Marquesas, The Paumotus, The Gilberts, Apemama), l'auteur décrit des paysages, des types, des populations et des mœurs étudiées pendant la croisière qu`il fit dans les archipels des Marquises, des Touamotou et des Gilbert. La quatrième et surtout la troisième partie, consacrées aux îles Gilbert et particulièrement à Apemana et à son roi, le chef tyran Tem Binoka, sont riches d'anecdotes et d'expériences personnelles, nées de rapports directs des indigènes avec l'auteur.
Oeuvre de la maturité artistique de Stevenson, le livre est écrit dans un style précis de la même qualité que les pages les plus travaillées des œuvres narratives de l'écrivain. ll met en relief le fait que les maladies, le cannibalisme (alors à peu près complètement disparu), les guerres intestines et les superstitions avaient causé la mort de populations encore nombreuses quelques décennies auparavant. La vision de Stevenson est entièrement dominée par ce sentiment de déclin et de mort qui revêt un caractère d'autant plus dramatique et sombre qu`il contraste avec les paysages paradisiaques des archipel: et avec la beauté physique des habitants. L'œuvre compte parmi les plus caractéristiques de Stevenson, et elle constitue l'un des meilleurs livres de voyage du siècle dernier (- Trad.Gallimard. 1920).






