- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Berne
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Denis Diderot (1713-1784) - "Le Rêve de D’Alembert" (1669) - "Le Neveu de Rameau" (1762-1773) - "Jacques le Fataliste (1778)" - .....
Last update 10/10/2021

1760-1770, L'esprit du XVIIIe siècle? "Chaque siècle a son esprit qui le caractérise. L'esprit du nôtre semble être celui de la liberté. La première attaque contre la superstition a été violente, sans mesure. Une fois que les hommes ont osé d'une manière quelconque donner l'assaut à la barrière de la religion, cette barrière, la plus formidable qui existe comme la plus respectée, il est impossible de s'arrêter. Dès qu'ils ont tourné les regards menaçants contre la majesté du ciel, ils ne manqueront pas, le moment d'après, de les diriger contre la souveraineté de la terre. Le câble qui tient et comprime l'humanité est formé de deux cordes; l'une ne peut céder sans que l'autre vienne à rompre..." (Diderot, lettre à la princesse Dashkoff, 3 avril 1771). Diderot n'a cessé d'osciller entre le déisme d'un Voltaire et l'athéisme, il a franchi plus d'une fois la frontière, avançant et reculant, mais en homme de lettres désarmé face une autorité et une tradition régnante soupçonneuse et persécutrice...
Dans le Rêve de d'Alembert, le médecin Bordeu définit la liberté comme « la dernière impulsion du désir et de l'aversion, le dernier résultat de ce qu'on a été depuis la naissance jusqu'au moment où l'on est » - Diderot est le reflet d'une évolution des idées dans le XVIIIe siècle, les lumières de la raison, le rationalisme, cèdent devant les "transports de la sensibilité", l'instinct et la passion. Ce qui aurait pu être conflictuel chez d'autres auteurs, est vécu pleinement, comme naturellement : "notre véritable sentiment n'est pas celui dans lequel nous n'avons jamais vacillé, mais celui auquel nous sommes le plus habituellement revenus." L'œuvre de Diderot est à l'image du personnage, à l'image de son tempérament, elle est à la fois tumultueuse, versatile, joyeuse et insatiable, composant dans tous les registres littéraires, exception faite de la poésie, et ne cessant de reprendre et d'approfondir les idées les plus paradoxales, il fut déiste, puis sceptique, puis franchement matérialiste, s'opposant à la religion et s'enthousiasmant pour la science, faisant jaillir la connaissance des sens et son évolution de la complexité croissante de la vie, bavard, sensuel, démonstratif, sans tact ni délicatesse, "sa sensibilité est à fleur de peau, écrira Mlle de Lespinasse, il ne va pas plus loin que l'émotion..."
Mais que semble poursuivre Diderot? L'Homme, l'être humain, semble-t-il répondre, un être humain sans Dieu, à qui il revient alors de construire une "morale", et non pas une métaphysique, et pour fonder cette morale, il faut savoir ce qu'est cet être humain et s'il est libre. L'idée de Dieu est d'emblée rejetée, l'existence du mal est en effet incompatible, pour lui, avec cette idée, et Dieu est impensable et ses attributs totalement contradictoires. Reste à savoir "si la vie est une bonne ou une mauvaise chose, si la nature humaine est bonne ou méchante, ce qui fait notre bonheur ou notre malheur..."
C'est dans l'article GENIE, du tome VII de l'Encyclopédie (1757), écrit par Diderot, que l'on saisit à quel point, en cette moitié du XVIIIe siècle, l'âge classique n'est plus qu'un très lointain souvenir..
"GÉNIE. (Philosophie et littérature.) L'étendue de l'esprit, la force de l'imagination et l'activité de l'âme, voilà le génie. De la manière dont on reçoit ses idées dépend celle dont on se les rappelle. L'homme jeté dans l'univers reçoit avec des sensations plus ou moins vives les idées de tous les êtres. La plupart des hommes n'éprouvent de sensations vives que par l'impression des objets qui ont un rapport immédiat à leurs besoins, à leur goût, etc.
Tout ce qui est étranger à leurs passions, tout ce qui est sans analogie à leur manière d'exister, ou n'est point aperçu par eux, ou n'en est vu qu'un instant sans être senti, et pour être à jamais oublié.
L'homme de génie est celui dont l'âme, plus étendue, frappée par les sensations de tous les êtres, intéressée à tout ce qui est dans la nature, ne reçoit pas une idée qu'elle n'éveille un sentiment ; tout l'anime et tout s'y conserve.
Lorsque l'âme a été affectée par l'objet même, elle l'est encore par le souvenir ; mais, dans l'homme de génie, l'imagination va plus loin : il se rappelle des idées avec un sentiment plus vif qu'il ne les a reçues, parce qu'à ces idées mille autres se lient, plus propres à faire naître le sentiment. Le génie entouré des objets dont il s'occupe ne se souvient pas : il voit ; il ne se borne pas à voir : il est ému ; dans le silence et l'obscurité du cabinet, il jouit de cette campagne riante et féconde ; il est glacé par le sifflement des vents ; il est brûlé par le soleil, il est effrayé des tempêtes. L'âme se plaît souvent dans ces affections momentanées ; elles lui donnent un plaisir qui lui est précieux ; elle se livre à tout ce qui peut l'augmenter ; elle voudrait par des couleurs vraies, par des traits ineffaçables, donner un corps aux .fantômes qui sont son ouvrage, qui la transportent ou qui l'amusent.
Veut-elle peindre quelques-uns de ces objets qui viennent l'agiter, tantôt les êtres se dépouillent de leurs imperfections ; il ne se place dans ses tableaux que le sublime, l'agréable alors le génie peint en beau; tantôt elle ne voit dans les événements les plus tragiques que les circonstances les plus terribles ; et le génie répand dans ce moment les couleurs les plus sombres, les expressions énergiques de la plainte et de la douleur ; il anime la matière, il colore la pensée ; dans la chaleur de l'enthousiasme, il ne dispose ni de la nature, ni de la suite de ses idées ; il est transporté dans la situation des personnages qu'il fait agir ; il a pris leur caractère : s'il éprouve dans le plus haut degré les passions héroïques, telles que la confiance d'une grande âme que le sentiment de ses forces élève au-dessus de tout danger, telles que l'amour de la patrie porté jusqu'à l'oubli de soi-même, il produit le sublime, le moi de Médée, le qu'il mourût du vieil Horace, le je suis consul de Rome de Brutus; transporté par d'autres passions, il fait dire à Hermione : qui te l'a dit? A Orosmane : j'étais aimé ; à Thyeste : je reconnais mon frère...
Le génie n'est pas toujours génie ; quelquefois, il est plus aimable que sublime ; il sent et peint moins dans les objets le beau que le gracieux ; il éprouve et fait moins éprouver des transports qu'une douce émotion...
Le goût est souvent séparé du génie. Le génie est un pur don de la nature; ce qu'il produit est l'ouvrage d'un moment ; le goût est l'ouvrage de l'étude et du temps ; il tient à la connaissance d'une multitude de règles ou établies ou supposées ; il fait produire des beautés qui ne sont que de convention. Pour qu'une chose soit belle selon les règles du goût, il faut qu'elle soit élégante, finie, travaillée sans le paraître : pour être de génie, il faut quelquefois qu'elle soit négligée, qu'elle ait l'air irrégulier, escarpé, sauvage. Le sublime et le génie brillent dans Shakespeare comme des éclairs dans une longue nuit, et Racine est toujours beau: Homère est plein de génie, et Virgile d'élégance.
Les règles et les lois du goût donneraient des entraves au génie; il les brise pour voler au sublime, au pathétique, au grand. L'amour de ce beau éternel qui caractérise la nature, la passion de conformer ses tableaux à je ne sais quel modèle qu'il a créé et d'après lequel il a les idées et les sentiments du beau, sont le goût de l'homme de génie. Le besoin d'exprimer les passions qui l'agitent est continuellement gêné par la grammaire et par l'usage : souvent l'idiome dans lequel il écrit se refuse à l'expression d'une image qui serait sublime dans un autre idiome.. Enfin, la force et l'abondance, je ne sais quelle rudesse, l'irrégularité, le sublime, le pathétique, voilà dans les arts le caractère du génie ; il ne touche pas faiblement, il ne plaît pas sans étonner, il étonne encore par ses fautes ...
Le génie est frappé de tout, et, dès qu'il n'est point livré à ses pensées et subjugué par l'enthousiasme, il étudie, pour ainsi dire, sans s'en apercevoir; il est forcé, par les impressions que les objets font sur lui, à s'enrichir sans cesse de connaissances qui ne lui ont rien coûté ; il jette sur la nature des coups d'œil généraux et perce ses abîmes. Il recueille dans son sein des germes qui y entrent imperceptiblement et qui produisent dans le temps des effets si surprenants qu`il est lui-même tenté de se croire inspiré : il a pourtant le goût de l'observation. mais il observe rapidement un grand espace, une multitude d'êtres. Le mouvement, qui est son état naturel, est quelquefois si doux qu'à peine il l'aperçoit ; mais le plus souvent ce mouvement excite des tempêtes, et le génie est plutôt emporté par un torrent d'idées qu'il ne suit librement de tranquilles réflexions.
Dans l'homme que l'imagination domine, les idées se lient par les circonstances et par le sentiment : il ne voit souvent des idées abstraites que dans leur rapport avec les idées sensibles. Il donne aux abstractions une existence indépendante de l'esprit qui les a faites ; il réalise ses fantômes, son enthousiasme augmente au spectacle de ses créations, c'est-à-dire de ses nouvelles combinaisons, seules créations de l'homme ; emporté par la foule de ses pensées, livré à la facilité de les combiner, forcé de produire, il trouve mille preuves spécieuses et ne peut s'assurer d'une seule; il construit des édifices hardis que la raison n'oserait habiter, et qui lui plaisent par leurs proportions et non par leur solidité ; il admire ses systèmes comme il admirerait le plan d'un poème, et il les adopte comme beaux en croyant les aimer comme vrais.
Le vrai ou le faux, dans les productions philosophiques, ne sont point les caractères distinctifs du génie... Le génie hâte cependant les progrès de l`a philosophie par les découvertes les plus heureuses et les moins attendues : il s'élève d'un vol d'aigle vers une vérité lumineuse, source de mille vérités auxquelles parviendra dans la suite en rampant la foule timide des sages observateurs. Mais, à côté de cette vérité lumineuse, il placera les ouvrages de son imagination : incapable de marcher dans la carrière et de parcourir successivement les intervalles, il part d'un point et s'élance vers le but ; il tire un principe fécond des ténèbres ; il est rare qu'il suive la chaîne des conséquences ; il est primesautier, pour me servir de l'expression de Montaigne. Il imagine plus qu'il n'a vu ; il produit plus qu'il ne découvre ; il entraîne plus qu'il ne conduit : il anima les Platon, les Descartes, les Malebranche, les Bacon, les Leibnitz ; et, selon le plus ou moins que l'imagination domina dans ces grands hommes, il fit éclore des systèmes brillants ou découvrir de grandes vérités...
Dans les arts, dans les sciences, dans les affaires, le génie semble changer la nature des choses ; son caractère se répand sur tout ce qu'il touche, et ses lumières, s'élançant au-delà du passé et du présent, éclairent l'avenir : il devance son siècle qui ne peut le suivre ; il laisse loin de lui l'esprit qui le critique avec raison, mais qui, dans sa marche égale, ne sort jamais de l'uniformité de la nature. Il est mieux senti que connu par l'homme qui veut le définir : ce serait à lui-même à parler de lui ; et cet article, que je n'aurais pas dû faire, devait être l'ouvrage d'un de ces hommes extraordinaires, qui honore ce siècle, et qui, pour connaître le génie, n'aurait eu qu'à regarder en lui-même".
Et Diderot est sans doute le premier à annoncer la disparition de la philosophie rationnelle au profit de la philosophie, expérimentale : "Les faits, de quelque nature qu'ils soient, sont la véritable richesse du philosophe. La philosophie rationnelle s'occupe beaucoup plus à lier les faits qu'elle possède qu'à en recueillir de nouveaux. La philosophie expérimentale, qui ne se propose rien, est toujours contente de ce qui lui vient. La philosophie rationnelle est toujours instruite, lors même que ce qu'elle s'est proposé ne lui vient pas. Dieu, je ne te demande rien, car le cours des choses est nécessaire par lui-même, si tu n'es pas; ou par ton décret, si tu es. Le physicien abandonnera le pourquoi et ne s'occupera que du comment. Le comment se tire des êtres; le pourquoi de notre entendement : il tient à nos systèmes. Rien de plus vain que la question : pourquoi il existe quelque chose? Il est un ordre essentiellement conséquent aux qualités primitives de la matière. La chaîne des causes n'a point eu de commencement, et celle des effets n'aura point de fin. La supposition d'un être quelconque placé en dehors de l'univers matériel est impossible..."

Denis Diderot (1713-1784)
Denis Diderot, fils d'un artisan coutelier, naquit à Langres en 1713. Il fit de bonnes études chez les jésuites de cette ville et à Paris, fut employé chez un procureur, mais abandonna vite l'étude du droit pour mener une vie à la fois très libre et difficile, il perd la foi, peu d'éléments nous sont connus, jusqu'en 1742, date à laquelle il rencontre Rousseau, fait la connaissance de Grimm, son ami le plus intime, et épouse en 1743 Antoinette Champion, lingère de son état.
C'est en 1745 qu'il se lance dans la lutte philosophique, il a 32 ans. Le libraire Le Breton lui confie la direction de l'Encyclopédíe, la grande entreprise de sa vie et du siècle, le privilège est obtenu en 1745. L'emprisonnement à Vincennes retarda l'impression du premier volume, qui parut enfin en 1751, Diderot avait trente- huit ans, et en 1772, quand le prodigieux monument sera achevé, il en aura cinquante-neuf. Une tâche énorme poursuivie sur pratiquement une trentaine d'années, qui ne l'a pourtant pas totalement absorbé, tant son activité littéraire, théâtrale, artistique était inépuisable. Il écrit plusieurs ouvrages de polémique philosophique : les "Pensées philosophiques" (1746), la "Lettre sur les Aveugles à l'usage de ceux qui voient" (1749) - qui lui vaut d'être emprisonné à Vincennes pour athéisme -, un Essai sur le beau, la Lettre sur les sourds-muets (1751) où Condillac a puisé, "De L'Interprétation de la Nature" (1753), qui prône un matérialisme hardi et nouveau. Il publie en 1757 "le Fils naturel ou les épreuves de la Vertu", et expose dans les "Entretiens sur le Fils naturel", ses idées sur le drame et la comédie. Il se brouille avec Rousseau, fréquente Mme d'Épinay, le baron d'Holbach, se lie avec Sophie Volland à qui il écrit des lettres fort vivantes et sensibles, et publie en 1759 un "Salon" qui inaugure une série de comptes rendus qui durera vingt ans ainsi que sa Correspondance avec Grimm,
En 1765, Catherine de Russie lui achète sa bibliothèque; Diderot lui rend visite en 1773 et séjourne plusieurs mois à Saint-Pétersbourg. Cette période de sa vie est particulièrement féconde et les ouvrages philosophiques se succèdent : "Entretien entre d'Alembert et Diderot" (1769), "le Rêve de d'Alembert" (1770), "Ceci n'est pas un conte" (1772) ; en 1773, "Jacques le Fataliste" est en préparation, ainsi que le "Paradoxe sur le comédien", qui paraîtra en 1778.
A son retour de Russie (1774), bien que surmené, il continue à se dépenser en études et travaux divers : il rédige un essai sur la vie de Sénèque, termine le "Paradoxe sur le comédien" (1778), "le Neveu de Rameau" et enfin "Est-il bon est-il méchant?" (1781). Il meurt d'apoplexie en 1784. Une grande partie de l'œuvre de Diderot ne sera publiée qu'après sa mort : "La Religieuse" est un roman mi-sensible, mi-scandaleux sur la vie des couvents; "Jacques le Fataliste", succession originale d'aventures amoureuses entremêlées de réflexions sur la matière, la fatalité, l'art et la vie, est une œuvre désordonnée et captivante ; "le Neveu de Rameau" enfin, est sans doute un roman sans équivalent dans la littérature française, à la fois une confidence personnelle sincère et vive, presque cynique, tableau coloré de la pittoresque clientèle des cafés du Palais-Royal, et vertigineux débat sur le parasitisme, la paresse, l'échec de l'individu et les erreurs de la société. Cet ouvrage fut traduit en allemand par Gœthe en 1805...

1746-1747 - Diderot entre en littérature, après des travaux de traduction : les Pensées philosophiques, puis en 1747, "La Promenade du sceptique". De la même époque datent un roman philosophique et libertin, "Les Bijoux indiscrets", et des Mémoires sur différents sujets de mathématiques (nous avons de lui cinq Mémoires publiés en 1748 sur l'Acoustique, la Développante du Cercle, la Tension des cordes, le Projet d'un nouvel orgue, la Résistance de l'air au mouvement des pendules)...

1747, "La Promenade du sceptique, ou les Allées".
A peine Diderot se mit-il à écrire, que déjà il fut sous surveillance policière, le livre un instant disparu, émergea en 1800 lors d'une vente aux enchères, mais ne fut édité qu'en 1830. Il est d'usage de voir dans cet ouvrage ses premiers pas vers l'athéisme, et de considérer qu'à sa manière, Diderot tourne résolument le dos à l'esprit des Lumières. Revenu de la bataille de Fontenoy, nous dit-il sans cette histoire, il rencontre un certain Cléobule qui s'est retiré du monde s'en est dégoûté pour développer une réflexion assez singulière quant à la méthode : "je remarquai bientôt que les matières qu'il entamait étaient presque toujours analogues aux objets qu'il avait sous les yeux"...
"Dans une espèce de labyrinthe, formé d'une haute charmille coupée de sapins élevés et touffus, il ne manquait jamais de m'entretenir des erreurs de l'esprit humain, de l'incertitude de nos connaissances, de la frivolité des systèmes de la physique et de la vanité des spéculations sublimes de la métaphysique. Assis au bord d'une fontaine, s'il arrivait qu'une feuille détachée d'un arbre voisin, et portée par le zéphyr sur la surface de l'eau, en agitât le cristal et en troublât la limpidité, il me parlait de l'inconstance de nos affections, de la fragilité de nos vertus, de la force des passions, des agitations de notre âme, de l'importance et de la difficulté de s'envisager sans prévention, et de se bien connaître.
Transportés sur le sommet d'une colline qui dominait les champs et les campagnes d'alentour, il m'inspirait le mépris pour tout ce qui élève l'homme sans le rendre meilleur; il me montrait mille fois plus d'espace au-dessus de ma tête que je n'en avais sous mes pieds, et il m'humiliait par le rapport évanouissant du point que j'occupais à l'étendue prodigieuse qui s'offrait à ma vue.
Redescendus dans le fond d'une vallée, il considérait les misères attachées à la condition des hommes, et m'exhortait à les attendre sans inquiétude et à les supporter sans faiblesse.
Une fleur lui rappelait ici une pensée légère ou un sentiment délicat. Là c'était au pied d'un vieux chêne, ou dans le fond d'une grotte, qu'il retrouvait un raisonnement nerveux et solide, une idée forte, quelque réflexion profonde.
Je compris que Cléobule s'était fait une sorte de philosophie locale que toute sa campagne était animée et parlante pour lui; que chaque objet lui fournissait des pensées d'un genre particulier, et que les ouvrages de la nature étaient à ses yeux un livre allégorique où il lisait mille vérités qui échappaient au reste des hommes.
Pour m'assurer davantage de ma découverte, je le conduisis un jour à l'étoile dont j'ai parlé. Je me souvenais qu'en cet endroit il m'avait touché quelque chose des routes diverses par lesquelles les hommes s'avancent vers leur dernier terme, et j'essayai s'il ne reviendrait pas dans ce lieu à la même matière. Que je fus satisfait de mon expérience! Combien de vérités importantes et neuves n'entendis-je pas. En moins de deux heures que nous passâmes à nous promener de l'allée des épines dans celle des marronniers, et de l'allée des marronniers dans son parterre, il épuisa l'extravagance des religions, l'incertitude des systèmes de la philosophie et la vanité des plaisirs du monde. Je me séparai de lui, pénétré de la justesse de ses notions, de la netteté de son jugement et de l'étendue de ses connaissances et, de retour chez moi, je n'eus rien de plus pressé que de rédiger son discours, ce qui me fut d'autant plus facile que, pour se mettre à ma portée, Cléobule avait affecté d'emprunter des termes. et des comparaisons de mon art..."
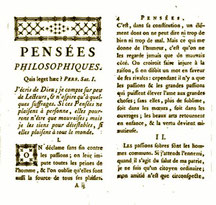
1746 - "Pensées philosophiques"
"La pensée qu'il n'y a pas de Dieu n'a jamais effrayé personne" - Diderot publie en 1745 l'Essai sur le mérite et la vertu, traduction libre d'un ouvrage de l'Anglais Shaftesbury, puis en 1746 un ouvrage plus audacieux, les "Pensées Philosophiques" où il attaque le christianisme et milite en faveur de la religion naturelle ; ces Pensées seront complétées en 1770 par une Addition beaucoup plus violente. L'ouvrage marque les véritables débuts de sa carrière littéraire. Diderot dénonce non seulement l'absurdité des différents dogmes de la religion chrétienne qu'il juge contraire à la morale, souligne la faiblesse des preuves qu'elle invoque, et s'en prend à l'idéal d'ascétisme de la morale chrétienne auquel il propose de substituer une morale visant à un libre développement de notre nature humaine. Quant à l'athéisme, sa réfutation passe par le spectacle de l'ordre de la nature. Condamné par le Parlement dès sa parution, l'ouvrage eut un succès immédiat, voir les nombreuses réfutations qu'il suscita...
V. — C'est le comble de la folie, que de se proposer la ruine des passions. Le beau projet que celui d'un dévot qui se tourmente comme un forcené, pour ne rien désirer, ne rien aimer, ne rien sentir et qui finirait par devenir un vrai monstre s'il réussissait!
IX. — Sur le portrait qu'on me fait de l'Être suprême, sur son penchant à la colère, sur la rigueur de ses vengeances, sur certaines comparaisons qui nous expriment en nombre le rapport de ceux qu'il laisse périr à ceux à qui il daigne tendre la main, l'âme la plus droite serait tentée de souhaiter qu'il n'existât pas. L'on serait assez tranquille en ce monde, si l'on était assez bien assuré que l'on n'a rien à craindre dans l'autre : la pensée qu'il n'y a point de Dieu n'a jamais effrayé personne, mais bien celle qu'il y en a un tel que celui qu'on me peint.
XIV. — Pascal avait de la droiture: mais il était peureux et crédule. Élégant écrivain, et raisonneur profond, il eût sans doute éclairé l'univers, si la Providence ne l'eût abandonné à des gens qui sacrifièrent ses talents à leurs haines. Qu'il serait à souhaiter qu'il eut laissé aux théologiens de son temps le soin de vider leurs querelles; qu'il se fût livré à la recherche de la vérité, sans réserve et sans crainte d'offenser Dieu, en se servant de tout l'esprit qu'il en avait reçu, et surtout qu'il eût refusé pour maîtres des hommes qui n'étaient pas dignes d'être ses disciples! On pourrait bien lui appliquer ce que l'ingénieux La Mothe disait de La Fontaine : Qu'il fut assez bête pour croire qu'Arnaud, de Sacy et Nicole valaient mieux que lui.
XIX. — Les subtilités de l'ontologie ont fait tout au plus des sceptiques: c'est a la connaissance de la nature qu'il était réservé de faire de vrais déistes. La seule découverte des germes a dissipé une des plus puissantes objections de l'athéisme. Que le mouvement soit essentiel ou accidentel à la matière, je suis maintenant convaincu que ses effets se terminent à des développements : toutes les observations concourent à me démontrer que la putréfaction seule ne produit rien d'organisé ; je puis admettre que le mécanisme de l'insecte le plus vil n'est pas moins merveilleux que celui de l'homme, et je ne crains pas qu'on en infère qu'une agitation intestine des molécules étant capable de donner l'un, il est vraisemblable qu'elle a donné l'autre. Si un athée avait avancé, il y a deux cents ans , qu'on verrait peut-être un jour des hommes sortir tout formés des entrailles de la terre, comme on voit éclore une foule d'insectes d'une masse de chair échauffée, je voudrais bien savoir ce qu'un métaphysicien aurait eu à lui répondre.....
Addition aux Pensées philosophiques, objections diverses contre les écrits des différents théologiens...
I. — Les doutes, en matière de religion, loin d'être des actes d'impiété, doivent être regardés comme de bonnes œuvres, lorsqu'ils sont d'un homme qui reconnaît humblement son ignorance, et qu'ils naissent de la crainte de déplaire à Dieu par l'abus de la raison,
II — Admettre quelque conformité entre la raison de l'homme et la raison éternelle, qui est Dieu, et prétendre que Dieu exige le sacrifice de la raison humaine, c'est établir qu'il veut et ne veut pas tout à ta fois.
III. — Lorsque Dieu, de qui nous tenons la raison, en exige le sacrifice, c'est un faiseur de tours de gibecière qui escamote ce qu'il a donné.
IV. — Si je renonce à ma raison, je n'ai plus de guide : il faut que j'adopte en aveugle un principe secondaire, et que je suppose ce qui est en question,
V. — Si la raison est un don du ciel, et que l'on en puisse dire autant de la foi, le ciel nous a fait deux présents incompatibles et contradictoires.
VI. — Pour lever cette difficulté, il faut dire que la foi est un principe chimérique, et qui n'existe point dans la nature,
VIL — Pascal, Nicole et autres ont dit : Qu'un Dieu punisse de peines éternelles la faute d'tin père coupable sur tous ses enfants innocents, c'est une proposition supérieure et non contraire à la raison. Mais qu'est-ce donc qu'une proposition contraire à la raison, si celle qui énonce évidemment un blasphème ne l'est pas?
VIII. — Égaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n'ai qu'une petite lumière pour me conduire. Survient un inconnu qui me dit : Mon ami, souffle ta bougie pour mieux trouver ton chemin. Cet inconnu est un théologien.
IX. — Si ma raison vient d'en haut, c'est la voix du ciel qui me parle par elle; il faut que je l'écoute.
X. — Le mérite et le démérite ne peuvent s'appliquer à l'usage de la raison, parce que toute la bonne volonté du monde ne peut servir à un aveugle pour discerner des couleurs. Je suis forcé d'apercevoir l'évidence où elle est, et le défaut d'évidence où l'évidence n'est pas, à moins que je ne sois un imbécile; or l'imbécillité est un malheur et non pas un vice.
XI. — L'auteur de la nature, qui ne me récompensera pas pour avoir été un homme d'esprit, ne me damnera pas pour avoir été un sot....
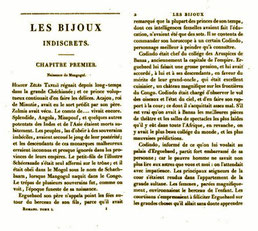
1748 - "Les Bijoux indiscrets"
Roman publié anonymement que Diderot semble plus tard regretté avoir écrit, mais peut-être que le côté licencieux a permis de dévoiler certaines de ses opinions. Un sultan, Mangogul, s'ennuie, sa favorite, Mirzoza, ayant épuisé toute la chronique scandaleuse de la capitale, lui conseille de consulter un génie afin de connaître les secrets galants des dames de la Cour. Le génie lui offre un anneau magique, il suffit de tourner le chaton de la bague pour pénétrer par la voie d'un de ses bijoux tous les secrets et intrigues d'une femme. La capitale est à Paris, on reconnaît Louis XV et Pompadour, les sujets qui agitent la Cour sont égratignés, de la querelle des Anciens et des Modernes au problème de la nature de l'âme...
"Ah ! dit Mangogul en bâillant et se frottant les yeux, j'ai mal à la tête. Qu'on ne me parle jamais de philosophie ; ces conversations sont malsaines. Hier, je me couchai sur des idées creuses, et au lieu de dormir en sultan, mon cerveau a plus travaillé que ceux de mes ministres ne travailleront en un an. Vous riez ; mais pour vous convaincre que je n'exagère point et me venger de la mauvaise nuit que vos raisonnements m'ont procurée, vous allez essuyer mon rêve tout du long.
" Je commençais à m'assoupir et mon imagination à prendre son essor, lorsque je vis bondir à mes côtés un animal singulier. Il avait la tête de l'aigle, les pieds du griffon, le corps du cheval et la queue du lion. Je le saisis malgré ses caracoles, et, m'attachant à sa crinière je sautai légèrement sur son dos. Aussitôt il déploya de longues ailes qui partaient de ses flancs et je me sentis porter dans les airs avec une vitesse incroyable.
" Notre course avait été longue, lorsque j'aperçus, dans le vague de l'espace, un édifice suspendu comme par enchantement. Il était vaste. Je ne dirai point qu'il péchât par les fondements, car il ne portait sur rien. Ses colonnes, qui n'avaient pas un demi-pied de diamètre, s'élevaient à perte de vue et soutenaient des voûtes qu'on ne distinguait qu'à la faveur des jours dont elles étaient symétriquement percées.
" C'est à l'entrée de cet édifice que ma monture s'arrêta. Je balançai d'abord à mettre pied à terre, car je trouvais moins de hasard à. voltiger sur mon hippogriffe qu'à me promener sous ce portique. Cependant, encouragé par la multitude de ceux qui l'habitaient et par une sécurité remarquable qui régnait sur tous les visages, je descends, je m'avance, je me jette dans la foule et je considère ceux qui la faisaient.
" C'étaient des vieillards, ou bouffis, ou fluets, sans embonpoint et sans force et presque tous contrefaits. L'un avait la tête trop petite, l'autre les bras trop courts. Celui-ci péchait par le corps, celui-là manquait par les jambes. La plupart n'avaient point de pieds et n'allaient qu'avec des béquilles. Un souffle les faisait tomber, et ils demeuraient à terre jusqu'à ce qu'il prît envie à quelque nouveau débarqué de les relever. Malgré tous ces défauts, ils plaisaient au premier coup d'oeil. Ils avaient dans la physionomie je ne sais quoi d'intéressant et de hardi. Ils étaient presque nus, car tout leur vêtement consistait en un petit lambeau d'étoffe qui ne couvrait pas la centième partie de leur corps.
" Je continue de fendre la presse et je parviens au pied d'une tribune à laquelle une grande toile d'araignée servait de dais. Du reste, sa hardiesse répondait à celle de l'édifice. Elle me parut posée comme sur la pointe d'une aiguille et s'y soutenir en équilibre. Cent fois je tremblai pour le personnage qui l'occupait. C'était un vieillard à longue barbe, aussi sec et plus nu qu'aucun de ses disciples. Il trempait, dans une coupe pleine d'un fluide subtil, un chalumeau qu'il portait à sa bouche et soufflait des bulles à une foule de spectateurs qui l'environnaient et qui travaillaient à les porter jusqu'aux nues.
" Où suis-je ? me dis-je à moi-même, confus de ces puérilités. Que veut dire ce souffleur avec ses bulles et tous ces enfants décrépits occupés à les faire voler ? Qui me développera ces choses ?... " Les petits échantillons d'étoffes m'avaient encore frappé, et j'avais observé que plus ils étaient grands moins ceux qui les portaient s'intéressaient aux bulles. Cette remarque singulière m'encouragea à aborder celui qui me paraîtrait le moins déshabillé.
" J'en vis un dont les épaules étaient à moitié couvertes de lambeaux si bien rapprochés que l'art dérobait aux yeux les coutures. Il allait et venait dans la foule, s'embarrassant fort peu de ce qui s'y passait. Je lui trouvai l'air affable, la bouche riante, la démarche noble, le regard doux, et j'allai droit à lui.
" - Qui êtes-vous ? où suis-je ? et qui sont tous ces gens ? lui demandai-je sans façon.
" - Je suis Platon, me répondit-il. Vous êtes dans la région des hypothèses, et ces gens-là sont des systématiques.
" - Mais par quel hasard, lui répliquai-je, le divin Platon se trouve-t-il ici ? et que fait-il parmi ces
insensés ?...
" - Des recrues, me dit-il. J'ai, loin de ce portique, un petit sanctuaire où je conduis ceux qui reviennent des systèmes.
" - Et à quoi les occupez-vous ?
" - A connaître l'homme, à pratiquer la vertu et à sacrifier aux Grâces...
" - Ces occupations sont belles ; mais que signifient tous ces petits lambeaux d'étoffes par lesquels vous ressemblez mieux à des gueux qu'à des philosophes ?..."

1749 - Diderot quitte le déisme pour un athéisme matérialiste assumé. Pour avoir publié "Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient", mais sans doute plus encore "la Promenade du Sceptique" et "Apologie pour l'abbé de Prade" (et une certaine rancune de Mme de Saint-Maur et de ses amis), Diderot est emprisonné à Vincennes, une expérience qui sera très marquante, et prendra soin à l'avenir de ne pas toujours publier la totalité de ses ouvrages. C'est là qu'il reçoit la fameuse visite de Rousseau méditant son premier Discours. Les Mémoires de Marmontel montrent que ces détentions des hommes de lettres n'offraient rien de particulièrement éprouvant...

1749 - "Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient"
Célèbre lettre écrite à Mme de Puisieux, sa maîtresse du moment, et surtout écrit scientifique et philosophique dans lequel Diderot expose que la connaissance et la perception des choses émanent d’une sensibilité propre à chacun. Aussi, les aveugles ont-ils une conception autre du monde qui les entoure. L'origine? une expérience de Réaumur qui avait rendu la vue par une opération de la cataracte à un aveugle de naissance et qui avait convié un certain nombre de personnes (dont Mme Dupré de Saint-Maur, la maîtresse de Réaumur), aux premières réactions du sujet au contact de la lumière. Il se tournera ensuite vers un cas plus complexe, celui de Nicolas Saunderson, célèbre mathématicien, aveugle de naissance qui imagina une "arithmétique palpable". Dans cet ouvrage, l’auteur montrait alors clairement une vision matérialiste et athée, qui ne pouvait que le conduire en prison. Diderot entend donc montrer que nos idées morales et métaphysiques dépendent de l'état de notre organisme et ne résultent nullement d'un instinct divin ou d'une révélation. Bien plus, selon Diderot, il serait presque impossible à un aveugle-né de croire en Dieu.
"Comme je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps, je me mis à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus. Je m'aperçus d'abord qu'il avait une aversion prodigieuse pour le vol ; elle naissait en lui de deux causes : de la facilité qu'on avait de le voler sans qu'il s'en aperçût ; et plus encore, peut-être, de celle qu'on avait de l'apercevoir quand il volait. Ce n'est pas qu'il ne sache très bien se mettre en garde contre le sens qu'il nous connaît de plus qu'à lui, et qu'il ignore la manière de bien cacher un vol. Il ne fait pas grand cas de la pudeur : sans les injures de l'air, dont les vêtements le garantissent, il n'en comprendrait guère l'usage...
Comme, de toutes les démonstrations extérieures qui réveillent en nous la commisération et les idées de la douleur, les aveugles ne sont affectés que par la plainte, je les soupçonne, en général, d'inhumanité...
Nous-mêmes ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles? tant nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent ! Aussi je ne doute poing que, sans la crainte du châtiment, bien des gens n'eussent moins de peine à tuer un homme à une distance où ils ne le verraient gros que comme une hirondelle, qu'à égorger un bœuf de leurs mains. Si nous avons de la compassion pour un cheval qui souffre, et si nous écrasons une fourmi sans aucun scrupule, n'est-ce-pas le même principe qui nous détermine? Ah, madame ! que la morale des aveugles est différente de la nôtre! que celle d'un sourd différerait encore de celle d'un aveugle, et qu'un être qui aurait un sens de plus que nous trouverait notre morale imparfaite, pour ne rien dire de pis !
Notre métaphysique ne s'accorde pas mieux avec la leur. Combien de principes pour eux qui ne sont que des absurdités pour nous et réciproquement ! Je pourrais entrer là-dessus dans un détail qui vous amuserait sans doute, mais que de certaines gens, qui voient du crime à tout, ne manqueraient pas d'accuser d'irreligion, comme s'il dépendait de moi de faire apercevoir aux aveugles les choses autrement qu'ils ne les aperçoivent. Je me contenterai d'observer une chose dont je crois qu'il faut que tout le monde convienne : c'est que ce grand raisonnement qu'on tire des merveilles de la nature, est bien faible pour des aveugles! La facilité que nous avons de créer, pour ainsi dire, de nouveaux objets par le moyen d'une petite glace, est quelque chose de plus incompréhensible pour eux que des astres qu'ils ont été condamnés à ne voir jamais. Ce globe lumineux qui s'avance d'orient en occident les étonne moins qu'un petit feu qu'ils ont la commodité d'augmenter ou de diminuer: comme ils voient la matière d'une manière beaucoup plus abstraite que nous, ils sont moins éloignés de croire qu'elle pense.
Si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux se trouvait confondu chez un peuple d'aveugles, il faudrait qu'il prît le parti de se taire, ou celui de passer pour un fou. Il leur annoncerait tous les jours quelque nouveau mystère, qui n'en serait un que pour eux, et que les esprits forts se sauraient bon gré de ne pas croire. Les défenseurs de la religion ne pourraient-ils pas tirer un grand parti d'une incrédulité si opiniâtre, si juste même, à certains égards, et cependant si peu fondée? Si vous vous prêtez pour un instant à cette supposition, elle vous rappellera, sous des traits empruntés, l'histoire et les persécutions de ceux qui ont eu le malheur de rencontrer la vérité dans des siècles de ténèbres, et l'imprudence de la déceler à leurs aveugles contemporains, entre lesquels ils n'ont point eu d'ennemis plus cruels que ceux qui, par leur état et leur éducation, semblaient devoir être les moins éloignés de leurs sentiments."
L'entretien qu'au moment de mourir Saunderson eut avec le pasteur Holmes est l'une des pages les plus puissantes de notre auteur, s'élevant une conception de la matière qui fait appel à des notions nouvelles d'évolution et de probabilités, et défie hes philosophes de trouver, à travers les agitations irrégulières de cet océan de matière qu'il ouvre à nos réflexions "quelques vestiges de cet Être intelligent dont vous admirez ici la sagesse"...
"Lorsqu'il fut sur le point de mourir, on appela auprès de lui un ministre fort habile, M. Gervaise Holmes; ils eurent ensemble un entretien sur l'existence de Dieu, dont il nous reste quelques fragments que je vous traduirai de mon mieux; car ils en valent bien la peine. Le ministre commença par lui objecter les merveilles de la nature : « Eh, monsieur! lui disait le philosophe aveugle, laissez la tout ce beau spectacle qui n'a jamais été fait pour moi! J'ai été condamné à passer ma vie dans les ténèbres,- et vous me citez des prodiges que je n'entends point, et qui ne prouvent que pour vous et que pour ceux qui voient comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut que vous me le fassiez toucher.
— Monsieur, reprit habilement le ministre, portez les main sur vous-même, et vous rencontrerez la divinité dans le mécanisme admirable de vos organes.
— Monsieur Holmes, reprit Saunderson, je vous le répète, tout cela n'est pas aussi beau pour moi que pour vous. Mais le mécanisme animal fût-il aussi parfait que vous le prétendez, et que je veux bien le croire, car vous êtes un honnête homme très-incapable de m'en imposer, qu'a-t-il de commun avec un être souverainement intelligent? S'il vous étonne, c'est peut- être parce que vous êtes dans l'habitude de traiter de prodige tout ce qui vous paraît au-dessus de vos forces. J'ai été si souvent un objet d'admiration pour vous, que j'ai bien mauvaise opinion de ce qui vous surprend. J'ai attiré du fond de l'Angleterre des gens qui ne pouvaient concevoir comment je faisais de la géométrie : il faut que vous conveniez que ces gens-là n'avaient pas de notions bien exactes de la possibilité des choses. Un phénomène est-il, à notre avis, au-dessus de l'homme? nous disons aussitôt : c'est l'ouvrage d'un Dieu; notre vanité ne se contente pas à moins. Ne pourrions-nous pas mettre dans nos discours un peu moins d'orgueil, et un peu plus de philosophie? Si la nature nous offre un nœud difficile à délier, laissons-le pour ce qu'il est; et n'employons pas à le couper la main d'un être qui devient ensuite pour nous un nouveau nœud plus indissoluble que le premier. Demandez à un Indien pourquoi le monde reste suspendu dans les airs, il vous répondra qu'il est porté sur le dos d'un éléphant; et l'éléphant sur quoi l'appuiera-t-il ? sur une tortue ; et la tortue, qui la soutiendra?... Cet Indien vous fait pitié; et l'on pourrait vous dire comme à lui : Monsieur Holmes, mon ami, confessez d'abord votre ignorance, et faites-moi grâce de l'éléphant et de la tortue.»
Saunderson s'arrêta un moment : il attendait apparemment que le ministre lui répondît; mais par où attaquer un aveugle? M. Holmes se prévalut de la bonne opinion que Saunderson avait conçue de sa probité, et des lumières de Newton, de Leibnitz, de Clarke et de quelques-uns de ses compatriotes, les premiers génies du monde, qui tous avaient été frappés des merveilles de la nature, et reconnaissaient un être intelligent pour son auteur. C'était, sans contredit, ce que le ministre pouvait objecter de plus fort à Saunderson. Aussi le bon aveugle convint-il qu'il y aurait de la témérité à nier ce qu'un homme, tel que Newton, n'avait pas dédaigné d'admettre : il représenta toutefois au ministre que le témoignage de Newton n'était pas aussi fort pour lui, que celui de la nature entière pour Newton ; et que Newton croyait sur la parole de Dieu, au lieu que lui il en était réduit à croire sur la parole de Newton. « Considérez, monsieur Holmes, ajouta-t-il, combien il faut que j'aie de confiance en votre parole et dans celle de Newton. Je ne vois rien, cependant j'admets en tout un ordre admirable ; mais je compte que vous n'en exigerez par davantage. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers, pour obtenir de vous en revanche la liberté de penser ce qu'il me plaira de son ancien et premier état, sur lequel vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point ici de témoins à m'opposer; et vos yeux ne vous sont d'aucune ressource. Imaginez donc, si vous voulez, que l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté; mais laissez-moi croire qu'il n'en est rien; et que si nous remontions à la naissance des choses et des temps, et que nous sentissions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous rencontrerions une multitude d'êtres informes pour quelques êtres bien organisés. Si je n'ai rien à vous objecter sur la condition présente des choses, je puis du moins vous interroger sur leur condition passée. Je puis vous demander, par exemple, qui vous a dit à vous, à Leibnitz, à Clarke et à Newton, que dans les premiers instants de la formation des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les autres sans pieds?... »
Avec La Lettre sur les Aveugles, Diderot commença à se faire une réputation et il communiqua à Voltaire, qui était alors à Paris, son livre, un Voltaire qui, après avoir réussi à faire jouer, malgré le vieux Crébillon et ses protecteurs, sa "Sémirami"s, assistait aux représentations de "Nanine". S'établit ainsi entre le poète-dramaturge et le philosophe une correspondance qui, sans avoir été particulièrement active, fut assez continue. Mais il y a dans la Lettre sur les Aveugles un passage que Voltaire ne peut accepter, "Je vous avoue que je ne suis point du tout de l'avis de Saunderson, qui nie un Dieu parce qu'il est né aveugle". Ce qui n'est pas tout à fait la teneur de ce que dit Saunderson. Et plus tard, Voltaire, bien qu'il ne fût pas encore de ses plus intimes, d'annoncer, le 30 juillet 1749, à l'abbé Raynal, que madame du Châtelet avait écrit au marquis du Châtelet, gouverneur de Vincennes, pour le prier d'adoucir autant qu'il le pourrait la prison de Socrate-Diderot. « Il est honteux, ajoutait Voltaire, que Diderot soit en prison et que le poète Roi ait une pension. Ces contrastes-là font saigner le cœur."

En 1746 le libraire Le Breton a confié à Diderot la direction de l'Encyclopédie, d'Alembert écrit le Discours préliminaire et Diderot le Prospectus qui paraîtra en 1750. Le privilège pour l'Encyclopédie,, accordé dès 1745, avait été scellé le 21 janvier 1746. Mais l'incarcération du directeur mettait l'œuvre en péril avant même qu'elle n'eût commencé de paraître, et, chose curieuse, le comte d'Argenson, à qui était dû l'emprisonnement, avait accepté la dédicace de l'Encyclopédie. Le philosophe fut relâché avant la fin du mois de septembre 1749, après une détention de cent jours. Dans une lettre du 30 septembre, il remercie Bernard du Châtelet et termine en le suppliant « de lui continuer les marques de sa bienveillance auprès de M. d'Argenson, car il en a besoin plus que jamais ». La publication commença en 1751, très mal accueillie par le Journal de Trévoux. Diderot répondit par les deux lettres au Père Berthier. Par ailleurs, c'était un grand succès, avec l'expression de sentiments assez mêlés. Pendant vingt ans, jusqu'en 1765, les travaux de l'Encyclopédie vont absorber une grande partie de l'activité de Diderot. Il rédige, corrige, révise une foule d'articles, stimule les collaborateurs.
1751-1753 - Parution du premier volume de l'Encyclopédie en 1751, Diderot avait trente- huit ans et en 1772, et quand le monument fut achevé, il en aura cinquante-neuf. Mais on profite de la collaboration de l'abbé de Prades à l'Encyclopédie pour l'interdire après le second volume, le 7 février 1752. L'abbé avait été condamné pour sa thèse en Sorbonne, "à la Jérusalem céleste", comme favorisant le matérialisme et renversant les fondements de la morale chrétienne. L'abbé, décrété de prise de corps, s'enfuit à Berlin et fut accueilli par Frédéric II. Mais tous les contemporains virent là-dessous la main des Jésuites, et la haine que leur portait d'Alembert contribua peut-être pour quelque chose à la résolution qu'il montra de conserver sa place et ses responsabilités à la direction de l'entreprise. La publication reprit en 1753 avec une préface au troisième volume et continua jusqu'au septième volume, donné en 1757. L'opposition persistait, manifestée surtout dans les petites feuilles et les pamphlets...
Tout naturellement, Diderot se chargea, dans l'Encyclopédie, de la partie purement philosophique : c'est lui qui rédigea le plus grand nombre des articles qui concernent les hommes et les systèmes, ceux surtout de l'antiquité. Mais on n'a pu s'étonner de trouver ici un Diderot plus réservé, moins passionné, peut-être se sentait-il surveillé, mais ce n'est pas dans les articles philosophiques qu'il faut chercher les hardiesses de son œuvre, elles sont d'ailleurs beaucoup plus dans l'intention générale, Diderot devait, après s'être vu supprimer le privilège, tâcher au moins de se conserver une tolérance tacite de l'édition de la publication...
En 1750, Diderot est installé à Paris, place de la Vieille-Estrapade, son fils y meurt, et aussi son troisième enfant, peu de temps après sa naissance. Le 2 septembre 1753, naquit Marie- Angélique, la future Mme de Vandeul, dont les lettres constitueront un véritable trésor pour suivre l'activité de son père. Plus tard, il ira rue Taranne, vis-à-vis de la rue Saint-Benoît. Il y habita pendant plus de trente ans ; les appartements étaient au quatrième étage ; le cinquième était affecté à la bibliothèque. C'est là que grimpaient directement tous ceux qui avaient quelque chose à tirer du philosophe, recommandations littéraires ou secours d'argent...
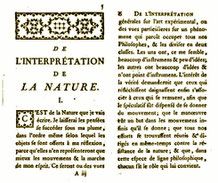
1754 - "Pensées sur l’interprétation de la nature"
Pour penser cet être humain sans Dieu, une connaissance scientifique de l'homme est à acquérir et pourrait permettre d'élaborer une morale positive. "Nous avons trois moyens principaux : l'observation de la nature, la réflexion et l'expérience. L'observation recueille les faits; la réflexion les combine; l'expérience vérifie le résultat de la combinaison". Voyons donc d'abord cet être humain comme un "organisme"... L'ouvrage fut écrit au moment où paraissaient les premiers volumes de l'Encyclopédie. Inspiré de Bacon, l'idée qui domine est celui de la fin du règne des mathématiques au bénéfice de celui des sciences de la nature. Il va jusqu'à croire, à la différence de Buffon, en une possibilité de passage entre matière morte et matière vivante. Ouvrage majeur compte tenu de l'ampleur de sa réflexion...
On y retrouve quelque par le propos de la Promenade du sceptique, écrite en 1747, la pensée se développe en symbiose avec la Nature qu'elle observe mais la pensée est elle-même un élément de cette Nature, une intuition que reprendront bien des auteurs...
"C'est de la nature que je vais écrire. Je laisserai les pensées se succéder sous ma plume, dans l'ordre même selon lequel les objets se sont offerts à ma réflexion ; parce qu'elles n'en représenteront que mieux les mouvements et la marche de mon esprit. Ce seront, ou des vues générales sur l'art expérimental, ou des vues particulières sur un phénomène qui parait occuper tous nos philosophes, et les diviser en deux classes. Les uns ont, ce me semble, beaucoup d'instruments et peu d'idées ; les autres ont beaucoup d'idées et n'ont point d'instruments. L'intérêt de la vérité demanderait que ceux qui réfléchissent daignassent enfin s'associer à ceux qui se remuent, afin que le spéculatif fût dispensé de se donner du mouvement ; que le manœuvre eût un but dans les mouvements infinis qu'il se donne ; que tous nos efforts se trouvas- sent réunis et dirigés en même temps contre la résistance de la nature ; et que, dans cette espèce de ligue philosophique chacun fit le rôle qui lui convient.
C'est dans L'Interprétation de la Nature que nous trouvons le texte essentiel comme première vue du transformisme et de l'évolution. "Il me paraît impossible, écrit Diderot, que tous les êtres de la nature aient été produits avec une matière parfaitement homogène" et "Je crois même entrevoir que la diversité des phénomènes ne peut être le résultat d’une hétérogénéité quelconque... "
"J’appellerai donc éléments les différentes matières hétérogènes nécessaires pour la production générale des phénomènes de la nature; et j’appellerai la nature le résultat général actuel, ou les résultats généraux successifs de la combinaison des éléments. Les éléments doivent avoir des différences essentielles; sans quoi tout aurait pu naître de l’homogénéité, puisque tout y pourrait retourner. Il est, il a été, ou il sera une combinaison naturelle ou une combinaison artificielle dans laquelle un élément est, a été ou sera porté à sa plus grande division possible. La molécule d’un élément dans cet état de division dernière est indivisible d’une indivisibilité absolue, puisqu’une division ultérieure de cette molécule, étant hors des lois de la nature et au-delà des forces de l’art, n’est plus qu’intelligible. L’état de division dernière possible dans la nature ou par l’art n’étant pas le même, selon toute apparence, pour des matières essentiellement hétérogènes, il s’ensuit qu’il y a des molécules essentiellement différentes en masse et toutefois absolument indivisibles en elles-mêmes.
Combien y a-t-il de matières absolument hétérogènes, ou élémentaires ? nous l’ignorons. Quelles sont les différences essentielles des matières que nous regardons comme absolument hétérogènes ou élémentaires ? nous l’ignorons. Jusqu’où la division d’une matière élémentaire est-elle portée, soit dans les productions de l’art, soit dans les ouvrages de la nature ? nous l’ignorons. Etc., etc., etc. J’ai joint les combinaisons de l’art à celles de la nature, parce qu’entre une infinité de faits que nous ignorons, et que nous ne saurons jamais, il en est un qui nous est encore caché: savoir si la division d’une matière élémentaire n’a point été, n’est point ou ne sera pas portée plus loin dans quelque opération de l’art qu’elle ne l’a été, ne l’est, et ne le sera dans aucune combinaison de la nature abandonnée à elle-même.
Et l’on va voir par la première des questions suivantes pourquoi j’ai fait entrer dans quelques-unes de mes propositions les notions du passé, du présent et de l’avenir; et pourquoi j’ai inséré l’idée de succession dans la définition que j’ai donnée de la nature.
1. Si les phénomènes ne sont pas enchaînés les uns aux autres, il n’y a point de philosophie. Les phénomènes seraient tous enchaînés que l’état de chacun d’eux pourrait être sans permanence. Mais si l’état des êtres est dans une vicissitude perpétuelle; si la nature est encore à l’ouvrage; malgré la chaîne qui lie les phénomènes, il n’y a point de philosophie. Toute notre science naturelle devient aussi transitoire que les mots. Ce que nous prenons pour l’histoire de la nature n’est que l’histoire très incomplète d’un instant Je demande donc si les métaux ont toujours été et seront toujours tels qu’ils sont; si les plantes ont toujours été et seront toujours telles qu’elles sont; si les animaux ont toujours été et seront toujours tels qu’ils sont, etc. Après avoir médité profondément sur certains phénomènes, un doute qu’On vous pardonnerait peut-être, ô sceptiques, ce n’est pas que le monde ait été créé, mais qu’il soit tel qu’il a été et qu’il sera.
2. De même que dans les règnes animal et végétal, un individu commence, pour ainsi dire, s’accroît, dure, dépérit et passe; n’en serait-il pas de même des espèces entières ? Si la foi ne nous apprenait que les animaux sont sortis des mains du Créateur tels que nous les voyons; et s’il était permis d’avoir la moindre incertitude sur leur commencement et sur leur fin, le philosophe abandonné à ses conjectures ne pourrait-il pas soupçonner que l’animalité avait de toute éternité ses éléments particuliers, épars et confondus dans la masse de la matière; qu’il est arrivé à ces éléments de se réunir, parce qu’il était possible que cela se fit; que l’embryon formé de ces éléments a passé par une infinité d’organisations et de développements; qu’il a eu, par succession, du mouvement, de la sensation, des idées, de la pensée, de la réflexion, de la conscience, des sentiments, des passions, des signes, des gestes, des sons, des sons articulés, une langue, des lois, des sciences, et des arts; qu’il s’est écoulé des millions d’années entre chacun de ces développements; qu’il a peut-être encore d’autres développements à subir, et d’autres accroissements à prendre, qui nous sont inconnus; qu’il a eu ou qu’il aura un état stationnaire; qu’il s’éloigne, ou qu’il s’éloignera de cet état par un dépérissement éternel, pendant lequel ses facultés sortiront de lui comme elles y étaient entrées; qu’il disparaîtra pour jamais de la nature, ou plutôt qu’il continuera d’y exister, mais sous une forme, et avec des facultés tout autres que celles qu’on lui remarque dans cet instant de la durée ?
La religion nous épargne bien des écarts et bien des travaux. Si elle ne nous eût point éclairés sur l’origine du monde et sur le système universel des êtres, combien d’hypothèses différentes que nous aurions été tentés de prendre pour le secret de la nature ? Ces hypothèses, étant toutes également fausses, nous auraient paru toutes à peu près également vraisemblables. La question, pourquoi il existe quelque chose, est la plus embarrassante que la philosophie pût se proposer, et il n’y a que la révélation qui y réponde.
3. Si l’on jette les yeux sur les animaux et sur la terre brute qu’ils foulent aux pieds; sur les molécules organiques et sur le fluide dans lequel elles se meuvent; sur les insectes microscopiques, et sur la matière qui les produit et qui les environne, il est évident que la matière en général est divisée en matière morte et en matière vivante. Mais comment se peut-il faire que la matière ne soit pas une, ou toute vivante, ou toute morte ? La matière vivante est-elle toujours vivante ? Et la matière morte est-elle toujours et réellement morte ? La matière vivante ne meurt-elle point ? La matière morte ne commence-t-elle jamais à vivre ?
4. Y a-t-il quelque autre différence assignable entre la matière morte et la matière vivante, que l’organisation, et que la spontanéité réelle ou apparente du mouvement ?
5. Ce qu’on appelle matière vivante, ne serait-ce pas seulement une matière qui se meut par elle-même ? Et ce qu’on appelle une matière morte, ne serait- ce pas une matière mobile par une autre matière ?
6. Si la matière vivante est une matière qui se meut par elle-même comment peut-elle cesser de se mouvoir sans mourir ?
7. S’il y a une matière vivante et une matière morte par elles-mêmes, ces deux principes suffisent-ils pour la production générale de toutes les formes et de tous les phénomènes ?
8. En géométrie, une quantité réelle jointe à une quantité imaginaire donne un tout imaginaire; dans la nature, si une molécule de matière vivante s’applique à une molécule de matière morte, le tout sera-t-il vivant, ou sera- t-il mort ?
9. Si l’agrégat peut être ou vivant ou mort, quand et pourquoi sera-t-il vivant ? quand et pourquoi sera-t-il mort ?
10. Mort ou vivant, il existe sous une forme. Sous quelque forme qu’il existe, quel en est le principe ?
11. Les moules sont-ils principes des formes ? Qu’est-ce qu’un moule ? Est-ce un être réel et préexistant ? ou n’est-ce que les limites intelligibles de l’énergie d’une molécule vivante unie à de la matière morte ou vivante; limites déterminées par le rapport de l’énergie en tout sens, aux résistances en tout sens ? Si c’est un être réel et préexistant, comment s’est-il formé ?
12. L’énergie d’une molécule vivante varie-t-elle par elle-même ? ou ne varie-t-elle que selon la quantité, la qualité, les formes de la matière morte ou vivante à laquelle elle s’unit ?
13. Y a-t-il des matières vivantes spécifiquement différentes de matières vivantes ? ou toute matière vivante est-elle essentiellement une et propre à tout ? J’en demande autant des matières mortes.
14. La matière vivante se combine-t-elle avec de la matière vivante ?
Comment se fait cette combinaison ? Quel en est le résultat ? J’en demande autant de la matière morte.
15. Si l’on pouvait supposer toute la matière vivante, ou toute la matière morte, y aurait-il jamais autre chose que de la matière morte, ou que de la matière vivante ? ou les molécules vivantes ne pourraient elles pas reprendre la vie, après l’avoir perdue, pour la reperdre encore; et ainsi de suite, à l’infini ?
Quand je tourne mes regards sur les travaux des hommes, et que je vois des villes bâties de toutes parts, tous les éléments employés, des langues fixées, des peuples policés, des ports construits, les mers traversées, la terre et les cieux mesurés, le monde me paraît bien vieux. Lorsque je trouve les hommes incertains sur les premiers principes de la médecine et de l’agriculture, sur les propriétés des substances les plus communes, sur la connaissance des maladies dont ils sont affligés, sur la taille des arbres, sur la forme de la charrue, la terre ne me paraît habitée que d’hier ,et si les hommes étaient sages, ils se livreraient enfin à des recherches relatives à leur bien-être, et ne répondraient à mes questions futiles que dans mille ans au plus tôt; ou peut-être même, considérant sans cesse le peu d’étendue qu’ils occupent dans l’espace et dans la durée, ils ne daigneraient jamais y répondre...."
Et le Rêve de d'Alembert, L'Entretien avec d'Alembert, la Suite de L'Entretien, ne seront, avec des compléments de morale et quelques traits impertinents, que le développement de cet aperçu prophétique. On y retrouve le développement de l'idée avec une sorte d'enthousiasme, qui ne se peut comparer qu'à celui de Lucrèce...
«Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent toutes les espèces ; tout est un flux perpétuel. Tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins plante ; toute plante est plus ou moins animal... Il n'y a qu'un seul grand individu ; c'est le tout. Dans ce tout, comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle ; mais quand vous donnerez le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un concept faux... Qu'est- ce qu'un être ? La somme d'un certain nombre de tendances. Est-ce que je puis être autre chose qu'une tendance ? Non, je vais à un terme. Et les espèces ? ces espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur est propre. Et la vie ? La vie, une suite d'actions et de réactions... »

1757 - "Le Fils naturel ou Les Epreuves de la vertu"
Naissance de la "tragédie domestique", du drame des conditions - Diderot entend renouveler un théâtre qui, au XVIIIe siècle, entre tragédie et comédie voit naître un nouveau genre, le drame. Il s'agit d'émouvoir en puisant dans la réalité courante, une pure création des philosophes, dira-t-on, pour moraliser et attendrir la bourgeoisie et le peuple. Et l'être humain n'est-il pas loin d'être toujours soit dans la douleur soit dans la joie. Pour Diderot, par opposition à la tragédie héroïque qui met en scène rois et princes, le drame est une "tragédie domestique et bourgeoise". La peinture des caractères (comédie classique) et des passions (tragédie classique) est abandonnée au profit de celle des "conditions", de la représentation de l'homme de lettres ou du commerçant, du père de famille ou de l'époux : « Ce ne sont plus les caractères qu'il faut mettre sur la scène, mais les conditions. Jusqu'à présent, dans la comédie, le caractère a été l'objet principal, et la condition n'a été que l'accessoire ; il faut que la condition devienne aujourd'hui l'objet principal, et que le caractère ne soit que l'accessoire. C'est du caractère qu'on tirait toute l'intrigue. On cherchait en général les circonstances qui le faisaient sortir, et l'on enchaînait ces circonstances. C'est la condition, ses devoirs, ses avantages, ses embarras, qui doivent servir de base à l'ouvrage. Il me semble que cette source est plus féconde, plus étendue et plus utile que celle des caractères.... »
Se succèdent ainsi "Le Négociant de Lyon", second drame de Beaumarchais, "le Fils naturel" (joué sans succès en 1771), "le Père de famille" (Diderot, joué en 1761), "la Mère coupable" (Beaumarchais), "le Philosophe sans le savoir " (Sedaine). Le personnage ridicule n'est plus le bourgeois gentilhomme mais le noble hautain et futile...
DORVAL - Et ce mortel heureux, connaît-il son bonheur ?
ROSALIE - Si c'est un bonheur, il doit le connaître.
DORVAL - Si vous aimez, on vous aime sans doute ?
ROSALIE - Dorval, vous le savez.
DORVAL, vivement - Oui, je le sais ; et mon cœur le sent... Qu'ai-je entendu ?... Qu'ai-je dit ?... Qui me sauvera de moi-même ?...
"Le Fils Naturel" est écrit en 1757 avec une mise en scène, suivant les théories chères à Diderot, très soigneusement indiquée. Dorval, ami de Clairville, est aimé de Rosalie, qui doit épouser Clairville, et de Constance, sœur de Clairville. Le père de Rosalie va bientôt arriver pour célébrer le mariage, et Dorval, qui aime Rosalie, mais qui est honnête homme, ne voit d'autre moyen, pour sortir d'embarras et rester fidèle à ses principes et à l'amitié, que de partir au plus vite. Constance veut l'en empêcher; elle lui avoue assez délicatement son amour. L'arrivée de Clairville évite à Dorval une réponse qui serait difficile, mais le plonge dans une difficulté nouvelle ; il lui demande d'intervenir auprès de Rosalie pour démêler les causes de son refroidissement. C'est l'explication de l'acte II, scène II ; Rosalie avoue qu'elle n'aime plus Clairville, parce qu'elle en aime un autre...

"Le Père de famille", longtemps inédit, écrit en 1758, fut représenté en 1761 à la Comédie-Française, avec un succès qui charma Diderot, et dont le bruit parvint jusqu'à Voltaire. Reprise en 1769, la pièce était encore jouée en 1830. Mais c'est en Allemagne qu'elle exerça le plus d'in- fluence, grâce à Lessing. Meister note très justement qu'elle avait « surtout alors, bien plus d'analogie avec l'esprit et les mœurs germaniques qu'avec l'esprit et le caractère français. »
Elle est très supérieure au Fils Naturel, et Diderot en goûtait profondément le sujet, puisqu'il en reprend le thème dans Les Pères malheureux. La nuit s'est passée à attendre le retour de Saint- Albin. Le Père de famille se promène, les bras croisés, pendant que sa fille Cécile fait la partie de trictrac de son oncle, le Commandeur. Germeuil, fils d'un ami mort, élevé parle père de famille, regarde tendrement Cécile à la dérobée. A six heures du matin, le Commandeur, fatigué, veut s'aller coucher, mais non sans faire des reproches à son beau-frère. Les jeunes gens s'en vont également, après que le Père de famille a tâché d'obtenir de Germeuil des renseignements sur la conduite de son fils. Saint-Albin arrive enfin, vêtu en homme du peuple. Il avoue qu'il a fait la connaissance d'une jeune fille honnête et pauvre, et qu'il veut l'épouser, La scène est vraiment belle. L'acte II s'ouvre sur un tableau, comme les aime Diderot. Cécile déjeune tout en faisant son choix parmi les marchandises qu'étale Mme Papillon, aidée des conseils de sa femme de chambre, cependant que le Père de famille montre la bonté de son cœur en accordant des délais à des débiteurs ou des secours à des malheureux. Resté seul avec Cécile, le Père tâche de pénétrer le secret de son inclination pour Germeuil ; la jeune fille se défend de vouloir se marier ; elle aimerait mieux la retraite dans un couvent, ce qui déclenche une attaque de Diderot contre les cloîtres ...
Le père de famille
Vous craignez des peines, et vous ne pensez pas à celles que vous me causeriez ? Vous m'abandonneriez ? Vous quitteriez la maison de votre père pour un cloître ? La société de votre oncle, de votre frère et la mienne, pour la servitude ? Non, ma fille, cela ne sera point. Je respecte la vocation religieuse ; mais ce n'est pas la vôtre. La nature, en vous accordant les qualités sociales, ne vous destina pas à l'inutilité... Mademoiselle, ne me parlez jamais de couvent... Je n'aurai point donné la vie à un enfant ; je je ne l'aurai point élevé ; je n'aurai point travaillé sans relâche à assurer son bonheur, pour le laisser descendre tout vif dans un tombeau ; et avec lui mes espérances et celles de la société trompées... Et qui la repeuplera de citoyens vertueux, si les femmes les plus dignes d'être des mères de famille s'y refusent ?
(..) Où sont les exemples de l'intérêt pur et sincère, de la tendresse réelle, de la confiance intime, des secours continus, des satisfactions réciproques, des chagrins partagés, des soupirs entendus, des larmes confondues, si ce n'est dans le mariage ?... lien sacré des époux, si je pense à vous, mon âme s'échauffe et s'élève ! noms tendres de fils et de fille, je ne vous prononçai jamais sans tressaillir, sans être touché !... Cécile, rappelez-vous la vie de votre mère : en est-il une plus douce que celle d'une femme qui a employé sa journée à remplir les devoirs d'épouse attentive, de mère tendre, de maîtresse compatissante ?...
La réserve de Cécile l'afflige, après ce qu'il croit être l'inconduite de Saint-Albin..
Il faudra donc que je quitte la vie, sans avoir vu le bonheur d'aucun de mes enfants... Cécile... Cruels enfants, que vous ai-je fait pour me désoler ?... J'ai perdu la confiance de ma fille. Mon fils s'est précipité dans des liens que je ne puis approuver, et qu'il faut que je rompe.
On introduit Sophie, la jeune fille aimée par Saint- Albin et Mme Hébert, la femme qui l'a recueillie. Le Père de famille interroge Sophie, qui l'intéresse par ses malheurs, lui promet de la faire reconduire dans sa famille, mais lui demande de décourager Saint-Albin. Il souffre lui-même du sacrifice qu'il impose à son fils, par respect des préjugés ..
O lois du monde ! ô préjugés cruels !... Il y a déjà si peu de femmes pour un homme qui pense et qui sent ! pourquoi faut-il que le choix en soit encore si limité ? Mais mon fils ne tardera pas à venir... Secouons, s'il se peut, de mon âme, l'impression que cette enfant y a faite... Lui représenterai-je, comme il me convient, ce qu'il me doit, ce qu'il se doit à lui-même, si mon cœur est d'accord avec le sien ?...

1757, Diderot - Rousseau - En décembre 1757, c'est la brouille avec Jean-Jacques Rousseau, Diderot le poursuivra désormais de ses sarcasmes. Rousseau fut piqué par un mot du Fils Naturel, et Diderot se sentit visé par une note de la Lettre sur les Spectacles, mais surtout les intrigues autour de Mme d'Epinay, le rôle obscur de Grimm, la rivalité entre «les Philosophes» et celui qui avait cessé de l'être, l'orgueil maladif de Rousseau amenèrent une rupture définitive. Diderot le dit nettement dans l'Essai sur les Règnes : l'Encyclopédie vit en lui un ennemi, et dans ses succès un danger : «C'est qu'il s'était fait anti-philosophe ; c'est qu'entre ses fanatiques, ceux qui n'apportent aux opinions religieuses ni grande certitude, ni grande importance, haïssent encore moins les prêtres que les philosophes.»
Et Mme de Vandeul de commenter : « Je n'étais pas née, dit-elle, lorsqu'il fit connaissance avec Jean-Jacques. Ils étaient liés lorsque mon père fut enfermé à Vincennes; il donna à dîner à ma mère, et lui laissa entendre que mon père ferait sagement d'abandonner l'Encyclopédie à ceux qui voudraient s'en charger, et que cet ouvrage troublerait toujours son repos. Ma mère comprit que Rousseau désirait cette entreprise, et elle le prit en aversion. Le sujet réel de leur brouillerie est impossible à raconter : c'est un tripotage de société où le diable n'entendrait rien. Tout ce que j'ai entrevu de clair dans cette histoire, c'est que mon père a donné à Rousseau l'idée de son discours sur les arts, qu'il a revu et peut-être corrigé, qu'il lui a prêté de l'argent plusieurs fois ; que tout le temps qu'il a demeuré à Montmorency, mon père avait la constance d'y aller une ou deux fois la semaine à pied, pour dîner avec lui. Rousseau avait une maîtresse appelée Mlle Levasseur, depuis sa femme ; cette maîtresse laissait mourir sa mère de faim ; mon père lui faisait une pension de cinquante écus ; cet article était porté sur ses tablette de dépenses. Rousseau lui fit la lecture de l'Héloïse ; cette lecture dura trois jours et presque trois nuits. Cette besogne finie, mon père voulut consulter Rousseau sur un ouvrage dont il s'occupait. Allons-nous coucher, dit Jean-Jacques, il est tard, j'ai envie de dormir. Il y eut une tracasserie de société, mon père s'y trouva fourré ; il conseilla tout le monde pour le mieux, mais les gens qui tripotent ne font jamais usage des conseils que contre ceux qui les donnent. Le résultat de ce tracas fut une note de Rousseau dans la Préface de sa Lettre sur les Spectacles, tirée de l'Ecclésiaste ; mon père s'appliqua la note, et ces deux amis furent brouillés pour jamais. Ce qu'il y a de sûr, c'est que mon père a rendu à Jean-Jacques des services de tout genre ; qu'il n'en a reçu que des marques d'ingratitude, et qu'ils se sont brouillés pour des vétilles. Au demeurant, si quelqu'un peut deviner quelque chose de ce grimoire, c'est M. de Grimm ; s'il n'en sait rien, personne n'expliquera jamais cette affaire».....
1758-1759 - En 1758, Rousseau se déclara offensé par l'article que d'Alembert avait écrit sur Genève, auquel il répondit par la Lettre sur les spectacles. Le livre d'Helvétius, "L'Esprit", servit, comme précédemment la thèse de l'abbé de Prades, de prétexte à une nouvelle condamnation de la publication de l'Encyclopédie. Un arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 1759 retirait le privilège, et un autre arrêt du 21 juillet ordonnait aux libraires de rendre aux souscripteurs la somme de soixante-douze livres. Cette fois, d'Alembert cède, ne pouvant compter, écrit-il à Voltaire, le 28 janvier 1758, sur M. de Malesherbes. « Si vous connaissiez M. de Malesherbes, si vous saviez combien il a peu de nerf et de consistance, vous seriez convaincu que nous ne pourrions compter sur rien avec lui, même après les promesses les plus positives. »
Et pourtant M. de Malesherbes prêtait à l'Encyclopédie l'appui le plus positif. Mais la question de l'argent est alors cruciale et sujet à bien des attitudes que l'on peut juger singulières, ainsi de celle de D'Alembert confirmée en détails dans une lettre de Diderot à Sophie du 11 octobre 1759 qui rapporte mot à mot leurs échanges : D'Alembert voulait de l'argent, Diderot lui en offre, agrémenté de reproches assez durs. Ce ne fut pas la rupture, mais un début d'éloignement qui ne connut que de rares retours....
Diderot continua donc tout seul à diriger l'impression de l'Encyclopédie, soutenu par M. de Malesherbes, le duc de Richelieu, le lieutenant de police Sartine, Mme Geoffrin, Mme de Pompadour. La guerre de libelles continuait avec les ennemis des philosophes, qui sont aussi les ennemis de Voltaire, les Abraham Chaumeix (1730-1790), les Fréron (1754-1802), les Palissot (1730-1814). En 1760 parut "la comédie des Philosophes" du Sieur Palissot. On sait comment Voltaire, dans les "Mélanges" surtout, a traité toutes ces critiques ; "Le Neveu de Rameau" contient la vengeance de Diderot à l'égard de Palissot...
1759-1774 - Correspondance Diderot - Sophie Volland
Diderot rencontre Sophie Volland (Louise-Henriette, 1717-1784) en 1756, lui voue un amitié passionnée, - elle est amie, amante et correspondante - et lui écrit des lettres particulièrement révélatrices de ses intuitions paradoxales sur la "vie" qui l'obsèdent. Leur rencontre date de 1755, Diderot avait quarante-deux ans et Sophie dix ans de moins, elle vivait avec sa mère, veuve d'un financier, et avec sa sœur, et pendant leurs nombreuses séparations, Diderot tiendra Sophie au courant des moindres particularités de sa santé et de tous les événements de sa vie.
Ainsi de cette lettre du 15 octobre 1759, "ce que c'est que de vivre..."
"Il me passa par la tête un paradoxe que je me souviens d'avoir entamé un jour à votre sœur; et je dis au père Hoop, car c'est ainsi que nous l'avons surnommé parce qu'il a l'air ridé, sec et vieillot: "Vous êtes bien à plaindre "! mais s'il était quelque chose de ce que je pense, vous le seriez bien davantage. - Le pis est d'exister, et j'existe. - Le pis n'est pas d'exister, mais d'exister pour toujours. - Aussi je me flatte qu'il n'en sera rien. - Peut-être. Dites-moi, avez-vous jamais pensé sérieusement à ce que c'est que de vivre ? Concevez-vous bien qu'un être puisse jamais passer de l'état de non-vivant à l'état de vivant? Un corps s'accroît ou diminue, se meut ou se repose ; mais s'il ne vit pas par lui-même, croyez-vous qu'un changement, quel qu'il soit, puisse lui donner de la vie? Il n'en est pas de vivre comme de se mouvoir ; c'est autre chose. Un corps en mouvement frappe un corps en repos, et celui-ci se meut ; mais arrêtez, accélérez un corps non vivant, ajoutez-y, retranchez-en, organisez-le, c'est-à-dire disposez-en les parties comme vous l'imaginerez : si elles sont mortes, elles ne vivront non plus dans une position que dans une autre. Supposer qu'en mettant à côté d'une particule morte, une, deux ou trois particules mortes, on en formera un système de corps vivant, c'est avancer, ce me semble, une absurdité très forte, ou je ne m'y connais pas. Quoi ! la particule A placée à gauche de la particule B n'avait point la conscience de son existence, ne sentait point, était inerte et morte ; et voilà que celle qui était à gauche mise à droite, et celle qui était à droite mise à gauche, le tout vit, se connaît, se sent ! Cela ne se peut. Que fait ici la droite ou la gauche? Y a-t-il un côté et un autre dans l'espace ? Cela serait, que le sentiment et la vie n'en dépendraient pas. Ce qui a ces qualités les a toujours eues et les aura toujours. Le sentiment et la vie sont éternels. Ce qui vit a toujours vécu, et vivra sans fin. La seule différence que je connaisse entre la mort et la vie, c'est qu'à présent vous vivez en masse, et que, dissous, épars en molécules, dans vingt ans d'ici vous vivrez en détail. - Dans vingt ans, c'est bien loin !"
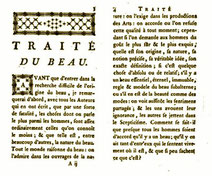
1751-1759 - "Recherches philosophiques sur l'origine et la nature du Beau"
Il semble que ce soit Grimm qui ait orienté définitivement Diderot vers la critique d'art. L'esthétique l'intéressait depuis longtemps, puisque l'article "Beau" de l'Encyclopédie, ou "Recherches philosophiques sur l'origine el la nature du Beau" date de 1751, qu'en 1755 il écrivait "l'Histoire el le secret de la peinture en cire", également destinée à l'Encyclopédie sous le titre : Encaustique, mais qui céda la place à l'article de Monnoye. Aussi, ne faut-il pas souscrire entièrement à l'ardente dédicace du Salon de 1765, dans laquelle Diderot, en même temps qu'il rend hommage à Grimm, expose les principes de sa critique. En demandant à Diderot des notes pour le Salon de 1759, puis pour celui de 1761, avec une exigence dont témoigne la lettre à Sophie Volland du 17 septembre 1761, Grimm fut pour la vocation du critique d'art une cause occasionnelle, non pas la cause efficiente. Nous avons de Diderot les Salons de 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1775, 1781. En 1759, l'institution du Salon annuel était déjà un petit événement parisien, et l'on peut dire que grâce à Diderot, il allait devenir un événement artistique européen. Dans le Tableau de Paris, Mercier écrit alors que le "Salon du Louvre est peut-être la pièce la plus régulièrement vaste qui existe dans aucun palais d'Europe. On y accourt en foule. La poésie et la musique n'obtiennent pas aussi grand nombre d'amateurs. Les flots du peuple, pendant six semaines entières, ne tarissent pas du matin au soir. Il y a des heures où l'on étouffe. On y voit des tableaux de dix-huit pieds de long qui montent dans la voûte spacieuse et des miniatures larges comme le pouce à hauteur d'appui. Le sacré, le profane, le pathétique, le grotesque, tous les sujets historiques ou fabuleux y sont traités et pèle mêle arrangés. C'est la confusion même; les spectateurs ne sont pas plus bigarrés que les objets qu'ils contemplent..."
En 1759, s'expose des oeuvres Greuze, Chardin, La Tour, Boucher, et voici Diderot formulant déjà une critique de la Nativité de Boucher, dans laquelle il met bien en relief ce qu'il y a de faux par manque de convenance chez un des maîtres les moins qualifiés qu'il fut pour traiter un sujet religieux : "J'avoue que le coloris en est faux, qu'elle a trop d'éclat, que l'enfant est de couleur rose, qu'il n'y a rien de si ridicule qu'un lit galant en baldaquin dans un sujet pareil ; mais la Vierge est si belle, si amoureuse et si touchante ! Il est impossible d'imaginer rien de plus fini ni rien de plus espiègle que ce petit saint Jean, couché sur le dos, qui tient un épi. II me prend toujours envie d'imaginer une flèche à la place de cet épi..."
Et à propos d'un tableau de Joseph-Marie Vien, dans lequel Psyché qui vient avec sa lampe surprendre et voir l'Amour endormi, Diderot écrit, "Les deux figures sont de chair, mais elles n'ont pas la grâce et la délicatesse qu'exigeait le sujet... Psyché n'est point cette femme qui vient en tremblant sur la pointe du pied.."
C'est aussi dans ce salon de 1759, que Diderot rencontre les vues du port de Bordeaux, d'Avignon. peinte par Joseph Vernet (1714-1789), le peintre de marines qui sait, comme son compatriote Hubert Robert, répondre à l'engouement du public pour les paysages les plus idéalisés : "Nous avons une foule de Marines de Vernet, les unes locales, les autres idéales, et dans toutes, c'est la même imagination, le même feu, la même sagesse, le même coloris, les mêmes détails, la même variété. Il faut que cet homme travaille avec une facilité prodigieuse. Vous connaissez son mérite. Il est tout entier dans quatorze ou quinze tableaux. Les mers se soulèvent et se tranquillisent à son gré; le ciel s'obscurcit, l'éclair s'allume, le tonnerre gronde, la tempête s'élève, les vaisseaux s'embrasent; on entend le bruit des flots, les cris de ceux qui périssent, on voit..., on voit tout ce qui lui plaît. »
En 1763, Diderot se montrera plus enthousiaste, quatre années ont passé, l'esthétique du philosophe s'est étoffée : "C'est Vernet qui sait rassembler les orages, ouvrir les cataractes du ciel et inonder la terre; c'est lui qui sait aussi, quand il lui plaît, dissiper la tempête et rendre le calme à la mer, la sérénité aux cieux. Alors toute la nature, sortant comme du chaos, s'éclaire d'une manière enchanteresse et reprend tous ses charmes. Comme ses jours sont sereins! comme ses nuits sont tranquilles! comme les eaux sont transparentes! C'est lui qui crée le silence, la fraîcheur et l'ombre dans les forêts. C'est lui qui ose sans crainte placer le soleil ou la lune dans son firmament. Il a volé à la nature son secret; tout ce qu'elle produit, il peut le répéter. Et comment ses compositions n'étonneraient-elles pas? Il embrasse un espace infini; c'est toute l'étendue du ciel sous l'horizon le plus élevé, c'est la surface d'une mer, c'est une multitude d'hommes occupés du bonheur de la société, ce sont des édifices immenses et qu'il conduit à perte de vue...."
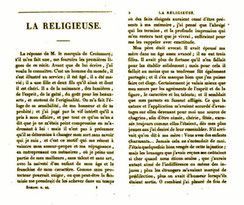
1760 - "La Religieuse"
Roman et apologie de la liberté individuelle dans un couvent de femmes au XVIIIe siècle
Suzanne, une des trois filles de la famille Simonin (ou Delamarre), est rejetée par ses parents : sans doute est-elle le fruit d'un adultère. Voyant que le promis de sa soeur aînée s'intéresse à elle, car elle est belle et spirituelle, contrairement à ses deux soeurs, elle l'avoue à sa mère qui la place dans un couvent. Une fois ses deux soeurs mariées, elle espère en sortir, mais ses parents décident de lui faire prendre le voile. Malgré ses réticences, en proie aux conseils insidieux de la mère supérieure, elle accepte de devenir novice. Vient le moment de confirmer ses voeux. Pour s'attacher un protecteur, le marquis de Croismare, elle entreprend ses mémoires.
La correspondance de Grimm nous montre que l'origine de ce roman fut une intrigue de société. Pour faire revenir dans la compagnie de Mme d'Epinay et de d'Holbach le marquis de Croismare qui s'était retiré dans ses terres, on imagina de l'intéresser en faveur d'une jeune fîlle, Suzanne Simonin, qui avait dû prononcer des vœux malgré elle. Le roman est la confession supposée de la religieuse et Grimm, qui croira le manuscrit perdu ou inachevé, et Diderot sut apporter dans cette supercherie littéraire tout cet art du naturel qu'il savait transcrire en écriture...
"...Je ne vous ferai pas le détail de mon noviciat ; si l'on observait toute son austérité, on n'y résisterait pas ; mais c'est le temps le plus doux de la vie monastique. Une mère des novices est la soeur la plus indulgente qu'on a pu trouver. Son étude est de vous dérober toutes les épines de l'état ; c'est un cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée. C'est elle qui épaissit les ténèbres qui vous environnent, qui vous berce, qui vous endort, qui vous en impose, qui vous fascine ; la nôtre s'attacha à moi particulièrement. Je ne pense pas qu'il y ait aucune âme, jeune et sans expérience, à l'épreuve de cet art funeste, Le monde a ses précipices ; mais je n'imagine pas qu'on y arrive par une pente aussi facile. Si j'avais éternué deux fois de suite, j'étais dispensée de l'office, du travail, de la prière ; je me couchais de meilleure heure, je me levais plus tard ; la règle cessait pour moi. Imaginez, monsieur, qu'il y avait des jours où je soupirais après l'instant de me sacrifier. Il ne se passe pas une histoire fâcheuse dans le monde qu'on ne vous en parle ; on arrange les vraies, on en fait de fausses, et puis ce sont des louanges sans fin et des actions de grâces à Dieu qui nous met à couvert de ces humiliantes aventures. Cependant il approchait, ce temps, que j'avais quelquefois hâté par mes désirs.
Alors je devins rêveuse, je sentis mes répugnances se réveiller et s'accroître. Je les allais confier à la supérieure, ou à notre mère des novices. Ces femmes se vengent bien de l'ennui que vous leur portez : car il ne faut pas croire qu'elles s'amusent du rôle hypocrite qu'elles jouent, et des sottises qu'elles sont forcées de vous répéter ; cela devient à la fin si usé et si maussade pour elles ; mais elles s'y déterminent, et cela pour un millier d'écus qu'il en revient à leur maison. Voilà l'objet important pour lequel elles mentent toute leur vie, et préparent à de jeunes innocentes un désespoir de quarante, de cinquante années, et peut-être un malheur éternel ; car il est sûr, monsieur, que, sur cent religieuses qui meurent avant cinquante ans, il y en a cent tout juste de damnées, sans compter celles qui deviennent folles, stupides ou furieuses en attendant.
Il arriva un jour qu'il s'en échappa une de ces dernières de la cellule où on la tenait renfermée. Je la vis. Voilà l'époque de mon bonheur ou de mon malheur, selon, monsieur, la manière dont vous en userez avec moi. Je n'ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans vêtement ; elle traînait des chaînes de fer ; ses yeux étaient égarés ; elle s'arrachait les cheveux ; elle se frappait la poitrine avec les poings, elle courait, elle hurlait ; elle se chargeait elle-même, et les autres, des plus terribles imprécations ; elle cherchait une fenêtre pour se précipiter. La frayeur me saisit, je tremblai de tous mes membres, je vis mon sort dans celui de cette infortunée, et sur-le-champ il fut décidé, dans mon coeur, que je mourrais mille fois plutôt que de m'y exposer. On pressentit l'effet que cet événement pourrait faire sur mon esprit ; on crut devoir le prévenir. On me dit de cette religieuse je ne sais combien de mensonges ridicules qui se contredisaient : qu'elle avait déjà l'esprit dérangé quand on l'avait reçue ; qu'elle avait eu un grand effroi dans un temps critique ; qu'elle était devenue sujette à des visions ; qu'elle se croyait en commerce avec les anges ; qu'elle avait fait des lectures pernicieuses qui lui avaient gâté l'esprit ; qu'elle avait entendu des novateurs d'une morale outrée, qui l'avaient si fort épouvantée des jugements de Dieu, que sa tête ébranlée en avait été renversée ; qu'elle ne voyait plus que des démons, l'enfer et des gouffres de feu ; qu'elles étaient bien malheureuses ; qu'il était inouï qu'il y eût jamais eu un pareil sujet dans la maison ; que sais-je quoi encore ? Cela ne prit point auprès de moi. A tout moment ma religieuse folle me revenait à l'esprit, et je me renouvelais le serment de ne faire aucun voeu.
Le voici pourtant arrivé ce moment où il s'agissait de montrer si je savais me tenir parole. Un matin, après l'office, je vis entrer la supérieure chez moi. Elle tenait une lettre. Son visage était celui de la tristesse et de l'abattement ; les bras lui tombaient ; il semblait que sa main n'eût pas la force de soulever cette lettre ; elle me regardait ; des larmes semblaient rouler dans ses yeux ; elle se taisait et moi aussi ; elle attendait que je parlasse la première ; j'en fus tentée, mais je me retins. Elle me demanda comment je me portais ; que l'office avait été bien long aujourd'hui ; que j'avais un peu toussé ; que je lui paraissais indisposée. A tout cela je répondis : «Non, ma chère mère. » Elle tenait toujours sa lettre d'une main pendante ; au milieu de ces questions, elle la posa sur ses genoux, et sa main la cachait en partie ; enfin, après avoir tourné autour de quelques questions sur mon père, sur ma mère, voyant que je ne lui demandais point ce que c'était que ce papier, elle me dit : « Voilà une lettre... »
A ce mot je sentis mon coeur se troubler, et j'ajoutai d'une voix entrecoupée et avec des lèvres tremblantes : « Elle est de ma mère ?
- Vous l'avez dit ; tenez, lisez... »
Je me remis un peu, je pris la lettre, je la lus d'abord avec assez de fermeté ; mais à mesure que j'avançais, la frayeur, l'indignation, la colère, le dépit, différentes passions se succédant en moi, j'avais différentes voix, je prenais différents visages et je faisais différents mouvements. Quelquefois je tenais à peine ce papier, ou je le tenais comme si j'eusse voulu le déchirer, ou je le serrais violemment comme si j'avais été tentée de le froisser et de le jeter loin de moi.
« Eh bien ! mon enfant, que répondrons-nous à cela ?
- Madame, vous le savez.
- Mais non, je ne le sais pas. Les temps sont malheureux, votre famille a souffert des pertes ; les affaires de vos soeurs sont dérangées ; elles ont l'une et l'autre beaucoup d'enfants, on s'est épuisé pour elles en les mariant ; on se ruine pour les soutenir. Il est impossible qu'on vous fasse un certain sort ; vous avez pris l'habit ; on s'est constitué en dépenses ; par cette démarche vous avez donné des espérances ; le bruit de votre profession prochaine s'est répandu dans le monde. Au reste, comptez toujours sur tous mes secours. Je n'ai jamais attiré personne en religion, c'est un état où Dieu nous appelle, et il est très dangereux de mêler sa voix à la sienne. Je n'entreprendrai point de parler à votre coeur, si la grâce ne lui dit rien ; jusqu'à présent je n'ai point à me reprocher le malheur d'une autre : voudrais-je commencer par vous, mon enfant, qui m'êtes si chère ? Je n'ai point oublié que c'est à ma persuasion que vous avez fait les premières démarches ; et je ne souffrirai point qu'on en abuse pour vous engager au-delà de votre volonté. Voyons donc ensemble, concertons-nous. Voulez-vous faire profession ?
- Non, madame.
- Vous ne vous sentez aucun goût pour l'état religieux ?
- Non, madame.
- Vous n'obéirez point à vos parents ?
- Non, madame.
- Que voulez-vous donc devenir ?
- Tout, excepté religieuse. Je ne le veux pas être, je ne le serai pas.
- Eh bien ! vous ne le serez pas. Voyons, arrangeons une réponse à votre mère... »

Les Salons de 1761-1767
C'est Diderot qui rédige l'article BEAU de l'Encyclopédie et en 1759 il abordera la critique d'art avec ses Salons (1759-1781) destinés à la Correspondance littéraire de Grimm...
Le public du peintre a évolué - Aristocrates amateurs d'art et bourgeois enrichis, conscients de toute la puissance de leur influence, imposent aux peintres leurs goûts non seulement dans le choix des sujets, mais également dans la thématique retenue : c'est ce qui explique la profusion des scènes dites "de genre" et des tableaux de chevalets dont la raison d'être est purement décorative, et dont les dimensions sont exigées par la taille réduite des nouveaux appartements. C'est une peinture d'agrément qui orne galeries, salons et boudoirs, y apportant un élément nouveau de bonheur de vivre. Par la plume Diderot, le bien-pensant et l'homme de goût diront de ces tableaux sans envergure et quelquefois coquins : «Toujours petits tableaux, petites idées, compositions frivoles, propres au boudoir d'une petite maîtresse, à la petite maison d'un petit-maître, faites pour de petits abbés, de petits robins, de gros financiers ou autres personnages sans mœurs et d'un petit goût" (Salon de 1767).
En revanche, si le public du peintre oriente indiscrètement son art selon son bon plaisir, du moins sait-il déceler et apprécier sa personnalité propre et l'originalité de sa facture. Le XVIIIe siècle, qui redécouvre l'individu en l'Homme, sera le premier à découvrir dans un tableau le talent de l'artiste et à établir ainsi des rapports entre l'oeuvre et le génie. On peut y voir l'origine de la prodigieuse destinée de la critique d'art. Diderot sera le véritable créateur du genre et cet extrait du Salon de 1761 relatif à des tableaux de Boucher, illustre justement la nouvelle attitude de l'amateur d'art qui, dans ses éloges comme dans ses critiques, aboutit en dernière analyse à ce qui, pour lui, est devenu l'essentiel : l'artiste.
"Personne n'entend comme Boucher l'art de la lumière et des ombres. Il est fait pour tourner la tête à deux sortes de personnes, les gens du monde et les artistes. Son élégance, sa mignardise, sa galanterie romanesque, sa coquetterie, son goût, sa facilité, sa variété, son éclat, ses carnations fardées, sa débauche, doivent captiver les petits-maîtres, les petites femmes, les jeunes gens, les gens du monde, la foule de ceux qui sont étrangers au vrai goût, à la vérité, aux idées justes, à la sévérité de l'art. Comment résisteraient-ils au saillant, aux pompons, aux nudités, au libertinage, à l'épigramme de Boucher? Les artistes qui voient jusqu'à quel point cet homme a surmonté les difficultés de la peinture, et pour qui c'est tout que ce mérite qui n 'est guère bien connu que d'eux, fléchissent le genou devant lui; c'est leur dieu. Les gens d'un grand goût, d'un goût sévère et antique, n'en font nul cas. Au reste, ce peintre est à peu près en peinture ce que l'Arioste est en poésie. Celui qui est enchanté de I'un est inconséquent s'il n'est pas fou de l'autre. Ils ont, ce me semble, la. même imagination, le même goût, le même style, le même coloris. Boucher a un faire qui lui appartient tellement que dans quelque morceau de peinture qu'on lui donnât une figure à exécuter, on la reconnaîtrait sur-le-champ."

En 1763, voici ce qu'écrit Diderot de Chardin, un Chardin (1699-1779) qu'il appréciait par dessus tout ..
"Il y a au Salon plusieurs petits tableaux de Chardin ; ils représentent presque tous des fruits avec les accessoires d'un repas. C'est la nature même ; les objets sont hors de la toile et d'une vérité à tromper les yeux.
Celui qu'on voit en montant l'escalier mérite surtout l'attention. L'artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine, deux biscuits, un bocal rempli d'olives, une corbeille de fruits, deux verres à moitié pleins de vin, une bigarade avec un pâté.
Pour regarder les tableaux des autres, il semble que j'aie besoin de me faire des yeux ; pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à garder ceux que la nature m'a donnés et m'en bien servir.
Si je destinais mon enfant à la peinture, voilà le tableau que j'achèterais. «Copie-moi cela, lui dirais-je. Copie-moi cela encore. » Mais peut-être la nature n'est-elle pas plus difficile à copier.
C'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c'est que ces olives sont réellement séparées de l'œil par l'eau dans laquelle elles nagent ; c'est qu'il n'y a qu'à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade, l'ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau.
C'est celui-ci qui entend l'harmonie des couleurs et des reflets. Chardin, ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette ; c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile.
Après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau, je l'occuperais sur la Raie dépouillée, du même maître (Louvre). L'objet est dégoûtant, mais c'est la chair même du poisson, c'est sa peau, c'est son sang ; l'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement. Monsieur Pierre, regardez bien ce morceau, quand vous irez à l'Académie, et apprenez, si vous le pouvez, le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures."
Dans le Salon de 1765, Diderot insistera à nouveau sur la complétude de l'art de Chardin..
"S'il est vrai, comme le disent les philosophes, qu'il n'y a de réel que nos sensations ; que ni le vide de l'espace, ni la solidité même des corps n'est peut-être rien en elle-même de ce que nous éprouvons ; qu'ils m'apprennent, ces philosophes, quelle différence il y a pour eux, à quatre pieds de tes tableaux, entre le Créateur et toi.
Chardin est si vrai, si vrai, si harmonieux, que quoiqu'on ne voie sur sa toile que la nature inanimée, des vases, des bouteilles, du pain, du vin, de l'eau, des raisins, des fruits, des pâtés, il se soutient et peut-être vous enlève à deux des plus beaux Vernet, à côté desquels il n'a pas balancé de se mettre. C'est, mon ami, comme dans l'univers, où la présence d'un homme, d'un cheval, d'un animal, ne détruit point l'effet d'un bout de roche, d'un arbre, d'un ruisseau. Le ruisseau, l'arbre, le bout de roche intéressent moins sans doute que l'homme, la femme, le cheval, l'animal ; mais ils sont également vrais..."
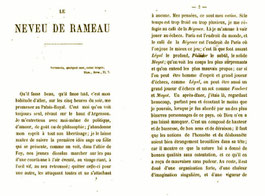
1762 - "Le Neveu de Rameau"
Dialogue avec lui-même , souvent considéré comme le chef d'oeuvre de Diderot - Diderot prend sa plume en 1762 pour composer les premières lignes de son roman, "le Neveu de Rameau". Sous forme de dialogues (un style que Diderot affectionne particulièrement), le roman réplique à la pièce de Palissot, intitulée "la Comédie des philosophes" et dans laquelle Diderot y est tout bonnement ridiculisé. Dans son oeuvre, Diderot participe également à la querelle des Bouffons, donnant la parole au neveu du compositeur français, Jean-François Rameau. Il s’agit en fait d’un dialogue philosophique entre ce dernier et le philosophe, au cours duquel sont traités les thèmes de la vie, de la morale, du comportement de l’homme au sein de la société... C'est aussi un dialogue-miroir, Rameau est un autre Diderot aux traits exacerbés, un raté cynique et génial, dépourvu de tout sens moral, un Diderot comme fasciné par le personnage qu'il aurait peut-être pu ou voulu devenir...". Rameau, c'est «un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison ; il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonnes qualités sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaises sans pudeur.» Quand Diderot le rencontre, il vient de perdre sa situation chez le financier Bertin et son amie, Mlle Huss...
Le "Neveu de Rameau" ne sera pourtant pas publié du temps de Diderot. Goethe en fera la traduction en 1805 tandis qu’il ne paraîtra en France qu’en 1890. Le début du roman est parmi les plus connus...
" Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les cinq heures du soir me promener au Palais-Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie; j'abandonne mon esprit à tout son libertinage; je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, comme on voit, dans l'allée de Foi, nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées ce sont mes catins.
Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde, et le café de la Régence est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu; c'est chez Rey que font assaut le Légal profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos ; car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs comme Légal, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un sot comme Foubert et Mayot.
Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de ce pays où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison.
Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonnes qualités sans ostentation, et ce qu'il en a reçu de mauvaises sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière, et d'une vigueur de poumons peu commune. Si vous le rencontrez Jamais et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous enfuirez. Dieux, quels terribles poumons ! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois il est maigre et hâve comme un malade au dernier de ré de la consomption ; on compterait ses dents à travers ses joues, on dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu'il sort de la Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier, ou qu'il eût été renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd'hui en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de l'appeler pour lui donner l'aumône. Demain poudré, chaussé, frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre, et vous le prendriez à peu près pour un honnête homme . Il vit au jour la journée ; triste ou gai, selon les circonstances. Son premier soin le matin, quand il est levé, est de savoir où il dînera; après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude : ou il regagne, à pied, un petit grenier qu'il habite, à moins que l'hôtesse ennuyée d'attendre son loyer, ne lui en ait redemandé la clef ; ou il se rabat dans une taverne du faubourg où il attend le jour entre un morceau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas six sous dans sa poche, ce qui lui arrive quelquefois, il a recours soit à un fiacre de ses amis, soit au cocher d'un grand seigneur qui lui donne un lit sur de la paille, à côté de ses chevaux. Le matin il a encore une partie de son matelas dans ses cheveux.
Si la saison est douce, il arpente toute la nuit le Cours ou les Champs-Élysées. Il réparaît avec le jour à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois pour le reste de la semaine. Je n'estime pas ces originaux-là ; d'autres en font leurs connaissances familières, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres, et qu'ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage, ont introduite. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente et qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite ; il fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien ; il démasque les coquins ; c'est alors que l'homme de bon sens écoute et démêle son monde."
Tableau d'une hallucination, d'une hallucination consciente, le génie qui est en Rameau interpelle son bohême de neveu et lui fait le tableau de ce qu'il pourrait être s'il était ce grand homme...
"Le quelque chose qui est là et qui me parle, me dit : Rameau, tu voudrais bien avoir fait ces deux morceaux-là ; si tu avais fait ces deux morceaux-là, tu en ferais bien deux autres ; et quand tu en aurais fait un certain nombre, on te jouerait, on te chanterait partout ; quand tu marcherais, tu aurais la tête droite ; la conscience te rendrait témoignage à toi-même de ton propre mérite ; les autres, te désigneraient du doigt. On dirait, c’est lui qui a fait les jolies gavottes et il chantait les gavottes ; puis avec l’air d’un homme touché, qui nage dans la joie, et qui en a les yeux humides, il ajoutait, en se frottant les mains ; tu aurais une bonne maison, et il en mesurait l’étendue avec ses bras, un bon lit, et il s’y étendait nonchalamment, de bons vins, qu’il goûtait en faisant claquer sa langue contre son palais, un bon équipage et il levait le pied pour y monter, de jolies femmes à qui il prenait déjà la gorge et qu’il regardait voluptueusement, cent faquins me viendraient encenser tous les jours ; et il croyait les voir autour de lui ; il voyait Palissot, Poincinet, les Frérons père et fils, La Porte ; il les entendait, il se rengorgeait, les approuvait, leur souriait, les dédaignait, les méprisait, les chassait, les rappelait ; puis il continuait : et c’est ainsi que l’on te dirait le matin que tu es un grand homme ; tu lirais dans l’histoire des Trois Siècles que tu es un grand homme ; tu serais convaincu le soir que tu es un grand homme ; et le grand homme, Rameau le neveu s’endormirait au doux murmure de l’éloge qui retentirait dans son oreille ; même en dormant, il aurait l’air satisfait ; sa poitrine se dilaterait, s’élèverait, s’abaisserait avec aisance ; il ronflerait, comme un grand homme ; et en parlant ainsi ; il se laissait aller mollement sur une banquette ; il fermait les yeux, et il imitait le sommeil heureux qu’il imaginait. Après avoir goûté quelques instants la douceur de ce repos, il se réveillait, étendait ses bras, bâillait, se frottait les yeux, et cherchait encore autour de lui ses adulateurs insipides..."

En 1765, la critique esthétique de Diderot se fait plus acerbe tout en devenant plus pénétrante : "Que voulez-vous que cet artiste jette sur la toile? Ce qu'il a dans l'imagination ; et que peut avoir dans l'imagination un homme qui passe sa vie avec les prostituées du plus bas étage ? La grâce de ses bergères est la grâce de la Favart dans Rose et Colas ; celle de ses déesses est empruntée à la Deschamps. Je vous défie de trouver dans toute la campagne un brin d'herbe de ses paysages. Et puis une confusion d'objets entassés les uns sur les autres, si déplacés, si disparates...
J'ose dire que cet homme ne sait vraiment ce que c'est que la grâce ; j'ose dire qu'il n'a jamais connu la vérité ; j'ose dire que les idées de délicatesse, d'honnêteté, d'innocence, de simplicité, lui sont devenues presque étrangères ; j'ose dire qu'il n'a pas vu un instant la nature, du moins celle qui est faite pour intéresser mon âme, la vôtre, celle d'un enfant bien né, , celle d'une femme qui sent ; j'ose dire qu'il est sans goût. Entre une infinité de preuves que j'en donnerais, une seule suffira : c'est que dans la multitude de figures d'hommes et de femmes qu'il a peintes, je défie qu'on en trouve quatre de caractère propre au bas-relief, encore moins à la statue. Il y a trop de mines, de petites mines, de manière, d'afféterie pour un art sévère. Il a beau me les montrer nues, je leur vois toujours le rouge, les mouches, les pompons et toutes les fanfîoles de la toilette..."
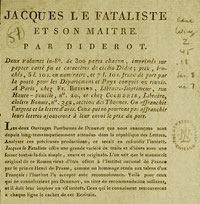
1765 - "Jacques le fataliste"
"Jacques le Fataliste" tient du conte philosophique mais sa forme est celle d'une conversation libre entre Jacques et son maître sur les amours du premier. C'est le récit le plus long et le plus complexe de Diderot. Le dialogue, meilleur moyen de traduire les pensées du philosophe, dévie sans cesse pour traiter d’autres sujets, tels que l’art, la liberté, le destin et dans lesquels le lecteur est souvent pris à partie, il s'agit d'exciter notre esprit plus que notre coeur, jusqu'au burlesque de certaines situations. Jacques, le valet au franc-parler, et son maître sont des personnages errants, on ne sait d'où ils viennent et où ils vont, mais ils sont toujours prêts à raisonner sur tout et à philosopher de tout. Remanier dans les années 1770, l’œuvre sera publiée en feuilleton dans "les Correspondances" de Grimm à partir de 1778. Il ne paraîtra en volume qu’en 1796...
"Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. Comment s’appelaient-ils ? Que vous importe ? D’où venaient-ils ? Du lieu le plus prochain. Où allaient-ils ? Est-ce que l’on sait où l’on va ? Que disaient-ils ? Le maître ne disait rien ; et Jacques disait que son capitaine disait que tout ce qui nous arrive de bien et de mal ici-bas était écrit là-haut.
LE MAÎTRE - C’est un grand mot que cela.
JACQUES - Mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d’un fusil avait son billet.
LE MAÎTRE - Et il avait raison… »
Après une courte pause, Jacques s’écria : « Que le diable emporte le cabaretier et son cabaret !
LE MAÎTRE - Pourquoi donner au diable son prochain ? Cela n’est pas chrétien.
JACQUES - C’est que, tandis que je m’enivre de son mauvais vin, j’oublie de mener nos chevaux à l’abreuvoir. Mon père s’en aperçoit ; il se fâche. Je hoche de la tête ; il prend un bâton et m’en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy ; de dépit je m’enrôle. Nous arrivons ; la bataille se donne.
LE MAÎTRE - Et tu reçois la balle à ton adresse.
JACQUES - Vous l’avez deviné ; un coup de feu au genou ; et Dieu sait les bonnes et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles se tiennent ni plus ni moins que les chaînons d’une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois que je n’aurais été amoureux de ma vie, ni boiteux.
LE MAÎTRE - Tu as donc été amoureux ?
JACQUES - Si je l’ai été !
LE MAÎTRE - Et cela par un coup de feu ?
JACQUES - Par un coup de feu.
LE MAÎTRE - Tu ne m’en as jamais dit un mot.
JACQUES - Je le crois bien.
LE MAÎTRE - Et pourquoi cela ?
JACQUES - C’est que cela ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard.
LE MAÎTRE - Et le moment d’apprendre ces amours est-il venu ?
JACQUES - Qui le sait ?
LE MAÎTRE - À tout hasard, commence toujours… »
Jacques commença l’histoire de ses amours. C’était l’après-dîner : il faisait un temps lourd ; son maître s’endormit. La nuit les surprit au milieu des champs ; les voilà fourvoyés. Voilà le maître dans une colère terrible et tombant à grands coups de fouet sur son valet, et le pauvre diable disant à chaque coup : « Celui-là était apparemment encore écrit là-haut… »
Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me plairait. Qu’est-ce qui m’empêcherait de marier le maître et de le faire cocu ? d’embarquer Jacques pour les îles ? d’y conduire son maître ? de les ramener tous les deux en France sur le même vaisseau ? Qu’il est facile de faire des contes ! Mais ils en seront quittes l’un et l’autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce délai.
L’aube du jour parut...."
Dès l'introduction, Diderot nous explique qu'au fond la vie n'est qu'un enchaînement de forces que l'être humain n'a que l'illusion de contrôler. Peut-on dans ce contexte parler et distinguer monde physique et monde moral? Le bien de l'espèce humaine est au fondement de toute morale possible, nous explique Diderot, une espèce humaine qui n'est qu'un accident dans l'immense devenir de l'univers matériel, et donc sous l'emprise d'un déterminisme matérialiste total : le Maître se sent libre et assume une liberté d'indifférence, et Jacques le fataliste tente de se conduire comme s'il se croyait libre, mais peut-on mettre en pratique, dans la vie quotidienne, une philosophie déterministe ne laissant aucune place à la liberté morale? Que devient le destin individuel? Diderot élude toute réponse...
"Jacques ne connaissait ni le nom de vice, ni le nom de vertu ; il prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait prononcer les mots récompenses ou châtiments, il haussait les épaules. Selon lui la récompense était l'encouragement des bons; le châtiment, l'effroi des méchants. Qu'est-ce autre chose, disait-il, s'il n'y a point de liberté, et que notre destinée soit écrite là-haut?
Il croyait qu'un homme s'acheminait aussi nécessairement à la gloire ou à l'ignominie, qu'une boule qui aurait la conscience d'elle-même suit la pente d'une montagne ; et que, si l'enchaînement des causes et des effets qui forment la vie d'un homme depuis le premier instant de sa naissance jusqu'à son dernier soupir nous était connu, nous resterions convaincus qu'il n'a fait que ce qu'il était nécessaire de faire. Je l'ai plusieurs fois contredit, mais sans avantage et sans fruit. En effet, que répliquer à celui qui vous dit : Quelle que soit la somme des éléments dont je suis composé, je suis un; or, une cause n'a qu'un effet ; j'ai toujours été une cause une ; je n'ai donc jamais eu qu'un effet à produire ; ma durée n'est donc qu'une suite d'effets nécessaires. C'est ainsi que Jacques raisonnait d'après son capitaine. La distinction d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son capitaine lui avait fourré dans la tête toutes ces opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par cœur. D'après ce système, on pourrait imaginer que Jacques ne se réjouissait, ne s'affligeait de rien ; cela n'était pourtant pas vrai. Il se conduisait à peu près comme vous et moi. Il remerciait son bienfaiteur, pour qu'il lui fît encore du bien. Il se mettait en colère contre l'homme injuste; et quand on lui objectait qu'il ressemblait alors au chien qui mord la pierre qui l'a frappé : "Nenni, disait-il, la pierre mordue par le chien ne se corrige pas ; l'homme injuste est corrigé par le bâton". Souvent il était inconséquent comme vous et moi, et sujet à oublier ses principes, excepté dans quelques circonstances où sa philosophie le dominait évidemment; c'était alors qu'il disait : "Il fallait que cela fût, car cela était écrit là-haut." Il tâchait à prévenir le mal; il était prudent avec le plus grand mépris pour la prudence. Lorsque l'accident était arrivé, il en revenait à son refrain ; et il était consolé. Du reste, bonhomme, franc, honnête, brave, attaché, fidèle, très têtu, encore plus bavard..."
Le problème de la liberté et du libre-arbitre est par suite traité par le dialogue, mais nous restons encore et toujours englués dans les mêmes contradictions...
"LE MAITRE : A quoi penses-tu?
JACQUES : Je pense que, tandis que vous me parliez et que je vous répondais, vous me parliez sans le vouloir, et que je vous répondais sans le vouloir.
LE MAITRE : Après?
JACQUES : Après? Et que nous étions deux vraies machines vivantes et pensantes.
LÉ MAITRE : Mais à présent que veux-tu ?
JACQUES : Ma foi, c'est encore tout de même. Il n'y a dans les deux machines qu'un ressort de plus en jeu.
LE MAITRE : Et ce ,ressort-là ?...
JACQUES : Je veux que le diable m'emporte si je conçois qu'il puisse jouer sans cause. Mon capitaine disait : "Posez une cause, un effet s'ensuit ; d'une cause faible, un faible effet ; d'une cause momentanée, un effet d'un moment ; d'une cause intermittente, un effet intermittent ; d'une cause contrariée, un effet ralenti ; d'une cause cessante, un effet nul."
LE MAITRE : Mais il me semble que je sens au dedans de moi-même que je suis libre, comme je sens que je pense.
JACQUES : Mon capitaine disait : "Oui, à présent que vous ne voulez rien ; mais veuillez vous précipiter de votre cheval?"
LE MAITRE : Eh bien ! je me précipiterai.
JACQUES : Gaiement, sans répugnance, sans effort, comme lorsqu'il vous plaît d'en descendre à la porte d'une auberge?
LE MAITRE : Pas tout à fait ; mais qu'importe, pourvu que je me précipite, et que je prouve que je suis libre?
JACQUES : Mon capitaine disait : "Quoi ! vous ne voyez pas que sans ma contradiction il ne vous serait jamais venu en fantaisie de vous rompre le cou? C'est donc moi qui vous prends par le pied, et qui vous jette hors de selle. Si votre chute prouve quelque chose, ce n'est donc pas que vous soyez libre, mais que vous êtes fou." Mon capitaine disait encore que la jouissance d'une liberté qui pourrait s'exercer sans motif serait le vrai caractère d'un maniaque.
LE MAITRE : Cela est trop fort pour moi ; mais en dépit de ton capitaine et de toi, je croirai que je veux quand je veux.
JACQUES : Mais si vous êtes et si vous avez toujours été le maître de vouloir, que ne voulez-vous à présent aimer une guenon; et que n'avez-vous cessé d'aimer Agathe toutes les fois que vous l'avez voulu? Mon maître, on passe les trois quarts de sa vie à vouloir, sans faire.
LE MAITRE : Il est vrai.
JACQUES : Et à faire sans vouloir.
LE MAITRE : Tu me démontreras celui-ci ?..."
Dans la suite un peu chaotique de ce roman s'insèrent d'autres récits, l'histoire des amours de Mme de La Pommeraye et du marquis des Arcis, racontée par une hôtesse bavarde; l'aventure romanesque d'un moine défroqué, devenu le secrétaire du marquis, prétexte à une diatribe contre les couvents d'hommes; la vie et les aventures de M. Desglands, récit partagé par Jacques et son maître puis interrompu par le récit d'un amour de jeunesse de ce dernier alors que Jacques est pris d'un violent mal de gorge...
"Vengeance de femme"...
Jacques le Fataliste fut traduit en allemand en 1792 avant de paraître en France en 1796, mais il abritait un récit secondaire qui devint très rapidement autonome et fut traduit dès 1785 par Schiller ("Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache") tant l'intrigue parut audacieuse et la psychologie féminine si finement décrite.
La "Vengeance de femme" met en scène la marquise de La Pommeraye, une veuve qui avait "des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur", mais qui avait été si malheureuse avec un premier mari," qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage", et le marquis des Arcis, un homme de plaisir, croyant peu à la vertu des femmes, mais qui sut la séduire par "sa poursuite constante, secondée de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, de sa figure, des apparences de la passion la plus vraie, de la solitude, du penchant à la tendresse". Diderot parvient avec une élégance naturelle singulière à traduire la psychologie d'une femme, abusée une fois de plus, une fois de trop, par un séducteur invétéré: elle réagit alors en deux temps, joue de la naïveté du marquis pour le précipiter dans l'aveu, aveu de son indifférence, de sa volonté de rupture, de son désir de liberté, puis met en place les éléments d'une dramatique et cruelle vengeance perdant sa réputation et destinée "à effrayer tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme"...
Mme de la Pommeraye cède donc aux avances du marquis des Arcis, malgré ses résolutions antérieures, ils passèrent ainsi quelques années dans la plus étroite intimité. Mais notre marquis peu à peu s'ennuie et reprend la vie de société, peu à peu se détache d'elle et ne s'efforce plus même de cacher son indifférence. Mme de la Pommeraye va donc tenter de s'assurer de ses véritables sentiments par une fausse confidence. Le piège s'ouvre...
«Un jour, après dîner, elle dit au marquis : Mon ami, vous rêvez.
— Vous rêvez aussi, marquise.
— Il est vrai, et même assez tristement.
— Qu'avez- vous ?'
— Rien.
— Cela n'est pas vrai. Allons, marquise, dit-il en baillant, racontez-moi cela ; cela vous désennuiera et moi.
— Est-ce que vous vous ennuyez ?
— Non ; c'est qu'il y a des jours....
— Où l'on s'ennuie.
— Vous vous trompez, mon amie, je vous jure que vous vous trompez : c'est qu'en effet il y a des jours... On ne sait à quoi cela tient.
— Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence ; mais je crains de vous affliger.
— Vous pourriez m'affliger, vous ?
— Peut-être ; mais le ciel m'est témoin de mon innocence. Cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu, par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque moi-même je n'y ai point échappé.
— Ah ! c'est de vous... Et avoir peur !... De quoi s'agit- il ?
— Marquis, il s'agit... Je suis désolée ; je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
— Non, mon amie, parlez ; auriez-vous au fond de votre cœur un secret pour moi. La première de nos conventions ne fût-elle pas que nos âmes s'ouvriraient l'une à l'autre sans réserve ?
— Il est vrai, et voilà ce qui me pèse ; c'est un reproche qui met le comble à un beaucoup plus important que je me fais. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté ? J'ai perdu l'appétit ; je ne bois et je ne mange que par raison ; je ne saurais dormir. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m'interroge et je me dis : Est-ce qu'il est moins aimable ? Non. Auriez- vous a lui reprocher quelques liaisons suspectes ? Non. Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée ? Non. Pourquoi, votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé ? Car il l'est, vous ne pouvez vous le cacher ; vous ne l'attendez plus avec la même impatience, vous n'avez plus le même plaisir à le voir ; cette inquiétude quand il tardait à revenir. Cette douce émotion au bruit de sa voiture, quand on l'annonçait, quand il paraissait, vous ne l'éprouvez plus.
— Comment, madame ? »
Alors la marquise de la Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment, après lequel elle ajouta : « Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous allez me dire. Marquis ! épargnez-moi... Non, ne m'épargnez pas, dites-les-moi ; je les écouterai avec résignation, parce que je les mérite. Oui, mon cher marquis, il est vrai... Oui, je suis... Mais n'est-ce pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée, sans y ajouter encore la honte, le mépris d'être fausse, en vous le dissimulant ? Vous êtes le même, mais votre amie est changée; votre amie vous révère, vous estime autant et plus et plus que jamais ; mais... mais une femme accoutumée comme elle à examiner de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme et à ne s'en imposer sur rien, ne peut se cacher que l'amour en est sorti. La découverte est affreuse, mais elle n'en est pas moins réelle. La marquise de la Pommeraye, moi, moi, inconstante ! légère !... Marquis, entrez en fureur, cherchez les noms les plus odieux, je me les suis donnés d'avance ; donnez-les-moi, je suis prête à les accepter tous, tous, excepté celui de femme fausse, car en vérité je ne le suis pas. »
Cela dit, Mme de la Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer. Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit : « Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a. point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. Ah ! quelle supériorité ce moment vous donne sur moi ! Que je vous vois grande et que je me trouve petit ! C'est vous qui avez parlé la première, et c'est moi qui fus coupable le premier. Mon amie, votre sincérité m'entraîne ; je serais un monstre si elle ne m'entraînait pas, et je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit ; mais je me taisais, je souffrais, et je ne sais quand j'aurais eu le courage de parler.
— Vrai, mon ami ?
— Rien de plus vrai, et il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait.
— En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé !
— Ou que ce fût en moi qu'il eût cessé le premier.
— Vous avez raison, je le sens.
— Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment ; et si l'expérience du passé ne m'avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais. »
Et le marquis en lui parlant ainsi lui prenait les mains et les lui baisait. Mme de la Pommeraye renfermant en elle-même le dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole et dit au marquis : « Mais, marquis, qu'allons-nous devenir !
— Nous ne nous en sommes imposé ni l'un ni l'autre ; vous avez droit à toute mon estime; je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j'avais à la vôtre : nous continuerons de nous voir, nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié. Nous nous serons épargné tous ces ennuis, toutes ces petites perfidies, tous ces reproches, toute cette humeur qui accompagnent communément les passions qui finissent ; nous serons uniques dans notre espèce. Vous recouvrerez toute votre liberté ; vous me rendrez la mienne ; nous voyagerons dans le monde ; je serai le confident de vos conquêtes ; je ne vous cèlerai rien des miennes, si j'en lais quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Cela sera délicieux ! Vous m'aiderez de vos conseils, je ne vous refuserai pas les miens dans les circonstances périlleuses où vous croirez en avoir besoin. Oui sait ce qui peut arriver ? »
Le marquis applaudit avec quelque naïveté de l'heureuse rupture qui lui rend sa liberté, et à l'élégance d'une femme qui l'accepte. Mais en fait, Mme de la Pommeraye ne songe qu'à se venger et va donc recherche une tenancière de tripot et sa fille, qui se fait appeler d'Aisnon, les loge dans un faubourg, leur fait prendre l'habit et le train de deux femmes de vertu...
«Tandis que nos deux dévotes édifiaient, et que la bonne odeur de leur piété et de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Mme de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié, de la confiance la plus parfaite. Toujours bienvenu, jamais ni grondé, ni boudé, même après de longues absences, il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes, et elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile ; elle lui jetait quelquefois des mots de mariage, mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ces propos tendres ou galants dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, ou elle en souriait, ou elle les laissait tomber. »

Dans la suite un peu chaotique de ce roman s'insèrent d'autres récits, l'histoire des amours de Mme de La Pommeraye et du marquis des Arcis, racontée par une hôtesse bavarde; l'aventure romanesque d'un moine défroqué, devenu le secrétaire du marquis, prétexte à une diatribe contre les couvents d'hommes; la vie et les aventures de M. Desglands, récit partagé par Jacques et son maître puis interrompu par le récit d'un amour de jeunesse de ce dernier alors que Jacques est pris d'un violent mal de gorge...
"Vengeance de femme"...
Jacques le Fataliste fut traduit en allemand en 1792 avant de paraître en France en 1796, mais il abritait un récit secondaire qui devint très rapidement autonome et fut traduit dès 1785 par Schiller ("Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache") tant l'intrigue parut audacieuse et la psychologie féminine si finement décrite.
La "Vengeance de femme" met en scène la marquise de La Pommeraye, une veuve qui avait "des mœurs, de la naissance, de la fortune et de la hauteur", mais qui avait été si malheureuse avec un premier mari," qu'elle aurait mieux aimé s'exposer à toutes sortes de malheurs qu'au danger d'un second mariage", et le marquis des Arcis, un homme de plaisir, croyant peu à la vertu des femmes, mais qui sut la séduire par "sa poursuite constante, secondée de ses qualités personnelles, de sa jeunesse, de sa figure, des apparences de la passion la plus vraie, de la solitude, du penchant à la tendresse". Diderot parvient avec une élégance naturelle singulière à traduire la psychologie d'une femme, abusée une fois de plus, une fois de trop, par un séducteur invétéré: elle réagit alors en deux temps, joue de la naïveté du marquis pour le précipiter dans l'aveu, aveu de son indifférence, de sa volonté de rupture, de son désir de liberté, puis met en place les éléments d'une dramatique et cruelle vengeance perdant sa réputation et destinée "à effrayer tous ceux qui seraient tentés à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme"...
Mme de la Pommeraye cède donc aux avances du marquis des Arcis, malgré ses résolutions antérieures, ils passèrent ainsi quelques années dans la plus étroite intimité. Mais notre marquis peu à peu s'ennuie et reprend la vie de société, peu à peu se détache d'elle et ne s'efforce plus même de cacher son indifférence. Mme de la Pommeraye va donc tenter de s'assurer de ses véritables sentiments par une fausse confidence. Le piège s'ouvre...
«Un jour, après dîner, elle dit au marquis : Mon ami, vous rêvez.
— Vous rêvez aussi, marquise.
— Il est vrai, et même assez tristement.
— Qu'avez- vous ?'
— Rien.
— Cela n'est pas vrai. Allons, marquise, dit-il en baillant, racontez-moi cela ; cela vous désennuiera et moi.
— Est-ce que vous vous ennuyez ?
— Non ; c'est qu'il y a des jours....
— Où l'on s'ennuie.
— Vous vous trompez, mon amie, je vous jure que vous vous trompez : c'est qu'en effet il y a des jours... On ne sait à quoi cela tient.
— Mon ami, il y a longtemps que je suis tentée de vous faire une confidence ; mais je crains de vous affliger.
— Vous pourriez m'affliger, vous ?
— Peut-être ; mais le ciel m'est témoin de mon innocence. Cela s'est fait sans mon consentement, à mon insu, par une malédiction à laquelle toute l'espèce humaine est apparemment assujettie, puisque moi-même je n'y ai point échappé.
— Ah ! c'est de vous... Et avoir peur !... De quoi s'agit- il ?
— Marquis, il s'agit... Je suis désolée ; je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
— Non, mon amie, parlez ; auriez-vous au fond de votre cœur un secret pour moi. La première de nos conventions ne fût-elle pas que nos âmes s'ouvriraient l'une à l'autre sans réserve ?
— Il est vrai, et voilà ce qui me pèse ; c'est un reproche qui met le comble à un beaucoup plus important que je me fais. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n'ai plus la même gaieté ? J'ai perdu l'appétit ; je ne bois et je ne mange que par raison ; je ne saurais dormir. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m'interroge et je me dis : Est-ce qu'il est moins aimable ? Non. Auriez- vous a lui reprocher quelques liaisons suspectes ? Non. Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée ? Non. Pourquoi, votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé ? Car il l'est, vous ne pouvez vous le cacher ; vous ne l'attendez plus avec la même impatience, vous n'avez plus le même plaisir à le voir ; cette inquiétude quand il tardait à revenir. Cette douce émotion au bruit de sa voiture, quand on l'annonçait, quand il paraissait, vous ne l'éprouvez plus.
— Comment, madame ? »
Alors la marquise de la Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment, après lequel elle ajouta : « Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous allez me dire. Marquis ! épargnez-moi... Non, ne m'épargnez pas, dites-les-moi ; je les écouterai avec résignation, parce que je les mérite. Oui, mon cher marquis, il est vrai... Oui, je suis... Mais n'est-ce pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée, sans y ajouter encore la honte, le mépris d'être fausse, en vous le dissimulant ? Vous êtes le même, mais votre amie est changée; votre amie vous révère, vous estime autant et plus et plus que jamais ; mais... mais une femme accoutumée comme elle à examiner de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme et à ne s'en imposer sur rien, ne peut se cacher que l'amour en est sorti. La découverte est affreuse, mais elle n'en est pas moins réelle. La marquise de la Pommeraye, moi, moi, inconstante ! légère !... Marquis, entrez en fureur, cherchez les noms les plus odieux, je me les suis donnés d'avance ; donnez-les-moi, je suis prête à les accepter tous, tous, excepté celui de femme fausse, car en vérité je ne le suis pas. »
Cela dit, Mme de la Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer. Le marquis se précipita à ses genoux et lui dit : « Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n'y en a. point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. Ah ! quelle supériorité ce moment vous donne sur moi ! Que je vous vois grande et que je me trouve petit ! C'est vous qui avez parlé la première, et c'est moi qui fus coupable le premier. Mon amie, votre sincérité m'entraîne ; je serais un monstre si elle ne m'entraînait pas, et je vous avouerai que l'histoire de votre cœur est mot à mot l'histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit ; mais je me taisais, je souffrais, et je ne sais quand j'aurais eu le courage de parler.
— Vrai, mon ami ?
— Rien de plus vrai, et il ne nous reste qu'à nous féliciter réciproquement d'avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait.
— En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé !
— Ou que ce fût en moi qu'il eût cessé le premier.
— Vous avez raison, je le sens.
— Jamais vous ne m'avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment ; et si l'expérience du passé ne m'avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais. »
Et le marquis en lui parlant ainsi lui prenait les mains et les lui baisait. Mme de la Pommeraye renfermant en elle-même le dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole et dit au marquis : « Mais, marquis, qu'allons-nous devenir !
— Nous ne nous en sommes imposé ni l'un ni l'autre ; vous avez droit à toute mon estime; je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j'avais à la vôtre : nous continuerons de nous voir, nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié. Nous nous serons épargné tous ces ennuis, toutes ces petites perfidies, tous ces reproches, toute cette humeur qui accompagnent communément les passions qui finissent ; nous serons uniques dans notre espèce. Vous recouvrerez toute votre liberté ; vous me rendrez la mienne ; nous voyagerons dans le monde ; je serai le confident de vos conquêtes ; je ne vous cèlerai rien des miennes, si j'en lais quelques-unes, ce dont je doute fort, car vous m'avez rendu difficile. Cela sera délicieux ! Vous m'aiderez de vos conseils, je ne vous refuserai pas les miens dans les circonstances périlleuses où vous croirez en avoir besoin. Oui sait ce qui peut arriver ? »
Le marquis applaudit avec quelque naïveté de l'heureuse rupture qui lui rend sa liberté, et à l'élégance d'une femme qui l'accepte. Mais en fait, Mme de la Pommeraye ne songe qu'à se venger et va donc recherche une tenancière de tripot et sa fille, qui se fait appeler d'Aisnon, les loge dans un faubourg, leur fait prendre l'habit et le train de deux femmes de vertu...
«Tandis que nos deux dévotes édifiaient, et que la bonne odeur de leur piété et de la sainteté de leurs mœurs se répandait à la ronde, Mme de la Pommeraye observait avec le marquis les démonstrations extérieures de l'estime, de l'amitié, de la confiance la plus parfaite. Toujours bienvenu, jamais ni grondé, ni boudé, même après de longues absences, il lui racontait toutes ses petites bonnes fortunes, et elle paraissait s'en amuser franchement. Elle lui donnait ses conseils dans les occasions d'un succès difficile ; elle lui jetait quelquefois des mots de mariage, mais c'était d'un ton si désintéressé qu'on ne pouvait la soupçonner de parler pour elle. Si le marquis lui adressait quelques-uns de ces propos tendres ou galants dont on ne peut guère se dispenser avec une femme qu'on a connue, ou elle en souriait, ou elle les laissait tomber. »
Un jour, elle le décide à faire une promenade au Jardin du Roi et, comme par hasard, lui fait rencontrer les dames d'Aisnon. Le marquis remarque la beauté de la fille, la marquise ne manque pas de lui vanter les mérites de leur caractère, leur dignité dans la pauvreté, leur refus de rien accepter pour améliorer leur situation. Il se prend de passion et Mme de la Pommeraye fait tout ce qui est nécessaire pour fortifier ce sentiment naissant.
« Elle tint le marquis près d'un mois dans l'attente de l'entrevue qu'elle avait promise, c'est-à-dire qu'elle lui laissa tout le temps de pâtir, de se bien enivrer, et que, sous prétexte d'adoucir la longueur du délai, elle lui permit de l'entretenir de sa passion. Le marquis venait donc tous les jours causer avec Mme de la Pommeraye, qui achevait de l'irriter, de l'endurcir, et de le perdre par les discours les plus artificieux. »
Elle finit cependant par lui ménager une entrevue.
- Mme de La Pommeraye - Eh bien ! marquis, ne faut-il pas que je sois bien bonne ? Trouvez-moi à Paris une autre femme qui en fasse autant.
- Le Marquis, en se jetant à ses genoux. - J'en conviens ; il n'y en a pas une qui vous ressemble. Votre bonté me confond : vous êtes la seule véritable amie qu'il y ait au monde.
- Mme de La Pommeraye - Etes- vous bien sûr de sentir toujours également le prix de mon procédé ?
- Le Marquis - Je serais un monstre d'ingratitude, si j'en rabattais.
- Mme de La Pommeraye - Changeons de texte. Quel est l'état de votre cœur ?
- Le Marquis - Faut-il vous l'avouer franchement ? Il faut que j'aie cette fille-là ou que je périsse.
- Mme de La Pommeraye - Vous l'aurez sans doute, mais il faut savoir comme quoi.
- Le Marquis - Nous verrons.
- Mme de La Pommeraye - Marquis, marquis, je vous connais, je les connais : tout est vu.
Le marquis cherche à l'avoir comme maîtresse, et pour arriver à ses fins, il séduit son confesseur, puis propose à la fille d'Aisnon de l'enlever. Il lui offre une somme considérable et des pierreries. Mme de la Pommeraye fait renvoyer le tout. Le marquis propose alors de partager sa fortune avec elles et de leur assurer la possession d'une de ses maisons à la ville et d'une autre à la campagne.
"Les nouvelles propositions sont faites. Autre conciliabule des trois femmes. La mère et la fille attendaient en silence la décision de Mme de La Pommeraye. Celle-ci se promena un moment sans parler. «Non, non, dit-elle, cela ne suffît pas à mon cœur ulcéré.» Et aussitôt elle prononça le refus ; et aussitôt les deux femmes fondirent en larmes, se jetèrent à ses pieds, et lui représentèrent combien il était affreux pour elles de repousser une fortune immense, qu'elles pouvaient accepter sans aucune conséquence. Mme de La Pommeraye leur répondit sèchement : « Est-ce que vous vous imaginez que ce que je fais, je le fais pour vous ? Qui êtes-vous ? Que vous dois-je ? A quoi tient-il que je ne vous renvoie l'une et l'autre à votre tripot ? Si ce que l'on vous offre est trop pour vous, c'est trop peu pour moi. Ecrivez, madame, la réponse que je vais vous dicter et qu'elle parte sous mes yeux.»
Ces femmes s'en retournèrent encore plus effrayées qu'affligées. Le marquis ne tarda point à reparaître chez Mme de La Pommeraye : — Eh bien, lui dit-elle, vos nouvelles offres ? »
- Le Marquis - Faites et rejetées. J'en suis désespéré. Je voudrais arracher cette malheureuse passion de mon cœur ; je voudrais m'arracher le, cœur, et je ne saurais. Marquise, regardez-moi, ne trouvez-vous pas qu'il y a entre cette jeune fille et moi quelques traits de ressemblance ?
- Mme de La Pommeraye - Je ne vous en avais rien dit ; mais je m'en étais aperçue. Il ne s'agit pas de cela : que résolvez-vous ?
- Le Marquis - Je ne puis me résoudre à rien. Il me prend des envies de me jeter dans une chaise de poste, et de courir tant que terre me portera ; un moment après la force m'abandonne ; je suis comme anéanti, ma tête s'embarrasse : je deviens stupide et ne sais que devenir.
- Mme de La Pommeraye - Je ne vous conseille pas de voyager, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à Villejuif pour revenir...
- Le Marquis - Je ne suis bien nulle part, et je me détermine à la plus haute sottise qu'un homme de mon état, de mon âge et de mon caractère puisse faire. Mais il vaut mieux épouser que de souffrir. J'épouse.
- Mme de La Pommeraye - Marquis, l'affaire est grave, et demande de la réflexion.
- Le Marquis - Je n'en ai fait qu'une, mais elle est solide : c'est que je ne puis jamais être plus malheureux que je ne suis.
- Mme de La Pommeraye - Vous pourriez vous tromper.
- Le Marquis - Voici donc enfin, mon amie, une négociation dont je puis, ce me semble, vous charger honnêtement. Voyez la mère et la fille ; interrogez la mère, sondez le cœur de la fille, et dites-leur mon dessein.
- Mme de La Pommeraye - Tout doucement, marquis. J'ai cru les connaître assez pour ce que j'en avais à faire. Mais à présent qu'il s'agit du bonheur de mon ami, il me permettra d'y regarder de plus près. Je m'informerai dans leur province, et je vous promets de les suivre pas à pas pendant toute la durée de leur séjour à Paris.
- Le Marquis - Ces précautions me semblent assez superflues. Des femmes dans la misère, qui résistent aux appâts que je leur ai tendus, ne peuvent être que les créatures les plus rares. Avec mes offres je serais venu à bout d'une duchesse. D'ailleurs, ne' m'avez-vous pas dit vous-même...
- Mme de La Pommeraye - Oui, j'ai dit tout ce qu'il vous plaira, mais avant tout cela permettez que je me satisfasse. »
Mme de la Pommeraye fait ses informations, recueille les renseignements les plus favorables, impose encore au marquis pour s'examiner davantage une quinzaine d'attente qui lui parut éternelle, puis prête sa maison pour l'entrevue et la signature du contrat....
Le lendemain des noces Mme de la Pommeraye écrit au marquis un billet pour le prier de passer chez elle et le reçoit avec un visage où l'indignation se peignait dans toute sa force...
- « Marquis, apprenez à me connaître. Si les autres femmes s'estimaient assez pour éprouver mon ressentiment, vos semblables seraient moins communs. Vous aviez acquis une honnête femme, que vous n'avez pas su conserver ; cette femme, c'est moi; elle s'est vengée en vous en faisant épouser une digne de vous. Sortez de chez moi, et allez-vous- en rue Traversière, à l'hôtel de Hambourg, où l'on vous apprendra le sale métier que votre femme et votre belle- mère ont exercé pendant dix ans, sous le nom de d'Aisnon. »
Le marquis se retire pendant quinze jours dans ses terres et dès son retour, envoie sa belle-mère aux Carmélites. Quant à sa femme, elle joue le grand jeu romantique de la courtisane réhabilitée...
"A son retour, le marquis s'enferma dans son cabinet, et écrivit deux lettres, l'une à sa femme, l'autre à sa belle-mère. Celle-ci partit dans la même journée, et se rendit au couvent des Carmélites de la ville prochaine, où elle est morte il y a quelques jours. Sa fille s'habilla, et se
traîna dans l'appartement de son mari où il lui avait apparemment enjoint de venir. Dès la porte, elle se jeta à genoux. "Levez-vous", lui dit le marquis...
Au lieu de se lever, elle s'avança vers lui sur ses genoux ; elle tremblait de tous ses membres ; elle était échevelée ; elle avait le corps un peu penché, les bras portés de son côté, la tête relevée, le regard attaché sur ses yeux, et le visage inondé de pleurs.
« Il me semble, lui dit-elle, un sanglot séparant chacun de ses mots, que votre cœur, justement irrité, s'est radouci," et que peut-être avec le temps j'obtiendrai miséricorde. Monsieur, de grâce, ne vous hâtez pas de me pardonner. Tant de filles honnêtes sont devenues de malhonnêtes femmes, que peut-être serai-je un exemple contraire. Je ne suis pas encore digne que vous vous rapprochiez de moi ; attendez, laissez-moi seulement l'espoir du pardon. Tenez-moi loin de vous ; vous verrez ma conduite ; vous la jugerez : trop heureuse mille fois, trop heureuse si vous daignez quelquefois m'appeler ! Marquez-moi le recoin obscur de votre maison où vous permettez que j'habite ; j'y resterai sans murmure. Ah ! si je pouvais m'arracher le nom et le titre qu'on m'a fait usurper, et mourir après, à l'instant vous seriez satisfait ! Je me suis laissé conduire par faiblesse, par séduction, par autorité, par menaces, à une action infâme ; mais ne croyez pas. Monsieur, que je sois méchante : je ne la suis pas, puisque je n'ai pas balancé à paraître devant vous quand vous m'avez appelée, et que j'ose à présent lever les yeux sur vous et vous parler. Ah ! si vous pouviez lire au fond de mon cœur, et voir combien mes fautes passées sont loin de moi ; combien les mœurs de mes pareilles me sont étrangères ! La corruption s'est posée sur moi ; mais elle ne s'y est pas attachée. Je me connais, et une justice que je me rends, c'est que par mes goûts, par mes sentiments, par mon caractère, j'étais née digne de l'honneur de vous appartenir. Ah ! s'il m'eût été libre de vous voir, il n'y avait qu'un mot à dire, et je crois que j'en aurais eu le courage. Monsieur, disposez de moi comme il vous plaira ; faites entrer vos gens ; qu'ils me dépouillent, qu'ils me jettent la nuit dans la rue : je sous- cris à tout. Quel que soit le sort que vous me préparez, je m'y soumets : le fond d'une campagne, l'obscurité d'un cloître peut me dérober pour jamais à vos yeux: parlez, et j'y vais. Votre bonheur n'est point perdu sans ressource, et vous pouvez m'oublier...
— Levez-vous, lui dit doucement le marquis ; je vous ai pardonné; au moment même de l'injure j'ai respecté ma femme en vous; il n'est pas sorti de ma bouche une parole qui l'ait humiliée, ou du moins je m'en repens, et je proteste qu'elle n'en entendra plus aucune qui l'humilie, si elle se souvient qu'on ne peut rendre son époux malheureux sans le devenir. Soyez honnête, soyez heureuse, et faites que je le sois. Levez-vous, je vous en prie, ma femme, levez-vous et embrassez-moi, Madame la marquise, levez-vous, vous n'êtes pas à votre place ; madame des Arcis, levez-vous...
Pendant qu'il parlait ainsi, elle était restée le visage caché dans ses mains, et la tête appuyée sur les genoux du marquis ; mais au mot de ma femme, au mot de madame des Arcis, elle se leva brusquement, et se précipita sur le marquis, elle le tenait embrassé, à moitié suffoquée par la douleur et par la joie ; puis elle se séparait de lui, se jetait à terre, et lui baisait les pieds.
"Ah ! lui disait le marquis, je vous ai pardonné ; je vous l'ai dit ; et je vois que vous n'en croyez rien. - Il faut, lui répondit-elle, que cela soit, et que je ne le croie jamais.»
Le marquis ajoutait : « En vérité, je crois que je ne me repens de rien ; et que cette Pommeraye, au lieu de se venger, m'aura rendu un grand service. Ma femme, allez vous habiller, tandis qu'on s'occupera à faire vos malles. Nous partons pour ma terre, où nous resterons jusqu'à ce que nous puissions reparaître ici sans conséquence pour vous et pour moi. »

Au Salon de 1767 figurait le portrait de Diderot par Michel Van Loo, et voici comment le modèle fait ainsi la critique :
«Moi. J'aime Michel; mais j'aime encore mieux la vérité. Assez ressemblant ; il peut dire à ceux qui ne le reconnaissent pas, comme le jardinier de l'opéra-comique : « C'est qu'il ne m'a jamais vu sans perruque. » Très vivant ; c'est sa douceur, avec sa vivacité ; mais trop jeune, tête trop petite, joli comme une femme, lorgnant, souriant, mignard, faisant le petit bec, la bouche en cœur ; rien de la sagesse de couleur du Cardinal de Choiseul ; et puis un luxe de vêtement à ruiner le pauvre littérateur si le receveur de la capitation vient à l'imposer sur sa robe de chambre. L'écritoire, les livres, les accessoires aussi bien qu'il est possible quand on a voulu la couleur brillante et qu'on veut être harmonieux. Pétillant de près, vigoureux de loin, surtout les chairs. Du reste, de belles mains, bien modelées, excepté la gauche qui n'est pas dessinée. On le voit de face ; il a la tête nue ; son toupet gris, avec sa mignardise, lui donne l'air d'une vieille coquette qui fait encore l'aimable ; la position d'un secrétaire d'Etat et non d'un philosophe. La fausseté du premier moment a influé sur tout le reste. C'est cette folle de Mme Van Loo qui venait jaser avec lui, tandis qu'on le peignait, qui lui a donné cet air-là, et qui a tout gâté. Si elle s'était mise à son clavecin, et qu'elle eût préludé ou chanté :
Non ha ragione, ingrato.
Un core abbandonato,
ou quelque autre morceau du même genre, le philosophe sensible eût pris un tout autre caractère ; et le portrait s'en serait ressenti. Ou mieux encore, il fallait le laisser seul, et l'abandonner à sa rêverie. Alors sa bouche se serait entr'ou verte, ses regards distraits se seraient portés au loin, le travail de sa tête, fortement occupée, se serait peint sur son visage ; et Michel eût fait une belle chose. Mon joli philosophe, vous me serez à jamais un témoignage précieux de l'amitié d'un artiste, excellent artiste, plus excellent homme. Mais que diront mes petits-enfants, lorsqu'ils viendront à comparer mes tristes ouvrages avec ce riant, mignon, efféminé, vieux coquet-là ? Mes enfants, je vous préviens que ce n'est pas moi. J'avais en une journée cent physionomies diverses, selon la chose dont j'étais affecté. J'étais serein, triste, rêveur, tendre, violent, passionné, enthousiaste ; mais je ne fus jamais tel que vous me voyez là. J'avais un grand front, des yeux très vifs, d'assez grands traits, la tête tout à fait du caractère d'un ancien orateur, une bonhomie qui touchait de bien près à la bêtise, à la rusticité des anciens temps. Sans l'exagération de tous les traits dans la gravure qu'on a faite d'après le crayon de Greuze, je serais infiniment mieux. J'ai un masque qui trompe l'artiste ; soit qu'il y ait trop de choses fondues ensemble ; soit que les impressions de mon âme se succédant trop rapidement et se peignant toutes sur mon visage, l'œil du peintre ne me retrouvant pas le même d 'un instant à l'autre, sa tâche ne devienne beaucoup plus difficile qu'il ne la croyait. Je n'ai jamais été bien fait que par un pauvre diable appelé Garaud, qui m'attrapa, comme il arrive à un sot qui dit un bon mot. Celui qui voit mon portrait par Garaud me voit »
Diderot, dans son Salon de 1767, semble faire le tour des problèmes que posait l'art du portrait à cette époque, en faisant ressortir d'une part le mensonge mais aussi la pérennité du portrait d'apparat, et d'autre part, l'honnêteté, mais aussi ce qu'on pensait être les limites, du portrait réaliste...
"Pourquoi un peintre d'histoire est-il communément un mauvais portraitiste? Pourquoi un barbouilleur du pont Notre-Dame fera-t-il plus ressemblant qu'un professeur de l'Académie? C'est que celui-ci ne s'est jamais occupé de l'imitation rigoureuse de la nature; c'est qu'il a l'habitude d'exagérer, d'affaiblir, de corriger son modèle; c'est qu'il a la tête pleine de règles qui l'assujettissent et qui dirigent son pinceau, sans qu'il s'en aperçoive; c'est qu'il a toujours altéré les formes d'après ces règles du goût, et qu'il continue de les altérer; c'est qu'il fond, avec les traits qu'il a sous les yeux et qu'il s'efforce en vain de copier rigoureusement, des traits empruntés des antiques qu'il a étudiés, des tableaux qu'il a vus et admirés et de ceux qu'il a faits; c'est qu'il est savant; c'est qu'il est libre, et qu'il ne peut se réduire à la condition de l'esclave et de l'ignorant; c'est qu'il a son faire, son tic, sa couleur, auxquels il revient sans cesse; c'est qu'il exécute une caricature en beau et que le barbouilleur, au contraire, exécute une caricature en laid. Le portrait ressemblant du barbouilleur meurt avec la personne; celui de l'habile homme reste à jamais. C'est d'après ce dernier que nos neveux se forment les images des grands hommes qui les ont précédés."

Le tableau de Greuze relatif à la Jeune fille qui pleure son oiseau mort commenté par Diderot est un morceau de choix...
«La jolie élégie ! le charmant poème ! la belle idylle que Gessner en ferait ! C'est la vignette d'un morceau de ce poète. Tableau délicieux ! le plus agréable et peut-être le plus intéressant du Salon. La pauvre petite est de face ; sa tête est appuyée sur sa main gauche : l'oiseau mort est posé sur le bord supérieur de la cage, la tête pendante, les ailes traînantes, les pattes en l'air. Le joli catafalque que cette cage ! que cette guirlande de verdure qui serpente autour a de grâces ! la pauvre petite ! ah ! qu'elle est affligée ! Comme elle est naturellement placée ! Que sa tête est belle ! qu'elle est élégamment coiffée ! que son visage a d'expression ! Sa douleur est profonde ; elle est à son malheur, elle y est tout entière. la belle main ! la belle main ! le beau bras ! Voyez la vérité, les détails de ces doigts ; et ces fossettes, et cette mollesse, et cette teinte de rougeur dont la pression de la tête a coloré le bout de ces doigts délicats, et le charme de tout cela. On s'approcherait de cette main pour la baiser, si on ne respectait cette enfant et sa douleur. Tout enchante en elle, jusqu'à son ajustement. Ce mou- choir de cou est jeté d'une manière ! il est d'une souplesse et d'une légèreté ! Quand on aperçoit ce morceau, on dit : Délicieux ! Si l'on s'y arrête ou qu'on y revienne, on s'écrie : Délicieux ! Délicieux ! Bientôt on se surprend conversant avec cette enfant et la consolant. Cela est si vrai, que voici ce que je me souviens de lui avoir dit à différentes reprises : «Mais, petite, votre douleur est bien profonde, bien réfléchie ! Que signifie cet air rêveur et mélancolique ! Quoi ! pour un oiseau ! Vous ne pleurez pas, vous êtes affligée ; et la pensée accompagne votre affliction. Çà, petite, ouvrez-moi votre cœur : parlez-moi vrai ; est-ce bien la mort de cet oiseau qui vous retire si fortement et si triste- ment en vous-même ?... Vous baissez les yeux ; vous ne me répondez pas. Vos pleurs sont prêts à couler. Je ne suis pas père ; je ne suis ni indiscret, ni sévère.. Eh bien, je le conçois ; il vous aimait, il vous le jurait, et le jurait depuis longtemps. Il souffrait tant : le moyen de voir souffrir ce qu'on aime ?... Eh! laissez-moi continuer ; pourquoi me fer- mer la bouche de votre main ?... Ce matin-là, par malheur, votre mère était absente. Il vint ; vous étiez seule : il était beau, si passionné, si tendre, si charmant ! Il avait tant d'amour dans les yeux! tant de vérité dans les expressions !il disait de ces mots qui vont si droit à l'âme ! et en les disant il était à vos genoux : Cela se conçoit encore. Il tenait une de vos mains ; de temps en temps vous y sentiez la chaleur de quelques larmes qui tombaient de ses yeux et qui coulaient le long de vos bras. Votre mère ne revenait toujours point. Ce n'est pas votre faute ; c'est la faute de votre mère... Mais voilà-t-il pas que vous pleurez de plus belle... Mais ce que je vous en dis n'est pas pour vous faire pleurer. Et pourquoi pleurer ? Il vous a promis ; il ne manquera à rien de ce qu'il a promis. Quand on a été assez heureux pour rencontrer un enfant charmant comme vous, pour s'y attacher, pour lui plaire ; c'est pour toute la vie... — Et mon oiseau ?... — « Vous souriez. Ah ! mon ami, qu'elle était belle ! ah ! si vous l'aviez vue sou- rire et pleurer ! » Je continuai : « Eh bien, votre oiseau ! Quand on s'oublie soi-même, se souvient-on de son oiseau ? Lorsque l'heure du retour de votre mère approcha, celui que vous aimez s'en alla. Qu'il était heureux, content, transporté ! Qu'il eut de peine à s'arracher d'auprès de vous !... Comme vous me regardez ! Je sais tout cela. Combien il se leva et se rassit de fois ! Combien il vous dit, redit adieu sans s'en aller ! combien de fois il sortit et rentra ! Je viens de le voir chez son père : il est d'une gaieté charmante, d'une gaieté qu'ils partagent tous, sans pouvoir s'en défendre... — Et ma mère ?... — Votre mère, à peine fut-il sorti qu'elle rentra : elle vous trouva rêveuse comme vous l'étiez tout à l'heure. On l'est toujours comme cela. Votre mère vous parlait, et vous n'entendiez pas ce qu'elle vous disait ; elle vous commandait une chose et vous en faisiez une autre. Quelques pleurs se présentaient au bord de vos paupières ; ou vous les reteniez, ou vous détourniez la tête pour les essuyer furtivement. Vos dis- tractions continues impatientèrent votre mère ; elle vous gronda ; et ce vous fut une occasion de pleurer sans contrainte et de soulager votre cœur... Continuerai-je, petite? Je crains que ce que je vais dire ne renouvelle votre .peine. Vous le voulez ?... Eh bien, votre bonne mère se reprocha de vous avoir contristée ; elle s'approcha de vous, elle vous prit les mains, elle vous baisa le front et les joues, et vous en pleurâtes bien davantage. Votre tête se pencha sur elle ; et votre visage que la rougeur commençait à colorer, tenez, tout comme le voilà qui se colore, alla se cacher dans son sein. Combien cette bonne mère vous a dit de choses douces ! et combien ces choses douces vous faisaient de mal ! Cependant votre serin avait beau s'égosiller, vous avertir, vous appeler, battre des ailes, se plaindre de votre oubli, vous ne le voyiez point, vous ne l'entendiez point : vous étiez à d'autres pensées. Son eau ni la graine ne furent point renouvelées ; et ce matin l'oiseau n'était plus... Vous me regardez encore ; est-ce qu'il me reste encore quelque chose à dire ? Ah ! j'entends, petite ; cet oiseau, c'est lui qui vous l'avait donné : eh bien, il en retrouvera un autre aussi beau... Ce n'est pas tout encore : vos yeux se fixent sur moi, et se remplissent de nouveau de larmes ; qu'y a-t-il donc encore ? Parlez, je ne saurais vous deviner... — Et si la mort de cet oiseau n'était que le présage !... Que ferais-je ? que deviendrais-je? S'il était ingrat... — Quelle folie! Ne craignez rien, pauvre petite : cela ne se peut, cela ne sera pas ! »
Quoi ! mon ami, vous me riez au nez! vous vous moquez d'un grave personnage qui s'occupe de consoler un enfant en peinture de la perte de son oiseau, de la perte de tout ce qu'il vous plaira ? Mais voyez donc comme elle est belle ! comme elle est intéressante ! Je n'aime point à affliger ; malgré cela, il ne me déplairait pas trop d'être la cause de sa peine.
Le sujet de ce petit poème est si fin, que beaucoup de personnes ne l'ont pas entendu ; ils ont cru que cette jeune fille ne pleurait que son serin. Greuze a déjà peint une fois le même sujet, il a placé devant une glace fêlée une grande fille en satin blanc, pénétrée d'une profonde mélancolie. Ne pensez-vous pas qu'il y aurait autant de bêtise à attribuer les pleurs de la jeune fille de ce Salon à la perte d'un oiseau, que la mélancolie de la jeune fille du Salon précédent à son miroir cassé ? Cette enfant pleure autre chose, vous dis-je. D'abord vous l'avez entendue, elle en convient ; et son affliction réfléchie le dit de reste. Cette douleur ! à son âge ! et pour un oiseau !... Mais quel âge a-t-elle donc ?... Que vous répondrai-je, et quelle question m'avez-vous faite ? Sa tête est de quinze à seize ans, et son bras et sa main de dix-huit à dix-neuf. C'est un défaut de cette composition qui devient d'autant plus sensible, que la tête étant appuyée sur la main, une des parties donne tout contre la mesure de l'autre. Placez la main autrement, et l'on ne s'apercevra plus qu'elle est un peu trop forte et trop caractérisée. C'est, mon ami, que la tête a été prise d'après un modèle, et la main d'après un autre. Du reste, elle est très vraie, cette main, très belle, très parfaitement coloriée et dessinée. Si vous voulez passer à ce tableau cette tache légère, avec un ton de couleur un peu violâtre, c'est une chose très belle. La tête est bien éclairée, de la couleur la plus agréable qu'on puisse donner à une blonde, car elle est blonde, notre petite : peut-être demanderait-on que cette tête fît un peu plus le rond de bosse. Le mouchoir rayé est large, léger, du plus beau transparent; le tout fortement touché, sans nuire aux finesses de détail »

Diderot, précurseur de Buffon, de Lamarck et de Darwin...
En 1770, dans le récit de son Voyage à Bourbonne, Diderot esquisse, à propos des eaux thermales, les grandes révolutions du globe :
« Combien de vicissitudes dans l'espace immense qui s'étend au-dessus de nos têtes ? Combien d'autres dans les entrailles profondes de la terre ? Une rivière nécessaire au mouvement des moulins à sucre, à l'arrosement des terres plantées de cannes et à la subsistance des habitants vient de disparaître à la Martinique dans un tremblement de terre, et de rendre une contrée à l'état sauvage. Les mers et la population marchent. Un jour il y aura des baleines où croissent nos moissons, des déserts où la race humaine fourmille. Les volcans semblent communiquer de l'un à l'autre pôle. Lorsque l'un mugit en Islande, un autre se tait en Sicile ou parle dans les Cordillères. Les entrailles de la terre sont fouillées de cavités immenses où des masses énormes d'eaux vont ou iront s'engloutir. Le feu a creusé des réservoirs à l'eau ; ces réservoirs un temps vides, un autre temps remplis, sont à découvert comme nos lacs, ou attendent que la croûte qui les couvre, se fonde, se brise et les montre. Les extrémités de notre demeure s'affaissent, l'équateur s'élève par une force qui va toujours en croissant. Ce que nous appelons notre globe tend sans cesse à ne former qu'un mince et vaste plan. Peut-être qu'avant d'avoir pris cette forme, il ira se précipiter dans l'océan de feu qui l'éclairé, à la suite de Mercure, de Vénus et de Mars. Qui sait si Mercure sera la première proie qu'il a dévorée ? Que diront nos neveux lorsqu'ils verront la planète de Mercure se perdre dans ce gouffre enflammé ? Pourront-ils s'empêcher d'y prévoir leur sort à venir ? Si, du milieu de leur terreur, ils ont le courage d'agrandir leurs idées, ils prononceront que toutes les parties du grand tout s'efforcent à s'approcher, et qu'il est un instant où il n'y aura qu'une masse générale et commune. »
Les Epoques de la Nature sont de 1778...

1772 - "Supplément au Voyage de Bougainville"
"Tu n'es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ?" - L'homme, sans Dieu, "naturel", est-il bon ou méchant, mais plus encore, il devient ici l'observateur de l'Européen, Diderot dresse à sa manière un réquisitoire à l'encontre de cet aveuglement qui caractérise l'homme civilisé qui croit savoir...
Toute la première moitié du XVIIIe siècle semblait pousser Diderot à l'optimisme, mais les objections vont s'accumuler, l'histoire apparaît très rapidement comme une suite d'atrocités. Diderot s’inspire du "Voyage autour du monde de Bougainville" pour écrire ce nouveau dialogue philosophique. Un Tahitien âgé émet des reproches à l’encontre de Bougainville, lequel espère coloniser Tahiti. À travers ce vieux personnage, le philosophe dénonce aussi bien l’esclavage que la colonisation et défend la liberté. Le discours du tahitien évoque par ailleurs les qualités de la vie naturelle contre les méfaits de la société civilisée. L’auteur fait également l’apologie des mœurs et coutumes tahitiennes, en contradiction avec les interdits religieux et sociaux sur la sexualité des Européens. Le texte de Diderot est d’abord publié discrètement, avant de paraître en volume en 1796.
Diderot prend la défense des sociétés naturelles et de leurs mœurs, qu'il oppose à la cruauté de la civilisation européenne. Dans cet extrait, il donne la parole à un vieillard qui exhorte son peuple à se protéger des Européens....
"Il était père d'une famille nombreuse. À l'arrivée des Européens, il laissa tomber des regards de dédain sur eux, sans marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l'abordèrent ; il leur tourna le dos, se retira dans sa cabane. Son silence et son souci ne décelaient que trop sa pensée : il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclipsés. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur le rivage, s'attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs bras, et pleuraient, ce vieillard s'avança d'un air sévère et dit : « Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ce soit de l'arrivée, et non du
départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au côté de celui-là, dans l'autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. Mais je me console ; je touche à la fin de ma carrière; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point.
Ô Tahitiens ! mes amis ! Vous auriez un moyen d'échapper à un funeste avenir ; mais j'aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu'ils s'éloignent et qu'ils vivent."
Puis, s'adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands qui t'obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive ; nous sommes innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n'es ni un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l'as dit à moi, ce qu'ils ont écrit sur cette lame de métal : "Ce pays est à nous".
Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes, et qu'il gravât sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres : Ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? Tu es le plus fort I Et qu'est-ce que cela fait ? Lorsqu'on t'a enlevé une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t'es récrié, tu t'es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le vol de toute une contrée ! Tu n'es pas esclave : tu souffrirais la mort plutôt que de l'être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t'emparer comme de la brute, le Tahitien, est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu'il n'ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jeté sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t'avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières.
Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qu'y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu'où tu voudras ce que tu appelles les commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s'arrêter, lorsqu'ils n'auraient à obtenir de la continuité de leurs pénibles efforts que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l'étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu'il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t'agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques. Regarde ces hommes ; vois comme ils sont droits, sains et robustes. Regarde ces femmes; vois comme elles sont droites, saines, fraîches et belles.
Prends cet arc, c'est le mien; appelle à ton aide un, deux, trois, quatre de tes camarades, et tâchez de le tendre. Je le tends moi seul. Je laboure la terre; je grimpe la montagne ; je perce la forêt ; je parcours une lieue de la plaine en moins d'une heure. Tes jeunes compagnons ont eu peine à me suivre; et j'ai quatre-vingt-dix ans passés. Malheur à cette île ! malheur aux
Tahitiens présents, et à tous les Tahitiens à venir, du jour où tu nous as visités !
Nous ne connaissions qu'une maladie; celle à laquelle l'homme, l'animal et la plante ont été condamnés, la vieillesse; et tu nous en as apporté une autre : tu as infecté notre sang. Il nous faudra peut-être exterminer de nos propres mains nos filles, nos femmes, nos enfants; ceux qui ont approché tes femmes; celles qui ont approché tes hommes. Nos champs seront trempés du sang impur qui a passé de tes veines dans les nôtres: ou nos enfants condamnés à nourrir et à perpétuer le mal que tu as donné aux pères et aux mères, et qu'ils transmettront à jamais à leurs descendants...."

L'entretien de l’Aumônier et d'Orou..
"Dans la division que les Otaïtiens se firent de l'équipage de Bougainville, l'aumônier devint le partage d'Orou. L’aumônier et l'otaïtien étaient à peu près du même âge, trente-cinq à trente-six ans. Orou n'avait alors que sa femme et trois filles appelées Asto, Palli et Thia. Elles le déshabillèrent, lui lavèrent le visage, les mains et les pieds, et lui servirent un repas sain et frugal. Lorsqu'il fut sur le point de se coucher, Orou, qui s'était absenté avec sa famille, reparut, lui présenta sa femme et ses trois filles nues et lui dit : Tu as soupé, tu es jeune, tu te portes bien ; si tu dors seul, tu dormiras mal : l'homme a besoin, la nuit, d'une compagne à son côté. Voilà ma femme, voilà mes filles, choisis celle qui te convient ; mais si tu veux m'obliger, tu donneras la préférence à la plus jeune de mes filles qui n'a point encore eu d'enfants. La mère ajouta: Hélas ! je n'ai pas à m'en plaindre, la pauvre Thia ! ce n'est pas sa faute.
L’aumônier répondit que sa religion, son état, les bonnes mœurs et l'honnêteté ne lui permettaient pas d'accepter ses offres.
Orou répliqua : Je ne sais ce que c'est que la chose que tu appelles religion mais je ne puis qu'en penser mal, puisqu'elle t'empêche de goûter un plaisir innocent auquel nature, la souveraine maîtresse, nous invite tous ; de donner l'existence à un de tes semblables ; de rendre un service que le père, la mère et les enfants te demandent ; de t'acquitter envers un hôte qui t'a fait un bon accueil, et d'enrichir une nation en l'accroissant d'un sujet de plus. Je ne sais ce que c'est que la chose que tu appelles état ; mais ton premier devoir est d'être homme et d'être reconnaissant. Je ne te propose pas de porter dans ton pays les mœurs d'Orou, mais Orou, ton hôte et ton ami, te supplie de te prêter aux mœurs d'Otaïti. Les mœurs d'Otaïti sont-elles meilleures ou plus mauvaises que les vôtres ? c'est une question facile à décider. La terre où tu es né a-t-elle plus d'hommes qu'elle n'en peut nourrir ? en ce cas tes mœurs ne sont ni pires ni meilleures que les nôtres. En peut-elle nourrir plus qu'elle n'en a ? nos mœurs sont meilleures que les tiennes. Quant à l'honnêteté que tu m'objectes, je te comprends : j'avoue que j'ai tort et je t'en demande pardon. Je n'exige pas que tu nuises à ta santé ; si tu es fatigué, il faut que tu te reposes, mais j'espère que tu ne continueras pas à nous contrister. Vois le souci que tu as répandu sur tous ces visages. Elles craignent que tu n'aies remarqué en elles quelques défauts qui leur attirent ton dédain. Mais quand cela serait, le plaisir d'honorer une de mes filles entre ses compagnes et ses sœurs et de faire une bonne action ne te suffirait-il pas ? Sois généreux.
L'AUMONIER - Ce n'est pas cela ; elles sont toutes quatre également belles. Mais ma religion ! mais mon état !
OROU - Elles m'appartiennent et je te les offre ; elles sont à elles et elles se donnent à toi. Quelle que soit la pureté de conscience que la chose religion et la chose état te prescrivent, tu peux les accepter sans scrupule. Je n'abuse point de mon autorité, et sois sûr que je connais et que je respecte les droits des personnes.
Ici le véridique aumônier convient que jamais la Providence ne l'avait exposé à une aussi pressante tentation. Il était jeune ; il s'agitait, il se tourmentait; il détournait ses regards des aimables suppliantes, il les ramenait sur elles ; il levait ses yeux et ses mains au ciel. Thia, la plus jeune, embrassait ses genoux et lui disait : « Étranger, n'afflige pas mon père, n'afflige pas ma mère, ne m'afflige pas. Honore-moi dans la cabane et parmi les miens ; élève-moi au rang de mes sœurs qui se moquent de moi. Asto, l'aînée, a déjà trois enfants ; Palli, la seconde, en a deux, et Thia n'en a point. Étranger, honnête étranger, ne me rebute pas ; rends-moi mère : fais-moi un enfant que je puisse un jour promener par la main, à côté de moi, dans Otaïti, qu'on voie dans neuf mois attaché à mon sein, dont je sois fière, et qui fasse une partie de ma dot lorsque je passerai de la cabane de mon père dans une autre. Je serai peut-être plus chanceuse avec toi qu'avec nos jeunes Otaïtiens. Si tu m'accordes cette faveur, je ne t'oublierai plus ; je te bénirai toute ma vie ; j'écrirai ton nom sur mon bras et sur celui de ton fils, nous le prononcerons sans cesse avec joie ; et lorsque tu quitteras ce rivage, mes souhaits t'accompagneront sur les mers jusqu'à ce que tu sois arrivé dans ton pays. »
Le naïf aumônier dit qu'elle lui serrait les mains, qu'elle attachait sur ses yeux des regards si expressifs et si touchants, qu'elle pleurait, que son père, sa mère et ses sœurs s'éloignèrent, qu'il resta seul avec elle, et qu'en disant, Mais ma religion ! mais mon état ! il se trouva le lendemain couché à côté de cette jeune fille qui l'accablait de caresses, et qui invitait son père, sa mère et ses sœurs, lorsqu'ils s'approchèrent de son lit le matin, à joindre leur reconnaissance à la sienne, Asto et Palli qui s'étaient éloignées rentrèrent avec les mets du pays, des boissons et des fruits. Elles embrassaient leur sœur et faisaient des vœux sur elle ; ils déjeunèrent tous ensemble, ensuite Orou, demeuré seul avec l'aumônier, lui dit : Je vois que ma fille est contente de toi, et je te remercie. Mais pourrais-tu m'apprendre ce que c'est que le mot religion que tu as prononcé tant de fois et avec tant de douleur ? ....."

1772 - "Regrets sur ma vieille robe de chambre ou Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune"
Diderot, certes lecteur enthousiaste du romancier anglais Richardson, trace un chemin littéraire qui lui est bien personnel, entre conte philosophique et roman réaliste, les brefs récits ou dialogues se succèdent, Les Deux Amis de Bourbonne, Entretien d'un père avec ses enfants (composés en 1770), Ceci n'est pas un conte (1772), Regrets sur ma vieille robe de chambre (publié en 1772), puis de seront des oeuvres plus longues, La Religieuse (composée en 1760) et ses deux romans les plus importants, Le Neveu de Rameau (commencé en 1762) et Jacques le fataliste (1773).
« Pourquoi ne l'avoir pas gardée ? Elle était faite à moi ; j'étais fait à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner ; j'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesée, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prêtât ; car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière, un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume, elle présentait le flanc. On y voyait tracés en longues raies noires les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ces longues raies annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant ; on ne sait qui je suis.
Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre ; je suis devenu l'esclave de la nouvelle.
Le dragon qui surveillait la toison d'or ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui s'est livré, pieds et poings liés, aux caprices, à la merci d'une jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir : Où est ma bonne, ma vieille gouvernante ? Quel démon m'obsédait le jour que je la chassai pour celle-ci ! Puis il pleure, il soupire.
Je ne pleure pas, je ne soupire pas ; mais à chaque instant je dis : Maudit soit celui qui inventa l'art de donner du prix à l'étoffe commune en la teignant en écarlate ! Maudit soit le précieux vêtement que je révère ! Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calemande ?
Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises ; l'opulence a sa gêne.
Ô Diogène ! si tu voyais ton disciple sous le fastueux manteau d'Aristippe, comme tu rirais ! Ô Aristippe, ce manteau fastueux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante, efféminée, et de la vie libre et ferme du cynique déguenillé ! j'ai quitté le tonneau où je régnais, pour servir sous un tyran.
Ce n'est pas tout, mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent.
Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de Bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les angles sur cette tapisserie ; entre ces estampes trois ou quatre plâtres suspendus formaient avec ma vieille robe de chambre l'indigence la plus harmonieuse.
Tout est désaccordé. Plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté.
Une nouvelle gouvernante stérile qui succède dans un presbytère, la femme qui entre dans la maison d'un veuf, le ministre qui remplace un ministre disgracié, le prélat moliniste qui s'empare du diocèse d'un prélat janséniste, ne causent pas plus de trouble que l'écarlate intruse en a causé chez moi.
Je puis supporter sans dégoût la vue d'une paysanne. Ce morceau de toile grossière qui couvre sa tête ; cette chevelure qui tombe éparse sur ses joues ; ces haillons troués qui la vêtissent à demi ; ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à la moitié de ses jambes ; ces pieds nus et couverts de fange ne peuvent me blesser : c'est l'image d'un état que je respecte ; c'est l'ensemble des disgrâces d'une condition nécessaire et malheureuse que je plains. Mais mon cœur se soulève ; et, malgré l'atmosphère parfumée qui la suit, j'éloigne mes pas, je détourne mes regards de cette courtisane dont la coiffure à points d'Angleterre, et les manchettes déchirées, les bas de soie sales et la chaussure usée, me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille.
Tel eût été mon domicile, si l'impérieuse écarlate n'eût tout mis à son unisson.
J'ai vu la Bergame céder la muraille, à laquelle elle était depuis si longtemps attachée, à la tenture de damas.
Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite : la Chute de la manne dans le désert du Poussin, et l'Esther devant Assuérus du même ; l'une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c'est la triste Esther ; la Chute de la manne dissipée par une Tempête de Vernet.
La chaise de paille reléguée dans l'antichambre par le fauteuil de maroquin.
Homère, Virgile, Horace, Cicéron, soulager le faible sapin courbé sous leur masse, et se renfermer dans une armoire marquetée, asile plus digne d'eux que de moi.
Une grande glace s'emparer du manteau de ma cheminée.
Ces deux jolis plâtres que je tenais de l'amitié de Falconet, et qu'il avait réparés lui-même, déménagés par une Vénus accroupie. L'argile moderne brisée par le bronze antique.
La table de bois disputait encore le terrain, à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle, et qui semblaient devoir la dérober longtemps à l'injure qui la menaçait. Un jour elle subit son sort et, en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allèrent se ranger dans les serres d'un bureau précieux.
Instinct funeste des convenances ! Tact délicat et ruineux, goût sublime qui change, qui déplace, qui édifie, qui renverse ; qui vide les coffres des pères ; qui laisse les filles sans dot, les fils sans éducation ; qui fait tant de belles choses et de si grands maux, toi qui substituas chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois ; c'est toi qui perds les nations ; c'est toi qui, peut-être, un jour, conduiras mes effets sur le pont Saint-Michel, où l'on entendra la voix enrouée d'un juré crieur dire : À vingt louis une Vénus accroupie.
L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la Tempête de Vernet, qui est au-dessus, faisait un vide désagréable à l'œil. Ce vide fut rempli par une pendule ; et quelle pendule encore ! une pendule à la Geoffrin, une pendule où l'or contraste avec le bronze.
Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire, qu'il obtint.
Autre vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut rempli par deux La Grenée.
Ici est une Magdeleine du même artiste ; là, c'est une esquisse ou de Vien ou de Machy ; car je donnai aussi dans les esquisses. Et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte aussi à la misère nationale.
De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisières. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe, je le sens. Mais j'ai juré et je jure, car les pieds de Denis le philosophe ne fouleront jamais un chef-d'œuvre de la Savonnerie, que je réserverai ce tapis, comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écarlate, j'entre dans mon cabinet, si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisières ; il me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur.
Non, mon ami, non : je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours au besoin qui s'adresse à moi ; il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le secours, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie ; ma tête ne s'est point relevée. Mon dos est bon et rond, comme ci-devant. C'est le même ton de franchise ; c'est la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date et le poison n'a point encore agi. Mais avec le temps, qui sait ce qui peut arriver? Qu'attendre de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père, et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle, une somme utile... »

1772 - "Fragments échappés du portefeuille d'un philosophe"
"Vous dites qu'il y a une morale universelle, et je veux bien en convenir ; mais cette morale universelle ne peut être l'effet d'une cause locale et particulière. Elle a été la même dans tous les temps passés, elle sera la même dans tous les siècles à venir ; elle ne peut donc avoir pour base les opinions religieuses, qui, depuis l'origine du monde, et d'un pôle à l'autre, ont toujours varié. Les Grecs ont eu des dieux méchants, les Romains ont eu des dieux méchants ; nous avons un Dieu bon ou méchant, selon la tète de celui qui y croit ; l'adorateur stupide du fétiche adore plutôt un diable qu'un dieu ; cependant ils ont tous eu les mêmes idées de la justice, de la bonté, de la commisération, de l'amitié, de la fidélité, de la reconnaissance, de l'ingratitude, de tous les vices, de toutes les vertus. Où chercherons-nous l'origine de cette unanimité de jugement si constante et si générale au milieu d'opinions contradictoires et passagères ? Où nous la chercherons ? Dans une cause physique, constante et éternelle. Et où est cette cause ? Elle est dans l'homme même, dans la similitude d'organisation d'un homme à un autre, similitude d'organisation qui entraine celle des mêmes besoins, des mêmes plaisirs, des mêmes peines, de la même force, de la même faiblesse ; source de la nécessité de la société, ou d'une lutte commune et concertée contre des dangers communs, et naissant au sein de la nature même qui menace l'homme de cent côtés différents. Voilà l'origine des liens particuliers et des vertus domestiques ; voilà l'origine des liens généraux et des vertus publiques ; voilà la source de la notion d'une utilité personnelle et publique ; voilà la source de tous les pactes individuels et de toutes les lois ; voilà la cause de la force de ces lois dans une nation pauvre et menacée ; voilà la cause de leur faiblesse dans une nation tranquille et opulente ; voilà la cause de leur presque nullité d'une nation à une autre.
Il semble que la nature ait posé une limite au bonheur et au malheur des espèces. On n'obtient rien que par l'industrie et par le travail, on n'a aucune jouissance douce qui n'ait été précédée par quelque peine ; tout ce qui est au delà des besoins physiques rigoureux ne mérite presque que le nom de fantaisie. Pour savoir si la condition de l'homme brut, abandonné au pur instinct animal, dont la journée employée à chasser, à se nourrir, à produire son semblable et à se reposer, est le modèle de toutes ses journées et de toute sa vie ; pour savoir, dis-je, si cette condition est meilleure ou pire que celle de cet être merveilleux qui trie le duvet pour se coucher, file le cocon du ver à soie pour se vêtir, a changé la caverne, sa première demeure, en un palais, a su multi- plier, varier ses commodités et ses besoins de mille manières différentes, il faudrait, à ce que je crois, trouver une mesure commune à ces deux conditions ; et il y en a une : c'est la durée...."
1772 - Diderot écrit un ensemble de textes consacrés au problème des rapports entre hommes et femmes, tant du point de vue moral que psychologique, ainsi dans le Supplément au voyage de Bougainville et dans deux contes, "Ceci n'est pas un conte", qui contient deux brèves histoires d'amours malheureuses, et "Madame de La Carlière", histoire d'amour tragique entre le chevalier Desroche, libertin avéré, et une jeune veuve, Mme de la Carlière, dont il tombe amoureux, qu'il épouse avec promesse de lui être pas infidèle, mais qu'il trompera avec toutes les conséquences que cela entraînera. Dans le Supplément au Voyage de Bougainville, Diderot entreprend la critique du mariage : le mariage est, selon lui, le cas-type, où les conventions sociales se sont superposées au fait naturel de l'attrait réciproque en vue de la procréation. Il condamne d'abord la subordination de la femme à l'homme, dont elle devient la propriété légale. Il condamne également l'indissolubilité du mariage, comme « contraire à la loi générale des êtres »....

1773 - Diderot, courtisan de Catherine II - Après Voltaire, Diderot se laisse prendre à son tour au mirage du despotisme éclairé. En 1765, l'impératrice de Russie, Catherine II, achète la bibliothèque de Diderot qui souhaite alors constituer une dot à sa fille. L'impératrice lui en laisse la jouissance et invite ainsi Diderot à Saint-Pétersbourg. Il entreprend ce long voyage en 1773, part le 21 mai 1773, s'arrête quelque temps à La Haye et va demeurer cinq mois à la cour de Russie, puis rentrer en France, après un nouveau séjour à La Haye, en octobre 1774. Il sera littéralement enchanté par son séjour, mais son imagination intarissable semble avoir impatienté plus d'une fois la souveraine. La Russie venait de démembrer la Suède, dépouiller la Turquie, et semblait vouloir travailler à quelque équilibre européen sans se soucier du roi de Prusse. Diderot aurait-il pu plaider la cause de son pays, ce que semblait attendre un duc d'Aiguillon, mais notre philosophe, tout à la joie exubérante de son séjour, avait le mal de son pays.
Diderot racontera dans une lettre à sa femme avoir été reçu soixante fois au moins par l'Impératrice pendant les cinq mois qu'il est resté à Pétersbourg, et à la famille Volland il écrit :
«La porte du cabinet de la souveraine m'est ouverte tous les jours, depuis trois heures de l'après-midi jusqu'à cinq, et quelquefois jusqu'à six. J'entre ; on me fait asseoir, et je cause avec la même liberté que vous m'accordez ; et en sortant, je suis forcé de m'avouer à moi-même que j'avais l'âme d'un esclave dans le pays qu'on appelle des hommes libres, et que je me suis trouvé l'âme d'un homme libre dans le pays qu'on appelle des esclaves. Ah ! mes amies, quelle souveraine ! quelle extraordinaire femme !,.. Sachez qu'il s'est fait trois miracles en ma faveur : le premier, quarante-cinq jours de beau temps de suite, pour aller ; le second, cinq mois de suite dans une cour, sans y donner prise à la malignité; et cela avec une franchise de caractère peu commune et qui prête au torquet des courtisans curieux et malins ; le troisième, trente jours de suite d'une saison dont on n'a pas d'exemple, pour revenir, sans autre accident que des voitures brisées : nous en avons changé quatre fois. » Mais, écrira Mme de Vandeul, «Le froid et les eaux de la Néva dérangèrent prodigieusement sa santé : je suis convaincue que ce voyage a abrégé sa vie.» ...
Diderot regagnera Paris au mois d'octobre 1774...

1773-1778 - "Paradoxe sur le comédien"
"L'acteur est las, et vous tristes; c'est qu'il s'est démené sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener." - Étonnant éveilleur des esprits, Diderot n'hésite jamais à s'opposer aux idées reçues. Son Paradoxe sur le comédien, qu'ont lu passionnément de grands acteurs et metteurs en scène comme Louis Jouvet, Jean Vilar et Jean-Louis Barrault, souligne l'écart qui existe entre le jeu théâtral et la vie réelle, et met en valeur la science et la lucidité de l'excellent acteur, artiste conscient et supérieur....
"Avant de dire : "Zaïre, vous pleurez!" ou "Vous y serez, ma fille", l'acteur s'est longtemps écouté lui-même; c 'est qu'il s 'écoute au moment où il vous trouble, et que tout son talent consiste non pas à sentir comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment, que vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire, et ont été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront; attendez-les à ce mot, à cette syllabe ni plus tôt ni plus tard. Ce tremblement de voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation, leçon recordée d'avance, grimace pathétique, singerie sublime dont l'acteur garde le souvenir longtemps après l'avoir étudiée, dont il avait la conscience présente au moment où il l'exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et pour lui, toute la liberté de son esprit, et qui ne lui ôte ainsi que les autres exercices, que la force du corps. Le socque ou le cothurne déposé, sa voix est éteinte, il éprouve une extrême fatigue, il va changer de linge ou se coucher; mais il ne lui reste ni trouble ni douleur, ni mélancolie ni affaissement d'âme. C'est vous qui remportez toutes ces impressions. L'acteur est las, et vous tristes; c'est qu'il s'est démené sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener. S'il en était autrement, la condition du comédien serait la plus malheureuse des conditions; mais il n'est pas le personnage, il le joue, et le joue si bien que vous le prenez pour tel : l'illusion n'est que pour vous; il sait bien, lui, qu'il ne l'est pas."

Il faut rappeler qu'en 1769 avait paru une brochure intitulée "Garrick ou les Acteurs Anglais", «ouvrage écrit d'un style obscur, entortillé, boursouflé et plein d'idées communes». Si mauvaise fût-elle, du moins offre-t-elle ce mérite d'avoir inspiré à Diderot les observations qu'il a données à la Correspondance de Grimm, et qui, développées, méditées, lui ont fourni le Paradoxe, écrit après 1772 et revu postérieurement. Diderot, qui connaissait beaucoup de comédiens et d'actrices particulièrement la fameuse Mademoiselle Clairon (1723-1803), qui de soubrette était devenue la gloire du théâtre français, une déesse aux pieds de laquelle on retrouvait le duc de Richelieu, l’écrivain Marmontel, le marquis de Ximénès, ou l’acteur Garric. Diderot entend accorder aux acteurs une part prépondérante dans le spectacle, discute ici le point de savoir ce qui constitue le génie de l'acteur. Au moyen de quelques anecdotes amusantes, mais comme toujours avec des considérations psycholo-physiologiques, il s'efforce d'établir que ce qu'il faut pour exceller sur la scène ce n'est pas la sensibilité naturelle mais, au contraire, un sang-froid qui va jusqu'à l'insensibilité. Paradoxe, en ce qu'il affirme qu'on exprimera d'autant mieux la passion qu'on sera plus complètement exempt de l'éprouver ; mais paradoxe de mots plutôt que d'idées. Sa thèse est que le rôle doit être minutieusement préparé, étudié dans ses moindres détails, et que les gestes, les intonations doivent être fixés dans la mémoire, avec autant de soin que les paroles mêmes des répliques. C'est ainsi que se rejoignent l'auteur et l'acteur, l'un comme l'autre, doivent rendre, non pas la réalité brute, mais la réalité idéale. Il faut admirer comment cette homme sensible critique la sensibilité ...
"Il est mille circonstances pour une où la sensibilité est aussi nuisible dans la société que sur la scène. Voilà deux amants, ils ont l'un et l'autre une déclaration à faire. Quel est celui qui s'en tirera le mieux ? Ce n'est pas moi. Je m'en souviens, je n'approchais de l'objet aimé qu'en tremblant ; le cœur me battait, mes idées se brouillaient ; ma voix s'embarrassait, j'estropiais tout ce que je disais ; je répondais non quand il fallait répondre oui ; je commettais mille gaucheries, des maladresses sans fin ; j'étais ridicule de la tête aux pieds, je m'en apercevais, je n'en étais que plus ridicule. Tandis que, sous mes yeux, un rival gai, plaisant et léger, se possédant, jouissant de lui-même, n'échappant aucune occasion de louer, et de louer finement, amusait, plaisait, était heureux ; il sollicitait une main qu'on lui abandonnait, il s'en saisissait quelquefois sans l'avoir sollicitée, il la baisait, il la baisait encore, et moi, retiré dans un coin, détournant mes regards d'un spectacle qui m'irritait, étouffant mes soupirs, faisant craquer mes doigts, accablé de mélancolie, couvert d'une sueur froide, je ne pouvais ni montrer ni celer mon chagrin. On a dit que l'amour, qui ôtait l'esprit à ceux qui en avaient, en donnait à ceux qui n'en avaient pas ; c'est-dire, en autre français, qu'il rendait les uns sensibles et; sots, et les autres froids et entreprenants...."
"C'est qu'être sensible est une chose, et sentir est une autre. L'une est une affaire d'âme, l'autre une affaire de jugement C'est qu'on sent avec force et qu'on ne saurait rendre ; c'est qu'on rend, seul, en société, au coin d'un foyer, en lisant, en jouant, pour quelques auditeurs, et qu'on ne rend rien qui vaille au théâtre ; c'est qu'au théâtre, avec ce qu'on appelle de la sensibilité, de l'âme, des entrailles, on rend bien une ou deux tirades et qu'on manque le reste ; c'est qu'embrasser toute l'étendue d'un grand rôle, y ménager les clairs et les obscurs, les doux et les faibles, se montrer égal dans les endroits tranquilles et dans les endroits agités, être varié dans les détails, harmonieux et un dans l'ensemble, et se former un système soutenu de déclamation qui aille jusqu'à sauver les boutades du poète, c'est l'ouvrage d'une tête froide, d'un profond jugement, d'un goût exquis, d'une étude pénible, d'une longue expérience et d'une ténacité de mémoire peu commune; c'est que la règle qualis ab incœpto processerit et sibi constet, très rigoureuse pour le poète, l'est jusqu'à la minutie pour le comédien ; c'est que celui qui sort de la coulisse sans avoir son jeu présent et son rôle noté éprouvera toute sa vie le rôle d'un débutant, ou que si, doué d'intrépidité, de suffisance et de verve, il compte sur la prestesse de sa tête et l'habitude du métier, cet homme vous en imposera par sa chaleur et son ivresse, et que vous applaudirez à son jeu comme un connaisseur en peinture sourit à une esquisse libertine où tout est indiqué et rien n'est décidé. C'est un de ces prodiges qu'on a vu quelquefois à la foire ou chez Nicolet. Peut-être ces fous-là font-ils bien de rester ce qu'ils sont, des comédiens ébauchés. Plus de travail ne leur donnerait pas ce qui leur manque et pourrait leur ôter ce qu'ils ont. Prenez- les pour ce qu'ils valent, mais ne les mettez pas à côté d'un tableau fini.."

1769 - "Entretien entre D'Alembert et Diderot"
L'Entretien, le premier des trois dialogues imaginaires qui composent le Rêve de d’Alembert : D'Alembert, mathématicien, entame le dialogue par un acte de foi en un Être suprême, auquel Diderot oppose un torrent d'éloquence sur la constitution de l'Univers et la génération des êtres, et avance l’hypothèse audacieuse, avancée par Diderot, d’un monde créé sans créateur, d’une « chaîne des êtres » constituée d’une même matière en mouvement, sensible et plurielle...
D'ALEMBERT. — J'avoue qu'un Être qui existe quelque part et qui ne correspond à aucun point de l'espace; un Etre qui est inétendu et qui occupe de l'étendue; qui est tout entier sous chaque partie de cette étendue; qui diffère essentiellement de la matière et qui lui est uni : qui la suit et qui la meut sans se mouvoir; qui agit sur elle et qui en subit toutes les vicissitudes ; un Etre dont je n'ai pas la moindre idée; un Etre d'une nature aussi contradictoire est difficile à admettre. Mais d'autres obscurités attendent celui qui le rejette; car enfin cette sensibilité que vous lui substituez, si c'est une qualité générale et essentielle de la matière, il faut que la pierre sente.
DIDEROT. — Pourquoi non ?
D’ALEMBERT. — Cela est dur à croire.
DIDEROT. — Oui, pour celui qui la coupe, la taille, la broie et qui ne l’entend pas crier.
D’ALEMBERT. — Je voudrais bien que vous me disiez quelle différence vous mettez entre l’homme et la statue, entre le marbre et la chair.
DIDEROT. — Assez peu. On fait du marbre avec de la chair, et de la chair avec du marbre.
D’ALEMBERT. — Mais l’un n’est pas l’autre.
DIDEROT. — Comme ce que vous appelez la force vive n’est pas la force morte.
D’ALEMBERT. — Je ne vous entends pas.
DIDEROT. — Je m’explique. Le transport d’un corps d’un lieu dans un autre n’est pas le mouvement, ce n’en est que l’effet. Le mouvement est également et dans le corps transféré et dans le corps immobile.
D’ALEMBERT. — Cette façon de voir est nouvelle.
DIDEROT. — Elle n’en est pas moins vraie. Ôtez l’obstacle qui s’oppose au transport local du corps immobile, et il sera transféré. Supprimez par une raréfaction subite l’air qui environne cet énorme tronc de chêne, et l’eau qu’il contient, entrant tout à coup en expansion, le dispersera en cent mille éclats. J’en dis autant de votre propre corps.
D’ALEMBERT. — Soit. Mais quel rapport y a-t-il entre le mouvement et la sensibilité ? Serait-ce par hasard que vous reconnaîtriez une sensibilité active et une sensibilité inerte, comme il y a une force vive et une force morte ? Une force vive qui se manifeste par la translation, une force morte qui se manifeste par la pression ; une sensibilité active qui se caractérise par certaines actions remarquables dans l’animal et peut-être dans la plante ; et une sensibilité inerte dont on serait assuré par le passage à l’état de sensibilité active.
DIDEROT. — À merveille. Vous l’avez dit.
D’ALEMBERT. — Ainsi la statue n’a qu’une sensibilité inerte ; et l’homme, l’animal, la plante même peut-être, sont doués d’une sensibilité active.
DIDEROT. — Il y a sans doute cette différence entre le bloc de marbre et le tissu de chair ; mais vous concevez bien que ce n’est pas la seule.
D’ALEMBERT. — Assurément. Quelque ressemblance qu’il y ait entre la forme extérieure de l’homme et de la statue, il n’y a point de rapport entre leur organisation intérieure. Le ciseau du plus habile statuaire ne fait pas même un épiderme. Mais il y a un procédé fort simple pour faire passer une force morte à l’état de force vive ; c’est une expérience qui se répète sous nos yeux cent fois par jour ; au lieu que je ne vois pas trop comment on fait passer un corps de l’état de sensibilité inerte à l’état de sensibilité active.
DIDEROT. — C’est que vous ne voulez pas le voir. C’est un phénomène aussi commun.
D’ALEMBERT. — Et ce phénomène aussi commun, quel est-il, s'il vous plaît?
DIDEROT. — Je vais vous le dire, puisque vous voulez en avoir la honte. Cela se fait toutes les fois que vous mangez.
D’ALEMBERT. — Toutes les fois que je mange!
DIDEROT. — Oui ; car en mangeant, que faites- vous? Vous levez les obstacles qui s'opposaient à la sensibilité active de l'aliment. Vous l'assimilez avec vous-même; vous en faites de la chair; vous l'animalisez ; vous le rendez sensible; et ce que vous exécutez sur un aliment, je l'exécuterai quand il me plaira sur le marbre.
D’ALEMBERT. — Et comment cela?
DIDEROT. — Comment? je le rendrai comestible.
D’ALEMBERT. — Rendre le marbre comestible, cela ne me paraît pas facile.
DIDEROT. — C'est mon affaire que de vous en indiquer le procédé. Je prends la statue que vous voyez, je la mets dans un mortier, et à grands coups de pilon...
D’ALEMBERT. — Doucement, s'il vous plaît : c'est le chef-d'œuvre de Falconet. Encore si c'était un morceau d'Huez ou d'un autre...
DIDEROT. — Cela ne fait rien à Falconet : la statue est payée, et Falconet fait peu de cas de la considération présente, aucun de la considération à venir.
D’ALEMBERT. — Allons, pulvérisez donc.
DIDEROT. — Lorsque le bloc de marbre est réduit en poudre impalpable, je mêle cette poudre à l'humus ou terre végétale; je les pétris bien ensemble; j'arrose le mélange, je le laisse putréfier un an, deux ans, un siècle, le temps ne me fait rien. Lorsque le tout s'est transformé en une matière à peu près homogène, en humus, savez-vous ce que je fais?
D’ALEMBERT. — Je suis sûr que vous ne mangez pas de l'humus.
DIDEROT. — Non, mais il y a un moyen d'union, d'appropriation, entre l'humus et moi, un latus, comme vous dirait le chimiste.
D’ALEMBERT. — Et ce latus c'est la plante.
DIDEROT. — Fort bien. J'y sème des pois, des fèves, des choux, d'autres plantes légumineuses. Les plantes se nourrissent de la terre, et je me nourris des plantes.
D’ALEMBERT. — Vrai ou faux, j'aime ce passage du marbre à l'humus, de l'humus au règne végétal, et du règne végétal au règne animal, à la chair.
DIDEROT. — Je fais donc de la chair ou de l'âme, comme dit ma fille, une matière activement sensible; et si je ne résous pas le problème que vous m'avez proposé, du moins j'en approche beaucoup; car vous m'avouerez qu'il y a bien plus loin d'un morceau de marbre à un être qui sent, que d'un être qui sent à un être qui pense.
D’ALEMBERT. — J'en conviens. Avec tout cela l'être sensible n'est pas encore l'être pensant.
DIDEROT. — Avant que de faire un pas en avant, permettez-moi de vous faire l'histoire d'un des plus grands géomètres de l'Europe. Qu'était-ce d'abord que cet être merveilleux? Rien.
D’ALEMBERT. — Comment rien ! On ne fait rien de rien.
DIDEROT, — Vous prenez les mots trop à la lettre. Je veux dire qu'avant que sa mère, la belle et scélérate chanoinesse Tencin, eût atteint l'âge de puberté, avant que le militaire La Touche fût adolescent, les molécules qui devaient former les premiers rudiments de mon géomètre étaient éparses dans les jeunes et frôles machines de l'un et de l'autre, se filtrèrent avec la lymphe, circulèrent avec le sang, jusqu'à ce qu'enfin elles se rendissent dans les réservoirs destinés à leur coalition, les testicules de son père et de sa mère. Voilà ce germe rare formé ; le voilà, comme c'est l'opinion commune, amené par les trompes de Fallope dans la matrice ; le voilà attaché à la matrice par un long pédicule; le voilà, s'accroissant successivement et s'avançant à l'état de fœtus; voilà le moment de sa sortie de l'obscure prison arrivé ; le voilà né, exposé sur les degrés de Saint-Jean-le-Rond qui lui donna son nom ; tiré des Enfants-Trouvés; attaché à la mamelle de la bonne vitrière, madame Rousseau; allaité, devenu grand de corps et d'esprit, littérateur, mécanicien, géomètre. Comment cela s'est-il fait? En mangeant et par d'autres opérations purement mécaniques. Voici en quatre mots la formule générale : Mangez, digérez, distillez in vasi licito, et fiat homo secundum artem. Et ce- lui qui exposerait à l'Académie le progrès de la formation d'un homme ou d'un animal, n'emploierait que des agents matériels dont les effets successifs seraient un être inerte, un être sentant, un être pensant, un être résolvant le problème de la précession des équinoxes, un être sublime, un être merveilleux, un être vieillissant, dépérissant, mourant, dissous et rendu à la terre végétale.
D’ALEMBERT. — Vous ne croyez donc pas aux germes préexistants?
DIDEROT. — Non,
D’ALEMBERT. — Ah ! que vous me faites plaisir!
DIDEROT. — Cela est contre l'expérience et la raison : contre l'expérience qui chercherait inutilement ces germes dans l'œuf et dans la plupart des animaux avant un certain âge: contre la raison qui nous apprend que la divisibilité de la matière a un terme dans la nature, quoiqu'elle n'en ait aucun dans l'entendement, et qui répugne à concevoir un éléphant tout formé dans un atome et dans cet atome un autre éléphant tout formé, et ainsi de suite à l'infini.
D’ALEMBERT. — Mais sans ces germes préexistants, la génération première des animaux ne se conçoit pas.
DIDEROT. — Si la question de la priorité de l'œuf sur la poule ou de la poule sur l'œuf vous embarrasse, c'est que vous supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils sont à présent. Quelle folie ! On ne sait non plus ce qu'ils ont été qu'on ne sait ce qu'ils deviendront. Le vermisseau imperceptible qui s'agite dans la fange, s'achemine peut-être à l'état de grand animal; l'animal énorme, qui nous épouvante par sa grandeur, s'achemine peut-être à l'état de vermisseau, est peut-être une production particulière momentanée de cette planète.
D’ALEMBERT. — Comment avez-vous dit cela?
DIDEROT. — Je vous disais... Mais cela va nous écarter de notre première discussion.
D’ALEMBERT. — Qu'est-ce que cela fait? Nous y reviendrons ou nous n'y reviendrons pas.
DIDEROT. — Me permettriez-vous d'anticiper de quelques milliers d'années sur les temps?
D’ALEMBERT. — Pourquoi non? Le temps n'est rien pour la nature.
DIDEROT. — Vous consentez donc que j'éteigne notre soleil?
D’ALEMBERT. — D'autant plus volontiers que ce ne sera pas le premier qui se soit éteint...."
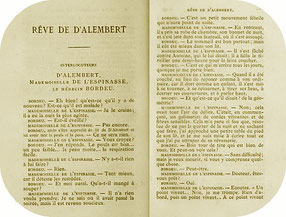
1769 - "Le Rêve de d’Alembert"
C'est dans l'Interprétation de la Nature, dans les Principe sur la matière et le mouvement, dans la Réception d'un philosophe, et surtout dans le Rêve de d'Alembert qu'il faut chercher ces vues de génie par où Diderot est notre contemporain. Trois ouvrages, l'Entretien, Le Rêve et la Suite de l'Entretien. "Le Rêve de d’Alembert" est un Dialogue philosophique qui suit "l’Entretien entre d’Alembert et Diderot" et dans lequel Diderot met en scène son ancien collaborateur encyclopédiste, Jean Le Rond d’Alembert, Julie de Lespinasse, femme des Lumières érudite et passionnée et un médecin du nom de Bordeu. Les conversations tournent autour de l’origine matérielle de l’univers lui permettant d'exposer sa théorie développée du matérialisme athée : selon lui, le monde est une unité de matière, un tout sensible qui évolue seul, dans lequel l'être humain n’est que le fruit de l’une de ces évolutions. La nature est un tout dont les différents composants minéral, végétal, animal, animal pensant, sont interdépendants, animés d'un même dynamisme qui est celui de la matière éternelle, principe premier. C'est un dialogue qui parfois entre dans une sorte de vertige intellectuel, de lyrisme scientifique original et suggestif...
Le début du Dialogue est extraordinaire. D'Alembert, après son Entretien avec Diderot, est rentré fort tard, sa nuit fut agitée et peuplée de cauchemars, Mlle de l'Espinasse est restée à son chevet, noté ses propos et les soumet au docteur Bordeu, sans doute un homme qui connaît bien les théories de Diderot...
BORDEU. — Eh bien! qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce qu'il est malade?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Je le crains ; il a eu la nuit la plus agitée.
BORDEU. — Est-il éveillé?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. Pas encore.
BORDEU, après s'être approché du lit de D'Alembert et de lui avoir tâté le pouls et la peau. — Ce ne sera rien.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. Vous croyez ?
BORDEU- — J'en réponds. Le pouls est bon... un peu faible... la peau moite... la respiration facile.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — N'y a-t-il rien à lui faire?
BORDEU. — Rien.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Tant mieux, car il déteste les remèdes.
BORDEU. — Et moi aussi. Qu'a-t-il mangé à souper?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Il n'a rien voulu prendre. Je ne sais où il avait passé la soirée, mais il est revenu soucieux.
BORDEU. — C'est un petit mouvement fébrile qui n'aura point de suite.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — En rentrant, il a pris sa robe de chambre, son bonnet de nuit, et s'est jeté dans son fauteuil, où il s'est assoupi.
BORDEU. — Le sommeil est bon partout; mais il eût été mieux dans son lit.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Il s'est fâché contre Antoine, qui le lui disait; il a fallu le tirailler une demi-heure pour le faire coucher.
BORDEU. — C'est ce qui m'arrive tous les jours, quoique je me porte bien.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Quand il a été couché, au lieu de reposer comme à son ordinaire, car il dort comme un enfant, il s'est mis à se tourner, à se retourner, à tirer ses bras, à écarter ses couvertures, et à parler haut.
BORDEU. — Et qu'est-ce qu'il disait? de la géométrie?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Non; cela avait tout l'air du délire. C'était, en commençant, un galimatias de cordes vibrantes et de fibres sensibles. Cela m'a paru si fou que, résolue de ne pas le quitter de la nuit et ne sachant que faire, j'ai approché une petite table du pied de son lit, et je me suis mise à écrire tout ce que j'ai pu attraper de sa rêvasserie.
BORDEU. — Bon tour de tête qui est bien de vous. Et peut-on voir cela?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Sans difficulté ; mais je veux mourir, si vous y comprenez quelque chose.
BORDEU. — Peut-être.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Docteur, êtes- vous prêt?
BORDEU. — Oui.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Ecoutez. «Un point vivant... Non, je me trompe. Rien d'abord, puis un point vivant... A ce point vivant il s'en applique un autre, encore un autre ; et par ces applications successives il résulte un être un, car je suis bien un, je n'en saurais douter... (En disant cela, il se tâtait partout.) Mais comment cette unité s'est-elle faite? (Eh! mon ami. lui ai-je dit, qu'est-ce que cela vous fait? dormez..- Il s'est tu. Après un moment de silence, il a repris comme s'il s'adressait à quelqu'un :). Tenez, philosophe, je vois bien un agrégat, un tissu de petits êtres sensibles, mais un animal!... un tout! un système un, lui, ayant la conscience de son unité ! Je ne le vois pas, non, je ne le vois pas...» Docteur, y entendez-vous quelque chose?
BORDEU. — A merveille.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Vous êtes bien heureux... « Ma difficulté vient peut-être d'une fausse idée. »
BORDEU. — Est-ce vous qui parlez?
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. - Non, c'est le rêveur. Je continue... Il a ajouté, en s'apostrophant lui-même : « Mon ami D'Alembert, prenez-y garde, vous ne supposez que de la contiguïté ou il y a continuité... Oui, il est assez malin pour me dire cela... Et la formation de cette continuité? Elle ne l'embarrassera guère... Comme une goutte de mercure se fond dans une autre goutte de mercure, une molécule sensible et vivante se fond dans une molécule sensible et vivante... D'abord il y avait deux gouttes, après le contact il n'y en a plus qu'une... "
Tandis que d'Alembert sort lentement de son sommeil, une nouvelle discussion s`engage entre le docteur et Mlle de 'Espinasse, l'être humain est comme un ensemble de micro-organismes, une association provisoire dans laquelle les organes ont tous une certaine autonomie, même dans leur commune dépendance vis-à-vis du système nerveux. Suivent de singulières considérations sur les monstres et les causes de leur difformité, sur les ressemblances anatomiques profondes qui existent entre l'homme et la femme, sur la physiologie nerveuse et la sensation. Des pages remplies d'observations et d'hypothèses fortes et audacieuses...
Ainsi Diderot semble anticiper l'idée de la transformation des espèces que les travaux de Lamarck (1744-1829) et de Darwin (1809-1882) généraliseront quelques années plus tard...
"Qui sait si la fermentation et ses produits sont épuisés? Qui sait à quel instant de la succession de ces générations animales nous en sommes? Qui sait si ce bipède déformé, qui n'a que quatre pieds de hauteur, qu'on appelle encore dans le voisinage du pôle un homme, et qui ne tarderait pas à perdre ce nom en se déformant un peu davantage, n'est pas l'image d'une espèce qui passe ? Qui sait s'il n'en est pas ainsi de toutes les espèces d'animaux? Qui sait si tout ne tend pas à se réduire à un grand sédiment inerte et immobile? Qui sait quelle sera la durée de cette inertie? Qui sait quelle race nouvelle peut résulter derechef d'un amas aussi grand de points sensibles et vivants? Pourquoi pas un seul animal? Qu'était l'éléphant dans son origine? Peut-être l'animal énorme tel qu'il nous paraît, peut-être un atome, car tous les deux sont également possibles ; ils ne supposent que le mouvement et les propriétés diverses de la matière... L'éléphant, cette masse énorme, organisée, le produit subit de la fermentation ! Pourquoi non? Le rapport de ce grand quadrupède à sa matrice première est moindre que celui du vermisseau à la molécule de farine qui l'a produit ; mais le vermisseau n'est qu'un vermisseau... C'est-à-dire que la petitesse qui vous dérobe son organisation lui ôte le merveilleux...
Le prodige, c'est la vie, c'est la sensibilité ; et ce prodige n'en est plus un... Lorsque j'ai vu la matière inerte passer à l'état sensible, rien ne doit plus m'étonner. Quelle comparaison d'un petit nombre d'éléments mis en fermentation dans le creux de ma main, et de ce réservoir immense d'éléments divers épars dans les entrailles de la terre, à sa surface, au sein des mers, dans le vague des airs !... Cependant, puisque les mêmes causes subsistent, pourquoi les effets ont-ils cessé? Pourquoi ne voyons-nous plus le taureau percer la terre de sa corne, appuyer ses pieds contre le sol, et faire effort pour en dégager son corps pesant?... Laissez passer la race présente des animaux subsistants ; laissez agir le grand sédiment inerte quelques millions de siècles. Peut-être faut-il, pour renouveler les espèces, dix fois plus de temps qu'il n'en est accordé à leur durée. Attendez, et ne vous hâtez pas de prononcer sur le grand travail de la nature. Vous avez deux grands phénomènes, le passage de l'état d'inertie à l'état de sensibilité, et les générations spontanées ; qu'ils vous suffisent : tirez-en de justes conséquences, et dans un ordre de choses où il n'y a ni grand ni petit, ni durable ni passager absolus, garantissez-vous du sophisme de l'éphémère...."
"Toute chose est plus ou moins une chose quelconque, plus ou moins terre, plus ou moins eau..." pour D'Alembert-Diderot, tous les êtres sont soumis au déterminisme universel, toutes les espèces se transforment, il y a parfaite continuité entre le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et l'être humain, et tout être n'est qu'une parcelle du grand tout...
"Tous les êtres circulent les uns dans les autres, par conséquent toutes les espèces... tout est en un flux perpétuel... Tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins plante ; toute plante est plus ou moins animal. Il n'y a rien de précis en nature... Le ruban du père Castel... Oui, père Castel, c'est votre ruban et ce n'est que cela. Toute chose est plus ou moins une chose quelconque, plus ou moins terre, plus ou moins eau, plus ou moins air, plus ou moins feu; plus ou moins d'un règne ou d'un autre...donc rien n'est de l'essence d'un être particulier... Non, sans doute, puisqu'il n'y a aucune qualité dont aucun être ne soit participant... et que c'est le rapport plus ou moins grand de cette qualité qui nous la fait attribuer à un être exclusivement à un autre... Et vous parlez d'individus, pauvres philosophes ! laissez-là vos individus ; répondez-moi. Y a-t-il un atome en nature rigoureusement semblable à un autre atome ?... Non... ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu'il est impossible qu'il y ait un vide dans la chaîne? Que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n'y en a point, non, il n'y en a point... Il n'y a qu'un seul grand individu, c'est le tout.
Dans ce tout comme dans une machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle; mais quand vous donnerez le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un concept aussi faux que si, dans un oiseau, vous donniez le nom d'individu à l'aile, à une plume de l'aile... Et vous parlez d'essences, pauvres philosophes! laissez là vos essences. Voyez la masse générale, ou si, pour l'embrasser, vous avez l'imagination trop étroite, voyez votre première origine et votre fin dernière..."
Diderot laissant libre-cours à son imagination scientifique et philosophique parvient aux limites d'un pensable de notre condition humaine dans le quel les idées de libre arbitre. de responsabilité, de mérite et de faute, la vertu et le vice ne sont plus que des noms donnés aux suites de certains états physiologiques...
"MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Un moment, docteur : récapitulons. D'après vos principes, il me semble que, par une suite d'opérations purement mécaniques, je réduirais le premier génie de la terre à une masse de chair inorganisée, à laquelle on ne laisserait que la sensibilité du moment, et que l'on ramènerait cette masse informe de l'état de stupidité le plus profond qu'on puisse imaginer à la condition de l'homme de génie. L'un de ces deux phénomènes consisterait à mutiler l'écheveau primitif d'un certain nombre de ses brins, et à bien brouiller le reste; et le phénomène inverse, à restituer à l'écheveau les brins qu'on en aurait détachés, et à abandonner le tout à un heureux développement. Exemple : j'ôte à Newton les deux brins auditifs, et plus de sensations de sons; les brins olfactifs, et plus de sensations d'odeurs; les brins optiques, et plus de sensations de couleurs ; les brins palatins, et plus de sensations de saveurs; je supprime ou brouille les autres, et adieu l'organisation du cerveau, la mémoire, le jugement, les désirs, les aversions, les passions, la volonté, la conscience du soi: et voilà une masse informe qui n'a retenu que la vie et la sensibilité.
BORDEU. — Deux qualités presque identiques ; la vie est de l'agrégat, la sensibilité est de l'élément.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. — Je reprends cette masse et je lui restitue les brins olfactifs, elle flaire ; les brins auditifs, et elle entend ; les brins optiques, et elle voit: les brins palatins, et elle goûte. En démêlant le reste de l'écheveau, je permets aux autres brins de se développer, et je vois renaître la mémoire, les comparaisons, le jugement, la raison, les désirs, les aversions, les passions, l'aptitude naturelle, le talent, et je retrouve mon homme de génie, et cela sans l'entremise d'aucun agent hétérogène et inintelligible.
BORDEU. — A merveille : tenez-vous-en là, le reste n'est que du galimatias... Mais les abstractions ? mais l'imagination? L'imagination, c'est la mémoire des formes et des couleurs. Le spectacle d'une scène, d'un objet, monte nécessairement l'instrument sensible d'une certaine manière; il se remonte, ou de lui-même, ou il est remonté par quelque cause étrangère. Alors il frémit au dedans ou il résonne au dehors ; il se recorde en silence les impressions qu'il a reçues, ou il les fait éclater par des sons convenus.
D'ALEMBERT. — Mais son récit exagère, omet des circonstances, en ajoute, défigure le fait ou rembellit, et les instruments sensibles adjacents conçoivent des impressions qui sont bien celles de l'instrument qui résonne, mais non celles de la chose qui s'est passée.
BORDEU. — Il est vrai, le récit est historique ou poétique.
D'ALEMBERT. — Mais comment s'introduit cette poésie ou ce mensonge dans le récit?
BORDEU. — Par les idées qui se réveillent les unes les autres, et elles se réveillent parce qu'elles ont toujours été liées. Si vous avez pris la liberté de comparer l'animal à un clavecin, vous me permettrez bien de comparer le récit du poète au chant.
D'ALEMBERT — Cela est juste.
BORDEU. — Il y a dans tout chant une gamme. Cette gamme a ses intervalles; chacune de ses cordes a ses harmoniques, et ces harmoniques ont les leurs. C'est ainsi qu'il s'introduit des modulations de passage dans la mélodie, et que le chant s'enrichit et s'étend. Le fait est un motif donné que chaque musicien sent à sa guise.
MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. Et pourquoi embrouiller la question par ce style figuré? Je dirais que, chacun ayant ses yeux, chacun voit et raconte diversement. Je dirais que chaque idée en réveille d'autres, et que, selon son tour de tête ou son caractère, on s'en tient aux idées qui représentent le fait rigoureusement, ou l'on y introduit les idées réveillées; je dirais qu'entre ces idées il y a du choix; je dirais... que ce seul sujet traité a fond fournirait un livre.
D'ALEMBERT. — Vous avez raison..."

1773 - "Entretien d'un père avec ses enfants, ou Du danger de se mettre au-dessus des lois"
Dialogue conçu lors d'une visite de Diderot à la maison paternelle de Langres dans lequel il met en scène son père, homme d'une droiture scrupuleuse, sa soeur, son frère prêtre et lui-même. Un soir le père confie à ses enfants un épisode de sa vie qui le tourmenta. A mort du curé de Thivet, le narrateur avait dû être l'arbitre de sa succession, une succession qui devait échoir à ses parents, très pauvres, mais un testament autographe était en faveur d'un riche commerçant parisien. Ce dernier semblait très ancien sans doute caduque, fallait-il le brûler, la question prend de la hauteur au fil des échanges, la raison de l'espèce humaine n'est-elle pas plus sacrée que celle du législateur?...
Mais ce que l'on peut retenir des premiers passages de cet Entretien c'est la technique de Diderot, la manière avec laquelle il nous entraîne dans sa vision philosophique et morale en nous donnant, par d'infimes détails réalistes, l'illusion de la vérité ...
"C'était en hiver. Nous étions assis autour de lui, devant le feu, l'abbé, ma sœur et moi. Il me disait, à la suite d'une conversation sur les inconvénients de la célébrité : « Mon fils, nous avons fait tous les deux du bruit dans le monde, avec cette différence que le bruit que vous faisiez avec votre outil vous ôtait le repos et que celui que je faisais avec le mien ôtait le repos aux autres. » Après cette plaisanterie, bonne ou mauvaise, du vieux forgeron, il se mit à rêver, à nous regarder avec une attention tout à fait marquée, et l'abbé lui dit : « Mon père, à quoi rêvez-vous?
— Je rêve, lui répondit-il, que la réputation d'homme de bien, la plus désirable de toutes, a
ses périls, même pour celui qui la mérite.» Puis, après une courte pause, il ajouta : « J'en frémis encore quand j'y pense... Le croiriez-vous, mes enfants? Une fois dans ma vie, j'ai été sur le point de vous ruiner ; oui, de vous ruiner de fond en comble.
L'abbé. — Et comment cela?
MON PÈRE. — Comment? Le voici...
Avant que je commence (dit-il à sa fille), sœurette, relève mon oreiller qui est descendu trop
bas; (à moi) et toi, ferme les pans de ma robe de chambre, car le feu me brûle les jambes...
Vous avez tous connu le curé de Thivet ?
MA SŒUR. — Ce bon vieux prêtre, qui, à l'âge de cent ans, faisait ses quatre lieues dans la matinée?
L'abbé. — Qui s'éteignit à cent et un ans. en apprenant la mort d'un frère qui demeurait avec lui, et qui en avait quatre-vingt-dix-neuf?
MON PÈRE. — Lui-même.
L'abbé. — Eh bien?
MON PÈRE. - Eh bien, ses héritiers, gens pauvres et dispersés sur les grands chemins, dans
les campagnes, aux portes des églises où ils mendiaient leur vie, m'envoyèrent une procuration qui m'autorisait à me transporter sur les lieux, et à pourvoir à la sûreté des effets du défunt curé leur parent. Comment refuser à des indigents un service que j'avais rendu à plusieurs familles opulentes? J'allai à Thivet..."

1776 - "Entretien d’un philosophe avec la Maréchale de ...."
Profession de foi matérialiste dont l'interlocutrice est la femme du maréchal de Broglie, qui commanda l'armée des émigrés en 1792. Elle joue le rôle d'une femme du monde, dévote mais éclairée, face à laquelle Diderot-Crudeli va lui démontrer la faiblesse des arguments sur lesquels s'appuie sa foi en l'existence de Dieu et en la Providence. La clarté de cet entretien fit son succès.
"J'avais je ne sais quelle affaire à traiter avec le maréchal de *** ; j'allai à son hôtel, un matin ; il était absent : je me fis annoncera madame la maréchale. C'est une femme charmante ; elle est belle et dévote comme un ange ; elle a la douceur peinte sur son visage ; et puis, un son de voix et une naïveté de discours tout à fait avenants à sa physionomie. Elle était à sa toilette. On m'approche un fauteuil ; je m'assieds, et nous causons. Sur quelques propos de ma part, qui l'édifièrent et qui la surprirent (car elle était dans l'opinion que celui qui nie la très sainte Trinité est un homme de sac et de corde, qui finira par être pendu), elle me dit :
N'êtes- vous pas monsieur Crudeli ?
CRUDELI - Oui, madame.
LA MARÉCHALE - C'est donc vous qui ne croyez rien?
CRUDELI - Moi-même .
LA MARÉCHALE Cependant votre morale est d'un croyant.
CRUDELI - Pourquoi non, quand il est honnête homme ?
LA MARÉCHALE - Et cette morale-là, vous la pratiquez?
CRUDELI - De mon mieux.
LA MARÉCHALE - Quoi ! vous ne volez point, vous ne tuez point, vous ne pillez point ?
CRUDELI - Très rarement.
LA MARECHALE - Que gagnez-vous donc à ne pas croire ?
CRUDELI - Rien du tout, madame la maréchale. Est-ce qu'on croit, parce qu'il y a quelque chose à gagner ?
LA MARÉCHALE - Je ne sais ; mais la raison d'intérêt ne gâte rien aux affaires de ce monde ni de l'autre.
CRUDELI - J'en suis un peu fâché pour notre pauvre espèce humaine. Nous n'en valons pas mieux.
LA MARÉCHALE - Quoi ! vous ne volez point ?
CRUDELI - Non, d'honneur.
LA MARÉCHALE - Si vous n'êtes ni voleur ni assassin, convenez du moins que vous n'êtes pas conséquent.
CRUDELI - Pourquoi donc ?
LA MARÉCHALE - C'est qu'il me semble que si je n'avais rien à espérer ni à craindre, quand je n'y serai plus, il y a bien de petites douceurs dont je ne me priverais pas, à présent que j'y suis. J'avoue que je prête à Dieu à la petite semaine.
CRUDELI - Vous l'imaginez ?
LA MARÉCHALE - Ce n'est point une imagination, c'est un fait.
CRUDELI - Et pourrait-on vous demander quelles sont ces choses que vous vous permettriez, si vous étiez incrédule?
LA MARÉCHALE - Non pas, s'il vous plait ; c'est un article de ma confession.
CRUDELI - Pour moi, je mets à fonds perdu.
LA MARÉCHALE - C'est la ressource des gueux.
CRUDELI - M'aimeriez-vous mieux usurier ?
LA MARECHALE - Mais oui : on peut faire l'usure avec Dieu tant qu'on veut; on ne le ruine pas. Je sais bien que cela n'est pas délicat, mais qu'importe ? Comme le point est d'attraper le ciel, ou d'adresse ou de force, il faut tout porter en ligne de compte, ne négliger aucun profit. Hélas ! nous aurons beau faire, notre mise sera toujours bien mesquine en comparaison de la rentrée que nous attendons. Et vous n'attendez rien, vous?
CRUDELI - Rien.
LA MARÉCHALE - Cela est triste. Convenez donc que vous êtes bien méchant ou bien fou !
CRUDELI - En vérité, je ne saurais, madame la maréchale.
LA MARÉCHALE - Quel motif peut avoir un incrédule d'être bon, s'il n'est pas fou ? Je voudrais bien le savoir.
CRUDELI - Et je vais vous le dire.
LA MARÉCHALE - Vous m'obligerez.
CRUDELI - Ne pensez-vous pas qu'on peut être si heureusement né, qu'on trouve un grand plaisir à faire le bien ?
LA MARÉCHALE - Je le pense.
CRUDELI - Qu'on peut avoir reçu une excellente éducation, qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance?
LA MARÉCHALE - Assurément.
CRUDELI - Et que, dans un âge plus avancé, l'expérience nous ait con- vaincus, qu'à tout prendre, il vaut mieux, pour son bonheur dans ce monde, être un honnête homme qu'un coquin ?
LA MARÉCHALE - Oui-da ; mais comment est-on honnête homme, lorsque de mauvais principes se joignent aux passions pour entraîner au mal ?
CRUDELI - On est inconséquent : et y a-t-il rien de plus commun que d'être inconséquent !
LA MARÉCHALE - Hélas ! malheureusement, non : on croit, et tous les jours on se conduit comme si on ne croyait pas.
CRUDELI - Et sans croire, on se conduit à peu près comme si l'on croyait.
LA MARÉCHALE - A la bonne heure ; mais quel inconvénient y aurait-il à avoir une raison de plus, la religion, pour faire le bien, et une raison de moins, l'incrédulité, pour mal faire?
CRUDELI - Aucun, si la religion était un motif de faire le bien, et l'in- crédulité un motif de faire le mal.
LA MARÉCHALE - Est-ce qu'il y a quelque doute là-dessus? Est-ce que l'es- prit de religion n'est pas de contrarier cette vilaine nature corrompue ; et celui de l'incrédulité, de l'abandonner à sa malice, en l'affranchissant de la crainte ?
CRUDELI - Ceci, madame la maréchale, va nous jeter dans une longue discussion.
LA MARÉCHALE - Qu'est-ce que cela fait ? Le maréchal ne rentrera pas sitôt ; et il vaut mieux que nous parlions raison, que de médire de notre prochain.
CRUDELI - Il faudra que je reprenne les choses d'un peu haut.
LA MARÉCHALE - De si haut que vous voudrez, pourvu que je vous entende.
CRUDELI - Si vous ne m'entendiez pas, ce serait bien ma faute.
LA MARÉCHALE - Cela est poli ; mais il faut que vous sachiez que je n'ai jamais lu que mes heures, et que je ne me suis guère occupée qu'à pratiquer l'Évangile et à faire des enfants.
CRUDELI - Ce sont deux devoirs dont vous vous êtes bien acquittée.
LA MARÉCHALE - Oui, pour les enfants ; vous en avez trouvé six autour de moi, et dans quelques jours vous en pourriez voir un de plus sur mes genoux : mais commencez .
CRUDELI - Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien dans ce monde- ci, qui soit sans inconvénient ?
LA MARÉCHALE - Aucun.
CRUDELI - Et quelque mal qui soit sans avantage ?
LA MARÉCHALE - Aucun.
CRUDELI - Qu'appelez- vous donc mal ou bien ?
LA MARÉCHALE - Le mal, ce sera ce qui a plus d'inconvénients que d'avantages ; et le bien, au contraire, ce qui a plus d'avantages que d'inconvénients.
CRUDELI - Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de se souvenir de sa définition du bien et du mal ?
LA MARÉCHALE - Je m'en souviendrai. Vous appelez cela une définition ?
CRUDELI - Oui.
LA MARECHALE - C'est donc de la philosophie ?
CRUDELI - Excellente.
LA MARECHALE - Et j'ai fait de la philosophie !
CRUDELI - Ainsi, vous êtes persuadée que la religion a plus d'avantages que d'inconvénients; c'est pour cela que vous l'appelez un bien ?
LA MARÉCHALE - Oui,
CRUDELI - Pour moi, je ne doute point que votre intendant ne vous vole un peu moins la veille de Pâques que le lendemain des fêtes ; et que de temps en temps la religion n'empêche nombre de petits maux et ne produise nombre de petits biens.
LA MARÉCHALE - Petit à petit, cela fait somme.
CRUDELI - Mais croyez-vous que les terribles ravages qu'elle a causés dans les temps passés, et qu'elle causera dans les temps à venir, soient suffisamment compensés par ces guenilleux avantages-là? Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les nations. Il n'y a pas un musulman qui n'imaginât faire une action agréable à Dieu et au saint Prophète, en exterminant tous les chrétiens, qui, de leur côté, ne sont guère plus tolérants. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans une même contrée, des divisions qui se sont rarement éteintes sans effusion de sang. Notre histoire ne nous en offre que de trop récents et de trop funestes exemples. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la société entre les citoyens, et dans la famille entre les proches, les haines les plus fortes et les plus constantes. Le Christ a dit qu'il était venu pour séparer l'époux de la femme, la mère de ses enfants, le frère de la sœur, l'ami de l'ami ; et sa prédiction ne s'est que trop fidèlement accomplie.
LA MARÉCHALE - Voilà bien les abus ; mais ce n'est pas la chose.
CRUDELI - C'est la chose, si les abus en sont inséparables.
LA MARÉCHALE - Et comment me montrerez-vous que les abus de la religion sont inséparables de la religion ?
CRUDELI - Très aisément : dites-moi, si un misanthrope s'était proposé de faire le malheur du genre humain, qu'aurait-il pu inventer de mieux que la croyance en un être incompréhensible sur lequel les hommes n'auraient jamais pu s'entendre, et auquel ils auraient attaché plus d'importance qu'à leur vie ? Or, est-il possible de séparer de la notion d'une divinité l'incompréhensibilité la plus profonde et l'importance la plus grande ?
LA MARÉCHALE - Non.
CRUDELI - Concluez donc.
LA MARÉCHALE - Je conclus que c'est une idée qui n'est pas sans conséquence dans la tète des fous......"

"... Qu'il est impossible d'assujettir un peuple à une règle qui ne convient qu'à quelques hommes mélancoliques, qui l'ont calquée sur leur caractère. Il en est des religions comme des institutions monastiques, qui toutes se relâchent avec le temps..."
CRUDELI. - Mais, Madame la maréchale, est-ce qu'il y a des chrétiens? Je n'en ai jamais vu.
LA MARÉCHALE. - Et c'est à moi que vous dites cela, à moi?
CRUDELI. - Non, Madame, ce n'est pas à vous; c'est à une de mes voisines qui est honnête et pieuse comme vous l'êtes, et qui se croyoit chrétienne de la meilleure foi du monde, comme vous, vous le croyez.
LA MARÉCHALE. - Et vous lui fîtes voir qu'elle avoit tort ?
CRUDELI. - Et en un instant.
LA MARÉCHALE. - Comment vous y prîtes-vous ?
CRUDELI. - J'ouvris un Nouveau Testament, dont elle s'étoit beaucoup servie, car il étoit fort usé. Je lui lus le sermon sur la montagne, et à chaque article je lui demandai : Faites-vous cela ? et cela donc ? et cela encore? J'allai plus loin. Elle est belle, et quoiqu'elle soit très-dévote, elle ne l'ignore pas; elle a la peau très blanche, et quoiqu'elle n'attache pas un grand prix à ce frêle avantage, elle n'est pas fâchée qu'on en fasse l'éloge ; elle a la gorge aussi bien qu'il soit possible de l'avoir, et quoiqu'elle soit très-modeste, elle trouve bon qu'on s'en aperçoive.
LA MARÉCHALE. - Pourvu qu'il n'y ait qu'elle et son mari qui le sachent.
CRUDELI. - Je crois que son mari le sait mieux qu'un autre; mais pour une femme qui se pique de grand christianisme, cela ne suffît pas. Je lui dis : N'est-il pas écrit dans l'Evangile que celui qui a convoité la femme de son prochain a commis l'adultère dans son cœur?
LA MARÉCHALE. - Elle vous répondit qu'oui ?
CRUDELI. - Je lui dis : Et l'adultère commis dans le cœur ne condamne-t-il pas aussi sûrement qu'un adultère mieux conditionné?
LA MARÉCHALE. - Elle vous répondit qu'oui?
CRUDELI. - Je lui dis : Et si l'homme est damné pour l'adultère qu'il a commis dans le cœur, quel sera le sort de la femme qui invite tous ceux qui l'approchent à commettre ce crime? Cette dernière question l'embarrassa.
LA MARÉCHALE. - Je comprends; c'est qu'elle ne voiloit pas fort exactement cette gorge, qu'elle avoit aussi bien qu'il est possible de l'avoir.
CRUDELI. - Il est vrai. Elle me répondit que c'étoit une chose d'usage; comme si rien n'étoit plus d'usage que de s'appeler chrétien et de ne l'être pas; qu'il ne falloit pas se vêtir ridiculement, comme s'il y avoit quelque comparaison à faire entre un misérable petit ridicule, sa damnation éternelle et celle de son prochain ; qu'elle se laissoit habiller par sa couturière, comme s'il ne valoit pas mieux changer de couturière que renoncer à sa religion; que c'étoit la fantaisie de son mari, comme si un époux étoit assez insensé pour exiger de sa femme l'oubli de la décence et de ses devoirs, et qu'une véritable chrétienne dût pousser l'obéissance pour un époux extravagant jusqu'au sacrifice de la volonté de son Dieu, et au mépris des menaces de son rédempteur !
LA MARÉCHALE. - Je savois d'avance toutes ces puérilités-là; je vous les aurois peut-être dites comme votre voisine ! Mais, elle et moi, nous aurions été toutes deux de mauvaise foi. Mais quel parti prit-elle d'après votre remontrance ?
CRUDELI. - Le lendemain de cette conversation (c'étoit un jour de fête), je remontois chez moi, et ma dévote et belle voisine descendoit de chez elle pour aller à la messe.
LA MARÉCHALE. - Vêtue comme de coutume ?
CRUDELI. - Vêtue comme de coutume. Je souris, elle sourit, et nous passâmes l'un à côté de l'autre sans nous parler. Madame la maréchale, une honnête femme! une chrétienne! une dévote! Après cet exemple, et cent mille autres de la même espèce, quelle influence réelle puis-je accorder à la religion sur les mœurs? Presque aucune, et tant mieux.
LA MARÉCHALE. - Comment, tant mieux?
CRUDELI. - Oui, Madame : s'il prenoit en fantaisie à vingt mille habitans de Paris de conformer strictement leur conduite au sermon sur la montagne...
LA MARÉCHALE. - Eh bien ! il y auroit quelques belles gorges plus couvertes.
CRUDELI. - Et tant de fous, que le lieutenant de police ne sauroit qu'en faire ; car nos petites-maisons n'y suffiroient pas. Il y a dans les livres inspirés deux morales : l'une générale et commune à toutes les nations, à tous les cultes, et qu'on suit à peu près; une autre, propre à chaque nation et à chaque culte, à laquelle on croit, qu'on prêche dans les temples, qu'on préconise dans les maisons, et qu'on ne suit point du tout.
LA MARÉCHALE. - Et d'où vient cette bizarrerie?
CRUDELI. - De ce qu'il est impossible d'assujettir un peuple à une règle qui ne convient qu'à quelques hommes mélancoliques, qui l'ont calquée sur leur caractère. Il en est des religions comme des institutions monastiques, qui toutes se relâchent avec le temps. Ce sont des folies qui ne peuvent tenir contre l'impulsion constante de la nature, qui nous ramène sous sa loi. Et faites que le bien des particuliers soit si étroitement lié avec le bien général qu'un citoyen ne puisse presque pas nuire à la société sans se nuire à lui-même; assurez à la vertu sa récompense, comme vous avez assuré à la méchanceté son châtiment; que sans aucune distinction de culte, dans quelque condition que le mérite se trouve, il conduise aux grandes places de l'État; et ne comptez plus sur d'autres méchans que sur un petit nombre d'hommes, qu'une nature perverse que rien ne peut corriger entraîne au vice. Madame la maréchale, la tentation est trop proche; et l'enfer est trop loin : n'attendez rien , qui vaille la peine qu'un sage législateur s'en occupe, d'un système d'opinions bizarres qui n'en impose qu'aux enfans ; qui encourage aux crimes par la commodité des expiations; qui envoie le coupable demander pardon à Dieu de l'injure faite à l'homme, et qui avilit l'ordre des devoirs naturels et moraux, en le subordonnant à un ordre de devoirs chimériques.
LA MARÉCHALE. - Je ne vous comprends pas.
CRUDELI. - Je m'explique : mais il me semble que voilà le carrosse de M. le maréchal, qui rentre fort à propos pour m'empêcher de dire une sottise.
LA MARÉCHALE. - Dites, dites votre sottise, je ne l'entendrai pas ; je me suis accoutumée à n'entendre que ce qui me plaît....»

1778-1782 - "Essai sur les règnes de Claude et de Néron"
En 1778, Diderot publie l'Essai sur Sénèque le philosophe, dont on retient une attaque contre Rousseau, quand, au détour d'une note, il le traite de "sophiste éloquent". A une époque où d'Holbach et son cercle poursuivent un militantisme athée, Diderot retrace la vie de Sénèque, auquel il s'identifie avec passion, puis dans un deuxième temps analyse ses rapports avec Claude et Néron. C'est une aussi une sorte de bilan personnel : «Cette médiocrité dans tous les genres est la suite d'une curiosité effrénée et d'une fortune si modique qu'il ne m'a jamais été permis de me livrer tout entier à une seule branche de la connaissance humaine. J'ai été forcé toute ma vie de suivre des occupations auxquelles je n'étais pas propre et de laisser de côté celles où j'étais appelé par mon goût, mon talent et quelques espérances de succès. »

1781 - "Est-t-il bon? Est-il méchant?"
Un bijou. Comédie d'intrigue, l'une de ses dernières oeuvres, publiée après sa mort, concentrée en fait sur un seul personnage, un certain M. Hardouin, littérateur de renommée, partagé entre ses assiduités auprès des femmes et sa manie de vouloir rendre service, et qui doit écrire un spectacle en l'honneur d'une Mme de Malves. C'est lui-même qu'il peint sous les traits de M. Hardouin ; c'est de lui-même qu'il demande s'il est bon, parce qu'il est appliqué à faire le bien et à rendre service, s'il est méchant, parce qu'il apporte quelque malignité Un dialogue étincelant, la légèreté de ton propre au dix-huitième siècle...
Mme de Chepy désire donner un divertissement pour la fête de son amie, Mme de Malves ; elle demande à M. Hardouin de lui composer quelque chose...
M.HARDOUIN - Je suis désespéré de vous refuser net, mais tout net. Premièrement, parce que je suis excédé de fatigue et qu'il ne me reste pas une idée, mais pas une. Secondement, parce que j'ai heureusement ou malheureusement, une de ces têtes auxquelles on ne commande pas. Je voudrais vous servir que je ne le pourrais.
MME DE CHEPY - Ne dirait-on pas qu'on vous demande un chef-d'œuvre ?
M.HARDOUIN - Vous demandez au moins une chose qui vous plaise, et cela ne paraît pas aisé ; qui plaise à la personne que vous voulez fêter, et cela est très difficile ; enfin qui me plaise à moi, et je ne suis presque jamais content de ce que je fais.
MME DE CHEPY - Ce ne sont là que les fantômes de votre paresse ou les prétextes de votre mauvaise volonté. Vous me persuadez peut-être que vous redoutez beaucoup mon jugement ! Mon amie, j'en conviens, a le tact exquis, mais elle est juste, et sera plus touchée d'un mot heureux que blessée d'une mauvaise scène ; et quand elle vous trouverait un peu plat, qu'est-ce que cela vous ferait ? Vous auriez tort de craindre nos beaux esprits, dont nous suspendons la critique en vous nommant. Pour vous, monsieur, c'est autre chose ; après avoir été mécontent de vous-même tant de fois, vous en serez quitte pour être injuste une fois de plus.
M.HARDOUIN - D'ailleurs, madame, je n'ai pas l'esprit libre. Vous connaissez Mme Servin ? c'est, je crois, votre amie.
MME DE CHEPY - Je la rencontre dans le monde, je la vois chez elle. Nous ne nous aimons pas, mais nous nous embrassons.
M.HARDOUIN - Sa bienfaisance inconsidérée lui a attiré une affaire très ridicule, et vous savez ce que c'est qu'un ridicule, surtout pour elle. N'a-t-elle pas découvert que j'étais lié avec son adverse partie, et ne faut-il pas absolument que je la tire de là ? J'ai même pris la liberté de donner rendez-vous ici à mon homme.
MME DE CHEPY - Tenez, mon cher Hardouin, laissez faire à chacun son rôle ; celui des avocats est de terminer les procès, le vôtre de produire des ouvrages charmants. Voulez-vous savoir ce qui vous arrivera ? Vous vous brouillerez avec la dame dont vous êtes le négociateur, avec son adversaire, et avec moi, si vous me refusez.
M.HARDOUIN - Pour une chose aussi frivole ? C'est ce que je ne croirai jamais.
MME DE CHEPY - Mais c'est à moi, ce me semble, à juger si la chose est frivole ou non ; cela tient à l'intérêt que j'y mets.
M.HARDOUIN - C'est-à-dire que s'il vous plaisait d'y en mettre dix fois, cent fois plus qu'il ne faut...
MME DE CHEPY - Je serais peu sensée peut-être, mais vous n'en seriez que plus désobligeant. Allons, mon cher, promettez-moi, ou je vous ferais une abominable tracasserie avec une de vos meilleures amies.
M.HARDOUIN - Quelle amie ? Oui que ce soit, je ne ferai sûrement pas pour elle ce que je ne ferais pas pour vous.
MME DE CHEPY - Promettez.
M.HARDOUIN - Je ne saurais.
MME DE CHEPY - Faites la pièce.
M.HARDOUIN - En vérité, je ne saurais.
MME DE CHEPY - Le rôle de suppliante ne me va guère, et celui de la douceur ne me dure pas ; prenez-y garde, je vais me fâcher.
M.HARDOUIN - Non, madame, vous ne vous fâcherez pas.
MME DE CHEPY - Et je vous dis, moi, monsieur, que je suis fâchée, très fâchée de ce que vous en usez avec moi comme vous n'en useriez pas avec cette grosse provinciale rengorgée qui vous commande avec une impertinence qu'on lui passerait à peine si elle était jeune et jolie ; avec cette petite minaudière qui est l'un et l'autre, mais qui gâte tout cela, qui ne fait pas un geste qui ne soit apprêté, qai ne dit pas un mot sans prétention, et qui est toujours aussi mécontente des autres que satisfaite d'elle-même,... avec la mademoiselle ; oui, avec mademoiselle que voilà, qui vous donne quelquefois à ma toilette des distractions dont je pourrais me choquer, s'il me convenait, mais dont je continuerai de rire...
{ironiquement)
Mademoiselle, je vous prie, je vous supplie de vouloir bien intercéder pour moi auprès de M. Hardouin.
Et le pauvre Hardouin- Diderot, laissé seul avec la femme de chambre, se plaint de toutes les tracasseries dont on l'accable, finit par céder pour les beaux yeux de Mme Beaulieu...
M.HARDOUIN
Je suis obsédé d'embarras : j'en ai pour mon compte, j'en ai pour le compte d'autrui ; pas un instant de repos. Si l'on frappe à ma porte, je crains d'ouvrir ; si je sors, c'est le chapeau rabattu sur les yeux. Si l'on me relance en visite, la pâleur me vient. Ils sont une nuée qui attendent après le succès d'une comédie que je dois lire aux Français, ne vaut-il pas mieux que je m'en occupe que de perdre mon temps à ces balivernes de société ? Ou ce que l'on fait est mauvais, et ce n'était pas la peine de le faire ; ou si cela est passable, le jeu des acteurs le rend plat.
Mme BEAULIEU
Il paraît que M, Hardouin n'a pas une haute idée de notre talent.
M.HARDOUIN
S'il Faut. Mademoiselle, vous en dire la vérité, j'ai vu les acteurs de société les plus vantés, cela fait pitié ; le meilleur n'entrerait pas dans une troupe de province et figurerait mal chez Nicolet.
Mme BEAULIEU
Voilà que je suis aussi piquée de mon côté. Savez-vous que je me mêle de jouer ?
M.HARDOUIN
Tant pis, mademoiselle, faites des boucles,
Mme BEAULIEU
Ne m'avez-vous pas dit que vous feriez la pièce si je voulais ? Je ne sais si un poète est un honnête homme, mais on m'a dit de tout temps qu'un honnête homme n'avait que sa parole. Je veux vous convaincre que l'auteur s'en prend souvent à l'acteur, quand il ne devrait s'en prendre qu'à lui-même ; je veux que vous vous entendiez siffler et que vous nous entendiez applaudir jusqu'aux nues.
M.HARDOUIN
Mademoiselle me jette le gantelet, il faut le ramasser. J'ai promis de faire la pièce et je la ferai.
Vous voyez, la voilà outrée, et je suis sûre de n'avoir pas un mois à rester ici. Je voudrais que les fêtes, les pièces et les poètes fussent tous au fond de la rivière.
Pendant qu'il appelle l'inspiration, Hardouin est dérangé par un laquais qui lui vient annoncer toute une série de fâcheux, un tailleur, un créancier, d'autres encore, une femme triste, mais assez bonne à consoler, "entre vingt et trente". C'est Mme Bertrand, veuve d'un capitaine qui s'est héroïquement laissé couler après avoir sauvé son équipage, et qui demande une pension. Hardouin s'engage à intervenir pour elle auprès de Poultier, premier commis de la marine, et de se rendre personnelle la grâce qu'il sollicite, oui, personnelle. Je m'en charge qu'à cette condition : ayez pour agréable de vous rappeler que je vous en ai prévenue et que vous avez consenti.
Plus tard, nous verrons Mme Bertrand dont la démarche a été couronnée de le succès, on apportera le brevet de la pension doublée, tout simplement parce que Hardouin a fait croire à Poultier qu'il était sans doute son fils. Et Hardouin lui conseillera de remercier elle-même Poultier et de lui présenter son fils, dont il peut ainsi assurer l'avenir. Et Diderot fait son examen de conscience sous le nom de M. Hardouin pendant que Poultier cherchera en vain une ressemblance dans les traits du fils de Mme Bertrand...
- Moi, un bon homme, comme on le dit ! je ne le suis point. Je suis né foncièrement dur, méchant, pervers. Je suis touché presque jusqu'aux larmes de la tendresse de cette mère pour son enfant, de sa sensibilité, de sa reconnaissance, j'aurais même du goût pour elle ; et malgré moi, je persiste dans le projet peut-être de la désoler... Hardouin, tu t'amuses de tout, il n'y a rien de sacré pour toi ; tu es un fieffé monstre... Cela est mal, très mal... il faut absolument que tu te défasses de ce mauvais tour d'esprit.,, et que je renonce à la malice que j'ai projetée ?.., Oh, non... mais après celle-là, plus, plus ; ce sera la dernière de ma vie.
1784 - Comme le médecin interdit désormais à Diderot, affaibli par son voyage en Russie, de monter ses étages, Grimm lui obtient un appartement, il quitte la rue Taranne pour la rue de Richelieu. Un véritable palais, mais le 19 février 1784, il fut attaqué d'un violent crachement de sang, les pilules de Bâcher le soutinrent quelque temps, et au cours de sa maladie, le curé de Saint-Sulpice vint le voir. La' veille de sa mort, nous dit Mme de Vandeul, "il reçut le soir ses amis ; la conversation s'engagea sur la philosophie et les différentes routes pour arriver à cette science ; « le premier pas, dit-il, vers la philosophie, c'est l'incrédulité. » Ce mot est le dernier qu'il ait proféré devant moi ; il était tard, je le quittai, j'espérais le revoir encore. Il se leva le samedi 30 juillet 1784 ; il causa toute la matinée avec son gendre et son médecin ; il se fit raccommoder son vésicatoire dont il souffrait ; il se mit à table, mangea une soupe, du mouton bouilli et de la chicorée ; il prit un abricot ; ma mère voulut l'empêcher de manger ce fruit : « Mais quel diable de mal veux-tu que cela me fasse ? » Il le mangea, appuya son coude sur la table pour manger quelques cerises en compote, toussa légèrement. Ma mère lui fit une question ; comme il gardait, le silence, elle leva la- tête, le regarda, il n'était plus » ....
Editions de l'oeuvre - Diderot, au contraire de Voltaire ou de Rousseau, ne s'est jamais occupé, de son vivant, de recueillir ses œuvres, et nul ne s'en est occupé pour lui. Bien mieux, la plupart du temps, ses meilleures productions n'ont circulé qu'en manuscrit, dans une proportion restreinte, et n'ont été imprimées que des années après sa mort. Ainsi, La Promenade du sceptique, imprimée seulement en 1830; L'Oiseau blanc, en 1788; les Salons, enfouis dans la Correspondance de Grimm; La Religieuse, en 1796; Le Voyage à Bourbonne, en 1831 ; la Lettre sur le commerce de la librairie, en 1861; l'admirable Rêve de d'Alembert, en 1830; les Eleuthéromanes, en 1795 ; le Supplément aux voyages de Bougainville, en 1 796; Jacques le fataliste, aussi en 1796; Ceci n'est pas un conte, en 1798; Le Paradoxe sur le comédien, en 1830 ; Le Neveu de Rameau, sous la Restauration, etc. Les contemporains de Diderot, le grand public, n'ont donc eu que la moindre partie de lui-même. Et il n'y eut jamais d'éditions populaires de ses oeuvres complètes, le premier recueil, paru sous ce titre "OEuvres philosophiques de M***", Amsterdam (Rey), 1772, est incomplet, c'est en 1798 que Naigeon publia les oeuvres complètes en 15 volumes in-8°, c'est-à-dire quatorze ans après la mort de Diderot; et la première édition digne de Diderot, celle qui a été publiée par Brière, date de 1821...
