- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Condorcet (1743-1794), "Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain" (1794) - Volney (1757-1820), "Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires" (1791) - ....
Last update 10/10/2021

A côté des encyclopédistes proprement dits il y a eu en France, au XVIIIe siècle, d'autres philosophes qui, sans être leurs collaborateurs directs, en partagèrent les tendances, en soutinrent les idées, furent condamnés ou en moururent, et par leurs ouvrages collaborèrent en somme à l'oeuvre d'émancipation intellectuelle qu'ils avaient entreprise. Parmi eux , Condorcet occupe une place à part dans l'histoire de la pensée française : il est, dit-on, le dernier des "philosophes", le seul qui ait pris une part active à la Révolution. Certes, il n'a pas conçu de système absolument original, mais il rassemble toutes les théories de ses prédécesseurs. Nous retrouvons chez lui les idées de Voltaire, de Rousseau, de Turgot, d'Helvétius, de Condillac, peu à peu façonnées en un tout d'une grande cohérence et dont la dernière expression est la fameuse "Esquisse d'un Tableau historique des progrès de l'Esprit humain", sorte de résumé philosophique du XVIIIe siècle conçu par un homme qui paradoxalement tentait de fuir au même instant la Terreur et la mort ..
("Nicolas de Condorcet se donnant la mort dans sa prison, 28 mars 1794", gravure, Vizille, musée de la Révolution française, d'après Alexandre-Évariste Fragonard)
Dans un contexte de remise en question totale de l'ordre politique et social alors dominant, mais une remise en question qui n'ose encore assumer sa radicalité tant l'ordre apparent du monde pourrait-il en être submergé sans limitation possible, s'exprime la petite musique de la la "loi naturelle", principe d'émancipation qui s'impose de lui-même tout simplement parce que structurant tant notre histoire que notre géographie, reste à la laïciser...
Cette réflexion de 1793 n'est-elle pas toujours en cours au XXIe siècle, pensée qui tourne en boucle ...
La question de la "loi naturelle" est alors en filigrane de toutes les réflexions, au même titre que de l'idée de "progrès", progrès plus du genre humain que de la nature humaine, ne serait-ce que parce que cet être humain vit et n'existe plus qu'en société. En 1793 Volney publiait le "Catéchisme du Citoyen français", qu'il aurait pu appelé, écrira-t-il, le "Catéchisme du bon sens et des honnêtes gens" et qu'il espérait devenir un livre classique et populaire dans toute l'Europe...

(Volney) LA LOI NATURELLE, ou PRINCIPES PHYSIQUES DE LA MORALE.
CHAPITRE PREMIER. - De la loi naturelle.
D. Qu'est-ce que la loi naturelle?
R. C'est l'ordre régulier et constant des faits, par lequel Dieu régit l'univers; : ordre que sa sagesse présente aux sens et à la raison des hommes , pour servir à leurs actions de règle égale et commune , et pour les guider , sans distinction de pays ni de secte , vers la perfection et le bonheur.
D. Définissez-moi clairement le mot loi.
R. Le mot "loi", pris littéralement , signifie "lecture", parce que, dans l'origine, les ordonnances et règlements étaient la lecture par excellence que l'on faisait au peuple, afin qu'il les observât et n'encourût pas les peines portées contre leur infraction : d'où il suit que l'usage originel expliquant l'idée véritable , la loi se définit :
« Un ordre ou une défense d'agir , avec la clause expresse d'une peine attachée à l'infraction , ou d'une récompense attachée à l'observation de cet ordre. »
D. Est-ce qu'il existe de tels ordres dans la nature ? .
R. Oui.
D. Que signifie ce mot nature?
R. Le mot nature prend trois sens divers :
1e, Il désigne l'univers, le monde matériel : on dit , dans ce premier sens , la beauté de la nature , la richesse de la nature ; c'est-à-dire les objets du ciel et de la terre offerts à nos regards.
2e, Il désigne la puissance qui anime , qui meut l'univers, en la considérant comme un être distinct , comme l'ame est au corps ; on dit , dans ce second sens : «Les intentions de la nature , les «secrets incompréhensibles de la nature».
3e, Il désigne les opérations partielles de cette puissance dans chaque être ou dans chaque classe d'êtres ; et l'on dit, dans ce troisième sens : C'est « une énigme que la nature de l'homme; chaque être agit selon sa nature. »
Or, comme les actions de chaque être ou de chaque espèce d'êtres sont soumises à des règles constantes et générales, qui ne peuvent être enfreintes sans que l'ordre général ou particulier soit interverti et troublé, l'on donne à ces règles d'actions et de mouvements le nom de lois naturelles ou lois de la nature.
D. Donnez-moi des exemples de ces lois.
R. C'est une loi de la nature, que le soleil éclaire successivement la surface du globe terrestre; que sa présence y excite la lumière et la chaleur, que la chaleur agissant sur l'eau forme des vapeurs; que ces vapeurs élevées en nuages dans les régions de l'air s'y résolvent en pluies ou en neiges , qui renouvellent sans cesse les eaux des sources et des fleuves. C'est une loi de la nature, que l'eau coule de haut en bas ; qu'elle cherche son niveau ; qu'elle soit plus pesante que l'air ; que tous les corps tendent vers la terre ; que la flamme s'élève vers les cieux; qu'elle désorganise les végétaux et les animaux; que l'air soit nécessaire à la vie de certains animaux ; que, dans certaines circonstances, l'eau les suffoque et les tue; que certains sucs de plantes, certains minéraux attaquent leurs organes, détruisent leur vie , et ainsi d'une foule d'autres faits.
Or, parce que tous ces faits et leurs semblables sont immuables, constants, réguliers, il en résulte pour l'homme autant de véritables ordres de s'y conformer, avec la clause expresse d'une peine attachée à leur infraction, ou d'un bien-être attaché à leur observation ; de manière que si l'homme prétend voir clair dans les ténèbres, s'il contrarie la marche des saisons, l'action des éléments ; s'il prétend vivre dans l'eau sans se noyer, toucher la flamme sans se brûler, se priver d'air sans s'étouffer , boire des poisons sans se détruire, il reçoit de chacune de ces infractions aux lois naturelles une punition corporelle et proportionnée à sa faute; - qu'au contraire , s'il observe et pratique chacune de ces lois dans les rapports exacts et réguliers qu'elles ont avec lui , il conserve son existence, et la rend aussi heureuse qu'elle peut l'être ; et parce que toutes ces lois, considérées relativement à l'espèce humaine , ont pour but unique et commun de la conserver et de la rendre heureuse, on est convenu d'en rassembler l'idée sous un même mot , et de les appeler collectivement la loi naturelle."
CHAPITRE II.
Caractères de la loi naturelle.
D. Quels sont les caractères de la loi naturelle ?
R. On en peut compter dix principaux.
D. Quel est le premier ?
R. C'est d'être inhérente à l'existence des choses, par conséquent, d'être primitive et antérieure à toute autre loi , en sorte que toutes celles qu'ont reçues les hommes n'en sont que des imitations, dont la perfection se mesure sur leur ressemblance avec ce modèle primordial
D. Quel est le second ?
R. C'est de venir immédiatement de Dieu , d'être présentée par lui à chaque homme , tandis que les autres ne nous sont présentées que par des hommes qui peuvent être trompés ou trompeurs.
D. Quel est le troisième?
R. C'est d'être commune à tous les temps , à tous les pays, c'est-à-dire, d'être une et universelle.
D. Est-ce qu'aucune autre loi n'est universelle?
R. Non , car aucune ne convient , aucune n'est applicable à tous les peuples de la terre ; toutes sont locales et accidentelles , nées par des circonstances de lieux et de personnes ; en sorte que si tel homme , tel événement n'eût pas existé , telle loi n'existerait pas.
D. Quel est le quatrième caractère ?
R. C'est d'être uniforme et invariable.
D. Est-ce qu'aucune autre n'est uniforme et invariable ?
R. Non ; car ce qui est bien et vertu selon l'une, est mal et vice selon l'autre ; et ce qu'une même loi approuve dans un temps, elle le condamne souvent dans un autre.
D. Quel est le cinquième caractère ?
R. D'être évidente et palpable, parce qu'elle consiste tout entière en faits sans cesse présents aux sens et à la démonstration.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas évidentes ?
R. Non ; car elles se fondent sur des faits passés et douteux, sur des témoignages équivoques et suspects , et sur des preuves inaccessibles aux sens.
D. Quel est le sixième caractère ?
R. D'être raisonnable, parce que ses préceptes et toute sa doctrine sont conformes à la raison et à l'entendement humain.
D. Est-ce qu'aucune autre loi n'est raisonnable?
R. Non, car toutes contrarient la raison et l'entendement de l'homme, et lui imposent avec tyrannie une croyance aveugle et impraticable.
D. Quel est le septième caractère ?
R. D'être juste, parce que dans cette loi les peines sont proportionnées aux infractions.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas justes?
R. Non ; car elles attachent souvent aux mérites ou aux délits des peines ou des récompenses démesurées, et elles imputent à mérite ou à délit des actions nulles ou indifférentes.
D. Quel est le huitième caractère ?
R. D'être pacifique et tolérante , parce que , dans la loi naturelle , tous les hommes étant frères et égaux en droits , elle ne leur conseille à tous que paix et tolérance , même pour leurs erreurs.
D. Est-ce que les autres lois ne sont pas pacifiques ?
R. Non ; car toutes prêchent la dissension, la discorde , la guerre , et divisent les hommes par des prétentions exclusives de vérité et de domination.
D. Quel est le neuvième caractère?
R. D'être également bienfaisante pour tous les hommes , en leur enseignant à tous les véritables moyens d'être meilleurs et plus heureux.
D. Est-ce que les autres ne sont pas aussi bienfaisantes ?
R. Non ; car aucune n'enseigne les véritables moyens du bonheur : toutes se réduisent à des pratiques pernicieuses ou futiles, et les faits le prouvent, puisqu'après tant de lois, tant de religions , de législateurs et de prophètes , les hommes sont encore aussi malheureux et aussi ignorants qu'il y a six mille ans.
D. Quel est le dernier caractère de la loi naturelle ?
R. C'est de suffire seule à rendre les hommes plus heureux et meilleurs, parce qu'elle embrasse tout ce que les autres lois civiles ou religieuses ont de bon ou d'utile, c'est-à-dire qu'elle en est essentiellement la partie morale ; de manière que, si les autres lois en étaient dépouillées, elles se trouveraient réduites à des opinions chimériques et imaginaires, sans aucune utilité pratique..."

Condorcet (1743-1794)
Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis de Condorcet, naquit le 17 septembre 1743, à Ribemont en Picardie (maison natale devenue musée). Son père, officier de cavalerie, avait épousé Mme de Saint-Félix, jeune veuve d'origine bourgeoise, de santé délicate, fort dévote, mais riche. L'année même de sa naissance, le père de Condorcet fut tué à Neuf-Brisach.
Né dans une famille noble du Dauphiné, il fit de brillantes études chez les jésuites et soutint à 16 ans une thèse de mathématiques. Il entre à ving-six ans comme mathématicien à l'Académie des sciences, prononce les Eloges de Buffon et de d'Alembert. En 1774, dans ses Lettres d'un théologien à l'auteur du dictionnaire des trois siècles, il se révèle polémiste ardent et apôtre de la tolérance. Economiste, il publie en 1776 ses "Réflexions sur le commerce des blés" et en 1786 sa "Vie de Turgot". Philosophe, il édite les "Pensées" de Pascal (1776) et écrit une "Vie de Voltaire" (1787). Membre de l'Académie française (1782, son discours de réception porte sur l'union des sciences physiques et morales. Lié au clan philosophique, il s'initie avec Turgot à la politique : il milite pour faire reconnaître les droits des femmes et ceux des esclaves noirs (1781). Ses amis, les Encyclopédistes, les Physiocrates, Turgot, Voltaire, ont beaucoup contribué à l'orienter vers les choses sociales. D'autres influences devaient s'exercer dans le même sens : les salons qu'il fréquentait, ceux de Mlle de Lespinasse et de Mme Helvétius. celui de Mme de Condorcet elle-même, que Michelet appelle "le centre naturel de l'Europe pensante.

RÉFLEXIONS d'un Citoyen y sur la révolution de 1789....
"Sous un gouvernement modéré , qui encourage , par une sage indulgence, la liberté de penser , qui compte pour quelque chose les opinions , même individuelles , je crois que tout homme peut, sans danger, manifester la sienne. Je vais donc dire ce que je pense de la nouvelle révolution, c'est-à-dire , l'établissement des grands-bailliages & de la cour plénière : je trouve dans cette double opération , des inconvénients très-sérieux : j'oserai les développer.
Ma franchise peut-elle blesser le gouvernement ? Non. Si je ne le flatte pas, je ne l'offenserai pas non plus : ma plume n’est pas moins éloignée de l’audace que de la bassesse. Loin de moi toute coupable pensée : il ne peut y avoir de crime sans intention ; & je proteste , au besoin , contre toute opinion qui , calomniant mon coeur , me supposeroit des intentions criminelles.
Les dépositaires de l’autorité du roi veulent , je tâche du moins de me le persuader , répondre à ses vœux: c’est le bien de l’état , c’est le bonheur des peuples qu’ils ont eus pour objet , en substituant un ordre nouveau à l’ordre ancien; mais ils sont hommes ; & comme hommes, sujets à l’erreur ; exposés à ces préventions involontaires , qui égarent quelquefois le zèle le plus pur : ils peuvent donc s’être trompés ici : les en avertir , ce n’est pas les attaquer , c’est les servir : je les respecte trop pour leur faire l’injure de redouter de leur part des ressentiments , lorsque je crois en mériter des égards : il est de leur dignité , de leur noblesse de protéger les écrits ou une vertueuse hardiesse leur découvre la vérité, comme de flétrir de leur indignation ou de leur mépris; ceux où des plumes serviles nourrissent , par de lâches adulations , l’illusion dangereuse qui la leur dérobe : cette bassesse est une insulte ; ma fierté est un hommage...."
Sous la Révolution, membre de la Législative en 1791, c'est le point culminant de sa carrière politique. Il ne penche ni à droite, ni à gauche, ce qui explique comment il a pu, sous la Convention, partager les opinions des Girondins et cependant donner tout son appui à Danton. Il fut élu secrétaire, vice-président, puis président de la Législative. Il n'était nullement orateur. Malgré tout, l'Assemblée lui était favorable, écoutait patiemment ses discours, discutait avec respect ses déclarations. Il s'occupe de projets d'instruction nationale et c'est un des rares révolutionnaires à défendre l'égalité entre les sexes. Son rôle fut plus effacé sous la Convention où il fut élu en 1792 par cinq départements et siégea comme député de l'Aisne, son pays natal. Il fut, de prime abord, en opposition avec la majorité de ses collègues lors du procès du roi. Il vota contre l'exécution de Louis XVI. Comme membre du comité de la Constitution, il présenta un rapport que les Jacobins attaquèrent violemment et auquel ils substituèrent un autre projet qui fut voté peu après. Alors Condorcet écrivit un pamphlet pour en appeler au peuple contre l'Assemblée.
Le 8 juillet 1793, il est dénoncé par François Chabot et décrété d'arrestation, « comme prévenu de conspiration contre l'unité et l'indivisibílité de la République ». Accusé de modérantisme, il passe alors dans la clandestinité ...
Et c'est un proscrit, réfugié chez Mlle Vernet, rue des Fossoyeurs, qui rédige l' "Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain" (1794), profession de foi paradoxalement optimiste...
Menacé d'arrestation, en fuite, il se réfugie dans les carrières de Montrouge et y passe la nuit, la journée, la nuit encore; mais, le 27 mars, mourant de faim, il entre dans un cabaret de Clamart où ses réponses embarrassées et sa mine étrange le font arrêter. Blessé à la jambe, trop faible, il est conduit à Bourg-la-Reine, mis dans un cachot où son geôlier le trouva mort le lendemain, le 29 mars 1794.
Sa veuve, Sophie de Grouchy, marquise de Condorcet (1764-1822), en prison sous la Terreur, retrouva la liberté après Thermidor. Elle publia la Théorie des sentiments moraux, traduite d'Adam Smith et suivie de Lettres sur la sympathie adressées à Cabanis. Elle anima le clan des idéologues et édita des textes de son mari...

DE L'INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION D'AMÉRIQUE SUR L'EUROPE.
INTRODUCTION.
"Le chemin de la vérité, dit le poète Sadi, est étroit et placé entre deux précipices. Le moindre faux pas fait rouler au fond; on se relève étourdi de la chute; on gravit avec peine pour se rapprocher du sommet ; on croit y toucher; on fait un dernier effort, et l'on retombe de l'autre côté.
L'Amérique avait à peine déclaré son indépendance, et nos politiques voyaient déjà clairement que la ruine de l'Angleterre et la prospérité de la France devaient être la conséquence nécessaire de cette heureuse révolution. Cette indépendance est reconnue, assurée; ils semblent la voir avec indifférence, et ne s'avisent de douter de leurs prédictions qu'à l'instant où l'événement commence à en vérifier la dernière partie.
J'ai cru que ce moment où l'opinion semble s'égaler en sens contraire, était précisément celui où il pouvait être utile de discuter tranquillement les conséquences de ce grand événement, et je vais tâcher d'être prophète de sang-froid.
Le prix proposé par M. l'abbé Raynal , sur le bien et le mal qui ont résulté pour l'Europe de la découverte du Nouveau -Monde, avait excité mon intérêt; j'avais osé entreprendre de résoudre cette question , mais j'ai senti que ce travail était au-dessus de mes forces , et je n'ai sauvé de l'incendie que le chapitre où j'examinais l'influence que l'indépendance de l'Amérique aurait sur l'humanité, sur l'Europe, sur la France en particulier, et l'analyse des principes d'après lesquels j'essayais de trouver une méthode de mesurer les différents degrés du bonheur public.
Une nation prise en corps étant un être abstrait , elle ne peut être ni heureuse ni malheureuse. Ainsi, quand on parle du bonheur d'une nation collectivement , on ne peut entendre que deux choses : ou une espèce de valeur moyenne, regardée comme le résultat du bonheur et du malheur des individus; ou les moyens généraux de bonheur, c'est-à-dire de tranquillité et de bien-être que le sol, les lois, l'industrie, les rapports avec les nations étrangères, peuvent offrir à la généralité des citoyens. Il suffit d'avoir quelque idée de justice pour sentir que l'on doit s'en tenir au dernier sens.
Autrement, il faudrait adopter la maxime trop répandue chez les républicains anciens et modernes , que le petit nombre peut être légitimement sacrifié au plus grand; maxime qui met la société dans un état de guerre perpétuelle, et soumet à l'empire de la force ce qui ne devrait l'être qu'à la raison et à la justice.
Les moyens généraux de bonheur pour l'homme en société peuvent se partager en deux classes : la première comprend tout ce qui assure, tout ce qui étend la jouissance libre de ses droits naturels. La seconde renferme les moyens de diminuer le nombre des maux auxquels l'humanité est assujettie par la nature ; de pourvoir à nos premiers besoins plus sûrement et avec moins de travail; de nous procurer un plus grand nombre de jouissances par l'emploi de nos forces et l'usage légitime de nos industries ; et, par conséquent, les moyens d'augmenter notre force et notre industrie doivent être rangés dans la même classe.
Les droits de l'homme sont :
1e, la sûreté de sa personne, sûreté qui renferme l'assurance de n'être troublé par aucune violence, ni dans l'intérieur de sa famille, ni dans l'emploi de ses facultés, dont il doit conserver l'exercice indépendant et libre pour tout ce qui n'est pas contraire aux droits d'un autre.
2e, la sûreté et la jouissance libre de sa propriété.
3e, Comme, dans l'état de société, il y a certaines actions qui doivent être assujetties à des règles communes ; comme il faut établir des peines pour les atteintes portées par un individu aux droits d'autrui , soit par la violence, soit par la fraude, l'homme a encore le droit de n'être soumis pour tous ces objets qu'à des lois générales, s'étendant à l'universalité des citoyens , dont l'interprétation ne puisse être arbitraire, dont l'exécution soit confiée à des mains impartiales.
4° Enfin , le droit de contribuer, soit immédiatement, soit par des représentants, à la confection de ces lois et à tous les actes faits au nom de la société, est une conséquence nécessaire de l'égalité naturelle et primitive de l'homme, et l'on doit re- garder une jouissance égale de ce droit pour chaque homme usant de sa raison, comme le terme duquel on doit chercher à se rapprocher. Tant qu'on ne l'a pas atteint , on ne peut pas dire que les citoyens jouissent de ce dernier droit dans toute son étendue.
Il n'est aucun des droits des hommes qu'on ne puisse déduire facilement de ceux auxquels nous venons d'essayer de les réduire, et il serait même aisé de prouver que tous les principes des lois civiles, criminelles, comme ceux des lois d'administration, de commerce, de police, sont une suite de l'obligation de respecter les droits compris dans les trois premières divisions.
Le bonheur d'une société est d'autant plus grand , que ces droits y appartiennent avec plus d'étendue aux membres de l'Etat. Mais la jouissance de chacun de ces mêmes droits n'est pas également importante pour le bonheur commun; nous les avons placés ici suivant l'ordre dans lequel nous croyons qu'ils contribuent à ce bonheur, et nous ajouterons même que, dans une société très-nombreuse, il doit arriver presque nécessairement que le dernier de ces droits se trouve presque nul pour le plus grand nombre des habitants d'un pays.
Des républicains zélés l'ont regardé comme le premier de tous; et il est vrai sans doute que, dans une nation éclairée, dégagée de toute superstition, où il appartiendrait en réalité à tout citoyen qui pourrait ou voudrait l'exercer, la jouissance de ce droit assurerait celle de tous les autres. Mais il perd ses avantages les plus précieux, si l'ignorance, si les préjugés écartent ceux qui doivent l'exercer du sentier étroit que la règle immuable de la justice leur a tracé; et, relativement au bonheur public, une république qui aurait des lois tyranniques peut être fort au-dessous d'une monarchie.
En adoptant cet ordre, on sent que la violation très-fréquente ou très-forte d'un droit moins essentiel peut nuire davantage au bonheur commun que la violation légère ou très-rare d'un droit plus important; qu'ainsi, par exemple, une forme dans la jurisprudence criminelle, qui exposerait les innocents à être condamnés par des juges ignorants ou prévenus, peut faire plus de mal à un pays qu'une loi qui condamnerait à mort pour un délit imaginaire très-rare dans le lieu où cette peine est établie. Des lois fiscales, des lois prohibitives peuvent, en attaquant l'exercice libre de la propriété, être plus nuisibles qu'un pouvoir d'emprisonner arbitrairement, dont on ne ferait qu'un usage très-rare.
Ces principes sont simples ; mais la manière d'évaluer les degrés du mal ou du bien que peuvent produire ces différentes lésions des droits naturels , ou la destruction des abus contraires à ces droits, commence à devenir difficile. Il ne suffirait pas de con- naître avec précision les effets de chaque loi injuste, de chaque réforme utile , il faudrait encore une mesure commune à laquelle on pût les comparer...."

SUR LE PRÉJUGÉ QUI SUPPOSE UNE CONTRARIETE D'INTERETS ENTRE PARIS ET LES PROVINCES (10-17 juillet 1790)
On a proposé à l'assemblée nationale de se transporter à trente lieues de Paris , et on en donnait pour raison le défaut de liberté causé par l'opposition d'intérêts entre la capitale et les provinces.
Le zèle des habitants de Paris pour la liberté , leur attachement inébranlable pour la constitution, leur respectueuse soumission aux décrets les plus opposés à leurs désirs , méritaient peut-être qu'on leur épargnât des expressions qui renferment une défiance si injurieuse.
Mais laissons ce qui tient à des circonstances passagères, et bornons-nous à chercher s'il est vrai que Paris ait d'autres intérêts que les provinces. Pour bien résoudre cette question , il faut examiner d'abord si l'intérêt d'une capitale est, par la nature des choses, opposé à celui du reste de l'empire; autrement il y aurait des remèdes à une opposition d'intérêts purement accidentels, et il faudrait les chercher. Nous verrons ensuite si des combinaisons locales ont établi réellement cette contrariété entre Paris et les provinces.
Celte prétendue opposition d'intérêts entre les nations du globe, entre les divisions d'un même État, entre les capitales et les provinces, entre les villes et les campagnes, entre les métropoles et les colonies, entre le commerce et l'agriculture, entre les capitalistes et les propriétaires , entre les riches et les pauvres, a été jusqu'ici une des principales causes qui ont retardé les progrès de la liberté, de la paix , de la véritable égalité encore si peu connue.
C'est le prétexte banal de presque toutes les mauvaises lois civiles, de la forme vicieuse des impôts, et des vexations qu'elle nécessite, des règlements de commerce les plus ruineux, de la complication des constitutions libres, de la désunion entre les enfants d'une même patrie, de la guerre entre les peuples. C'est par là que d'insidieux politiques, plus encore peut-être par préjugé que par système, ont changé la société, qui ne devait être qu'une réunion d'hommes mutuellement occupés d'augmenter le bonheur commun, en une arène dans laquelle des ennemis ouverts ou cachés se disputent des dépouilles par la ruse ou par la force.
C'est enfin la dernière ressource de ceux qui voient avec une douleur impuissante, la connaissance des droits naturels des hommes ébranler dans leurs fondements les abus destructeurs qui ont régné si longtemps. C'est par là qu'on peut tromper encore ceux qu'on n'ose plus opprimer, et cacher aux yeux du faible les chaînes invisibles dont on veut l'entourer.
Il serait facile de détruire ce système en remontant aux premiers principes des sociétés, en montrant que le bonheur social est attaché au libre exercice des droits naturels, ce qui suppose le respect pour les droits d'autrui , et au développement le plus libre des forces et des facultés de chaque individu; développement qui, restreint par la justice seule, augmente pour soi-même, comme pour autrui, la masse des jouissances et les avantages de la société.
On ferait voir que les diverses professions, du moins celles qui naissent de la nature et non des institutions arbitraires , sont nécessaires l'une à l'autre, s'entr'aident, et ne se nuisent point ; que les richesses, si des lois vicieuses ne s'opposent pas à leur distribution naturelle, tendent à se diviser et non à se réunir dans un petit nombre de mains; qu'en attendant que de bonnes lois, favorables même à la pluralité des riches, établissent lentement cette égalité plus grande, l'intérêt actuel des pauvres est de conserver une inégalité, qui seule peut faire employer l'espèce d'industrie pour l'acquisition de laquelle ils ont consumé leurs premières années; qu'enfin l'oppression ne produit jamais qu'un avantage passager, qui ne peut même s'étendre que sur le petit nombre de la classe des oppresseurs.
Les provinces d'un même empire, comme les diverses nations du globe, n'ont qu'un seul intérêt, celui d'une communication libre qui les fasse jouir des biens que les progrès de la civilisation doivent amener, et ces biens sont d'autant plus grands, ces progrès d'autant plus rapides que la communication a lieu entre plus de nations et sur un plus grand es- pace. Une paix constante est donc l'intérêt commun de la pluralité des citoyens de toutes les nations, et l'on sait que la guerre la plus heureuse, utile à un petit nombre d'individus, est nécessairement un malheur pour le reste. Le véritable intérêt commercial est que chacun puisse se procurer avec plus de facilité, et au prix d'un moindre travail, une plus grande somme de jouissances, et que ces jouissances soient également réparties; il n'existe donc qu'un véritable intérêt commercial, le même pour toutes les nations; c'est le rétablissement de la liberté la plus entière. Une grande partie des négociants riches d'un pays peut trouver du profit à détruire le commerce d'un autre pays; mais le reste des citoyens a un intérêt précisément contraire, et ces prétendus défenseurs du commerce national en sont les véritables ennemis; car la liberté n'est pas seulement utile à ceux qui consomment, elle l'est à la pluralité des marchands eux-mêmes , puisqu'elle tend nécessairement à répandre entre eux les profits avec plus d'égalité. D'ailleurs, ceux qui sollicitent des lois exclusives pour le commerce qu'ils font, sont intéressés, en qualité de consommateurs, à la liberté de tous les autres genres de commerce, et ces intérêts se compensent; car on ne peut prétendre sans doute que des prohibitions qui s'étendraient à tout fussent préférables à une liberté générale. L'intérêt de la pluralité des capitalistes, comme de la pluralité des propriétaires, n'est-il pas que l'administration prenne la bonne foi pour guide, et que l'État soit tranquille ?
La métropole a-t-elle des colonies qui puissent augmenter sa puissance, elle doit, pour l'intérêt même de cette puissance, ne voir en elles que des parties d'une confédération commune qui ont droit à l'égalité. A-t-elle des colonies de commerce, son intérêt unique est que ses citoyens achètent au meilleur marché des denrées que les colonies produisent ou transmettent , et la liberté seule du commerce peut procurer cet avantage.
Dans l'état actuel des sociétés, le pauvre a intérêt que la propriété des riches soit assurée, puisque le plus grand nombre ne peut subsister que des salaires payés par cette propriété; et qu'envahir le bien de celui qui possède, ce serait condamner à mourir de faim celui qui ne possède rien , quand même il aurait sa part au pillage.
En un mot, ou les intérêts opposés sont ceux d'un très-petit nombre de tyrans en contradiction avec l'intérêt général , ou bien ce sont les intérêts de deux grandes classes d'hommes; et alors l'avantage de celle qui opprime est nécessairement presque nul pour chacun de ceux qui la composent, et ne peut entrer en compensation avec le danger auquel ils s'exposent : c'est donc encore à l'intérêt de quelques-uns des chefs de cette classe que l'intérêt commun serait sacrifié. Quel bien revient-il aux neuf dixièmes des Turcs, de la tyrannie que leur nation exerce sur les Grecs, sur les Arméniens, sur les Coptes ?
Quel fruit retire le peuple français des horreurs exercées par les planteurs contre les malheureux habitants de l'Afrique, sinon d'acheter plus cher des denrées souillées de sang et de larmes ?
Mais je dois me borner ici à examiner l'identité ou l'opposition d'intérêts entre une capitale elles pro- vinces du même empire.
Qu'est-ce qu'une capitale? C'est la ville où résident les pouvoirs qui s'exercent sur la nation entière. Cette résidence y appelle nécessairement plusieurs classes d'hommes : d'abord ceux qui, sous quelque titre que ce soit, sont nécessaires à la décision , à l'expédition, à la sollicitation de ces affaires générales; ensuite ceux qui , par des vues d'intérêt, d'ambition ou de gloire, cherchent à influer sur les décisions, à obtenir des emplois.
Ces pouvoirs ne peuvent choisir qu'une grande ville pour le lieu de leur réunion , et ils l'augmentent encore; mais toute grande ville est nécessairement aussi, dans la division de l'Etat où elle est située, le chef-lieu d'une province; comme chef-lieu, elle est encore un centre d'affaires moins générales qui y attirent de nouveaux habitants : si au contraire il n'existe pas de telles divisions, alors un plus grand nombre de pouvoirs généraux sont concentrés dans la capitale. De plus , tous les gens riches , tous ceux que le nom de leurs pères, leurs places, leurs actions, leurs talents, ont illustrés, doivent se porter naturellement vers cette résidence; la curiosité, le plaisir de voir traiter de plus près de grands intérêts, la font préférer aux autres villes opulentes.
Le séjour de ces personnages riches ou accrédités doit devenir celui des arts et du luxe, et le séjour des arts et du luxe est celui des hommes qui ont une fortune indépendante, et qui veulent en jouir.
Dans une grande ville, occupée d'affaires importantes, la vie privée est nécessairement plus libre, et c'est un nouvel attrait. Mais dans ce séjour des arts et du luxe, où l'on consomme nécessairement beau- coup de superfluités, le talent de les préparer avec agrément, avec recherche, doit être en honneur : la capitale doit donc avoir un commerce d'objets de luxe, el en fournir toutes les parties de l'empire où l'on veut imiter son goût. La capitale d'un grand empire sera donc nécessairement une très-grande ville; son étendue, sa population, sa magnificence, seront donc proportionnées à la population, à la richesse de l'empire. Se plaindre de ce que la capitale est grande, c'est se plaindre d'une conséquence infaillible de l'existence d'une capitale ; conséquence qui ne pourrait s'éviter que par des lois contraires à la liberté. Mais est-ce un mal que les grandes capitales? Non, sans doute, lorsque la nature seule en fixe l'étendue, lorsque l'on n'y traite que les affaires qui doivent être communes à tout l'empire , lorsqu'on n'y place que les établissements qui doivent en occuper le chef-lieu.
Ne faites rien contre la capitale : vous agiriez inutilement, et ce que vous feriez contre elle retomberait sur les provinces; ne faites rien pour elle, elle n'y gagnerait pas, et les provinces y perdraient.
....
Parmi les avantages d'une capitale qui n'est que capitale , on doit compter pour beaucoup celui de placer tous les pouvoirs dans le lieu où il y a le moins d'erreurs et d'intérêts particuliers.
Si la capitale est une grande ville de commerce, l'esprit mercantile prend la place de l'esprit public, el les intérêts de tons les citoyens sont sacrifiés aux préjugés prohibitifs des négociants riches; on ne fait plus des lois pour que le commerce soit utile à la nation , mais pour que la nation fasse à ses frais la fortune des commerçants.
Si la capitale était placée au milieu d'un pays qui possédât exclusivement certaines manufactures, qui produisît, à l'exclusion de la plupart des autres provinces, une espèce particulière de denrée précieuse , alors le progrès de cette industrie, de cette culture, prendrait la place de l'intérêt national.
Voulez-vous qu'il règne dans un pays une politique fondée sur des principes libéraux; voulez-vous que les droits naturels des hommes , que les maximes éternelles de la justice soient la base unique de toutes les lois, faites que l'esprit de commerce ne domine point dans le lieu d'où elles émanent. Dans une ville , dans un pays où le commerce, proportionné aux besoins, n'occupe qu'une partie des habitants, où il existe pour les citoyens, il adoucit les mœurs, il produit les vertus domestiques; mais dans les villes où il est l'occupation générale, où il domine, où les citoyens existent pour lui, il devient avide et tyrannique.
La liberté du commerce et de l'industrie , en leur permettant de se répandre avec plus d'égalité, de se distribuer suivant le vœu de la nature et les besoins des hommes, préservera de ce danger. Ce que je viens de dire du commerce serait également vrai des militaires de terre ou de mer, des ministres de la justice, des gens occupés des opérations de banque, que, malgré une liaison nécessaire, il ne faut pas confondre avec les commerçants. Toute profession qui devient dominante, après s'être cor- rompue elle-même, finit par altérer et par corrompre l'esprit public. Plus au contraire les diverses classes sont mêlées de manière à se faire équilibre, à ne permettre à aucune d'acquérir de la prépondérance, plus les principes de justice seront respectés. Il ne faut pas conclure que ces classes diverses aient des intérêts réellement opposés, mais seulement que la réunion des hommes qui doivent naturellement avoir les mêmes préjugés rend ces préjugés plus opiniâtres et plus dangereux, en opposant la force du grand nombre et le poids de l'opinion à l'autorité de la raison. L'esprit qui règne dans le lieu où réside le législateur a sur les lois une influence nécessaire, et l'on doit regarder comme un bonheur pour un peuple libre d'avoir, comme la France, une capitale où aucun grand intérêt n'oppose ses préjugés à la voix de la raison et au sentiment de la liberté.
Dans une capitale qui doit presque uniquement sa grandeur à ce titre, l'habitude de voir traiter les affaires générales donne nécessairement plus d'étendue aux idées ; les préjugés de tous les pays , de toutes les professions, combattus les uns par les autres, laissent à la raison un champ plus libre; des intérêts locaux ou particuliers ne rétrécissent point les vues; l'opinion publique qui s'y forme a plus de dignité et de grandeur, s'éloigne moins des principes de la justice universelle.
On y exerce, contre les abus d'un pouvoir quelconque, une vigilance moins inquiète, parce qu'il y a plus de lumières; plus sûre, parce qu'il y a plus d'expérience; plus pure, parce que la prospérité des citoyens y dépend surtout de la paix et de la liberté...."

Le XVIIIe siècle a cru en l'évolution de l'humanité à partir d'un passé barbare vers un avenir de perfection scientifique. Cette thèse est, avant Condorcet, celle de François Jean de Chastellux, de Sébastien Mercier, de Volney, et de Turgot. Condorcet complète l'ébauche de Turgot, en atténue un peu l'esprit chrétien, y ajoute des déductions. Pour la première fois, l'histoire est divisée, non pas en fonction des événements politiques, mais du progrès des connaissances, l'être humain est pour lui une créature foncièrement rationnelle et neuf étapes déjà écoulées du destin de l'humanité sont ainsi décrites, jusqu'à cette dixième et ultime étape, celle d'un avenir où les nations se fondent en un seul peuple, ou disparaît l'inégalité sociale, un Âge d'or qui va alimenter tous les esprits de l'école révolutionnaire. Les utopies fouriéristes et saint-simoniennes sont incompréhensibles sans Condorcet, quand bien même l'amplification oratoire comble ici des simplifications historiques parfois arbitraires...
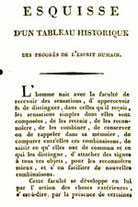
INTRODUCTION A L’ESQUISSE D’UN TABLEAU HISTORIQUE DES PROGRÈS DE L’ESPRIT HUMAIN ..
"L'homme naît avec la faculté de recevoir des sensations; d'apercevoir et de distinguer les sensations simples dont elles sont composées, de les retenir, de les reconnaitre, de les combiner; de comparer entre elles ces combinaisons; de saisir ce qu'elles ont de commun et ce qui les distingue; d'attacher des signes à tous ces objets, pour les reconnaitre mieux, et faciliter des combinaisons nouvelles.
Cette faculté se développe en lui par l'action des choses extérieures, c'est-à-dire, par la présence de certaines sensations composées, dont la constance, soit dans leur identité, soit dans les lois de leurs changements, est indépendante de lui. Elle se développe également par la communication avec des individus semblables à lui; enfin, par des moyens artificiels, que ces premiers développements ont conduit les hommes à inventer.
Les sensations sont accompagnées de plaisir et de douleur, et l'homme a de même la faculté de transformer ces impressions momentanées en sentiments durables, doux ou pénibles; d'éprouver ces sentiments à la vue ou au souvenir des plaisirs ou des douleurs; & l'homme a de même la faculté de transformer ces impressions momentanées en sentimens durables, doux ou pénibles ; d'éprouver ces sentimens à la vue ou au souvenir des plaisirs on des douleurs des autres êtres sensibles. Enfin , de cette faculté unie à celle de former et de combiner des idées , naissent entre lui et ses semblables , des relations d' intérêt, et de devoir , auxquelles la nature même a voulu 'attacher la portion la plus précieuse de notre bonheur & les plus douloureux de nos maux .
Si l'on se borne à observer, à connoitre les faits généraux et les lois constantes que présente le développement de ces facultés, dans ce qu' il a de commun aux divers individus de l'espèce humaine , cette science porte le nom de métaphysique .
Mais si l'on considère ce même développement dans ses résultats, relativement à la masse des individus qui coexistent dans le même temps sur un espace donné, et si on le suit de générations en générations , il présente alors le tableau des progrès de l'esprit humain . Ce progrès est soumis aux mêmes lois générales qui s'observent dans le développement individuel de nos facultés, puisqu'il est le résultat de ce développement, considéré en même-temps dans un grand nombre d' individus réunis en société . Mais le résultat que chaque instant présente dépend de celui qu'offroient les instans precédens et influe sur celui des temps qui doivent suivre.
Ce tableau est donc historique , puisque , assujetti à de perpétuelles variations , il se forme par l'observation successive des sociétés humaines aux différentes époques qu'elles ont parcourues. Il doit présenter l'ordre des changemens, exposer l'influence qu'exerce chaque instant sur celui qui le remplace, et montrer ainsi, dans les modifications qu'a reçues l'espèce humaine , en se renouvelant sans cesse au milieu de l'immensité des siècles , la marche qu'elle a suivie, les pas qu'elle a faits vers la vérité ou le bonheur. Ces observations, sur ce que l'homme a été , sur ce qu'il est aujourd'hui, conduiront ensuite aux moyens d'assurer et d'accélérer les nouveaux progrès que sa nature lui permet d'espérer encore.
Tel est le but de l'ouvrage que j'ai entrepris, & dont le résultat sera de montrer , par le raisonnement et par les faits , qu'il n'a été marqué aucun terme au perfectionnement des facultés humaines; que la perfectibilité de homme est réellement indéfinie; que les progrès de cette perfectibilité , désormais indépendante de toute puissance qui voudroit les arrêter, n'ont d' autre terme que la durée du globe où la nature nous a jetés . Sans doute , ces progrès pourront suivre une marche plus ou moins rapide , mais jamais elle ne sera rétrograde ; du moins , tant que la terre occupera la même place dans le système de l'univers, et que les lois générales de ce système ne produiront sur ce globe , ni un bouleversement général , ni des changemens qui ne permettroient plus à l'espèce humaine d'y conserver , d' y déployer les mêmes facultés , &. d'y trouver les mêmes ressources.
Le premier état de civilisation où l'on ait observé l'espèce humaine, est celui d'une société peu nombreuse d'hommes subsistans de la chasse & de la pêche , ne connoissant que l'art grossier de fabriquer leurs armes & quelques ustensiles de ménage, de construire ou de se creuser des logemens, mais ayant déjà une langue pour se communiquer leurs besoins, et un petit nombre d'idées morales , dont ils déduisent des règles communes de conduite, vivant en familles, se conformant à des usages généraux qui leur tiennent lieu de lois , et ayant même une forme grossière de gouvernement.
On sent que l'incertitude et la difficulté de pourvoir à sa subsistance, l'alternative nécessaire d'une fatigue extrême et d'un repos absolu, ne laissent point à l'homme ce loisir, où, s'abandonnant à ses idées, il peut enrichir son intelligence de combinaisons nouvelles. Les moyens de satisfaire à ses besoins sont même trop dépendants du hasard et des saisons, pour exciter utilement une industrie dont les progrès puissent se transmettre; et chacun se borne à perfectionner son habileté ou son adresse personnelle.
Ainsi, les progrès de l'espèce humaine durent alors être très lents; elle ne pouvait en faire que de loin en loin, et lorsqu'elle était favorisée par des circonstances extraordinaires. Cependant, à la subsistance tirée de la chasse, de la pêche, ou des fruits offerts spontanément par la terre, nous voyons succéder la nourriture fournie par des animaux que l'homme a réduits à l'état de domesticité, qu'il sait conserver et multiplier. A ces moyens se joint ensuite une agriculture grossière; l'homme ne se contente plus des fruits ou des plantes qu'il rencontre; il apprend à en former des provisions, à les rassembler autour de lui, à les semer ou à les planter, à favoriser leur reproduction par le travail de la culture.
La propriété, qui, dans le premier état, se bornait à celle des animaux tués par lui, de ses armes, de ses filets, des ustensiles de son ménage, devint d'abord celle de son troupeau, et ensuite celle de la terre qu'il avait défrichée et cultivée. A la mort du chef, cette propriété se transmet naturellement à la famille. Quelques-uns possèdent un superflu susceptible d'être conservé. S'il est absolu, il fait naître de nouveaux besoins; s'il n'a lieu que pour une seule chose, tandis qu'on éprouve la disette d'une autre, cette nécessité donne l'idée des
échanges: dès lors, les relations morales se compliquent et se multiplient. Une sécurité plus grande, un loisir plus assuré et plus constant, permettent ,de se livrer à la méditation, ou du moins, à une observation suivie. L'usage s'introduit, pour quelques individus, de donner une partie de leur superflu en échange d'un travail dont ils seront dispensés eux-mêmes.
Il existe donc une classe d'hommes dont le temps n'est pas absorbé par un labeur corporel, et dont les désirs s'étendent au delà de leurs simples besoins. L'industrie s'éveille; les arts déjà connus s'étendent et se perfectionnent; les faits que le hasard présente à l'observation de l'homme plus attentif et plus exercé, font éclore des arts nouveaux; la population s'accroît à mesure que les moyens de vivre deviennent moins périlleux et moins précaires; l'agriculture, qui peut nourrir un plus grand nombre d'individus sur le même terrain, remplace les autres sources de subsistance : elle favorise cette multiplication, qui, réciproquement, en accélère les progrès; les idées acquises se communiquent plus promptement et se perpétuent plus sûrement dans une société devenue plus sédentaire, plus rapprochée, plus intime.
Déjà l'aurore des sciences commence à paraître ..."

CONDORCET, DES PROGRÈS DE L'ESPRIT HUMAIN - "Nous exposerons l'origine, nous tracerons l'histoire des erreurs générales, qui ont plus ou moins retardé ou suspendu la marche de la raison, qui souvent même, autant que les événements politiques, ont fait rétrograder l'homme vers l'ignorance...."
" .. Depuis l'époque où l'écriture alphabétique a été connue dans la Grèce, l'histoire se lie à notre siècle, à l'état actuel de l'espèce humaine dans les pays les plus éclairés de l'Europe, par une suite non interrompue de faits et d'observations; et le tableau de la marche et des progrès de l'esprit humain est devenu véritablement historique. La philosophie n'a plus rien à deviner, n`a plus de combinaisons hypothétiques à former; il suffit de rassembler, d'ordonner les faits, et de montrer les vérités utiles qui naissent de leur enchaînement et de leur ensemble.
Il ne resterait enfin qu'un dernier tableau à tracer, celui de nos espérances, des progrès qui sont réservés aux générations futures, et que la constance des lois de la nature semble leur assurer. Il faudrait y montrer par quels degrés ce qui nous paraîtrait aujourd'hui un espoir chimérique doit successivement devenir possible, et même facile; pourquoi, malgré les succès passagers des préjugés, et l'appui qu'ils reçoivent de la corruption des gouvernements ou des peuples, la vérité seule doit obtenir un triomphe durable; par quels liens la nature a indissolublement uni les progrès des lumières et ceux de la liberté, de la vertu, du respect pour les droits naturels de l'homme; comment ces seuls biens réels, si souvent séparés qu'on les a crus même incompatibles, doivent au contraire devenir inséparables, dès l'instant où les lumières auront atteint un certain terme dans un plus grand nombre de nations à la fois, et qu'elles auront pénétré la masse entière d'un grand peuple, dont la langue serait universellement répandue, dont les relations commerciales embrasseraient toute l'étendue du globe. Cette réunion s'étant déjà opérée dans la classe entière des hommes éclairés, on ne compterait plus dès lors parmi eux que des amis de l'humanité, occupés de concert à accélérer son perfectionnement et son bonheur.
Nous exposerons l'origine, nous tracerons l'histoire des erreurs générales, qui ont plus ou moins retardé ou suspendu la marche de la raison, qui souvent même, autant que les événements politiques, ont fait rétrograder l'homme vers l'ignorance.
Les opérations de l'entendement qui nous conduisent à l'erreur ou qui nous y retiennent, depuis le paralogisme subtil, qui peut surprendre l'homme le plus éclairé, jusqu'aux rêves de la démence, n'appartiennent pas moins que la méthode de raisonner juste ou celle de découvrir la vérité, à la théorie du développement de nos facultés individuelles : et, par la même raison, la manière dont les erreurs générales s'introduisent parmi les peuples, s'y propagent, s'y transmettent, s'y perpétuent, fait partie du tableau historique des progrès de l'esprit humain.
Comme les vérités qui le perfectionnent et qui l'éclairent, elles sont la suite nécessaire de son activité, de cette disproportion toujours existante entre ce qu'il connaît, ce qu'il a le désir et ce qu'il croit avoir le besoin de connaître.
On peut même observer que, d'après les lois générales du développement de nos facultés, certains préjugés ont dû naître à chaque époque de nos progrès, mais pour étendre bien au delà leur séduction ou leur empire; parce que les hommes conservent encore les préjugés de leur enfance, ceux de leur pays et de leur siècle, longtemps après avoir reconnu toutes les vérités nécessaires pour les détruire.
Enfin, dans tous les pays, dans tous les temps, il est des préjugés différents, suivant le degré d'instruction des diverses classes d'hommes, comme suivant leurs professions. Ceux des philosophes nuisent aux nouveaux progrès de la vérité; ceux des classes moins éclairées retardent la propagation des vérités déjà connues; ceux de certaines professions accréditées ou puissantes y opposent des obstacles: ce sont trois genres d'ennemis que la raison est obligée de combattre sans cesse, et dont elle ne triomphe souvent qu'après une lutte longue et pénible. L'histoire de ces combats, celle de la naissance, du triomphe et de la chute des préjugés, occupera donc une grande place dans cet ouvrage, et n'en sera la partie ni la moins importante, ni la moins utile..."

Un "tableau historique" pour "présenter l'ordre des changements, exposer l'influence qu'exerce chaque instant sur l'instant qui lui succède, et montrer ainsi, dans les modifications qu'a reçues l'espère humaine, en se renouvelant sans cesse au milieu de l'immensité des siècles, la marche qu'elle a suivie, les pas qu'elle a faits vers la vérité ou le bonheur. Ces observations, sur ce que l'homme a été, sur ce qu'il est aujourd'hui, conduiront ensuite aux moyens d'assurer et d'accélérer les nouveaux progrès que sa nature lui permet d'espérer encore..."
- Première époque. Les hommes sont réunis en peuplades.
- Deuxième époque. Les peuples pasteurs. - Passage de cet état à celui des peuples agriculteurs.
- Troisième époque. Progrès des peuples agriculteurs, jusqu'à l'invention de l'écriture alphabétique.
- Quatrième époque. Progrès de l'esprit humain dans la Grèce, jusqu'au temps de la division des sciences, vers le siècle d'Alexandre.
- Cinquième époque. Progrès des sciences depuis leur division jusqu'à leur décadence.
- Sixième époque. Décadence des lumières, jusqu'à leur restauration, vers le temps des croisades.
- Septième époque. Depuis les premiers progrès des sciences, lors de leur restauration dans l'Occident, jusqu'à l'invention de l'imprimerie.
- Huitième époque. Depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'au temps où les sciences et la philosophie secouèrent le joug de l'autorité.
- Neuvième époque. Depuis Descartes jusqu'à la formation de la République française
- Dixième époque. Les progrès futurs de l'esprit humain.

Quatrième époque - Progrès de l'esprit humain dans la Grèce, jusqu'au temps de la division des sciences, vers le siècle d'Alexandre.
"Les Grecs, dégoûtés de ces rois qui, se disant les enfants des dieux, déshonoraient l'humanité par leurs fureurs et par leurs crimes, s'étaient partagés en républiques, parmi lesquelles Lacédémone seule reconnaissait des chefs héréditaires, mais contenus par l'autorité des autres magistratures, mais soumis aux lois, comme les citoyens, et affaiblis par le partage de la royauté entre les aînés des deux branches de la famille des Héraclides.
Les habitants de la Macédoine, de la Thessalie, de l'Epire, liés aux Grecs par une origine commune, par l'usage d'une même langue, et gouvernés par des princes faibles et divisés entre eux, ne pouvaient opprimer la Grèce ; ils suffisaient pour la préserver au nord des incursions des nations scythiques.
À l'occident, l'Italie, partagée en États isolés et peu étendus, ne pouvait inspirer à la Grèce aucune crainte. Déjà même la Sicile presque entière, les plus beaux ports de la partie méridionale de l'Italie étaient occupés par des colonies grecques, qui, en conservant avec
leurs métropoles des liens de fraternité, formaient néanmoins des républiques indépendantes. D'autres colonies s'étaient établies dans les îles de la mer Egée, et sur une partie des côtes de l'Asie Mineure.
Ainsi la réunion de cette partie du continent asiatique au vaste empire de Cyrus, fut, dans la suite, le seul danger réel qui pût menacer l'indépendance de la Grèce et la liberté de ses habitants.
La tyrannie, quoique plus durable dans quelques colonies, et surtout dans celles dont l'établissement avait précédé la destruction des familles royales, ne pouvait être considérée que comme un fléau passager et partiel qui faisait le malheur des habitants de quelques villes, sans influer sur l'esprit général de la nation.
La Grèce avait reçu des peuples de l'Orient leurs arts, une partie de leurs connaissances, l'usage de l'écriture alphabétique, et leur système religieux ; mais des communications établies entre elle et ces peuples, par des Orientaux exilés, qui avaient cherché un asile dans la Grèce, par des Grecs qui voyageaient en Orient, transportèrent seules dans la Grèce les lumières et les erreurs de l'Asie et de l'Égypte.
Les sciences ne pouvaient donc être devenues dans la Grèce l'occupation et le patrimoine d'une caste particulière. Les fonctions de leurs prêtres se bornèrent au culte des dieux. Le génie pouvait y déployer toutes ses forces, sans être assujetti à des observances pédantesques, au système d'hypocrisie d'un collège sacerdotal. Tous les hommes conservaient un droit égal à la connaissance de la vérité. Tous pouvaient chercher à la découvrir pour la communiquer à tous, et la leur communiquer tout entière. Cette heureuse circonstance, plus encore que la liberté politique, laissait à l'esprit humain, chez les Grecs, une indépendance, garant assuré de la rapidité et de l'étendue de ses progrès.
Cependant, leurs sages, leurs savants, qui prirent bientôt après le nom plus modeste de philosophes ou d'amis de la science, de la sagesse, s'égarèrent dans l'immensité du plan trop vaste qu'ils avaient embrassé. Ils voulurent pénétrer la nature de l'homme et celle des dieux, l'origine du monde et celle du genre humain. Ils essayèrent de réduire la nature entière à un seul principe, et les phénomènes de l'univers à une loi unique. Ils cherchèrent à renfermer dans une seule règle de conduite, et tous les devoirs de la morale, et le secret du véritable bonheur.
Ainsi, au lieu de découvrir des vérités, ils forgèrent des systèmes ; ils négligèrent l'observation des faits, POUR S'ABANDONNER A LEUR IMAGINATION ; et ne pouvant appuyer leurs opinions sur des preuves, ils essayèrent de les défendre par des subtilités. Cependant, ces mêmes hommes cultivaient avec succès la géométrie et l'astronomie. La Grèce leur dut les premiers éléments de ces sciences, et même quelques vérités nouvelles, ou du moins la connaissance de celles qu'ils avaient rapportées de l'Orient, non comme des croyances établies, mais comme des théories, dont ils connaissaient les principes et les preuves.
Au milieu de la nuit de ces systèmes nous voyons même briller deux idées heureuses, qui reparaîtront encore dans des siècles plus éclairés.
Démocrite regardait tous les phénomènes de l'univers comme le résultat des combinaisons et du mouvement de corps simples, d'une figure déterminée et immuable, ayant reçu une impulsion première, d'où résulte une quantité d'action qui se modifie dans chaque atome, mais qui, dans la masse entière, se conserve toujours la même. Pythagore annonçait que l'univers était gouverné par une harmonie dont les propriétés des nombres devaient dévoiler les principes ; c'est-à-dire, que tous les phénomènes étaient soumis à des lois générales et calculées. On reconnaît aisément, dans ces deux idées, et les systèmes hardis de Descartes, et la philosophie de Newton.
Pythagore découvrit par ses méditations, ou reçut des prêtres, soit de l'Égypte, soit de l'Inde, la véritable disposition des corps célestes et le vrai système du monde : il le fit connaître aux Grecs. Mais ce système était trop contraire au témoignage des sens, trop opposé aux idées vulgaires, pour que les faibles preuves sur lesquelles on pouvait en établir la vérité, fussent capables d'entraîner les esprits. Il resta caché dans le sein de l'école pythagoricienne, et fut oublié avec elle, pour reparaître vers la fin du XVIe siècle, appuyé de preuves certaines, qui ont alors triomphé et de la répugnance des sens, et des préjugés de la superstition, plus puissants encore et plus dangereux.
Cette école pythagoricienne s'était répandue principalement dans la grande Grèce ; elle y formait des législateurs et d'intrépides défenseurs des droits de l'humanité : elle succomba sous les efforts des tyrans. Un d'eux brûla les Pythagoriciens dans leur école ; et ce fut une raison suffisante sans doute, non pour abjurer la philosophie, non pour abandonner la cause des peuples, mais pour cesser de porter un nom devenu trop dangereux, et pour quitter des formes qui n'auraient plus servi qu'à réveiller les fureurs des ennemis de la liberté et de la raison.
Une des premières bases de toute bonne philosophie est de former pour chaque science une langue exacte et précise, où chaque signe représente une idée bien déterminée, bien circonscrite, et de parvenir à bien déterminer, à bien circonscrire les idées par une analyse rigoureuse.
Les Grecs, au contraire, abusèrent des vices de la langue commune, pour jouer sur le sens des mots, pour embarrasser l'esprit dans de misérables équivoques, pour l'égarer, en exprimant successivement par un même signe des idées différentes. Cette subtilité donnait cependant de la finesse aux esprits, en même temps qu'elle épuisait leur force contre de chimériques difficultés.
Ainsi, cette philosophie de mots, en remplissant des espaces où la raison humaine semble s'arrêter devant quelque obstacle supérieur à ses forces, ne sert point immédiatement à ses progrès, mais elle les prépare ; et nous aurons encore occasion de répéter cette même observation.
C'était en s'attachant à des questions peut-être à jamais insolubles, en se laissant séduire par l'importance ou la grandeur des objets, sans songer si l'on aurait les moyens d'y atteindre ; c'était en voulant établir les théories avant d'avoir rassemblé les faits, et construire l'univers quand on ne savait pas même encore l'observer ; c'était cette erreur, alors bien excusable, qui, dès les premiers pas, avait arrêté la marche de la philosophie.
Aussi Socrate, en combattant les sophistes, en couvrant de ridicule leurs vaines subtilités, criait-il aux Grecs de rappeler enfin sur la terre cette philosophie qui se perdait dans le ciel ; non qu'il dédaignât ni l'astronomie, ni la géométrie, ni l'observation des phénomènes de la nature ; non qu'il eût l'idée puérile et fausse de réduire l'esprit humain à la seule étude de la morale : c'est au contraire précisément à son école et à ses disciples que les sciences mathématiques et physiques durent leurs progrès ; parmi les ridicules qu'on cherche à lui donner dans les comédies, le reproche qui amène le plus de plaisanteries est celui de cultiver la géométrie, d'étudier les météores, de tracer des cartes de géographie, de faire des observations sur les verres brûlants, dont, par une singularité remarquable, l'époque la plus reculée ne nous a été transmise que par une bouffonnerie d'Aristophane.
Socrate voulait seulement avertir les hommes de se borner aux objets que la nature a mis à leur portée ; d'assurer chacun de leurs pas avant d'en essayer de nouveaux ; d'étudier l'espace qui les entoure, avant de s'élancer au hasard dans un espace inconnu.
La mort de Socrate est un événement important dans l'histoire humaine ; elle fut le premier crime qui ait signalé cette guerre de la philosophie et de la superstition ; guerre qui dure encore parmi nous, comme celle de la même philosophie contre les oppresseurs de l'humanité, dont l'incendie d'une école pythagoricienne avait marqué l'époque. L'histoire de ces guerres va devenir une des parties les plus importantes du tableau qui nous reste à tracer.
Les prêtres voyaient avec douleur des hommes qui, cherchant à perfectionner leur raison, à remonter aux causes premières, connaissaient toute l'absurdité de leurs dogmes, toute l'extravagance de leurs cérémonies, toute la fourberie de leurs oracles et de leurs prodiges. Ils craignaient que ces philosophes ne confiassent ce secret aux disciples qui fréquentaient leurs écoles : que d'eux il ne passât à tous ceux qui, pour obtenir de l'autorité ou du crédit, étaient obligés de donner quelque culture à leur esprit ; et qu'ainsi l'empire sacerdotal ne fût bientôt réduit à la classe la plus grossière du peuple, qui finirait elle-même par être désabusée.
L'hypocrisie effrayée se hâta d'accuser les philosophes d'impiété envers les dieux, afin qu'ils n'eussent pas le temps d'apprendre aux peuples que ces dieux étaient l'ouvrage de leurs prêtres. Les philosophes crurent échapper à la persécution, en adoptant, à l'exemple des
prêtres eux-mêmes, l'usage d'une double doctrine, en ne confiant qu'à des disciples éprouvés les opinions qui blessaient trop ouvertement les préjugés vulgaires.
Mais les prêtres présentaient au peuple comme des blasphèmes les vérités physiques même les plus simples. Ils poursuivirent Anaxagore, pour avoir osé dire que le soleil était plus grand que le Péloponèse. Socrate ne put échapper à leurs coups. Il n'y avait plus dans Athènes de Périclès qui veillât à la défense du génie et de la vertu. D'ailleurs, Socrate était bien plus coupable. Sa haine pour les sophistes, son zèle pour ramener vers des objets plus utiles la philosophie égarée, annonçait aux prêtres que la vérité seule était l'objet de ses recherches ; qu'il voulait, non faire adopter par les hommes un nouveau système, et soumettre leur imagination à la sienne, mais leur apprendre à faire usage de leur raison ; et de tous les crimes, c'est celui que l'orgueil sacerdotal sait le moins pardonner.
Ce fut au pied du tombeau même de Socrate que Platon dicta les leçons qu'il avait reçues de son maître. Son style enchanteur, sa brillante imagination, les tableaux riants ou majestueux, les traits ingénieux et piquants, qui, dans ses Dialogues, font disparaître la sécheresse des discussions philosophiques ; ces maximes d'une morale douce et pure, qu'il a su y répandre ; cet art avec lequel il met ses personnages en action et conserve à chacun son caractère ; toutes ces beautés, que le temps et les révolutions des opinions n'ont pu flétrir, ont dû sans doute obtenir grâce pour les rêves philosophiques qui trop souvent forment le fond de ses ouvrages, pour cet abus des mots que son maître avait tant reproché aux sophistes, et dont il n'a pu préserver le plus grand de ses disciples.
On est étonné, en lisant ses Dialogues, qu'ils soient l'ouvrage d'un philosophe qui, par une inscription placée sur la porte de son école, en défendait l'entrée à quiconque n'aurait pas étudié la géométrie ; et que celui qui débite avec tant d'audace des hypothèses si creuses et si frivoles, ait été le fondateur de la secte, où l'on a soumis pour la première fois, à un examen rigoureux, les fondements de la certitude des connaissances humaines, et même ébranlé ceux qu'une raison plus éclairée aurait fait respecter.
Mais la contradiction disparaît, si l'on songe que jamais Platon ne parle en son nom ; que Socrate, son maître, s'y exprime toujours avec la modestie du doute ; que les systèmes y sont présentés au nom de ceux qui en étaient, ou que Platon supposait en être les auteurs : qu'ainsi ces mêmes Dialogues sont encore une école de pyrrhonisme, et que Platon y a su montrer à la fois l'imagination hardie d'un savant qui se plaît à combiner, à développer de brillantes hypothèses, et la réserve d'un philosophe qui se livre à son imagination, sans se laisser entraîner par elle ; parce que sa raison, armée d'un doute salutaire, sait se défendre des illusions même les plus séduisantes...."

CONDORCET, NEUVIEME EPOQUE ...
"Depuis Descartes jusqu'à la formation de la République française. Nous avons vu la raison humaine se former lentement par les progrès naturels de la civilisation; la superstition s'emparer d'elle pour la corrompre, et le despotisme dégrader et engourdir les esprits sous le poids de la crainte et du malheur.
Un seul peuple échappe à cette double influence. De cette terre heureuse où la liberté vient d'allumer le flambeau du génie, l'esprit humain, affranchi des liens de son enfance, s'avance vers la vérité d'un pas ferme.
Mais la conquête ramène bientôt avec elle la tyrannie, que suit la superstition, sa compagne fidèle, et l'humanité tout entière est replongée dans des ténèbres qui semblent devoir être éternelles. Cependant, le jour renaît peu à peu; les yeux, longtemps condamnés à l'obscurité, l'entrevoient, se referment, s'y accoutument lentement, fixent enfin la lumière, et le génie ose se remontrer sur ce globe, d'où le fanatisme et la barbarie l'avaient exilé. Déjà nous avons vu la raison soulever ses chaînes, en relâcher quelques-unes; et acquérant sans cesse des forces nouvelles, préparer, accélérer l'instant de sa liberté.
Il nous reste à parcourir l'époque où elle acheva de les rompre, où, forcée d'en traîner encore les restes, elle s'en délivre peu à peu; où, libre enfin dans sa marche, elle ne peut plus être arrêtée que par ces obstacles dont le renouvellement est inévitable à chaque nouveau progrès, parce qu'ils ont pour cause nécessaire la constitution même de notre intelligence, c'est-à-dire, un rapport établi par la nature entre nos moyens pour découvrir la vérité, et la résistance qu'elle oppose à nos efforts.
L'intolérance religieuse avait forcé sept des provinces belgiques à secouer le joug de l'Espagne, et à former une république fédérative. Elle seule avait réveillé la liberté anglaise, qui, fatiguée par de longues et sanglantes agitations, a fini par se reposer dans une constitution longtemps admirée par la philosophie, et désormais réduite à n'avoir plus pour appui que la superstition nationale et l'hypocrisie politique. Enfin, c'était encore aux persécutions sacerdotales que la nation suédoise avait dû le courage de ressaisir une partie de ses droits. Cependant, au milieu de ces mouvements, causés par des querelles théologiques, la France, l'Espagne, la Hongrie, la Bohême, avaient vu s'anéantir leurs faibles libertés, ou ce qui, du moins, en avait l'apparence.
On chercherait en vain, dans les pays appelés libres, cette liberté qui ne blesse aucun des droits naturels de l'homme; qui non seulement lui en réserve la propriété, mais lui en conserve l'exercice. Celle qu'on y trouve, fondée sur un droit positif inégalement réparti, accorde plus ou moins de prérogatives à un homme, suivant qu'il habite telle ou telle ville, qu'il est né dans telle ou telle classe, qu'il a telle ou telle fortune, qu'il exerce telle ou telle profession; et le tableau rapproché de ces distinctions bizarres dans les diverses nations, sera la meilleure réponse que nous puissions opposer à ceux qui en soutiennent encore les avantages et la nécessité.
Mais, dans ces mêmes pays, les lois garantissent la liberté individuelle et civile; mais si l'homme n'y est pas tout ce qu'il doit être, la dignité de sa nature n'y est point avilie: quelques-uns de ces droits sont au moins reconnus; on ne peut plus dire qu'il soit esclave; on doit dire seulement qu'il ne sait pas encore être vraiment libre.
Chez les nations où, pendant le même temps, la liberté a fait des pertes plus ou moins réelles, les droits politiques dont la masse du peuple jouissait étaient renfermés dans des limites si étroites, que la destruction de l'aristocratie presque arbitraire sous laquelle il avait gémi semble en avoir plus que compensé la perte. Il a perdu ce titre de citoyen, que l'inégalité rendait presque illusoire; mais la qualité d'homme a été plus respectée; et le despotisme royal l'a sauvé de l'oppression féodale, l'a soustrait à cet état d'humilíation, d'autant plus pénible que le nombre et la présence de ses tyrans en renouvellent sans cesse le sentiment. Les lois ont dû se perfectionner et dans les constitutions demi-libres, parce que l'intérêt de ceux qui y exercent un véritable pouvoir, n'est pas habituellement contraire aux intérêts généraux du peuple; et dans les Etats despotiques, soit parce que l'intérêt de la prospérité publique se confond souvent avec celui du despote, soit parce que, cherchant lui-même à détruire les restes du pouvoir des nobles ou du clergé, il en résultait dans les lois un esprit d'égalité, dont le motif était d'établir celle de l'esclavage, mais dont les effets pouvaient souvent être salutaires.
Nous exposerons en détail les causes qui ont produit en Europe ce genre de despotisme dont, ni les siècles antérieurs, ni les autres parties du monde, n'ont offert d'exemple; où l'autorité presque arbitraire, contenue par l'opinion, réglée par les lumières, adoucie par son propre intérêt, a souvent contribué aux progrès de la richesse, de l'industrie, de l'instruction, et quelquefois même à ceux de la liberté civile.
Les mœurs se sont adoucies par l'affaiblissement des préjugés qui en avaient maintenu la férocité; par l'influence de cet esprit de commerce et d'industrie, ennemi des violences et des troubles qui font fuir la richesse; par l'horreur qu'inspirait le tableau encore récent des barbaries de l'époque précédente; par une propagation plus générale des idées philosophiques, d'égalité et d'humanité; enfin, par l'effet lent, mais sûr, du progrès général des lumières.
L'intolérance religieuse a subsisté, mais comme une invention de la prudence humaine, comme un hommage aux préjugés du peuple, ou une précaution contre son effervescence. Elle a perdu ses fureurs; les bûchers, rarement allumés, ont été remplacés par une
oppression souvent plus arbitraire, mais moins barbare; et dans ces derniers temps, on n'a plus persécuté que de loin en loin, et, en quelque sorte, par habitude ou par complaisance. Partout, et sur tous les points, la pratique des gouvernements avait suivi, mais lentement et comme à regret, la marche de l'opinion, et même celle de la philosophie...."
L'amour du genre humain, qui marque les Lumières, ne peut manquer de s'accompagner de la plus grande confiance dans son génie et dans ses progrès. Les contacts de plus en plus étroits avec d'autres civilisations ont pu susciter, il est vrai, quelques doutes quant au bien-fondé des valeurs occidentales et à leur supériorité. Mais si le mythe du bon sauvage a séduit certains d'entre eux (on pense à Rousseau et au Diderot du Supplément au voyage de Bougainville), la plupart des philosophes du siècle sont animés par la conviction qu'un "amour de l'ordre anime en secret le genre humain" (Voltaire, Essai sur les mœurs) et que l'effort vers la civilisation est inscrit dans la nature. Leur matérialisme et leur scientisme les incitent d'ailleurs à apercevoir dans les phénomènes naturels ce même ordre dont l'homme ne saurait s'excepter ..

Dixième époque, Des progrès futurs de l'esprit humain ?
« Si l'homme peut prédire, avec une assurance presque entière les phénomènes dont il connaît les lois; si, lors même qu'elles lui sont inconnues, il peut, d'après l'expérience du passé, prévoir, avec une grande probabilité, les événements de l'avenir; pourquoi regarderait-on comme une entreprise chimérique, celle de tracer, avec quelque vraisemblance, le tableau des destinées futures de l'espèce humaine, d'après les résultats de son histoire ? Le seul fondement de croyance dans les sciences naturelles, est cette idée que les lois générales, connues ou ignorées, qui règlent les phénomènes de l'univers, sont nécessaires et constantes; et par quelle raison ce principe serait-il moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et morales de l'homme, que pour les autres opérations de la nature ? Enfin, puisque des opinions formées d'après l'expérience du passé, sur des objets du même ordre, sont la seule règle de la conduite des hommes les plus sages, pourquoi interdirait-on au philosophe d'appuyer ses conjectures sur cette même base, pourvu qu'il ne leur attribue pas une certitude supérieure à celle qui peut naître du nombre, de la constance, de l'exactitude des observations ?
Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l'inégalité entre les nations; les progrès de l'égalité dans un même peuple; enfin, le perfectionnement réel de l'homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l'état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés, tels que les français et les anglo-américains ? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l'ignorance des sauvages, doit-elle peu à peu s'évanouir ?
Y a-t-il sur le globe des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
Cette différence de lumières, de moyens ou de richesses, observée jusqu'à présent chez tous les peuples civilisés entre les différentes classes qui composent chacun d'eux; cette inégalité, que les premiers progrès de la société ont augmentée, et pour ainsi dire produite, tient-elle à la civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l'art social ? Doit-elle continuellement s'affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l'art social, qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu'une inégalité utile à l'intérêt de tous, parce qu'elle favorisera les progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie, sans entraîner, ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement; en un mot, les hommes approcheront-ils de cet état où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d'après leur propre raison dans les affaires communes de la vie, et la maintenir exempte de préjugés, pour bien connaître leurs droits et les exercer d'après leur opinion et leur conscience; où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins; où enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents, et non l'état habituel d'une portion de la société ?
Enfin, l'espèce humaine doit-elle s'améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et, par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et de prospérité commune; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique; soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l'intensité et dirigent l'emploi de ces facultés, ou même de celui de l'organisation naturelle de l'homme ?
En répondant à ces trois questions, nous trouverons, dans l'expérience du passé, dans l'observation des progrès que les sciences, que la civilisation ont faits jusqu'ici, dans l'analyse de la marche de l'esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n'a mis aucun terme à nos espérances. »

"Je vous salue, ruines solitaires, tombeaux saints, murs silencieux! c'est vous que j'invoque ; c'est à vous que j'adresse ma prière. Oui ! tandis que votre aspect repousse d'un secret effroi les regards du vulgaire , mon cœur trouve à vous contempler le charme des sentiments profonds et des hautes pensées. Combien d'utiles leçons , de réflexions touchantes ou fortes n'offrez-vous pas à l'esprit qui sait vous consulter I C'est vous qui , lorsque la terre entière asservie se taisait devant les tyrans, proclamiez déjà les vérités qu'ils détestent, et qui, confondant la dépouille des rois avec celle du dernier esclave , attestiez le saint dogme de I'égalité. C'est dans votre enceinte , qu'amant solitaire de la liberté , j'ai vu m'apparaître son génie, non tel que se le peint un vulgaire insensé, armé de torches et de poignards, mais sous l'aspect auguste de la justice, tenant en ses mains les balances sacrées où se pèsent les actions des mortels aux portes de l'éternité..." ( Invocation)
Volney (1757-1820), "Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires" (1791)
Apres avoir commencé ses études de médecine à Paris, Constantin François Chasseboeuf, comte de Volney, se consacra bientôt à des travaux d'érudition, écrit un mémoire "Sur la chronologie d'Hérodote" (1781), qui lui valut l'amitié d'Holbach et de se faire accepter dans la société de Mme Helvétius, puis se fait reconnaître comme écrivain par son récit de "Voyage en Egypte et en Syrie" (1787). C'est en 1791, alors qu'il siégeait à la Constituante comme député du Tiers, qu'il publia son grand ouvrage, "Les Ruines ou Méditations sur les révolutions des empires". En 1793, son petit ouvrage "La Loi naturelle ou catéchisme du citoyen" eut un immense succès, mais sous la Terreur l'auteur fut accusé de royalisme et incarcéré. Sauvé par le 9-Thermidor et la chute de Robespierre, Volney fut nommé en 1794 professeur d'histoire aux Ecoles normales, et devint membre de l'lnstitut dès sa création. En 1795, il entreprit un voyage aux Etats-Unis, y sera accueilli par son ami Benjamin Franklin.
"Mais à peine arrivé en Amérique , après une longue et pénible traversée , loin de se livrer à un repos nécessaire et qu'il semblait y être venu chercher, Volney, toujours avide d'instruction, ne put résister à la vue du vaste champ d'observations qui s'ouvrait devant lui. Il s'était depuis long- temps persuadé de cette vérité, qu'il n'est rien de si difficile que de parler avec justesse du système général d'un pays ou d'une nation, et qu'on ne peut le faire qu'en observant et voyant par soi-même. Il se mit donc en devoir d'explorer cette nouvelle contrée , comme douze années auparavant il avait traversé les pays d'Orient, c'est-à- dire, presque toujours à pied et sans guide. Ce fut ainsi qu'il parcourut successivement toutes les parties des États-Unis, étudiant le climat, les lois, les habitants , les mœurs , et lisant dans le grand livre de la nature les divers changements opérés par la force toute-puissante des siècles.
Le grand Washington , le libérateur des États- Unis , le guerrier patriote qui avait préféré la liberté de son pays à de vains honneurs, Washington ne pouvait voir avec indifférence l'auteur des "Ruines", aussi le reçut-il avec distinction , et lui donna-t-il publiquement les marques d'estime et de confiance. Il n'en fut pas de même de J. Adams, qui exerçait alors les premières fonctions de la république. Volney , toujours sincère, avait critiqué franchement un livre que le président avait publié quelque temps avant d'être élevé à la magistrature quinquennale. On attribua généralement à une petite rancune d'auteur une persécution injuste et absurde que Volney eut à essuyer. Il fut accusé d'être l'agent secret d'un gouvernement dont la hache n'avait cessé de frapper des hommes , qui , comme lui, étaient les amis sincères d'une liberté raisonnable. On prétendit qu'il avait voulu livrer la Louisiane au directoire , tandis qu'il avait publié ouvertement que, suivant lui, l'invasion de cette province était un faux calcul politique. Ce fut dans ce même temps qu'il fut en butte aux attaques du docteur Priestley, aussi célèbre par ses talents que remarquable par une manie de catéchiser que l'incendie de sa maison à Londres n'avait pu guérir. Le physicien anglais n'avait pu lire de sang froid quelques pages des Ruines sur les diverses croyances des peuples..."
Partisan du coup d'Etat du 18-Brumaíre, organisé par Emmanuel-Joseph Sieyès et exécuté par Napoléon Bonaparte, et qui marque la fin du Directoire et de la Révolution, Volney fut nommé membre du Sénat dont il fut par la suite vice-président.
Mais, après s'être opposé au Concordat, à l'expédition de Saint-Domingue et à la proclamation de l'empire, il disparait de la scène politique et la dernière partie de sa vie fut exclusivement consacrée à ses travaux d'érudition : "Simplification des langues orientales" (1795), "Leçons d'histoire, professée à l'Ecole normale" (1799), "Tableau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amérique" (1803), "Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne" (1804), "Histoire de Samuel, inventeur du sacre des rois" (1819), "L'Alphabet européen appliqué aux langues asiatiques" (1819), ...

LES RUINES, ou MÉDITATION SUR LES RÉVOLUTIONS DES EMPIRES.
CHAPITRE PREMIER.
Le Voyage.
"La onzième année du règne d' Abd-ul-Hamid , fils d'Ahmed, empereur des Turks, au temps où les Russes victorieux s'emparèrent de la Krimée et plantèrent leurs étendards sur le rivage qui mène à Constantinople , je voyageais dans l'empire des Ottomans , et je parcourais les provinces qui jadis furent les royaumes d'Egypte et de Syrie.
Portant toute mon attention sur ce qui concerne le bonheur des hommes dans l'état social, j'entrais dans les villes et j'étudiais les mœurs de leurs habitants ; je pénétrais dans les palais, et j'observais la conduite de ceux qui gouvernent ; je m' écartais dans les campagnes, et j'examinais la condition des hommes qui cultivent ; et partout ne voyant que brigandage et dévastation , que tyrannie et que misère, mon cœur était oppressé de tristesse et d'indignation.
Chaque jour je trouvais sur ma route des champs abandonnés , des villages désertés , des villes en ruines : souvent je rencontrais d'antiques monuments, des débris de temples, de palais et de forteresses; des colonnes, des aqueducs, des tombeaux : et ce spectacle tourna mon esprit vers la méditation des temps passés , et suscita dans mon cœur des pensées graves et profondes.
Et j'arrivai à la ville de Hems , sur les bords de l'Oronte; et là , me trouvant rapproché de celle de Palmyre, située dans le désert, je résolus de connaître par moi-même ses monuments si vantés ; et, après trois jours de marche dans des solitudes arides, ayant traversé une vallée remplie de grottes et de sépulcres , tout à coup , au sortir de cette vallée, j'aperçus dans la plaine la scène de ruines la plus étonnante : c'était une multitude innombrable de superbes colonnes debout , qui , telles que les avenues de nos parcs , s'étendaient à perte de vue en files symétriques. Parmi ces colonnes étaient de grands édifices, les uns entiers, les autres demi-écroulés. De toutes parts la terre était jonchée de semblables débris , de corniches , de chapiteaux , de fûts , d'entablements , de pilastres , tous de marbre blanc, d'un travail exquis. Après trois quarts d'heure de marche le long de ces ruines, j'entrai dans l'enceinte d'un vaste édifice, qui fut jadis un temple dédié au soleil ; et je pris l'hospitalité chez de pauvres paysans arabes , qui ont établi leurs chaumières sur le parvis même du temple, et je résolus de demeurer pendant quelques jours pour considérer en détail la beauté de tant d'ouvrages.
Chaque jour je sortais pour visiter quelqu'un des monuments qui couvrent la plaine; et un soir que, l'esprit occupé de réflexions, je m'étais avancé jusqu'à la vallée des sépulcres , je montai sur les hauteurs qui la bordent, et d'où l'œil domine à la fois l'ensemble des ruines et l'immensité du désert. — Le soleil venait de se coucher; un bandeau rougeâtre marquait encore sa trace à l'horizon lointain des monts de la Syrie : la pleine lune à l'orient s'élevait sur un fond bleuâtre, aux planes rives de l'Euphrate : le ciel était pur, l'air calme et serein; l'éclat mourant du jour tempérait l'horreur des ténèbres; la fraîcheur naissante de la nuit calmait les feux de la terre embrasés; les pâtres avaient retiré leurs chameaux; l'œil n'apercevait plus aucun mouvement sur la terre monotone et grisâtre ; un vaste silence régnait sur le désert; seulement à de longs intervalles on entendait les lugubres cris de quelques oiseaux de nuit et de quelques chacals .. . L'ombre croissait, et déjà dans le crépuscule mes regards ne distinguaient plus que les fantômes blanchâtres des colonnes et des murs... Ces lieux solitaires, cette soirée paisible, cette scène majestueuse, imprimèrent à mon esprit un recueillement religieux. L'aspect d'une grande cité déserte, la mémoire des temps passés, la comparaison de l'état présent , tout éleva mon cœur à de hautes pensées. Je m'assis sur le tronc d'une colonne; et là, le coude appuyé sur le genou, la tête soutenue sur la main, tantôt portant mes regards sur le désert, tantôt les fixant sur les ruines, je m'abandonnai à une rêverie profonde.
CHAPITRE II. La Méditation.
Ici , me dis-je , ici fleurit jadis une ville opulente : ici fut le siège d'un empire puissant. Oui, ces lieux maintenant si déserts, jadis une multitude vivante animait leur enceinte; une foule active circulait dans ces routes aujourd'hui solitaires. En ces murs où règne un morne silence, retentissaient sans cesse le bruit des arts et les cris d'allégresse et de fête : ces marbres amoncelés formaient des palais réguliers ; ces colonnes abattues ornaient la majesté des temples; ces galeries écroulées dessinaient les places publiques. Là , pour les devoirs respectables de son culte, pour les soins touchants de sa subsistance, affluait un peuple nombreux : là, une industrie créatrice de jouissances appelait les richesses de tous les climats , et l'on voyait s'échanger la pourpre de Tyr pour le fil précieux de la Sérique, les tissus moelleux de Kachemire pour les tapis fastueux de la Lydie , l'ambre de la Baltique pour les perles et les parfums arabes , l'or d'Ophir pour l'étain de Thulé.
Et maintenant voilà ce qui subsiste de cette ville puissante , un lugubre squelette ! Voilà ce qui reste d'une vaste domination , un souvenir obscur et vain ! Au concours bruyant qui se pressait sous ces portiques a succédé une solitude de mort. Le silence des tombeaux s'est substitué au murmure des places publiques. L'opulence d'une cité de commerce s'est changée en une pauvreté hideuse. Les palais des rois sont devenus le repaire des bêtes fauves ; les troupeaux parquent au seuil des temples , et les reptiles immondes habitent les sanctuaires des dieux!... Ah! comment s'est éclipsée tant de gloire! comment se sont anéantis tant de travaux !... Ainsi donc périssent les ouvrages des hommes! ainsi s'évanouissent les empires et les nations! ..."
CHAPITRE XIII.
"L'espèce humaine s'améliorera-t-elle?
A ces mots, oppressé du sentiment douloureux dont m'accabla leur sévérité : « Malheur aux nations ! m'écriai-je en fondant en larmes; malheur à moi-même! Ah ! c'est maintenant que j'ai désespéré du bonheur de l'homme. Puisque ses maux procèdent de son cœur , puisque lui seul peut y porter remède , malheur à jamais à son existence ! Qui pourra , en effet , mettre un frein à la cupidité du fort et du puissant? Qui pourra éclairer l'ignorance du faible? Qui instruira la multitude de ses droits, et forcera les chefs de remplir leurs devoirs? Ainsi , la race des hommes est pour toujours dévouée à la souffrance ! Ainsi , l'individu ne cessera d'opprimer l'individu , une nation d'attaquer une autre nation , et jamais il ne renaîtra pour ces contrées des jours de prospérité et de gloire. Hélas! des conquérants viendront ; ils chasseront les oppresseurs et s'établiront à leur place ; mais , succédant à leur pouvoir, ils succéderont à leur rapacité, et la terre aura changé de tyrans sans changer de tyrannie. »
Alors me tournant vers le Génie : « O Génie ! lui dis-je , le désespoir est descendu dans mon ame : en connaissant la nature de l'homme , la perversité de ceux qui gouvernent et l'avilissement de ceux qui sont gouvernés , m'ont dégoûté de la vie ; et quand il n'est de choix que d'être complice ou victime de l'oppression, que reste-t-il à l'homme vertueux, que de joindre sa cendre à celle des tombeaux! »
Et le Génie , gardant le silence , me fixa d'un regard sévère mêlé de compassion; et, après quelques instants, il reprit : « Ainsi, c'est à mourir que la vertu réside ! L'homme pervers est infatigable à consommer le crime, et l'homme juste se rebute au premier obstacle à faire le bien ! Mais tel est le cœur humain : un succès l'enivre de confiance, un revers l'abat et le consterne : toujours entier à la sensation du moment, il ne juge point des choses par leur nature , mais par l'élan de sa passion. Homme qui désespères du genre humain , sur quel calcul profond de faits et de raisonnements as-tu établi ta sentence? As-tu scruté l'organisation de l'être sensible, pour déterminer avec précision si les mobiles qui le portent au bonheur sont essentiellement plus faibles que ceux qui l'en repoussent? Ou bien, embrassant d'un coup d'œil l'histoire de l'espèce , et jugeant du futur par l'exemple du passé, as-tu constaté que tout progrès lui est impossible? Réponds! depuis leur origine, les sociétés n'ont-elles fait aucun pas vers l'instruction et un meilleur sort? Les hommes sont-ils encore dans les forêts, manquant de tout , ignorants , féroces , stupides? Les nations sont-elles encore toutes à ces temps où , sur le globe , l'œil ne voyait que des brigands brutes ou des brutes esclaves ? Si , dans un temps , dans un lieu , des individus sont devenus meilleurs , pourquoi la masse ne s'améliorerait-elle pas? Si des sociétés partielles se sont perfectionnées , pourquoi ne se perfectionnerait pas la société générale? Et si les premiers obstacles sont franchis, pourquoi les autres seraient-ils insurmontables?
« Voudrais-tu penser que l'espèce va se détériorant ? Garde-toi de l'illusion et des paradoxes du misanthrope . l'homme, mécontent du présent, suppose au passé une perfection mensongère, qui n'est que le masque de son chagrin. Il loue les morts en haine des vivants , il bat les enfants avec les ossements de leurs pères.
Pour démontrer une prétendue perfection rétrograde , il faudrait démentir le témoignage des faits et de la raison ; et s'il reste aux faits passés de l'équivoque , il faudrait démentir le fait subsistant de l'organisation de l'homme; il faudrait prouver qu'il naît avec un usage éclairé de ses sens; qu'il sait, sans expérience , distinguer du poison l'aliment ; que l'enfant est plus sage que le vieillard, l'aveugle plus assuré dans sa marche que le clairvoyant ; que l'homme civilisé est plus malheureux que l'anthropophage; en un mot, qu'il n'existe pas d'échelle progressive d'expérience et d'instruction.
« Jeune homme, crois-en la voix des tombeaux et le témoignage des monuments : des contrées sans doute ont déchu de ce qu'elles furent à certaines époques ; mais si l'esprit sondait ce qu'alors même furent la sagesse et la félicité de leurs habitants, il trouverait qu'il y eut dans leur gloire moins de réalité que d'éclat, il verrait que dans les anciens États, même les plus vantés, il y eut d'énormes vices , de cruels abus , d'où résulta précisément leur fragilité; qu'en général les principes des gouvernements étaient atroces ; qu'il régnait de peuple à peuple un brigandage insolent, des guerres barbares; des haines implacables ; que le droit naturel était ignoré; que la moralité était pervertie par un fanatisme insensé, par des superstitions déplorables: qu'un songe, qu'une vision, un oracle, causaient à chaque instant de vastes commotions : et peut-être les nations ne sont-elles pas encore bien guéries de tant de maux; mais du moins l'intensité en a diminué, et l'expérience du passé n'a pas été totalement perdue...."
