- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers - O'Connor
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Bataille - Michaux
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Bloch
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Boulgakov
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak
- 1960-1970
- 1960s
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- Pynchon - Heller - Toole
- Ellis
- U.Johnson - C.Wolf
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Grossman
- Warhol
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Berne
- 1970-1980
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Baldwin - Ellison
- Bergman
- Tennessee Williams
- Bradbury - A.C.Clarke
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Mishima
- Salinger - Styron
- Fromm
- Pasternak

Boris Vian (1920-1959), "J’irai cracher sur vos tombes" (1946), "L'écume des jours" (1947) - Raymond Queneau (1903-1976), "Le Dimanche de la vie" (1952), "Zazie dans le métro" (1959) - ...
Last update : 11/11/2016
La lecture de Boris Vian, pour peu que nous acceptions d'ouvrir notre imagination, notre vécu, et pourquoi pas notre perception du monde environnant, nous entraîne dans un univers qui, en introduction, ne raconte pas mais suggère des histoires, des personnages : fort de cette distance, nous pénétrons dans un univers qui semble parallèle à celui qui nous est le plus familier, où le langage a le pouvoir de modifier les choses et les situations, a cette capacité d'entre-mêler poésie et humour noir, étrangeté, absurdité et mélancolie, et où l’horrible peut côtoyer le merveilleux. Au fond, ce qui revient le plus souvent comme une lancinante interrogation, c'est que l'être humain, basculant dans cette expérience que lui offre l'imagination et son langage, entre dans un monde qui va se modifier au gré des émotions et des événements, mais sans y trouver, au bout du compte et du récit, véritablement sa place. Et la brèche qui s'est ouverte dans son espace familier ne peut plus se refermer...
The reading of Boris Vian, if we accept to open our imagination, our experiences, and why not our perception of the surrounding world, takes us into a universe which, as an introduction, does not tell but suggests stories, characters: strengthened by this distance, we enter a universe which seems parallel to the one we are most familiar with, where language has the power to modify things and situations, has this capacity to intertwine poetry and black humour, strangeness, absurdity and melancholy, and where the horrible can rub shoulders with the marvellous. In the end, what comes back most often as a haunting question is that the human being, tilting in this experience offered to him by imagination and language, enters a world that will change according to emotions and events, but without finding, in the end and in the story, a real place for it. And the breach that has opened up in her familiar space can no longer be closed...
La lectura de Boris Vian, si aceptamos abrir nuestra imaginación, nuestras experiencias y, por qué no, nuestra percepción del mundo que nos rodea, nos lleva a un universo que, a modo de introducción, no cuenta sino que sugiere historias, personajes: fortalecidos por esta distancia, entramos en un universo que parece paralelo al que conocemos mejor, donde el lenguaje tiene el poder de modificar cosas y situaciones, tiene esta capacidad de entrelazar la poesía y el humor negro, la extrañeza, el absurdo y la melancolía, y donde lo horrible puede codearse con lo maravilloso. Al final, lo que vuelve más a menudo como una pregunta inquietante es que el ser humano, inclinándose en esta experiencia que le ofrecen la imaginación y el lenguaje, entra en un mundo que cambiará según las emociones y los acontecimientos, pero sin encontrar, al final y en la historia, un lugar real para ello. Y la brecha que se ha abierto en su espacio familiar ya no puede cerrarse...


Boris Vian (1920-1959)
"Queneau aime "Vercoquin et le plancton". Gallimard accepte ce premier roman puis un deuxième, "L’Écume des jours". Sartre reçoit l’auteur aux Temps modernes, où
paraîtront ses "Chroniques du Menteur". "J’irai cracher sur vos tombes" fait scandale – un vrai scandale, du premier coup, celui que tant d’artistes attendent en vain toute leur vie… Et pourtant,
cela ne prend pas. Les seuls romans de Vian qui connaissent le succès de son vivant sont ceux qu’il signe Sullivan. Les autres ne trouvent pas leur public. Le dernier, "L’Arrache-cœur", sept ans
à peine après Vercoquin, est un ultime échec. Vian en conclut que sa destinée ne sera pas littéraire. Il renonce au roman" (Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard), sa renommée viendra de
son personnage. L’écrivain crée un univers plein de fantaisie, où se retrouvent toutes ses passions, le jazz, la philosophie, la création verbale ; l’amour de la vie y affronte l’angoisse de la
mort, toujours omniprésente. On a souvent dit que Boris Vian avait beaucoup écrit, parfois trop vite, ses écrits sont innombrables pour un écrivain mort à 39 ans et qui n'écrivit, dit-il,
sérieusement qu'à 23 ans. La nostalgie pour la fameuse époque de Saint-Germain-des-Prés peut expliquer un certain engouement tardif. La romancière Elsa Triolet est de celles qui le détestèrent,
une "absence de conviction", note-t-elle à propos de la pièce "L'Equarissage pour tous", a "gentiment détruit le côté révoltant"...
Né à Ville-d'Avray, près de Paris, Boris Vian commença des études de philosophie puis s'orienta vers le métier d'ingénieur (1942). C'est sous le pseudonyme américain de Vernon Sullivan que Boris Vian entra en littérature. Son premier livre, qu'il proposa au public comme le récit d'un auteur américain dont lui-même n'était que le traducteur, était une sorte de thriller violent, intitulé" J'irai cracher sur vos tombes" (1946).
Après ce premier scandale, Vernon Sullivan réitéra sa provocation avec des romans tels que "Elles se rendent pas compte" (1948) ou "Et on tuera tous les affreux" (1948), tous placés sous le signe de la sexualité et du scandale. Sous son nom véritable, Vian publia des ouvrages d'un ton moins violent mais tout aussi désespéré, où ses liens avec l'humour et la pataphysique sont sensibles : "Vercoquin et le Plancton" (1946), "l'Automne à Pékin" (1947), "l'Écume des jours" (1947), "l'Herbe rouge" (1950) ou" l'Arrache-cœur" (1953).
Atteint d'une maladie de cœur, qu'il transposera sous la forme poétique d'un nénuphar dans "l'Écume des jours", Boris Vian semble avoir souhaité vivre le plus intensément possible, multipliant ses activités et ses expériences. Ce passionné de jazz devint naturellement après la guerre l'une des figures les plus connues des nuits de Saint-Germain-des-Prés.
A partir de 1954, il se consacre à la chanson et interprète ses propres textes. Trompettiste de talent (il jouait régulièrement dans une boîte devenue célèbre, Le Tabou), il fut un parolier et un interprète insolent : sa chanson "le Déserteur", fit scandale pendant la guerre d'Algérie.
Il vécut à Paris, avec son épouse Ursula, de 1953 à sa mort, 6 rue Véron, derrière le Moulin Rouge… Il connaîtra un succès posthume dans les années 1960, notamment avec L'Ecume des jours, mai 1968 le récupère, et les années 1970-1980 en font un écrivain reconnu, et retombe dans l'oubli...

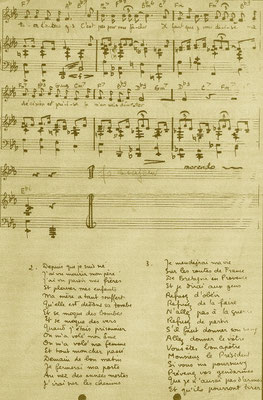


Vercoquin et le plancton (1947)
"La foule anonyme des zazous s'affaira dans les salons, roulant des tapis, déplaçant les meubles, vidant les boîtes de cigarettes dans des poches plus idoines, préparant la danse..." Gaston Gallimard avait chargé Raymond Queneau de préparer une nouvelle collection, "La Plume au vent", et celui-ci fut amusé par "Vercoquin et le plancton", une exploration débridée du monde des zazous menée par Boris Vian. Le mouvement zazou est un phénomène de mode qu'évoque Simone de Beauvoir dans "La Force des choses", un mouvement engendré par la Guerre et la Collaboration, des fils et filles de bonne famille affichant contre leurs parents pétainistes une anglophilie provocante et cynique, prônant une véritable religion du swing, et s'habillant avec des surplus américains. Les miliciens leur font la chasse en 1942, la Résistance prend les devant de la scène et le phénomène s'atténue lorsque débarquent, avec la Libération, les GI's, le jazz.et les V-Discs (Victory Discs). Les existentialistes vont succéder aux zazous, le Be-Bop et la petite robe noire à la Juliette Gréco, tandis qu'Anne-Marie Cazalis, proche de Boris Vian, accueille les nouvelles figures de Saint-Germain des Près dans la cave du Tabou, rue Dauphine et du club de jazz Le Club Saint-Germain, rue Saint-Benoît...
"Le roman se situe entre deux surprises-parties. Dans la première, le Major tombe amoureux de Zizanie. Dans la seconde, il se fiance avec Zizanie. La fête, devenue bacchanale, est tellement réussie que la maison saute avec tous ses habitants, c’est-à-dire ceux qui s’amusent et les voisins qui ne peuvent pas dormir. Entre les deux événements il y a toute la stratégie mise en œuvre par le Major pour obtenir de l’oncle et tuteur de Zizanie la main de celle-ci. L’oncle et tuteur dirige une formidable entreprise qui fabrique des dossiers d’information sur tout ce qui existe. C’est un travail colossal et parfaitement inutile dont on essaie vainement, en haut lieu, d’endiguer l’expansion aussi envahissante qu’un raz de marée. L’officine emploie un personnel discipliné et compétent qui sait utiliser les moindres éclipses du patron à des fins aussi justifiées que le flirt, le jeu de dames, la musique de jazz, etc..."

Michelle Vian (Ma vie avec Boris), née Michelle Leglise en 1920, épousa Boris Vian en 1941, moins d'un an après leur rencontre, en divorça en 1953 et fit
partie de l'équipe des «Temps modernes». Puis Vian épousa Ursula Kübler en 1954...
«Boris a démarré en flèche avec « Vercoquin et le plancton », qui a beaucoup plu à Queneau dès 1945. Mais ça n’était pas destiné à l’impression: c’était
juste destiné à faire rigoler les copains. Boris était ingénieur, il n’avait pas idée qu’il serait écrivain. Il faisait des petits poèmes, comme tous les étudiants: dans le genre Villon, puis
dans le genre Baudelaire. Boris est passé par tous les genres! On n’y accordait pas beaucoup d’importance. C’était drôle, mais à l’époque tout le monde faisait des vers. On n’avait guère que ça à
faire sous l’Occupation. Il ne s’est considéré comme un écrivain qu’à partir du moment où Queneau lui a dit qu’il en était un, et lui a pris «Vercoquin» en lui demandant quelques aménagements :
tous les personnages avaient des noms de barons et de ducs; Queneau trouvait que ça encombrait inutilement. Ils ont été très proches, tous les deux. Boris voyait en lui un
père.»
«...La danse et le jazz nous rapprochaient. Et puis je crois que Boris était très attiré par moi : il faut vous dire que j’étais très jolie... Depuis
que Charles Trenet le leur avait fait connaître, dès 1937, les zazous écoutaient du jazz. Enfin, ce qu’ils pouvaient écouter. C’était interdit de jouer du jazz américain, les Allemands jouaient
du jazz allemand qui n’était pas bon: ils en étaient encore au saxo rieur. Ca avait toujours un côté soldatesque, ils se sont rattrapés après, même si pour la mélodie, ils ne sont pas forts. Mais
Boris n’avait pas attendu Trenet. Il était en avance ! Il connaissait le jazz américain dès 1936.
Quand les zazous ont entendu Pétain, les jeunes ont dit: «Ils nous font chier avec leur guerre, on n’en a rien à f...». Ils n’étaient pas mobilisés à ce
moment-là, ils avaient 18-19 ans. Pendant la drôle de guerre, les pères étaient à l’armée, les mères pleuraient, les enfants étaient libres. Alors ils écoutaient du jazz, et quand ils ont entendu
Pétain, ils sont devenus gaullistes. Pourquoi? Parce que de Gaulle était en Angleterre. Ceux qu’on aimait, parce qu’ils étaient proches et déjà nos alliés, c’étaient les Anglais. On est devenu
anglais.
Les zazous portaient le costume anglais de l’époque, qui rappelle celui qu’ont plus tard porté les mods: la veste longue, les deux poches, un peu
évasée, cintrée, le pantalon un peu court, mais pas trop, découvrant des chaussettes de laine blanche, absolument, hélas des chaussures en bois parce qu’il n’y avait rien d’autre; les filles, des
jupes courtes s’arrêtant au genou, en général écossaises, ou alors volantes, des chaussures en bois, compensées, des petits pull-overs, de n’importe quelle couleur, la coiffure en nid de pie avec
les cheveux en arrière, ou alors des résilles, et puis le parapluie. Les garçons avaient la toute petite cravate, en nœud d’épingle, et les cheveux en arrière, avec la queue de canard. Voilà pour
les zazous. Quand ils avaient de l’argent, ils essayaient de se faire faire des costumes.
Ce qui nous rassemblait, aussi, c’étaient les films. Les films étaient allemands! Mais il n’y avait que ça. Peut-être un nouveau film par semaine. Alors
on se réunissait chez nous, et on dansait. C’était le swing qu’on dansait. Voilà les zazous. On était Anglais, on était contre Pétain, on ne voulait pas aller à la guerre. On n’a connu les
Américains que plus tard, même si on connaissait leur jazz.»
« .... A la Libération, on est devenus Américains. Ils dansaient ces Amerlos ! Comme des dieux ! On était étourdis… Boris faisait du jazz depuis
longtemps, il s'était inscrit au Hot Club de France à 16 ans. Il avait une trompette assez défoncée, ça n'était pas bon pour son coeur, mais enfin il en jouait, bien. Comme il n'avait pas de
souffle, ce n'était pas Armstrong, c'était plutôt Bix Beiderbecke : style Chicago, très rythmé, avec de jolies harmonies. Avec l'orchestre Abadie, il allait de club en club. Moi j'accompagnais.
J'étais la femme du trompette et, surtout, une belle blonde... Et puis je servais d'interprète. Boris avait fait grec-latin-maths et une langue, l’allemand – c’était la voie noble à l’époque. Moi
j’avais fait latin-anglais, et comme j’avais passé toutes mes vacances d’été en Angleterre, j’étais bilingue. Alors il m’était d’autant plus facile d’accueillir les Américains. J’ai appris
l’anglais à Boris, très vite, en l’espace de six mois. On ne nous payait pas, mais les soldats américains nous fournissaient des V-discs, qui avaient été enregistrés pour eux, et qu’on ne pouvait
pas donner parce qu’ils étaient fragiles : au bout de quatre ou cinq tours ils se cassaient. Tous les musiciens en avaient enregistré pour les soldats, même Ellington. Ca, les soldats américains
étaient magnifiquement traités! Surtout par rapport aux nôtres… Ils avaient tout. Et d’ailleurs ils nous apportaient tout: les jeans, les souliers en caoutchouc... Quand ils ont appris qu'on
avait un bébé, le lendemain il y avait un camion au bas du faubourg Poissonnière avec du lait, des haricots et des bouquins sur lesquels il était écrit : « Quand vous aurez fini, passez-le à un
autre GI... Après, il n’y en a plus eu, des Américains. Les politiques, et surtout de Gaulle, n’aimaient pas voir les Américains chez eux. C’était dégueulasse d’ailleurs. Quel était ce mot
d’ordre qui était écrit sur tous les murs? GI Go home.....»

(Simone de Beauvoir, La Force des Choses, Gallimard)
"Par Queneau, je fis la connaissance de Boris Vian : ingénieur de formation, il écrivait et il jouait de la trompette; il avait été un des animateurs du
mouvement zazou qu'avaient engendré la guerre et la collaboration : leurs riches parents séjournant la plupart du temps à Vichy des fils et des filles de famille organisaient dans les
appartements abandonnés des parties « terribles ››; ils vidaient les caves et brisaient les meubles, imitant les saccages guerriers; ils trafiquaient au marché noir. Anarchistes, apolitiques,
contre leurs parents pétainistes ils affichaient une anglophilie provocante; ils imitaient l'élégance gourmée, l'accent, les manières des snobs anglais. L'Amérique, ils y pensaient si peu qu'ils
furent déconcertés quand Paris se remplit d'Américains; pourtant ils avaient avec eux un lien très fort : le jazz dont ils étaient fanatiques. L'orchestre d”Abadie où jouait Vian fut engagé par
le « French Welcome Committee ›› le jour même de l'entrée des G.l. à Paris, et rattaché au « Special Service Show ››. Ainsi s'explique la tenue qui fut, pendant trois ans, celle des ex-zazous;
ils s'habillaient avec des surplus américains : blue jeans et chemises à carreaux. Ils se réunissaient avenue Rapp, dans le quartier des Champs-Élysées et aussi au Champo, au coin de la rue
Champollion, qui était alors un dancing. Une poignée d'entre eux aimaient, outre le jazz, Kafka, Sartre, les romans américains : pendant la guerre ils fouinaient dans les boîtes des quais et ils triomphaient quand ils y dénichaient les œuvres interdites de Faulkner ou d'Hemingway. Pour lire, pour
discuter, ils venaient à Saint-Germain-des-Prés. C'est ainsi que je rencontrai Vian au bar du Pont-Royal; il avait en lecture chez Gallimard un manuscrit qui plaisait beaucoup à Queneau; je pris
un verre avec eux et avec Astruc; je trouvai que Vian s'écoutait et qu'il cultivait trop complaisamment le paradoxe. Il donna en mars une « partie ››; quand j'arrivai, tout le monde avait déjà
beaucoup bu; sa femme Michelle, ses longs cheveux de soie blonde répandus sur ses épaules, souriait aux anges; Astruc dormait sur le divan, pieds nus; je bus vaillamment moi aussi tout en
écoutant des disques venus d'Amérique. Vers deux heures, Boris me proposa une tasse de café; nous nous sommes assis dans la cuisine et jusqu'à1'aube nous avons parlé : de son roman, du jazz, de
la littérature, de son métier d'ingénieur. Je ne découvrais plus rien d'affecté dans ce long visage lisse et blanc mais une extrême gentillesse et une espèce de candeur têtue; Vian mettait autant
de feu à détester "les affreux" qu'à aimer ce qu'il aimait : il jouait de la trompette bien que son cœur le lui interdit. ("Si vous continuez, vous serez mort dans dix ans", lui avait dit le
médecin.) Nous parlions et l'aube arriva trop vite : j'accordais le plus haut prix, quand il m'était donné de les cueillir, à ces moments fugaces d'amitié éternelle.
[...]
Je redescends au Pont-Royal, voir Vian qui m'a apporté son roman et un livre américain sur le jazz, on en traduira un morceau. Il parle du jazz avec
passion. Il me dit qu'il existe en Amérique.de très bonnes pièces radiophoniques, un peu naïves, mais charmantes, comme celle de la petite chenille qui danse au son de "Yes, sir; t'is my baby",
ou du petit garçon qui cherche dans les astres son chien écrasé par un autobus et dont on s'aperçoit à la dernière minute qu'il a été écrasé lui aussi. Il fera un article là-dessus. Son roman est
extrêmement amusant, surtout la conférence de Jean-Sol Partre, et le meurtre avec l'arrache-cœur. J'aime aussi la recette de Gouffé : "Prenez un andouillon; écorchez-le malgré ses cris" [. .
.]
Deux heures d'attente à la légation suisse. Mais elles passent vite parce que je lis "L'Écume des jours" de Vian, que j'aime beaucoup, surtout la triste
histoire de Chloé qui meurt avec un nénuphar dans le poumon; il a créé un monde à lui; c'est rare, et ça m'émeut toujours. Les deux dernières pages sont saisissantes; le dialogue avec le
crucifix, c'est l'équivalent du "Non", dans "Le Malentendu" de Camus, mais c'est plus discret et plus convaincant. Ce qui me frappe, c'est la vérité de ce roman et aussi sa grande tendresse...
(La Force des choses, Gallimard, 1963)

"Il est fort déprimant de se trouver par mégarde dans une surprise-party qui prend un faux
départ. Car le maître – ou la maîtresse – de maison reste dans la salle vide, avec deux ou trois amis en avance, sans la moindre jolie fille car une jolie fille est toujours en
retard. C’est le moment choisi par son jeune frère pour des exhibitions aventurées tout à l’heure, il n’osera plus. Et surtout, on
l’aura bouclé. Et l’on regarde ces deux ou trois malheureux prendre des poses plastiques dans la pièce au parquet fraîchement ciré, imitant un tel ou un tel – mais ceux-là savent réellement
danser. Eux non plus n’oseront plus, tout à l’heure… Imaginez-vous alors que vous êtes arrivé moins tôt. Quand la fête bat son plein. Vous entrez. Les bons compaings vous tapent dans le dos. Ceux
dont vous n’avez pas envie de serrer la main dansent déjà – toujours ils dansent, et c’est pourquoi vous n’êtes pas entièrement d’accord avec eux – et d’un seul coup d’œil, vous voyez s’il y a
quelques filles disponibles. (Une fille est disponible quand elle est jolie.) S’il y en a, tout va bien : c’est encore le début de la surprise-party, elles n’ont été ni très invitées ni très
dangereusement exploitées, car les garçons qui sont venus seuls – par timidité pour la plus grande partie – n’ont pas assez bu pour avoir de l’audace. Or vous n’avez pas besoin de boire pour
avoir de l’audace, aussi, vous venez toujours seul. Ne cherchez pas à faire de l’esprit. Elles ne comprennent jamais. Celles qui comprennent sont déjà mariées. Faites-la boire avec vous. C’est
tout. Vous avez alors l’occasion de déployer des prodiges de rouerie pour trouver une bouteille de quelque chose. (Vous la prenez simplement dans la cachette que vous venez d’indiquer à quelque
nouvel arrivant, pas très à la page.) Cachez-la dans votre pantalon. Seul, le goulot dépasse la ceinture. Revenez vers votre proie. Adoptez un air anodin, avec une touche de mystère. Prenez-la
par le bras, par la taille même, et dites-lui tout bas : « À vous de trouver un verre, un seul suffit pour nous deux, je me suis défendu… Chut… » Puis vous vous infiltrez dans la chambre voisine.
Elle ferme à clef ? Tiens ! Quel hasard ! À l’intérieur, l’Amiral. C’est un copain. Bien sûr, il n’est pas seul. Vous tapez sur le panneau, trois petits coups et un gros, ou sept moyens coups et
deux petits, suivant le traité conclu avec l’Amiral. Sitôt entré, refermez vite la porte à clef et ne lorgnez pas trop du côté de l’Amiral, qui se remet en ligne de bataille. Il ne s’occupe pas
de vous, absorbé par la délicate manœuvre qui consiste à insinuer sa main dans l’entrebâillement latéral de la jupe de sa partenaire, fille intelligente et habillée intelligemment. Sortez votre
bouteille, qui vous fait froid, sans précaution stuperfétatoire, car l’Amiral a la sienne. Restez près de la porte, pour l’entendre frapper quand elle reviendra… Et elle ne revient pas… Pour vous
remettre de ce choc, débouchez la bouteille. Buvez un bon coup au goulot. Attention ! Pas plus de la moitié ! Il reste peut-être un espoir… "

1946 - J’irai cracher sur vos tombes
L'histoire, comme les autres histoires de Vian sous le pseudonyme de Sullivan, se déroule dans le Sud des États-Unis et met en scène les difficultés des Noirs américains dans leur vie quotidienne face aux Blancs. Le personnage principal est un jeune Noir qui veut venger le lynchage de son frère cadet, assassiné par les Blancs. Doté de l'apparence d'un Blanc par un curieux caprice de la nature, il peut s'introduire dans les milieux huppés de la bourgeoisie blanche; il séduira deux sœurs, créatures superbes issues des meilleures familles, pour les tuer sauvagement l'une et l'autre avant d'être lui-même pendu par la police. L'ouvrage, qui traite du racisme, de la violence et de la sexualité, provoqua un énorme scandale en France, puisque la presse se déchaîna et que l'«affaire» fut portée devant les tribunaux.
"Personne ne me connaissait à Buckton. Clem avait choisi la ville à cause de cela ; et d’ailleurs, même si je m’étais dégonflé, il ne me restait pas assez d’essence pour continuer plus haut vers le Nord. À peine cinq litres. Avec mon dollar, la lettre de Clem, c’est tout ce que je possédais. Ma valise, n’en parlons pas. Pour ce qu’elle contenait. J’oublie : j’avais aussi dans le coffre de la voiture le petit revolver du gosse, un malheureux 6,35 bon marché ; il était encore dans sa poche quand le shérif était venu nous dire d’emporter le corps chez nous pour le faire enterrer. Je dois dire que je comptais sur la lettre de Clem plus que sur tout le reste. Cela devait marcher, il fallait que cela marche. Je regardais mes mains sur le volant, mes doigts, mes ongles. Vraiment personne ne pouvait trouver à y redire. Aucun risque de ce côté. Peut-être allais-je m’en sortir.
Mon frère Tom avait connu Clem à l’Université. Clem ne se comportait pas avec lui comme les autres étudiants. Il lui parlait volontiers ; ils buvaient ensemble, sortaient ensemble dans la Caddy de Clem. C’est à cause de Clem qu’on tolérait Tom. Quand il partit remplacer son père à la tête de la fabrique, Tom dut songer à s’en aller aussi. Il revint avec nous. Il avait beau-coup appris et n’eut pas de mal à être nommé instituteur de la nouvelle école. Et puis, l’histoire du gosse flanquait tout par terre. Moi, j’avais assez d’hypocrisie pour ne rien dire, mais pas le gosse. Il n’y voyait aucun mal. Le père et le frère de la fille s’étaient chargés de lui.
De là venait la lettre de mon frère à Clem. Je ne pouvais plus rester dans ce pays, et il demandait à Clem de me trouver quelque chose. Pas trop loin, pour qu’il puisse me voir de temps en temps, mais assez loin pour que personne ne nous connaisse. Il pensait qu’avec ma figure et mon caractère, nous ne risquions absolument rien. Il avait peut-être raison, mais je me rappelais tout de même le gosse.
Gérant de librairie à Buckton, voilà mon nouveau boulot. Je devais prendre contact avec l’ancien gérant et me mettre au courant en trois jours. Il changeait de gérance, montait en grade et voulait faire de la poussière sur son chemin.
Il y avait du soleil. La rue s’appelait maintenant Pearl-Harbor Street. Clem ne le savait probablement pas. On lisait aussi l’ancien nom sur les plaques. Au 270, je vis le magasin et j’arrêtai la Nash devant la porte. Le gérant recopiait des chiffres sur des bordereaux, assis derrière sa caisse ; c’était un homme d’âge moyen, avec des yeux bleus durs et des cheveux blond pâle, comme je pus le voir en ouvrant la porte. Je lui dis bon-jour.
– Bonjour. Vous désirez quelque chose ?
– J’ai cette lettre pour vous.
– Ah ! C’est vous que je dois mettre au courant. Faites voir cette lettre.
Il la prit, la lut, la retourna et me la rendit.
– Ce n’est pas compliqué, dit-il. Voilà le stock. (Il eut un geste circulaire). Les comptes seront terminés ce soir. Pour la vente, la publicité et le reste, suivez les indications des inspecteurs de la boîte et des papiers que vous recevrez.
– C’est un circuit ?
– Oui. Succursales.
– Bon, acquiesçai-je. Qu’est-ce qui se vend le plus ?
– Oh, romans. Mauvais romans, mais ça ne nous regarde pas. Livres religieux, pas mal, et livres d’école aussi. Pas beau-coup de livres d’enfants, ni de livres sérieux. Je n’ai jamais essayé de développer ce côté-là.
– Les livres religieux, pour vous, ce n’est pas sérieux.
Il se passa la langue sur les lèvres.
– Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.
Je ris de bon coeur.
– Ne prenez pas ça mal, je n’y crois pas beaucoup non plus.
– Eh bien, je vais vous donner un conseil. Ne le faites pas voir aux gens, et allez écouter le pasteur tous les dimanches, parce que, sans ça, ils auront vite fait de vous mettre à pied.
– Oh, ça va, dis-je. J’irai écouter le pasteur.
– Tenez, dit-il en me tendant une feuille. Vérifiez ça. C’est la comptabilité du mois dernier. C’est très simple. On reçoit tous les livres par la maison mère. Il n’y a qu’à tenir compte des entrées et des sorties, en triple exemplaire. Ils passent ramasser l’argent tous les quinze jours. Vous êtes payé par chèques, avec un petit pourcentage.
– Passez-moi ça, dis-je.
Je pris la feuille, et je m’assis sur un comptoir bas, encombré de livres sortis des rayons pour les clients, et qu’il n’avait probablement pas eu le temps de remettre en place.
– Qu’est-ce qu’il y a à faire dans ce pays ? lui demandai-je encore.
– Rien, dit-il. Il y a des filles au drugstore en face, et du bourbon chez Ricardo, à deux blocks.
Il n’était pas déplaisant, avec ses manières brusques."

1947 - L’Ecume des jours
C'est l'ouvrage le plus connu de Vian, une histoire d'amour déchirante dont les protagonistes sont Colin, amateur de jazz, et son amie Chloé. Leur ami Chick, lecteur de Jean-Sol Partre, est à leurs côtés. Le livre commence de façon idyllique, puisque le monde, animé ou inanimé, forme un berceau harmonieux pour les deux amants : le bonheur est partout. Mais bientôt Chloé tombe malade et se met à tousser : la maladie est transposée sous la forme d'un nénuphar qui pousse dans sa poitrine. Avec la maladie qui tue Chloé peu à peu, le monde rieur laisse la place à la tristesse et à la laideur, et la mort touche tous les êtres qui l'entouraient : Chick meurt et Colin se suicide. Cette histoire tragique, hantée par l'angoisse de la maladie qui détruit la jeunesse, devint célèbre grâce aux jeux de langage qui la caractérisent.
Si L'Ecume des jours fut publié par Gallimard, - Boris Vian avait alors 26 ans et pouvait espérer d'autres encouragements - , le même éditeur refuse les romans suivants, L'Automne à Pékin, L'Herbe rouge, L'Arrache-Coeur. La déception est immense, Boris Vian s'engage alors sur une autre voie, celle du spectacle..
"Colin terminait sa toilette. Il s’était enveloppé, au sortir du bain, d’une ample serviette de tissu bouclé dont seuls ses jambes et son torse dépassaient. Il prit à l’étagère de verre, le vaporisateur et pulvérisa l’huile fluide et odorante sur ses cheveux clairs. Son peigne d’ambre divisa la masse soyeuse en longs filets orange pareils aux sillons que le gai laboureur trace à l’aide d’une fourchette dans de la confiture d’abricots. Colin reposa le peigne et, s’armant du coupe-ongles, tailla en biseau les coins de ses paupières mates, pour donner du mystère à son regard. Il devait recommencer souvent, car elles repoussaient vite. Il alluma la petite lampe du miroir grossissant et s’en approcha pour vérifier l’état de son épiderme. Quelques comédons saillaient aux alentours des ailes du nez. En se voyant si laids dans le miroir grossissant, ils rentrèrent prestement sous la peau et, satisfait, Colin éteignit la lampe. Il détacha la serviette qui lui ceignait les reins et passa l’un des coins entre ses doigts de pied pour absorber les dernières traces d’humidité. Dans la glace, on pouvait voir à qui il ressemblait, le blond qui joue le rôle de Slim dans Hollywood Canteen. Sa tête était ronde, ses oreilles petites, son nez droit, son teint doré. Il souriait souvent d’un sourire de bébé, et, à force, cela lui avait fait venir une fossette au menton. Il était assez grand, mince avec de longues jambes, et très gentil. Le nom de Colin lui convenait à peu près. Il parlait doucement aux filles et joyeusement aux garçons. Il était presque toujours de bonne humeur, le reste du temps il dormait.
Il vida son bain en perçant un trou dans le fond de la baignoire. Le sol de la salle de bains, dallé de grès cérame jaune clair, était en pente et orientait l’eau vers un orifice situé juste au-dessus du bureau du locataire de l’étage inférieur. Depuis peu, sans prévenir Colin, celui-ci avait changé son bureau de place. Maintenant, l’eau tombait sur son garde-manger.
Il glissa ses pieds dans des sandales de cuir de roussette et revêtit un élégant costume d’intérieur, pantalon de velours à côtes vert d’eau très profonde et veston de calmande noisette. Il accrocha la serviette au séchoir, posa le tapis de bain sur le bord de la baignoire et le saupoudra de gros sel afin qu’il dégorgeât toute l’eau contenue. Le tapis se mit à baver en faisant des grappes de petites bulles savonneuses.
Il sortit de la salle de bain et se dirigea vers la cuisine, afin de surveiller les derniers préparatifs du repas. Comme tous les lundis soir, Chick venait dîner, il habitait tout près. Ce n’était encore que samedi, mais Colin se sentait l’envie de voir Chick et de lui faire goûter le menu élaboré avec une joie sereine par Nicolas, son nouveau cuisinier. Chick, comme lui célibataire, avait le même âge que Colin, vingt-deux ans, et des goûts littéraires comme lui, mais moins d’argent. Colin possédait une fortune suffisante pour vivre convenablement sans travailler pour les autres. Chick, lui, devait aller tous les huit jours au ministère, voir son oncle et lui emprunter de l’argent, car son métier d’ingénieur ne lui rapportait pas de quoi se maintenir au niveau des ouvriers qu’il commandait, et c’est difficile de commander à des gens mieux habillés et mieux nourris que soi-même. Colin l’aidait de son mieux en l’invitant à dîner toutes les fois qu’il le pouvait, mais l’orgueil de Chick l’obligeait d’être prudent, et de ne pas montrer, par des faveurs trop fréquentes, qu’il entendait lui venir en aide.
Le couloir de la cuisine était clair, vitré des deux côtés, et un soleil brillait de chaque côté, car Colin aimait la lumière. Il y avait des robinets de laiton soigneusement astiqués, un peu partout. Les jeux des soleils sur les robinets produisaient des effets féeriques. Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets, et couraient après les petites boules que formaient les rayons en achevant de se pulvériser sur le sol, comme des jets de mercure jaune. Colin caressa une des souris en passant, elle avait de très longues moustaches noires, elle était grise et mince et lustrée à miracle. Le cuisinier les nourrissait très bien sans les laisser grossir trop. Les souris ne faisaient pas de bruit dans la journée et jouaient seulement dans le couloir.
Colin poussa la porte émaillée de la cuisine. Le cuisinier Nicolas surveillait son tableau de bord. Il était assis devant un pupitre également émaillé de jaune clair et qui portait des cadrans correspondant aux divers appareils culinaires alignés le long des murs. L’aiguille du four électrique, réglé pour la dinde rôtie, oscillait entre « presque » et « à point ». Il allait être temps de la retirer. Nicolas pressa un bouton vert, ce qui déclenchait le palpeur sensitif. Celui-ci pénétra sans rencontrer de résistance, et l’aiguille atteignit « à point » à ce moment. D’un geste rapide, Nicolas coupa le courant du four et mit en marche le chauffe-assiettes.
« Ce sera bon ? demanda Colin.
– Monsieur peut en être sûr, affirma Nicolas. La dinde était parfaitement calibrée.
– Quelle entrée avez-vous préparée ?
– Mon Dieu, dit Nicolas, pour une fois, je n’ai rien innové. Je me suis borné à plagier Gouffé.
– Vous eussiez pu choisir un plus mauvais maître ! remarqua Colin. Et quelle partie de son oeuvre allez-vous reproduire ?"
Puis c'est la scène, la fameuse scène de la première rencontre au chapitre 11, Colin, qui éprouve le désir de devenir amoureux, rencontre pour la première fois Chloé, et "la majeure partie du reste du monde se mit à compter pour du beurre.."
"- C'est Colin, dit Isis. Colin je vous présente Chloé.
Colin avala sa salive. Sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés.
- Bonjour ! dit Chloé…
- Bonj… êtes-vous arrangée par Duke Ellington ? demanda Colin… Et puis il s'enfuit, parce qu'il avait la conviction d'avoir dit une
stupidité.
Chick le rattrapa par un pan de sa veste.
- Où vas-tu comme ça ? Tu ne vas pas t'en aller déjà ? Regarde !…
Il tira de sa poche un petit livre relié en maroquin rouge.
- C'est l'original du Paradoxe sur le Dégueulis, de Partre…
- Tu l'as trouvé quand même ? dit Colin.
Puis il se rappela qu'il s'enfuyait et s'enfuit..."

"Dites-moi des choses, alors… " - Le chapitre suivant accentue cette impression d'instantanéité qui rapproche les deux jeunes gens, le choc est d'autant plus physique qu'il donne à voir une toute autre réalité qu'ils partagent le plus naturellement du monde, mais un monde propre à Boris Vian, les choses ont souvent une singularité surprenante ...
« Bonjour !… »
Chloé était arrivée par-derrière. Il retira vite son gant, s’empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit « Ouille !… » et lui serra
la main. Elle riait.
« Vous avez l’air bien embarrassé ! »
Un manteau de fourrure à longs poils, de la couleur de ses cheveux, et une toque en fourrure aussi, et de petites bottes courtes à revers de
fourrure.
Elle prit Colin par le bras.
« Offrez-moi le bras. Vous n’êtes pas dégourdi, aujourd’hui !…
– Ça allait mieux la dernière fois », avoua Colin.
Elle rit encore, et le regarda et rit de nouveau encore mieux.
« Vous vous moquez de moi, dit Colin, piteux. C’est pas charitable.
– Vous êtes content de me voir ? dit Chloé.
– Oui !… » dit Colin.
Ils marchaient, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l’air et s’approchait d’eux.
« J’y vais ! proposa-t-il.
– Vas-y », dit Colin.
Et le nuage les enveloppa. À l’intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle.
« On ne nous voit plus ! dit Colin… Mais nous, on les voit !…
– C’est un peu transparent, dit Chloé. Méfiez-vous.
– Ça ne fait rien, on se sent mieux tout de même, dit Colin. Que voulez-vous faire ?
– Juste se promener… Ça vous ennuie ?
– Dites-moi des choses, alors…
– Je ne sais pas de choses assez bien, dit Chloé. On peut regarder les vitrines. Regardez celle-ci !… C’est intéressant. »
Dans la vitrine, une jolie femme reposait sur un matelas à ressort. Sa poitrine était nue, et un appareil lui brossait les seins vers le haut, avec de
longues brosses soyeuses en poil blanc et fin. La pancarte portait : Économisez vos chaussures avec l’Antipode du Révérend Charles.
« C’est une bonne idée, dit Chloé.
– Mais ça n’a aucun rapport !… dit Colin. C’est bien plus agréable avec la main. »
Chloé rougit.
« Ne dites pas des choses comme ça. Je n’aime pas les garçons qui disent des horreurs devant les jeunes filles.
– Je suis désolé… dit Colin, je ne voulais pas… »
Il avait l’air si désolé qu’elle sourit et le secoua un peu pour lui montrer qu’elle n’était pas fâchée. Dans une autre vitrine, un gros homme avec un
tablier de boucher égorgeait de petits enfants. C’était une vitrine de propagande pour l’Assistance publique.
« Voilà où passe l’argent, dit Colin. Ça doit leur coûter horriblement cher de nettoyer ça tous les soirs.
– Ils ne sont pas vrais !… dit Chloé alarmée.
– Comment peut-on savoir ? dit Colin. Ils les ont pour rien à l’Assistance publique…
– Je n’aime pas ça, dit Chloé. Avant, on ne voyait pas de vitrines de propagande comme ça. Je ne trouve pas que ce soit un
progrès.
– Ça n’a pas d’importance, dit Colin. Ça n’agit que sur ceux qui croient à ces imbécillités.
– Et ça ?… » dit Chloé.
Dans la vitrine, c’était un ventre, monté sur des roues caoutchoutées, bien rond et bien rebondi. Sur l’annonce, on pouvait lire : Le vôtre ne fera pas
de plis non plus si vous le repassez avec le Fer Électrique.
« Mais je le connais !… dit Colin. C’est le ventre de Serge, mon ancien cuisinier !… Qu’est-ce qu’il peut faire là ?
– Ça ne fait rien, dit Chloé. Vous n’allez pas épiloguer sur ce ventre. Il est bien trop gros, d’ailleurs…
– C’est qu’il savait faire la cuisine !…
– Allons-nous-en, dit Chloé. Je ne veux plus voir de vitrines, ça me déplaît.
– Qu’est-ce qu’on va faire ? dit Colin. On va prendre le thé quelque part ?
– Oh !… Ce n’est pas l’heure… et puis, je n’aime pas beaucoup ça. »
Colin respira, soulagé, et ses bretelles craquèrent.
« Qu’est-ce qui a fait ce bruit ?
– J’ai marché sur une branche morte, expliqua Colin en rougissant.
– Si nous allions nous promener au Bois ? » dit Chloé.
Colin la regarda, ravi.
« C’est une très bonne idée. Il n’y aura personne. »
Chloé rougit.
« Ce n’est pas pour ça. D’ailleurs, ajouta-t-elle pour se venger, nous ne quitterons pas les grandes allées, autrement, on se mouille les pieds.
»
Il serra un peu le bras qu’il sentait sous le sien.
« On va prendre le souterrain », dit-il.
Le souterrain était bordé des deux côtés par une rangée de volières de grandes dimensions, où les Arrangeurs Urbains entreposaient les
pigeons-de-rechange pour les Squares et les Monuments. Il y avait aussi des pépinières de moineaux et des pépiements de petits moineaux. Les gens ne descendaient pas souvent dedans parce que les
ailes de tous ces oiseaux faisaient un courant d’air terrible où volaient de minuscules plumes blanches et bleues.
« Ils ne s’arrêtent jamais de remuer ? dit Chloé en assujettissant sa toque pour éviter qu’elle ne s’envole.
– Ce ne sont pas les mêmes tout le temps », dit Colin.
Il luttait avec les pans de son pardessus.
« Dépêchons-nous de dépasser les pigeons, les moineaux font moins de vent », dit Chloé en se serrant contre Colin.
Ils se hâtèrent et sortirent de la zone dangereuse. Le petit nuage ne les avait pas suivis. Il s’était acheminé par le raccourci et les attendait déjà à
l’autre extrémité..."

"Chloé sentait une force opaque dans son corps" - Chloé et Colin étaient parvenus à se délimiter un monde qui leur étaient propre, une quiétude partagée qui recolorait leur existence, mais quelque chose va se détraquer, juste à la fin de leur mariage "un vent froid les attendait sur le perron". Chloé s'est mise à tousser, le voyage de noces vers le Sud s'est ébréché, d'infimes tensions sont apparues avec leurs amis. Puis, à la patinoire, Chloé est tombée en syncope..
"La main de Chloé, tiède et confiante, était dans la main de Colin. Elle le regardait, ses yeux clairs un peu étonnés le tenaient en repos. En bas de la plate-forme, dans la chambre, il y avait des soucis qui s’amassaient, acharnés à s’étouffer les uns les autres. Chloé sentait une force opaque dans son corps, dans son thorax, une présence opposée, elle ne savait comment lutter, elle toussait de temps en temps pour déplacer l’adversaire accroché à sa chair profonde. Il lui paraissait qu’en respirant à fond elle se fût livrée vive à la rage terne de l’ennemi, à sa malignité insidieuse. Sa poitrine se soulevait à peine et le contact des draps lisses sur ses jambes longues et nues mettait le calme dans ses mouvements. À ses côtés, Colin, le dos un peu courbé, la regardait. La nuit venait, se formait en couches concentriques autour du petit noyau lumineux de la lampe allumée au chevet du lit, prise dans le mur, enfermée par une plaque ronde de cristal dépoli.
« Mets-moi de la musique, mon Colin, dit Chloé. Mets des airs que tu aimes.
– Ça va te fatiguer », dit Colin.
Il parlait de très loin, il avait mauvaise mine. Son cœur tenait toute la place dans sa poitrine, il ne s’en rendait compte que
maintenant.
« Non, je t’en prie », dit Chloé.
Colin se leva, descendit la petite échelle de chêne et chargea l’appareil automatique. Il y avait des haut-parleurs dans toutes les pièces. Il mit en
marche celui de la chambre.
« Qu’as-tu mis ? » demanda Chloé.
Elle souriait. Elle le savait bien.
« Tu te rappelles ? dit Colin.
– Je me rappelle…
– Tu n’as pas mal ?
– Je n’ai pas très mal… »
À l’endroit où les fleuves se jettent dans la mer, il se forme une barre difficile à franchir, et de grands remous écumeux où dansent les épaves. Entre
la nuit du dehors et la lumière de la lampe, les souvenirs refluaient de l’obscurité, se heurtaient à la clarté et, tantôt immergés, tantôt apparents, montraient leurs ventres blancs et leurs dos
argentés. Chloé se redressa un peu.
« Viens t’asseoir près de moi… »
Colin se rapprocha d’elle, il s’installa en travers du lit et la tête de Chloé reposait au creux de son bras gauche. La dentelle de sa chemise légère
dessinait sur sa peau dorée un réseau capricieux, tendrement gonflé par la naissance des seins. La main de Chloé s’accrochait à l’épaule de Colin.
« Tu n’es pas fâché ?…
– Pourquoi fâché ?
– D’avoir une femme si bête… »
Il embrassa le creux de l’épaule confiante.
« Tire un peu ton bras, ma Chloé. Tu vas prendre froid.
– Je n’ai pas froid, dit Chloé. Écoute le disque. »
Il y avait quelque chose d’éthéré dans le jeu de Johnny Hodges, quelque chose d’inexplicable et de parfaitement sensuel. La sensualité à l’état pur,
dégagée du corps.
Les coins de la chambre se modifiaient et s’arrondissaient sous l’effet de la musique. Colin et Chloé reposaient maintenant au centre d’une
sphère.
« Qu’est-ce que c’était ? demanda Chloé.
– C’était The Mood to be Wooed, dit Colin.
– C’est ce que je sentais, dit Chloé. Comment le docteur vat-il pouvoir entrer dans notre chambre avec la forme qu’elle a ?
....»

Mais le nénuphar s'est remis à grossir, attaquant l'autre poumon de Chloé. Colin s'est ruiné à disposer des brassées de fleurs tout autour du lit et le ciel
ne cesse
de s'assombrir, la chambre de rapetisser, tandis que Chloé s'affaiblit de plus en plus et meurt. Colin règle comme il peut le cérémonial de
l'enterrement..
"On ne voyait plus Chloé, mais une vieille boîte noire, marquée d’un numéro d’ordre et toute bosselée. Ils la saisirent, et s’en servant comme d’un
bélier, la précipitèrent par la fenêtre. On ne descendait les morts à bras qu’à partir de cinq cents doublezons.
« C’est pour cela, pensa Colin, que la boîte a tant de bosses », et il pleura parce que Chloé devait être meurtrie et
abîmée.
Il songea qu’elle ne sentait plus rien et pleura plus fort. La boîte fit un fracas sur les pavés et brisa la jambe d’un enfant qui jouait à côté. On le
repoussa contre le trottoir et ils la hissèrent sur la voiture à morts. C’était un vieux camion peint en rouge et un des deux porteurs conduisait.
Très peu de gens suivaient le camion, Nicolas, Isis et Colin, et deux ou trois qu’ils ne connaissaient pas. Le camion allait assez vite. Ils durent
courir pour le suivre. Le conducteur chantait à tue-tête. Il ne se taisait qu’à partir de deux cent cinquante doublezons.
Devant l’église, on s’arrêta, et la boîte noire resta là pendant qu’ils entraient pour la cérémonie. Le Religieux, l’air renfrogné, leur tournait le dos
et commença à s’agiter sans conviction. Colin restait debout devant l’autel.
Il leva les yeux : devant lui, accroché à la paroi, il y avait Jésus sur sa croix. Il avait l’air de s’ennuyer et Colin lui demanda
:
« Pourquoi est-ce que Chloé est morte ?
– Je n’ai aucune responsabilité là-dedans, dit Jésus. Si nous parlions d’autre chose…
– Qui est-ce que cela regarde ? » demanda Colin.
Ils s’entretenaient à voix très basse et les autres n’entendaient pas leur conversation.
« Ce n’est pas nous, en tout cas, dit Jésus.
– Je vous avais invité à mon mariage, dit Colin.
– C’était réussi, dit Jésus, je me suis bien amusé. Pourquoi n’avez-vous pas donné plus d’argent, cette fois-ci ?
– Je n’en ai plus, dit Colin, et puis, ce n’est plus mon mariage, cette fois-ci.
– Oui », dit Jésus.
Il paraissait gêné.
« C’est très différent, dit Colin. Cette fois, Chloé est morte… Je n’aime pas l’idée de cette boîte noire...."

1947 - L’Automne à Pékin
Raymond Queneau, en tête de l'édition originale de L'Arrache-Cœur, en 1953, qualifiait L'Automne à Pékin d'«œuvre difficile et méconnue ». Ce roman, où triomphe l'absurde, débute par quatre parties liminaires indépendantes, notées A, B, C et D, qui présentent séparément presque tous les personnages de l’histoire, puis se poursuit selon trois mouvements intercalés de « Passages » qui sont des interventions ironiques de l’auteur relativement au déroulement des événements. De manière exceptionnelle, ce roman ne compte pas moins d’une trentaine de personnages qui convergent bon gré mal gré vers le fameux désert d’Exopotamie. La quiétude du seul hôtel de ces lieux va être bouleversée par la construction d’un chemin de fer dont on peut douter qu’il soit utile. Comble de l’absurde, la voie ferrée va devoir couper l’hôtel en deux, sous les ordres du cauteleux Amadis Dudu : « Le désert est la seule chose qui ne puisse être détruite que par construction. »
"Amadis Dudu suivait sans conviction la ruelle étroite qui constituait le plus long des raccourcis permettant d’atteindre l’arrêt de l’autobus 975. Tous les jours, il devait donner trois tickets et demi, car il descendait en marche avant sa station, et il tâta sa poche de gilet pour voir s’il lui en restait. Oui. Il vit un oiseau, penché sur un tas d’ordures, qui donnait du bec dans trois boîtes de conserves vides et réussissait à jouer le début des Bateliers de la Volga ; et il s’arrêta, mais l’oiseau fit une fausse note et s’envola, furieux, grommelant, entre ses demi-becs, des sales mots en oiseau. Amadis Dudu reprit sa route en chantant la suite ; mais il fit aussi une fausse note et se mit à jurer.
Il y avait du soleil, pas beaucoup, mais juste devant lui, et le bout de la ruelle luisait doucement, car le pavé était gras ; il ne pouvait pas le voir parce qu’elle tournait deux fois, à droite, puis à gauche. Des femmes aux gros désirs mous apparaissaient sur le pas des portes, leur peignoir ouvert sur un grand manque de vertu, et vidaient leur poubelle devant elles ; puis, elles tapèrent toutes ensemble sur le fond des boîtes à ordures, en faisant des roulements, et comme d’habitude, Amadis se mit à marcher au pas. C’est pour cela qu’il préférait passer par la ruelle. Ça lui rappelait le temps de son service militaire avec les Amerlauds, quand on bouffait du pineute beutteure dans des boîtes en fer-blanc, comme celles de l’oiseau mais plus grandes. Les ordures tombaient en faisant des nuages de poussière ; il aimait ça parce que cela rendait le soleil visible. D’après l’ombre de la lanterne rouge du grand six, où vivaient des agents de police camouflés (c’était en réalité un commissariat ; et, pour dérouter les soupçons, le bordel voisin portait une lanterne bleue), il s’approchait, environ, de huit heures vingt-neuf. Il lui restait une minute pour atteindre l’arrêt ; ça représentait exactement soixante pas d’une seconde, mais Amadis en faisait cinq toutes les quatre secondes et le calcul trop compliqué se dissolvait dans sa tête ; il fut, normalement, par la suite, expulsé par ses urines, en faisant toc sur la porcelaine. Mais longtemps après.
Devant l’arrêt du 975, il y avait déjà cinq personnes et elles montèrent toutes dans le premier 975 qui vint à passer, mais le contrôleur refusa l’entrée à Dudu. Bien que celui-ci lui tendît un bout de papier dont la simple considération prouvait qu’il était bien le sixième, l’autobus ne pouvait disposer que de cinq places et le lui fit voir en pétant quatre fois pour démarrer. Il fila doucement et son arrière traînait par terre, allumant des gerbes d’étincelles aux bosses rondes des pavés ; certains conducteurs y collaient des pierres à briquet pour que ce soit plus joli (c’étaient toujours les conducteurs de l’autobus qui venait derrière).
Un second 975 s’arrêta sous le nez d’Amadis. Il était très chargé et soufflait vert. Il en descendit une grosse femme et une pioche à gâteau portée par un petit monsieur presque mort.
Amadis Dudu s’agrippa à la barre verticale et tendit son ticket, mais le receveur lui tapa sur les doigts avec sa pince à cartes.
– Lâchez ça ! dit-il.
– Mais il est descendu trois personnes ! protesta Amadis.
– Ils étaient en surcharge, dit l’employé d’un ton confidentiel, et il cligna de l’oeil avec une mimique dégoûtante.
– Ce n’est pas vrai ! protesta Amadis.
– Si, dit l’employé, et il sauta très haut pour atteindre le cordon, auquel il se tint pour faire un demi-rétablissement et montrer son derrière à Amadis. Le conducteur démarra car il avait senti la traction de la ficelle rose attachée à son oreille.
Amadis regarda sa montre et fit « Bouh ! » pour que l’aiguille recule, mais seule l’aiguille des secondes se mit à tourner à l’envers ; les autres continuèrent dans le même sens et cela ne changeait rien. Il était debout au milieu de la rue et regardait disparaître le 975, lorsqu’un troisième arriva, et son pare-chocs l’atteignit juste sur les fesses. Il tomba et le conducteur avança pour se mettre juste au-dessus de lui et ouvrit le robinet d’eau chaude qui se mit à arroser le cou d’Amadis. Pendant ce temps-là, les deux personnes qui tenaient les numéros suivants montèrent, et lorsqu’il se releva, le 975 filait devant lui. Il avait le cou tout rouge et se sentait très en colère ; il serait sûrement en retard. Il arriva, pendant ce temps, quatre autres personnes qui prirent des numéros en appuyant sur le levier. La cinquième, un gros jeune homme, reçut, en plus, le petit jet de parfum que la compagnie offrait en prime toutes les cent personnes ; il s’en fut droit devant lui en hurlant, car c’était de l’alcool presque pur, et, dans l’oeil, cela fait très mal. Un 975 qui passait dans l’autre sens l’écrasa complaisamment pour mettre fin à ses souffrances, et l’on vit qu’il venait de manger des fraises.
Il en arriva un quatrième avec quelques places, et une femme qui était là depuis moins longtemps qu’Amadis tendit son numéro. Le receveur appela à voix haute.
– Un million cinq cent six mille neuf cent trois !
– J’ai le neuf cent !…
– Bon, dit le receveur, le un et le deux ?
– J’ai le quatre, dit un monsieur.
– Nous avons le cinq et le six, dirent les deux autres personnes.
Amadis était déjà monté, mais la poigne du receveur le saisit au collet.
– Vous l’avez ramassé par terre, hein ? Descendez !
– On l’a vu ! braillèrent les autres. Il était sous l’autobus.
Le receveur gonfla sa poitrine, et précipita Amadis en bas de la plate-forme, en lui perçant l’épaule gauche d’un regard de mépris. Amadis se mit à sauter sur place de douleur. Les quatre personnes montèrent, et l’autobus s’en alla en se courbant, car il se sentait un peu honteux.
Le cinquième passa plein, et tous les voyageurs tirèrent la langue à Amadis et aux autres qui attendaient là. Même le receveur cracha vers lui, mais la vitesse mal acquise ne profita pas au crachat, qui n’arriva pas à retomber par terre. Amadis tenta de l’écraser au vol, d’une chiquenaude, et le manqua. Il de fureur terrible, et quand il eut raté le sixième et le septième, il se décida à partir à pied. Il tâcherait de le prendre à l’arrêt suivant, où plus de gens descendaient habituellement.
Il partit en marchant de travers exprès, pour que l’on voie bien qu’il était en colère. Il devait faire à peu près quatre cents mètres, et, pendant ce temps-là, d’autres 975 le dépassèrent, presque vides. Quand il atteignit enfin la boutique verte, dix mètres avant l’arrêt, il déboucha, juste devant lui d’une porte cochère, sept jeunes curés et douze enfants des écoles qui portaient des oriflammes idolâtriques et des rubans de couleurs. Ils se rangèrent autour de l’arrêt et les curés mirent deux lance-hosties en batterie, pour ôter aux passants l’envie d’attendre le 975. Amadis Dudu cherchait à se rappeler le mot de passe, mais des tas d’années s’étaient écoulées depuis le catéchisme, et il ne put retrouver le mot. Il essaya de se rapprocher en marchant à reculons, et reçut dans le dos une hostie enroulée, lancée avec une telle force qu’il eut la respiration coupée et se mit à tousser. Les curés riaient et s’affairaient autour des lance-hosties qui crachaient sans arrêt des projectiles. Il passa deux 975 et les gosses occupèrent presque toutes les places vides. Dans le second il y en avait encore, mais un des curés resta sur la plate-forme et l’empêcha de monter ; et quand il se retourna pour prendre un numéro, six personnes attendaient déjà, et il fut découragé. Il courut alors de toute sa vitesse pour joindre l’arrêt suivant. Loin devant, il apercevait l’arrière du 975 et les gerbes d’étincelles, et il se plaqua au sol, car le curé braquait le lance-hosties dans sa direction. Il entendit l’hostie passer au-dessus de lui en faisant un bruit.
Amadis se releva tout souillé. Il hésitait presque à se rendre à son bureau dans cet état de saleté, mais que dirait l’horloge pointeuse. Il avait mal au couturier droit, et tenta de se planter une épingle dans la joue pour faire passer la douleur ..."
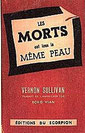
Les morts ont tous la même peau (1947)
Roman policier écrit par Boris Vian sous le pseudonyme de Vernon Sullivan dans lequel Dan, un sang-mêlé, un noir à peau blanche, s'est fait une place dans
la société des blancs : il travaille comme videur dans un bar new-yorkais et a épousé une femme blanche. Surgit un homme qui prétend être son frère et qui menace de révéler ses
origines...
"Il était deux heures de l’après-midi quand elle eut fini de s’habiller. Ça prend toujours un peu plus de temps qu’on ne croit ; mais ça m’arrangeait
d’une certaine façon. Il y aurait plus de monde, au cinéma. Du reste, j’avais choisi la salle où je voulais l’emmener. C’était une petite salle, à côté d’un collège de jeunes filles, toujours
bien remplie. Évidemment, il restait une chance que mon projet échoue lamentablement, mais, à ce moment, j’avais encore une solution en réserve. Nous quittâmes son appartement et l’ascenseur nous
déposa au rez-de-chaussée. Je la regardais à la dérobée. Malgré sa jeunesse, il y avait quelque chose dans sa façon de marcher et de s’habiller – on ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de ce
qu’elle était. Une idée me vint. L’idée que moi, j’avais réussi à dissimuler quelque chose de bien plus inavouable. J’avais réussi et je réussirais encore. Et dans quel but ? pensai-je, me
raillant moi-même. Tout ça, mes efforts, mes années de travail chez Nick ? Et me retrouver impuissant. Mais bah !… Maintenant j’étais bien tranquille, ça reviendrait vite. C’est drôle. Hier, avec
Sheïla, j’étais effondré. Tout à l’heure, avec cette fille, je m’étais mis en colère. Elle avait eu un mot malheureux aussi. Maintenant, je me sentais calme comme jamais. Je savais ce que
j’allais faire.
Elle marchait à côté de moi. Jolie fille. Les jambes, les seins, la tête. Tout y était. Il faut savoir choisir ses alibis. Nous arrivâmes au cinéma et
je pris deux places. Je la suivis le long de l’escalier nickelé au tapis épais, et le jet de la torche électrique du préposé troua l’ombre. Il regarda mes billets. – Seulement des places
séparées, dit-il. Vous changerez. Ça, ça faisait quinze pour Dan. Elle s’assit et je m’assis derrière elle, deux rangs plus loin. Dix minutes après, je me levai sans bruit et fis le tour par le
fond ; j’atteignis la sortie de secours et me trouvai dans la rue. Un taxi passait à vide. J’ébauchai un geste. Non. Pas de taxi. Métro. Je regardai ma montre. Largement le temps. Je fonçai vers
le métro... "

1948 - Et on tuera tous les affreux
Pastiche burlesque des romans policiers, l'histoire a pour décor une boîte de nuit de Los Angeles, dans laquelle un jeune bellâtre du nom de Rock Bailey est la coqueluche des demoiselles. Pourtant il désire conserver sa virginité jusqu'au jour de ses vingt ans. Ce soir-là, il est drogué et enlevé dans la clinique du docteur Schutz où on tente de le forcer à faire l'amour avec une magnifique fille, ce qu'il refuse de faire. Rocky décide ensuite de mener une enquête avec son ami Gary et Andy Sigman, un chauffeur de taxi qui l'a aidé, sur le docteur Schutz et ses expériences suspectes.
"Prendre un coup sur la tête, ce n’est rien. Être drogué deux fois de suite dans la même soirée, ce n’est pas trop pénible… Mais sortir prendre l’air et se retrouver dans une chambre in-connue avec une femme, tous les deux dans le costume d’Adam et Ève, ça commence à être un peu fort. Quant à ce qui m’est arrivé ensuite…
Mais je crois qu’il vaut mieux que je reprenne tout depuis le début de la première soirée. Soirée d’été, pour préciser. La date exacte importe peu.
Eh bien, je ne sais pas pourquoi j’avais envie de sortir. Le soir, je préfère en général aller me coucher, et me lever tôt, mais certains jours on sent le besoin d’un peu d’alcool, d’un peu de chaleur humaine, de compagnie. Probable que je suis un senti-mental. On ne le dirait pas à me voir, mais les bosses que font mes muscles sont les apparences trompeuses sous lesquelles je dissimule mon petit coeur de Cendrillon. J’aime bien les amis ; j’aime bien les amies ; je n’ai jamais manqué ni des unes ni des autres et de temps en temps je remercie en moi-même mes parents du physique qu’ils m’ont donné ; il y en a qui remercie-raient Dieu, je sais… mais entre nous, je trouve qu’ils mêlent Dieu à des histoires auxquelles il n’a réellement rien à voir. Quoi qu’il en soit, ma mère ne m’a pas loupé… mon père non plus… après tout il y est aussi pour quelque chose.
J’avais envie de sortir et je suis sorti. Il y a un avantage indéniable à se choisir des parents bien à leur aise. Je suis sorti ; toute la bande m’attendait au Zooty Slammer. Gary Kilian, le reporter du Call, Clark Lacy, un copain de l’université qui vivait près de Los Angeles, comme moi, et nos compagnes habituelles ; pas de ces filles que tous les types se croient obligés de trimbaler quand ils ont un peu d’argent ; pas de ces chanteuses à la gomme, pas de ces danseuses trop expertes. Je n’aime pas ça… elles sont toujours à se frotter contre vous. Pas ces filles-là. Non. Des amies, des vraies… ni figurantes en quête de contrat, ni ingénues un peu amochées, simplement des gentilles filles sympathiques. C’est terrible ce que j’ai du mal à en trouver. Lacy, il en déniche autant qu’il veut et il peut sortir avec elles dix soirs de suite sans qu’elles essaient de l’embrasser ; moi, je ne leur fais pas du tout le même effet, et c’est assommant de rem-barrer une jolie qui se jette dans vos bras. Quand même je ne voudrais pas avoir la gueule de Lacy. C’est une autre histoire, d’ailleurs. En fin de compte, je savais qu’au Slammer je rencontrerais Beryl Reeves et Mona Thaw et qu’avec elles, je ne risquais rien… Pour en revenir aux autres, elles ont toutes l’air de se figurer que l’amour c’est le but de la vie, surtout quand on pèse 90 kg et qu’on a six pieds deux pouces… Je leur réponds toujours que si je suis dans cette forme là, c’est justement parce que je me ménage. Et que si elles avaient mon tonnage de viande nette à balader, ça les fatiguerait assez pour qu’elles me fichent la paix… En tout cas, Beryl et Mona ne sont pas comme ça, et elles savent qu’une vie hygiénique c’est bien préférable à toutes les plaisanteries pas nouvelles qu’on répète sur les canapés.
Je suis entré au Zooty Slammer. C’est une boîte sympa, te-nue par Lem Hamilton, un gros pianiste noir qui a joué autre-fois dans l’orchestre de Leatherbird. Il connaît tous les musiciens de la côte et Dieu sait qu’il y en a en Californie. Au Slam-mer, on peut entendre de la vraie musique. J’aime ça, ça dé-tend… comme je suis déjà détendu naturellement, c’est terriblement reposant. Gary m’attendait, Lacy dansait avec Beryl et Mona me sauta au cou…
– Bonsoir Mona, dis-je. Rien de neuf ? Salut, Gary.
– Salut, me dit Kilian.
Il était impeccable, comme toujours. Un joli garçon brun à la peau bleutée. Son bowtie rouge clair avait l’air amidonné tellement il tenait droit. Ce que j’aime, chez Gary, c’est qu’il a du goût pour la toilette. Enfin il a le même goût que moi, c’est cela qu’il faut comprendre.
Mona me regardait.
– Rocky, me dit-elle, c’est indécent. Vous devenez plus beau tous les jours.
Avec elle, ce n’était pas gênant. Son ton était… comment… supportable.
– Vous êtes merveilleux, Rocky. Vos cheveux blonds… votre peau orange… mmm… on en mangerait.
J’ai rougi quand même. Je suis de cette espèce. Gary se foutait de moi…
– Tu ne protestes même plus, Rock, me dit-il. Autrefois, tu serais parti…
– Elle m’a donné des preuves d’intelligence, répondis-je, mais si elle continue comme ça, je vais sûrement m’en aller.
Elle rit. Gary aussi. Moi aussi. Ça, ce sont des copains.
Tout de même, je préférais que Lacy ne soit pas là… Je n’aime pas que les filles me complimentent sur mon physique, surtout devant Clark Lacy ; c’est le meilleur type de la terre, mais on dirait que son père est un rat et sa mère une grenouille, ça ne m’étonnerait pas tellement ; c’est de ça qu’il a l’air. Et ça le gêne un peu pour faire la cour aux filles.
Mona a remis ça.
– Rocky, quand allez-vous vous décider à m’avouer que vous m’aimez ? "
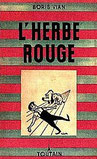
L'Herbe rouge (1950)
"Le vent, tiède et endormi, poussait une brassée de feuilles contre la fenêtre. Wolf, fasciné, guettait le petit coin de jour démasqué périodiquement
par le retour en arrière de la branche. Sans motif, il se secoua soudain, appuya ses mains sur le bord de son bureau et se leva. Au passage, il fit grincer la lame grinçante du parquet et ferma
la porte silencieusement pour compenser. Il descendit l’escalier, se retrouva dehors et ses pieds prirent contact avec l’allée de briques, bordée d’orties bifides, qui menait au Carré, à travers
l’herbe rouge du pays. La machine, à cent pas, charcutait le ciel de sa structure d’acier gris, le cernait de triangles inhumains. La combinaison de Saphir Lazuli, le mécanicien, s’agitait comme
un gros hanneton cachou près du moteur. Saphir était dans la combinaison. De loin, Wolf le héla et le hanneton se redressa et s’ébroua.
Il rejoignit Wolf à dix mètres de l’appareil et ils terminèrent ensemble.
– Vous venez le vérifier ? demanda-t-il.."
Refusé par Gallimard sous un autre titre, "Le Ciel crevé", "L'Herbe rouge" est finalement publié en 1950 par un éditeur de fortune. Boris Vian ne cesse de
conjurer ses propres inquiétudes au gré des situations les plus absurdes, un imaginaire aussi noir que burlesque. Ici l'ingénieur Wolf utilise ses connaissances de mécanique et de physique pour
explorer sa matière existentielle, inventant une machine pouvant lui faire revivre son passé et ses angoisses. Et parvenir au point où tout se serait à un moment donné détraqué, pour espérer
verser ce fatras de souvenirs dans le total oubli. Pour ce faire, il a construit un derrick au-dessus d'un trou qui plonge au centre de la Terre et cherche la couche des "souvenirs purs" : "
C’est tuant, de traîner avec soi ce qu’on a été avant..."
"La figure de Wolf était moite et glacée.
Ses jambes tremblaient maintenant et ce n’était pas la vibration du moteur qui les faisait trembler. Peu à peu, méthodiquement, il parvint cependant à
se contrôler.
À ce moment, il s’aperçut qu’il se rappelait. Il ne lutta pas contre les souvenirs et se maîtrisa plus profondément, baigné dans le passé. Le givre
craquant caparaçonnait ses vêtements de cuir d’une croûte brillante, cassée aux poignets et aux genoux.
Les lambeaux du temps jadis se pressaient autour de lui, tantôt doux comme des souris grises, furtifs et mobiles, tantôt fulgurants pleins de vie et de
soleil – d’autres coulaient tendres et lents fluides sans mollesse et légers, pareils à la mousse des vagues.
Certains avaient la précision, la fixité des fausses images de l’enfance formées après coup par des photographies ou les conversations de ceux qui se
souviennent, impossibles à ressentir à nouveau, car leur substance s’est évanouie depuis longtemps.
Et d’autres revivaient, tout neufs, comme il les rappelait à lui, ceux des jardins, de l’herbe et de l’air, dont les mille nuances de vert et de jaune
se fondent dans l’émeraude de la pelouse, foncé au noir dans l’ombre fraîche des arbres.
Wolf tremblait dans l’air blême et se souvenait. Sa vie s’éclairait devant lui aux pulsations ondoyantes de sa mémoire.
À sa droite et à sa gauche, la coulée lourde empoissait les montants de la cage.
Et d’abord ils accoururent en hordes inorganisées, comme un grand incendie d’odeurs, de lumière et de murmures.
Il y avait les porte-boules, dont on fait sécher les fruits rugueux pour obtenir le poil rêche à jeter dans le cou. Il y a des gens qui les nomment
platanes. Ce mot ne change rien à leurs propriétés.
Il y avait les feuilles tropicales barbelées de longs crochets cornés et bruns pareils à ceux d’insectes combattants.
Il y avait les cheveux courts de la petite fille, en neuvième, et le tablier bis du garçon dont Wolf était jaloux.
Les grands pots rouges des deux côtés du perron, transformés en Indiens sauvages par la nuit qui venait, et l’incertitude de
l’orthographe.
La chasse aux vers de terre avec un long manche à balai tournant.
Cette chambre immense, dont on entrevoyait la voûte sphérique par-delà le coin d’un édredon bombé comme le ventre énorme du géant qui mangeait les
moutons...."

1953 – L’Arrache-cœur
L’Arrache-cœur ne connut aucun succès, compte tenu sans doute de l'étrangeté de son texte, déroulant des situations absurdes à partir de jeux de mots ou de mots pris au pied de la lettre. Jacquemort est psychiatre et arrive dans un village, situé en bordure d'une falaise, où les habitants ont de drôle de comportements : les enfants peuvent voler dès qu’ils écartent le bras, les vieux sont vendus aux plus offrants pour être maltraités lors d’une foire quotidienne, les villageois se débarrassent des objets de leur honte dans un ruisseau pour qu’un homme les repêche avec ses dents. Jacquemort cherche désespérément des personnes à psychanalyser, pour s’imprégner de leurs ressentis, car lui n’en éprouve aucun. A force de fréquenter les villageois, le psychiatre va subir une métamorphose et s'intégrer totalement dans leurs étranges moeurs et coutumes.
"Le sentier longeait la falaise. Il était bordé de calamines en fleur et de brouillouses un peu passées dont les pétales noircis jonchaient le sol. Des insectes pointus avaient creusé le sol de mille petits trous ; sous les pieds, c’était comme de l’éponge morte de froid.
Jacquemort avançait sans se presser et regardait les calamines dont le coeur rouge sombre battait au soleil. À chaque pulsation, un nuage de pollen s’élevait, puis retombait sur les feuilles agitées d’un lent tremblement. Distraites, des abeilles vaquaient.
Du pied de la falaise s’élevait le bruit doux et rauque des vagues. S’arrêtant, Jacquemort se pencha sur l’étroit rebord qui le séparait du vide. En bas, tout était très loin, à pic, et de l’écume tremblait dans le creux des roches comme une gelée de juillet. Cela sentait l’algue braisée. Pris de vertige, Jacquemort s’agenouilla sur l’herbe terreuse de l’été, toucha le sol de ses deux mains étendues ; rencontrant dans ce geste des crottes de bique aux contours bizarrement irréguliers, il conclut à la présence, parmi ces animaux, d’un bouc de Sodome dont il croyait pourtant l’espèce disparue.
Maintenant, il avait moins peur et il osa de nouveau s’incliner sur la falaise. Les grands pans de roc rouge tombaient à la verticale dans l’eau peu profonde, d’où ils ressortaient presque aussitôt pour donner lieu à une falaise rouge sur la crête de laquelle Jacquemort, à genoux, se penchait.
Des récifs noirs émergeaient de place en place, huilés par le ressac et couronnés d’un anneau de vapeur. Le soleil corrodait la surface de la mer et la salissait de graffiti obscènes.
Jacquemort se releva, reprit sa marche. Le chemin tournait. À gauche il vit des fougères déjà marquées de roux et des bruyères en fleur. Sur les rocs dénudés brillaient des cristaux de sel apportés par le chasse-marée. Le sol, vers l’intérieur du pays, s’élevait en pente escarpée. Le sentier contournait des masses brutales de granit noir, jalonné, par places, de nouvelles crottes de bique. De biques, point. Les douaniers les tuaient, à cause des crottes.
Il accéléra l’allure, et se trouva brusquement dans l’ombre, car les rayons du soleil ne parvenaient plus à le suivre. Soulagé par la fraîcheur, il allait encore plus vite. Et les fleurs de calamines passaient en ruban de feu continu devant ses yeux.
À de certains signes, il reconnut qu’il approchait et prit le soin de mettre en ordre sa barbe rousse et effilée. Puis, il repartit allègrement. Un instant, la Maison lui apparut tout entière entre deux pitons de granit, taillés par l’érosion en forme de sucette et qui encadraient le sentier comme les piliers d’une poterne géante. Le chemin tournait à nouveau, il la perdit de vue. Elle était assez loin de la falaise, tout en haut. Lorsqu’il passa entre les deux blocs sombres, elle se démasqua entièrement, très blanche, entourée d’arbres insolites. Une ligne claire se détachait du portail, serpentait paresseusement sur le coteau et rejoignait, à bout de course, le sentier. Jacquemort s’y engagea. Arrivé presque en haut de la côte, il se mit à courir car il entendait les cris.
Du portail grand ouvert au perron de la maison une main prévoyante avait tendu un ruban de soie rouge. Le ruban montait l’escalier, aboutissait à la chambre. Jacquemort le suivit. Sur le lit, la mère reposait, en proie aux cent treize douleurs de l’enfantement. Jacquemort laissa tomber sa trousse de cuir, releva ses manches et se savonna les mains dans une auge de lave brute.
Seul dans sa chambre, Angel s’étonnait de ne pas souffrir. Il entendait sa femme gémir à côté, mais ne pouvait aller lui tenir les mains parce qu’elle le menaçait de son revolver. Elle préférait crier sans personne, car elle haïssait son gros ventre et ne voulait pas qu’on la vît dans cet état. Depuis deux mois, Angel restait seul en attendant que tout fût terminé ; il méditait sur des sujets infimes. Il tournait aussi en rond assez souvent, ayant appris par des reportages que les prisonniers tournent comme des bêtes, mais quelles ? Il dormait et tâchait de dormir en pensant aux fesses de sa femme, car, vu le ventre, il préférait penser à elle de dos. Une nuit sur deux, il se réveillait en sursaut. Le mal, en général, était fait et cela n’avait rien de satisfaisant.
Les pas de Jacquemort résonnèrent dans l’escalier. En même temps, les cris de la femme cessèrent et Angel resta frappé de stupeur. S’approchant doucement de la porte, il essaya de voir, mais le pied du lit lui masquait tout le reste et il se tordit douloureusement l’oeil droit sans résultat appréciable. Il se redressa et tendit l’oreille, à personne en particulier.
Jacquemort reposa le savon sur le bord de l’auge et saisit la serviette-éponge. Il s’essuya les mains, ouvrit sa trousse. De l’eau grouillait non loin de là, dans un vase électrique. Jacquemort y stérilisa son doigtier, le doigta habilement et découvrit la femme pour voir de quoi il retournait.
Ayant vu, il se redressa et dit d’un ton dégoûté :
– Il y en a trois.
– Trois…, murmura la mère, étonnée.
Puis elle se remit à hurler car son ventre lui rappelait soudain qu’elle y avait très mal.
Jacquemort prit dans sa trousse quelques pilules de fortifiant et les avala, il en aurait besoin. Puis, décrochant une bassinoire, il en donna un grand coup par terre pour faire monter la valetaille. Il entendit courir en bas, puis attaquer l’escalier. La nurse apparut, vêtue de blanc comme pour un enterrement chinois.
– Préparez les appareils, dit Jacquemort. Comment vous appelez-vous ?
– J’m’appelle Culblanc, M’sieur, répondit-elle avec un fort accent campagnard.

Boris Vian parle ici de l'influence maternelle sur son enfance à Ville-d'Avray,il y puisera ses lâchetés et ses peurs, ses limites. Clémentine, mère paranoïaque, abusive par tendresse, entreprend de veiller jusqu'à se rendre inhumaine, jusqu'à les enfermer dans une cage, les trois "salopiots" qu'elle a mis au monde, Joël, Noël et Citroën….
"ll s’interrogeait, incertain. La femme se taisait et la domestique, immobile, le regardait, le visage dénué d’expression.
– Il faut qu’elle perde les eaux, dit-elle.
Jacquemort, sans réagir, approuva. Puis, frappé, il releva la tête. La lumière baissait.
– C’est le soleil qui se cache ? demanda-t-il.
La bonne alla regarder. Le jour s’envolait derrière la falaise et un vent silencieux venait de se lever. Elle revint,
inquiète.
– Je ne sais pas ce qui arrive…, murmura-t-elle.
Dans la chambre, on ne distinguait rien qu’une phosphorescence autour du miroir de la cheminée.
– On va s’asseoir et attendre, suggéra Jacquemort à voix douce.
Il montait de la fenêtre une odeur d’herbes amères et de poussière. Le jour avait totalement disparu. Dans le creux d’ombre de la chambre, la mère se
mit à parler.
– Je n’en aurai plus, dit-elle. Jamais plus je n’en voudrai.
Jacquemort se boucha les oreilles. Elle avait une voix d'ongles sur du cuivre. La nurse sanglota, terrorisée. La voix envahissait la tête de Jacquemort
et lui lardaít le cerveau.
- Ils vont sortir, dit la mère avec un rire dur. Ils vont sortir et me faire mal et ce sera seulement le commencement.
Le lit commençait à geindre. La mère haletait dans le silence, et la voix reprit :
- Il y aura des années, des années, et chaque heure, chaque minute,
Jacquemort se boucha les oreilles. Elle avait une voix d’ongles sur du cuivre. La nurse sanglota, terrorisée. La voix envahissait la tête de Jacquemort
et lui lardait le cerveau.
– Ils vont sortir, dit la mère avec un rire dur. Ils vont sortir et me faire mal et ce sera seulement le commencement.
Le lit commençait à geindre. La mère haletait dans le silence, et la voix reprit :
– Il y aura des années, des années, et chaque heure, chaque seconde sera peut-être le but, et toute cette douleur n’aura servi qu’à cela et à me faire
mal pour tout le temps.
– Assez, murmura Jacquemort avec netteté.
La mère, maintenant, hurlait à se lacérer la gorge. Les yeux du psychiatre s’accoutumaient à la lueur émanée du miroir. Il vit la femme gisante, le
corps arqué, s’efforcer de tous ses membres. Elle poussa de longs cris successifs, et la voix retentissait aux oreilles de Jacquemort comme un voile de brume aigre et collante. Et subitement,
entre le dièdre des jambes levées, parurent, l’une après l’autre, deux taches plus claires. Il devina les gestes de la nurse, qui s’arrachait à sa terreur pour saisir les deux enfants, qu’elle
roula dans du linge.
– Encore un, dit-il pour lui.
La mère, torturée, semblait près d’abandonner. Jacquemort se mit debout. Comme le troisième bébé arrivait, il le saisit adroitement, aida la femme.
Brisée, elle retomba. La nuit se déchirait sans bruit, la lumière entrait dans la chambre, et la femme reposait, sa tête tournée sur le côté. De grands cernes marquaient son visage abîmé par le
travail. Jacquemort s’épongea le front et le cou, s’étonna d’entendre les bruits du jardin, dehors. La nurse achevait d’envelopper le dernier bébé, qu’elle coucha près des deux autres, sur le
lit. Elle alla jusqu’à l’armoire, à qui elle prit un drap qu’elle déploya dans la longueur.
– Je vais lui bander le ventre, dit-elle. Et il faut qu’elle dorme. Vous, allez-vous-en.
– Vous avez coupé les cordons ? s’enquit Jacquemort. Ligaturez-les bien serré.
– J’ai fait des rosettes, dit la nurse. Ça tient aussi bien et c’est plus élégant.
Il acquiesça, abruti.
– Allez retrouver Monsieur, suggéra la nurse.
Jacquemort s’approcha de la porte derrière laquelle Angel attendait. Il tourna la clé et entra. "

Les enfants appartiennent à leur mère. Et pas à leur père. Et leurs mères les aiment, par conséquent, il faut qu’ils fassent ce qu’elles disent. Elles savent mieux qu’eux ce qu’il leur faut, ce qui est bon pour eux, ce qui fera qu’ils resteront des enfants le plus longtemps possible….
"Comme je suis inquiète, se dit Clémentine, accoudée à sa fenêtre.
Le jardin se dorait au soleil.
Je ne sais pas où sont Noël, Joël ni Citroën. En ce moment ils peuvent être tombés dans le puits, avoir mangé des fruits empoisonnés, avoir reçu une
flèche dans l’œil si un enfant joue sur le chemin avec une arbalète, attraper la tuberculose si un bacille de Koch se met en travers, perdre connaissance en respirant des fleurs trop parfumées,
se faire piquer par un scorpion ramené par le grand-père d’un enfant du village, explorateur célèbre revenu récemment du pays des scorpions, tomber d’un arbre, courir trop vite et se casser une
jambe, jouer avec l’eau et se noyer, descendre la falaise et trébucher et se rompre le cou, s’écorcher à un vieux fil de fer et contracter le tétanos ; ils vont aller au fond du jardin et
retourner une pierre, sous la pierre, il y aura une petite larve jaune qui va éclore instantanément, qui va s’envoler vers le village, s’introduire dans l’étable d’un méchant taureau, le piquer
près du nase ; le taureau sort de son étable, il démolit tout ; le voilà qui part sur le chemin, dans la direction de la maison, il est comme fou et il laisse des touffes de poils noirs dans les
virages en s’accrochant aux haies d’épine-vinette ; juste devant la maison, il se rue tête baissée contre une charrette lourde tirée par un vieux cheval à moitié aveugle. Sous le choc, la
charrette se disloque et un fragment de métal est projeté en l’air à une hauteur prodigieuse ; c’est peut-être une vis, un boulon, un écrou, un clou, une ferrure du brancard, un crochet de
l’attelage, un rivet des roues, charronnées, puis brisées, réparées au moyen d’éclisses de frêne taillées à la main, et le morceau de fer monte en sifflant vers le ciel bleu. Il passe par-dessus
la grille du jardin, mon Dieu, il retombe, il retombe et en tombant effleure l’aile d’une fourmi volante et l’arrache, et la fourmi, mal dirigée, perdant sa stabilité, vague au-dessus des arbres
comme une fourmi abîmée, s’abat soudain dans la direction de la pelouse, mon Dieu, il y a là Joël, Noël et Citroën, la fourmi tombe sur la joue de Citroën et, rencontrant peut-être des traces de
confiture, le pique…
– Citroën ! où es-tu ?
Clémentine s’était précipitée hors de sa chambre, et criait, hors d’elle, tout en descendant l’escalier au grand galop. Dans le vestibule, elle se
heurta à la bonne.
– Où sont-ils ? Où sont mes enfants ?
– Mais ils dorment, répondit l’autre l’air étonné. C’est l’heure de leur sieste.
Eh bien ! oui, ce n’est pas arrivé cette fois ; mais c’était parfaitement plausible. Elle remonta dans sa chambre. Son cœur battait. Décidément, c’est
dangereux de les laisser aller seuls au jardin. En tout cas, il faudra leur interdire de retourner des pierres. On ne sait pas ce qu’on peut trouver sous une pierre. Des cloportes venimeux, des
araignées dont la piqûre est mortelle, des cancrelats qui peuvent véhiculer des maladies coloniales contre lesquelles il n’y a pas de remèdes connus, des aiguilles empoisonnées cachées là par un
médecin assassin lors de sa fuite vers le village après le meurtre des onze personnes en traitement qu’il avait amenées à modifier leur testament en sa faveur, fraude infâme découverte par un
jeune interne du service, un type bizarre avec une barbe rousse.
Que devient donc Jacquemort ? pensa-t-elle à ce propos ou vice versa. Je ne le vois plus guère. Ça vaut autant. Sous prétexte qu’il est à la fois
psychiatre et psychanalyste, il se mêlerait peut-être de l’éducation de Joël, Noël et de Citroën. Et de quel droit, on se le demande. Les enfants appartiennent à leur mère. Puisqu’elles ont eu
mal en les faisant, ils appartiennent à leur mère. Et pas à leur père. Et leurs mères les aiment, par conséquent, il faut qu’ils fassent ce qu’elles disent. Elles savent mieux qu’eux ce qu’il
leur faut, ce qui est bon pour eux, ce qui fera qu’ils resteront des enfants le plus longtemps possible. Les pieds des Chinoises. Les Chinoises, on leur met les pieds dans des chaussures
spéciales. Peut-être des bandelettes. Ou des petits étaux. Ou des moules d’acier. Mais en tout cas, on s’arrange pour que leurs pieds restent tout petits. On devrait faire la même chose avec les
enfants entiers. Les empêcher de grandir. Ils sont bien mieux à cet âge-là. Ils n’ont pas de soucis. Ils n’ont pas de besoins. Ils n’ont pas de mauvais désirs. Plus tard, ils vont pousser. Ils
vont étendre leur domaine. Ils vont vouloir aller plus loin. Et que de risques nouveaux. S’ils sortent du jardin, il y a mille dangers supplémentaires. Que dis-je mille ? Dix mille. Et je ne suis
pas généreuse. Il faut éviter à tout prix qu’ils sortent du jardin. Déjà, dans le jardin, ils courent un nombre incalculable de risques. Il peut y avoir un coup de vent imprévu qui casse une
branche et les assomme. Que la pluie survienne, et, s’ils sont en sueur après avoir joué au cheval, ou au train, ou au gendarme et au voleur, ou à un autre jeu courant, que la pluie survienne et
ils vont attraper une congestion pulmonaire, ou une pleurésie, ou un froid, ou une crise de rhumatismes, ou la poliomyélite, ou la typhoïde, ou la scarlatine, ou la rougeole, ou la varicelle, ou
cette nouvelle maladie dont personne ne sait encore le nom. Et si un orage se lève. La foudre. Les éclairs. Je ne sais pas, il peut même y avoir ce qu’ils disent, ces phénomènes d’ionisation, ça
a un assez sale nom pour que ça soit terrible, ça rappelle inanition. Et il peut arriver tant d’autres choses. S’ils sortaient du jardin, cela serait évidemment bien pire. Mais n’y pensons pas
pour l’instant. Il y a assez à faire pour épuiser toutes les possibilités propres du jardin. Et quand ils seront plus grands, ah ! la ! la ! Oui, voilà les deux choses terrifiantes, évidemment :
qu’ils grandissent et qu’ils sortent du jardin. Que de dangers à prévoir. C’est vrai, une mère doit tout prévoir. Mais laissons ça de côté. Je réfléchirai à tout ça un peu plus tard ; je ne
l’oublie pas : grandir et sortir. Mais je veux me contenter du jardin pour le moment. Rien que dans le jardin, le nombre d’accidents est énorme. Ah ! Justement ! le gravier des allées. Combien de
fois n’ai-je pas dit qu’il était ridicule de laisser les enfants jouer avec le gravier. S’ils en avalent ? On ne peut pas s’en apercevoir tout de suite. Et trois jours après, c’est l’appendicite.
Obligé d’opérer d’urgence. Et qui le ferait ? Jacquemort ? Ce n’est pas un docteur. Le médecin du village ? Il n’y a qu’un vétérinaire. Alors, ils mourraient, tout simplement. Et après avoir
souffert. La fièvre. Leurs cris. Non, pas de cris, ils gémiraient, ce serait encore plus horrible. Et pas de glace. Impossible de trouver de la glace pour leur mettre sur le ventre. La
température monte, monte. Le mercure dépasse la limite. Le thermomètre éclate. Et un éclat de verre vient crever l’œil de Joël qui regarde Citroën souffrir. Il saigne. Il va perdre l’œil.
Personne pour le soigner. Tout le monde est occupé de Citroën, qui geint de plus en plus doucement. Profitant du désordre, Noël se faufile dans la cuisine. Une bassine d’eau bouillante sur le
fourneau. Il a faim. On ne lui a pas donné son goûter, naturellement, ses frères malades, on l’oublie. Il monte sur une chaise devant le fourneau. Pour prendre le pot de confiture. Mais la bonne
l’a remis un peu plus loin que d’habitude, parce qu’elle a été gênée par une poussière volante. Cela n’arriverait pas si elle balayait un peu plus soigneusement. Il se penche. Il glisse. Il tombe
dans la bassine. Il a le temps de pousser un cri, un seul, et il est mort, mais il se débat encore mécaniquement, comme les crabes qu’on jette vivants dans l’eau bouillante. Il rougit comme les
crabes. Il est mort. Noël !
Clémentine se précipita vers la porte. Elle appela la bonne.
– Oui Madame.
– Je vous interdis de servir des crabes à déjeuner.
– Mais il n’y en a pas, Madame. C’est du rosbif et des pommes de sable.
– Je vous l’interdis tout de même.
– Bien Madame.
– Et ne faites plus jamais de crabes. Ni de homard. Ni d’écrevisses. Ni de langoustes.
– Bien Madame.
Elle rentra dans sa chambre. Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux tout faire cuire lorsqu’ils dorment, et tout manger
froid...."

Les Fourmis, 1949
Onze récits écrits de 1944 à 1947 sont réunis dans ce volume, un antimilitarisme résolu. Le premier récit qui donne son titre à l'ouvrage a été publié en 1946 dans Les Temps Modernes. Chaque nouvelle est écrite dans le style "Vian" - les idées les plus démentes et les situations les plus atroces sont décrites avec simplicité, détachement, ironie - et se termine de façon inattendue.
(La route déserte) "Un jeune homme allait se marier. Il terminait ses études de marbrier funéraire et en tous genres. Il était de bonne famille, son père dirigeait la section K des Chaudières Tubulères et sa mère pesait soixante-sept kilos. Ils vivaient au numéro 15, rue des Deux-Frères, le papier de la salle à manger, malheureusement, n'avait pas changé depuis 1926 et représentait des oranges orange sur un fond bleu de Prusse, ce qui est laid. De nos jours, on n"aurait rien mis et ceci sur un fond d'une couleur différente, plus claire par exemple. Il s'appelait Fidèle, et son père Juste. Sa mère aussi avait un nom.
Comme tous les soirs, il prit le métro pour se rendre à son cours, une pierre tombale sous le bras et ses outils dans une petite valise. A cause de la pierre, il se payait des couchettes afin d'éviter les remarques souvent acides, et pouvant abîmer le grain poli du calcaire, que l'on attire dans les voitures ordinaires, à voyager très chargé. .."
XIII
"Je viens de recevoir une lettre de Jacqueline, elle a dû la confier à un autre type
pour la mettre à la poste, car elle était dans une de nos enveloppes. Vraiment, c'est une fille bizarre, mais probablement toutes
les filles ont des idées pas ordinaires. Nous avons reculé un peu depuis hier, mais demain, nous avançons de nouveau. Toujours les mêmes villages
complètement démolis, ça vous donne le cafard. On a trouvé une radio toute neuve. Ils
sont en train de l'essayer, je ne sais pas si réellement on peut remplacer une lampe par un morceau de bougie. Je pense que oui
: je l'entends jouer Chattanooga, je l'ai dansé avec Jacqueline un peu avant de partir de là-bas. Je pense que je vais lui répondre si j'ai encore du temps. Maintenant, c'est Spike
Jones; j'aime aussi cette musique-là et je
voudrais bien que tout soit fini pour aller m'acheter une cravate civile avec des raies
bleues et jaunes."
XV
"Je suis toujours debout sur la mine. Nous étions partis ce matin en patrouille et je marchais le dernier comme d'habitude, ils sont tous passés à côté,
mais j'ai senti le déclic sous mon pied et je me suis arrêté net. Elles n'éclatent que quand on retire le pied. J 'ai lancé aux
autres ce que j'avais dans mes poches et je leur ai dit de s'en aller. Je suis tout seul. Je devrais attendre qu'ils reviennent, mais je leur ai dit de ne pas revenir, et
je
pourrais essayer de me jeter à plat ventre, mais j'aurais horreur de vivre sans jambes. Je n'ai gardé que mon carnet et le crayon. Je vais les lancer
avant de changer de jambe et il faut absolument que je le fasse parce que j'en ai assez de la guerre et parce qu'il me vient des
fourmis."

LE DESERTEUR (février 1954)
Les généraux n'aiment pas la guerre parce qu'elle perturbe leur tranquillité, écrit Boris Vian en 1951 dans Le Goûter des généraux, une pièce au
vitriol qui ne sera reconnue qu'à la fin des années 1960: "le jour où il ne restera que des militaires on sera tout de même autrement tranquille... et il n'y aura plus de guerre." (Dossiers
acénonètes du Collège de Pataphysique, 18-19).
Dans les années 1954-55, Boris Vian va se tourner vers le spectacle et la chanson, "engagée" il va sans dire. La plus célèbre, un texte antimilitariste
devenu, dit-on, hymne pacifiste, oeuvre d'un révolté qui appelle à la désertion alors que débute la conscription de toute une classe d'âge pour participer à la guerre d'Algérie. "Le
Déserteur", fut composé en février 1954. René Coty vient d'être difficilement élu, après treize tours de scrutin, président de la République alors que les conflits coloniaux se succèdent, en
Indochine puis en Algérie. La guerre d’Indochine, une guerre menée par des militaires de profession, a débuté en 1946 est entre dans sa dernière année, la défaite de l’armée française à la
Bataille de Diên Biên Phu marque le mois de mai 1954. Un nouveau conflit colonial approche à grand pas, la guerre d’Algérie, plus de trente attentats auront lieu, dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1954, en différents points du territoire algérien. "Le Déserteur" est d'abord interprété en mai 1954 par Mouloudji, qui refuse de chanter certains passages (il en appelle à ces
«Messieurs qu'on nomme grands» et non pas directement au Président de la République, et refuse d'appeler des jeunes gens à tirer sur les gendarmes). La chanson est reprise par Boris Vian lui-même
dès le début de l'année 1955 et rencontre alors l'hostilité générale. La censure ne s'exerça réellement sur cette chanson qu'à partir de 1958, la Guerre d'Algérie entrant dans une phase plus
critique....
Monsieur le Président
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Je viens de recevoir
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Monsieur le Président
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
C'est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m'en vais déserter
Depuis que je suis né
J'ai vu mourir mon père
J'ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Ma mère a tant souffert
Elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers
Quand j'étais prisonnier
On m'a volé ma femme
On m'a volé mon âme
Et tout mon cher passé
Demain de bon matin
Je fermerai ma porte
Au nez des années mortes
J'irai sur les chemins
Je mendierai ma vie
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens:
Refusez d'obéir
Refusez de la faire
N'allez pas à la guerre
Refusez de partir
S'il faut donner son sang
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n'aurai pas d'armes ("que je tiendrai une arme")
Et qu'ils pourront tirer ("et que je sais tirer ...")
Des poèmes inédits, probablement écrits entre 1951 et fin 1952, marquent une période d'intense dépression et de souffrance pour Boris Vian, il peine alors à se faire publier et subit plusieurs crises déclenchées par son atrophie cardiaque. Ils seront repris et chantés par Serge Reggiani..
JE VOUDRAIS PAS CREVER
Je voudrais pas crever
Avant d`avoir connu
Les chiens noirs du Mexique
Qui dorment sans rêver
Les singes à cul nu
Dévoreurs de tropiques
Les araignées d`argent
Au nid truffé de bulles
Je voudrais pas crever
Sans savoir si la lune
Sous son faux air de thune
A un côté pointu
Si le soleil est froid
Si les quatre saisons
Ne sont vraiment que quatre
Sans avoir essayé
De porter une robe
Sur les grands boulevards
Sans avoir regardé
Dans un regard d'égout
Sans avoir mis mon zobe
Dans des coinstots bizarres
Je voudrais pas finir
Sans connaître la lèpre
Ou les sept maladies
Qu'on attrape la-bas
Le bon ni le mauvais
Ne me feraient de peine
Si si si je savais
Que j'en aurai l'étrenne
Et il y a z aussi
Tout ce que je connais
Tout ce que j'apprécie
Que je sais qui me plaît
Le fond vert de la mer
Où valsent les brins d'algue
Sur le sable ondulé
L'herbe grillée de juin
La terre qui craquelle
L'odeur des conifères
Et les baisers de celle
Que ceci que cela
La belle que voilà
Mon Ourson, l'Ursula
Je voudrais pas crever
Avant dlavoir usé
Sa bouche avec ma bouche
Son corps avec mes mains
Le reste avec mes yeux
J'en dis pas plus faut bien
Rester révérencieux
Je voudrais pas mourir
Sans qu'on ait inventé
Les roses éternelles
La journée de deux heures
La mer à la montagne
La montagne à la mer
La fin de la douleur
Les journaux en couleur
Tous les enfants contents
Et tant de trucs encore..

Le 10 février 1953, dans une note intime Boris Vian écrivait ...
" ll me vient å l'idée que c'est terrible mais je ne sais absolument pas comment je serai ce que je serai après. Un vieux de quelle sorte. Et qu'au fond ça serait maintenant le moment merveilleux pour mourir si je croyais à la littérature. Alors qu'est-ce que je fais je meurs ou non? je voudrais reprendre un peu tout ça il y a bien longtemps les choses ont beaucoup bougé j'écris plein de conneries et ceci qui est une connerie de qualité plus personnelle en souffre c'est injuste que diable mon personnel vaut bien celui d'autres c'est-à-dire aussi moins."
Et le 7 mai 1952, cette autre confidence :
Je suis pas tellement chaud pour les écrire, ces histoires. C'est petit, tout ça. C'est pas plus petit que celles des autres, mais ce que c'est petit aussi, celles des autres. Cent ans sur une petite terre dans un petit système solaire dans une petite galaxie d'un petit univers. Rien, quoi. Vraiment rien. Et tout en même temps, mais de l'intérieur seulement.
Non, je lâche. J'ai pas envie. J'ai pas assez de mains. Et j'ai tant de choses en retard. Le forçat c'est pas celui qui travaille sur ordre, c'est celui qui ne fait pas ce qu'iI sent qu'iI doit faire. Ça, ça gêne. Mais c'est moins pénible quand même. Puisqu'on le fait pas, au bout du compte. Ne pas faire quelque chose, c'est de la vie positive. Je déconne. J'ai moins envie d'écrire mes histoires...
Et le 15 octobre 1952:
J'écris tant de choses sans rien dedans, pour vivre, que ça me dégoûte de I'acte lui-même, malgré l'envie que j'ai souvent et les idées que je voudrais coincer au passage. Mais perdues irrémédiablement, comme des battements de cœur.



Raymond Queneau, de dix-sept ans l'aîné de Boris Vian, deviendra en quelque sorte le père d'élection de ce dernier. Queneau est en effet le premier qui lui fait confiance comme écrivain et le fait éditer, mais aussi partage avec lui l’héritage d'Alfred Jarry et de son singulier "esprit pataphysique" (la science qui consiste en "la connaissance et l’application des solutions imaginaires"), la passion pour le langage et le jazz, la fantaisie caustique et les goûts artistiques.
"Boris Vian est un homme instruit et bien élevé, il sort de Centrale, ce n'est pas rien,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a joué de la trompinette comme pas un, il a été un des rénovateurs de la cave en France; il a défendu le style
Nouvelle-Orléans,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a aussi défendu le bibop,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian est passé devant la justice des hommes pour avoir écrit J'irai cracher sur vos tombes, sous le nom de Vernon
Sullivan,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a écrit trois autres pseudépygraphes,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a traduit de véritables écrits américains authentiques absolument, et même avec des difficultés de langage que ç'en est pas
croyable,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a écrit une pièce de théâtre, L'Équarrissage pour tous, qui a été jouée par de vrais acteurs sur une vraie scène, pourtant il n'y était pas allé avec le dos de la Q.I.R.,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian est un des fondateurs d'une des sociétés les plus secrètes de Paris, le Club des Savanturiers,
mais ce n'est pas tout :
Boris Vian a écrit de beaux livres, étranges et pathétiques, L'Écume des jours, le plus poignant des romans d'amour contemporains; Les Fourmis, la plus
termitante des nouvelles écrites sur la guerre; L'Automne à Pékin, qui est une œuvre difficile et méconnue,
mais ce n'est pas tout :
Car tout ceci n'est rien encore : Boris Vian va devenir Boris Vian."
(Avant-propos de L'Arrache-cœur, éditions Vrille, 1958, Fayard)


Raymond Queneau (1903-1976)
"Quelle satisfaction peut-on bien éprouver à ne pas comprendre quelque chose ?" Et c'est dans le langage que Queneau va s'amuser à épuiser son immense curiosité.
Queneau entend en effet bouleverser les rapports entre la langue écrite et son usage oral, s'adonnant à cette pleine liberté de langage qui lui permet de jouer verbalement et avec un plaisir infini des situations les plus cocasses de notre quotidien et de nos savoirs les plus sérieux. "Je naquis au Havre un vingt et un février en mil neuf cent et trois. Ma mère était mercière et mon père mercier. Ils trépignaient de joie." Raymond Queneau passe à Paris une licence de philosophie et en 1924 rejoint le mouvement surréaliste dont le dynamisme et l'inventivité le séduisent. Mais en 1929, il rompt avec Breton et va poursuivre sa passion des "fous littéraires", mêlant dans son oeuvre poésie et humour, révolte et dérision. Son premier roman, "Le Chiendent" (1933) est un jeu sur le langage, un tentative d'écrire "comme on parle", qu'il poursuivra à travers toute son oeuvre: "Pierrot mon ami" (1942), "Loin de Rueil" (1944), "Les Fleurs bleues" (1965). Il adhère en 1951 à ce fameux Collège de pataphysique qui fait la satire des institutions. En 1959, il publie "Zazie dans le métro", dont Louis Malle tire un film.
Esprit encyclopédique, poète, Queneau soutient l'Oulipo, atelier d'écriture qui crée des textes à partir de règles formelles contraignantes (Exercices de style, 1947 et 1963). Il a rédigé en 1937 un roman autobiographique en vers, "Chêne et Chien". Affecté par la mort de sa femme en 1972, il décède quatre ans plus tard.

Queneau introduit dans son "Cent Mille Milliards de poèmes", grâce à la disposition de chaque vers sur une bande de papier autonome, des possibilités indéfinies de combinaisons poétiques à partir des vers de dix sonnets. Le poème "Si tu t'imagines" reprend, selon le mot de Queneau, "un t'aime de Ronsard" et mêle à des jeux phonétiques le souvenir parodié du sonnet de Ronsard, "Mignonne, allons voir si la rose"...
Si tu t'imagines, si tu t'imagines
Fillette, fillette, si tu t'imagines
Qu'ça va, qu'ça va, qu'ça va durer toujours
La saison des za, la saison des za
Saison des zamours
Ce que tu te goures, fillette, fillette
Ce que tu te goures.
Si tu crois, petite, si tu crois, ah ! ah !
Que ton teint de rose, ta taille de guêpe
Tes mignons biceps, tes ongles d'émail
Ta cuisse de nymphe et ton pied léger
Si tu crois, petite,
Qu'ça va, qu'ça va, qu'ça va durer toujours
Ce que tu te goures, fillette, fillette
Ce que tu te goures.
Les beaux jours s'en vont
Les beaux jours de fêtes
Soleils et planètes tournent tous en rond
Mais toi, ma petite, tu marches tout droit
Vers sque tu vois pas
Très sournois, s'approchent
La ride véloce
La pesante graisse
Le menton triplé
Le muscle avachi
Allons, cueille, cueille les roses, les roses
Roses de la vie,
Et que leurs pétales soient la mer étale
De tous les bonheurs,
Allons, cueille, cueille, si tu le fais pas
Ce que tu te goures, fillette, fillette
Ce que tu te goures
(Ed.Gallimard,1952)

Le Chiendent (1933)
Premier roman de Queneau, Le Chiendent annonce toute l'oeuvre de l'écrivain : la parodie et la transcription écrite du français parlé produisent immédiatement de nombreux effets comiques. C'est ainsi que Mme Cloche s'abandonne au regret et à la rêverie, à la manière d'Emma Bovary, l'héroïne de Flaubert.
"La petite vie allait recommencer. C'était finis les grands espoirs. La grande vie. Les grandes perspectives. Elle avala sa menthe verte, en se poissant les doigts.
Alle aurait commencé par s'acheter quelques robes, des chouettes alors, qui l'auraient rajeunie de vingt ans et alle s'rait allée chez l'institut d'beauté, où squ'on l'aurait rajeunie de vingt ans. Total, quarante. Ca fait qu'elle en aurait eu quinze. Avec de la monnaie, qu'est-ce qu'on ne fait pas! Ensuite de quoi, a s'rait allée chez l'marchand d'bagnoles. Une bathouze qu'elle aurait dit, avec un capot long comme ça, et des coussins bien rembourrés. Quéque chose qui fasse impressionnant. Alle aurait pris une femme de chambre et un chauffeur et en route pour Montécarlau. Et puis elle aurait aussi acheté une villa à Neuilly avec eau, gaz, électricité, ascenseur, cuisine électrique, frigidaire, chauffage central, tseuseufeu (TSF), et peut-être une salle de bain. Alle commencerait par faire remplir sa cave de champagne. Tous les jours, à tous les repas, champagne, sauf le matin, au lever, toujours comme d'habitude, boudin froid et gros rouge.
A s'voyait déjà arrivant au casino, quéquepart au soleil, dans un patelin ousqu'i fait toujours beau; a s'voyait arrivant au casino, avec épais comme ça d'poudre sur la gueule, les nichons rafistolés et une robe à trois mille balles su'l'dos, entre deux types bien fringués en smoquinges et les cheveux collés su'l'crâne, des beaux mecs, quoi. Et les gens i zauraient dit : Qui c'est celle-là qu'a des diamants gros comme le poing? C'est-y la princesse Falzar ou la duchesse de Frangipane? Non, non, qu'i zauraient dit les gens renseignés, c'est Mme du Belhôtel, qui s'occupe d'oeuvres de bienfeuzouance et du timbre antiasthmatique. Alle a été mariée avec un prince hindou qu'i diraient les gens, c'est s'qu'essplique sa grosse galette. En tout cas, y a une chose qu'elle aurait pas fait, ça aurait été d'jouer à la roulette. C'est idiot. On perd tout c'qu'on veut. Non sa belle argent, elle l'aurait pas j'tée comm'ça su'l'tapis vert, pour qu'alle s'envole et qu'alle la r'voie pus. Non, Alle aurait pas reculé d'vant la dépense, ça non; pour la rigolade, elle aurait été un peu là. Mais aller foutre son pèze dans la caisse d'un casino, ça, a n'l'aurait pas fait."

"Pierrot, mon ami" (1943)
Le plus énigmatique des romans de Raymond Queneau, . un roman policier sans criminel, sans victime et sans détective, un lecteur qui tend à penser que peut-être l'auteur lui cache quelque chose, mais quoi, mais où ? Roman de l'oubli, a-t-on dit, les visages, les événements et les lieux s`enfouissent dans une brume opaque, les gens ne se reconnaissent pas facilement, ils hésitent, ils doutent de leur mémoire et de celle de leurs interlocuteurs, et ce d'autant plus qu'ils évoluent tous dans un temps insaisissable tout en possédant une certaine réalité. Pierrot, personnage lunaire, évolue dans cet univers guère plus activement qu'un bouchon sur l`eau. Il ne connaît que des emplois précaires, des déboires amoureux et fait partie de ces "philosophes" populaires qu'affectionne Raymond Queneau et "qui portent sur le monde ce regard myope qu`une jeunesse difficile a rendu mi-indulgent, mi-résigné. Rien ne peut vraiment les surprendre, car ils n'attendent rien, ni des hommes ni de la Providence...."
"Tu vois bien que ce ne sont pas de méchants garçons, dit Mme Tortose qui venait de se décaisser à son époux, Paradis et Petit Pouce eurent l'autorisation de partir.
- Bien, patron. On boucle et on va se promener.
Ils bouclèrent et allèrent se promener. Ils allèrent au plus près, c'est-à-dire qu'ils ne sortirent pas de l'Uni-Park, où ce dimanche de juin déversait et le beau temps et la foule, conjugués en un bouillonnement noir et gueulard qu'aspergeaient de leurs feux et de leurs musiques plus de vingt attractions. Ici l'on tourne en rond et là on choit de haut, ici l'on va très vite et là tout de travers, ici l'on se bouscule et là on se cogne, partout on se secoue les tripes et l'on rit, on tâte de la fesse et l'on palpe du nichon, on exerce son adresse et l'on mesure sa force, et l'on rit, on se déchaîne, on bouffe de la poussière.
Pierrot, Petit-Pouce et Paradis s'appuyèrent contre la balustrade qui entourait la piste des autos électriques à ressorts et ils examinèrent la situation. Comme à l'habitude, il y avait là des couples (sans intérêt), des hommes seuls, des femmes seules. Tout le jeu consistait pour les hommes seuls à tamponner les femmes seules. Quelques hommes seuls, très jeunes, encore dans toute la fleur de leur naïveté, se contentent des joies de la vanité et s'appliquent à décrire des ellipses sans heurts. Peut-être se consolent-ils ainsi de ne pas en avoir une vraie, d'auto. Quant aux femmes seules, elles peuvent naturellement être deux dans la même voiture, ça ne les empêche pas d'être seules, à moins de cas extrêmes plus ou moins saphiques.
Petit-Pouce et Paradis, après avoir serré la pince de quelques collègues dont la besogne consistait à voltiger d'auto en auto pour faire payer les amateurs (certains ne démarraient pas de toute la soirée), Petit-Pouce et Paradis aperçurent justement un de ces couples bi-femelles et y reconnurent les deux petites qui avaient amorcé la soirée devant le Palace. Ils attendirent avec patience que de choc en choc elles passassent près d'eux; et alors les interpellèrent, sans vergogne. Elles firent tout d'abord fi de ces avances et continuèrent leurs pérégrinations, mais une mêlée générale les ayant coincées face à leurs galants, elles voulurent bien sourire.
Au coup de cloche marquant le renouvellement de l'écot, Petit-Pouce et Paradis enjambèrent la clôture et se jetèrent dans un véhicule. Dès que la cloche annonça la reprise des hostilités, ils se mirent à la poursuite des deux enfants pour les percuter. Et hardi! Ayant ainsi fait amplement connaissance, au coup de cloche suivant un chassé-croisé répartit ces quatre personnes en deux couples hétérosexuels. Petit-Pouce choisit la brune frisée et Paradis prit la décolorée. Et hardi! Pierrot ne choisit ni ne prit rien.
Accoudé bien à son aise, Pierrot pensait à la mort de Louis XVI, ce qui veut dire, singulièrement, à rien de précis; il n'y avait dans son esprit qu'une buée mentale, légère et presque lumineuse comme le brouillard d'un beau matin d'hiver, qu'un vol de moucherons anonymes. Les autos se cognaient avec énergie, les trolleys crépitaient contre le filet métallique, des femmes criaient; et, au-delà, dans tout le reste de l'Uni-Park, il y avait cette rumeur de foule qui s'amuse et cette clameur de charlatans et tabarins qui fusent et ce grondement d'objets qui s'usent. Pierrot n'avait aucune idée spéciale sur la moralité publique ou l'avenír de la civilisation, On ne lui avait jamais dit qu'il était intelligent. On lui avait plutôt répété qu'il se conduisait comme un manche ou qu'il avait des analogies avec la lune. En tout cas, ici, maintenant, il était heureux, et content, vaguement.
D'ailleurs parmi les moucherons, il y en avait un plus gros que les autres et plus insistant. Pierrot avait un métier, tout au moins pour la saison. En octobre, il verrait. Pour le moment, il avait un tiers d`an devant lui tintant déjà des écus de sa paye. Il y avait de quoi être heureux et content pour quelqu'un qui connaissait en permanence les jours incertains, les semaines peu probables et les mois très déficients. Son œil beurre noir lui faisait un peu mal, mais est-ce que la souffrance physique a jamais empêché le bonheur ?
Petit-Pouce et Paradis eux, pour eux la vie était belle, vraiment. Un bras passé autour de la taille d'une succulente caille, de l'autre négligemment manipulant le volant de leur véhicule réduit, ils se payaient du bonheur à quarante sous les cinq minutes. Ils jouissaient doublement de leur sens tactile, directement, par le contact d'une côte ou d'un sein à travers une étoffe minimum, indirectement par les heurts qu'ils imposaient ou plus rarement récoltaient. Ils jouissaient également doublement dans leur vanité, directement en heurtant
beaucoup plus souvent qu'ils n'étaient heurtés, indirectement en pensant à Pierrot qu'ils avaient laissé a la bourre, et solitaire. Avec la musique en plus, un haut-parleur qui bramait "ô mon amour, à toi toujours", il y avait vraiment de quoi laisser courir le long de son échine le frisson de la douce existence; et comme quoi il est prouvé qu'on peut très bien ne pas penser à la mort de Louis XVI, et tout de même continuer à exister avec au moins une apparence humaine, et du plaisir dans le cœur.
Cependant, durant les entr'actes, Petit-Pouce n'était pas tellement que ça un homme heureux. Parce qu'lil était marié, très légitimement. Et il avait des remords. Des tout petits mais des remords tout de même. Alors tout en sortant son larenqué, il n'en pressait que plus fort la jeune mamelle où se plantaient ses doigts.
Ses copains remettant ça, Pierrot, lassé, se détourna. Il avait devant lui la masse babylonienne l'Alpinic-Railway où parfois passait un train de wagonnets dévalant en emportant avec lui des hystéries de femmes. A sa droite, les philosophes, dispersés par la police, s'étaient regroupés le nez en l'air, à quelques pas d'un écureuil dans lequel s'évertuait une gaillarde à biceps, et qui n'avait pas froid aux yeux, ni ailleurs. A sa gauche, se succédaient tirs, jeux et loteries. C'est de ce côté qu'il alla ..."
"Les Ziaux" (1943), composé entre 1920 et 1943, contient une quarantaine de poèmes dont certains datent de l`adolescence. C`est, avec "Marine" et "Un enfant a dit", l'ouvrage de Raymond Queneau dans lequel l'influence du surréalisme est la plus apparente. Mais ce qui frappe davantage, c'est la grande liberté de ton et d`allure de ce recueil. Contrairement à la plupart de ses confrères, Queneau ne se croit pas tenu de donner toujours de lui la même image et ne craint pas de désorienter ses lecteurs...
L'EXPLICATION DES MÉTAPHORES
Loin du temps, de l'espace, un homme est égaré,
Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore,
Les naseaux écumants, les deux yeux révulsés,
Et les mains en avant pour tâter le décor
- D'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on,
La signification de cette métaphore :
"Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore"
Et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions ?
Si je parle du temps, c'est qu'il n'est pas encore,
Si je parle d'un lieu, c'est qu'iI a disparu,
Si je parle d'un homme, il sera bientôt mort,
Si je parle du temps, c'est qu'il n'est déjà plus,
Si le parle d'espace, un dieu vient le détruire,
Si ie parle des ans, c'est pour anéantir,
Si j'entends le silence, un dieu vient y mugir
Et ses cris répétés ne peuvent que me nuire.
Car ces dieux sont démons; ils rampant dans l'espace
Minces comme un cheveu, amples comme I'aurore,
Les naseaux écumants, la bave sur la face,
Et les mains en avant pour saisir un décor
- D'ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on,
La signification de cette métaphore :
"Minces comme un cheveu, amples comme l'aurore"
Et pourquoi cette face hors des trois dimensions ?
Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvrent la mer
De leur poids infini, de leur vol immortel,
Si je parle des dieux, c'est qu'ils hantent les airs,
Si je parle des dieux, c'est qu'ils sont perpétuels,
Si je parle des dieux, c'est qu'ils vivent sous terre,
insufflant dans le sol leur haleine vivace,
Si je parle des dieux, c'est qu'ils couvent le fer,
Amassent le charbon, distillent le cinabre.
Sont-ils dieux ou démons ? lls emplissent le temps,
Minces comme un cheveu, amples comme l'aurore
L'émail des yeux brisé, les naseaux écumants,
Et les mains en avant pour saisir un décor
- D'ailIeurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on,
La signification de cette métaphore :
"Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore"
Et pourquoi ces deux mains hors des trois dimensions ?
Oui, ce sont des démons. L'un descend, l'autre monte.
A chaque nuit son jour, à chaque mont son val, S
A chaque jour sa nuit, à chaque arbre son ombre,
A chaque être son Non, à chaque bien son mal,
Oui, ce sont des reflets, images négatives,
S'agitant à l'instar de l'immobilité,
Jetant dans le néant leur multitude active
Et composant un double à toute vérité.
Mais ni dieu ni démon l'homme s'est égaré,
Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore,
Les naseaux écumants, les deux yeux révulsés,
Et les mains en avant pour tâter un décor
- D'ailleurs inexistant. C'est qu'il est égaré;
ll n'est pas assez mince, il n'est pas assez ample :
Trop de muscles tordus, trop de salive usée.
Le calme reviendra lorsqu'il verra le Temple
De sa forme assurer sa propre éternité."
(Les Ziaux)

"Loin de Rueil" (1944)
Un roman, qui devait s`appeler La Peau des rêves et qui se présente comme une paraphrase très libre de la mythologie du cinéma, La Peau des rêves, c'est l`écran sur lequel les rêves se profilent, et qu'il faut traverser pour pouvoir les réaliser. Il raconte l'histoire de Jacques L`Aumône, fils d`un bonnetier de Rueil, et future vedette de Westerns sous le nom de James Charity, suite à de nombreuses aventures, souvent rocambolesques. En effet, les rêves étant ce qu'ils sont, le lecteur n`est jamais assuré de l'authenticité des péripéties dans lesquelles le romancier malicieux plonge son héros. D`autres personnages apparaissent, Théodore L`Aumône. père de Jacques, le poète (méconnu) Louis-Philippe des Cigales, le pharmacien Baponot, plus quelques femmes pleines de charme, dont la jolie et volontaire Lulu Doumer qui deviendra, à la fin du roman. la partenaire de James Charity. Le thème du rêveur, avatar quotidien du poète, trouvera un développement systématique et plus complet, vingt ans plus tard, dans "Les Fleurs bleues". Ajoutons l'inattendu thème qui revient tout le long du roman comme un motif musical, celui des poux, images triviales des rêves (les pédiculidés courent sur la tête et les songes à l'intérieur), les poux suivent les héros, ponctuent leurs états d'âme et leur donnent des sujets de conversation....
LE REVEUR ÉVEILLÉ
"La mère Béchut se montre enfin aux applaudissements de l'assistance et assommant un vieux piano elle exécute de douze fausses notes dans la clé de sol un morceau de musique sautillant et pimprené qui fut peut-être célèbre. Puis vient le documentaire, la pêche à la sardine. Les gosses ça les emmerde le docucu, et comment. De plus ils n'ont pas des bottes de patience. Conséquemment s'agite la salle et bientôt les cris s'enflent au point que les rares adultes présents ne pourraient plus goûter les harmonies béchutiennes même s'iIs le désiraient les imbéciles. Puis ensuite après au milieu d'un chahut général s'estompent les sardines. On fait la lumière. Les gosses s'entrexaminent et se lancent des boulettes de papier ou des bouts de sucette gluants. Enfin de nouveau la lumière s'éteint.
On fait silence. Le premier grand film commence.
Se profila sur l'écran un cheval énorme et blanc, et les bottes de son cavalier. On ne savait pas encore à quoi tout cela mènerait, la mère Béchut tapait à cœur fendre sur sa grelottante casserole, Jacques et Lucas tenaient leur siège à deux mains comme si ç'avait été cette monture qu'ils voyaient là devant eux immense et planimétrique. On montre donc la crinière du solipède et la culotte du botté et l'on montre ensuite les pistolets dans la ceinture du culotté et l'on montre après le thorax puissamment circulaire du porteur d'armes à feu et
l'on montre enfin la gueule du type, un gaillard à trois poils, un mastard pour qui la vie des autres compte pas plus que celle d'un pou, et Jacquot n'est nullement étonné de reconnaître en lui Jacques l'Aumône.
Comment est-il là ? C'est assez simple. Après avoir abdiqué pour des raisons connues de lui seul Jacques Comte des Cigales a quitté l'Europe pour les Amériques et le premier métier qu'il a choisi de faire en ces régions lointaines est celui d'orlaIoua.
En ce moment par exemple, il inspecte la plaine debout sur un éperon rocheux qui domine la vallée, il finit par apercevoir là-bas à l'horizon quelque chose, on ne sait pas encore très bien quoi. Il fait un geste, un grand geste purement décoratif qui zèbre l'écran de toute la promesse de rares aventures et le cheval qui jusqu'alors piaffait fout le camp au galop.
On les voit qui déboulent des pentes, à pic parce qu'on a mis l'objectif de travers, sans le dire. Ils sautent par-dessus d'imprévus obstacles ou voltigent par-dessus des ruisseaux.
lls s'engagent sur une petite passerelle qui joint sans garde-fou les deux rives escarpées d'un torrent et le vertige ne saisit pas Jacques lorsqu'il aperçoit à cent mètres au-dessous de lui
le bouillonnement des eaux. Un peu après ce passage, un défi (semble-t-il) aux lois de l'équiIibre, notre héros se précipite menaçant sur un chariot bâche que conduit un vieil homme et que traînent approximativement deux ou trois mules.
Haut les mains, le vioc obtempère, mais alors ô merveille, une superbe et idéale innocente et blonde jeune fille apparaît et le cinéma sans couleur doit s'avouer impuissant à rendre la cérulèinité de ses châsses. Jacques, galant homme, ne lui fera pas le moindre mal non plus qu'au croulant qui n'est autre que le papa. Au contraire, il les va protéger. ll les accompagne et caracole près de la beauté qui s'apprivoise. Le paternel fait glisser son émotion en s'huilant le gosier avec du visqui, c'est un gai luron qui trémousse encore joliment des doigts du pied qu'il n'a pas dans la tombe.
Tout d'un coup, voilà ce qu'on craignait et ce qu'on espérait: cinq ou six lascars se sont embusqués derrière les rochers. Haut les mains qu'ils crient eux aussi, mais Jacques ne se laisse pas impressionner : il se jette à bas de son cheval et que la poudre parle! Elle ne parle pas, elle siffle! Non pas elle, les balles! Sifflent. En tout cas voilà déjà un des assaillants sur le carreau : il voulut montrer son nez hors de sa cachette et toc c'est un mourant. Un second, fantaisie singulière, change d'abri. Notre héros l'atteint d'un plomb agile et le desperado faisant une grimace s'écroule supprimé. La jeune personne s'est planquée derrière le chariot, elle utilise une carabine élégante et jolie pour faire le coup de feu. Un grand méchant à moustaches noires vise avec soin Jacques l'Aumône, pan la jolie blonde lui enlève un bout de biceps d'une balle rasante. Cet exploit provoque la retraite des agresseurs. On se congratule quand tout å coup on s'aperçoit que le paternel est mort. Il a reçu un coup de pétard dans le buffet. Il est plein de grains de plomb. Il n'y a plus qu'à l'enterrer.
On l'enterre.
Mais que va-t-elle devenir, la charmante orpheline, plus belle encore d'avoir ses yeux tout humides. Elle a de plus en plus besoin d'un protecteur et comme elle voudrait bien aller à Houston (Texas) rejoindre son frère, Jacques propose de l'accompagner.
Elle veut bien, mais arrivés en ville, minute, faut se séparer. Jacques s'incline, on est galant ou on ne l'est pas. Ben. D'ailleurs la gosse n'a pas froid aux yeux malgré son innocence et saurait bien répondre d'une balle dans le buffet à des propositions trop hardies. Elle demande où est son frangin, orphelin qui s'ignore. On lui dit qu'il est au bar. Elle n'hésite pas un seul instant. Malgré la sale réputation de ces endroits la voilà qui pousse la porte à double battant et entre. Ce n'est pas un bar pour rire. il est immense et tonitruant, on n'y boit que du tord-intestins et les citoyens qui se montrent là sont des vachement durs, quant aux femmes court vêtues et pailletées des durement vaches.
La petite qui se nomme Daisy par conséquent cherche partout son frère. L'Idée lui vient de s'adresser au patron. Ça doit être ça le patron : il a une redingote grise et une grosse moustache au-dessus d'un ventre qui commence à pousser. "Pardon, Monsieur, avez-vous vu mon frère, l'orpheIin Billy?"
Le patron veut avoir des détails, la conversation l'intéresse : on devine pourquoi. Encore un satyre. Venez donc voir dans ce coin-là qu'il lui dit à la petite, venez donc voir s'il n'est pas caché par là. Petit petit petit. L'innocente le suit. Le salaud ferme la porte derrière lui et commence à relever les babines avec conculpuissance. Oh! le vilain sagouin. La petite y passerait sans doute si Jacques n'entrait pas là comme par hasard. D'une taloche sur l'occiput il aplatit le patron dégonflé.
Ç'ui-ci en croque sa moustache et grince des dents. Pas difficile de deviner qu'il leur revaudra ca et qu'il va couver une vacherie pas ordinaire.
Jacques s'incline galamment : « Puis-je vous être utile à quelque chose, mademoiselle ? » Elle sourit et répond : « Je cherche mon frère I'orpheIin Billy. » Billy ? Il ne connaît que ça. Hélas, c'est pas un frère très respectable. Il le lui montre. Billy au premier étage s'enivre, de surcroît une cocotte est assise sur ses genoux. Horreur qu'elle fait, la petite. Jacques arrache à la débauche le pauvre orphelin, c'est encore le sujet, et l'objet, d'une bagarre maison.
Tout finit par s'arranger; Jacques offre un ranch à Daisy, ce qui permet à la petite d'exhiber une jupe-culotte et des bottes blanches.
Cependant, le responsable du beuglant n'a pas digéré l'avanie à zézigue inflfligée par le fondateur de la dynastie des Laumoningiens. ll recrute quelques Apaches et les lance dans le
circuit. Ils enlèvent la poupée et Jacquot suivi du frangin qu'en a toujours un coup dans l'nez fonce à leur poursuite.
Ça galope pendant cinq minutes, ca barde pendant trois et en fin de compte il délivre la mignonne mais comme ça I'embête de l'épouser, car il n'a pas encore envie de faire une fin, il préfère s'acclimater une balle mortelle dans le buffet quitte à ressusciter ultérieurement."
(Loin de Rueil)

"Exercices de style" (1947)
Le livre le plus célèbre de Raymond Queneau, avant la parution de "Zazie dans le métro" (1959) : il raconte de quatre-vingt-dix neuf manières différentes la brève histoire que voici :
"Sur la plate-forme arrière d`un autobus de la ligne S, le narrateur aperçoit un jeune homme au long cou. coiffé d`un chapeau orné d'une tresse au lieu de ruban. Une brève altercation oppose ce jeune homme à un autre voyageur, qu`il accuse de lui avoir délibérément écrasé les orteils. Puis, il va s`asseoir à l'intérieur, une place s`étant libérée. Passant un peu plus tard. toujours en autobus, devant la gare Saint-Lazare. le narrateur revoit le jeune homme. en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton de son pardessus."
Ces cent-moins-une variations sur un thème dérisoire sont tout à la fois d'une grande virtuosité linguistique et extrêmement drôles, maintes fois reprises par des comédiens et des metteurs en scène. Dès 1949, Yves Robert en faisait un spectacle avec la complicité des Frères Jacques. ...
Hésitations
"Je ne sais pas très bien où ça se passait... dans une église, une poubelle, un charnier? Un autobus peut-être? Il y avait là... mais qu'est-ce qu'il y avait donc là? Des œufs, des tapis, des radis? Des squelettes? Oui, mais avec encore leur chair autour, et vivants. Je crois bien que c'est ça. Des gens dans un autobus. Mais il y en avait un (ou deux?) qui se faisait remarquer, je ne sais plus très bien par quoi. Par sa mégalomanie? Par son adiposité? Par sa mélancolie? Mieux... plus exactement... par sa jeunesse ornée d'un long... nez? menton? pouce? non : cou, et d'un chapeau étrange, étrange, étrange. Il se prit de querelle, oui c'est ça, avec sans doute un autre voyageur (homme ou femme? enfant ou vieillard?). Cela se termina, cela finit bien par se terminer d'une façon quelconque, probablement par la fuite de l'un des deux adversaires.
Je crois bien que c'est le même personnage que je rencontrai, mais où? Devant une église? devant un charnier? devant une poubelle? Avec un camarade qui devait lui parler de quelque chose, mais de quoi? de quoi? de quoi?"
Précisions
"A12 h 17 dans un autobus de la ligne S, long de 10 mètres, large de 2,1, haut de 3,5, à 3 km600 de son point de départ, alors qu'il était chargé de 48 personnes, un individu du sexe masculin, âgé de 27 ans 3 mois 8 jours, taille 1 m 72 et pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 17 centimètres dont la calotte était entourée d'un ruban long de 35 centimètres, interpelle un homme âgé de 48 ans 4 mois 3 jours, taille 1 m 68 et pesant 77 kg, au moyen de 14 mots dont l'énonciation dura 5 secondes et qui faisaient allusion à des déplacements involontaires de 15 à 20 millimètres. Il va ensuite s'asseoir à quelque 2 m 10 de là. 118 minutes plus tard, il se trouvait à 10 mètres de la gare Saint-Lazare, entrée banlieue, et se promenait de long en large sur un trajet de 30 mètres avec un camarade âgé de 28 ans, taille 1 m 70 et pesant 71 kg qui lui conseilla en 15 mots de déplacer de 5 centimètres, dans la direction du zénith, un bouton de 3 centimètres de diamètre."
Philosophíque
"Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et outilitaire d'un autobus S y peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience
profane affligée du long cou de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans entéléchie véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalíté néoberkeleyienne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide où il se décompose en ses éléments premiers et crochus.
La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais anagogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de pardessus situé sociologiquement trop bas."
"L'Instant fatal" (1948), un recueil de quatre-vingt-dix poèmes, réunis en quatre sous-groupes: "Marine" (1920-1930) et "Un enfant a dit" (1943-1948), "Pour un art poétique", qui traite de la poésie avec une tendre désinvolture, et "L'Instant fatal", plein d`ironie grinçante et consacré à la vieillesse et à la mort...
JE CRAINS PAS ÇA TELLMENT
Je crains pas ça tellment la mort de mes entrailles
et la mort de mon nez et celle de mes os
Je crains pas ça tellment moi cette moustiquaille
qu'on baptisa Raymond d'un père dit Queneau
Je crains pas ça tellment où va la bouquinaille
les quais les cabinets la poussière et l'ennui
Je crains pas ça tellment moi qui tant écrivaille
et distille la mort en quelques poésies
Je crains pas ça tellment La nuit se coule douce
entre les bords telgneux des paupières des morts
Elle est douce la nuit caresse d'une rousse
le miel des mérldiens des pôles sud et nord
Je crains pas cette nuit Je crains pas le sommeil
absolu Ça doit être aussi lourd que le plomb
aussi sec que la lave aussi noir que le ciel
aussi sourd qu'un mendiant bêlant au coin d'un pont
Je crains bien le malheur le deuil et la soufirance
et l'angoisse et la guigne et l'excès de I'absence
Je crains I'abîme obèse où gît la maladie
et le temps et l'espace et les torts de l'esprit
Mais je crains pas tellment ce lugubre imbécile
qui viendra me cueillir au bout de son curdent
lorsque vaincu i'aurai d'un œil vague et placide
cédé tout mon courage aux rongeurs du présent
Un jour je chanterai Ulysse ou bien Achille
Enée ou bien Didon Quichotte ou bien Pansa
Un jour je chanterai le bonheur des tranquilles
les plaisirs de la pêche ou la paix des villas
Aujourd'hui bien lassé par l'heure qui s'enroule
tournant comme un bourin tout autour du cadran
permettez mille excuz à ce crâne - une boule -
de susurrer plaintif la chanson du néant
(L'Instant fatal)

"Le Dimanche de la vie" (1952)
"C'est le dimanche de la vie, qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais", citation discutable de Hegel en épigraphe, notre personnage central, Valentin Brû, ressemble au héros de "Pierrot mon ami", il en a l'innocence et le fatalisme tend à considérer sans état d'âme particulier le monde qui l'entoure parce que l'histoire se répète toujours. Engagé volontaire pour cinq ans, le soldat Valentin Brû a fait son temps dans les colonies françaises, et notamment à Madagascar, où il a participé à la campagne contre les Hain-Tenys Merinas. Démobilisé au Bouscat, près de Bordeaux, il cède à la convoitise d'une mercière sensiblement plus âgée que lui, Julia Ségovie, et l'épouse. Peu après le mariage, un petit héritage amène le couple à Paris. Valentin exploite un modeste commerce de cadres pour photographies, et Julia la crédulité publique sous le nom de Mme Saphir. Puis, une grave maladie de sa femme conduit Valentin à la remplacer dans la psychologie élémentaire appliquée à la seconde vue. La guerre de 1939 survient alors, sans l'étonner car il l`avait depuis longtemps prévue. Il ne cherchera pas à modifier l'ordre du monde, dont il se satisfait d'ailleurs, mais, plus rusé que naïf, moins généreux que méfiant, il n'a pas une trop bonne opinion de ses contemporains, ce qui lui permet de réussir dans le commerce des cadres et la boule de cristal. Quant à Julia, l'épouse de Valentin, la mercière du Bouscat devenue voyante, c'est un de ces personnages de "femmes fortes" qu'affectionne Raymond Queneau et qui, contrairement à son jeune époux, tient à diriger sa vie et s'efforce de modifier les événements à son avantage...
"Ça ne fit quand même pas un pli. Trois mois plus tard, ils étaient mariés, l'ancien soldat Brû, la mercière. Après une chose s'imposait, mais voilà qu'on se trouvait déjà en octobre : pas possible de fermer la boutique en pleine saison.
Ils en discutèrent longtemps, l'ancien soldat Brû la mercière. Fallait voir la réalité en face : effectivement, des flopées de clientes se jetaient sur le bouton de nacre, la ganse et le sparadrap : on n'était pas assez riches pour rater toutes ces bonnes affaires.
Non, bien sûr, disait Valentin. Tu vois bien, disait Julia. Pourtant, disait Valentin, pourtant c'est de rigueur le voyage de noces. En principe, disait Julia, en principe je ndis pas. Tu vois bien, disait Valentin. Faut reconnaître, disait Julia, faut reconnaître qu'un mariage sans voyage de noces, ca n'existe pas. Non, disait Valentin, non ça n'existe pas. Oui, disait Julia, oui mais la pleine saison c'est la pleine saison, et on ne peut rien changer aux saisons. On pourrait peut-être retarder le voyage de noces jusqu'aux vacances prochaines, suggéra Valentin. Et les vacances alors, objecta Julia, quand est-ce qu'on les prendrait? Et il n'y avait rien à répondre à ça.
Ils finirent par adopter la seule solution possible, la seule et unique à savoir que le seul Valentin ferait seul le voyage de noces. Pendant ce temps-là, Julia continuerait à faire marcher le commerce et entasserait la monnaie. Le principe étant admis, ils fixèrent ensuite la durée : quinze jours leur parut suffisant. On se lasse de trop d'intimité et, à la longue, on se fatigue de la bagatelle, uniquement la bagatelle : deux semaines, juste ce qu'il faut pour goûter sans se dégoûter. Puis ils fixèrent le but : retenant pour plus tard le champ de bataille d'Iéna, Valentin suggéra le Mont-Saint-Michel, mais Julia préféra Bruges, Bruges-la-Morte, pas l'autre à deux kilomètres, près des marais. Touché par ce choix qui lui parut une tendre attention à l'égard de son nom de famille, Valentin se rallie à cette proposition. Il n'y a plus qu'à déterminer l'itinéraire : on passera naturellement par Paris, vingt-quatre heures dans la capitale, c'est toujours de l'agrément, de ces souvenirs qui s'oublient pas facilement. Inutile d'aller chez les Brébagra, à peine installés : on les dérangerait, et puis on avait toute la vie devant soi pour les voir. Non, mais on se précipiterait aux Folies-Bergère. Ce projet plaît moins à Valentin. C'est fou, à ce qu'on dit, ce qu'il est facile de se perdre dans Paris. On s'y fait de plus écraser, picpoquer, entôler. Bien des ennuis en perspective, trouve l'ancien soldat Brû, mais il n'osa contrarier un désir aussi légitime. Puisqu'il lui fallait passer une soirée aux Folies-Bergère, il la passerait. Et tout fut ainsi bien entendu.
Julie l'accompagna au train, elle lui avait n'avait pas spécifié dans le sens de la marche, car elle s'en moquait : elle n'était pas de ces femmes à qui de menus détails de cet ordre soulèvent le cœur. Elle monta dans le vagon avec Valentin, un beau vagon avec un couloir
qui courait tout du long des compartiments, et à chaque bout de somptueux vécés dont Julia recommanda l'usage à Valentin. Puis, sur son conseil, il marqua sa place de son chapeau et d'une publication licencieuse quelconque qu'elle lui avait achetée dans ce but. On ne prenait jamais trop de précautions, dit-elle en jetant un regard féroce autour d'elle, il y a toujours des salauds pour s'installer là où ils n'ont pas le droit. Y en a même, ajoute Julie, qui arrachent les étiquettes de la location. C'est dégueulasse vous ne trouvez pas, mesdames?
Elle s'adressait aux deux seules occupantes du compartiment, deux paysannes assises du bout des fesses aux deux seules places non-louées. Les autres locataires, sûrs de leur fait, ne se pressaient pas. Valentin, lui, était parvenu à se trouver à la gare avec vingt-cinq minutes d'avance. Et il venait de réussir à installer dans le filet un truc lourd bardé d'aluminium, une caisse ramenée des colonies qui lui servirait de valise. Julia en avait une belle pour les vacances, qu'on n'userait pas cette fois-ci. Valentin, ravi de sa réussite, se tourna vers Julia.
- C'est moche, ça, disait-elle à l'une des paysannes en palpant son foulard. C'est de la mauvaise qualité. Je parie que vous avez acheté ça à un marchand ambulant, pas vrai?
La bonne femme sourit d'admiration, épatée par tant de perspicacité.
- Si vous voulez quelque chose de qualité et qui vous dure toute votre vie, venez donc me trouver : mademoiselle Julia, rue Gambetta, au Bouscat. Je vous ferai des prix.
- Merci bien, madame.
- Tu viens? dit-elle à Valentin. On va pas moisir là jusqu'au départ.
Elle se retourna vers les manantes et leur cria :
- Gardez-lui sa place! hein?
- Oui, oui, madame. Comptez sur nous, madame, comptez sur nous.
Sur le quai, ils regardèrent le train, un bel express.
- C'est chouette de voyager, dit Julia avec une satisfaction extrême. Je trouve qu'il y a rien
de si bien que les voyages, c'est autrement mieux que le cinéma. D'ailleurs les trois quarts du temps, le cinéma c'est pour les ballots. Tu ne trouves pas?
- Oui, dit Valentin.
Elle le regarda.
- Tu n'as pas l'air bien gai, remarqua-t-elle.
Il ne répondit pas tout de suite, il hésitait entre trois propositions également vraies : "Si, je suis gai, mais ça se voit pas", "Pas trop puisque tu ne viens pas avec moi" et "J'ai peur qu'on me chipe ma place".
- Je te cause, dit Julia. T'es dans la lune? Je te répète que tu n'as pas l'air bien gai.
- Moi?
- Oui, toi. Bien sûr, toi. Pas le voisin.
Et s'adressant à un meussieu qui écoutait, mine de rien :
- Mais non, meussieu, c'est pas à vous que je cause, c'est à mon coco.
Le type passa son chemin.
- Eh bien, commença Valentin.
Julia lui coupa la parole.
- Dis pas de bêtises et amuse-toi bien. Tu as ton argent?
- Oui, je l'ai.
- Te le fais pas calotter. Tu en as assez pour quinze jours, tu verras. Naturellement, à Paris
faudra pas aller chez Drouant.
- Non, faudra pas.
- Et tu m'enverras des cartes postales, oublie pas.
- Non, j'oublierai pas.
Ils allaient et venaient le long du train. Le vagon-restaurant provoqua leur admiration.
- Faudra qu'un jour on se paie ça, dit Valentin vaguement.
- Il paraît qu'on y mange très mal, dit Julia. Ça vaut pas un bon panier préparé à la maison.
- Non, bien sûr, dit Valentin.
Il s'aperçut qu'il n'en emportait pas, de panier préparé à la maison. Mais il n'avait pas faim.
- Y en a du monde, constata Julie. Tu devrais regagner ta place.
Ils s'embrassèrent.
Quelques personnes s'étaient installées dans le couloir. Malgré sa crainte de les irriter, Valentin crut possible de les déranger. Dans son compartiment, son coin demeurait libre; les paysannes l'avaient défendu valeureusement. On occupait maintenant toutes les autres places. Le chapeau fut un problème; Valentin le résolut en se le mettant sur la tête, le problème. Il regarda sur le quai, pour agiter son mouchoir, mais il n'eut pas besoin de sortir ce dernier. Le dos de Julia s'éloignait.
Alors, il commence à étudier son journal dit amusant. Sur la couverture, il voit une jeune femme partiellement dénudée qui caresse la barbe d'un faune de marbre. Valentin étudie attentivement cette image couleur bonbon, et, conformément à ce que désiraient le dessinateur et le rédacteur en chef de ce magazine, il pense que la jeune femme nue a des attraits certains. Il en admire surtout le relief et passe dessus un index curieux. Mais la gravure est plate : le cul est un effet de l'art. Valentin jette un regard sournois autour de lui : les deux paysannes l'épient avec attendrissement, mais un gros meussieu lui jette un coup d'oeil sévère. Valentin tourne rapidement la page. A en juger par le quai, immobile, on se trouve toujours à Bordeaux.
Valentin entreprend la lecture de la page suivante; on y recommande des préservatifs, des mariages sérieux, des méthodes pour grandir ou pour se défendre dans la rue. Les deux autres pages dissertent des mêmes questions, et des coloniaux y demandent des marraines. A Madagascar, des copains s'amusaient à ça et, quand ils allaient en perm, c'était du tout cuit qu'ils disaient. Ne comprenant pas que l'écriture pût servir à transmettre des inexactitudes, Valentin n'avait même pas essayé. Il jeta de nouveau un coup d'oeil autour de lui. Cette fois-ci, on était partis. Des locomotives se garaient en demi-cercle et des agents de la propreté nettoyaient des rapides qui avaient servi. Le nombre des voies diminua, l'express choisit la sienne et se mit à se déplacer dessus avec vitesse et décision ...".
(Gallimard)

Zazie dans le métro
(Première parution en 1959, nouvelle édition augmentée de deux fragments)
On dit des personnages des romans de Queneau, sont pour la plupart des gens qui pensent, non que l'auteur leur prête ses pensées, mais, devant nous lecteurs, alors que les gens ordianires évitent tout effort cérébral et absorbe,nt en l'état les idées des autres qui parviennent jusqu'à eux, ses héros, eux, vont faire fonctionner leur cervelle, comme un outil d'investigation. Zazie est un magnifique exemple de cette dernière catégorie, au gré de son parcours d'apprentissage, elle met en oeuvre une énergique obstination qui lui permet d'affronter des situations les plus burlesques et insolites : la verdeur de l'écriture de Queneau et ses transpositions de la langue parlée en firent une "héroïne" entrée d'emblée dans notre mémoire littéraire.
"Zazie, une jeune provinciale de 12 ans est confiée par sa mère à son oncle Gabriel. Jeanne Lalochère, récemment veuve, veut profiter de ce week-end à Paris pour faire une escapade en galante compagnie. Récupérée par Gabriel et son ami Charles,chauffeur de taxi, à la gare d'Austerlitz, Zazie n'a qu'une seule obsession : prendre le métro. Or, il est en grève et Zazie manifeste son désintérêt pour tout le reste. Arrivée chez son oncle, elle fait la connaissance de Marceline, sa tante. Elle dîne et se couche. Le lendemain, profitant du réveil tardif de son oncle qui travaille de nuit, Zazie échappe à Turandot qui la voit sortir seule de la maison. Elle fugue et pleure en réalisant qu'elle ne pourra effectivement pas prendre le métro. C'est alors qu'elle rencontre un inconnu qu'elle identifie comme un satyre et qui l'emmène au marché aux puces. Il lui achète une paire de jeans et l'invite à manger des moules frites. Décidant d'être polie, elle lui fait la conversation en lui détaillant l'histoire du meurtre de son père par sa mère un an plus tôt. ..."
Au terme du roman, Queneau tire la morale de l'histoire. Lorsque Jeanne demande à Zazie: "alors, qu'est-ce que t'as fait?", celle-ci répond, sans hésitation: "j'ai vieilli."
"Doukipudonktan, se demanda Gabriel excédé. Pas possible, ils se nettoient jamais. Dans le journal, on dit qu’il y a pas onze pour cent des appartements à Paris qui ont des salles de bains, ça m’étonne pas, mais on peut se laver sans. Tous ceux-là qui m’entourent, ils doivent pas faire de grands efforts. D’un autre côté, c’est tout de même pas un choix parmi les plus crasseux de Paris. Y a pas de raison. C’est le hasard qui les a réunis. On peut pas supposer que les gens qu’attendent à la gare d’Austerlitz sentent plus mauvais que ceux qu’attendent à la gare de Lyon. Non vraiment, y a pas de raison. Tout de même quelle odeur. Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s’en tamponna le tarin.
– Qu’est-ce qui pue comme ça ? dit une bonne femme à haute voix.
Elle pensait pas à elle en disant ça, elle était pas égoïste, elle voulait parler du parfum qui émanait de ce meussieu.
– Ça, ptite mère, répondit Gabriel qui avait de la vitesse dans la repartie, c’est Barbouze, un parfum de chez Fior.
– Ça devrait pas être permis d’empester le monde comme ça, continua la rombière sûre de son bon droit.
– Si je comprends bien, ptite mère, tu crois que ton p parfum naturel fait la pige à celui des rosiers.
Eh bien, tu te trompes, ptite mère, tu te trompes.
– T’entends ça ? dit la bonne femme à un ptit type à côté d’elle, probablement celui qu’avait le droit de la grimper légalement. T’entends comme il me manque de respect, ce gros cochon ?
Le ptit type examina le gabarit de Gabriel et se dit c’est un malabar, mais les malabars c’est toujours bon, ça profite jamais de leur force, ça serait lâche de leur part. Tout faraud, il cria :
– Tu pues, eh gorille.
Gabriel soupira. Encore faire appel à la violence. Ça le dégoûtait cette contrainte. Depuisl’hominisation première, ça n’avait jamais arrêté. Mais enfin fallait ce qu’il fallait. C’était pas de sa faute à lui, Gabriel, si c’était toujours les faibles qui emmerdaient le monde. Il allait tout de même laisser une chance au moucheron.
– Répète un peu voir, qu’il dit Gabriel.
Un peu étonné que le costaud répliquât, le ptit type prit le temps de fignoler la réponse que voici :
– Répéter un peu quoi ?
Pas mécontent de sa formule, le ptit type. Seulement, l’armoire à glace insistait : elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe monophasée :
– Skeutadittaleur…
Le ptit type se mit à craindre. C’était le temps pour lui, c’était le moment de se forger quelque bouclier verbal. Le premier qu’il trouva fut un alexandrin :
– D’abord, je vous permets pas de me tutoyer.
– Foireux, répliqua Gabriel avec simplicité.
Et il leva le bras comme s’il voulait donner la beigne à son interlocuteur. Sans insister, celui-ci s’en alla de lui-même au sol, parmi les jambes des gens. Il avait une grosse envie de pleurer. Heureusement vlà ltrain qu’entre en gare, ce qui change le paysage. La foule parfumée dirige ses multiples regards vers les arrivants qui commencent à défiler, les hommes d’affaires en tête au pas
accéléré avec leur porte-documents au bout du bras pour tout bagage et leur air de savoir voyager mieux que les autres.
Gabriel regarde dans le lointain ; elles, elles doivent être à la traîne, les femmes, c’est toujours à la traîne ; mais non, une mouflette surgit qui l’interpelle :
– Chsuis Zazie, jparie que tu es mon tonton Gabriel.
– C’est bien moi, répond Gabriel en anoblissant son ton. Oui, je suis ton tonton.
La gosse se mare. Gabriel, souriant poliment, la prend dans ses bras, il la transporte au niveau de ses lèvres, il l’embrasse, elle l’embrasse, il la redescend.
– Tu sens rien bon, dit l’enfant.
– Barbouze de chez Fior, explique le colosse.
– Tu m’en mettras un peu derrière les oreilles ?
– C’est un parfum d’homme.
– Tu vois l’objet, dit Jeanne Lalochère s’amenant enfin. T’as bien voulu t’en charger, eh bien, le voilà.
– Ça ira, dit Gabriel.
– Je peux te faire confiance ? Tu comprends, je ne veux pas qu’elle se fasse violer par toute la famille.
– Mais, manman, tu sais bien que tu étais arrivée juste au bon moment, la dernière fois.
– En tout cas, dit Jeanne Lalochère, je ne veux pas que ça recommence.
– Tu peux être tranquille, dit Gabriel.
– Bon. Alors je vous retrouve ici après-demain pour le train de six heures soixante.
– Côté départ, dit Gabriel.
– Natürlich, dit Jeanne Lalochère qui avait été occupée. A propos, ta femme, ça va ?
– Je te remercie. Tu viendras pas nous voir ?
– J’aurai pas le temps.
– C’est comme ça qu’elle est quand elle a un jules, dit Zazie, la famille ça compte plus pour elle.
– A rvoir, ma chérie. A rvoir, Gaby.
Elle se tire.
Zazie commente les événements :
– Elle est mordue.
Gabriel hausse les épaules. Il ne dit rien. Il saisit la valoche à Zazie.
Maintenant, il dit quelque chose.
– En route, qu’il dit.
Et il fonce, projetant à droite et à gauche tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Zazie galope derrière.
– Tonton, qu’elle crie, on prend le métro ?
– Non.
– Comment ça, non ?
Elle s’est arrêtée. Gabriel stope également se retourne, pose la valoche et se met à expliquer.
– Bin oui : non. Aujourd’hui, pas moyen. Y a grève.
– Y a grève.
– Bin oui : y a grève. Le métro, ce moyen de transport éminemment parisien, s’est endormi sous terre, car les employés aux pinces perforantes ont cessé tout travail.
– Ah les salauds, s’écrie Zazie, ah les vaches. Me faire ça à moi.
– Y a pas qu’à toi qu’ils font ça, dit Gabriel parfaitement objectif.
– Jm’en fous. N’empêche que c’est à moi que ça arrive, moi qu’étais si heureuse, si contente et tout de m’aller voiturer dans lmétro. Sacrebleu, merde alors.
– Faut te faire une raison, dit Gabriel dont les propos se nuançaient parfois d’un thomisme légèrement kantien.
Et, passant sur le plan de la cosubjectivité, il ajouta :
Et puis faut se grouiller : Charles attend.
– Oh ! celle-là je la connais, s’esclama Zazie furieuse, je l’ai lue dans les Mémoires du général Vermot.
– Mais non, dit Gabriel, mais non, Charles, c’est un pote et il a un tac. Je nous le sommes réservé à cause de la grève précisément, son tac. T’as compris ? En route.
Il resaisit la valoche d’une main et de l’autre il entraîna Zazie. Charles effectivement attendait en lisant dans une feuille hebdomadaire la chronique des cœurs saignants. Il cherchait, et ça faisait des années qu’il cherchait, une entrelardée à laquelle il puisse faire don des quarante-cinq cerises de son printemps. Mais les celles qui, comme ça, dans cette gazette, se plaignaient, il les trouvait toujours soit trop dindes, soit trop tartes. Perfides ou sournoises. Il flairait la paille dans les poutrelles des lamentations et découvrait la vache en puissance dans la poupée la plus meurtrie.
– Bonjour, petite, dit-il à Zazie sans la regarder en rangeant soigneusement sa publication sous ses fesses.
– Il est rien moche son bahut, dit Zazie.
– Monte, dit Gabriel, et sois pas snob.
– Snob mon cul, dit Zazie.
Elle est marante, ta petite nièce, dit Charles qui pousse la seringue et fait tourner le moulin. D’une main légère mais puissante, Gabriel envoie Zazie s’asseoir au fond du tac, puis il s’installe à côté d’elle.
Zazie proteste.
– Tu m’écrases, qu’elle hurle folle de rage.
– Ça promet, remarque succinctement Charles d’une voix paisible.
Il démarre.
On roule un peu, puis Gabriel montre le paysage d’un geste magnifique.
– Ah ! Paris, qu’il profère d’un ton encourageant, quelle belle ville. Regarde-moi ça si c’est beau.
– Je m’en fous, dit Zazie, moi ce que j’aurais voulu c’est aller dans le métro.
– Le métro ! beugle Gabriel, le métro ! ! mais le voilà ! ! !
Et, du doigt, il désigne quelque chose en l’air. Zazie fronce le sourcil. Essméfie.
– Le métro ? qu’elle répète. Le métro, ajoute-t-elle avec mépris, le métro, c’est sous terre, le métro. Non mais.
– Çui-là, dit Gabriel, c’est l’aérien.
– Alors, c’est pas le métro.
– Je vais t’esspliquer, dit Gabriel. Quelquefois, il sort de terre et ensuite il y rerentre.
– Des histoires.
Gabriel se sent impuissant (geste), puis, désireux de changer de conversation, il désigne de nouveau quelque chose sur leur chemin.
– Et ça ! mugit-il, regarde ! ! le Panthéon ! ! !
– Qu’est-ce qu’il faut pas entendre, dit Charles sans se retourner.
Il conduisait lentement pour que la petite puisse voir les curiosités et s’instruise par-dessus le marché.
– C’est peut-être pas le Panthéon ? demanda Gabriel.
Il y a quelque chose de narquois dans sa question.
– Non, dit Charles avec force. Non, non et non, c’est pas le Panthéon.
– Et qu’est-ce que ça serait alors d’après toi ?
La narquoiserie du ton devient presque offensante pour l’interlocuteur qui, d’ailleurs, s’empresse d’avouer sa défaite.
– J’en sais rien, dit Charles.
– Là. Tu vois.
– Mais c’est pas le Panthéon.
C’est que c’est un ostiné, Charles, malgré tout.
– On va demander à un passant, propose Gabriel.
– Les passants, réplique Charles, c’est tous des cons.
– C’est bien vrai, dit Zazie avec sérénité.
Gabriel n’insiste pas. Il découvre un nouveau sujet d’enthousiasme.
– Et ça, s’exclame-t-il, ça c’est…
Mais il a la parole coupée par une euréquation de son beau-frère.
– J’ai trouvé, hurle celui-ci. Le truc qu’on vient de voir, c’était pas le Panthéon bien sûr, c’était la gare de Lyon.
– Peut-être, dit Gabriel avec désinvolture, mais maintenant c’est du passé, n’en parlons plus, tandis que ça, petite, regarde-moi ça si c’est chouette comme architecture, c’est les Invalides…
– T’es tombé sur la tête, dit Charles, ça n’a rien à voir avec les Invalides.
– Eh bien, dit Gabriel, si c’est pas les Invalides, apprends-nous cexé.
– Je sais pas trop, dit Charles, mais c’est tout au plus la caserne de Reuilly.
– Vous, dit Zazie avec indulgence, vous êtes tous les deux des ptits marants.
Zazie, déclare Gabriel en prenant un air majestueux trouvé sans peine dans son répertoire, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t’y conduirai.
– Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m’intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con.
– Qu’est-ce qui t’intéresse alors ?
Zazie répond pas.
– Oui, dit Charles avec une gentillesse inattendue, qu’est-ce qui t’intéresse ?
– Le métro.

Le Chien à la mandoline (1965)
Ce recueil de poèmes se présente comme "une sorte de journal intime". A travers le titre, c'est Queneau qui se met en scène et trouve des accents proches de son ami Jacques Prévert pour faire la satire de la société de son temps, notamment la "haute société" dans ses rituels de la réception mondaine, par exemple. Ici aussi, Queneau joue de la création verbale. S'appuyant sur des lieux communs et le langage épuisé des conventions sociales, ou s'amusant du langage oral, Queneau crée ainsi des expressions et des tournures originales, comme le célèbre "Doukipudonktan" de "Zazie dans le métro".
Haute Société
"Ce sont des messieurs très bien
ils s'assoient sur des chaises en rotin
sur des chaises avec des ornements, des paillettes, de la verroterie
ils s'assoient sur des chaises très bien
pour dire des choses très bien
ils disent des choses pleines de pensées, d'idées
des conneries quoi, des conneries très bien
qu'ils prononcent très bien
en mettant l'orthographe à tous les mots
une orthographe très bien
et lorsque les messieurs très bien ont fini de dire leurs conneries très bien
prononcées avec une orthographe très bien
on leur sert des consommations très bien
du pipi de chat, de l'urine de chèvre et du ouisqui très bien"
Egocentrisme II
"Je m'attendais au coin de la rue
j'avais envie de me faire peur
en effet lorsque je me suis vu
j'ai reculé d'horreur
Faisant le tour du pâté de maison
je me suis cogné contre moi-même
c'est ainsi qu'en toute saison
on peut se distraire à l'extrême"
