- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Katherine Mansfield (1888-1923), "Bliss" (1920) - The Garden Party" (1923) - "The Doll'sHouse" (1922) - "The Dove's Nest and other Stories" (1923) - ...
Last update: 12/27/2016
Pour Katherine Mansfield, douée d'une sensibilité extrême, chaque instant, chaque fait et chaque scène jailli de la vie quotidienne, si insignifiant soient-ils, va acquérir, au fil de sa si courte vie, une importance extrême : chacun noté sans convention et avec la simplicité de ce qu'elle éprouve, sans se préoccuper du lecteur. Et la justesse de son analyse fait merveilleusement ressentir ce qu'ils ont de secrètement de singulier ou le malaise qu'ils recouvrent. Elle naquit et grandit dans un milieu bourgeois à Wellington, Novelle-Zélande, gagne en 1903 l'Angleterre, où elle s’imprègne des courants littéraires et culturels de l’époque : des premières années marquées par des expériences difficiles, notamment des relations tumultueuses, une grossesse hors mariage, et un mariage éphémère, autant d'expériences personnelles qu'elle va transformer en fictions. C'est dans "Bliss" (1920) que se révèle le mieux la personnalité de l'écrivain, par les sujets (jeunes filles rêveuses et inquiètes, vieilles filles, univers ludique des enfants, incompréhension, solitude, pauvreté...) et par l`expression d`une apparente impassibilité où frise l'ironie face au tragique de la vie ...
Sa vie a été essentiellement solitaire, écrira l'une de ses talentueuses biographes. Elle voyageait trop loin des limites d'un comportement acceptable pour que sa famille ait le sentiment qu'elle était l'une des leurs : mais elle ne se sentait à l'aise dans aucun autre groupe et n'a pas non plus fondé de famille. L'empreinte particulière de sa fiction est toute entière dans cette profonde solitude dans laquelle tente de vivre chacun de ses personnage. L'incapacité à comprendre ou à être compris est endémique chez Mansfield. Les étrangers s'interprètent mal, les adultes et les enfants se contredisent, des fossés d'incompréhension séparent les femmes des maris. Ni le bonheur ni la douleur ne sont partagés très souvent ou très longtemps. La vie de famille peut avoir une surface complaisante, mais sous celle-ci la peur et la cruauté rôdent. Dans l'une de ses images les plus mémorables, une bonne épouse imagine qu'elle donne à son mari des petits paquets contenant ses sentiments, et qu'il est surpris, lorsqu'il ouvre le dernier paquet, de le trouver plein de haine : la haine aurait été son émotion préférée....

Katherine Mansfield (1888-1923)
"South Sea islander", native de Wellington, Katherine Mansfield quitte la Nouvelle-Zélande pour le Queen's College de Londres en 1901, ne parvient plus à s'adapter à la vie mondaine des jeunes filles à marier lors de son retour à Wellington en 1906, et obtient de pouvoir à nouveau regagner Londres en 1908, toute à son admiration passionnée pour Oscar Wilde et pour les décadents anglais. Après un premier mariage, avec George Bowden, vite rompu, et des débuts comme violoncelliste, de la musique son intérêt se déplace vers la littérature à laquelle elle décide de se consacrer définitivement. C'est en 1911 qu'elle publie son premier recueil de nouvelles "In a German Pension" (Pension de famille allemande), où l'on remarque tant la complexité de sa personnalité que sa sensibilité à l'écriture d'un Tchekhov. Ses nouvelles suivantes, "Bliss" (Félicité, 1920), "Prelude" (1916), "The Garden Party" (La Garden Party, 1922), "At the Bay" (Sur la baie, 1922), "The Doll’s House" (La maison de poupées, 1922), "The Dove’s Nest" (Le Nid de colombes, 1923) l'imposent très rapidement au-devant de la scène littéraire. Katherine Mansfield et John Middleton Murry, son compagnon et biographe, fréquente D.H Lawrence et sa femme Frieda, mais aussi Virginia Woolf rencontrée en 1916 et que l'on a fort souvent rapprochée d'elle.
La Première Guerre mondiale, la mort de son frère Leslie, la tuberculose, ses difficultés de relation avec son époux, autant de raisons qui marquent progressivement une rupture en elle, - terminer ses nouvelles lui semble de plus en plus difficile -, et la voit céder aux affabulations ascétiques d'une Georges Gurdjieff et mourir à 35 ans... On connaît la remarque de Virginia Woolf dans son journal : "I was jealous of her writing - the only writing I have ever been jealous of."
Claire Tomalin dans sa biographie, "Katherine Mansfield: A Secret Life", s'attachera à déconstruire bien des mythes et une fascination posthume pour sa vie tragique, pour nous transmettre toute la complexité réelle d'une personnalité profondément humaine et femme avant tout ...



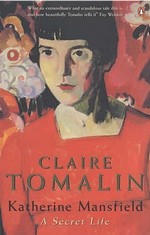

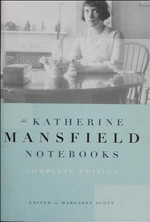


Après avoir voyagé en Europe de 1903 à 1906, Mansfield termine ses études en Angleterre et retourne en Nouvelle-Zélande, où elle commence à se consacrer sérieusement à sa carrière de nouvelliste. Elle publie plusieurs textes dans le Native Companion, un périodique australien, ce qui constitue son premier travail d'écriture rémunéré. Après ce modeste succès, Mansfield est déterminée à devenir écrivain professionnel. Cependant, elle se lasse rapidement de la vie provinciale néo-zélandaise et, deux ans plus tard, elle retourne en Angleterre en 1908.
De retour à Londres, Mansfield s'adonne à la vie de bohème de nombreux artistes et écrivains, et a des relations sexuelles avec des hommes et des femmes. Après plusieurs liaisons désastreuses, Mansfield est enceinte et est envoyée par sa mère dans la ville thermale de Bad Wörishofen en Allemagne. Elle fait une fausse couche après avoir tenté de soulever une valise au-dessus d'une armoire, mais malgré ses souffrances à cette époque, les expériences de Mansfield en Bavière auront un effet significatif sur sa vision de la littérature. Après avoir découvert les nouvelles d'Anton Tchekhov, les œuvres du maître russe auront une influence encore plus grande sur Mansfield qu'Oscar Wilde, pour lequel elle avait fait une véritable fixation. De retour à Londres en janvier 1910, l'auteur fait publier de nombreuses nouvelles dans The New Age, un magazine socialiste qui jouit d'une grande notoriété intellectuelle. Influencées par son expérience de l'Allemagne, ces nouvelles constituent le contenu de son premier recueil publié, "In a German Pension", en 1911. Le livre est salué par plusieurs critiques, principalement en raison de son portrait défavorable des Allemands, la nouvelle "Frau Brechenmacher Attend a Wedding" étant particulièrement remarquée. Néanmoins, malgré les premières louanges de la critique, le livre n'a pas connu de succès commercial et Mansfield a plus tard qualifié le recueil d'« immature »...

"In a German Pension and Other Stories" (Pension de famille allemande, 1911)
Recueil d'une quinzaine de nouvelles, dont "Frau Brechenmacher Attends a Wedding", "Germans at Meat," "The Baron", "The Modern Soul," "The Advanced Lady" , "The Sister of the Baroness", "Frau Fischer", "The Luft Band", "The Child-who-was-tired", "The Swing of the pendulum"...
"(The Modern Soul) ... “The Godowskas,” he murmured. “Do you know them? A mother and daughter from Vienna. The mother has an internal complaint and the daughter is an actress. Fräulein Sonia is a very modern soul. I think you would find her most sympathetic. She is forced to be in attendance on her mother just now. But what a temperament! I have once described her in her autograph album as a tigress with a flower in the hair. Will you excuse me? Perhaps I can persuade them to be introduced to you.”
I said, “I am going up to my room.” But the Professor rose and shook a playful finger at me. “Na,” he said, “we are friends, and, therefore, I shall speak quite frankly to you. I think they would consider it a little ‘marked’ if you immediately retired to the house at their approach, after sitting here alone with me in the twilight. You know this world. Yes, you know it as I do.”
I shrugged my shoulders, remarking with one eye that while the Professor had been talking the Godowskas had trailed across the lawn towards us. They confronted the Herr Professor as he stood up.
“Good-evening,” quavered Frau Godowska. “Wonderful weather! It has given me quite a touch of hay fever!” Fräulein Godowska said nothing. She swooped over a rose growing in the embryo orchard, then stretched out her hand with a magnificent gesture to the Herr Professor. He presented me.
“This is my little English friend of whom I have spoken. She is the stranger in our midst. We have been eating cherries together.”
“How delightful,” sighed Frau Godowska. “My daughter and I have often observed you through the bedroom window. Haven’t we, Sonia?”
Sonia absorbed my outward and visible form with an inward and spiritual glance, then repeated the magnificent gesture for my benefit. The four of us sat on the bench, with that faint air of excitement of passengers established in a railway carriage on the qui vive for the train whistle. Frau Godowska sneezed. “I wonder if it is hay fever,” she remarked,
worrying the satin reticule for her handkerchief, “or would it be the dew. Sonia, dear, is the dew falling?”
Fräulein Sonia raised her face to the sky, and half closed her eyes. “No, mamma, my face is quite warm. Oh, look, Herr Professor, there are swallows in flight; they are like a little flock of Japanese thoughts—nicht wahr?”
“Where?” cried the Herr Professor. “Oh yes, I see, by the kitchen chimney. But why do you say ‘Japanese’? Could you not compare them with equal veracity to a little flock of German thoughts in flight?” He rounded on me. “Have you swallows in England?”
“I believe there are some at certain seasons. But doubtless they have not the same symbolical value for the English. In Germany—”
“I have never been to England,” interrupted Fräulein Sonia, “but I have many English acquaintances. They are so cold!” She shivered.
“Fish-blooded,” snapped Frau Godowska. “Without soul, without heart, without grace. But you cannot equal their dress materials. I spent a week in Brighton twenty years ago, and the travelling cape I bought there is not yet worn out—the one you wrap the hot-water bottle in, Sonia. My lamented husband, your father, Sonia, knew a great deal about England. But the more he knew about it the oftener he remarked to me, ‘England is merely an island of beef flesh swimming in a warm gulf sea of gravy.’ Such a brilliant way of putting things. Do you remember, Sonia?”
“I forget nothing, mamma,” answered Sonia.
Said the Herr Professor: “That is the proof of your calling, gnädiges Fräulein. Now I wonder—and this is a very interesting speculation—is memory a blessing or—excuse the word—a curse?”
Frau Godowska looked into the distance, then the corners of her mouth dropped and her skin puckered. She began to shed tears...."
"... "Les Godowska, murmura-t-il. Les connaissez-vous? La mère et la fille, de Vienne. La mère souffre de douleurs internes et la fille est actrice. Fräulein Sonia est une âme très moderne. Vous la trouveriez, je crois, très sympathique. Elle est forcée de veiller sur sa mère maintenant. Mais quel tempérament ! Un jour, sur son album d'autographes, j'ai donné d'elle cette définition : "Une tigresse avec une fleur dans la crinière !" Voulez-vous m'excuser ? Peut-être les persuaderai-je de vous être présentées.
- Je monte dans ma chambre, dis-je. Mais le Professeur, en se levant, agita vers moi un index mutin : "Là, me dit-il, nous sommes amis et je vais donc vous parler très franchement. Elles jugeraient, je pense, un peu "marquant" que vous vous retiriez dans la maison à leur approche, après être restée assise seule ici, avec moi, au crépuscule. Vous connaissez la malice du monde. Oui, vous la connaissez aussi bien que moi."
Je haussai les épaules, remarquant du coin de l'oeil que pendant le discours du Professeur, les Godowska s'étaient traînées vers nous à travers l'allée. Le Herr Professor en se redressant les trouva en face de lui. "Bonsoir, chevrota Frau Godowska. Un temps inouï. Cela m'a donné un vrai commencement de rhume des foins." Fräulein Godowska ne dit rien. Elle fondit sur une rose du verger embryonnaire puis, d'un geste magnifique, tendit sa main au Herr Professor. Il me présenta.
- "Voici la petite amie anglaise dont je vous ai parlé. Elle est l'étrangère à notre foyer. Nous avons mangé des cerises ensemble.
- Comme c'est charmant! soupira Frau Godowska. Ma fille et moi vous avons souvent observée par la fenêtre de notre chambre. N'est-ce pas, Sonia ?"
Sonia, d'un coup d'oeil intérieur et spirituel, contempla ma forme extérieure et visible, puis daigna répéter pour moi son geste magnifique. Nous nous assîmes tous quatre sur le banc avec cet air de faible excitation qu'ont des voyageurs dans un wagon en attendant le coup de sifflet du départ. Frau Godowska éternua. "je me demande si c'est bien le rhume des foins", remarqua-t-elle en tourmentant son réticule de satin à la recherche de son mouchoir. "A moins que ce ne soit la rosée. Sonia, mon enfant, est-ce que la rosée tombe ?"
Fräulein Sonia offrit au ciel son visage, les yeux mi-clos. "Non, maman. Je sens mon visage tout à fait chaud. Oh ! voyez, Herr Professor, des hirondelles qui volent ; on dirait un petit troupeau de pensées japonaises - nicht wahr ?
- Où ? cria le Herr Professor. Oh! oui, je vois, près de la cheminée de la cuisine. Mais pourquoi "japonaises" ? Ne pourriez-vous pas, avec tout autant de vérité, les comparer à une petite troupe volante de pensées allemandes ? "
Il se tourna vers moi. "Avez-vous des hirondelles en Angleterre ?
- Quelques-unes, je crois, à certaines saisons, mais sans aucun doute elles n'ont pas pour les Anglais la même valeur symbolique. En Allemagne...
- je n'ai jamais été en Angleterre, interrompit Fräulein Sonia. Mais j'ai beaucoup de relations anglaises. Des gens si froids !" Elle frissonna.
- "Ils ont du sang de poisson, jeta sèchement Frau Godowska. Sans âme, sans cœur, sans grâce. Mais leurs étoffes sont inégalables. J'ai passé une semaine à Brighton voici vingt ans et la cape de voyage que j'ai achetée là n'est pas encore usée - c'est celle dans laquelle vous enveloppez la bouillotte, Sonia. Feu mon pauvre mari, votre père, Sonia, avait beaucoup appris sur l'Angleterre. Mais plus il apprenait de choses, plus il lui arrivait de me dire : "L'Angleterre est simplement une île de viande de bœuf nageant dans un gulf-stream de jus." Il avait une façon si brillante d'exprimer les choses ! Vous en souvient-il, Sonia?
- je n'oublie rien, maman, répondit Sonia.
- Voilà bien, dit le Herr Professor, la preuve de votre vocation, gnädige Fräulein. je me demande à ce sujet - et ceci est une spéculation des plus intéressantes - si la mémoire est une bénédiction ou, excusez le mot, une malédiction ?"
Frau Godowska regardait au loin ; soudain les coins de sa bouche s'abaissèrent, sa peau se plissa et elle fondit en larmes...." .

"Frau Brechenmacher Attends a Wedding", une critique si subtile mais acerbe de la société patriarcale et des attentes pesant sur les femmes - Frau Brechenmacher est une femme au foyer, mariée à un facteur. Leur relation est marquée par une dynamique de pouvoir asymétrique, le mari est autoritaire et exigeant, elle est docile et résignée. La nouvelle s’ouvre sur leur préparation pour assister à un mariage, une tâche déjà stressante pour Frau Brechenmacher, qui doit à la fois s’occuper de leur maison et se conformer aux attentes sociales. Durant cette fête, Frau Brechenmacher observe les festivités avec un certain détachement. Les rituels du mariage, censés symboliser l’amour et l’union, lui apparaissent comme une mascarade dans laquelle les femmes sont reléguées à un rôle subordonné. Elle remarque la nouvelle mariée, jeune et nerveuse, et anticipe le destin qui l’attend en tant qu’épouse, reflétant ses propres expériences. Et Les hommes, comme attendu, dont son mari, se comportent de manière bruyante et parfois agressive. L’ambiance festive met en lumière les déséquilibres de pouvoir entre les sexes, où les hommes dominent l’espace et les conversations, tandis que les femmes restent en retrait, servant les autres ou observant silencieusement. En rentrant chez eux, Frau Brechenmacher subit les reproches et les demandes de son mari, soulignant encore une fois de plus sa situation de soumission. Malgré sa fatigue, elle accepte passivement cette situation, résignée à son quotidien. Frau Brechenmacher va reprendre son travail domestique, confirmant que le mariage n’est pas une source de bonheur ou de partenariat égal, mais une institution qui perpétue l’oppression des femmes ...

Après la publication de son premier recueil de nouvelles, Mansfield soumet une histoire au nouveau magazine d'avant-garde Rhythm, mais l'article est rejeté par le rédacteur en chef, John Middleton Murry, qui demande une histoire plus sombre. Mansfield répond avec « The Woman at the Store », une histoire de meurtre et de maladie mentale. À cette époque, ses récits s'inspirent en partie du fauvisme, un mouvement artistique contemporain de l'époque, ainsi que des œuvres de Tchekhov. En 1911, Mansfield et Murry entament une relation et se marient en 1918, bien que leur mariage connaisse de nombreux désaccords et séparations. La vision de la vie de Mansfield et ses écrits ultérieurs seront gravement affectés par la mort de son frère bien-aimé, Leslie Heron « Chummie » Beauchamp, en 1915, alors qu'il combattait en France en tant que soldat néo-zélandais. Traumatisée par cette expérience, elle se réfugie dans l'écriture de souvenirs nostalgiques de leur enfance en Nouvelle-Zélande. C'est au cours de cette période turbulente de sa vie que Mansfield est la plus productive et que sa relation avec Murry s'améliore. En 1913, le couple s'était lié d'amitié avec D. H. Lawrence, et avait rencontré Virginia Woolf, T. S. Eliot, Lytton Strachey et Bertrand Russell lors de réunions mondaines et de présentations.
(PIC. D. H. Lawrence, Katherine Mansfield, Frieda Lawrence and John Middleton Murry at their wedding in 1914)
Woolf et son mari Leonard, qui viennent de fonder Hogarth Press, demandent à Mansfield de leur écrire une histoire. Elle leur donne « Prelude », qu'elle avait commencé à écrire en 1915 sous le titre « The Aloe ». L'histoire concerne une famille de Néo-Zélandais qui déménage, avec peu d'intrigue extérieure. Bien qu'elle n'ait pas atteint un public plus large et qu'elle ait été critiquée lors de sa publication en 1918, elle est devenue par la suite l'une des œuvres les plus célèbres de Mansfield, apparaissant comme la première histoire du recueil suivant.
En décembre 1917, Mansfield tombe malade et on lui diagnostique la tuberculose. Certains critiques affirment aujourd'hui qu'elle a attrapé la maladie par l'intermédiaire de D. H. Lawrence. Rejetant l'idée d'un sanatorium qui l'empêcherait d'écrire, Mansfield est contrainte de partir à l'étranger pour échapper à l'hiver anglais. Elle s'installe à Bandol, en France, dans un hôtel isolé, où elle souffre de dépression. Elle continue cependant à écrire des histoires, dont « Je ne parle pas français », l'une de ses œuvres les plus sombres, inspirée des « Notes du souterrain » de Fiodor Dostoïevski. « Bliss », le titre du deuxième recueil de nouvelles de Mansfield en 1920, a également été publié en 1918. « Bliss » concerne un personnage semblable à l'auteur, qui doit faire face à l'infidélité de son mari. La nouvelle a été immédiatement acclamée par la critique, contribuant à faire de Mansfield l'un des précurseurs du mouvement moderniste.
Le recueil comprend également l'histoire populaire « The Wind Blows ». Cette brève histoire présente le personnage de Matilda, qui est réveillée par le vent. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, sa mère va chercher des fleurs dans le jardin et est rappelée à l'intérieur pour le téléphone. Alors que Matilda s'apprête à partir pour sa leçon de musique, sa mère lui demande de ne pas y aller à cause du vent fort, mais elle y va quand même...
mais elle y va quand même...
Malheureusement, malgré son succès grandissant à cette époque, la santé de Mansfield se dégrade et elle subit sa première hémorragie pulmonaire en mars de la même année ....

"Bliss and Other Stories" (Félicité, 1920)
On a pu reprocher à Katherine Mansfield le choix si constant de ses intrigues, - des enfants trop sensibles pour leur milieu ("Sun and Moon"), des jeunes filles rêveuses, pauvres, incomprises, résignées -, mais avec cette sensibilité exacerbée qui la caractérise, elle est bien de son temps, une société d'après-guerre qui a perdue toute stabilité et tout idéal : dans "Félicité", une jeune femme toute à la joie de sa vie et de sa passion pour son mari, voit soudain celui-ci embrasser sa meilleure amie. Quatorze nouvelles composent le recueil dont "Je ne parle pas français", "Sun and Moon", "Bliss", "Psychology", "Pictures", "The Man Without a Temperament", "The Wind Blows", "Prelude", "Mr Reginald Peacock's Day", "Feuille d'Album"," A Dill Pickle"..
(Bliss) "Although Bertha Young was thirty she still had moments like this when she wanted to run instead of walk, to take dancing steps on and off the pavement, to bowl a hoop, to throw something up in the air and catch it again, or to stand still and laugh at - nothing - at nothing, simply. What can you do if you are thirty and, turning the corner of your own street, you are overcome, suddenly by a feeling of bliss - absolute bliss! - as though you'd suddenly swallowed a bright piece of that late afternoon sun and it burned in your bosom, sending out a little shower of sparks into every particle, into every finger and toe? ...
Oh, is there no way you can express it without being "drunk and disorderly"? How idiotic civilisation is! Why be given a body if you have to keep it shut up in a case like a rare, rare fiddle?
"No, that about the fiddle is not quite what I mean," she thought, running up the steps and feeling in her bag for the key - she'd forgotten it, as usual - and rattling the letter-box. "It's not what I mean, because - Thank you, Mary" - she went into the hall. "Is nurse back?"
"Yes, M'm."
"And has the fruit come?"
"Yes, M'm. Everything's come."
"Bring the fruit up to the dining-room, will you? I'll arrange it before I go upstairs."
It was dusky in the dining-room and quite chilly. But all the same Bertha threw off her coat; she could not bear the tight clasp of it another moment, and the cold air fell on her arms.
But in her bosom there was still that bright glowing place - that shower of little sparks coming from it. It was almost unbearable. She hardly dared to breathe for fear of fanning it higher, and yet she breathed deeply, deeply. She hardly dared to look into the cold mirror - but she did look, and it gave her back a woman, radiant, with smiling, trembling lips, with big, dark eyes and an air of listening, waiting for something ... divine to happen ... that she knew must happen ... infallibly.
Mary brought in the fruit on a tray and with it a glass bowl, and a blue dish, very lovely, with a strange sheen on it as though it had been dipped in milk.
"Shall I turn on the light, M'm?"
"No, thank you. I can see quite well."
There were tangerines and apples stained with strawberry pink. Some yellow pears, smooth as silk, some white grapes covered with a silver bloom and a big cluster of purple ones. These last she had bought to tone in with the new dining-room carpet. Yes, that did sound rather far-fetched and absurd, but it was really why she had bought them. She had thought in the shop: "I must have some purple ones to bring the carpet up to the table." And it had seemed quite sense at the time.
When she had finished with them and had made two pyramids of these bright round shapes, she stood away from the table to get the effect - and it really was most curious. For the dark table seemed to melt into the dusky light and the glass dish and the blue bowl to float in the air. This, of course, in her present mood, was so incredibly beautiful ... She began to laugh.
"No, no. I'm getting hysterical." And she seized her bag and coat and ran upstairs to the nursery.
Nurse sat at a low table giving Little B her supper after her bath. The baby had on a white flannel gown and a blue woollen jacket, and her dark, fine hair was brushed up into a funny little peak. She looked up when she saw her mother and began to jump.
"Now, my lovey, eat it up like a good girl," said nurse, setting her lips in a way that Bertha knew, and that meant she had come into the nursery at another wrong moment.
"Has she been good, Nanny?"
"She's been a little sweet all the afternoon," whispered Nanny. "We went to the park and I sat down on a chair and took her out of the pram and a big dog came along and put its head on my knee and she clutched its ear, tugged it. Oh, you should have seen her."
Bertha wanted to ask if it wasn't rather dangerous to let her clutch at a strange dog's ear. But she did not dare to. She stood watching them, her hands by her side, like the poor little girl in front of the rich girl with the doll.
The baby looked up at her again, stared, and then smiled so charmingly that Bertha couldn't help crying:
"Oh, Nanny, do let me finish giving her her supper while you put the bath things away.
"Well, M'm, she oughtn't to be changed hands while she's eating," said Nanny, still whispering. "It unsettles her; it's very likely to upset her."
How absurd it was. Why have a baby if it has to be kept - not in a case like a rare, rare fiddle - but in another woman's arms?
"Oh, I must!" said she.
Very offended, Nanny handed her over.
"Now, don't excite her after her supper. You know you do, M'm. And I have such a time with her after!"
Thank heaven! Nanny went out of the room with the bath towels.
"Now I've got you to myself, my little precious," said Bertha, as the baby leaned against her.
She ate delightfully, holding up her lips for the spoon and then waving her hands. Sometimes she wouldn't let the spoon go; and sometimes, just as Bertha had filled it, she waved it away to the four winds.
When the soup was finished Bertha turned round to the fire. "You're nice - you're very nice!" said she, kissing her warm baby. "I'm fond of you. I like you."
And indeed, she loved Little B so much - her neck as she bent forward, her exquisite toes as they shone transparent in the firelight - that all her feeling of bliss came back again, and again she didn't know how to express it - what to do with it.
"You're wanted on the telephone," said Nanny, coming back in triumph and seizing her Little B.
Down she flew. It was Harry.
"Oh, is that you, Ber? Look here. I'll be late. I'll take a taxi and come along as quickly as I can, but get dinner put back ten minutes - will you? All right?"
"Yes, perfectly. Oh, Harry!"
"Yes?"
What had she to say? She'd nothing to say. She only wanted to get in touch with him for a moment. She couldn't absurdly cry: "Hasn't it been a divine day!"
"What is it?" rapped out the little voice.
"Nothing. Entendu," said Bertha, and hung up the receiver, thinking how much more than idiotic civilisation was.
They had people coming to dinner. The Norman Knights - a very sound couple - he was about to start a theatre, and she was awfully keen on interior decoration, a young man, Eddie Warren, who had just published a little book of poems and whom everybody was asking to dine, and a "find" of Bertha's called Pearl Fulton. What Miss Fulton did, Bertha didn't know. They had met at the club and Bertha had fallen in love with her, as she always did fall in love with beautiful women who had something strange about them.
The provoking thing was that, though they had been about together and met a number of times and really talked, Bertha couldn't make her out. Up to a certain point Miss Fulton was rarely, wonderfully frank, but the certain point was there, and beyond that she would not go.
Was there anything beyond it? Harry said "No." Voted her dullish, and "cold like all blonde women, with a touch, perhaps, of anaemia of the brain." But Bertha wouldn't agree with him; not yet, at any rate.
"No, the way she has of sitting with her head a little on one side, and smiling, has something behind it, Harry, and I must find out what that something is."
"Most likely it's a good stomach," answered Harry.
He made a point of catching Bertha's heels with replies of that kind ... "liver frozen, my dear girl," or "pure flatulence," or "kidney disease," ... and so on. For some strange reason Bertha liked this, and almost admired it in him very much.
She went into the drawing-room and lighted the fire; then, picking up the cushions, one by one, that Mary had disposed so carefully, she threw them back on to the chairs and the couches. That made all the difference; the room came alive at once. As she was about to throw the last one she surprised herself by suddenly hugging it to her, passionately, passionately. But it did not put out the fire in her bosom. Oh, on the contrary!...."
"Malgré ses trente ans, Bertha Young avait encore des moments comme celui-ci, où elle avait envie de courir au lieu de marcher, d'esquisser des pas de danse du haut en bas du trottoir, de pousser un cerceau, de lancer quelque chose en l'air et de le rattraper, ou de rester immobile et de rire... à. rien, tout simplement. Que pouvez-vous faire, si vous avez trente ans, et qu'en tournant l'angle de votre propre rue, vous vous sentez envahie, soudain, par une sensation de félicité, d'absolue félicité ? Comme si vous veniez tout à coup d'avaler un morceau brillant de ce tardif soleil d'après-midi, qui continuerait à brûler dans votre poitrine, envoyant des petites fusées d'étincelles dans chaque parcelle de votre être, dans chaque doigt et chaque orteil ?... Oh! n'y a-t-il pas moyen d'exprimer cela autrement que par "ivresse et dérèglement"? Que la civilisation est donc idiote ! Pourquoi avoir reçu un corps, si c'est pour le garder enfermé dans son étui, comme un violon très rare? "Non, cette comparaison du violon n'est pas tout à fait cela..." songea-t-elle, tandis qu'elle montait les marches en courant, tâtait son sac pour y chercher sa clef, oubliée comme d'habitude, et secouait la boîte aux lettres...
"Ce n'est pas ce que je veux dire, parce que... - Merci, Mary - elle entra dans le hall - : Nurse est-elle revenue ?
- Oui, Madame.
- On a apporté les fruits ?
- Oui, Madame, tout est là.
- Donnez-moi les fruits de la salle à manger, je vous prie, je les arrangerai avant de monter."
Il faisait sombre dans la salle à manger, et très frais. Malgré cela Bertha Young rejeta son manteau. Elle ne pouvait en supporter la pression un instant de plus, et l'air froid tomba sur ses bras. Mais dans sa poitrine demeurait encore ce point brillant, brûlant, d'où partaient ces averses de petites étincelles. Elle osait à peine respirer de peur de l'attiser, et cependant elle respirait très profondément. Elle osait à peine regarder dans le miroir glacé, mais elle y regarda tout de même, et il lui rendit l'image d'une femme radieuse, aux lèvres souriantes, tremblantes, aux grands yeux sombres, et qui semblait écouter, attendre que quelque chose de divin arrivât, qu'elle savait devoir arriver... infailliblement.
Mary apporta les fruits sur un plateau avec une coupe de cristal et un plat bleu, très joli, aux reflets bizarres, comme s'il avait été trempé dans du lait.
- " Dois-je allumer, Madame?
- Non, merci, j'y vois très bien."
Il y avait des mandarines et des pommes teintées d'un rose de fraise, des poires jaunes aussi lisses que de la soie, des raisins blancs, veloutés d'argent, et une grosse grappe de raisin pourpre. Elle avait acheté cette dernière pour l'assortir au nouveau tapis de la salle à manger. Oui ; cela vous avait un air recherche et absurde, mais c'était bien là la raison qui la lui avait fait prendre. Elle avait songé dans le magasin : "Il faut que j'aie du raisin pourpre avant de mettre le tapis sur la table." Et, sur le moment même, cela lui avait paru plein de bon sens. Lorsqu'elle eut terminé les deux belles pyramides rondes et brillantes, elle se recula pour juger de l'effet, et il était vraiment des plus curieux : car la table sombre semblait se fondre dans la pénombre, la coupe de verre et le plat bleu flotter dans l'air. Ceci, naturellement, dans son état d'esprit actuel, lui sembla être d'une indicible beauté...
Elle commença à rire. "Non, non, je deviens nerveuse"; et s'emparant de son sac, elle s'élança vers la nursery. Nurse, assise à une table basse, faisait dîner la petite B..., qui sortait de son bain. Le bébé avait une robe de flanelle et un casaquin de laine bleue; ses cheveux fins et noirs étaient brossés en l'air, en une drôle de petite touffe pointue. Elle leva la tête lorsqu'elle vit sa mère et se mit à sauter.
- "Allons, ma jolie, mangeons tout, comme une bonne petite fille", dit Nurse, comprimant les lèvres d'une façon que Bertha connaissait bien et qui signifiait qu'elle venait, une fois de plus, d'entrer dans la nursery au mauvais moment.
- A-t-elle été sage, Nanny?
- Un vrai petit amour toute l'après-midi, chuchota Nanny. Nous sommes allées dans le parc, je me suis assise sur une chaise, je l'ai sortie de sa voiture, et un grand chien est venu poser sa tête sur mon genou; elle lui attrapait l'oreille et la tirait ; j'aurais voulu que vous la voyiez."
Bertha avait envie de lui demander si ce n'était pas un peu dangereux de lui laisser ainsi tirer l'oreille d'un chien inconnu. Mais elle n'osait pas. Elle restait là à regarder, les mains pendantes à son côté, comme la petite fille pauvre devant une petite fille riche avec la poupée. Le bébé leva de nouveau les yeux vers elle, le regard fixe, puis elle sourit si gentiment que Bertha ne put s'empêcher de s'écrier :
- Oh ! Nanny, laissez-moi finir de lui donner son souper, pendant que vous mettrez les affaires du bain en ordre.
- Très bien, Madame, mais on ne devrait pas la changer de mains pendant qu'elle mange, répondit Nurse toujours à voix basse. Ça la dérange, et il est très probable que ça l'indisposera.
Combien c'était absurde! Pourquoi avoir un bébé s'il doit être gardé dans un étui comme un violon très rare, mais dans les bras d'une autre femme?
- "Oh ! il le faut ! ", dit Bertha.
Très offensée, Nanny la lui tendit.
- "A présent, ne l'excitez pas après son souper, vous savez que cela vous arrive, Madame, et j'ai toutes les peines du monde avec elle ensuite !"
Dieu merci! Nanny sortait de la pièce avec les serviettes de bain. "A présent, je t'ai toute à moi, mon petit trésor", dit Bertha, tandis que le bébé s'appuyait contre elle. La petite mangeait délicieusement, avançant les lèvres vers la cuillère, et agitant les mains. Quelquefois, elle ne voulait pas lâcher la cuillère, et d'autres fois, elle la renvoyait aux quatre vents, comme Bertha venait juste de la remplir. La soupe finie, Bertha se retourna vers le feu. - "Tu es mignonne, tu es très mignonne! dit-elle en embrassant son bébé tout chaud. Je t'aime ! Je t'adore !" - Et vraiment, elle aimait tellement la petite B... et tellement son cou, lorsqu'elle le penchait en avant, ses exquis doigts de pied luisant en transparence à la lumière du feu, que toute sa sensation de félicité lui revint ; et de nouveau elle ne savait, ni comment l'exprimer, ni qu'en faire.
- On vous demande au téléphone !" dit Nanny, triomphante, qui revenait s'emparer de la petite B... Bertha descendit en courant, C'était Harry.
- Oh ! c'est toi, Ber ? dit-il. Ecoute, je serai en retard, je prendrai un taxi, et je viendrai aussi vite que je pourrai, mais fais repousser le dîner de dix minutes... Veux-tu? 'Tout va bien ?
- Oui, parfaitement. Oh !... Harry ?
- Quoi ?
Qu'avait-elle à dire ? Rien. Elle voulait seulement se sentir près de lui un instant. Elle ne pouvait pourtant pas s'écrier de façon absurde : n'est-ce pas que la journée a été divine ?
- Qu'est-ce qu'il y a ?
- Rien... entendu, dit Bertha, et elle raccrocha le récepteur, en songeant combien la civilisation était chose plus qu'idiote !
Ils avaient des invités à dîner : les Norman Knight, - un couple de tout repos : lui était sur le point de lancer un théâtre, et elle s'occupait avec beaucoup d'ardeur de décoration d'intérieurs ; un jeune homme, Eddie Warren, qui venait tout juste de publier un premier volume de poésies, et que tout le monde invitait à dîner, et une "trouvaille" de Bertha appelée Pearl Fulton. Que faisait Miss Fulton ? Bertha l'ignorait. Elles s'étaient rencontrées au club, et Bertha s'était éprise d'elle, comme elle le faisait de toutes les belles femmes qui avaient un air étrange. La chose agaçante, c'est qu'elles avaient beau être sorties ensemble bon nombre de fois, et avoir vraiment causé, Bertha ne pouvait pas encore la comprendre. Jusqu'à un certain point, Miss Fulton était d'une franchise rare, admirable, mais ce point demeurait, et ne pouvait être franchi. Y avait-il quelque chose au-delà ? Harry prétendait que non, la déclarait un peu "terne" et "froide" comme toutes les blondes, avec une légère atteinte, peut-être, d'anémie au cerveau. Mais Bertha ne voulait pas lui donner raison, pas encore, du moins.
- "Non, cette manière qu'elle a de s'asseoir, la tête légèrement de côté, en souriant, cache quelque chose, Harry, et il faut que je découvre ce que c'est.
- Plus que probable, un bon estomac", avait répondu Harry.
Il avait l'habitude d'arrêter les élans de Bertha par des réponses de ce genre : "foie gelé, ma chère fille", ou "simple flatulence", ou "maladie des reins"... et ainsi de suite. Par quelque raison inexpliquée, ce trait plaisait à Bertha ; pour un peu, elle l'eût même beaucoup admiré chez lui. Elle entra dans le salon et alluma le feu ; puis ramassant un à un les coussins si soigneusement disposés par Mary, elle les lança sur les fauteuils et les divans. Cela faisait toute la différence, la pièce se mit à vivre aussitôt. Sur le point de jeter le dernier, elle se surprit à le presser contre elle, passionnément, passionnément. Mais cela n'éteignit pas le feu dans sa poitrine, au contraire..."

".. Harry jouissait de son dîner. C'était, en quelque sorte, un trait chez lui, plutôt que sa nature ou l'effet d'une pose, que de parler ainsi de nourriture, de faire étalage de son « goût éhonté pour la chair blanche du homard, ou le ton vert des glaces à la pistache, vertes et froides comme les paupières des danseuses égyptiennes ».
Lorsqu'il la regarda et dit : « Bertha, ceci est un admirable soufflé !» elle aurait presque pu pleurer de joie enfantine.
Oh ! pourquoi se sentait-elle ce soir si tendre envers le monde entier ? Tout était bon, juste. Tout ce qui survenait semblait emplir à nouveau sa coupe débordante de félicité. Et toujours, au fond de sa pensée, demeurait le poirier. Il devait être en argent, à cette heure-ci, éclairé par la lune de ce pauvre Eddie, en argent comme Miss Fulton, qui, assise là, retournait une mandarine entre ses doigts délicats, si pâles qu'une lueur semblait en émaner.
Ce que Bertha n'arrivait pas à comprendre — ce qui lui semblait miraculeux — c'était la manière dont elle avait deviné si exactement, si rapidement, l'état d'âme de Miss Fulton. Car elle ne mit pas un instant en doute qu'elle avait deviné juste. Et cependant sur quoi se basait-elle ? Sur moins que rien ..."
La nouvelle qui fournit le titre du recueil décrit la journée d`une jeune femme (Bliss), la joie que lui procure l'atmosphère enivrante du printemps, sa belle demeure. le repas exquis qu'elle vient de servir, le groupe d`amis réunis à sa table; brusquement elle sent qu`elle est vraiment passionnément amoureuse de son mari. Sa "béatitude" est éphémère car, dans un miroir, elle le voit soudain embrasser sa meilleure amie ...
" ... une impression singulière frappa l'esprit de Bertha, et l'effraya presque.
Quelque chose d'aveugle et de souriant lui murmurait tout bas : «Bientôt ces gens vont partir, la maison sera tranquille, tranquille. Les lumières seront éteintes. Et vous serez seuls, ensemble, dans la chambre obscure, le lit chaud... »
Elle se leva d'un bond et courut au piano.
— Quel dommage que personne ne joue ! s'écria-t-elle. Quel dommage !
Pour la première fois de sa vie, Bertha Young désirait son mari. Oh ! elle l'aimait. Elle l'avait aimé, bien sûr, de toutes les autres manières, sauf de celle-ci. Et elle avait compris aussi qu'il était différent. Ils en avaient discuté si souvent ! Au début, elle s'était terriblement tourmentée de se sentir si froide, puis, après un temps, cela semblait ne plus avoir d'importance. Ils étaient si francs l'un vis-à-vis de l'autre, si bons camarades. C'était là leur meilleure manière d'être modernes. Mais à présent, ardemment ! ardemment ! Le mot
lui faisait mal dans son corps ardent. Etait-ce à cela que conduisait cette sensation de félicité ? Mais alors...
— Ma chère, dit Mrs Norman Knight, vous connaissez notre infériorité : nous sommes les victimes de l'heure et du train. Nous habitons Hampstead. Cela a été charmant.
— Je vous accompagne dans le hall, dit Bertha, j'étais si contente de vous avoir ! Mais il ne faut pas que vous manquiez le dernier train, c'est si désagréable, n'est-ce pas ?
— Prenez un whisky, Knight, avant de partir, cria Harry.
— Non, merci, mon vieux.
Pour cette parole, Bertha lui serra la main en la secouant.
— Bonsoir, adieu, criait-elle du haut de l'escalier, sentant que son être actuel prenait congé d'eux à jamais.
Lorsqu'elle revint au salon, les autres se levaient.
— ...
Alors vous pouvez faire une partie du chemin dans mon taxi.
— Je serai si reconnaissant de ne pas avoir à envisager une autre course seul, après ma terrible expérience !
— Vous pouvez trouver un taxi à la station, juste au bout de la rue. Vous n'aurez à marcher que quelques mètres.
— Bien agréable. Je vais mettre mon manteau.
Miss Fulton se dirigea vers le hall et Bertha se préparait à la suivre lorsque Harry se précipita, la bouscula presque.
— Laissez-moi vous aider.
Bertha comprit qu'il se repentait de son impolitesse ; elle le laissa aller. Quel gamin il était pour certaines choses, si impulsif, si simple !
Eddie et Bertha restèrent seuls près du feu.
— Je me demande si vous avez vu le nouveau poème de Dick intitulé "Table d'hôte", dit doucement Eddie. Il est si merveilleux ! Il se trouve dans la dernière anthologie. En avez-vous un exemplaire ? J'aimerais vous le montrer. Il commence par un vers d'une indéniable
beauté : "Pourquoi toujours la soupe à la tomate" ?
— Oui, dit Bertha. — Elle se dirigea vers une table, en face de la porte du salon, et Eddie la suivit, glissant silencieusement. Elle prit le petit livre et le lui donna; ni l'un ni l'autre n'avaient fait le moindre bruit.
Tandis qu'il feuilletait le livre, elle leva la tête vers le hall. Elle vit... Harry qui tendait le manteau de Miss Fulton, et Miss Fulton, le dos tourné, la tête penchée. Harry jeta le manteau, lui mit les mains sur les épaules, et la ramena avec violence face à lui. Sa bouche forma les mots : «Je vous adore », et Miss Fulton posa ses doigts de clair de lune sur les joues de Harry, et sourit de son sourire endormi. Les narines de Harry frémirent, ses lèvres se retroussèrent en un rictus, tandis qu'il murmurait : « Demain », et, de ses paupières, Miss Fulton dit : « Oui ».
— Le voilà, dit Eddie : "Pourquoi toujours la soupe à la tomate" ? C'est si profondément vrai, ne le sentezvous pas, la soupe à la tomate est si terriblement éternelle !
— Si vous préférez, disait la voix de Harry venant, très forte, du hall, je peux téléphoner pour demander un taxi à la porte.
— Oh ! non, c'est inutile, dit Miss Fulton. — Elle s'avança vers Bertha et lui donna ses doigts délicats.
— Adieu, et merci beaucoup.
— Adieu, dit Bertha.
Miss Fulton retint sa main un moment de plus.
— Votre merveilleux poirier... murmura-t-elle.
Et puis elle était partie. Eddie la suivait, comme le chat noir (suivait la chatte grise.
— Je vais fermer la boutique, s'écria Harry avec un sang-froid exagéré.
... Votre merveilleux poirier... poirier... poirier...
Bertha courut simplement vers les portes-fenêtres.
— Oh ! que va-t-il se passer à présent ? s'écria-t-elle.
Mais le poirier était aussi merveilleux que jamais, aussi couvert de fleurs, et aussi calme."
(trad. Stock, 1932)

Dans la longue nouvelle intitulée "Prélude", Mansfield décrit la vie d`une famille, les Burnell. au cours de deux journées ; les faits et gestes de chacun sont minutieusement étudiés. le lecteur pénètre dans l`intimité des personnages, voit leurs affinités et pressent les futurs motifs de discorde ...
" .. Dans la cuisine, à la longue table de sapin placée sous les deux fenêtres, la vieille Mrs Fairfield lavait la vaisselle du déjeuner. La croisée de la cuisine donnait sur une pente herbeuse qui descendait jusqu'au potager et aux plates-bandes de rhubarbe. L'office et
la buanderie la bordaient d'un côté, et sur cet appentis blanchi à la chaux grimpait une vigne noueuse. Mrs Fairfield avait remarqué hier que quelques vrilles passaient au travers des fissures du toit de la buanderie et que toutes les fenêtres avaient une épaisse collerette de verdure hérissée.
— J'aime beaucoup la vigne, déclara Mrs Fairfield, mais je ne crois pas que les raisins mûriront ici ; ils ont besoin du soleil d'Australie.— Elle se rappela comment Béryl, quand elle était enfant, ramassait des raisins blancs sur la vigne de la véranda, derrière leur maison de Tasmanie, lorsqu'elle avait été piquée à la jambe par une énorme fourmi rouge. Elle revoyait Béryl dans sa petite robe écossaise nouée sur les épaules par des rubans cramoisis, hurlant si fort que la moitié de la rue s'était précipitée chez eux. Et comme la jambe de l'enfant avait enflé !
« Ah !... » Mrs Fairfield retint sa respiration en y songeant. « Pauvre petite, c'était si effrayant ! » Les lèvres serrées, elle revint au fourneau prendre de l'eau chaude. L'eau moussait dans la grande bassine savonneuse avec des bulles roses et bleues sur l'écume. Les bras de la vieille Mrs Fairfield, nus jusqu'au coude, étaient teintés d'un rose vif. Elle portait une robe de foulard gris semé de grandes pensées violettes, un tablier de toile blanche, et un haut bonnet de mousseline en forme de moule à gelée ; à son col brillait un croissant de lune en argent surmonté de cinq petits hiboux, et, autour de son cou, s'enroulait une châtelaine de perles noires. Il était difficile de croire qu'elle n'avait pas été dans cette cuisine depuis des années, tant elle paraissait en faire partie. Elle serra la faïence d'une main précise et sûre, avec des mouvements lents et amples, allant du fourneau au dressoir, voyant au garde-manger, à l'office, comme s'il n'y avait pas un recoin qui ne lui fût familier. Quand elle eut terminé, les objets dans la cuisine semblaient tous rangés par catégories. Debout au milieu de la pièce, elle s'essuyait les mains avec un linge à carreaux, un sourire épanoui sur les lèvres...."

"Je ne parle pas français" - Raoul Duquette, un écrivain parisien désabusé et solitaire, obsédé par son apparence et son image publique, raconte sa relation avec Dick Harmon, un jeune Anglais optimiste et sympathique qu’il rencontre par hasard dans un café. Dick est tout ce que Raoul n’est pas : chaleureux, sincère, et enthousiaste. Fasciné par cet homme qui semble si différent de lui, Raoul se lie d’amitié avec lui, mais cette amitié est teintée de jalousie et de condescendance. Dick présente Raoul à Mouse, une jeune femme timide et vulnérable dont il est amoureux. Mouse est décrite comme douce mais effacée, dépendante de Dick - Elle était comme une petite créature perdue, si fragile, si peu adaptée à ce monde. Et pourtant, je ne pouvais pas m’empêcher de la mépriser -. Raoul ressent un mélange d’attirance et de mépris pour elle, mais jalouse leur relation. - Comme dans beaucoup d’œuvres de Mansfield, les descriptions sont fragmentées et impressionnistes, reflétant les pensées chaotiques et contradictoires de Raoul - . L’histoire prend une tournure dramatique lorsque Dick, en quête de nouvelles expériences, décide de quitter Paris et d’abandonner Mouse, - Il a dit au revoir comme s’il partait pour une promenade dans le parc. Pour lui, rien ne comptait vraiment -. Avant de partir, il confie Raoul à Mouse, lui demandant de veiller sur elle. Raoul, blessé par la confiance que Dick lui accorde sans voir sa vraie nature, rejette non sans cruauté Mouse, l'abandonnant seule et désespérée. Raoul, le manipulateur, retourne à son existence vide et cynique mais peu lui importe, - Je suis tout à fait certain que personne ne m’a jamais aimé. Et pourquoi devrais-je m’en soucier ? Je ne les aime pas non plus ...
"The Wind Blows", une histoire qui débute par une matinée venteuse, un vent violent qui semble refléter l'agitation intérieure qu'éprouve Matilda, la protagoniste, une jeune fille qui vit encore chez ses parents. Une relation distante et peu affective semble s'être instaurée entre eux, et c'est avec son frère, Bogey, qu'elle partage une complicité particulière, abordant tous les sujets qui les éloignent un temps de la banalité de leur quotidien. Le vent continue de souffler, Matilda est submergée par un sentiment de mélancolie et ressent relation profonde avec le vent, qui semble symboliser la force inexorable du changement et le passage du temps. La nouvelle se termine sur une note impressionniste, Matilda regarde au loin, perdue dans ses pensées, est-ce l’incertitude et l’ambiguïté du passage à l’âge adulte ...

Dans "Je ne parle pas français", "Psychologie", "Un homme sans tempérament", Mansfield analyse le drame de ceux qui ne savent pas s'abandonner à la douceur des sentiments...
"... Lorsqu'elle ouvrit la porte et le vit debout sur le seuil, elle fut plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été auparavant, et lui aussi, tandis qu'il la suivait dans le studio, semblait très, très content d'être venu.
— Pas occupée ?
— Non. J'allais prendre le thé.
— Et vous n'attendez personne ?
— Absolument personne.
— Ah ! c'est très bien.
Avec des gestes calmes et lents, il posa son chapeau et son pardessus, comme s'il avait du temps de reste, ou ne pensait pas qu'il dût les reprendre, puis il s'approcha du feu, et tendit les mains vers la flamme vive et bondissante.
Un instant, l'un et l'autre demeurèrent sans bruit dans cette lueur qui dansait. Immobiles, ils semblaient goûter, sur leurs lèvres souriantes, le doux choc de l'accueil. Leurs êtres secrets murmuraient :
— Pourquoi parler ? Ceci n'est-il pas suffisant ?
— Plus que suffisant. Je n'avais jamais compris jusqu'ici...
— Combien c'est bon simplement d'être avec vous...
— Comme cela...
— C'est plus que suffisant.
Puis, brusquement, il se retourna, la regarda, et vite elle s'éloigna.
— Voulez-vous une cigarette ? Je vais mettre la bouillotte. Avez-vous envie de thé ?
— Non ! pas moi.
— Eh bien ! moi, si.
— Oh ! vous... — il donna un coup de poing au coussin arménien et le lança sur le divan — vous êtes une parfaite petite Chinoise !
— Oui, vraiment, dit-elle en riant. J'ai envie de thé comme les hommes robustes ont envie de vin.
Elle alluma la lampe sous son large abat-jour orange, ferma les rideaux et tira la table à thé. Deux oiseaux chantaient dans la bouilloire, le feu papillonnait. Il se redressa, les mains sur les genoux. C'était exquis, cette besogne de prendre le thé — et elle avait toujours de
délicieuses petites choses à manger : des petits sandwiches épicés, des petits biscuits doux, aux amandes, et un gâteau brun, riche, parfumé au rhum. Mais c'était une interruption. Il aurait voulu la chose terminée, la table repoussée, leurs deux fauteuils rapprochés de la lumière, et le moment venu où il prendrait sa pipe, la remplirait et dirait en pressant le tabac dans le fourneau : «J'ai songé à ce que vous m'avez expliqué la dernière
fois et il me semble que... »
Oui, voilà ce qu'il attendait, et elle aussi...."

En 1922, Mansfield a publié son troisième recueil, « The Garden Party and Other Stories », qui a également été salué par la critique. Publiée initialement dans la Saturday Westminster Gazette le 4 février 1922, l'histoire qui donne son titre au recueil est écrite dans un style moderniste et concerne la famille Sheridan, qui s'apprête à organiser une garden-party. Laura est censée être responsable, mais elle a des problèmes avec les ouvriers qui semblent mieux informés, et sa mère a commandé des lys pour la fête sans l'accord de sa fille. Cependant, à l'annonce de la mort d'un voisin ouvrier, des tensions apparaissent entre les membres de la famille Sheridan. Le recueil contient également le célèbre récit « Miss Brill », une histoire douce-amère d'une femme fragile vivant une vie éphémère d'observation et de plaisirs simples à Paris...

"The Garden Party and Other Stories" (La Garden Party, 1922)
Katherine Mansfield parvient ici, sans procédé littéraire spécifique, à éclairer les aspects les plus sombres de l'intériorité humaine : celle-ci surgit en l'état par contraste avec la monotonie d'une existence quotidienne qui n'alimente en rien notre sensibilité. Les pleurs de l'enfant, les troubles de l'adolescent, la solitude de l'âge mûr, la séparation des êtres, autant de souffrances qui nous poussent à valoriser les douceurs éphémères des éléments les plus simples. Une quinzaine de nouvelles composent ce recueuil, dont "The Stranger", "Miss Brill", "The Daughters of the Late Colonel", "Life of Ma Parker", "The Young Girl", "Mr and Mrs Dove", "Her First Ball", "The Singing Lesson", "Bank Holiday", "An Ideal Family", "The Lady's Maid", "Marriage à la Mode", "At The Bay", "The Voyage"..
"At the Bay" (Sur la baie, 1922) montre l'anxiété de la jeune fille devant l'amour, thème que l'on retrouve aussi dans "The Young Girl" et, plus tard, "The Daughters of the late Colonel", lorsqu'elles auront pris de l'âge..
"At the Bay" (Sur la baie, 1922), une journée dans la vie d'une famille vivant près de la mer et l'anxiété d'une jeune fille devant l'amour, thème que l'on retrouve aussi dans "The Young Girl" et, plus tard, "The Daughters of the late Colonel" ...
".... Linda dropped into Beryl's hammock under the manuka tree, and Jonathan stretched himself on the grass beside her, pulled a long stalk and began chewing it. They knew each other well. The voices of children cried from the other gardens. A fisherman's light cart shook along the sandy road, and from far away they heard a dog barking; it was muffled as though the dog had its head in a sack. If you listened you could just hear the soft swish of the sea at full tide sweeping the pebbles. The sun was sinking.
"And so you go back to the office on Monday, do you, Jonathan?" asked Linda.
"On Monday the cage door opens and clangs to upon the victim for another eleven months and a week," answered Jonathan.
Linda swung a little. "It must be awful," she said slowly.
"Would ye have me laugh, my fair sister? Would ye have me weep?"
Linda was so accustomed to Jonathan's way of talking that she paid no attention to it.
"I suppose," she said vaguely, "one gets used to it. One gets used to anything."
"Does one? Hum!" the "Hum" was so deep it seemed to boom from underneath the ground. "I wonder how it's done," brooded Jonathan; "I've never managed it."
Looking at him as he lay there, Linda thought again how attractive he was. It was strange to think that he was only an ordinary clerk, that Stanley earned twice as much money as he. What was the matter with Jonathan? He had no ambition; she supposed that was it. And yet one felt he was gifted, exceptional. He was passionately fond of music; every spare penny he had went on books. He was always full of new ideas, schemes, plans. But nothing came of it all. The new fire blazed in Jonathan; you almost heard it roaring softly as he explained, described and dilated on the new thing; but a moment later it had fallen in and there was nothing but ashes, and Jonathan went about with a look like hunger in his black eyes. At these times he exaggerated his absurd manner of speaking, and he sang in church–he was the leader of the choir–with such fearful dramatic intensity that the meanest hymn put on an unholy splendour.
"It seems to me just as imbecile, just as infernal, to have to go to the office on Monday," said Jonathan, "as it always has done and always will do. To spend all the best years of one's life sitting on a stool from nine to five, scratching in somebody's ledger! It's a queer use to make of one's . . . one and only life, isn't it? Or do I fondly dream?" He rolled over on the grass and looked up at Linda. "Tell me, what is the difference between my life and that of an ordinary prisoner? The only difference I can see is that I put myself in jail and nobody's ever going to let me out. That's a more intolerable situation than the other. For if I'd been–pushed in, against my will–kicking, even–once the door was locked, or at any rate in five years or so, I might have accepted the fact and begun to take an interest in the flight of flies or counting the warder's steps along the passage with particular attention to variations of tread and so on. But as it is, I'm like an insect that's flown into a room of its own accord. I dash against the walls, dash against the windows, flop against the ceiling, do everything on God's earth, in fact, except fly out again. And all the while I'm thinking, like that moth, or that butterfly, or whatever it is, 'The shortness of life! The shortness of life!' I've only one night or one day, and there's this vast dangerous garden, waiting out there, undiscovered, unexplored."
"But, if you feel like that, why–" began Linda quickly.
"Ah! " cried Jonathan. And that "ah!" was somehow almost exultant. "There you have me. Why? Why indeed? There's the maddening, mysterious question. Why don't I fly out again? There's the window or the door or whatever it was I came in by. It's not hopelessly shut–is it? Why don't I find it and be off? Answer me that, little sister."
But he gave her no time to answer.
"I'm exactly like that insect again. For some reason"–Jonathan paused between the words–"it's not allowed, it's forbidden, it's against the insect law, to stop banging and flopping and crawling up the pane even for an instant. Why don't I leave the office? Why don't I seriously consider, this moment, for instance, what it is that prevents me leaving? It's not as though I'm tremendously tied. I've two boys to provide for, but, after all, they're boys. I could cut off to sea, or get a job up-country, or–" Suddenly he smiled at Linda and said in a changed voice, as if he were confiding a secret, "Weak . . . weak. No stamina. No anchor. No guiding principle, let us call it." But then the dark velvety voice rolled out:"
Would ye hear the story
How it unfolds itself . . .
and they were silent.
The sun had set. In the western sky there were great masses of crushed-up rose-coloured clouds. Broad beams of light shone through the clouds and beyond them as if they would cover the whole sky. Overhead the blue faded; it turned a pale gold, and the bush outlined against it gleamed dark and brilliant like metal. Sometimes when those beams of light show in the sky they are very awful. They remind you that up there sits Jehovah, the jealous God, the Almighty, Whose eye is upon you, ever watchful, never weary. You remember that at His coming the whole earth will shake into one ruined graveyard; the cold, bright angels will drive you this way and that, and there will be no time to explain what could be explained so simply. . . . But tonight it seemed to Linda there was something infinitely joyful and loving in those silver beams. And now no sound came from the sea. It breathed softly as if it would draw that tender, joyful beauty into its own bosom.
"It's all wrong, it's all wrong," came the shadowy voice of Jonathan. "It's not the scene, it's not the setting for . . . three stools, three desks, three ink pots and a wire blind."
Linda knew that he would never change, but she said, "Is it too late, even now?"
"I'm old–I'm old," intoned Jonathan. He bent towards her, he passed his hand over his head. "Look!" His black hair was speckled all over with silver, like the breast plumage of a black fowl.
Linda was surprised. She had no idea that he was grey. And yet, as he stood up beside her and sighed and stretched, she saw him, for the first time, not resolute, not gallant, not careless, but touched already with age. He looked very tall on the darkening grass, and the thought crossed her mind, "He is like a weed."
Jonathan stooped again and kissed her fingers.
"Heaven reward thy sweet patience, lady mine," he murmured. "I must go seek those heirs to my fame and fortune. . . ." He was gone...."
"... Linda se laissa tomber dans le hamac de Béryl, sous le manuka, et Jonathan s'étendit sur le gazon auprès d'elle, tira un long brin d'herbe et commença à le mâchonner. Ils se connaissaient bien. Les voix des enfants montaient avec des cris, des autres jardins. La légère charrette d'un pêcheur passa en cahotant le long de la route sablonneuse et, au loin, ils entendirent un chien aboyer; le son était sourd comme si la bête avait eu la tête dans un sac. Si on écoutait, on pouvait tout juste entendre le doux bruit liquide et rythmé de la mer à marée haute, balayant les galets. Le soleil descendait.
- "Alors, vous retournez au bureau lundi, n'est-ce pas, Jonathan ? demanda Linda.
- Lundi, la porte de la cage se rouvre et se referme avec fracas sur la victime pour onze mois et une semaine encore", répondit Jonathan.
Linda se balança un peu.
- Ce doit être affreux, dit-elle lentement.
- Voudriez-vous que je rie, ma charmante sœur? Voudriez-vous que je pleure ? ››
Linda était si bien habituée à la façon de parler de Jonathan qu'elle n'y faisait aucune attention.
- Je suppose, dit-elle d'un air vague, qu'on s'y accoutume. On s'accoutume à tout.
- Vraiment ? Hum!
Ce « hum ›› était si creux qu'il semblait résonner de dessous terre.
- Je me demande comment on y parvient, dit Jonathan d'un air méditatif et sombre. Moi, je n'y suis jamais arrivé.
En le regardant, tel qu'il reposait là, Linda songea une fois de plus qu'il était bien séduisant. C'était étrange de se dire qu'il n'était qu'un employé ordinaire, que Stanley gagnait deux fois plus d'argent que lui. Qu'est-ce qu'avait donc jonathan? Il manquait d'ambition ; c'était cela, supposait-elle. Et cependant on sentait qu'il avait des dons, qu'il était un être exceptionnel. Il aimait la musique avec passion ; il dépensait en livres tout l'argent dont il pouvait disposer. Il était toujours plein d'idées nouvelles, de projets, de plans. Mais rien de tout cela n'aboutissait. Le feu nouveau flambait en lui ; on croyait presque l'entendre gronder doucement tandis qu'il expliquait, décrivait, s'étendait sur la vision neuve; mais un instant après la flamme était retombée, il ne restait rien que des cendres et Jonathan allait et venait, ayant dans ses yeux noirs le regard d'un affamé. En des moments pareils, il exagérait les absurdités de sa façon de parler, et à l'église - où il conduisait le chœur - il chantait avec une intensité dramatique si terrible que le cantique le plus médiocre revêtait une splendeur profane.
- "Il me paraît tout aussi idiot, tout aussi infernal d'avoir à retourner lundi au bureau, déclara Jonathan, que cela m'a toujours semblé et me semblera toujours. Passer toutes les meilleures années de sa vie assis sur un tabouret, de neuf heures à cinq, à gribouiller le registre de quelqu'un d'autre! Voilà un drôle d'usage à faire de sa vie... de sa seule et unique vie, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce un rêve insensé que je fais?"
Il se retourna sur l'herbe et leva les yeux vers Linda.
- "Dites-moi, quelle est la différence entre mon existence et celle d'un prisonnier ordinaire La seule que je puisse voir est que je me suis mis en prison moi-même et que personne ne m'en fera jamais sortir. Cette situation-là est plus intolérable que l'autre. Car si j'avais été poussé là-dedans malgré moi - en me débattant même - quand la porte aurait été refermée, ou au bout de quelque cinq ans en tout cas, j'aurais pu accepter le fait ; j'aurais pu commencer à m'intéresser au vol des mouches, ou à. compter les pas du geôlier le long du couloir, en observant particulièrement les variations de sa démarche et tout ce qui s'ensuit. Mais, dans l'état des choses, je ressemble à un insecte qui est venu de son propre gré voler dans une chambre. Je me précipite contre les murs, je me précipite contre les fenêtres, je bats des ailes au plafond, je fais, en somme, tout ce qu'on peut faire en ce moment, sauf m'envoler au dehors. Et tout le temps, je ne cesse de penser, comme ce phalène, ou ce papillon, ou cet insecte quelconque : "O brièveté de la vie! O brièveté de la vie !" Je n'ai qu'une nuit ou qu'un jour, et ce vaste, ce dangereux jardin attend là, dehors, sans que je le découvre, sans que je l'explore!
- Mais, si vous avez ce sentiment-là, pourquoi..., commença Linda, vivement.
- Ah ! cria Jonathan. Ce "ah!" avait presque un accent d'exultation.
"Voilà ou vous me tenez ! Pourquoi ? Pourquoi, certes ? Voilà la question affolante, mystérieuse. Pourquoi est-ce que je ne m'envole pas au dehors ? La fenêtre ou la porte, 1'ouverture par laquelle je suis entré est là. Elle n'est pas close à tout jamais... n'est-ce pas ? Pourquoi donc ne puis-je la trouver et m'évader? Répondez à cela, petite sœur!"
Mais il ne lui donna pas le temps de la réponse. "Là encore, je ressemble exactement à cet insecte. Pour une raison quelconque... " Jonathan espaça les mots. ".. il n'est pas permis, il est défendu, il est contraire à la loi des insectes de cesser, même un instant, de venir frapper, battre des ailes, se traîner sur la vitre. Pourquoi ne pas quitter le bureau? Pourquoi ne pas examiner sérieusement, en ce moment, par exemple, ce qui m'empêche de le quitter? Ce n'est pas comme si j'étais retenu par des liens formidables. J'ai deux enfants à élever, mais après tout, ce sont des garçons. je pourrais filer, partir en mer ou trouver du travail à l'intérieur du pays, ou bien..."
Tout à coup, il sourit à Linda et dit d'une voix changée, comme s'il confiait un secret : - "Faible... faible. Pas de vigueur. Pas de port d'attache. Pas de principes qui me guident, s'il faut les appeler de ce nom." Mais ensuite, sa voix de velours sombre résonna :
- "Voulez-vous entendre le conte Et comment il se déroula..."
Ils restèrent silencieux. Le soleil avait disparu. Dans le ciel occidental, il y avait de grandes masses de nuages couleur de rose, mollement entassés. De larges rayons de lumière brillaient à travers ces nuages et au-delà, comme s'ils voulaient inonder tout le ciel. Là-haut, le bleu se fanait ; il se muait en un or pâle et la brousse, se profilant sur lui, luisait obscure et resplendissante comme un métal. Parfois, ces rayons de lumière, quand ils se montrent dans le ciel, vous remplissent d'épouvante. Ils vous rappellent que là-haut trône Jéhovah, le Dieu jaloux, le Tout-Puissant dont l'œil vous contemple, toujours vigilant, jamais las. Vous vous souvenez qu'à Sa venue, la terre tout entière croulera, réduite en un cimetière de ruines ; que les anges froids et lumineux vous chasseront de-ci de-là, et qu'il n'y aura pas de temps pour expliquer ce qui pourrait s'expliquer si simplement... Mais ce soir-là, il semblait à Linda qu'il y avait quelque chose d'infiniment joyeux et tendre dans ces rayons d'argent. Aucun bruit maintenant ne venait de la mer. Elle respirait doucement, comme si elle eût voulu attirer dans son sein toute cette beauté tendre et joyeuse. "Tout cela est mal, tout cela est injuste, répétait la voix crépusculaire de jonathan. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le décor... trois tabourets, trois pupitres, trois encriers, un écran de fil de fer."
Linda savait bien qu' il ne changerait jamais, mais elle dit :
- "Est-il trop tard, même à présent?
- Je suis vieux... je suis vieux", psalmodia Jonathan.
Il se pencha vers elle, il passa la main sur sa tête.
- "Regardez ! " Ses cheveux noirs étaient tout striés d'argent, comme sur la poitrine, le plumage noir d'un grand oiseau. Linda fut surprise. Elle n'avait aucune idée qu'il grisonnât. Et pourtant, lorsqu'il se tint debout auprès d'elle et soupira, et s'étira, elle le vit, pour la première fois, non pas résolu, non pas audacieux, non pas insouciant, mais déjà touché par la vieillesse. Il semblait très grand sur l'herbe assombrie, et cette pensée lui traversa l'esprit : "Il est comme une plante sans force." Jonathan se pencha de nouveau et lui baisa les doigts. "Le ciel récompense ta douce patience, ô dame de mes pensées, murmura-t-il. Il me faut aller quérir les héritiers de ma gloire et de ma fortune..."
Il avait disparu...."

Un recueil de nouvelles publié en 1923 et dédié au mari de l`auteur, John Middleton Murry. Certaines de ces nouvelles, qui comptent parmi les plus typiques de Katherine Mansfield, montrent parfaitement comment elle parvient à éclairer les aspects les plus secrets de la vie intérieure de l'être humain. En s'appuyant sur sa seule intuition, elle sait traduire toute la monotonie de l`existence quotidienne. Elle ne veut être alors qu`attentive à la vie secrète de la conscience. Le ton du récit n'en est que plus intime et plus poétique. L'auteur se penche sur la souffrance humaine : les pleurs de l'enfance. les troubles de l'adolescence, la solitude de l'âge mûr et la séparation des êtres. Cette souffrance conduit à ce plaisir des sens qui se satisfait de toutes les douceurs éphémères de l'existence : les herbes, les fleurs, et les oiseaux, le pain croustillant, et le reste.
Dans "A la baie" (At the Bay) et dans "La Jeune Fille" (The young Girl), l`auteur décrivait l`anxiété de plusieurs jeunes filles devant l'amour, "Les Jeunes Filles de feu le colonel" (The Daughters of the late Colonel) sont devenues de vieilles filles. Les réactions qu`elles manifestent à la mort de leur vieux père. qui était égoïste et grognon, laissent deviner la médiocrité de leur vie passée et leurs frustrations ...
" ... Comme la matinée se prolongeait, des groupes nombreux apparurent au sommet des dunes et descendirent à la plage pour se baigner. C’était chose entendue qu’à onze heures la mer appartenait aux femmes et aux enfants de la colonie d’été. Les femmes se déshabillaient les premières, enfilaient leur costume de bain, se couvraient la tête de hideux bonnets qui ressemblaient à des sacs à éponges ; puis on déboutonnait les vêtements des enfants. La grève était semée de petits tas d’habits et de souliers ; les grands chapeaux de soleil, des pierres sur les bords pour empêcher le vent de les emporter, avaient l’air de coquillages immenses. Il était étrange que la mer elle-même parût prendre un son différent, lorsque toutes ces formes bondissantes, en riant, en courant, entraient dans les vagues ..."
Linda, l’épouse de Stanley Burnell et la mère de leurs enfants, est un exemple typique des personnages féminins de Mansfield qui, loin des stéréotypes, est à la fois aimante et distante, forte et vulnérable, en décalage total avec un homme si pragmatique et terre-à-terre...
" ... elle l’avait épousé. Et qui plus est, elle l’aimait. Non pas le Stanley que voyait tout le monde, le Stanley de tous les jours ; mais un Stanley timide, plein de sensibilité, innocent, qui, chaque soir, s’agenouillait pour dire ses prières et qui désirait ardemment être bon. Stanley était une âme simple. S’il avait confiance en quelqu’un – comme il avait confiance en elle, par exemple –, c’était de tout son cœur. Il était incapable d’être déloyal ; il ne savait pas mentir. Et comme il souffrait cruellement s’il pensait que quelqu’un – elle-même – n’était pas absolument droit, absolument sincère avec lui ! « – Ça, c’est trop compliqué pour moi ! » Il lui jetait ces mots, mais son expression de franchise frémissante et troublée ressemblait à celle d’un animal pris au piège.
Mais le malheur était – ici Linda eut presque envie de rire, bien que l’affaire n’eût rien de risible, Dieu sait ! – le malheur était qu’elle voyait si rarement ce Stanley-là. Il y avait des éclairs, des moments, des trêves de calme, mais tout le reste du temps, on aurait dit qu’on vivait dans une maison qui ne pouvait perdre l’habitude de prendre feu, sur un navire qui faisait quotidiennement naufrage. Et toujours, c’était Stanley qui se trouvait au plus fort du danger. Tout son temps à elle se passait à venir à son secours, à le réconforter, à l’apaiser, à écouter son récit du sinistre. Et ce qui lui restait de loisirs s’écoulait dans la terreur d’avoir des enfants.
Linda fronça les sourcils ; elle se redressa sur sa chaise longue et saisit ses chevilles dans ses mains. Oui, c’était là son véritable grief contre la vie ; c’était là ce qu’elle ne parvenait pas à comprendre. C’était la question qu’elle posait, qu’elle posait et dont elle attendait en vain la réponse. Il est bien facile de dire que le sort commun des femmes est de mettre au monde des enfants. Ce n’était pas vrai. Elle, par exemple, était capable de prouver que c’était faux. Elle était brisée, sans courage, à force d’en avoir eu. Et, ce qui rendait la chose deux fois plus dure à supporter, c’était qu’elle n’aimait pas ses enfants. Il ne servait à rien de prétendre que si. Même si elle en avait eu la force, elle n’aurait jamais soigné ses petites filles, jamais joué avec elles.
Non, il semblait qu’un souffle glacé l’avait pénétrée tout entière pendant chacun de ces terribles voyages ; il ne lui restait plus aucune chaleur à leur donner. Quant au petit… eh bien, Dieu merci, sa mère s’en était chargé ; il était à elle, ou à Béryl, ou à quiconque le voulait. C’était à peine si elle l’avait tenu dans ses bras. Il lui était si indifférent que, tel qu’il reposait là… Linda jeta un regard vers lui ..."
"On se sent isolé, quand on vit seul. Bien entendu, il y a la famille, les amis, en foule ; mais ce n’est pas là ce qu’elle veut dire. Il lui faut quelqu’un qui découvre la Béryl que nul d’entre eux ne connaît, qui s’attende à ce qu’elle reste cette Béryl, toujours. Il lui faut un amoureux ..." - Sa fille, Beryl Fairfield, devenue jeune femme rêveuse et romantique, mais qui n'est que doutes et de craintes, désir d'amour intense et peur diffuse de celui-ci dans "At the Bay". Puis dans "The Young Girl", c'est une autre jeune fille dont l’anxiété va naître de l’innocence et de l’inexpérience : toujours, cet amour perçu comme un territoire inconnu, à la fois attirant et menaçant ...

"The Garden-Party" - La première de ces nouvelles, qui donne son titre au recueil, nous introduit parallèlement dans quelque riche demeure où se donne une garden-party et dans un foyer misérable où vient de mourir un père de six enfants. L'écrivain étudie les réactions que provoque la nouvelle de cette mort sur les membres de la famille riche. Tout à la joie de la fête, l`héroïne (Laura Sheridan) oublie ses voisins malheureux. Après le départ de la brillante compagnie, elle leur porte les restes du repas. En présence du mort, les sentiments confus accumulés dans son âme au cours de la journée s`expriment par des sanglots. Sans oublier cette exclamation puérile : "Excusez-moi si je garde mon chapeau", dit-elle au mort qu`elle voit si terriblement calme sur son grabat...
"It was just growing dusky as Laura shut their garden gates. A big dog ran by like a shadow. The road gleamed white, and down below in the hollow the little cottages were in deep shade. How quiet it seemed after the afternoon. Here she was going down the hill to somewhere where a man lay dead, and she couldn’t realize it. Why couldn’t she? She stopped a minute. And it seemed to her that kisses, voices, tinkling spoons, laughter, the smell of crushed grass were somehow inside her. She had no room for anything else. How strange! She looked up at the pale sky, and all she thought was, “Yes, it was the most successful party.”
Le crépuscule commençait à tomber comme Laura refermait la grille de leur jardin. Un gros chien passait en courant, pareil a une ombre. La route luisait toute blanche et là-bas, dans le creux, les maisonnettes étaient plongées dans une obscurité profonde. Comme tout semblait tranquille après cette journée ! Voilà qu’elle descendait la colline, allant quelque part où un homme gisait mort, et elle ne parvenait pas à saisir la réalité de ce fait. Pourquoi donc ne le pouvait-elle pas ? Elle s’arrêta une minute. Et il lui sembla que les baisers, les voix, les tintements des cuillères, les rires, l’odeur de l’herbe piétinée étaient, elle ne savait comment, en elle. Il n’y avait pas de place pour autre chose. Que c’était étrange ! Elle leva les yeux vers le ciel pâle, et la seule pensée qui lui vint fut celle-ci : « Oui, c’était la fête la plus réussie. »
"Now the broad road was crossed. The lane began, smoky and dark. Women in shawls and men’s tweed caps hurried by. Men hung over the palings; the children played in the doorways. A low hum came from the mean little cottages. In some of them there was a flicker of light, and a shadow, crab-like, moved across the window. Laura bent her head and hurried on. She wished now she had put on a coat. How her frock shone! And the big hat with the velvet streamer—if only it was another hat! Were the people looking at her? They must be. It was a mistake to have come; she knew all along it was a mistake. Should she go back even now?
No, too late. This was the house. It must be. A dark knot of people stood outside. Beside the gate an old, old woman with a crutch sat in a chair, watching. She had her feet on a newspaper. The voices stopped as Laura drew near. The group parted. It was as though she was expected, as though they had known she was coming here.
Maintenant, elle avait traversé la large route. La ruelle s’ouvrait, enfumée et sombre. Des femmes enveloppées de châles, coiffées de casquettes d’ouvriers, passaient en se hâtant.
Des hommes se penchaient par-dessus les clôtures : les enfants jouaient devant les portes. Un bourdonnement étouffé venait des mesquins petits cottages. Quelques-uns laissaient voir une lumière vacillante, et une ombre passait, pareille à un crabe, contre la fenêtre. Laura baissa la tête et pressa le pas. Elle regrettait à présent de n’avoir pas mis de manteau.
Comme sa robe brillait ! et ce grand chapeau aux flottants rubans de velours… si c’était seulement un autre chapeau ! Est-ce que les gens la regardaient ? Oui, sans doute. C’était une erreur que d’être venue ; tout le temps, elle avait eu conscience que c’était une erreur. Fallait-il s’en retourner, même à présent ? Non, il était trop tard. C’était cette maison-là. Ce devait être elle. Un sombre groupe de gens se tenait à l’extérieur. À la porte du jardin une vieille, vieille femme, avec une béquille, était assise sur une chaise et montait la garde. Elle avait les
pieds posés sur un journal. Les voix se turent quand Laura approcha. Le groupe se sépara. C’était comme si elle avait été attendue, comme si on avait su qu’elle allait venir.
"Laura was terribly nervous. Tossing the velvet ribbon over her shoulder, she said to a woman standing by, “Is this Mrs. Scott’s house?” and the woman, smiling queerly, said, “It is, my lass.”
Oh, to be away from this! She actually said, “Help me, God,” as she walked up the tiny path and knocked. To be away from those staring eyes, or to be covered up in anything, one of those women’s shawls even. I’ll just leave the basket and go, she decided. I shan’t even wait for it to be emptied. Then the door opened. A little woman in black showed in the gloom...."
Laura était horriblement gênée. Rejetant le ruban de velours sur son épaule, elle dit à une femme qui se trouvait là : – Est-ce ici que demeure madame Scott ? Et la femme avec un singulier sourire, répondit : – Oui, ma belle. Oh ! être loin de tout cela ! Elle en vint à dire : « Aide-moi, mon Dieu ! » en remontant l’étroite petite allée et en frappant à la porte. Être loin de ces yeux qui la dévisageaient, ou bien être couverte de n’importe quoi, même du châle d’une de ces femmes ! – Je ne ferai que laisser le panier et je m’en irai, décida-t-elle. Je n’attendrai même pas qu’on l’ait vidé. Alors, la porte s’ouvrit. Une petite femme en noir parut dans la pénombre....

"Life of Ma Parker" (Vie de Maman Parker), Ma Parker est une femme de ménage qui travaille pour un écrivain aisé, son employeur lui demande distraitement comment elle va, Ma Parker répond qu'elle a enterré son petit-fils récemment, mais son employeur montre peu d'empathie et retourne rapidement à ses préoccupations personnelles, la voici qui commence son humble tâche, mais cherche bientôt, en vain, un endroit où pleurer ..
"Quand le monsieur-auteur dont la vieille Maman Parker faisait l’appartement tous les mardis ouvrit la porte ce matin-là, il lui demanda des nouvelles de son petit-fils. Maman Parker, debout sur le paillasson dans le petit couloir sombre, étendit la main pour aider son monsieur à renfermer la porte avant de répondre.
– Nous l’avons enterré hier, m’sieu, dit-elle doucement.
– Oh ! mon Dieu ! je suis désolé, dit le monsieur-auteur d’un ton scandalisé. Il était en train de déjeuner. Il portait une robe de chambre considérablement râpée et tenait à la main un journal chiffonné. Mais il se sentait gêné. Il ne pouvait guère retourner à son cabinet de travail bien chaud sans avoir dit quelque chose – quelque chose de plus. Alors, sachant que ces gens-là attachent tant d’importance aux enterrements, il prononça avec bonté : « J’espère que les obsèques se sont bien passées ? »
– Mande pardon, m’sieu ? dit la vieille Maman Parker d’une voix enrouée.
Pauvre vieille chouette ! Elle avait l’air tout ahurie.
« J’espère que les obsèques étaient… étaient réussies », répéta-t-il. Maman Parker ne fit aucune réponse. Elle baissa la tête et, clopinant, s’en fut à la cuisine, la main crispée sur la vieille bourriche à poisson qui contenait ses brosses, ses chiffons pour le nettoyage, un tablier, une paire de pantoufles de feutre. Le monsieur-auteur leva les sourcils et retourna à son déjeuner...."
"Mr and Mrs Dove" (Monsieur et Madame Dove) - À travers Reggie, qui aime sincèrement, mais dont les sentiments ne sont pas partagés, la colombe, et Anne, qui ne partage pas ses sentiments, les thèmes universels de l’amour non partagé, et des attentes différentes de chacun des deux sexes ..., "en dépit de tout ce qu’il était capable d’imaginer, son amour à lui était si formidable qu’il ne pouvait s’empêcher d’espérer..."
"Mariage à la Mode" (Mariage à la mode), l'illusion du mariage, l'illusion des relations, rien ne peut combler le fossé émotionnel entre deux êtres qui ne partgaent pas les mêmes priorités vis-à-vis de l'existence...
"The Stranger" (L'Etranger) - M. Hammond attend avec impatience le retour de sa femme d’un voyage à l'étranger. Cependant, elle lui révèle une expérience émotionnelle inattendue qui bouleverse ses attentes....
"Her First Ball" (Son Premier Bal) - Leila, une jeune fille de la campagne, assiste à son premier bal et découvre à la fois l'excitation et la déception liées à la vie sociale. L’histoire est empreinte de l'émerveillement et de la désillusion.
"The Voyage" (Le Voyage) - Fenella, une petite fille, fait un voyage en bateau avec sa grand-mère après la mort de sa mère. L'histoire explore la transition, la perte et la résilience à travers les yeux d'un enfant...

"Miss Brill" - Une femme observe les gens dans un parc et se projette dans leurs vies, jusqu'à ce qu'une remarque cruelle et soudaine la confronte à sa propre solitude...
"Comme elle adorait rester assise dans ce jardin à tout observer. On aurait dit une pièce de théâtre, oui, tout à fait. Qui aurait pu croire que le ciel, dans le fond, n’était pas un décor ?
Mais Miss Brill ne découvrit pas aussitôt ce qui rendait la chose si passionnante ; ce fut seulement quand un petit chien brun fit son entrée en trottinant avec solennité, puis sortit lentement de même, comme un petit chien qui joue la comédie, un petit chien sous l’action de quelque stupéfiant. Elle s’aperçut alors que tout le monde était en scène. Ces gens n’étaient pas simplement le public, les spectateurs ; ils jouaient aussi. Elle-même avait un rôle et le répétait chaque dimanche. Sans doute, on aurait remarqué son absence, si elle n’avait pas été là ; elle faisait partie de la représentation, en somme. Que c’était singulier qu’elle n’y eût jamais songé auparavant ! Et pourtant ce fait-là expliquait pourquoi elle tenait tant à partir de chez elle ponctuellement, à la même heure, chaque semaine – de façon à ne pas être en retard pour la pièce. Il justifiait aussi l’étrange timidité qu’elle éprouvait à raconter à ses élèves anglaises l’emploi de ses après-midi de dimanche. Ce n’était pas étonnant ! Miss Brill faillit éclater de rire. Elle était donc une actrice ! ..."
"La Leçon de chant" (The Singing Lesson) - Miss Meadows, une jeune femme célibataire, commence sa journée dans un état de profonde tristesse après avoir reçu une lettre de son fiancé, Basil, mettant fin à leurs fiançailles. Mais elle doit malgré tout assurer ses leçons de chant. L`auteur éprouvera toujours pour la vie médiocre tant subies par certaines femmes une affectueuse compréhension... "Sans regarder personne, ses yeux parcoururent cette mer de blouses de couleur, qui ballottait des visages et des mains roses, de grands nœuds de ruban palpitants, des cahiers de musique étalés. Elle savait fort bien ce que pensaient les enfants ..."(.. and, looking at nobody, her glance swept over that sea of coloured flannel blouses, with bobbing pink faces and hands, quivering butterfly hair-bows, and music-books outspread. She knew perfectly well what they were thinking..)
"Bank Holiday" (Jour Férié), peinture impressionniste de différents personnages appartenant à des groupes divers et différentes classes sociales un jour de congé, en Angleterre ... "C’est un jour qui vole à tire-d’aile, moitié soleil, moitié vent. Quand le soleil se cache, une ombre plane ; quand il se montre de nouveau, il est ardent. Hommes et femmes le sentent leur brûler le dos, la poitrine, les bras ; ils ont l’impression que leurs corps se dilatent, prennent vie… si bien qu’ils font de grands gestes avides, lèvent en l’air des bras pour un rien, enlacent brusquement les filles, éclatent en rires soudains..." (It is a flying day, half sun, half wind. When the sun goes in a shadow flies over; when it comes out again it is fiery. The men and women feel it burning their backs, their breasts and their arms; they feel their bodies expanding, coming alive... so that they make large embracing gestures, lift up their arms, for nothing, swoop down on a girl, blurt into laughter...)
"An Ideal Family" (Une famille idéale), M. Neave, homme d'affaires prospère et patriarche d’une famille aisée, se prépare à rentrer chez lui après une journée de travail. Déjà âgé, il commence à sentir le poids des années et observe avec une certaine amertume les changements dans sa vie et autour de lui, notamment combien il se sent étranger parmi les siens, chacun vit ici sa propre vie ...
"Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, en repoussant le double battant de la porte et en descendant les trois larges marches vers le trottoir, le vieux M. Neave eut conscience qu’il était trop vieux pour le printemps. Le printemps – tiède, impatient, inquiet – était là ; il l’attendait dans la clarté dorée, prêt, en présence de tous, à l’assaillir, à souffler sur sa barbe blanche, à peser tendrement sur son bras. Et il était incapable de l’affronter, oui ; il ne pouvait plus redresser les épaules, encore une fois, et s’en aller à grands pas, crâne comme un jeune homme. Il était las et, bien que le soleil du soir brillât encore, il se sentait tout engourdi. Brusquement, l’énergie lui faisait défaut, le cœur lui manquait pour supporter davantage cette gaieté, cette agitation joyeuse ; il en était troublé. Il aurait voulu rester immobile, écarter tout cela d’un geste de sa canne, dire : « Allez-vous-en ! » Tout à coup, il lui en coûtait un effort terrible de saluer comme de coutume, en touchant son large feutre plat du bout de sa canne, tous les gens qu’il connaissait, amis, relations, fournisseurs, facteurs, cochers. Mais le regard animé qui accompagnait le salut, la petite lueur cordiale qui semblait dire : « Je suis de force à vous voir venir, tous tant que vous êtes ! » voilà ce que le vieux M. Neave ne pouvait plus trouver. Il s’en alla pesamment, levant haut les genoux, comme s’il avançait à travers un air devenu, en quelque sorte, compact et lourd comme de l’eau. Et la foule passait près de lui, rapide, chacun rentrant chez soi ; les trams filaient avec un cliquetis métallique, les charrettes légères cahotaient à grand bruit, les gros fiacres roulaient en oscillant, avec cette indifférence téméraire et provocante qui n’appartient qu’aux choses vues en rêve…"
"The Lady's Maid" (La femme de chambre), le monologue d'une femme de chambre, Ellen, au service d’une vieille dame riche et malade, qui parle de sa vie, de son immense dévotion envers sa maîtresse et des choix qu’elle a faits au fil des ans et qui se révèlent être de lourds sacrifices ...
Chacune de ces nouvelles est faite de petits épisodes caractéristiques destinés à mettre en lumière. avec grâce et délicatesse. mais aussi avec une certaine cruauté, la vie secrète des personnages : et c`est tout l'art de Katherine Mansfield. (Trad.Stock. 1932).

Mansfield passe ses dernières années à chercher des remèdes de moins en moins conventionnels à sa tuberculose. En février 1922, elle consulte le médecin russe Ivan Manoukhin. Son traitement « révolutionnaire », qui consiste à bombarder la rate de rayons X, provoque chez Mansfield des bouffées de chaleur et un engourdissement des jambes. Alors qu'elle se sent proche de la mort, Mansfield se concentre sur sa vie spirituelle. En octobre 1922, elle s'installe à l'Institut "pour le développement harmonieux de l'homme" de Georges Gurdjieff à Fontainebleau, en France, où elle est suivie par Olgivanna Lazovitch Hinzenburg. Malheureusement, l'auteur est victime d'une hémorragie pulmonaire fatale en janvier 1923, après avoir monté un escalier en courant pour montrer à Murry à quel point elle se sentait bien. Elle meurt le 9 janvier et est enterrée dans un cimetière du quartier de Fontainebleau, dans la ville d'Avon.
Mansfield s'est révélée être un écrivain prolifique dans les dernières années de sa vie, et une grande partie de sa prose et de sa poésie n'a pas été publiée à sa mort. Murry se chargea d'éditer et de publier ses œuvres, publiant son quatrième recueil, « The Dove's Nest and Other Stories », en 1923, suivi d'un cinquième et dernier recueil en 1924, sous le titre « Something Childish and Other Stories » ....

"The Dove’s Nest and Other Stories" (Le Nid de colombes, 1923)
Recueil comportant une dizaine de nouvelles dont "The Dove’s Nest ", inachevé, émoi d'une assemblée de femmes dans laquelle surgit un homme inconnu, "The Doll’s House" (La maison de poupées, 1922), étude délicate de l'âme adolescente, "A Married Man's Story", "The Fly", évocation de sa fille morte par un vieillard, "A Cup of Tea", jeu subtil d'équilibre de la vie conjugale, "The Canary", "Six years after", où une mère ne se résout pas à la mort de son enfant..
"A Cup of Tea" - Rosemary Fell est une jeune femme riche, sophistiquée et un peu égocentrique. Elle aime fréquenter les magasins de luxe et est influencée par les tendances littéraires et artistiques de son époque. Un après-midi, alors qu’elle sort d’une boutique où elle a envisagé d’acheter un objet coûteux, elle rencontre une jeune femme pauvre qui lui demande de l'argent pour acheter de la nourriture. Se sentant inspirée par quelques idées de charité et peut-être par une envie de faire quelque chose de "romantique", elle décide d’inviter la jeune femme chez elle pour lui offrir du thé et de l’aide. Cette décision semble également motivée par un désir de vivre une situation dramatique, presque littéraire, digne des romans qu’elle lit. De retour chez elle, Rosemary installe la jeune femme dans son salon luxueux. Mais bientôt, son mari, Philip, entre et s’étonne de voir cette invitée inhabituelle. Il ne critique pas ouvertement l'acte de charité de Rosemary, mais il fait un commentaire sur la beauté de la jeune femme, ce qui provoque une jalousie immédiate chez Rosemary. Se sentant menacée par la présence de cette femme qu’elle voulait initialement aider, Rosemary change brusquement d’attitude. Elle donne un peu d’argent à la jeune femme et la congédie rapidement. L’histoire se termine sur une note ironique, avec Rosemary demandant à son mari s’il la trouve jolie ...
"A Cup of Tea - Rosemary Fell was not exactly beautiful. No, you couldn't have called her beautiful. Pretty? Well, if you took her to pieces... But why be so cruel as to take anyone to pieces? She was young, brilliant, extremely modem, exquisitely well dressed, amazingly well read in the newest of the new books, and her parties were the most delicious mixture of the really important people and... artists - quaint creatures, discoveries of hers, some of them too terrifying for words, but others quite presentable and amusing.
Rosemary had been married two years. She had a duck of a boy. No, not Peter - Michael. And her husband absolutely adored her. They were rich, really rich, not just comfortably well off, which is odious and stuffy and sounds like one's grandparents. But if Rosemary wanted to shop she would go to Paris as you and I would go to Bond Street. If she wanted to buy flowers, the car pulled up at that perfect shop in Regent Street, and Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way, and said: "I want those and those and those. Give me four bunches of those. And that jar of roses. Yes, I'll have all the roses in the jar. No, no lilac. I hate lilac. It's got no shape." The attendant bowed and put the lilac out of sight, as though this was only too true; lilac was dreadfully shapeless. "Give me those stumpy little tulips. Those red and white ones." And she was followed to the car by a thin shop-girl staggering under an immense white paper armful that looked like a baby in long clothes....
One winter afternoon she had been buying something in a little antique shop in Curzon Street. It was a shop she liked. For one thing, one usually had it to oneself. And then the man who kept it was ridiculously fond of serving her. He beamed whenever she came in. He clasped his hands; he was so gratified he could scarcely speak. Flattery, of course. All the same, there was something...
"You see, madam," he would explain in his low respectful tones, "I love my things. I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them, who has not that fine feeling which is so rare..." And, breathing deeply, he unrolled a tiny square of blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale finger-tips. To-day it was a little box. He had been keeping it for her. He had shown it to nobody as yet. An exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream. On the lid a minute creature stood under a flowery tree, and a more minute creature still had her arms round his neck. Her hat, really no bigger than a geranium petal, hung from a branch; it had green ribbons.
And there was a pink cloud like a watchful cherub floating above their heads. Rosemary took her hands out of her long gloves. She always took off her gloves to examine such things. Yes, she liked it very much. She loved it; it was a great duck. She must have it. And, turning the creamy box, opening and shutting it, she couldn't help noticing how charming her hands were against the blue velvet. The shopman, in some dim cavern of his mind, may have dared to think so too. For he took a pencil, leant over the counter, and his pale, bloodless fingers crept timidly towards those rosy, flashing ones, as he murmured gently: "If I may venture to point out to madam, the flowers on the little lady's bodice....."
"Rosemary Fell n'etait pas précisément belle. Non, belle n'était pas le mot. Jolie? Ma foi ! à l'examiner en détail... Mais à quoi bon cette cruauté ? Elle était jeune, brillante, extrêmement moderne, mise avec un goût exquis, étonnamment au courant des plus nouveaux d'entre les nouveaux livres et ses réunions étaient le plus délicieux mélange de
gens vraiment importants et d'artistes - étranges créatures, des découvertes à elle, certains d'entre eux terrifiants au-delà de toute expression, mais d'autres tout à fait présentables et amusants. Rosemary était mariée depuis deux ans. Elle avait un amour de garçon. Non, pas Pierre, Michel. Son mari l'adorait littéralement. Ils étaient riches, vraiment riches, pas seulement dans l'aisance, ce qui est odieux, étouffant et vous donne l'impression de vivre comme vos grands-parents. Si Rosemary voulait faire des courses, elle allait à Paris comme nous allons à Bond Street. Si elle voulait acheter des fleurs, l'auto s'arrêtait devant cet admirable magasin de Regent Street; Rosemary entrait, elle promenait simplement autour d'elle son regard ébloui, selon ses manières un peu exotiques, et elle disait : "je veux celles-ci et celles-ci et celles-ci. Donnez-moi quatre gerbes de celles-ci et ce vase de roses. Oui je prends toutes les roses qui sont dans ce vase. Non, pas de lilas. je déteste le lilas. Cela n'a pas de forme."
La demoiselle s'inclinait et faisait disparaître les lilas comme pour confirmer la justesse de cette remarque; le lilas n'est-il pas, en vérité, terriblement informe ? "Donnez-moi ces petites tulipes trapues. Ces rouges et blanches." Et elle regagnait sa voiture, suivie d'une mince jeune fille qui chancelait sous une immense brassée de papier blanc, semblable à un bébé dans ses longues robes...
Un soir d'hiver, elle avait acheté quelque chose dans un petit magasin d'antiquités de Curzon Street. Elle aimait cette boutique. D'abord, on y était généralement seul. Et puis, le marchand adorait la servir; il en était ridicule. Toutes les fois qu'elle entrait, son visage s'épanouissait. Il joignait les mains, il était si charmé qu'il pouvait à peine parler. Flatterie, naturellement! Pourtant, il y avait là quelque chose...
- "Voyez-vous, Madame, lui expliquait-il avec des intonations graves, respectueuses, j'aime mes objets. Je préférerais ne pas m'en séparer plutôt que de les vendre à qui ne les apprécierait pas, à qui ne posséderait pas ce sentiment délicat, si rare..."
Et, respirant profondément, il déroulait un petit carré de velours bleu et le pressait du bout de ses doigts pâles contre la glace du comptoir. Ce jour-là, c'était une bonbonnière. Il l'avait gardée pour elle. Il ne l'avait encore montrée à personne. Une exquise bonbonnière recouverte d'émaux ; le vernis en était si délicat qu'on l'eût dite cuite dans la crème. Sur le couvercle, on voyait un minuscule personnage debout sous un arbre en fleurs ; un autre, plus minuscule encore, lui enlaçait le cou de ses bras. Son chapeau, pas plus gros qu'un pétale de géranium, pendait à une branche; il avait des rubans verts. Et un nuage rose, comme un chérubin protecteur, flottait au-dessus de leurs têtes. Rosemary sortit ses mains de ses longs gants. Elle retirait toujours ses gants pour examiner de tels objets. Oui, cette bonbonnière lui plaisait beaucoup. Elle l'aimait ; c'était un vrai bijou. Elle la voulait. Tout en maniant l'objet aux reflets de crème, l'ouvrant, le refermant, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer combien ses mains étaient jolies contre le velours bleu. Le marchand, dans quelque sombre caverne de son âme, osait peut-être concevoir la même pensée ; car il prit un crayon, se pencha sur le comptoir, et ses doigts pâles, exsangues, se glissèrent timidement vers les doigts roses, éblouissants; il chuchota :
"Puis-je me permettre de faire remarquer à Madame les fleurs, sur le corsage de la petite dame ?..."

"The Doll’s House" (La maison de poupées, 1922) est un nouveau recueil de nouvelles publié en 1922, avec pour héros, des enfants, encore préservés du tragique et de l'ironie d'une vie à laquelle l'auteur refuse les explications "après-coup" et l'échappatoire d'un au-delà. La nouvelle qui donne son titre au recueil conte la joie et la folle excitation de tous les gosses d'une école villageoise, au moment où les enfants Burnell reçoivent une grande maison de poupée et permettent à leurs camarades de venir la contempler. Sont seules exclues de ces réjouissances Lil et Else, les filles de la blanchisseuse, car le père est en prison et il est interdit de leur parler. Kezia Burnell (personnage peut-être autobiographique qui paraît dans d'autres nouvelles) décide de désobéir et fait venir en cachette les pauvres petites ; mais quelqu'un les surprend, et chasse les deux infortunées dont la seule ressource est de s'enfuir avec le souvenir d'une merveilleuse vision.
"The Dove’s Nest" (Le Nid de Colombes), inachevé, Milly et sa mère, Mme Travers, séjournent dans une villa en Italie pour permettre à Milly, souffrant d’une maladie incurable, de bénéficier d’un climat plus clément. La nouvelle s’ouvre sur une description sereine de leur environnement, qui contraste avec l’état physique fragile de Milly et les inquiétudes de sa mère. Milly, bien que malade, montre un désir ardent de vivre pleinement le peu de temps qui lui reste, et s'intéresse à la vie autour d’elle, notamment aux oiseaux qui nichent près de leur villa, en particulier des colombes qui symbolisent à la fois la paix et la fugacité de la vie. Mme Travers, quant à elle, est rongée par l’inquiétude pour sa fille. Elle oscille entre son rôle de mère protectrice et son désir d’offrir à Milly une vie aussi normale et joyeuse que possible malgré la maladie. La dynamique entre les deux femmes révèle une tension : Milly souhaite échapper à la protection étouffante de sa mère pour vivre des expériences authentiques, tandis que Mme Travers est paralysée par sa peur de perdre sa fille. La nouvelle est marquée par des moments de douceur et de mélancolie, alors que les deux femmes s’efforcent de trouver un équilibre entre la joie de vivre et la conscience constante de la mort ...
Katherine Mansfield tire tout son pouvoir d'attraction, et même de fascination, d`une sensibilité extrême qui pénètre les secrets du monde quotidien, y découvre un côté tragique et l'expose avec une impassibilité volontaire, mais qui tourne à une tristesse insolite et oppressante...

"Journal of Katherine Mansfield"
Publié pour la première fois en 1927 par son mari John Middleton Murry qui rassembla, de façon un peu arbitraire, des matériaux choisis, et en 1954 publia une édition appelée définitive du "Journal". Une édition complète du "Journal" est parue en 1973. Ce journal comprend la période qui va de 1914 à 1922; Katherine Mansfield avait détruit elle-même la partie du journal qui traitait des périodes précédentes. Loin d'être d'une narration continue, le journal est plutôt un recueil de notes, de brèves impressions, de pensées, de rêves, de jugements et de remarques que l`auteur développera plus tard dans ses nouvelles. Pour Katherine Mansfield, douée d'une sensibilité extrême, chaque fait et chaque scène de la vie quotidienne, si insignifiant soient-ils, acquièrent de l'importance. Nulle convention chez elle : partout elle note avec simplicité ce qu'elle éprouve, sans se préoccuper du lecteur. Déjà malade lors de la rédaction du "Journal", elle donne libre cours à son angoisse devant cette mort qui l'empêchera d'achever son œuvre.
Pendant ses dernières années, elle souffre atrocement : seule l'écriture peut l`apaiser. Son travail alors lui apparaît comme le but suprême de sa vie, et son seul bonheur; comme un devoir moral et presque mystique. Il faut, avant d'écrire, se sentir pur, calme et bon; il faut apprendre à oublier sa propre personnalité. Cependant, la fatigue et la nervosité s'emparent de l'auteur, et elle s'en plaint amèrement, se promettant d'être meilleure et plus forte. Souvent Mansfield rêve de sa patrie lointaine, la Nouvelle-Zélande, et l'évoque avec émotion.
En 1915, son frère cadet, Chummie, lui rend visite à Londres pendant quelques semaines ; avant de partir pour le front où il trouvera la mort. Le coup est terrible pour elle. Ce qui la soutient dans la douleur est le désir, d`évoquer à nouveau leur enfance commune, si chargée de souvenirs heureux. C'est de ces souvenirs dont seront saturés ses deux récits intitulés "Sur la baie" (At the Bay) et "Prélude" (Prelude), ainsi que d'autres nouvelles de moindre importance; Katherine Mansfield avait en outre l'íntention de composer un roman sur le même sujet, mais elle n'arrivera pas à réaliser son désir, et c'est seulement dans le "Journal" que nous pouvons en trouver les traces. C'est ainsi que le "Journal" de Katherine Mansfield est plus qu'un simple document sur sa vie, une véritable œuvre d'art ...
