- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch

Dino Buzzati (1906-1972), "Il deserto del Tartari" (Le Désert des Tartares, 1940), "Le K" (Il colombre e altri cinquanta racconti", 1966) - Cesare Pavese (1908-1950), "Le Bel Été" (La bella estate, 1941), " La spiaggia" (1941),"La Lune et les feux" (La luna e i falò, 1950) - ...
Last Update: 11/11/2016
Italo Calvino, dans la préface de son premier roman, "Le Chemin des nids d'araignée" (Il sentiero dei nidi di ragno, 1964) explique que le néoréalisme n'est pas une école, mais un "ensemble de voix" parlant une Italie multiple, silencieuse jusque-là ("non fu una scuola, ma un insieme di voci, in gran parte periferiche, una molteplice scoperta delle diverse Italie, specialmente delle Italie fino allora più sconosciute dalla letteratura"). Et c'est au lendemain de la guerre, guerre civile et guerre mondiale, que tout un chacun entend "faire entendre son existence" ("L'essere usciti da un'esperienza - guerra, guerra civile - che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un'immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie da raccontare, ognuno aveva la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava le parole di bocca").

Cesare Pavese et Dino Buzzati écrivent tous deux pendant le fascisme finissant, la guerre, puis l’Occupation et la libération.
Et c'est un bien mystérieux roman que publie Dino Buzzati alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, autant mystérieux qu'inquiétant ....
Les soldats d'une garnison attendent d'un jour à l'autre l'attaque de l'ennemi tartare, qui doit provenir du Nord. La forteresse où se déroule l'action appartient a un passé vague. Située au pied de rudes montagnes inaccessibles, au bord d'un désert caillouteux, elle est suspendue entre rêve et réalité. Les soldats se préparent constamment à cette attaque même si nul ne sait quand et comment elle aura lieu. Personne non plus ne connaît réellement l'ennemi. C'est le destin qui guide ces vies, dont celle du lieutenant Drogio qui se trouve là contre son gré, après un voyage épuisant assombri par l'énigmatique forteresse et par la dureté menaçante du paysage. Dans l'atmosphère surréaliste de la garnison, la vie est régie par une stricte routine militaire. Des sentinelles patrouillent on ne sait quoi pour défendre la forteresse d'on ne sait qui. Les manoeuvres militaires sont dépourvues de tout sens apparent, tandis que la vie irréelle des soldats est dominée par une attente absurde. Mais "chacun doit remplir son devoir", peu importe sa consistance ou son absence de consistance...
Si le message est simple, convenons que le roman imprègne néanmoins notre imagination, ne serait-ce que parce qu'au fond l’auteur a façonné une histoire fantôme hantée par les esprits les plus troublants de tous, nos propres attentes...
Alors que les héros de Dino Buzzati sont totalement perdus dans une attente tant inexpliquée qu'inexplicable, incapables de saisir leur destin et prisonniers d’un monde absurde, la solitude est au centre de toute l'œuvre (La lune et les feux, Dialogues avec Leuco, Le métier de vivre) de Cesare Pavese : ses personnages sont souvent incapables de se relier aux autres ou à leur propre terre. Tous deux ont une conscience aiguë d’un temps irréversible, souvent exprimé en terme de mélancolie et d’impuissance. Tous deux sont la proie du même sentiment tragique de ne jamais atteindre ce qu’on désire vraiment : Pavese cherche un « sens » dans le mythe, la femme, la nature, mais en vain, tandis que les personnages de Buzzati poursuivent un horizon qu'on ne peut espérer atteinde (le désert, la mer, le sud infini).
Restent le registre narratif et la tonalité qui les distinguent, Pavese est plus réaliste, proche du quotidien, très ancré dans le social, Buzzati, plus allégorique, symbolique, proche de ce « fantastique métaphysique » qu'on lui imposé dans la littérature italienne.

Dino Buzzati (1906-1972)
Dino Buzzati est l’un des conteurs les plus séduisants du XXe siècle : ses fictions sont un croisement entre Kafka et les frères Grimm, des fables et des fantasmes anxieux, enchanteurs, étranges, et notamment par leur matière-de-factualité (l’auteur a passé sa vie à écrire au Corriere della Sera, le principal journal de Milan). Dans un de ses contes, un ascenseur descend, descend, descend, ne s’écrase pas, ne s’arrête pas; dans un autre, les poches d’une veste se remplissent miraculeusement — et malicieusement — de l’argent des autres; dans un troisième, un immense poing apparaît dans le ciel un matin (« C’était Dieu, et la fin du monde »)...
Ecrivain, journaliste et, accessoirement, peintre, né à Belluno, dans le Frioul, l'une des régions les plus secrètes de l'Italie du Nord avec ses montagnes abruptes et une certaine autonomie de l'idiome et des sentiments -, l'histoire de Dino Buzzati est double.
Pour le public italien, il est dès l'abord un journaliste, entré de bonne heure au Corriere della Sera, le plus grand quotidien de la péninsule, débutant par une rubrique des faits divers les plus variés pour se signaler par des reportages de plus en lus et marqués par l`ange du bizarre, auxquels il demeurera fidèle jusqu'à la fin de sa vie - le goût du baroque et d'un certain fantastique le portera à décrire le métro de Milan en construction, tout en y poursuivant le diable, ou encore à raconter par le menu une visite de l'intérieur du corps humain...
Mais il est aussi l'un des maillons atypiques de cette chaîne d'auteurs et d'artistes qui contribue à ce que l'on nomme de part le monde le "réalisme magique", le versant italien est est composé d'écrivains tels que Alberto Savinio (1891-1952), Massimo Bontempelli (1878-1960) ou Tommaso Landolfi (1908-1979), ici les faits-divers du quotidien basculent dans l'étrange, l'imprévu, l'humour noir, les effets de surprise nous induisent sans cesse à méditer sur l'inquiétude existentielle, la peur du vide, la démesure du temps ...
Deux récits marquent ces débuts, "Burnabo des montagnes" (1933) et "Le Secret du bosco Vecchio" (Il segreto del Bosco Vecchio, 1935), dans lesquels Buzzati se révèle d'ores et déjà tel qu`en lui-même, dans sa personnalité dolomitique. On aura par la suite souvent tendance à rapprocher Buzzati de Kafka, mais si le monde de l'écrivain Tchèque est clos, celui de Buzzati est un monde de hauteurs, de mirages, d'attente perpétuelle d'une communication. L'impression d'un malaise ambiant ou le déni de tout espoir se retrouve certes dans son chef-d'œuvre, "Le Désert des Tartares" (1940) : épopée d'une attente chimérique, où se reflète la stagnation des garnisons libyennes que Buzzati avait connues par ses reportages, mais aussi la vaine et interminable extase de quelque autre Barnabo des montagnes... C`est à partir de ce livre que Buzzati, désormais assuré de ses moyens (un style net, le baroque naissant non des fioritures mais de la luxuriance de l'inventivité), que l'auteur se livre totalement, au vent de la fantaisie, mais sous le signe d'une angoisse constante : ce sera la suite de ses contes, qui va des "Set Messagers" (Settemessaggeri, 1941), à l' "Ecroulement de la Baliverna" (1954), des "Sessanta raconti" (1958) à "L'image de pierre", et aux nouvelles en gestation publiées sous le titre "En ce moment précis" (1963), le "K" (1966), les "Nuits difficiles" (1971)...
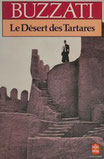
"Il deserto del Tartari" (Le Désert des Tartares, 1940)
" Ce fut un matin de septembre que Giovanni Drogo, qui venait d’être promu officier, quitta la ville pour se rendre au fort Bastiani, sa première affectation. Il faisait encore nuit quand on le réveilla et qu’il endossa pour la première fois son uniforme de lieutenant. Une fois habillé, il se regarda dans la glace, à la lueur d’une lampe à pétrole, mais sans éprouver la joie qu’il avait espérée. Dans la maison régnait un grand silence, rompu seulement par les petits bruits qui venaient de la chambre voisine, où sa mère était en train de se lever pour lui dire adieu. C’était là le jour qu’il attendait depuis des années, le commencement de sa vraie vie. ..."
C'est un roman qui fait tourner la plus simple des intrigues dans l’esprit du lecteur comme une présence inhabituellement persistante et interrogative. Un jeune officier militaire, Giovanni Drogo, affecté à un avant-poste éloigné aux confins d’un empire indéfini, passe sa vie sur des remparts surplombant un désert, en attendant l’invasion des légendaires Tartares, une attaque qui fournira tant à lui qu'à ses compagnons un moment de gloire sans équivalent en ce monde. Mais, à travers des années et des décennies d’attente, à investir son espoir dans le moindre scintillement de lumière à l’horizon, à dépenser sa vitalité à suivre les routines rigoureuses et à élaborer des précautions de mot de passe du fort isolé, les Tartares ne viennent jamais. Alors que les amis du soldat à la maison se marient, élèvent des enfants et mènent des vies plus ou moins épanouissantes, l’existence même de Drogo ne semble pouvoir jamais débuter : et la promesse de ses jours sombre dans un suspense implacable mais de plus en plus futile...
XI - Quasi due anni dopo Giovanni Drogo dormiva una notte nella sua camera della Fortezza. Ventidue mesi erano passati senza portare niente di nuovo e lui era rimasto fermo ad aspettare, come se la vita dovesse avere per lui una speciale indulgenza. Eppure ventidue mesi sono lunghi e possono succedere molte cose: c'è tempo perché si formino nuove famiglie, nascano bambini e incomincino anche a parlare, perché una grande casa sorga dove prima c'era soltanto prato, perché una bella donna invecchi e nessuno più la desideri, perché una malattia, anche delle più lunghe, si prepari (e intanto l'uomo continua a vivere spensierato), consumi lentamente il corpo, si ritiri per brevi parvenze di guarigione, riprenda più dal fondo, succhiando le ultime speranze, rimane ancora tempo perché il morto sia sepolto e dimenticato, perché il figlio sia di nuovo capace di ridere e alla sera conduca le ragazze nei viali, inconsapevole, lungo le cancellate del cimitero.
XI - Une nuit, presque deux ans plus tard, Giovanni Drogo dormait dans sa chambre du fort. Vingt-deux mois avaient passé sans rien apporter de neuf et il était resté ferme dans son attente, comme si la vie eût dû avoir pour lui une indulgence particulière. Et pourtant, c’est long vingt-deux mois, et bien des choses peuvent arriver : vingt-deux mois suffisent pour fonder de nouvelles familles, pour que naissent des enfants et qu’ils commencent même à parler, pour que s’élève une grande maison là où il n’y avait que de l’herbe, pour qu’une jolie femme vieillisse et ne soit plus désirée par personne, pour qu’une maladie, même l’une des plus longues, se prépare (et, pendant ce temps, l’homme continue de vivre, sans soucis), consume lentement le corps, se retire, laissant croire pendant un temps bref à la guérison, reprenne plus profondément, rognant les derniers espoirs, et il reste encore du temps pour que le mort soit enseveli et oublié, pour que son fils soit de nouveau capable de rire et, le soir, se promène par les avenues avec des jeunes filles ingénues, le long des grilles du cimetière.
L'esistenza di Drogo invece si era come fermata. La stessa giornata, con le identiche cose, si era ripetuta centinaia di volte senza fare un passo innanzi. Il fiume del tempo passava sopra la Fortezza, screpolava le mura, trascinava in basso polvere e frammenti di pietra, limava gli, scalini e le catene, ma su Drogo passava invano; non era ancora riuscito ad agganciarlo nella sua fuga.
Anche quella notte sarebbe stata uguale a tutte le altre se Drogo non avesse fatto un sogno. Egli era tornato bambino e si trovava di notte al davanzale di una finestra.
L’existence de Drogo, au contraire, s’était comme arrêtée. La même journée, avec ses événements identiques, s’était répétée des centaines de fois sans faire un pas en avant. Le fleuve du temps passait sur le fort, lézardait les murs, charriait de la poussière et des fragments de pierre, limait les marches et les chaînes, mais sur Drogo il passait en vain ; il n’avait pas encore réussi à l’entraîner dans sa fuite. Cette nuit aussi eût été semblable à toutes les autres si Drogo n’avait pas fait un rêve. Il était redevenu enfant et se trouvait, en pleine nuit, devant une fenêtre.
Par delà un profond renfoncement de la maison, il voyait la façade d’un somptueux palais illuminé par la lune. Et l’attention de Drogo enfant était attirée tout entière vers une étroite fenêtre haut placée, surmontée par un baldaquin de marbre. La lune, pénétrant par les vitres, allait frapper une table sur laquelle il y avait un tapis, un vase et des statuettes d’ivoire. Et ces quelques objets que l’on pouvait voir donnaient à imaginer que, derrière, dans l’obscurité, s’ouvrait l’intimité d’un vaste salon, le premier d’une interminable série, tous pleins de choses précieuses, et que le palais tout entier dormait, de ce sommeil absolu et provocant que connaissent les demeures des gens riches et heureux. Quelle joie – pensa Drogo – que de pouvoir vivre dans ces salons, de pouvoir s’y promener pendant des heures, découvrant toujours de nouveaux trésors.
Cependant, entre la fenêtre à laquelle il se penchait et le merveilleux palais – un intervalle d’une vingtaine de mètres – s’étaient mises à flotter des formes fragiles, pareilles peut-être à des fées, qui traînaient derrière elles de longs voiles, que la lune faisait chatoyer.
Dans le sommeil, la présence de semblables créatures, telles qu’il n’en avait jamais vu dans le monde réel, n’étonnait pas Giovanni. Elles ondulaient dans l’air en de lents tourbillons, effleurant avec insistance la jolie fenêtre.
A cause de leur nature même, elles semblaient appartenir logiquement au palais, mais le fait qu’elles ne prêtassent aucune attention à Drogo, ne s’approchant jamais de sa maison, mortifiait celui-ci. Ainsi même les fées fuyaient les enfants ordinaires pour s’occuper seulement des gens fortunés qui, eux, ne les regardaient même pas, mais dormaient, indifférents, sous des baldaquins de soie ?
« Psst… psst…», fit timidement Drogo deux ou trois fois, pour attirer l’attention des fantômes, tout en sachant bien néanmoins, au fond de son cœur, que ce serait inutile. Aucun d’eux, en effet, ne parut entendre, aucun d’eux ne s’approcha, même d’un mètre, de sa fenêtre.
Mais voici qu’une de ces créatures magiques s’accroche au rebord de la fenêtre d’en face, avec une sorte de bras, et frappe discrètement au carreau, comme pour appeler quelqu’un.
Il ne se passa que quelques instants avant qu’une frêle silhouette, oh ! combien petite comparée à la monumentale fenêtre, apparût derrière les vitres, et Drogo reconnut Angustina, lui aussi enfant.
Angustina, d’une pâleur impressionnante, portait un costume de velours, au col de dentelle blanche, et il n’avait pas du tout l’air content de cette sérénade silencieuse.
Drogo pensa que son camarade allait l’inviter, ne fût-ce que par politesse, à jouer avec les fantômes. Mais il n’en fut pas ainsi. Angustina ne sembla pas remarquer son ami et, lorsque Giovanni appela « Angustina ! Angustina ! », il ne tourna même pas les yeux vers lui. Au lieu de cela, Angustina, d’un geste las, ouvrit la fenêtre et se pencha vers l’esprit accroché au rebord de la fenêtre, comme s’il était très intime avec lui et comme s’il voulait lui dire quelque chose. L’esprit fit un signe et, suivant la direction de ce geste, Drogo tourna les yeux vers une grande place, absolument déserte, qui s’étendait devant les maisons. Sur cette place, à une dizaine de mètres du sol, avançait dans l’air un mince cortège d’autres esprits qui traînaient un petit palanquin. Apparemment de la même essence qu’eux, le petit palanquin était débordant de voiles et de panaches. Angustina, avec sa caractéristique expression d’indifférence et d’ennui, le regardait s’avancer ; il était évident que le petit palanquin lui était destiné.
L’injustice meurtrissait le cœur de Drogo. Pourquoi tout pour Angustina et rien pour lui ? Pour un autre encore, oui, mais justement pour Angustina, toujours si fier et arrogant ! Drogo regarda les autres fenêtres pour voir s’il y avait quelqu’un qui pût éventuellement prendre son parti, mais il ne parvint à découvrir personne.
Finalement, le petit palanquin s’arrêta, se balançant juste devant la fenêtre, et, d’un bond, tous les fantômes se juchèrent autour de lui, formant une palpitante couronne ; ils étaient tous tournés vers Angustina, non plus obséquieux, mais avec une curiosité avide et presque méchante. Abandonné à lui-même, le petit palanquin demeurait en l’air, comme accroché à d’invisibles fils.
D’un coup, toute jalousie abandonna Drogo, car il comprit ce qui était en train de se passer. Il voyait Angustina à la fenêtre, tout droit, les yeux fixés sur le petit palanquin. Oui, les messagers des fées étaient venus à lui, cette nuit-là, mais pour quelle ambassade ! C’était donc à un long voyage que devait servir le petit palanquin, et il ne serait de retour ni avant l’aube, ni la nuit suivante, ni celle d’après, ni jamais. Les salons du palais attendraient en vain leur petit maître, deux mains de femmes refermeraient avec précaution la fenêtre laissée ouverte par le fugitif et toutes les autres fenêtres aussi seraient closes pour abriter dans l’ombre les pleurs et la désolation.
Les fantômes, naguère aimables, n’étaient donc pas venus jouer avec les rayons de lune, ils n’étaient pas sortis, innocentes créatures, de jardins parfumés, mais ils venaient de l’abîme.
Les autres enfants eussent pleuré, ils eussent appelé leur mère, mais Angustina, lui, n’avait pas peur et conversait placidement avec les esprits, comme pour établir certaines modalités qu’il était nécessaire de préciser. Serrés autour de la fenêtre, semblables à une guirlande d’écume, ils se chevauchaient l’un l’autre, se poussant vers l’enfant, et celui-ci faisait oui de la tête, comme pour dire : bien, bien, tout est parfaitement d’accord. A la fin, l’esprit qui, le premier, avait agrippé l’appui de la fenêtre, peut-être était-ce le chef, fit un petit geste impérieux. Angustina, toujours de son air ennuyé, enjamba l’appui de la fenêtre (il semblait déjà devenu aussi léger que les fantômes) et s’assit dans le petit palanquin, croisant les jambes en grand seigneur. La grappe de fantômes se défit dans un ondoiement de voiles, le véhicule enchanté s’ébranla doucement.
Un cortège se forma, les fantômes firent une évolution semi-circulaire dans le renfoncement des maisons, pour s’élever ensuite dans le ciel, dans la direction de la lune. Pour décrire le demi-cercle, le petit palanquin passa, lui aussi, à quelques mètres de la fenêtre de Drogo, qui, agitant les bras, tenta de crier en un suprême adieu : « Angustina ! Angustina ! »
Son ami mort tourna finalement alors la tête vers Giovanni, le regardant fixement pendant quelques instants, et il sembla à Drogo qu’il lisait dans ses yeux une gravité vraiment excessive chez un enfant aussi petit. Mais le visage d’Angustina s’ouvrait lentement à un sourire de complicité, comme si Drogo et lui pouvaient comprendre bien des choses inconnues aux fantômes ; une ultime envie de plaisanter, la dernière occasion de montrer que lui, Angustina, n’avait besoin de la pitié de personne : « C’est un épisode quelconque, avait-il l’air de dire, il serait vraiment stupide de s’en étonner. »
Emporté par le palanquin, Angustina détacha ses yeux de Drogo et tourna la tête, regardant devant lui, dans la direction du cortège, avec une espèce de curiosité amusée et méfiante. Il avait l’air d’essayer pour la première fois un nouveau jouet auquel il ne tenait pas du tout, mais que, par politesse, il n’avait pu refuser.
Il s’éloigna de la sorte dans la nuit, avec une noblesse presque inhumaine. Il n’eut pas un seul regard pour son palais, ni pour la place qui était en dessous de lui, ni pour les autres maisons, ni pour la ville où il avait vécu. Le cortège avança en serpentant lentement dans le ciel, montant toujours plus haut, il devint une traînée confuse, puis un minuscule panache de brume, puis il disparut.
La fenêtre était restée ouverte, les rayons de la lune illuminaient encore la table, le vase, les statuettes d’ivoire qui avaient continué de dormir. A l’intérieur de cette maison, étendu sur le lit d’une autre chambre, à la lueur tremblotante des cierges, gisait peut-être un petit corps humain privé de vie, dont le visage ressemblait à celui d’Angustina ; et il devait porter un costume de velours au grand col de dentelle, avoir sur ses lèvres pâles et figées un sourire."

Dino Buzzati introduit le fantastique métaphysique dans la littérature italienne, loin du réalisme social alors dominant : et transpose ici l'absurde et l'attente vaine dans un décor militaire allégorique (la forteresse de Bastiani).
D'où lui vient cette inspiration? Né au pied des Dolomites, Buzzati baigne dans des paysages de montagnes écrasantes et de brouillards mystérieux. Cette géographie minérale et silencieuse est devenue la toile de fond de ses récits (Le Désert des Tartares, Les Sept Messagers). Il s'inscrit d'autre part dans la lignée d'Antonio Fogazzaro (Piccolo mondo antico), qui mêlait déjà réalisme et surnaturel, et de D'Annunzio pour sa dimension décadente - mais en épurant le lyrisme. Puis, Buzzati découvre Kafka dans les années 1930. Son influence est flagrante, on retrouve la bureaucratie cauchemardesque du "Château" dans la forteresse Bastiani, et la culpabilité sans faute de son personnage.
On y retrouve de même l'atmosphère de la Peinture Métaphysique, celle de Giorgio de Chirico et de ses places désertes, des ses ombres longues, et de ses architectures inquiétantes (Mélancolie d'une belle journée, 1913) : lui correspondent l'immobilité angoissante des lieux (Le Désert des Tartares) et les objets chargés de mystère (horloges, statues, portes closes). De même Carlo Carrà, ses natures mortes silencieuses et perspectives déformées qui semblent nourrir le surnaturel discret de Buzzati.
Enfin, reporter au Corriere della Sera (40 ans de carrière), Buzzati couvrira des faits divers, procès, catastrophes. Il y puise sa technique littéraire et transpose l'observation clinique du réel dans ses fictions (Un amour, chronique d'une passion destructrice). Des phrases courtes, des détails concrets qui rendent le fantastique crédible. Correspondant en Éthiopie (1939-1940) puis sur le front de l'Adriatique (1942), il y puise l'attente vaine des soldats (Le Désert des Tartares), l'arbitraire de la mort (Le Planétarium, récit de bombardements), la déshumanisation bureaucratique de l'armée. (Traduction Nouvelles, Pavillons - Robert Laffont)
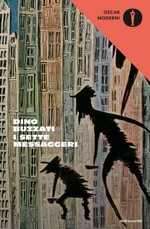
"I sette messaggeri" (1942, 13 nouvelles), "Paura alla Scala" (1949, 11 nouvelles), "Il colombre e altri cinquanta racconti " (1966, 54 nouvelles) et "La boutique del mistero" (1968, anthologie posthume choisie par Buzzati lui-même avant sa mort, 31 nouvelles considérées comme best-of) constituent les recueils originaux des si nombreuses nouvelles écrites par Buzzati (de 90 à 120 nouvelles) ...
Et de plus, Buzzati a publié des dizaines de textes brefs dans des journaux (Corriere della Sera, L’Europeo, etc.) qui n’ont pas été immédiatement inclus dans un recueil, - et qui révèlent tous la diversité de son génie fantastique, réaliste et symbolique...
Mais lorsqu'on aborde les traductions qui en sont faites et les publications réalisées tant en français qu'en anglais, bien des regroupements et des titres associés posent problème de mise en correspondance avec l'oeuvre originale : les éditeurs se chargeant d'adapter à leurs publics respectifs la matière littéraire sans toujours se préoccuper d'être fidèle à l'oeuvre ...
"Les Sept Messagers" (I sette messaggeri, 1942)
Un recueil de nouvelles et chef-d'œuvre du fantastique métaphysique. Buzzati y affine son art de la parabole : des situations banales basculent dans le vertige existentiel. En français, la plupart de ces nouvelles figurent dans "Le K" (1966, éd. Robert Laffont), le grand recueil français qui compile plusieurs recueils italiens ...

"I sette messaggeri" - Dans "Les Sept Messagers", le narrateur, un prince dont on ne connaîtra jamais le nom, entreprend un long voyage vers les confins du royaume hérité de son père. Il veut explorer l’extrémité de son territoire, qu’aucun souverain n’a jamais atteint. Pour garder le contact avec sa ville d’origine, il est accompagné de sept messagers (dont les noms bibliques – Adelmo, Rinaldo, Costantino, etc. – évoquent les anges ou les archétypes de fidèles serviteurs). Ces messagers partent régulièrement à cheval vers la capitale pour y prendre des nouvelles et rapporter la réponse du roi. Mais à mesure que le prince s’enfonce dans le territoire, les distances s’allongent, et les temps de communication s’étirent de manière exponentielle. Il devient de plus en plus difficile pour les messagers de faire l’aller-retour. Finalement, les messages cessent d’arriver : le prince poursuit seul, sans nouvelles, sans lien.
Le récit, très simple en apparence, fonctionne comme une métaphore du destin humain :
- Le voyage est une allégorie de la vie, ou d'une quête intérieure vers un but inconnu (la mort, la vérité, l’absolu).
- Les messagers représentent les liens avec le passé, les souvenirs, les émotions, la mémoire familiale, voire la jeunesse.
- Le fait que les messagers mettent de plus en plus de temps à revenir symbolise la progressive séparation avec son origine, l’éloignement existentiel du monde connu.
Le texte se termine sans résolution explicite. Le prince poursuivra indéfiniment sa quête, désormais irréversiblement isolé..

"Sette piani" (Sept étages)
Un homme entre dans un hôpital et se voit assigner un étage selon la gravité de son état. Il descend progressivement jusqu’au rez-de-chaussée réservé aux mourants, malgré sa conviction initiale qu’il n’est pas vraiment malade. Une métaphore terrifiante sur l’angoisse de la mort et la perte de contrôle.
"... Giuseppe Corte se mit aussitôt au lit et, ayant allumé une petite lampe au-dessus du traversin, entama la lecture d’un livre qu’il avait emporté avec lui. Peu après, une infirmière vint demander s’il n’avait besoin de rien.
Giuseppe Corte n’avait besoin de rien mais il prit plaisir à bavarder avec la jeune femme, la questionnant sur l'établissement. Il en apprit ainsi une étrange particularité : les malades étaient répartis étage par étage en fonction de la gravité de leur cas. Le septième étage, c’est-à-dire le dernier, était réservé aux formes particulièrement bénignes. Le sixième était destiné aux malades peu atteints mais nécessitant toutefois d’être soignés. Au cinquième, on s’occupait d’affections plus importantes et ainsi de suite, d'étage en étage. Au second se trouvaient les malades extrêmement atteints. Au premier, ceux pour lesquels il était inutile d'espérer.
Ce système singulier assouplissait grandement le service, et empêchait en outre qu’un malade léger pût être gêné par le voisinage d’un moribond, garantissant à chaque étage une atmosphère homogène.
D'autre part, on pouvait ainsi graduer les soins de façon parfaite. Il en découlait que les malades se trouvaient divisés en sept castes progressives. Chaque étage était comme un petit monde en soi, avec ses règles particulières, ses traditions. Et comme chaque service était sous les ordres d’un médecin différent, des nuances, aussi minimes fussent-elles mais précises, s'étaient fait jour dans la façon de soigner, bien que le directeur général eût donné à l'institution un unique style fondamental.
Quand l'infirmière fut sortie, Giuseppe Corte, ayant l’impression que sa fièvre était tombée, alla vers la fenêtre et regarda dehors, non pour observer le panorama sur la ville — qui pourtant lui était inconnue — mais dans l’espoir de découvrir, de l’autre côté de leurs propres fenêtres, les malades des étages inférieurs. La structure même de l’immeuble, aux bâtiments en quinconce, permettait ce genre d’observations. Ce fut surtout sur les fenêtres du premier étage que Giuseppe Corte concentra son attention ; mais elles semblaient lointaines et il ne pouvait les voir que de biais. Il ne découvrit rien d’intéressant. Pour la plupart d’ailleurs, elles étaient hermétiquement closes par des persiennes amovibles...."

"Un amore disturbato" (Un amour trouble)
Un homme marié, très respecté, a une liaison avec une jeune femme. Il n’est pas explicitement dit s’il s’agit d’une passion dévastatrice ou d’un simple écart : tout est raconté d’un ton froid, presque clinique. L’homme est profondément troublé non pas tant par l’amour ou le désir, mais par l’obsession mentale que cette liaison provoque. Il devient inquiet, surveille chaque signe, se perd dans ses propres pensées. Ce « trouble » est plus psychologique que charnel : il se sent épié, craint que tout soit découvert, que sa vie respectable s’effondre.
Puis il se rend compte qu’il ne s’agit pas d’amour réel, mais d’une possessivité maladive, d’un vide intérieur qu’il essaie de combler. La nouvelle se termine dans une atmosphère de malaise, sans issue ni délivrance....
"Par suite d’un de ces mouvements de dégoût soudain devant le train-train de la vie quotidienne qui s’empare quelquefois des personnes les plus dénuées de fantaisie, Ubaldo Resera, quarante et un ans, négociant en bois, un soir d’été, décida de rentrer à pied de son bureau par un autre chemin que celui qu’il empruntait habituellement, en passant par un quartier qui lui était à peu près inconnu. Il arrive en effet que l’on habite une vie entière dans la même maison sans jamais pousser plus loin dans des rues ou des places parfois très voisines ; cette proximité enlevant par là même la curiosité de les visiter.
En réalité, à première vue, ce quartier n’avait rien de spécial : sa physionomie d’ensemble ne différait guère des lieux que Resera fréquentait habituellement. Comme il était curieux, ce soir, de voir quelque chose de nouveau, il en fut déçu : les mêmes maisons, les mêmes styles d’architecture, les mêmes petits arbres rabougris le long des trottoirs, les mêmes boutiques. Jusqu’aux silhouettes des passants qui se ressemblaient. En sorte qu’il n’en ressentit aucun soulagement.
Pourtant, comme il était à peu près à mi-chemin de la rue Eraclite, son regard, par un pur hasard, se posa sur une petite maison à deux étages au fond d’une courte ruelle de traverse. Il y avait là une petite place où confluaient plusieurs rues. La maison faisait juste le coin, comme serrée entre deux de ces voies. Il y avait de chaque côté un minuscule jardinet.
Son premier coup d’œil fut fortuit et ne fit que glisser. Mais comme cela arrive parfois dans la rue quand un homme rencontre une femme et que leurs regards se croisent l’espace d’une seconde, sur le moment il n’y fait pas attention, pourtant quelques pas plus loin il ressent un certain trouble, comme si ces deux yeux inconnus lui avaient instillé quelque chose qu’il ne pourra jamais plus effacer. Et alors, dominé par un appel mystérieux, il s’arrête net, se retourne et la voit qui, au même moment, d’un mouvement identique, tout en continuant son chemin, tourne la tête pour regarder derrière elle. Et pour la seconde fois le regard de ces deux-là se rencontre et leur trouble s’accroît, comme une pointe acérée il s’enfonce dans leur âme, mystérieux pressentiment d’une fatalité.
C’est ainsi que Resera qui avait dépassé le croisement n’eut pas fait dix mètres que l’image de la maisonnette se répercutait en lui. Comme c’est étrange, pensa-t-il, qui sait ce qu’elle peut bien avoir de spécial, et en disant cela il cherchait à se dissimuler la vérité dont il était déjà parfaitement conscient dans le fond de son âme.
L’impérieux besoin de revoir tout de suite la maison lui fit faire volte-face et revenir sur ses pas. Mais pour quelle raison, en modifiant son chemin de si infime façon, feignait-il une fausse indifférence, se comportant comme quelqu’un qui, tout en se promenant, rebrousse chemin par pur caprice sans la moindre excuse ? Avait-il honte ? Avait-il peur que quelqu’un en le voyant ne devinât ses pensées ?
Au risque de se trahir – jouant là encore le rôle d’un passant désœuvré qui, par oisiveté, regarde autour de lui – il eut un bâillement très artificiel juste pour pouvoir lever les yeux vers les étages supérieurs des maisons voisines sans que la volonté du geste transparaisse.
Désagréable surprise : trois personnes au moins, c’est-à-dire deux vieilles femmes sur leur balcon et un jeune homme en bras de chemise accoudé à sa fenêtre, l’observaient. Il lui sembla même que le jeune homme lui souriait avec une ironie effrontée, comme s’il voulait lui dire : c’est inutile, cher monsieur, de nous jouer la comédie, car nous savons très bien pourquoi vous êtes revenu sur vos pas !
« C’est absurde, se gourmanda Resera, cherchant à se tranquilliser. Si ces trois-là me regardent c’est sans la moindre intention. En ce moment, je suis l’unique passant dans la rue, c’est tout à fait normal que je fasse automatiquement les frais de leur curiosité. Et puis, zut, après tout ! ils peuvent bien penser ce qu’ils veulent. Quel mal y a-t-il si j’ai envie de donner un coup d’œil à cette maison ? »
Il savait très bien pourtant en raisonnant ainsi qu’il n’était pas sincère avec lui-même.
Quoi qu’il en fût, il était trop tard ..."

"La creazione" (La création)
Réflexion ironique sur la création du monde par un Dieu "fonctionnaire".
"Le Tout-Puissant avait déjà construit l’univers, disposant avec une irrégularité fantaisiste les étoiles, les nébuleuses, les planètes, les comètes, et il était en train de contempler ce spectacle avec une certaine complaisance, quand un des innombrables ingénieurs-projeteurs à qui il avait confié la réalisation de son grand projet, s’approcha d’un air très affairé.
C’était l’esprit Odnom, un des plus intelligents et des plus dynamiques de la nouvelle vague des anges (n’allez surtout pas penser qu’il avait des ailes et une tunique blanche, les ailes et la tunique sont une invention des peintres de l’ancien temps qui trouvaient que c’était bien pratique sur le plan décoratif).
« Tu désires quelque chose ? lui demanda le Créateur, avec bienveillance.
— Oui, Seigneur, répondit l’esprit-architecte. Avant que tu n’apposes le mot « fin » à ton œuvre merveilleuse et que tu ne lui donnes ta bénédiction, je voudrais te faire voir un petit projet auquel nous avons pensé, avec quelques jeunes collègues. Oh ! quelque chose de très secondaire, une vétille, comparée à tout le reste, un détail, mais qui nous a quand même semblé intéressant. »
Et d’un porte-documents qu’il portait à la main, il tira une feuille où était dessinée une espèce de sphère.
« Fais voir », dit le Tout-Puissant, qui naturellement connaissait déjà tout du projet mais faisait semblant de l’ignorer et simulait la curiosité afin que ses meilleurs architectes en ressentissent un plus grand plaisir.
Le plan était très précis et portait toutes les cotes souhaitables.
« Voyons, qu’est-ce que cela peut bien être ? dit le Créateur, poursuivant sa feinte diplomatique. On dirait une planète, mais nous en avons déjà construit des milliards et des milliards. Faut-il vraiment en faire encore une, et de dimensions aussi restreintes de surcroît ?
— Il s’agit en effet d’une petite planète, confirma l’ange-architecte, mais, contrairement aux autres milliards de planètes, celle-ci présente des caractéristiques particulières. »
Et il expliqua comment ils avaient pensé la faire tourner autour d’une étoile à une distance telle qu’elle en recevrait de la chaleur mais pas trop, et il énuméra les éléments du devis, avec leurs quantités respectives et leur prix de revient. Dans quel but tout cela ? Eh bien, toutes ces conditions préalables étant réalisées, il se produirait sur ce globe minuscule un phénomène très curieux et amusant : la vie.
Il était évident que le Créateur n’avait pas besoin d’explications complémentaires...."

"Il cane che ha visto Dio" (Le chien qui a vu Dieu)
Parue dans le recueil "Il colombre e altri cinquanta racconti" (1966), en français dans "Le K" (1966). Dans un petit village italien, un chien errant, malpropre, silencieux et solitaire, se met à susciter la curiosité générale. On apprend qu’il aurait eu une vision divine : le chien, un jour, aurait littéralement « vu Dieu ». Au lieu d’admirer ou de protéger ce chien, les habitants deviennent méfiants et mal à l’aise. Certains se mettent à craindre le chien : il pourrait être un témoin de leurs péchés, une présence qui « voit » et « sait ». Le chien, pourtant inoffensif, est interprété comme un juge silencieux qui rend les villageois nerveux. On lui attribue une aura quasi sacrée, tout en le fuyant et en le redoutant.
Le personnage central humain est un notaire, homme respectable mais corrompu et adultère, qui vit dans la peur d’être découvert. Il voit dans ce chien une menace morale directe : le chien sait, le chien juge. Ce notaire, persuadé qu’il sera dénoncé ou puni, finit par développer une obsession paranoïaque. Et, incapable de supporter la présence accusatrice de l’animal, celui-ci décide finalement de le faire tuer. Le village finit ainsi par se débarrasser de ce « témoin » silencieux, croyant ainsi apaiser leurs angoisses.
"... Qu’il ait vu Dieu ou non, il est bien certain que Galeone était un chien bizarre. Avec une componction presque humaine il allait de maison en maison, pénétrait dans les cours, les boutiques, les cuisines, demeurait là de longues minutes à regarder les gens. Et puis il s’en allait en silence.
Qu’y avait-il de caché derrière ces deux bons yeux mélancoliques ? L’image du Créateur s’y était inscrite, selon toute vraisemblance. Laissant quelles traces ? Des mains tremblantes offraient à l’animal des parts de gâteau, des cuisses de poulet. Galeone, repu, fixait son regard dans les yeux de chacun, semblant deviner toute pensée. Alors les gens quittaient la place, incapables de résister plus longtemps. Jusqu’alors, à Tis, on administrait le bâton et les volées de pierres aux chiens sauvages et turbulents : avec celui-ci, nul n’aurait osé.
Peu à peu, tous se sentirent engagés à l’intérieur d’une espèce de complot, mais ils n’avaient pas le courage d’en parler. De vieux amis se regardaient dans les yeux, y cherchant en vain une silencieuse confession, chacun espérant pouvoir retrouver un complice. Mais qui allait d’abord se dévoiler ? Seul Lucioni, intrépide, revenait sans cesse sur ce sujet : « Tiens, tiens ! voici encore notre brave sale chien qui a vu Dieu ! » annonçait-il avec effronterie sitôt qu’apparaissait Galeone. Et il ricanait, lançant des clins d’œil à la ronde. La plupart du temps, les gens faisaient semblant de ne pas avoir compris. Ils demandaient sans trop insister des explications, secouaient la tête d’un air compatissant et murmuraient : « Des histoires ! Mais c’est ridicule ! sornettes de bonnes femmes ! » Se taire, ou pis encore s’unir aux ricanements du Maire eût été trop compromettant. Ils escamotaient l’affaire comme s’il se fût agi d’une plaisanterie stupide. Toutefois, si le cavalier Bernardis était présent, sa réponse était toujours la même :
— Le chien de l’ermite ? Tu parles ! Je vous dis que c’est une bête d’ici. Depuis des années il rôdaille dans Tis et je le vois, chaque jour que fait le bon Dieu, du côté du fournil ! .."

"Le K" (Il colombre, 1966)
Publié en 1966 sous le titre "Il colombre e altri cinquanta racconti". Traduit en français sous le titre "Le K", publié chez Robert Laffont en 1966. Contient 54 nouvelles, dont certaines déjà publiées dans des recueils précédents (I sette messaggeri, Paura alla Scala, etc.). On y trouve des Contes fantastiques (comme Il colombre, Les Sept Étages), des Récits métaphysiques (comme La Création), et de petites paraboles morales, fables animales, satires modernes. Il regroupe toutes les obsessions de Buzzati : le temps, la mort, la solitude, la quête inutile.

"Il colombre" (Le K)
La nouvelle la plus célèbre : un requin mythique (colombre) poursuit un marin durant toute sa vie - une métaphore de la fatalité, un suspense métaphysique. On y sent toute l'influence kafkaïenne, une menace absurde qui cristallise la culpabilité et la peur. Le marin croit qu’il veut sa mort, mais découvre trop tard que le Colombre voulait lui offrir une perle magique garantissant son bonheur.
"... Naviguer, naviguer, c’était son unique pensée. À peine avait-il touché terre dans quelque port, après de longs mois de mer, que l’impatience le poussait à repartir. Il savait que le K l’attendait au large et que le K était synonyme de désastre. Rien à faire. Une impulsion irrépressible l’attirait sans trêve d’un océan à un autre.
Jusqu’au jour où, soudain, Stefano prit conscience qu’il était devenu vieux, très vieux ; et personne de son entourage ne pouvait s’expliquer pourquoi, riche comme il l’était, il n’abandonnait pas enfin cette damnée existence de marin. Vieux et amèrement malheureux, parce qu’il avait usé son existence entière dans cette fuite insensée à travers les mers pour fuir son ennemi. Mais la tentation de l’abîme avait été plus forte pour lui que les joies d’une vie aisée et tranquille.
Et un soir, tandis que son magnifique navire était ancré au large du port où il était né, il sentit sa fin prochaine. Alors il appela le capitaine, en qui il avait une totale confiance, et lui enjoignit de ne pas s’opposer à ce qu’il allait tenter. L’autre, sur l’honneur, promit.
Ayant obtenu cette assurance, Stefano révéla alors au capitaine qui l’écoutait bouche bée, l’histoire du K qui avait continué de le suivre pendant presque cinquante ans, inutilement.
« Il m’a escorté d’un bout à l’autre du monde, dit-il, avec une fidélité que même le plus noble ami n’aurait pas témoignée. Maintenant je suis sur le point de mourir. Lui aussi doit être terriblement vieux et fatigué. Je ne peux pas tromper son attente. »
Ayant dit, il prit congé, fit descendre une chaloupe à la mer et s’y installa après s’être fait remettre un harpon.
«Maintenant, je vais aller à sa rencontre, annonça-t-il. Il est juste que je ne le déçoive pas. Mais je lutterai de toutes mes dernières forces.»
À coups de rames il s’éloigna. Les officiers et les matelots le virent disparaître là-bas, sur la mer placide, dans les ombres de la nuit. Au ciel il y avait un croissant de lune.
Il n’eut pas à ramer longtemps. Tout à coup le mufle hideux du K émergea contre la barque.
« Je me suis décidé à venir à toi, dit Stefano. Et maintenant, à nous deux ! »
Alors, rassemblant ses dernières forces, il brandit le harpon pour frapper.
« Bouhouhou ! mugit d’une voix suppliante le K. Quel long chemin j’ai dû parcourir pour te trouver ! Moi aussi je suis recru de fatigue… Ce que tu as pu me faire nager ! Et toi qui fuyais, fuyais… dire que tu n’as jamais rien compris ! ..."

"Il crollo della Baliverna" (L’écroulement de la Baliverna)
Publiée d'abord dans le recueil I sette messaggeri (1942), reprise ensuite dans Le K (1966) en français. Le narrateur décrit un immense bâtiment, la Baliverna, construit sur une colline et composé d’innombrables pièces et couloirs. Cet édifice est décrit comme labyrinthique, peuplé d’individus divers, symbolisant un microcosme social (médecins, rentiers, serviteurs, artistes, etc.). Un jour, le narrateur, en passant devant une balustrade délabrée, y grimpe par jeu et s'accroche pour se hisser plus haut. Son poids provoque une fissure ; la balustrade s’effondre, entraînant peu à peu toute la structure : l’énorme Baliverna s’écroule entièrement, causant une panique générale.
Le narrateur, terrifié, s’enfuit discrètement pour ne pas être reconnu ni arrêté. Il parvient à regagner la ville, se mêle à la foule et reprend une vie « normale ». Mais, bien qu'il ait échappé à toute poursuite judiciaire, le narrateur avoue vivre depuis ce jour avec un sentiment constant de culpabilité. Il se sent jugé non par un tribunal extérieur, mais par sa propre conscience : la société, les passants, les regards silencieux deviennent autant d’accusateurs muets. Sa vie devient un supplice moral incessant, car il porte en lui la responsabilité du désastre, même si personne ne le dénonce.
"... Mes souvenirs se mêlent : moi, courant à en perdre le souffle pour rejoindre mes compagnons ; les femmes sur le bord de la prairie, hurlant, debout ; une autre roulant à terre ; la silhouette d’une fille à moitié nue, penchée avec curiosité à l’une des plus hautes fenêtres, tandis que le gouffre s’étendait toujours davantage sous elle : enfin, en un éclair, la vision hallucinante de la muraille s’écroulant dans le vide. Alors, la masse entière du bâtiment, y compris les murailles de l’autre côté de la cour intérieure, tout se mit lentement en mouvement, entraîné dans une irrésistible ruine.
Un terrible grondement, semblable à celui de bombes et de bombes lâchées par des centaines d’avions libérateurs, la terre qui tremblait, un nuage de poussière jaunâtre recouvrant rapidement cet immense sépulcre.
Je me revois ensuite, rentrant vers ma demeure, anxieux de m’éloigner de cet endroit funeste, tandis que la foule, que la nouvelle avait atteinte à une vitesse prodigieuse, me regardait avec épouvante, sans doute à cause de mes vêtements tout poussiéreux. Mais ce que je ne parviens surtout pas à oublier, ce sont les regards, chargés d’horreur et de pitié, que me lançaient mon cousin et ses deux filles. Muets, ils me contemplaient comme oc contemple un condamné à mort (ou bien n’était-ce que pure imagination de ma part ?).
Chez moi, quand on sut ce que je venais de voir, nul ne s’étonna de mon émotion ; ni même que je dusse m’enfermer dans ma chambre durant quelques jours, sans parler à personne, refusant même de lire les journaux (je n’en aperçus qu’un, entre les mains de mon frère venu s’enquérir de ma santé : une immense photographie tenait la première page, représentant une file interminable de cercueils).
Était-ce bien moi qui avais provoqué cette hécatombe ? La rupture de l’étoile de fer avait-elle, par une monstrueuse progression de causes à effets, entraîné la ruine du gigantesque château tout entier ? Ou n’était-ce pas plutôt le lointain constructeur lui-même qui avait disposé, avec une malice diabolique, un jeu secret de masses en équilibre que la simple absence de ce minuscule fer de lance de malheur suffisait à mettre en mouvement ? Mais mon cousin, ou bien ses filles, ou même Scavezzo, ne s’étaient-ils pas rendu compte de ce que j’avais fait ? Et s’ils n’avaient rien aperçu, pourquoi donc, depuis lors, Giuseppe semblait-il éviter de me rencontrer ? Ou alors, est-ce moi qui me suis mis à manœuvrer inconsciemment, de crainte de me trahir, pour le voir le moins possible ? ..."
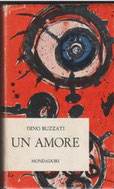
"Un Amore" (1963)
Un roman (et non une nouvelle), un roman psychologique racontant la passion obsessionnelle d’Antonio Dorigo, un architecte quinquagénaire milanais, pour Laide, une très jeune prostituée. Dorigo se laisse dominer, humilié, rongé par la jalousie. La solitude urbaine, la dépendance sexuelle et affective d’un homme mûr, l’autodestruction par le désir, la quête d’absolu dans l’amour charnel. Un style dépouillé, inspiré de son travail journalistique, et qui contraste avec son fantastique. Buzzati y explore le désir de possession et la pulsion érotique, mais l’écriture reste pudique comparée à des écrivains strictement « érotiques » (Bataille) : pour Buzzati, c’est toutefois une rupture stylistique majeure.
"... Il alluma sa quatrième cigarette, il eût fallu terminer le travail mais il n’en avait pas la moindre envie, à tout prendre cela ne pressait pas il suffisait de le donner samedi et on était à peine mardi, et puis d’ailleurs quand il ressentait le désir de faire l’amour le travail devenait fort difficile non que Dorigo fût un garçon particulièrement sensuel et surchargé de virilité cependant parfois à l’improviste sans motif apparent son imagination se mettait en marche et le cours de ses pensées déviait complètement.
Quand ensuite le rendez-vous avec une fille était pris son corps tout entier commençait à attendre, dans un état tout ensemble douloureux et superbe, difficile à expliquer, presque la sensation d’être une victime qui s’offrait sans restriction au sacrifice, de tout son corps dénudé, en un abandon et un débordement de languissantes ardeurs ; ardeurs qui grouillaient et fourmillaient partout dans ses membres, sa chair et ses viscères. Un potentiel de force terrible, rien moins que bestiale ou aveugle, tout au contraire lyrique, chargée d’obscure obscénité.
Dans ces moments-là Dorigo oubliait jusqu’à son propre visage qui ne lui avait jamais plu, qu’il avait toujours jugé odieux ; et il se créait l’illusion de pouvoir même être désiré.
Dans le même temps l’attente de la femme (« Tonino à l’appareil, bonjour mad… » « C’est vous ? depuis le temps que… ») faisait s’évanouir toute sa confiance en lui, si grande pourtant quand il travaillait. En présence de la femme il n’était plus l’artiste désormais presque célèbre, dont on parlait dans le monde entier, le metteur en scène génial, la personnalité enviée, l’homme sympathique au premier abord, il s’émerveillait lui-même d’être toujours aussi subitement sympathique mais avec les femmes il était bien autre, il devenait n’importe qui, ennuyeux même, il s’en était aperçu une infinité de fois, les femmes demeuraient intimidées et plus il s’efforçait de se montrer désinvolte et spirituel, plus cela empirait, la femme le regardait désorientée, presque apeurée, et il lui fallait être en grande confiance pour qu’il pût se retrouver lui-même et se montrer naturel mais pour parvenir à une véritable confiance cela nécessitait beaucoup de temps, les débuts étaient toujours tâtonnants et laborieux, comme il enviait Maronni qui en trois mots à peine mettait les filles à l’aise, de dépit il l’en haïssait parfois, avec les femmes ses paradoxes préférés étaient un jeu complètement erroné, il en prenait parfaitement conscience, au lieu de faire rire ils désorientaient et provoquaient une gêne, elles avaient l’impression qu’il se moquait d’elles ou qu’il voulait les snober. Il se consolait un peu en pensant qu’à la longue sa classe parvenait presque toujours à le sauver, tout au moins à lui faire faire bonne contenance, à défaut de plaire ; en fait la femme pressentait, bien qu’en la haïssant peut-être, sa supériorité intellectuelle, renfermée et orgueilleuse, qui ne parvenait pas à s’extérioriser et pourtant il eût tellement aimé s’abandonner sans réserve joyeusement comme un enfant dans l’enthousiasme de ses yeux.
Quelle fille lui aurait préparée, cet après-midi, Mme Ermelina ? Il se gardait bien d’un optimisme excessif, il est tellement difficile de tomber sur ce qu’on cherche, mais vraiment chez Mme Ermelina, grâce à Dieu ! il y avait toujours des filles fraîches, tout au moins la jeunesse des corps.
Dans le fond, pensait-il, ce ne serait pas mal du tout si Ermelina faisait venir la Britta. Il n’avait pas fait l’amour avec la Britta depuis des mois. La Britta ignorait les débordements sentimentaux, mais au lit elle ne faisait pas d’histoires. Ce corps blond, ferme, lisse, sans un seul poil pas même à l’aine. Certes il ne pouvait souffrir les blondes en général, même teintes. Mais Britta avait la compacité provocante d’un jeune phoque. Quand elle levait les bras, ses aisselles s’offraient, fleurs ouvertes, rosées, lisses, humides, tièdes, sans une ombre, une tendre rondeur pointait un peu, tant elle était jeune.
Il regarda son bureau, envahi de livres, de fascicules, de cartes, signes du travail.
À cette heure, par-dessus lui, par-dessous, tout autour, la ville tout entière travaillait, dans la même maison des hommes comme lui travaillaient, et travaillaient dans la maison d’en face, et dans l’antique maison de la via Foppa qu’on apercevait dans une trouée entre les autres maisons, et derrière encore, dans les maisons invisibles, et plus loin, plus loin encore, dans la brume, sur des kilomètres et des kilomètres, ils travaillaient. Des papiers, des registres, des formulaires, des coups de téléphone, des factures, des mains garnies de stylos, d’outils, de crayons, attentives à une vis, à une mortaise, à un encastrement, à une addition, à une greffe, à une soudure, à un piton, nuée de fourmis frénétiques assoiffées de bien-être et pourtant leurs pensées, oh il lui venait l’envie d’en rire, tous, tout autour, sur des kilomètres et des kilomètres, des pensées semblables aux siennes, indécentes et exquises, cette mystérieuse voix qui incite à la propagation de l’espèce, transcendée en vices étranges et brûlants, pourquoi jamais personne n’avait-il le courage de le dire ? pensées sur elle, sur elle, sur cette bouche particulière, sur ces lèvres faites d’une certaine façon, sur une perspective de muscles tendus, t’en souviens-tu ? délicats et flexibles, en des courbes diverses de toutes les autres, d’un pli, d’une plénitude, d’une ampleur, d’une chaleur, d’une moiteur, d’une souplesse, d’une profondeur, d’un abîme brûlant. Et les journaux parlaient d’un raidissement soviétique, d’interpellations à la Chambre à propos du Haut Adige, d’assurances données par Nenni sur l’autonomie du PSI, de l’incendie du cinéma Fiamma, de la crise dans le gouvernement régional de Sicile, quelle folle bouffonnerie.
Il alluma sa cinquième cigarette. Il était debout, tenu par cette excitation qui lui était propre (« Tonino à l’appareil, bonjour mad… » « C’est vous ? depuis le temps que… »). Mais il se sentait bien, aucune partie de son corps ne lui créait de gêne. Absolument tranquille, fort et serein. C’était en fait une matinée comme tant d’autres. Le ciel, dehors, demeurait gris et uniforme. Mais il se sentait bien.
Les heures à venir ne lui pesaient pas, de même que les prochains jours ne provoquaient en lui aucune peur d’aucune sorte. Ni le grand futur. Le téléphone se taisait. Dorigo était tranquille, le monde lui plaisait. Vêtu d’un complet grisaille, chemise blanche, cravate unie rouge magenta, chaussettes rouges également, chaussures noires de luxe, presque comme si.
Presque comme si tout devait continuer comme tout avait continué jusqu’alors, jusqu’à ce jour de février, qui était un mardi et portait le numéro 9. Tout, certain et favorable au bourgeois dans la force de l’âge, intelligent, corrompu, riche et heureux.???"
(...)

Cesare Pavese (1908-1950)
Né à Santo Stefano Belbo, dans les collines piémontaises, élevé par une mère peu expansive et rigide à Turin, ville industrialisée et au centre des luttes politiques, Cesare Pavese a vécu une période historique tragique et confuse et fut lui-même tourmenté par le sens à donner à sa présence au monde. La découverte de la littérature américaine, l'adhésion au Parti communiste, les amours déçues, l'insatisfaction devant le succès jalonnent son existence qui aboutit au suicide dans une chambre d'hôtel un soir d'août 1950, alors qu'il est au sommet de sa gloire.
Au début des années 30, il commence son travail de traducteur qu'il ne devait plus abandonner (Dos Passos, Melville, Steinbeck, G. Stein, Joyce, Defoë, Faulkner...). Arrêté pour antifascisme en 1935, il est exilé en Calabre pendant huit mois. L'année suivante, il publie son premier recueil de poèmes, mais ce n'est qu'avec son premier roman, en 1941, "Le Bel Été" (La bella estate), qu'il se signale à l'attention de la critique. Par la suite, il écrit et publie régulièrement romans et nouvelles nourris par la thématique néoréaliste mais traitée dans une perspective symbolique (l’un de ses récits, "Femmes entre elles", sera filmé en 1955 par Antonioni). Après la Seconde Guerre mondiale, Cesare Pavese adhère au Parti communiste italien, s'établit à Serralunga di Crea, puis à Rome, à Milan et finalement à Turin, travaillant pour les éditions Einaudi. Il ne cesse d'écrire durant ces années, notamment en 1949 un roman : "La Lune et les Feux".
(Une référence : "Travailler fatigue. Par chez toi. La plage. Vacance d'août. Le camarade. Dialogues avec Leucò. Avant que le coq chante. Le bel été. La lune et les feux. Le métier de vivre" - GALLIMARD, la magnifique collection Quarto, Paris, DL 2008)

"Paesi tuoi" (Par Chez toi, 1941)
Dès son premier roman, écrit en 1939, publié en 1941, Pavese affronte directement le mythe de la terre natale.
Un roman qui succède à un recueil de poèmes en vers narratifs, "Lavorare stanca" ("Travailler fatigue", 1936, une nouvelle édition élargie en 1943), écrit dans un style direct, sobre, inspiré par les écrivains américains (Steinbeck, Caldwell). Dans le cadre de la campagne piémontaise, dont l'écrivain est originaire, deux thèmes principaux dominent, celui de la solitude, d'un jeune citadin, Berto, isolé dans un milieu rural qui lui est fondamentalement étranger, et celui de la violence viscérale d'une famille de fermiers qu'incarne Talino, miné par des instincts qu'il ne domine pas et soutenu par une famille qui ne peut se passer de lui.
Berto et Talino se lient vaguement en prison. Berto est le Narrateur, un jeune ouvrier turinois, maçon. Il est emprisonné pour une rixe, il représente la ville, la modernité relative. Talino vante la beauté de ses collines et propose à Berto de venir l'aider aux moissons chez son père, promettant bon gîte et couvert. Berto, sans attache et curieux, accepte, voyant une échappatoire temporaire. Dès leur arrivée dans le hameau isolé de la famille Vinverra, Berto est frappé par la rudesse, la pauvreté et l'isolement. La ferme est misérable, les relations familiales tendues et brutales. Le contraste avec la ville (même ouvrière) est immense. Berto découvre un travail agricole exténuant (les foins, puis les moissons), la chaleur écrasante, la saleté, et une dynamique familiale en extrême tension : le père Vinverra, autoritaire et avare ; Talino, violent et jaloux, particulièrement envers son jeune frère et sa sœur Gisella ; la mère, soumise. La présence de Gisella introduit une tension sexuelle palpable. Sa beauté naturelle et son comportement libre fascinent et perturbent l'ouvrier urbain, mais exaspèrent Talino, qui a une relation ambiguë, quasi-possessive, avec elle. Berto se retrove entraîné malgré lui dans cette dynamique de la jalousie sexuelle et de violence fraternelle, et lors d'une fête au village voisin, les tensions explosent, une violente altercation physique éclate entre le frère et la sœur (après avoir dansé avec Ernesto, un jeune homme du village, voisin des Vinverra, le catalyseur de la tragédie, mais qui n'intervient pas) : Talino la frappe sauvagement : puis ce sera dans le lieu le plus symbolique de leur vie rurale, la grange (le fenile où est entreposé le foin), que le meurtre aura lieu, plus tard dans la nuit ou tôt le matin suivant. Berto est témoin du meurtre ou en découvre immédiatement l'horrible résultat. Talino, dans un état second, disparaît, fuyant les conséquences ou hanté par son acte. Pavese évite de donner un récit précis du meurtre : l'accent est mis sur l'horreur ressentie par Berto et l'atmosphère sans réelle humanité de l'ensemble des protagonistes, renforçant l'aspect primal et inéluctable de l'acte...
"Tout le monde avait quitté la cour, mais je n’avais pas bougé, et j'avais vu les femmes monter et descendre l’escalier, et la vieille qui coupait la polenta avec un fil et en donnait aux enfants, et, peu à peu, le silence s’était fait. On entendait les grillons, et, au loin, les chiens aussi.
Vinverra, son chapeau sur la tête, s’était assis, lui aussi, et il fixait la polenta et semblait écouter le bruit sourd que faisaient les pieds nus, au plafond. Un peu avant déja, il s’était levé, il était allé au pied de l'escalier, et en revenant, il avait dit, mais pas à moi : «Les femmes, elles attendent le curé. - Comme ça, le blé est déja battu, Vinverra, je lui dis. Maintenant, comment allez-vous faire?» - Vinverra me dit: «Eh non, il n’est pas battu. On commence demain.»
Il ne m’avait méme pas regardé, parce qu’il écoutait au loin, le regard fixé par terre. Que, le lendemain, la machine devait tourner, c’était pour lui parole d’évangile. Il ne s’apercevait pas que j’avais les mains qui tremblaient; mais je comprenais que c’était inutile de le contrarier. Et puis je ne faisais pas attention à lui, parce que j’avais constamment quelque chose devant les yeux comme quand quelqu’un s’en va sur la route, et que tout à coup il voit une automobile qui lui arrive dessus.
«Qui est-ce qui va le battre ? Il vous manque quatre bras. »
Mais Vinverra, buté: «Ils vont venir nous aider, ils vont venir. Ernesto, c’est son intérét. - Ernesto, il court aprés Talino, je dis. Et il a raison. - Ce n'est pas son affaire, dit Viverra, en colére. Ce n’est pas son affaire. - C’était mieux s’il devenait votre gendre. Comme ça, il ne serait rien arrivé. »
J'entends les chiens qui aboient plus fort, et je parie que la lune s’était levée. Je pensais aussi que, si rien ne s’était passé, ce soir, je me serais retrouvé avec Gisella et qu’on se serait trouvés amis, encore une autre fois.
«C’était mieux si ce fou restait là où il était, dit tout a coup Vinverra, sans lever la téte. Son malheur, ça a été de sortir et de rentrer au village. Moi, dés le premier moment où vous êtes arrivés, j’en ai senti l’odeur. - L'odeur de quoi? - De cette cuvette, répond Vinverra, en tendant le doigt. - Ah! elle est bonne, celle-là, je lui fais, plus furieux que lui, vous auriez dû me le dire à ce moment-la que c’était un criminel et qu’il avait mis le feu à la Grangia, et pas en donner la faute aux grillons et prétendre que je le surveille. - Quelque chose devait arriver, dit l'autre, buté, et puis il y avait le blé à battre. »
Alors je me léve et je monte la-haut, et de l’escalier, j’entendais marmonner plus fort, et je croise dans le noir une femme qui ne me dit rien, et je sens une odeur, d’hôpital cette fois, mais la fenêtre était grande ouverte et on voyait la Grangia et la lune. Elles étaient toutes en cercle, autour du lit, à genoux, à la lumiére de deux ou trois chandelles, et elles disaient le chapelet. Celles de la famille avaient sur la tête un voile noir comme si elles revenaient de l’église. Et, entre les chandelles et la lune, Gisella était sur le lit, encore toute bandée, avec un linge blanc sur le front, son nez et sa bouche étaient tout noirs...."
Talino reviendra, nulle culpabilité, le reste sera une affaire de carabiniers ...

Le Bel Été (La bella estate, 1949)
Le recueil est constitué de trois courts romans ou longues nouvelles : le premier intitulé "Le Bel Été" (La bella estate) est de 1940, le suivant, qui s'intitule "Le Diable sur les collines" (Il diavolo sulle colline), a été écrit en 1948, enfin le dernier, "Entre femmes seules" (Tra donne sole) date de 1949 qui est aussi la date de la première parution du recueil.
Dans celui-ci, les thèmes que Pavese avait déjà abordés dans "Avant que le coq chante" sont traités avec une force et une ampleur singulières. Les trois nouvelles du recueil se déroulent soit à Turin, soit dans les collines piémontaises, ces deux univers privilégiés auxquels l'écrivain était particulièrement attaché. Turin, c'est la ville des interminables promenades nocturnes, celle où les héros pavesiens refusent de dormir, marchent au long des nuits en tenant d'interminables conversations. C'est le lieu où il peut toujours "arriver quelque chose", c'est aussi l'atmosphère qui voit les individus se perdre. A Turin s'opposent les "collines", le pays des souvenirs d'enfance, l'endroit où l'on retrouve le contact avec la terre, le soleil, le vin, les forces brutes de la nature. Sur cescollines natales se conservent, immuables, les traditions locales, familiales. Et nous retrouvons aussi ici l' "enfer" pavesien : un univers où chaque manifestation de la vie a un "poids" et une saveur inégalables, mais où les individus sont dévorés par une plaie secrète : l'impossibilité de communiquer, la solitude. (Trad. Gallimard, 1955).
"La bella estate" - A la belle saison, comment s'enfermer entre quatre murs quand il fait si bon danser, marcher dans les rues de Turin où se moquer des gens qui passent? Le bel été, c'est le temps de la jeunesse, mais aussi de l'apprentissage doux-amer de l'existence pour les seize ans de Ginia qu'attire et effraie le monde des adultes, où l'étrange Amelia et le peintre Guido seront ses initiateurs ...
La première nouvelle roman revient sur la vie d'une jeune femme, nommée Ginia qui cède aux avances d'un jeune peintre Guido et s'ouvre sur une phrase célèbre, « À cette époque, c'était toujours fête » (A quei tempi era sempre festa), qui contraste avec la fin tragique de la jeune Gina (Ginia se perd une dernière fois en suivant Amelia l’initiatrice sombre, la lesbienne syphilitique dont elle embrasse la poitrine malade) ...
" A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada, per diventare come matte, e tutto era così bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, e magari venisse giorno all’improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare camminare fino ai prati e fin dietro le colline..."
"À cette époque-là, c’était toujours fête. Il suffisait de sortir et de traverser la rue pour devenir comme folles, et tout était si beau, spécialement la nuit, que, lorsqu’on rentrait, mortes de fatigue, on espérait encore que quelque chose allait se passer, qu’un incendie allait éclater, qu’un enfant allait naître dans la maison ou, même, que le jour allait venir soudain et que tout le monde sortirait dans la rue et que l’on pourrait marcher, marcher jusqu’aux champs et jusque de l’autre côté des collines.
"Bien sûr, disaient les gens, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeunes, vous n'êtes pas mariées, vous n'avez pas de soucis..." Et même l'une d'entre elles, Tina, était sortie boiteuse de l'hôpital et qui n'avait pas de quoi manger chez elle, riait, elle aussi, pour un rien et, un soir où elle clopinait derrière les autres, elle s'était arrêtée et s'était mise à pleurer parce que dormir était idiot et que c'était du temps volé à la rigolade.
Ginia, quand une de ses crises la prenait, n'en laissait rien paraître, mais, raccompagnant chez elle l'une des autres, elle parlait, parlait jusqu'au moment où elles ne savaient plus que dire.
De la sorte, lorsque arrivait l'instant de se quitter, il y avait déjà un bon moment qu'elles étaient chacune comme seules, et Ginia rentrait chez elle calmée et sans regretter de n'avoir plus de compagnie. Les nuits les plus belles, bien entendu, c'était le samedi, quand elles allaient danser et que le lendemain, on pouvait dormir. Mais il leur en fallait moins encore, et, certains matins, Ginia sortait pour aller travailler, heureuse à la seule idée du bout de chemin qu'elle avait à faire. Les autres disaient : "Moi, si je rentre tard, après, j'ai sommeil; si je rentre tard, on me sonne les cloches..." Mais Ginia n'était jamais fatiguée, et son frère, qui travaillait de nuit, la voyait seulement au repas du soir car, le jour, il dormait. A midi (Severino se retournait dans son lit quand elle entrait), Gínia mettait la table et mangeait avec appétit, mastiquant lentement, écoutant les bruits de la maison. Le temps passait lentement, comme c'est le cas dans les logements vides, et Ginia avait le loisir de laver les assiettes qui attendaient sur l'évier et de faire un peu le ménage; puis, elle s'étendait sur le divan qui était sous la fenêtre et se laissait aller à faire un petit somme, bercée par le tic-tac du réveil qui était dans la pièce voisine.
Parfois même, elle fermait les volets pour faire l'obscurité et se sentir plus seule. D'autant que Rosa, en descendant à trois heures, s'arrêtait devant sa porte et grattait doucement pour ne pas réveiller Severino, jusqu'au moment où elle lui répondait qu'elle était éveillêe. Alors, elles sortaient ensemble et se quittaient au tram.
Ginia et Rosa n'avaient de commun que ce bout de chemin et une étoile de petites perles dans les cheveux. Mais une fois où elles passaient devant une vitrine, Rosa ayant dit : "On a l'air de deux sœurs", Ginia s'aperçut que cette étoile faisait ordinaire et elle comprit que, si elle ne voulait pas être prise, elle aussi, pour une ouvrière, elle devait porter un chapeau.
D'autant plus que Rosa, qui était encore sous la coupe de son père et de sa mère, ne pourrait s'en payer un que Dieu sait quand.
Rosa, quand elle passait la réveiller, entrait s'il n'était pas déjà tard; et Ginia se faisait aider à remettre de l'ordre, et elles riaient sous cape de Severino qui, comme tous les hommes, ne savait pas ce que c'est que de tenir une maison. Rosa, pour faire durer la plaisanterie, appelait Severino "ton mari" mais, fréquemment, Ginia s'assombrissait et répliquait qu'avoir tous les ennuis d'un ménage mais pas d'homme, ce n'était pas très gai. Ginia ne parlait pas sérieusement - car, justement, son plus grand plaisir, c'étaít de passer ces quelques heures seule à la maison, comme une dame - mais il fallait bien faire comprendre de temps en temps à Rosa qu'elles n'étaient plus des gosses. Même dans la rue, Rosa ne savait pas se tenir, elle faisait des grimaces, riait, se retournait - Ginia l'aurait tuée.
Mais quand elles allaient ensemble au bal, Rosa était précieuse parce qu'elle tutoyait tout le monde et que ses sottises faisaient comprendre aux autres que Ginia était plus fine. Au cours de cette si belle année où elles commençaient à vivre seules, Ginia s'était vite aperçue que ce qu'elle avait de différent des autres, c'était qu'elle était seule également à la maison - Severino ne comptait pas -- et qu'à seize ans, elle pouvait vivre commeune femme. C'est pour cela que, tant qu'elle porta l'étoíle dans ses cheveux, elle accepta la compagnie de Rosa qui la faisait rire. Pour faire la folle, Rosa, quand elle s'y mettait, n'avait pas sa pareille dans tout le quartier. Lorsqu'elle riait et regardait en l'air, elle était capable de décontenancer n'importe qui, et, des soirées entières, elle ne faisait ni ne disait rien qui ne fût une vraie comédie. Et elle était querelleuse comme un coq. "Qu'est-ce que tu as, Rosa? lui demandait quelqu'un pendant qu'on attendait que l'orchestre commence. - Peur (et les yeux lui sortaient de la tête) : j'ai vu là derrière un vieux qui me fixe, il m'attend dehors, j'ai peur..." L'autre était incrédule: "Ça doit être ton grand-père.- Idiot! - Alors, on danse. - Non, parce que j'ai peur." Ginia, au milieu d'un tour de danse, entendait l'interlocuteur de Rosa qui criait : "Tu es une mal élevée, une garce, va te cacher. Retourne à l'usine!" Alors, Rosa riait et faisait rire les autres, mais Ginia, continuant de danser, se disait que c'était justement l'usine qui rendait les filles comme ça. Et, du reste, il suffisait de regarder les mécanos qui liaient, eux aussi, connaissance en faisant ce genre de plaisanteries.
S'il y en avait un dans la bande, on pouvait être sûr qu'avant la nuit, une fille se fâcherait ou, si elle était plus bête, se mettrait à pleurer. Ils vous charriaient comme Rosa. Ils voulaient toujours vous emmener dans les champs. Avec eux, on ne pouvait pas causer et il fallait se tenir tout de suite sur la défensive. Mais ce qu'ils avaient de bien, c'est que, certains soirs, on chantait, et eux chantaient bien, surtout si Ferruccio était là avec sa guitare, un grand blond qui était toujours chômeur mais qui avait encore les doigts noirs et abîmés par le charbon. Il semblait impossible que ces grosses mains fussent aussi agiles, et Ginia qui les avait senties sous son aisselle une fois où ils revenaient tous ensemble des collines, prenait bien garde de ne pas les regarder quand elles jouaient de la guitare..."
Ginia, l'héroïne, est une très jeune fille, qui travaille dans un atelier de couture et vit seule avec son frère, dans un univers pauvre et mesquin. Une fille plus âgée qu`elle, Amélia, se pare à ses yeux d'un grand prestige car elle pose nue pour des peintres et semble avoir accès à un milieu plus brillant que celui des ouvriers et des petites apprenties. Par l'intermédiaire d'Amélia, Ginia fait la connaissance d'un jeune peintre, Guido, et devient sa maîtresse. Mais elle sera cruellement déçue dans ses espoirs de bonheur et son amour pour Guido. "Le Bel Eté" est bien le récit de l'entrée d'une enfant dans le monde cruel des adultes, de la difficulté de s'y faire une place, de s'y défendre, de la difficulté, surtout, d'abandonner les rêves de l'enfance et de voir les êtres dans leur triste nudité ... Elle avait "voulu jouer les femmes et elle n'y était pas parvenue..."
"Il diavolo sulle colline" - Le Diable sur les collines - L'histoire d'un été, celui d'étudiants heureux de se brunir au soleil sur le Greppo où chantent les grillons, tandis que le riche et jeune Poli cherche dans l'alcool et la drogue un sens à sa vie ou peut-être un dérivatif au vide de son âme ...
"Nous étions très jeunes. Cette année-là, je crois bien que je ne dormis jamais. Mais j’avais un ami qui dormait encore moins que moi, et certains matins, on le voyait déjà se promener devant la gare à l'heure où arrivent et partent les premiers trains. Nous l'avions quitté tard dans la nuit, devant sa porte, mais Pieretto avait fait encore un tour, vu vraiment l’aube, bu un café. Maintenant, il observait les visages ensommeillés des balayeurs et des cyclistes.
Il ne se rappelait plus nos discours de la nuit : en continuant de veiller, il les avait digérés et disait tranquillement : « II se fait tard. Je vais me coucher. »
Lorsque l’un des autres trottait à notre suite, il était incapable de comprendre ce que nous pouvions bien faire à partir d’une certaine heure où il n’y avait plus la moindre ressource, plus d’osterie, plus de cinémas, ni plus rien à dire. S’asseyant avec nous trois sur un banc, il nous écoutait grommeler ou ricaner, s’enflammait à l'idée d’aller réveiller les filles ou d’attendre l’aurore sur la colline, puis, à un de nos brusques changements d’humeur, il hésitait et trouvait le courage de rentrer à la maison. Le lendemain, il nous demandait : « Qu’est-ce que vous avez fait après? » Il n’était pas facile de lui répondre. Nous avions
écouté un ivrogne, coller des affiches, fait le tour des marchés, vu passer des moutons sur les boulevards. "Nous avons fait la connaissance d'une femme", disait alors Pieretto.
L'autre ne nous croyait pas mais demeurait interdit.
Il faut de la persévérance, disait Pieretto. On passe et on repasse sous son balcon. Toute la nuit. Elle le sait, elle s’en, apercoit. Pas besoin de la connaître, elle le sent. Finalement arrive le moment où elle n’en peut plus : elle saute en bas de son lit et ouvre toutes grandes les persiennes. Alors, tu appuies l’échelle..."
Mais quand nous n’étions que tous les trois, nous ne parlions pas volontiers de femmes. Du moins pas sérieusement. Pas plus Pieretto qu’Oreste ne me disaient tout sur eux-mêmes. C’est pour cela qu’ils me plaisaient. Les femmes, celles qui vous séparent, viendraient plus
tard. Pour l'instant, nous parlions seulement de ce monde, de la pluie et du beau temps, et ça nous plaisait tellement qu’aller dormir nous semblait vraiment une perte de temps.
Une nuit de cette année-là, nous étions au bord du Po, sur un banc de l’avenue. « Allons nous coucher, avait marmonné Oreste.
- Couche-toi là, lui avions-nous dit, pourquoi veux-tu gaspiller l'été? Tu ne peux pas dormir d’un seul oeil? »
Oreste, la joue appuyée contre le dossier du banc, nous regarda à la dérobée. Quant à moi, je prétendais qu’à la ville on ne devrait jamais dormir...."
Oreste, Pieretto et le narrateur de la nouvelle font leurs études à Turin; le premier étudie la médecine, les deux autres le droit. La soif de vivre des trois jeunes gens est si violente qu'ils ne peuvent se résigner le soir à rentrer dormir chez eux; alors, presque chaque nuit, ils parcourent la ville et la campagne environnante, se grisant de conversations, de fumée de cigarettes et de clair de lune. C`est au cours d'une de ces randonnées qu'ils rencontrent un autre garçon, Poli, avec qui ils vont se lier intimement. Fils d'un très riche "commendatore" milanais, Poli vit au sein d'une société oisive et dépravée. Perverti jusqu'à la moelle, il est cependant habité par un rêve de pureté et d'innocence. Trop veule pour se détacher d'un milieu social qui le corrode, le jeune homme est pourtant assez sincère pour ne pas "tricher" avec l'existence lamentable et périlleuse dans laquelle il s'est engagé. C'est pourquoi, cahotant entre l'abjection et l'aspiration à la sainteté, il se laissera finalement détruire par l'alcool et la drogue....
"Tra donne sole" - L'ennui, arme du diable, frappe en ville comme sur les collines les cercles de la jeunesse dorée où Clelia Oitana, l'héroïne d'Entre Femmes Seules, a ses entrées de par son métier. Rien n'apaise cette "difficulté d'être" dont Pavese s'est fait le peintre attentif et sensible ...
"Comme les forains et les marchands de torrone, j’arrivai à Turin avec la dernière neige de janvier. Je me rappelai que c’était le carnaval en voyant sous les arcades les petites voitures des marchands ambulants et les becs d’acétylène incandescents bien qu’il ne fit pas encore nuit. Jetant des coups d’oeil à l'extérieur des arcades et par-dessus la tête des gens, j’allai à pied de la gare à l'hôtel. L’air cru me pinçait les jambes et j’avais beau être fatiguée, je m’attardais devant les devantures, sans me soucier des gens qui me bousculaient, regardant autour de moi et me serrant frileusement dans mon manteau de fourrure. Je me disais que, maintenant, les jours allongeaient et que bientôt un peu de soleil ferait disparaitre cette boue et annoncerait le printemps.
C’est ainsi que, dans la pénombre des arcades, je revis Turin. Lorsque je pénétrai dans l’hôtel, je ne rêvais que d’un bain brûlant, de m’étendre et d’une longue nuit. Je ne téléphonai à personne et personne ne savait que j’étais descendue à cet hôtel. Il n’y avait même pas un bouquet de fleurs pour m'accueillir. La femme de chambre qui fit couler mon bain me parlait, penchée sur la baignoire, pendant que je tournais dans la chambre. C’est la une chose qu’un homme, un valet de chambre, ne ferait pas. Je lui dis de s’en aller, que je n’avais besoin de personne. La petite balbutia quelque chose et me regarda en agitant les mains. Je lui demandai alors d’où elle était. Elle rougit vivement et me répondit qu’elle était de Ia Vénétie. « ça s’entend, lui dis-je, et moi, je suis de Turin; ça vous ferait plaisir de rentrer chez vous? »
Elle fit oui de la tête, avec un regard sournois. - « Comprenez alors que, moi, en arrivant ici, je rentre chez moi, lui dis-je. Ne me gâtez pas mon plaisir. - Je vous demande pardon, me dit-elle. Je peux m’en aller? »
Lorsque je fus seule, dans l’eau tiède, je fermai les yeux, irritée parce que je venais de trop parler et que ça n’en valait pas la peine. Plus je me convaincs que parler ne sert à rien, plus je parle. Surtout avec les femmes. Mais ma fatigue et cette légère fièvre se dissipèrent rapidement dans l’eau et je repensai à la dernière fois où j’étais venue a Turin — pendant la guerre — le lendemain d’un raid : toutes les canalisations avaient sauté, pas moyen de prendre un bain. Je repensai à cela en me félicitant du présent : tant que l’on peut prendre un bain, cela vaut la peine de vivre...."
Clelia, la narratrice de "Entre femmes seules" a connu à Turin une enfance pauvre et, jeune fille, a quitté la ville en se jurant de parvenir à une situation sociale qui lui assurerait aisance et indépendance. Dix-sept ans plus tard, la voici de retour à Turin où elle doit prendre la direction de la succursale d'une importante maison de couture romaine. Clelia a atteint son but : elle a obtenu, par son travail, une situation enviable, elle est reçue dans la meilleure société turinoise; de plus, elle est sans attache, indépendante. Mais la "réussite" de Clelia a son revers. La jeune femme est à tout jamais coupée du Turin de son enfance car celui-ci appartient à une classe sociale dont elle est définitivement sortie, sans pour autant s'être intégrée à la société dans laquelle elle est parvenue à faire représentation de son existence. Les plaisirs et les drames qui agitent les riches Turinois désœuvrés lui paraîtront toujours vains ou incompréhensibles. Solitaire, mais lucide, elle ne peut que se réfugier dans son métier, sa seule et véritable patrie ...

"La spiaggia" (1941)
Dans le microcosme social que constitue "La plage" pendant la saison balnéaire, le narrateur observe jalousement un couple ami. En attendant, en souhaitant même peut-être obscurément une rupture, il décrit en contrepoint sa solitude sans espoir, telle que fut celle de Pavese ...
"... De jour, sur la plage, c’était autre chose. On parle avec une étrange prudence quand on est à demi nu : les mots n’ont plus le même son que d’habitude, parfois on se tait et il semble que le silence lui-même libère des paroles ambiguës. Clelia avait une façon extatique de jouir du soleil, étendue sur les rochers, de se fondre avec ceux-ci et de s’aplatir contre le ciel, répondant à peine d’un chuchotement, d’un soupir ou d’un geste brusque du genou ou du coude aux brèves paroles de la personne qui était à côté d’elle. Je m’aperçus bientôt que, lorsqu’elle était étendue ainsi, Clelia n’écoutait vraiment rien. Doro, qui le savait, ne lui parlait jamais. Il restait assis sur sa serviette, mains croisées sur ses genoux, sombre et inquiet ; il ne s’étendait pas comme Clelia ; et si, parfois, il essayait de le faire, au bout de quelques minutes on le voyait se tortiller, se retourner et se mettre sur le ventre, ou se rasseoir comme précédemment.
Mais on n’était jamais seuls. La plage tout entière grouillait et causait – c’est pour cela que Clelia préférait au sable de tout le monde les rochers, la pierre dure et glissante. Lorsqu’elle se relevait, secouant ses cheveux, abrutie de soleil et riant, elle nous demandait de quoi nous avions parlé et regardait qui était là. Il y avait des amies, il y avait Guido, il y avait toute la bande. L’un sortait alors de l’eau. Un autre y entrait prudemment. Guido, dans son peignoir en tissu éponge blanc, arrivait avec des connaissances toujours nouvelles, qu’il congédiait au pied du parasol. Et puis, il grimpait sur le rocher et blaguait Clelia, mais il n’entrait jamais dans la mer.
L’heure la plus belle, c’était midi passé ou le coucher du soleil, quand la tiédeur ou la couleur de l’eau incitaient les plus rétifs à se baigner ou à se promener sur la plage, et où l’on restait presque seuls, tout au plus avec ce Guido qui causait aimablement. Doro, qui avait une lubie, celle de se distraire avec des pinceaux, plaçait parfois un chevalet sur le rocher, et il peignait des barques, des parasols, des taches de couleur, se contentant de nous regarder d’en haut et d’écouter nos bavardages. Parfois, l’un des membres du groupe arrivait en barque et, accostant avec prudence, nous appelait. Dans les silences qui suivaient, nous écoutions le clapotis de l’eau sur les galets.
L’ami Guido disait toujours que ce clapotis était le vice de Clelia, son secret, l’infidélité qu’elle nous faisait à tous. « Je ne trouve pas, dit Clelia, je l’écoute, nue et étendue au soleil, et peut nous voir qui veut. — Qui sait ? dit Guido. Qui sait les choses qu’une femme comme vous se fait raconter par les vagues. J’imagine ce que vous vous dites avant, quand vous vous étreignez. »
(...)
L'intrigue se déroule dans un village balnéaire italien pendant les vacances d'été. Le narrateur, Doro, intellectuel un peu désenchanté, et sa femme Clelia, plus sensuelle et impulsive, y séjournent. Ils fréquentent un petit groupe de vacanciers bourgeois, caractérisés par leur ennui, leur superficialité et leurs conversations oiseuses. La routine du groupe est brisée par l'arrivée de Berti, un jeune homme vigoureux, simple, charismatique et en harmonie avec la nature (il est souvent comparé à un faune ou à un jeune animal). Sa présence immédiate fascine Clelia et perturbe la dynamique du groupe. Clelia est irrésistiblement attirée par la vitalité primitive et la liberté que représente Berti, contrastant violemment avec l'atmosphère étouffante du groupe et la relation quelque peu usée qu'elle entretient avec Doro. Ce dernier observe la fascination de sa femme avec un mélange de jalousie, de lucidité désabusée et d'une certaine fascination lui-même pour Berti, symbole d'une authenticité qu'il ne possède pas.
Lors d'une promenade en mer, un enfant tombe à l'eau. C'est l'évènement clé. Tandis que les autres (dont Doro) restent paralysés par la peur ou l'indécision, Berti plonge immédiatement et sauve l'enfant avec une efficacité instinctive. Cet acte héroïque, naturel pour Berti, le place encore plus au centre de l'attention, notamment celle de Clelia, mais l'isole aussi davantage du groupe qui se sent humilié par sa propre lâcheté.
Pour tenter de se rapprocher de Berti et de cette vitalité, Clelia organise une excursion en montagne avec lui, Doro et une autre femme, Gina. L'expérience tourne court. Berti reste distant, imperméable aux tentatives de séduction de Clelia et à l'intellectualisme de Doro. La barrière entre son monde instinctif et celui, socialisé et compliqué, des vacanciers, est infranchissable. L'échec est cuisant pour Clelia.
Peu après l'excursion, Berti quittera la plage sans prévenir, disparaissant aussi soudainement qu'il était apparu. Sa disparition laisse un vide amer. Les vacances s'achèvent. Clelia, profondément déçue et blessée dans son désir, semble se résigner à retourner à sa vie avec Doro. Le groupe se disperse, retournant à son ennui et à sa superficialité habituels. La plage redevient un décor vide.
Une nouvelle existentialiste avant l'heure, d'une grande densité psychologique et symbolique, qui explore avec une lucidité cruelle les thèmes chers à Pavese : la solitude insurmontable, l'échec de la communication, la fascination pour une vitalité primitive inaccessible, l'ennui métaphysique et la frustration existentielle. Sa force réside dans sa sobriété même et dans la puissance évocatrice de son symbolisme, qui transforme une anecdote estivale en une parabole universelle sur la condition humaine et le désespoir de l'intellectuel moderne...

"La luna e i falò" (1950)
Dans "La Lune et les feux" (La luna e i falò, 1950), dernier roman de Pavese, un ancien pupille de l'Assistance publique, revient, après avoir émigré, au pays qui lui tient lieu de pays natal. C'est pour l'auteur un retour aux sources et son testament spirituel.Le thème dominant est "le sentiment d'être exclu". Les plus beaux chapitres du récit, écrit Calvino, sont ceux qui racontent deux jours de fête : "l'un vécu par l'enfant désespéré d'être resté à la maison parce qu'il n'a pas de chaussures, l'autre par le jeune homme qui doit conduire la voiture des filles du maître. Le poids existentiel qui se célèbre et s'épanche dans la fête, l'humiliation sociale qui cherche sa revanche animent ces pages dans lesquelles se fondent les divers plans de connaissance sur lesquels Pavese mène sa recherche." (traduction éditions Gallimard)
"Il y a une raison pour laquelle je suis revenu ici, dans ce pays, ici et non à Canelli, à Barbaresco ou à Alba. Ce n’est pas ici que je suis né, la chose est à peu près certaine ; où je suis né, je l’ignore ; par ici, il n’y a ni une maison, ni un lopin de terre, ni des ossements dont je puisse dire : « Voici ce que j’étais avant de naître. » J’ignore si je viens de la colline ou de la vallée, des bois ou d’une maison à balcons. Celle qui m’a abandonné sur les marches de la cathédrale d’Alba n’était peut-être même pas de la campagne, c’était peut-être la fille des propriétaires d’un palais, à moins que j’aie été apporté dans un panier de vendangeur par deux pauvres femmes de Monticello, de Neive ou – pourquoi pas ? – de Cravanzana. Qui pourrait dire de quelle chair je suis fait ? J’ai assez parcouru le monde pour savoir que toutes les chairs sont bonnes et se valent, mais c’est justement pour ça qu’on se démène et qu’on essaie de prendre racine, de se faire une terre et un pays : pour que votre chair vaille quelque chose de plus et dure plus qu’une banale suite de saisons.
Si j’ai grandi dans ce pays-ci, je dois en remercier la Virgilia et Padrino, des gens qui l’un et l’autre ne sont plus, même s’ils m’ont pris et élevé parce que l’Assistance publique d’Alessandria leur versait une mensualité. [Padrino : parrain. (N, d. T.)] Sur ces collines, il y a quarante ans, il y avait des pauvres diables qui, pour voir la couleur d’un écu d’argent, se chargeaient d’un bâtard de l’Assistance, en plus des enfants qu’ils avaient déjà. Il y en avait qui prenaient une fillette pour avoir ensuite une servante de qui l’on pouvait exiger n’importe quoi ; la Virgilia préféra me prendre, moi, parce que, des filles, elle en avait déjà deux et que, quand j’aurais un peu grandi, ils espéraient s’installer dans une grosse ferme et qu’en travaillant tous, on vivrait bien. Padrino avait alors la bicoque de Gaminella – deux pièces et une étable – une chèvre et le champ aux noisetiers. Moi, j’ai poussé avec ses filles ; on se volait la polenta et on dormait sur la même paillasse ; Angiolina, la plus grande, avait un an de plus que moi et ce fut seulement lorsque j’avais dix ans, l’hiver où mourut la Virgilia, que j’appris par hasard que je n’étais pas son frère. À partir de cet hiver-là, Angiolina, raisonnable, dut cesser de rôder avec nous dans les champs et par les bois ; elle s’occupait du ménage, faisait le pain et les fromages, et c’était elle qui allait à la mairie toucher mon écu ; moi, je me vantais devant Giulia de valoir cinq lires, je lui disais qu’elle ne rapportait rien et demandais à Padrino pourquoi nous ne prenions pas d’autres bâtards.
Maintenant, je savais que nous étions des miséreux, parce que seuls les miséreux élèvent les bâtards de l’Assistance. Avant, quand, sur le chemin de l’école, les autres me traitaient de bâtard, je croyais, moi, que c’était un mot comme salaud ou va-nu-pieds et je répondais sur le même ton. Mais j’étais déjà un grand garçon et la mairie ne payait plus mon écu, que je n’avais pas encore bien compris que ne pas être le fils de Padrino et de la Virgilia voulait dire que je n’étais pas né à Gaminella, que je n’étais pas sorti de sous les noisetiers ou de l’oreille de notre chèvre, comme les filles.
L’année dernière, quand je suis revenu pour la première fois au pays, je suis allé presque en cachette revoir les noisetiers. La colline de Gaminella, un versant long et ininterrompu de vignes, de champs et de prairies, une pente si insensible qu’en levant la tête, on n’en voit pas le sommet – et au sommet, il y a sans doute d’autres vignes, d’autres bois, et d’autres sentiers – la colline de Gaminella, donc, était comme dépouillée par l’hiver et laissait voir la nudité de sa terre et de ses arbres. À cette lumière froide, je la voyais nettement qui descendait graduellement, gigantesque, vers Canelli où s’achève notre vallée. Par la mauvaise petite route qui longe le Belbo, j’arrivai au parapet du petit pont et à la cannaie. Au-dessus de la berge, je vis le mur de grosses pierres noircies de notre bicoque, le figuier tout tordu, la petite fenêtre sans carreaux, et je pensais à ces hivers terribles. Mais alentour, les arbres et la terre n’étaient plus les mêmes ; le petit bois de noisetiers avait disparu et fait place à un chaume de maïs. De l’étable me parvint un mugissement de bœuf et, dans le froid du soir, je sentis l’odeur du fumier. Ceux qui logeaient maintenant dans notre bicoque n’étaient donc plus aussi pauvres que nous. Je m’étais toujours attendu à quelque chose de ce genre ou, peut-être, à trouver la bicoque en ruine ; tant de fois je m’étais imaginé accoudé au parapet du pont, en train de me demander comment il m’avait été possible de passer tant d’années dans ce trou et sur ces quelques sentiers à faire paître la chèvre et à chercher les pommes qui avaient roulé en bas de notre champ, convaincu que le monde finissait au tournant, à l’endroit où la route surplombe le Belbo. Mais je ne m’étais pas attendu à ne plus retrouver les noisetiers. Cela voulait dire que tout était bien fini. Cette nouveauté me découragea à tel point que je n’appelai pas et ne pénétrai pas sur l’aire. Je compris sur-le-champ ce que ça veut dire de ne pas être né en un lieu précis, de ne pas l’avoir dans le sang et de ne pas y être déjà à moitié enterré avec ses vieux, si bien qu’un changement de culture n’a pas d’importance. Bien sûr, des petits bois de noisetiers, il en restait sur les collines et je pouvais encore m’y retrouver ; moi-même, si j’avais été le propriétaire de ce champ, je l’aurais sans doute déboisé et ensemencé, mais, toujours est-il que, maintenant, il me faisait l’effet de ces chambres que l’on loue en ville, où l’on vit pendant un jour ou pendant des années, et qui, quand on déménage, ne sont plus que des coquilles vides, disponibles et mortes.
Heureusement que, ce soir-là, tournant le dos à Gaminella, j’avais en face de moi la colline du Salto, par-delà Belbo, avec ses crêtes et ses grandes prairies qui disparaissaient sur les cimes. Et plus bas, cette colline aussi n’était que vignes dépouillées, séparées par des champs en pente, et ses bouquets d’arbres, ses sentiers et ses fermes éparses étaient tels que je les avais vus jour après jour, année après année, assis sur le banc derrière notre bicoque ou sur le parapet du pont. Ensuite, pendant toutes ces années jusqu’au régiment, où j’avais été domestique à la ferme de la Mora, dans la plaine grasse par-delà Belbo, et où Padrino, après avoir vendu la bicoque de Gaminella, s’en était allé avec ses filles à Cossano, pendant toutes ces années, il suffisait que je lève les yeux des champs pour voir en dessous du ciel les vignes du Salto, qui, elles aussi, descendaient graduellement vers Canelli, dans le même sens que la voie du chemin de fer et que le sifflement du train qui, soir et matin, passait le long du Belbo, me faisant penser à des merveilles, aux gares et aux villes.
C’est ainsi que ce pays, où je ne suis pas né, j’ai cru pendant longtemps qu’il était le monde entier. Maintenant que le monde, je l’ai vu vraiment et que je sais qu’il est fait de tas de petits pays, je ne sais si, étant gosse, je me trompais tellement. On parcourt les mers et les terres, comme les jeunes gars, de mon temps, allaient aux fêtes des pays d’alentour, et dansaient, buvaient, se battaient et revenaient tout farauds à la maison, les poings en capilotade. On fait du raisin et on le vend à Canelli ; on récolte les truffes et on les porte à Alba. Il y a Nuto, mon ami du Salto, qui fournit de comportes et de pressoirs toute la vallée jusqu’à Camo. Qu’est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir un pays, ne serait-ce que pour le plaisir d’en partir. Un pays, ça veut dire ne pas être seul et savoir que chez les gens, dans les arbres, dans la terre, il y a quelque chose de vous, qui, même quand on n’est pas là, vous attend patiemment. Mais il n’est pas facile d’y vivre tranquillement. Depuis un an que je le tiens à l’œil et que, quand je peux, de Gênes, j’y fais un saut, celui-ci se dérobe à moi. Ces choses-là, on les comprend avec le temps et avec l’expérience. Est-il possible qu’à quarante ans et avec tout ce que j’ai vu du monde, je ne sache pas encore ce qu’est mon pays ?
(...)
Italo Calvino : le récit est emblématique : "tous les romans de Pavese tournent autour d'un thème caché, autour d'une chose non dite qui est la chose qu'il veut vraiment dire et qui ne peut être dite qu'en la taisant. Il se compose, autour de cela, un tissu de signes visibles, de paroles prononcées : ces signes, à leur tour, ont une face secrète (une signification polyvalente ou incommunicable) qui compte plus que celle qui est manifeste, mais leur véritable signification réside dans la relation qui les lie à la chose non dite."
Le roman est publié en avril 1950, trois mois plus tard, en août 1950, Cesare Pavese se suicide dans une chambre d'hôtel à Turin. "La Lune et les feux" est souvent considéré comme son œuvre la plus aboutie, synthétisant tous ses thèmes majeurs et atteignant une puissance narrative et symbolique qui le rend unique : le reflet le plus profond de son propre désarroi et de sa quête impossible d'appartenance et de sens, lui conférant une dimension testamentaire incontestable ...
"... Le premier jour de marché, Cinto vint à l’Angelo chercher le couteau que je lui avais promis. On me dit qu’un gosse m’attendait dehors et je le trouvai en habits de fête, chaussé de petits sabots, derrière quatre types qui jouaient aux cartes. Son père, me dit-il, était sur la place, en train de regarder une bêche.
— Tu veux les sous ou le couteau ? lui demandai-je.
Il voulait le couteau. Nous nous éloignâmes alors au soleil, passâmes au milieu des éventaires d’étoffes et de pastèques, au milieu des gens et des toiles à sac étendues par terre, pleines d’outils, de pinces, de socs, de clous, à la recherche d’un couteau.
— Si ton père le voit, lui dis-je, il est capable de te le prendre. Où vas-tu le cacher ?
Cinto riait avec ses yeux sans cils, « Pour ce qui est de mon père ! dit-il. S’il me le prend, je le tue. »
Quand nous fûmes arrivés devant l’éventaire des couteaux, je lui dis de choisir lui-même. Il ne me croyait pas. « Allons, dépêche-toi. » Il choisit un petit couteau qui me fit envie à moi aussi : beau, gros, couleur de marron d’Inde, avec deux lames à ressort et un tire-bouchon.
Puis nous retournâmes à l’hôtel et je lui demandai s’il avait trouvé d’autres cartes dans les fossés. Il tenait son couteau à la main, l’ouvrait et le fermait, en essayant la lame contre sa paume. Il me répondit que non. Je lui dis que moi-même, autrefois, je m’étais acheté un couteau comme ça au marché de Canelli, et qu’il m’avait servi aux champs pour couper l’osier.
Je lui fis servir un verre de menthe et, pendant qu’il buvait, je lui demandai s’il était déjà allé en train ou en car. Il me répondit que, plutôt qu’aller en train, il eût aimé aller à vélo, mais que Gosto du Morone lui avait dit qu’avec son pied c’était impossible et qu’il lui aurait fallu une moto. Je me mis à lui parler de l’époque où, en Californie, je circulais en camionnette et il resta là à m’écouter sans plus regarder les quatre types qui jouaient aux tarots.
Puis il me dit : « Aujourd’hui, il y a le match », et il écarquillait les yeux.
Je me préparais à lui demander : « Et toi, tu n’y vas pas ? », mais le Valino apparut sur le seuil de la porte de l’Angelo, l’air sombre. Cinto le sentit, s’en aperçut avant même de le voir, posa son verre et rejoignit son père. Ils disparurent ensemble dans le soleil.
Qu’aurais-je donné pour voir encore le monde avec les yeux de Cinto, pour recommencer à Gaminella comme lui, avec ce même père et, même, avec cette jambe, maintenant que je savais tant de choses et que je savais me défendre. Ce n’était pas de la pitié que j’éprouvais pour lui à certains moments, je l’enviais. Il me semblait savoir aussi les rêves qu’il faisait la nuit et les choses qui lui passaient par la tête tandis qu’il traînait la jambe sur la place. Je n’avais pas marché comme ça, moi, je n’étais pas boiteux, mais combien de fois j’avais vu passer les charrettes bruyantes pleines de femmes et de gosses qui allaient à la fête, à la foire, aux manèges de Castiglione, de Cossano, de Campetto, partout, et moi, je restais avec Giulia et Angiolina sous les noisetiers, sous le figuier, sur le petit mur du pont, ces longues soirées d’été, à regarder le ciel et les vignes toujours semblables. Et puis la nuit, toute la nuit, sur la route, on entendait les gens rentrer, chantant, riant et s’appelant à travers le Belbo. C’était ces soirs-là qu’une lumière, un feu d’herbes sèches, vus sur les collines lointaines, me faisaient crier et me rouler par terre parce que j’étais pauvre, parce que j’étais un gosse, parce que je n’étais rien. J’étais presque heureux quand survenait un orage, un orage terrible, de ceux qu’il y a en été, et que cela leur gâtait leur fête. Maintenant, quand j’y repensais, je regrettais cette époque, j’aurais voulu y être de nouveau.
Et j’aurais voulu me retrouver dans la cour de la Mora, cet après-midi d’août où tout le monde était allé à la fête à Canelli, même Cirino, même les voisins, et à moi qui avais seulement des sabots, on m’avait dit : « Tu ne voudrais tout de même pas y aller nu-pieds. Reste pour monter la garde. » C’était ma première année à la Mora et je n’osais pas me révolter. Mais il y avait pas mal de temps qu’on attendait cette fête : Canelli avait toujours été fameuse, il devait y avoir un mât de cocagne et une course en sac, et puis un match de football.
Les patrons et les deux filles y étaient allés aussi, ainsi que la petite avec l’Émilia, dans la grande voiture ; la maison était fermée. J’étais seul, avec le chien et avec les bœufs. Je restai un moment derrière la grille du jardin à regarder les gens qui passaient sur la route. Tous allaient à Canelli. J’enviai même les mendiants et les estropiés. Puis je me mis à lancer des pierres sur le colombier, pour casser les tuiles, et je les entendais tomber et rebondir sur le ciment de la terrasse. Pour jouer un sale tour à quelqu’un, je pris la serpe et m’enfuis dans les champs : « Comme ça, pensai-je, je ne monterai pas la garde. La maison peut brûler et les voleurs venir. » Dans les champs, je n’entendais plus le bavardage des passants et cela excitait encore plus ma rage et ma peur, j’avais envie de pleurer. Je me mis à chasser les sauterelles et je leur arrachais les pattes, les leur cassant à la jointure. « Tant pis pour vous, leur disais-je, vous auriez dû aller à Canelli. » Et je hurlais des blasphèmes, tous les blasphèmes que je connaissais.
Si j’avais osé, je me serais livré dans le jardin à un massacre de fleurs. Et je pensais à la tête d’Irene et de Silvia et je me disais qu’elles pissaient elles aussi.
Une petite voiture à cheval s’arrêta devant la grille. « Il n’y a personne ? » entendis-je crier. C’étaient deux officiers de Nizza que j’avais déjà vus une fois sur la terrasse avec elles. Je restai caché derrière le hangar, sans mot dire. « Il n’y a personne ? Signorine ! criaient-ils. Signorina Irene ! » Le chien se mit à aboyer et moi je me taisais toujours.
Au bout d’un instant, ils s’en allèrent, et maintenant j’avais une satisfaction. « Eux aussi, pensais-je, les bâtards ! » J’entrai dans la maison pour manger un morceau de pain.
La cave était fermée. Mais sur le rayon du buffet, au milieu des oignons, il y avait une pleine bouteille de bon vin et, la prenant, j’allai la boire tout entière, derrière les dahlias. À présent, j’avais la tête qui tournait et qui bourdonnait comme si elle avait été pleine de mouches. Revenant à la cuisine, je cassai la bouteille par terre, devant le buffet, comme si ç’avait été le chat, et je répandis sur le sol un peu de piquette pour remplacer le vin. Puis, j’allai dans le fenil.
Je fus saoul jusqu’au soir et c’est saoul que je fis boire les bœufs, que je leur changeai leur fourrage et leur donnai leur foin. Les gens commençaient à repasser sur la route et, de derrière la grille, je demandai ce qui était suspendu au mât de cocagne, si la course avait vraiment été en sac et qui avait gagné. Les gens s’arrêtaient volontiers, personne n’avait jamais autant causé avec moi. À présent, j’avais l’impression d’être un autre et je regrettais même de n’avoir pas parlé à ces deux officiers, de ne pas leur avoir demandé ce qu’ils voulaient à nos jeunes filles et s’ils croyaient vraiment qu’elles étaient comme celles de Canelli.
Quand la Mora se peupla de nouveau, j’en savais assez sur la fête pour pouvoir en parler avec Cirino, avec l’Émilia, avec tout le monde, comme si j’y avais été. À souper, il y eut encore à boire. La grande voiture rentra très tard dans la nuit, alors que je dormais depuis un bon moment et que je rêvais que je grimpais le long du dos lisse de Silvia comme si ç’avait été le mât de cocagne, et j’entendis Cirino qui se levait pour aller à la grille, et j’entendis parler, des portes claquer et le cheval s’ébrouer. Me retournant sur ma paillasse, je pensai combien c’était bon que, maintenant, on soit tous là. Le lendemain, on allait se réveiller, on irait dans la cour et je parlerais encore et entendrais encore parler de la fête."
(...)
Le récit est construit comme une remontée dans les souvenirs, sans chronologie linéaire, mêlant passé et présent, enquête et méditation. Pavese y rassemble et approfondit tous ses thèmes obsessionnels :
- Le Retour impossible : Anguilla, le protagoniste, revient dans son Piémont natal après des années d'exil (en l'occurrence, aux États-Unis), découvrant que le "pays" idéalisé de son enfance n'existe plus. Anguilla incarne de manière poignante les contradictions et les tourments de Pavese lui-même : l'intellectuel déraciné, l'éternel exilé, l'observateur lucide mais impuissant face à la violence du monde et à la perte des illusions. Le sentiment de ne plus appartenir nulle part, exprimé par Anguilla, résonne profondément avec l'état d'esprit de Pavese à la fin de sa vie.
- La Terre et le Paysage : Le rapport viscéral à la campagne piémontaise, ses collines, ses fermes, ses saisons, est plus puissant et symbolique que jamais.
- L'Enfance et l'Initiation : La quête des origines, la découverte douloureuse de la sexualité, de la violence et de la mort.
- Le Mythe : Pavese explore la fonction du mythe personnel et collectif, la manière dont les souvenirs et les légendes façonnent l'identité et se heurtent à la réalité. Les "feux" de purification (les falò) et la lune sont des symboles récurrents chargés de sens mythique.
- La Désillusion Politique et Existentielle : Le désenchantement post-Résistance et la difficulté de trouver un sens à l'existence sont au cœur du roman.
De 1945 à 1950, Cesare Pavese ne cesse d'écrire. C'est en 1945 qu'il écrivit "La Terre et la Mort" (La terra e la morte, "Verrà la morte e avra i tuoi occhi"), "Dialogues avec Leuco", "Le Camarade (Il compagno). Ce sont aussi les années où Pavese s'intéresse au communisme, auquel il adhère sans véritable vocation politique. En 1949, il publie "Avant que le coq chante", qui comprend "La Maison sur la colline", "Le Diable sur les collines", et "Entre femmes seules", dans lequel vit le plus réel de ses personnages féminins, Clelia. A l'automne de 1949, il écrivit en deux mois "La Lune et les Feux", "souvenir de l'enfance et du monde", son dernier livre et peut-être son chef-d'oeuvre. Son "Journal", qui retrace tout le parcours de son idéale "maturité" sera publié en 1952 sous le titre "Le Métier de vivre", et porte, à la date du 18 août 1950, cette ultime phrase : "Plus un mot. Un geste. Je n`écrirai plus." Le sentiment qu'il avait dit tout ce qu'il avait à dire, une nouvelle déception amoureuse (avec une jeune actrice américaine à laquelle il avait dédié des poèmes en anglais et des scénarios de cinéma), et l'insatisfaction devant le succès attisèrent son ancienne obsession du suicide. Le 26 août au soir, il se donna la mort dans une chambre d'hôtel en absorbant un barbiturique...

"Prima che il gallo canti" (1949, Avant que le coq chante)
Sous ce titre, Cesare Pavese a réuni en 1949 deux récits, "Il carcere" (1938, La prison), et "La casa in collina" (1947, La Maison sur la colline). L'édition française du recueil (1953) comprendra un troisième récit. Le thème commun à ces trois récits est celui de la difficulté des rapports humains, de l'amère solitude dont tout héros pavesien est la proie, solitude du narrateur de "Tes pays", pour qui le comportement des durs paysans piémontais est incompréhensible ; solitude de Stefano, qui voit les êtres avec lesquels il est obligé de vivre comme à travers les barreaux d'une cellule; solitude de Corrado, que son impuissance à s'engager aux côtés des antifascístes, ses amis, accule à une fuite éperdue, loin de la guerre, loin du danger, et loin des autres. (Trad. Gallimard, 1953)
"Tes pays" (Paesi tuai, 1937), récit en prose qui a pour cadre la campagne piémontaise, dont l' écrivain était originaire. Deux thèmes principaux y apparaissent, celui de la solitude, celle du narrateur, citadin isolé dans un milieu rural qui lui est étranger, et celui de l'inconscience criminelle d'une famille de fermiers. Talino, un inquiétant personnage miné par des instincts criminels, est protégé par sa famille, qui veut à tout prix le garder en raison des services qu'il rend à la ferme. ll faudra qu'il tue l'une de ses sœurs d'un coup de fourche pour que ses parents se résignent à le voir emmener par les carabiniers ..
"Il carcere" (1938, La prison) - Stefano, condamné politique, est envoyé, à sa sortie de prison, en résidence surveillée dans un village de l'Italie du Sud.Bientôt il découvre qu'il lui est si difficile de communiquer avec les habitants du pays que le village est devenu pour lui une nouvelle cellule : les murs ne sont plus les mêmes, mais la solitude du prisonnier est toujours aussi pesante.
"La casa in collina" (La Maison sur la colline) - Dans les années 1943-1945, à la fin de la guerre, Turin est écrasée sous les bombes. Les habitants se réfugient en banlieue, sur les collines. Les actions des partisans, la répression ajoutent leur cruauté à celle des bombardements. Corrado, petit professeur de lycée, n'arrive pas à trouver sa place dans la guerre. Il est seul; il a peur. Alors il quitte la ville, il fuit vers son pays natal, pour s'y terrer, et attendre...

Le Métier de vivre, posthume (Il mestiere di vivere, 1952)
Dans son journal, très intimiste, publié après son décès sous le titre qu’il lui avait lui-même donné, Le métier de vivre, on peut comprendre au fil des pages ce qui amena l’auteur à se supprimer alors qu’il était au sommet de sa gloire. Pavese y parle de lui-même, de sa solitude, de sa difficulté de vivre et des rapports qu’il entretient avec autrui et en particulier avec les femmes. Il aborde aussi longuement son métier d’écrivain et médite sur l’évolution de son style, sur la valeur de ses œuvres, sur le sens de la littérature. «Un homme seul, dans une baraque, qui mange le gras et la sauce d’une marmite. Certains jours il la racle avec un vieux couteau ; certains autres avec ses ongles ; il y a longtemps la marmite était pleine et bonne, maintenant elle est aigre et, pour en sentir le goût, l'homme ronge ses ongles cassés. Et il continuera demain et après. Il me ressemble à moi qui cherche du travail dans mon cœur.» (publié chez Gallimard en 1958 dans une traduction de Michel Arnaud, d’après l’édition italienne de 1952).
