- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

LatinAmerica - Caudillismo - Miguel Angel Asturias (1899-1974), "El señor Presidente" (1946) - Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) , "Facundo" (1845) - José Mármol (1818-1871), "Amalia" (1855) - Ramón del Valle-Inclán (1866-1936), "Tirano Banderas" (1926) - Martín Luis Guzmán (1887-1976), "La sombra del caudillo" (1928-1929) - Francisco Ayala (1906-2009), "Muertes de perro" (Morts de chien, 1958) - Augusto Roa Bastos (1917-2005),"Yo el Supremo" (Moi, le Suprême, 1974) -"El otono del patriarca" (L'Automne du patriarche, 1976), Gabriel Garcia Marquez (1927-2014) - "La fiesta del chivo" , Mario Vargas Llosa (1936-2025) ...
Last update : 03/03/2017

La confiscation du pouvoir au profit d'un dictateur ou d'un groupe oligarchique est un phénomène politique qui apparaît comme un mal endémique dont les racines plongent au plus profond des mentalités sud-américaines et qui remonte aux lendemains de l'éclatement de l'empire colonial espagnol. Avant la conquête, le cacique est le chef d'une tribu indienne. Après l'implantation espagnole, le cacique est un notable local, le chef d'une communauté au pouvoir patriarcal. Le "caudillo" est un chef militaire qui devient chef de bande puis chef d'Etat. Après le succès des luttes pour l'indépendance, bien des généraux n'acceptèrent qu'avec difficulté de rentrer dans le rang : ils profitèrent de leur puissance pour se tailler de petits empires qu'ils n'abandonnaient que lorsqu'un autre caudillo les renversait. Le caudillo désigne à la fois un pouvoir acquis par la violence et un type de rapport social fondé sur la seule force. Le "caudillismo" peut être un phénomène local, mais il prend souvent une dimension nationale à travers des personnages dont le charisme du cacique et la brutalité du caudillo mêlés font d'étonnants héros de roman...

Tous les personnages de caudillo reposent sur une expérience vécue par les écrivains et, bien souvent, sur la douloureuse épreuve personnelle de la prison et de l'exil. Parfois, le dictateur réel apparaît directement dans le roman : c'est le cas de Facundo Quiroza, dans "Facundo" (1845), de Sarmiento; de l'Argentin Rosas dans "Amalia" (1855), de José Marmol; du Mexicain Carranza dans "l'Aigle et le serpent" (1928), de M.J.Guzman; du Paraguyen Francia dans "Yo el Supremo" (1974), d'Augusto Roa Bastos. Mais le plus souvent le romancier campe un caudillo fictif qui sévit dans un pays à la situation spatiale et temporelle indécise mais qui fonctionne comme "un modèle réduit" de l'Amérique latine tout entière. Le roman du dictateur devient alors le roman de la dictature, conçue moins comme un régime inique que comme une dépravation profonde de la nature humaine, qui trouve dans le pouvoir absolu l'occasion de libérer et de satisfaire ses fantasmes : le cubain Alejo Carpentier, dans "El recurso del método"(1974) ou le colombien Gabriel García Márquez qui , dans "El otoño del patriarca" (1976), campe un dictateur paradoxal, archétype de tous les autocrates qui ont régné au cours du XXe siècle. Paradoxe de cruauté et de désespoir, paranoïaque et solitaire, le "patriarche" tient sous son emprise une population qui ne peut échapper à l'aura mythique qu'il s'est forgée ...

"El señor Presidente" ( Monsieur le Président, 1946)
Miguel Angel Asturias (1899-1974) aborde le roman avec "El señor Presidente", caricature d'Estrada Cabrera auquel s'opposa Asturias, alors étudiant, au Guatemala: derrière la façade "de paix et de progrès" de la dictature, la peur, le désespoir, l'injustice rongent et décomposent toute la société avec son lot d'adulateurs, soutenu par l'armée et l'appareil de répression policière, de mouchards, de profiteurs malhonnêtes, et de prisonniers politiques...
Ce n'est pas au Guatemala mais à Paris que fut écrit, entre 1925 et 1932, "Monsieur le Président", l'exemple le plus représentatif, des lettres non seulement guatémaltèques mais hispano-américaines. Politiquement, socialement, littérairement, le roman exprime admirablement la pensée, l'idéologie de Miguel Angel Asturias.
Ce roman est en effet la peinture, d'une dictature en Amérique centrale, celle du sinistre et solitaire Estrada Cabrera, figure historique (et qui devient ici mythique) du Guatemala au début de ce siècle. Monsieur le Président exerce son autorité, enfermé dans son palais, visible seulement de ses intimes; simple en apparence, mais dévoré par la passion du Pouvoir; affectueux avec ses familiers, mais hypocrite et prêt à les perdre au premier soupçon. C'est ce qui arrivera à son ami Miguel Visage d'Ange, coupable de ne pas avoir exécuté l'un de ses ordres monstrueux. Coupable par amour... Car Monsieur le Président est aussi l`histoire d'un amour - romantique parce qu'il est né du premier regard et pour toujours; "maléfique" dans un pays où chacun vit sous la menace, obligé de choisir entre la mort et la compromission (crime, malversation, délation).
On y retrouve l'écriture singulière d'Asturias, nourrie des rythmes narratifs propres aux mythes mayas aussi bien que du langage populaire guatémaltèque, et exaltée par une incessante invention d'images." (Editions Albin Michel, traduction par Georges Pillement et Dorita Nouhaud). Le roman fut tout d'abord un conte, "Los mendigos políticos" destiné à être publié dans un journal local, puis devint un roman avec un nouveau titre, "Tohil", en allusion à un dieu qui, dans la mythologie maya, exigeait des sacrifices humains pour étancher sa soif de sang.
De retour en Amérique en 1946, le Fondo de Cultura Económica au Mexique refuse sa publication avec dit-on cette répartie, "Llévese a su señor presidente a otra imprenta" ("Emmenez votre Président dans une autre imprimerie") qui inspira le titre définitif. "Quienes lo sufrieron en la Guatemala de los años veinte pudieron verse retratados en lo que al sentimiento de vivir el pánico metido hasta los tuétanos se refiere", écrira Ariel Batres, "ceux qui l'ont souffert au Guatemala dans les années 1920 pourraient être dépeints via un sentiment de panique, qui se reflète dans la moelle de chacun.."
"Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la Catedral helada, de paso hacia la Plaza de Armas, a lo largo de calles tan anchas como mars, en la ciudad que se iba quedando atrás ingrima y sola.... Les rues apparaissaient peu à peu dans la clarté fuyante de l'aube, au milieu de toits et de champs qui dégageaient une fraîcheur d'avril. C'était par là-bas qu'apparaissaient au galop les mules qui livraient le lait, les oreilles des bidons de métal tintinnabulantes, harcelées par les cris et le fouet de leur muletier. C'était par là-bas que le jour se levait pour les vaches qu'on trayait au seuil des maisons riches ou aux coins des rues des quartiers pauvres, au milieu des clients qui, en voie de rétablissement ou de consomption, les yeux creux et vitreux, s'attardaient près de leur vache préférée et s'approchaient pour prendre le lait eux-mêmes, inclinant à merveille le verre pour y recevoir plus de liquide que de mousse. C'était par là-bas que passaient les porteuses de pain, la tête enfoncée dans le thorax, le dos rond, les jambes raidies et les pieds nus, traçant une piqûre de pas ininterrompus et hésitants sous le poids des énormes panières, panière sur panière, pagodes qui laissaient dans l'air une odeur de pâte feuilletée caramélisée et de sésame grillé. C'était par là-bas qu'on entendait l'aubade les jours de fête nationale, réveille-matin que promenaient des fantômes de cuivre et de vent, sons faits de saveurs, éternuements de couleurs, pendant que, l'aube pointi-pointant, sonnait dans les églises, timide et hardie, la cloche de la première messe, timide et hardie car si son tintement faisait partie du jour de fête à saveur de chocolat et de tourte de chanoine, les jours de fête nationale il sentait le fruit défendu.
Fête nationale...
Des rues montait, avec une odeur de bonne terre, la joie des habitants qui jetaient de l'eau par les fenêtres afin qu'à leur passage soulèvent moins de poussière les soldats chargés de porter le drapeau jusqu'au Palais Présidentiel - drapeau fleurant bon le mouchoir tout neuf - ainsi que les voitures des notables qui se mettaient à la rue harnachés de pied en cap, docteurs en ceci ou cela trimbalant des armoires en redingote, généraux aux uniformes rutilants, empestant la chandelle - ceux-là coiffés de chapeaux de lumière, ceux-ci de tricornes de plumes - ainsi que le petit trot des employés subalternes dont l'importance se mesurait administrativement parlant d'après les frais d'enterrement que leur octroierait un jour l'Etat.
Seigneur! Seigneur! les cieux et la terre sont pleins de votre gloire! Le Président consentait à apparaître, satisfait du peuple qui le remerciait ainsi de toutes ses peines, isolé de tous, très loin, au milieu du groupe de ses intimes. Seigneur! Seigneur! les cieux et la terre sont pleins de votre gloire! Les femmes sentaient le divin pouvoir du Dieu Bien-Aimé. Les Princes de l'Eglise l'encensaient. Les journalistes du pays et de l'étranger se félicitaient d'être en présence d'une réincarnation de Périclès. Les juristes évoquaient un tournoi d'Alphonse le Sage. Les diplomates, Excellences de Tiflis, arboraient de grands airs, s'acceptant à Versailles, à la cour du Roi Soleil.
Seigneur! Seigneur! les cieux et la terre sont pleins de votre gloire! Les poètes se croyaient à Athènes, ainsi le proclamaient-ils au monde. Un sculpteur de saints se prenait pour Phidias et souriait en levant les yeux au ciel et en se frottant les mains, au bruit des applaudissements qui saluaient dans les rues le nom de l'éminent politique. Seigneur! Seigneur! les cieux et la terre sont pleins de votre gloire! Un compositeur de marches funèbres, fervent de Bacchus et du Saint Enterrement, se penchait à un balcon, sa figure couleur tomate, pour voir où était la terre. Mais, si les artistes s'imaginaient être à Athènes, les banquiers juifs se croyaient à Carthage, car le chef de l'Etat avait placé sa confiance en eux et, dans leurs coffres-forts sans fond, les gros sous du pays, à zéro virgule rien pour cent, placement qui leur permettait de s'enrichir avec les dividendes et de convertir la monnaie sonnante et trébuchante en prépuces circoncis. Seigneur! Seigneur! les cieux et la terre sont pleins de votre gloire!
Visage d'Ange se fraya un passage entre les invités. (Il était beau et méchant comme Satan).
- Le peuple vous réclame, Monsieur le Président!
- ...Le peuple ?
Le maître mit dans ces deux mots un bacille d'interrogation. Le silence régnait autour de lui. Sous le poids d'une grande tristesse qu'il combattit vite avec rage pour la faire disparaître de ses yeux, il se leva et se dirigea vers le balcon. Ses intimes l'entouraient quand il apparut devant la foule. Un groupe de femmes venait commémorer l'anniversaire du jour où il avait échappé à la mort. Celle qui était chargée de prononcer le discours commença en voyant le Président:
- Fils du peuple...
Le maître avala sa salive amère, évoquant peut-être ses années d'études auprès de sa mère sans ressources, dans une ville pavée de mauvaises volontés; mais le favori, qui cherchait à le flatter, hasarda à voix basse:
- Jésus aussi était fils du peuple !...
- Fils du peuple, répéta la femme au discours, du peuple, ai-je dit : le ciel, en ce jour de radieuse beauté, s'est vêtu de soleil, sa lumière protège tes yeux et ta vie, et sur l'exemple du travail sacro-saint il nous enseigne que dans la voûte céleste à la lumière succède l'ombre, l'ombre de la nuit noire et sans pardon d'où sortirent les mains criminelles qui, au lieu de semer les champs, comme toi, Maître, tu nous l'enseignes, semèrent sous tes pas une bombe qui, malgré sa scientifique fabrication européenne, te laissa indemne...
Des applaudissements nourris étouffèrent la voix de Langue de Vache - c'était le surnom de la commère qui lisait le discours - et, tels des éventails, les vivats en série agitèrent l'air jusqu'au héros du jour et à sa suite.
- Vive Monsieur le Président!
- Vive Monsieur le Président de la République!
- Vive Monsieur le Président Constitutionnel de la République!
- Qu'un ban résonne dans tous les cieux du monde pour ne finir jamais! Vive Monsieur le Président Constitutionnel de la République! Bienfaiteur de la Patrie! Chef du Grand Parti Libéral! Libéral de cœur et protecteur de la Jeunesse Studieuse!
Langue de Vache continua:
- Le drapeau aurait été flétri dans la boue s'ils avaient réussi, ces mauvais fils de la Patrie, soutenus dans leur projet criminel par les ennemis de Monsieur le Président. Ils n'avaient jamais songé que la main de Dieu veillait et veille sur votre précieuse existence, avec l'approbation de tous ceux qui, vous sachant digne d'être le Premier Citoyen de la Nation, vous entourèrent dans cet instant «tra-chic››; et ils vous entourent encore, et vous entoureront toutes les fois que ce sera nécessaire !
Oui, messieurs... mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais nous savons que, si s'étaient accomplis les funestes desseins de ce jour, de triste mémoire pour notre pays qui marche à la tête des peuples civilisés, la Patrie serait restée orpheline de son père et protecteur, elle serait tombée entre les mains de ceux qui, dans l'ombre, fourbissent leurs poignards pour en frapper la poitrine de la démocratie, comme l'a dit ce grand tribun qui s'appela Juan Montalvo! Grâce à vous, le pavillon flotte toujours, intact, et l'oiseau n'a pas fui le blason de la patrie, oiseau qui, comme le tennix, renaquit des cendres, des mains - se corrigeant - des "mâmes" qui déclarèrent l'indépendance nationale dans cette aurore de liberté d'Amérique, sans répandre une seule goutte de sang, ratifiant de telle sorte ce désir de liberté qu'avaient manifesté les "mâmes" - se corrigeant - les "mâmes" des Indiens qui luttèrent jusqu'à la mort pour la conquête de la liberté et du droit!
Donc, messieurs, c'est pour cela que nous venons féliciter aujourd'hui le plus illustre protecteur des classes nécessiteuses, qui veille sur nous avec l'amour d'un père et qui mène notre pays, comme je l'ai déjà dit, à l'avant-garde du progrès auquel Fulton donna l'impulsion avec la découverte de la vapeur et que Juan Santa Maria défendit de l'intrusion du flibustier en mettant le feu à la poudrière fatale dans les terres de Lempira. Vive la Patrie! Vive le Président Constitutionnel de la République, Chef du Parti Libéral! Bienfaiteur de la Patrie, protecteur de la femme sans défense, de l'enfant et de l'instruction! "
Les vivats de Langue de Vache se perdirent dans un incendie de cris qu'une mer d'applaudissements éteignit. Le Président répondit quelques mots, la main droite crispée sur le balcon en marbre, de trois-quarts pour éviter d'exposer sa poitrine, promenant son visage d'une épaule à l'autre pour voir la foule, le sourcil froncé, les yeux baladeurs. Hommes et femmes essuyèrent plus d'une larme.
- Si Monsieur le Président rentrait, prit sur lui de dire Visage d'Ange en l'entendant renifler, cette populace l'affecte trop...
Le Président du Tribunal Spécial se précipita vers le Président qui revenait du balcon, entouré de quelques amis, pour lui faire part de la fuite du Général et le féliciter avant les autres de son discours; mais, comme tous ceux qui s'étaient approches dans cette intention, il s'arrêta à mi-chemin, retenu par une crainte étrange, par une force surnaturelle et, pour ne pas rester la main en l'air, il la tendit à Visage d'Ange.
Le favori lui tourna le dos, et c'est la main en l'air que le Président du Tribunal entendit alors la première d'une série d'explosions qui, comme dans une décharge d'artillerie, se succédèrent en un instant. Et on entend des cris; et on saute, et on court, on piétine les chaises renversées, et les femmes ont des crises de nerfs; et on entend les pas des soldats qui s'éparpillent comme des grains de riz, la main sur leur cartouchière qui ne s'ouvre pas assez vite, le fusil chargé, parmi des mitrailleuses, des miroirs brisés, des officiers, des canons... Un colonel se perdit vers le haut d'un escalier, rengainant son revolver. Un autre descendait un escalier en colimaçon en rengainant son revolver. Ce n'était rien. Un capitaine franchit une fenêtre en rengainant son revolver. Un autre gagna la porte en rengainant son revolver. Ce n'était rien. Ce n'était rien! Mais l'atmosphère était glaciale. La nouvelle se répandit dans les salons en désordre. Ce n'était rien. Peu à peu les invités se rassemblèrent; celui-ci avait mouillé sa culotte de peur, celui-là en avait perdu ses gants, et ceux qui reprenaient des couleurs ne pouvait récupérer la parole, et ceux qui retrouvaient la parole manquaient toujours de couleurs. Ce que personne ne put dire ce fut par où et à quel moment avait disparu Monsieur le Président.
Par terre gisait, au pied d'un escalier, le premier tambour de la musique militaire. Il avait roulé depuis le premier étage avec son tambour et tout, leur faisant le coup du "sauve-qui-peut"....

"Facundo" (1845), de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)
Natif de San Juan, aux pieds des Andes, l'argentin Domingo Faustino Sarmiento s'exila par deux fois au Chili en 1831 et 1840 pour dénoncer la dictature de Juan Manuel de Rosas (1835-1852), objet de son essai "Facundo o Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga" (1845) : cette dictature n'est au fond que la conséquence de deux visions antinomiques qui traversent la société argentine, le monde urbain, dit civilisé, d'origine européenne, et le monde rural, dominée par la personnalité du "gaucho", semi-nomade, individualiste et sauvage, dont le caudillo Juan Facundo Quiroga est l'archétype. Rosas, l'allié de ce dernier, est alors représenté ici, via des procédés parfois quelque peu romanesques, comme l'homme des trahisons. Le libéral Sarmiento restera partagé entre ces deux aspirations, le "gaucho" et le "désir d'accession à la civilisation" tout au long de d'un parcours qui le conduira à devenir député, sénateur, ministre d'État, ambassadeur aux États-Unis, et président de la République entre 1868 et 1874.
Singulier parcours durant lequel il écrivit notamment "Recuerdos de provincia" (1850), autobiographique, "Viajes por África, Europa y América" (1849), récit de ses expériences à l'étranger, "Vida de Dominguito" (1886), récit portant sur la vie de son fils adoptif décédé au Paraguay, "Educación Popular"... "El que muere en esas ejecuciones del capataz no deja derecho a ningún reclamo, considerándose legítima la autoridad que lo ha asesinado. Así es como en la vida argentina empieza a establecerse el predominio de la fuerza bruta, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates", écrira-t-il : : c'est ainsi qu'a commencé à s'imposer dans la vie argentine la prédominance de la force brute, la prépondérance du plus fort, l'autorité sans limites et sans responsabilité des responsables, la justice administrée sans formes et sans débats....

"FACUNDO", chef-d`œuvre de l`homme politique et écrivain argentin Domingo Faustino Sarmiento,publié en 1845, pendant son exil au Chili. C`est un livre essentiel pour la connaissance de l'Argentine et, en même temps, une satire désormais classique du despotisme ("caudillo") hérité de l'époque coloniale. Il jette en outre une lueur prophétique sur l`avenir des peuples d`Amérique du Sud. "Facundo", qui donne son titre à I`ouvrage, est le nom de baptême de Quiroga, célèbre aventurier, "gaucho barbare" et tyran sanguinaire de San Juan, qui fut même gouverneur de Buenos Aires et dont Rosas lui-même se débarrassa sans scrupules le jour de son triomphe. Quiroga est représenté avec vigueur. Autour de lui sont évoquées d`autres figures tragiques, partout ce n`est que conflits d'ínstincts féroces et en même temps raffinés, exacerbés par une lutte incessante et implacable, tenaillés par la soif du pouvoir, balançant perpétuellement entre la victoire et la défaite, la tyrannie et l'esclavage, la ville et la pampa, la "civilisation" et la "barbarie" (le sous-titre de l`œuvre).
Le frère général Felice Aldao, quittant la bure pour la guerre, et le "Chaco" (Vicente Peñalosa, autre chef de bande) sont, après Facundo, les héros des autres parties du livre, consacrées au récit des événements historiques de l`orageuse période d`une guerre civile qui se poursuivit trente années durant. Tout à la fin, parmi les principaux acteurs de ce drame national, apparaît Sarmiento lui-même, réorganisateur de cette justice dont il se fait le champion.
L`auteur excelle dans les descriptions, véritables eaux-fortes, évoquant le pays dans ses traits essentiels, nous donnant des portraits de ses types les plus caractéristiques, un monde primitif au sortir d'un chaos d”instincts et de passions, cherchant douloureusement à se définir et se coordonner, tendu dans de tragiques convulsions, vers un idéal de paix et de bien-être social.
"Facundo" demeure un classique de l'Argentine et constitue, avec le "Martín Fierro" (1872) de José Hernandez (1834-1886), la pierre de touche de cette jeune littérature, ce dernier, écrit en langue "gaucho", mélange de vieil espagnol et d'expression propre au poète, histoire d'un gaucho enrôlé de force pour renforcer les garnisons de frontière et incapable de supporter la discipline militaire..

"Amalia" (1855), de José Mármol (1818-1871)
On a pu dire que la littérature argentine est née de deux événements majeurs, l'apparition du Romantisme en 1830, puis l’exil massif des écrivains sous le gouvernement de Juan Manuel de Rosas dès 1838 : le gouverneur de Buenos Aires a gouverné l’Argentine une première fois entre 1829 et 1832 et une seconde fois entre 1835 et 1852, et c’est au cours de ce dernier mandat qu'il a acquis sa réputation de tyran. Natif de Buenos Aires, proche de cette fameuse génération "libérale" de 1838 que mena le poète et nouvelliste Esteban Echeverria (1805-1851) contre la dictature de Rosas (1835-1852), Mármol est emprisonné en 1839 et doit s'exiler à Montevideo : la plupart de ses œuvres datent de ces années d'exil pendant lesquelles il voyage à travers l'Amérique du Sud, et , en 1851, commence la publication de son célèbre roman, "Amalia" : il met en scène et dénonce à la façon d'un documentaire détaillé les mœurs policières dans le Buenos Aires de l'année 1840 et multiples horreurs engendrées par la dictature de Rosas au travers des amours tragiques de la belle Amalia et d'Eduardo Belgrano qui tentait de fuir le pays. Et l'auteur argentin mêle la fiction et sa propre histoire personnelle (prison et fuite)...
"El 4 de mayo de 1840, a las diez y media de la noche, seis hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se detiene, y dice a los otros:
-Todavía una precaución más.
-Y de ese modo no acabaremos de tomar precauciones en toda la noche -contesta otro de ellos, al parecer el más joven de todos, y de cuya cintura pendía una larga espada medio cubierta por los pliegues de una capa de paño azul que colgaba de sus hombros.
-Por muchas que tomemos, serán siempre pocas -replica el primero que había hablado-. Es necesario que no salgamos todos a la vez. Somos seis; saldremos primeramente tres, tomaremos la vereda de enfrente, un momento después saldrán los tres restantes, seguirán esta acera, y nuestro punto de reunión será la calle de Balcarce, donde cruza con la que llevamos.
-Bien pensado.
-Sea, yo saldré delante con Merlo, y el señor -dijo el joven de la espada a la cintura, señalando al que acababa de hacer la indicación.
Y, diciendo esto, tiró el pasador de la puerta, la abrió, se embozó en su capa, y atravesando a la acera opuesta con los personajes que había determinado, enfiló la calle de Belgrano, con dirección al río. Los tres hombres que quedaban salieron dos minutos después, y luego de haber cerrado la puerta, tomaron la misma dirección que aquéllos, por la acera prefijada..."
« Le 4 mai 1840, à dix heures et demie du soir, six hommes traversaient la cour d’une petite maison de la rue de Belgrano, dans la ville de Buenos Aires. Arrivés dans l’entrée, aussi sombre que le reste de la maison, l’un d’eux s’arrêta et dit aux autres :
— Encore une précaution de plus.
— Et de cette façon, nous n’en finirons pas de prendre des précautions toute la nuit, répondit un autre, apparemment le plus jeune de tous, et dont la taille était ceinte d’une longue épée à demi dissimulée par les plis d’une cape de laine bleue qui lui tombait des épaules.
— Si nombreuses qu’elles soient, elles ne seront jamais suffisantes, répliqua le premier qui avait parlé. Il faut que nous ne sortions pas tous en même temps. Nous sommes six ; d’abord, trois sortiront et prendront le trottoir d’en face. Un instant après, les trois autres suivront par ce côté-ci, et notre point de rendez-vous sera la rue de Balcarce, à l’intersection avec celle que nous suivons.
— Bien pensé.
— Soit, je sortirai en premier avec Merlo et Monsieur, dit le jeune homme à l’épée, désignant celui qui venait de faire cette suggestion.
Et, ce disant, il tira le verrou de la porte, l’ouvrit, s’enveloppa dans sa cape et, traversant vers le trottoir opposé avec les personnes qu’il avait désignées, s’engagea dans la rue de Belgrano en direction du fleuve. Les trois hommes restants sortirent deux minutes plus tard et, après avoir refermé la porte, prirent la même direction que les premiers, du côté convenu… »

Dans les années 1910-1920, c'est le Mexique qui occupe le devant de la scène sud-américaine. La révolution mexicaine, qui entend renverser la dictature de Porfirio Díaz, se mue rapidement en une révolte générale. En 1913, Francisco Madero est chassé du pouvoir par celui qu'il a lui-même nommé à la tête de l'armée, le général Victoriano Huerta. Ce dernier ne reste au pouvoir que quelques mois, incapable de s'imposer ni aux groupes réclamant la réforme agraire conduits par Venustiano Carranza, Pancho Villa et Emiliano Zapata, ni aux Américains....

"Tirano Banderas" (1926), de l'espagnol Ramón del Valle-Inclán (1866-1936)
En sous-titre de "Novela de tierra caliente", le roman "Tirano Banderas" inaugure, dit-on, la fameuse tradition du portrait du dictateur latino-américain. L'intrigue se déroule dans un pays imaginaire d'Amérique centrale, la Républica de Santa fe de Tierra firme, à la fin du XIXe siècle, sur lequel règne un Santos Bandera qu'une révolte libératrice va liquider en trois jours de complots et de tragédie. Le roman est construit avec une grande inventivité de langage et sous forme d'une quasi pièce de théâtre particulièrement éblouissante et efficace. Natif de Vilanova de Arosa (Pontevedra), le dramaturge, romancier et journaliste espagnol Ramón del Valle-Inclán assume un personnage de dandy, extravagant, contradictoire, conservateur et révolutionnaire, rénovateur de la littérature espagnole qui n'hésite pas à parcourir le Mexique en 1892 puis en 1922 en plein sursaut post-révolutionnaire. Galicien dans l'âme dans ses nombreux textes en prose, sa carrière théâtrale prend son essor après 1910 lorsqu'il accompagne en Argentine l'actrice Jesfina Blanco devenue son épouse (1907). Valle-Inclán les suivit tour à tour. Sa première manière, marquée par la mélodie des rythmes, l'éclat des images, l'exaltation et le raffinement des sensations, en fait, auprès de Rubén Darío et de Juan Ramón Jiménez, l'un des plus grands artistes du « modernisme » en Espagne.
Sinfonía del Trópico-Primera Parte
"anta Fe de Tierra Firme —arenales, pitas, manglares, chumberas— en las cartas antiguas, Punta de las Serpientes.
Sobre una loma, entre granados y palmas, mirando al vasto mar y al sol poniente, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales San Martín de los Mostenses. En el campanario sin campanas levantaba el brillo de su bayoneta un centinela. San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era, por mudanzas del tiempo, Cuartel del Presidente Don Santos Banderas. —Tirano Banderas—.
El Generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios, después de haber fusilado a los insurrectos de Zamalpoa: Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. En el Perú había hecho la guerra a los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla de verde veneno. Desde la remota ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, está mirando las escuadras de indios, soturnos en la cruel indiferencia del dolor y de la muerte. A lo largo de la formación chinitas y soldaderas haldeaban corretonas, huroneando entre las medallas y las migas del faltriquero, la pitada de tabaco y los cobres para el coime. Un globo de colores se quemaba en la turquesa celeste, sobre la campa invadida por la sombra morada del convento. Algunos soldados, indios comaltes de la selva, levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas ferias de Santos y Difuntos. Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo..."
"Symphonie des Tropiques – Première Partie
« Sainte-Foi-de-Terre-Ferme — arènes, agaves, mangroves, figuiers de Barbarie — sur les anciennes cartes, Pointe-des-Serpents.
*Sur une colline, entre grenadiers et palmiers, face à l’immense océan et au soleil couchant, San Martín de los Mostenses enflammait les azulejos de ses coupoles coloniales arrondies. Dans le clocher sans cloches, une sentinelle dressait l’éclat de sa baïonnette. San Martín de los Mostenses, ce couvent démantelé d’où une lointaine révolution avait chassé les moines, était devenu, par les caprices du temps, le Quartier du Président Don Santos Banderas. — Tirano Banderas —.
*Le Généralito venait d’arriver avec quelques bataillons d’Indiens, après avoir fusillé les insurgés de Zamalpoa. Immobile et taciturne, juché de profil à une lointaine fenêtre, attentif à la relève des gardes dans la plaine fauve du couvent, il ressemblait à un crâne coiffé de lunettes noires et d’un petit nœud de clergyman. Au Pérou, il avait fait la guerre aux Espagnols, et de ces campagnes lui venait l’habitude de mâcher la coca, laissant toujours aux commissures de ses lèvres un filet de salive verte comme un poison. Depuis la fenêtre lointaine, figé dans une immobilité de corbeau sacré, il observait les escouades d’Indiens, sombres dans l’indifférence cruelle face à la douleur et à la mort. Le long des rangs, des chinitas et des soldaderas trottinaient, fouillant entre les médailles et les miettes des poches, quémandant une bouffée de tabac ou quelques pièces pour le jeu. Un ballon multicolore se consumait dans le turquoise du ciel, au-dessus de la plaine envahie par l’ombre violette du couvent. Quelques soldats, Indiens comaltes de la forêt, levaient les yeux.
Sainte-Foi célébrait ses fameuses foires des Saints et des Défunts. Tirano Banderas, à la fenêtre lointaine, n’était toujours que le gribouillis d’une chouette… »

"La sombra del caudillo" (1928-1929), de Martín Luis Guzmán (1887-1976)
Témoin privilégié des arcanes de la Révolution mexicaine, Martín Luis Guzmán a su démonter le fonctionnement du système politique mexicaine naissant et de ses dérives, notamment dans ses deux principales caractéristiques, le fameux "caudillisme" qui, sous une apparence populiste, ne fait qu'installer les éléments de sa prise de pouvoir et de conservation par tous les moyens de celui-ci, et l'apathie des masses populaires...
Natif de Chihuahua, le romancier mexicain Martin Luis Guzman devient le secrétaire de Pancho Villa après le coup d'Etat du général Victoriano Huerta qui renverse le président Francisco Madero en 1913. C'est aussi le point de départ du roman "El aguila y la serpiente" (L'Aigle et le serpent, 1928), qui va couvrir la phase la plus sanglante de la révolution, de 1913 à 1915 : il y révèle non seulement sa fascination pour les grandes figures de la révolution de 1910 (Vasconcelos, Pancho Villa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata), et son attachements aux mythes fondateurs du Mexique, mais plus encore que les autres romanciers de la révolution mexicaine (Gregorio López y Fuentes (1895-1966), "La Tierra", 1933, "El Indio", 1935; Rafael Felipe Muñoz (1899-1972), "Vámonos con Pancho Villa!", 1931; Mariano Azuela (1873-1952), "Los de abajo", 1916) Martín Luis Guzmán propose une analyse sans concession des différents protagonistes et épisodes avec un style suffisamment puissant pour donne une grande vérité à cette fresque par ailleurs mal équilibrée. Il vivra en Espagne de 1925 à 1936 puis regagnera sa patrie pour se consacrer à la littérature...
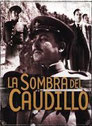
Dans "La sombra del caudillo" (1928-1929, L'Ombre du caudillo), Martín Luis Guzmán évoque avec une précision d'autant plus froide et détaillée que l'on sent son regard désormais désabusé qu'il jette sur la révolution mexicaine, les machinations qui ont agité la fin de la présidence du général Álvaro Obregón (1920-1924) et de celle de Plutarco Elias Calles (1924-1928). Son point de départ historique est l'assassinat du général Francisco Serrano, candidat à la présidence du Mexique en 1927, point de départ à partir duquel l'écrivain installe ses deux protagonistes, le général Ignacio Aguirre, honnête, idéaliste, démocrate, et Hilario Jimenez le corrompu, l'ambitieux, qui vont s'affronter dans un combat sans merci, fait d'attentats, de supplices et d'arrestations, au nom de la liberté...
"El Cudillac del general Ignacio Aguirre cruzó los rieles de la calzada de Chapultepec y vino a parar, haciendo rápido esguince, a corta distancia del apeadero de "Insurgentes".
Saltó de su sitio, para abrir la portezuela, el ayudante del chofer. Se moüeron con el cristal, en reflejos pavonados, trozos del luminoso paisaje urbano en las primeras horas de la tarde -perfiles de casas, árboles de la avenida, azul de cielo cubierto a trechos por cúmulos blancos y grandes...
Y así transcurrieron varios minutos.
En el interior del coche seguían conversando, con la animación característica de los jóvenes políticos de México, el general Ignacio Aguirre, ministro de la Guerra, y su amigo inseparable, insubstituible, íntimo: el diputado Axkaná. Aguirre hablaba envolviendo sus frases en el levísimo tono de despego que distingue al punto, en México, a los hombres públicos de significación propia. A ese matiz reducía, cuando no mandaba, su autoridad inconfundible. Axkaná al revés: dejaba que las palabras fluyeran, esbozaba teorías, entraba en generalizaciones y todo lo subrayaba con actitudes que a un tiempo lo subordinaban y sobreponían a su interlocutor, que le quitaban importancia de protagonista y se la daban de consejero. Aguirre era el político militar; Axkaná, el político ciül; uno, quien actuaba en las horas decisivas de las contiendas públicas; otro, quien creía encauzar los sucesos de esas horas o, al menos, explicarlos.
-Por momentos, el estrépito de los tranvías -fugaces en su carrera a lo largo delacalzada-resonaba en el interior del coche. Entonces los dos amigos, forzando lavoz, dejaban traslucir nuevos matices de sus personalidades distintas. En Aguirre se manifestaban asomos de fatiga, de impaciencia. En Axkaná apuntaba una rara maestría de palabra y de gesto, sin menoscabo de su aire reflexivo, lleno de reposo.
Ambos, al fin, dieron señales de despedirse mientras reducían a conclusiones breves el tema de su charla.
Dijo Aguirre:
-Quedamos entonces en que tú convencerás a Olivier de que no puedo aceptar la candidatura a la Presidencia de la República...
-Por supuesto.
-Y que él y todos deben sostener aliménez, que es el candidato del Caudillo...
-También. Axkaná tendió la mano. Aguirre insistió:
-¿Con los mismos argumentos que acabas de exponerme?
-Con los mismos.
Las manos se juntaron.
-¿Seguro?
-Seguro.
-Hasta la noche entonces.
-Hasta la noche.
Y Axkaná brincó fuera del auto con ágil movimiento..."
"La Cadillac du général Ignacio Aguirre franchit les rails de la chaussée de Chapultepec et vint s'arrêter, après une brève embardée, à courte distance de la station "Insurgentes".
L'aide du chauffeur bondit de son siège pour ouvrir la portière. Dans les reflets irisés de la vitre se reflétaient des fragments du paysage urbain en cette première heure de l'après-midi - silhouettes de maisons, arbres de l'avenue, morceaux de ciel bleu parsemé de grands cumulus blancs...
Ainsi s'écoulèrent plusieurs minutes.
À l'intérieur du véhicule, le général Ignacio Aguirre, ministre de la Guerre, et son ami inséparable, irremplaçable, son confident - le député Axkaná - poursuivaient leur conversation avec cette verve caractéristique des jeunes politiciens mexicains. Aguirre parlait en enveloppant ses phrases de ce ton à peine détaché qui distingue aussitôt, au Mexique, les hommes publics marquants. C'est à cette nuance qu'il réduisait - quand il ne l'imposait pas - son autorité incontestable. Axkaná, au contraire : laissait couler les mots, esquissait des théories, se perdait en généralités, le tout souligné par des attitudes qui tantôt le subordonnaient, tantôt le surplombaient, lui ôtant l'importance du protagoniste pour lui conférer celle du conseiller. Aguirre était le politique militaire ; Axkaná, le politique civil ; l'un agissait aux heures décisives des luttes publiques ; l'autre croyait canaliser ces événements ou du moins les expliquer.
Par instants, le vacarme des tramways - filant le long de la chaussée - résonnait dans l'habitacle. Alors les deux amis, forçant la voix, laissaient transparaître de nouvelles facettes de leurs personnalités distinctes. Chez Aguirre perçaient des signes de fatigue, d'impatience. Chez Axkaná se révélait une rare maîtrise de parole et de geste, sans altérer son air réfléchi, empreint de sérénité.
Enfin, tous deux marquèrent leur séparation en résumant brièvement le sujet de leur entretien.
Aguirre déclara :
-"Nous sommes donc d'accord que tu convaincras Olivier que je ne peux accepter la candidature à la Présidence de la République..."
-"Bien sûr."
-"Et qu'eux tous doivent soutenar Jiménez, le candidat du Caudillo..."
-"Également."
Axkaná tendit la main. Aguirre insista :
-"Avec les mêmes arguments que tu viens de m'exposer ?"
-"Les mêmes."
Les mains se serrèrent.
-"Sûr ?"
-"Sûr."
-"À ce soir, alors."
-"À ce soir."
Et d'un bond souple, Axkaná sauta hors de la voiture...

L'adaptation cinématographique que réalisa Julio Bracho Pérez-Gavilán (1909-1978) de "La sombra del caudillo" (1960), avec Tito Junco dans le rôle d'Ignacio Aguirre et Carlos López Moctezuma Pineda, se heurta à la censure pendant pratiquement une trentaine d'années tant le texte de Martín Luis Guzmán se montre corrosif dans son évocation implacable de la conduite du pouvoir qui suit la Révolution mexicaine...

Dans les années 1930, au Nicaragua, Tacho Somoza, assassin de Cesar Augusto Sandino, prend le pouvoir en 1936, soutenu par les Etats-Unis, et établit une dictature fortement anticommuniste que ses descendants perpétueront jusqu'en 1979. Gerardo Machado (1871-1939), élu président à Cuba transforme son régime en dictature et ne sera chassé du pouvoir qu'en 1933.
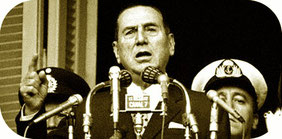
Dans les années 1940, Getulio Vargas qui a instauré en 1937, au Brésil, "l'Etat Nouveau", est chassé par un coup d'Etat militaire en 1945, avant d'être élu en 1951 président de la République. En Argentine, après une première tentative ratée de coup d'Etat en juin 1943, l'armée réussit "le coup d'Etat des colonels", et, en 1946, Juan Domingo Peron, colonel de la junte, est élu président de la République. Au Salvador, le général Salvador Castañeda accède au pouvoir par un coup d'Etat en 1945 et dirige le pays jusqu'en 1948, date à laquelle lui succède "un conseil révolutionnaire civil et militaire". Au Pérou, le général Manuel Odria (1897-1974) est porté au pouvoir par un coup d’État militaire en octobre 1948 et se retire du pouvoir en 1956 en ayant mené un mélange de populisme et de répression.

Dans les années 1950, au Guatemala, le gouvernement élu de Jacobo Arbenz est renversé par un putsch soutenu par les Etats-Unis, marquant le début de 40 années d'exactions des escadrons de la mort, qui feront plus de 200 000 victimes. Au Paraguay, le général Alfredo Stroessner prend le pouvoir en 1954 et instaure une longue dictature, alliage de népotisme, de corruption et de violences, et qui perdurera jusqu'en 1989. Le Costa Rica fera lui l'objet de plusieurs tentatives de renversement du régime du président José Figueres dans les années 1950 puis dans les années 1970.
Le roman du dictateur est devenu le roman de la dictature, conçue moins comme un régime inique que comme une dépravation profonde de la nature humaine, qui trouve dans le pouvoir absolu l'occasion de libérer et de satisfaire ses fantasmes : le cubain Alejo Carpentier, dans "El recurso del método" (1974) ou le colombien Gabriel García Márquez, dans "El otoño del patriarca" (1976). ..
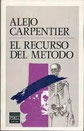
"El recurso del metodo" (1974, Le recours de la méthode), d'Alejo Carpentier (1904-1980)
"El recurso del método" (Raison d'Etat) est souvent comparé à "Yo, el Supremo" de Roa Bastos ou "El otoño del patriarca" de García Márquez, mais avec une approche plus ironique que mythique. Carpentier y fusionne son réalisme magique avec une analyse politique acerbe, ce qui en fait une référence majeure sur le caudillismo dans la littérature latino-américaine.
Le protagoniste, un "Primer Magistrado" sans nom (inspiré de figures comme Gerardo Machado ou Fulgencio Batista), incarne l'archétype du caudillo : autoritaire, grotesque, cultivé mais brutal, oscillant entre prétentions européennes et despotisme tropical. Carpentier démonte les mécanismes du pouvoir dictatorial (violence, théâtralité politique, recours à une pseudo-civilisation pour justifier la barbarie). Et le roman mêle un langage précieux et des scènes de répression brutale, soulignant l'absurdité du pouvoir. À Paris, il jouera le rôle du leader érudit, fréquentant les salons, s’entourant d’intellectuels, et se présentant comme un modernisateur. Mais cette "civilisation" est un masque pour légitimer sa violence politique. Dans les salons, il parlera de progrès, mais dans son pays, il réprimera dans le sang toute opposition (scènes de tortures, exécutions sommaires). Carpentier souligne l’absurdité de ce personnage qui cite Descartes ("Je pense, donc je suis") tout en ordonnant des massacres, révélant l’imposture des Lumières instrumentalisées par le pouvoir.
Paris est ici le décor de l’hypocrisie : le dictateur s’acoquine avec les banquiers parisiens pour s’enrichir, montrant que son "éclairement" sert en réalité à piller son pays au profit des puissances étrangères. Et son faste parisien (loges d’opéra, costumes somptueux) contraste avec la misère de son peuple, soulignant que sa "culture" n’est qu’une mise en scène pour assoir son autorité...

Francisco Ayala (1906-2009)
L'espagnol Francisco Ayala est le témoin lucide d’un siècle de chaos, un écrivain qui refuse les illusions. Natif de Genade, professeur de droit politique et de sociologie jeté dans l'exil par la Guerre civile, en 1939, - réfugié à Buenos Aires, à Porto-Rico, aux Etats-Unis, jusqu'en 1980 -, il entend dénoncer de manière caricaturale les dictatures sous toutes leurs formes, notamment à travers un dictateur centre-américain, Ramon Bocanegra ("Bouche noire" : la corruption, les mensonges du pouvoir, et une oralité destructrice; il décrète la mort d’un opposant en mangeant un gâteau, sans même y penser).).
Bocanegra ressemble aux caudillos des années 1950 (comme Trujillo en République dominicaine ou Somoza au Nicaragua), mais Ayala évite le portrait réaliste pour en faire une caricature universelle. Comme dans "Le Procès", Bocanegra incarne un pouvoir absurde et bureaucratique, où la violence est banale et incompréhensible. Et contrairement aux figures héroïques ou monstrueuses des romans traditionnels, Bocanegra est lâche, vulgaire et incompétent. Ses discours sont vides, ses décisions arbitraires (il fait exécuter un ministre parce que sa cravate lui déplaît). Et Ayala, ayant connu l'exil après la guerre d’Espagne, puise dans son observation des régimes totalitaires (franquisme, péronisme) pour créer un despote à la fois ridicule et terrifiant.
Ayala n’était pas seulement romancier, mais aussi essayiste (ses travaux sur le droit, la sociologie (Tratado de sociología, 1947*) et la politique (comme Razón del mundo, 1944) révèlent une pensée profonde sur les crises du XXe siècle), traducteur (il a traduit des œuvres clés de Thomas Mann, Rilke et Kafka, introduisant des courants européens en Espagne) et critique littéraire (ses analyses sur Cervantès ou Galdós montrent une finesse théorique rare).
Dans "Muertes de perro" (1958), puis dans "El fondo del vaso" (1962), Francisco Ayala entend mettre en garde contre les effets de cette corruption politique que fait subir le mécanisme de la dictature au tissu social tout entier : le fait que l'assassinat du dictateur puisse plonger son pays dans un chaos insondable sans qu'aucun ordre social semble ne pouvoir se substituer révèle tout le pessimisme de l'écrivain quant à notre monde contemporain ("El jardin de las delicias", 1971 : l’histoire détruit les individus). Contrairement au lyrisme de García Lorca ou au baroque de Carpentier, Ayala adopte un style clinique, presque sociologique, pour décrire la cruauté humaine. Oublié pendant l’exil, il est redécouvert dans les années 1980, recevant le Prix Cervantes en 1991...

"Muertes de perro" (Morts de chien, 1958)
"Muertes de perro" est l'un des romans les plus impressionnants écrits en espagnol sur l'arbitraire, l'abus de pouvoir, la dégradation humaine et la corruption qui caractérisent les dictatures. Au fur et à mesure que son récit progresse, reconstituant la vie d'Antón Bocanegra, despote tout-puissant d'un petit pays tropical du continent américain, le narrateur, Pinedo, témoin invalide de cette "grotesca danza de la muerte", va se révéler dans toute son abjection, soutenu dans son récit par le Journal intime de Tadeo Raquena, le secrétaire particulier du dictateur. Au-delà de la reconstitution détaillée d'une dictature, qui se veut défendre la Vérité, c'est pour Pinedo l'enjeu de se faire une place dans l'Histoire et, pour se faire aller, ne pas reculer devant un meurtre. Quant à Bocanegra, il n’est pas un monstre, mais un homme moyen grisé par l’impunité. En cela, Ayala rejoint Hannah Arendt : le mal est bureaucratique, quotidien, et donc d’autant plus effrayant ...
Mais le vrai génie d’Ayala est de révéler comment la société entretient le tyran : les intellectuels le flattent pour survivre, le peuple adore ses caprices, et les États-Unis le soutiennent pour des raisons géopolitiques ("Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta").

L'Amérique latine des années 1960 subit une dizaine de coups d'Etat contre des gouvernements pour la plupart démocratiquement élus : au Salvador, une junte, inspirée par l'expérience cubaine, renverse en octobre 1960 le pouvoir que détient le Parti révolutionnaire de l'Unité démocratique depuis la révolution de 1948, mais est elle-même renversée en janvier 1961 par un coup d'Etat du lieutenant-colonel Julio Rivera. En 1962 puis en 1966, les gouvernements argentins sont destitués par des coups d'Etat. En juillet 1963, l'armée renverse Carlos Julio Arosemena, le président de l'Equateur en poste depuis 1961, mais la junte militaire est elle-même renversée à son tour en mars 1966. En Bolivie, le coup d'Etat du colonel Barrientos en 1964 marque le début d'une succession de régimes militaires et la dictature est véritablement instaurée à partir de 1974. Au Brésil, le coup d'Etat militaire de 1964 renverse le président élu Joao Goulart et instaure une dictature violemment anti-communiste, qui va sévir pendant plus de 15 ans. En 1968, le Pérou voit le commandant Juan Velasco Alvarado, renversent le président élu Fernando Belaunde Terry. Enfin, le Général Omar Torrijos Herrera prend le pouvoir au Panama et le conservera jusqu'à sa mort en 1981.

Parallèlement, c'est en 1966 que, soutenue par la Révolution cubaine et l'argentin Che Guevara, fut lancée une guérilla marxiste-léniniste (Ejército de Liberación Nacional de Bolivia), internationaliste par volonté politique, en charge de s'implanter en Bolivie et de se diffuser à l'ensemble du continent. Mais l'arrestation de la plupart de ses membres et l'exécution du Che en octobre 1967 interrompirent toute velléité de révolution globale et entraînèrent le repli des différents mouvements dans les frontières de leurs différentes nations : Tupamaros, en Uruguay, communistes du Sendero Luminoso (Sentier lumineux) de Abimael Guzmán, au Pérou, Ejército Popular de Liberación, en Colombie, Fuerzas Armadas Revolucionarias, en Argentine...

Les années 1970 continuent et amplifient le mouvement de la décennie précédente. Cette longue période de régimes militaires autoritaires se poursuit au Chili en 1973, qui voit le général Augusto Pinochet, soutenu par les Etats-Unis, renverser le gouvernement de Salvador Allende et instaurer un régime d'une rare violence (3000 morts dénombrés dès les premiers mois, des milliers de disparu, et des dizaines de milliers de personnes torturées). En Uruguay, le régime du président Bordaberry est renversé en 1973 par une junte militaire qui entreprend le contrôle systématique de la population. En Argentine, après le retour, la réélection puis la mort de Juan Peron, une junte militaire s'empare du pouvoir en 1976 et les sept années de dictature que subiront la population se solderont par plus de 10000 morts et disparus. Et c'est au milieu des années 1970 (novembre 1975), que l'ensemble des dictatures militaires alors en place, Augusto Pinochet, à Santiago du Chili, Alfredo Stroessner, à Asuncion, Jorge Rafael Videla, à Buenos Aires, Juan Bordaberry, à Montevideo, Hugo Banzer, à Sucre, Ernesto Geisel, à Brasilia, soutiennent la tragique "Operación Cóndor", avec le soutien tacite des Etats-Unis, qui a pour projet de mener une lutte anti-guerilla et une campagne d'assassinats politiques des différents opposants exilés aux Etats-Unis et en Europe. Durant cette période, les coups d'Etats militaires ont aussi pour finalité première d'éradiquer par tous les moyens les "guérilleros terroristes gauchistes" : Tupamaros (1965-2010) en Uruguay, Mouvement de la gauche révolutionnaire chilienne, Montoneros (1970-1979) en Argentine, etc.

Augusto Roa Bastos (1917-2005)
Roa Bastos a transformé la dictature en laboratoire du langage, révélant que le vrai tyran est le discours lui-même - D'origine métisse, portugaise et guarani, natif d'Asunción, le paraguayen Augusto Roa Bastos est devenu écrivain pour n'avoir connu que des exils successifs: "Je dois à l'exil d'innombrables révélations. En dépit des tristesses qu'il m'a causées, sans l'exil je ne serais jamais devenu écrivain".
À quinze ans, il prend part à cette terrible guerre du Chaco, contre la Bolivie (1932-1935), séjourne deux ans à Londres, se réfugie en Argentine pour fuir la longue dictature du général Stroessner, puis gagne l'Europe en 1976 pour la dictature militaire qui s'installe en Argentine. Il aura publié un recueil de nouvelles, "El Trueno entre las hojas" (1953), témoignage de la lutte pour la vie des populations indigènes du Paraguay, "Hijo de Hombre" (1960, Fils d'homme) souvent présenté comme le chant de la "douleur paraguayenne", poursuivi sa défense des Indiens Guaranis et dénoncé leur exploitation (Los Pies sobre el agua, 1967 ; Madera quemada, 1967 ; Moriencia, 1967 ; Cuerpo presente y otros cuentos, 1971 ; Contar un cuento y otros relatos, 1984) : mais c'est avec "Yo el Supremo" (Moi, le Suprême) qui paraît à Buenos Aires en 1974 et connaît rapidement de très nombreuses rééditions en langue espagnole, que Roa Bastos livre une voix, celle d'un homme malade, solitaire, sans âge et sans visage, José Gaspar Rodríguez de Francia, "Suprême Dictateur", qui régna sans partage sur le Paraguay de 1814 à 1840. Le père fondateur de l'indépendance du Paraguay est aussi son premier dictateur, celui qui crée la nation et se met lui-même en scène, de sa prise de pouvoir à sa mort, dans un pays livré à l'inculture et à l'obéissance. "Je n'ai jamais aimé personne. Je m'en souviendrais. Quelque trace en serait restée dans ma mémoire. Sauf dans les rêves, et alors il s'agissait d'animaux. D'animaux de rêve, d'outre-monde. Des figures humaines d'une perfection indescriptible..."

"Yo el Supremo" (Moi, le Suprême, 1974)
Le Paraguayen Augusto Roa Bastos a toujours été un auteur discret que renforce un style bien sobre, usant de lettres, de témoignages anonymes, de monologues, d'une polyphonie loin de l'écriture plus baroque, pour ne pas dire brillante, d'un García Márquez ou d'un Alejo Carpentier. Ici, le protagoniste n'est pas un dictateur archétype rassemblant tous les traits des dictateurs latino-américains, mais un personnage historique reconstruit non tant pour le diaboliser que pour atteindre une certaine crédibilité : José Gaspar Rodríguez de Francia, dictateur du Paraguay au début du XIXe siècle, dit "dit El Supremo", fanatique, idéaliste et cruel, est aussi une figure paradoxale très éloignée du despote commun, un solitaire dont la puissance surprenait l'observateur étranger : "le peuple du Paraguay ne subit pas la tyrannie, mais s'y complaît et l'aime, le joug ne lui pèse pas, il ne désire pas entrer en communication avec les autres Nations, il ne comprend même pas que la situation politique et économique qui lui est faite est anormale et il n'en demande pas d'autre" (Charles Quentin, 1865).
Nous ne sommes plus tout à fait dans un roman de la dictature, mais dans celui de la puissance exercée par un homme à l'éthique singulière, liquidant les vestiges de l'ancienne puissance coloniale qui l'avait humiliée, contraignant ses concurrents à l'exil ou les emprisonnant, annihilant l'indépendance de l'Église actrice de son accusation d'être mulâtre. "El tema del poder, para mí, écrira-t-il, en sus diferentes manifestaciones, aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder, al bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan" ("Le sujet du pouvoir, pour moi, dans ses différentes formes, est le sujet du pouvoir. Dans tous mes travaux, que ce soit dans un contexte politique, religieux ou familial. Le pouvoir est un énorme stigmate, une sorte de fierté humaine qui doit contrôler le pouvoir de la personnalité des autres. C'est une condition non logique qui produit une société malade. La répression produit toujours la contre-attaque de la rébellion. Depuis mon enfance, j'ai ressenti le besoin de m'opposer au pouvoir, à la punition barbare pour des choses sans importance, dont les raisons ne se manifestent jamais.").
"Yo el Supremo Dictador de la República Ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadaver sea decapitado; la cabeza puesta en una pica por tres días en la Plaza de la República donde se convocará al pueblo al son de las campanas echadas al vuelo Todos mis servidores civiles y militares sufrirán pena de horca. Sus cadáveres serán enterradps en potreros de extramuros sin cruz ni marca que memore sus nombres.
Al término del dicho plazo, mando que mis restos sean quemados y las cenizas arrojadas al río....
¿Dónde encontraron eso? Clavado en la puerta de la catedral, Excelencia. Una partida de granaderos lo descubrió esta madrugada y lo retiró llevándolo a la comandancia. Felizmente nadie alcanzó a leerlo. No te he preguntado eso ni es cosa que importe. Tiene razón Usía, la tinta de los pasquines se vuelve agria más pronto que la leche. Tampoco es hoja de Gaceta porteña ni arrancada de libros, señor. ¡Qué libros va a haber aquí fuera de los míos!
Hace mucho tiempo que los aristócratas de las veinte familias han convertido los suyos en naipes. Allanar las casas de los antipatriotas. Los calabozos, ahí en los calabozos, vichea en los calabozos. Entre esas ratas uñudas greñudas puede hallarse el culpable. Apriétales los refalsos a esos falsarios. Sobre todo a Peña y a Molas. Tráeme las cartas en las que Molas me rinde pleitesía durante el Primer Consulado, luego durante la Primera Dictadura. Quiero releer el discurso que pronunció en la Asamblea del año 14 reclamando mi elección de Dictador. Muy distinta es su letra en la minuta del discurso, en las instrucciones a los diputados, en la denuncia en que años más tarde acusará a un hermano por robarle ganado de su estancia de Altos. Puedo repetir lo que dicen esos papeles, Excelencia. No te he pedido que me vengas a recitar los millares de expedientes, autos, providencias del archivo. Te he ordenado simplemente que me traigas el legajo de Mariano Antonio Molas. Tráeme también los panfletos de Manuel Pedro de Peña. ¡Sicofantes rencillosos! Se jactan de haber sido el verbo de la Independencia.
¡Ratas! Nunca la entendieron. Se creen dueños de sus palabras en los calabozos.
No saben más que chillar. No han enmudecido todavía. Siempre encuentran nuevas formas de secretar su maldito veneno. Sacan panfletos, pasquines, libelos, caricaturas. Soy una figura indispensable para la maledicencia. Por mí, pueden fabricar su papel con trapos consagrados. Escribirlo, imprimirlo con letras consagradas sobre una prensa consagrada. ¡Impriman sus pasquines en el Monte Sinaí, si se les frunce la realísima gana, folicularios letrinarios!
« Moi, le Suprême Dictateur de la République, j’ordonne qu’à ma mort, mon cadavre soit décapité ; que ma tête soit placée sur une pique pendant trois jours sur la Place de la République, où le peuple sera convoqué au son des cloches mises en branle. Tous mes serviteurs civils et militaires subiront la peine de la potence. Leurs cadavres seront enterrés dans des pâturages hors les murs, sans croix ni marque qui rappelle leurs noms. Au terme de ce délai, j’ordonne que mes restes soient brûlés et que les cendres soient jetées dans le fleuve...
— Où avez-vous trouvé cela ?
Cloué sur la porte de la cathédrale, Excellence. Une patrouille de grenadiers l’a découvert à l’aube et l’a rapporté au poste de commandement. Heureusement, personne n’a eu le temps de le lire.
— Je ne t’ai pas demandé cela, et cela n’a aucune importance.
— Vous avez raison, Votre Grâce, l’encre des pamphlets tourne plus vite que le lait.
— Ce n’est pas non plus une page de la Gazette de Buenos Aires ni arrachée d’un livre, monseigneur.
— Quels livres pourrait-il y avoir ici, en dehors des miens ?
Il y a bien longtemps que les aristocrates des vingt familles ont transformé les leurs en jeux de cartes.
— Fouillez les maisons des antipatriotes. Les cachots, là, dans les cachots, fouillez les cachots. Parmi ces rats aux ongles crochus et aux crins sales, vous trouverez peut-être le coupable. Serrez les boulons à ces faussaires. Surtout à Peña et à Molas. Apportez-moi les lettres où Molas me rend hommage pendant le Premier Consulat, puis durant la Première Dictature. Je veux relire le discours qu’il a prononcé à l’Assemblée de l’an 14, réclamant mon élection comme Dictateur. Bien différente est son écriture dans le brouillon du discours, dans les instructions aux députés, dans la dénonciation où, des années plus tard, il accusera son propre frère de lui avoir volé du bétail dans son estancia des Altos.
— Je peux vous réciter le contenu de ces documents, Excellence.
— Je ne t’ai pas demandé de me réciter les milliers de dossiers, procès-verbaux et décrets des archives. Je t’ai simplement ordonné de m’apporter le dossier de Mariano Antonio Molas. Apportez-moi aussi les pamphlets de Manuel Pedro de Peña. Sycophantes rancuniers ! Ils se vantent d’avoir été la voix de l’Indépendance.
— Rats ! Ils ne l’ont jamais comprise. Ils se croient maîtres de leurs mots dans les cachots.
Ils ne savent que piailler. Ils n’ont pas encore perdu la voix. Ils trouvent toujours de nouvelles manières de distiller leur maudit venin. Ils sortent des pamphlets, des libelles, des caricatures. Je suis une figure indispensable à la médisance. Qu’ils fabriquent leur papier avec des chiffons consacrés, s’ils veulent. Qu’ils l’écrivent, l’impriment avec des caractères sacrés sur une presse sacrée. Qu’ils impriment leurs pamphlets sur le mont Sinaï, s’ils en ont la très royale envie, folliculaires de latrines ! »
Augusto Roa Bastos a, dit-on, révolutionné la représentation de la dictature dans la littérature latino-américaine en proposant une vision
- "polyphonique", le roman mêle voix du dictateur (José Gaspar Rodríguez de Francia), commentaires anonymes, archives falsifiées et fragments poétiques pour révéler la dictature comme texte à déchiffrer. Contrairement aux portraits réalistes (comme chez Carpentier), Roa Bastos montre le pouvoir comme une construction narrative. Francia, obsédé par sa propre postérité, réécrit l'histoire en direct. Cette folie contrôlée préfigure Stroessner ou Pinochet, mais aussi les dystopies contemporaines (comme 1984 de Orwell, mais avec une dimension baroque) ou même certains dirigeants démocrates occidentaux ..
- "linguistiquement subversive" : Roa Bastos intègre des structures syntaxiques du guarani (langue indigène du Paraguay) pour saboter l'espagnol colonial ("Nde nda'éi chéve" ("Tu n'es pas à moi") – phrase-clé dans Yo el Supremo qui fracture la langue du pouvoir). De plus le dictateur veut tout contrôler par l'écrit, mais le roman célèbre les voix orales (chants populaires, rumeurs) comme armes de résistance. Cette idée influencera Mario Vargas Llosa (La Fiesta del Chivo).
- et profondément ancrée dans l'imaginaire "guarani" : le temps cyclique, la dictature comme malédiction ancestrale, "Yo el Supremo" suggère que les dictateurs sont les avatars d'un même cauchemar historique (approche que Gabriel García Márquez développera dans "El otoño del patriarca", 1975).
Roa Bastos montre que le pouvoir ne réside pas dans le tyran, mais dans les récits qui le légitiment (fausses lettres, décrets absurdes), une idée qui anticipe bien des études postcoloniales. Et alors que les romans du Boom magnifiaient parfois les dictateurs (El señor Presidente, Asturias), Roa Bastos le réduit à un corps malade et seul, piégé par ses propres fictions. Roberto Bolaño reconnaîtra sa dette envers "Yo el Supremo" pour écrire "By Night in Chile" (la dictature comme maladie mentale) et son utilisation de documents fictifs inspirera Carlos Fuentes (Terra Nostra) ou Ricardo Piglia (Respiración artificial).
García Márquez va faire du dictateur un personnage à la fois grotesque et tragique, révélant que la tyrannie est une maladie de l'imagination collective. Son œuvre reste une clé pour comprendre l'absurdité constitutive du pouvoir en Amérique latine...
Il a radicalement transformé la représentation du dictateur dans la littérature latino-américaine en fusionnant mythe, pouvoir et temporalité cyclique. Son approche, distincte de celle de Roa Bastos ou Carpentier, invente une poétique de la tyrannie où réalité et magie s'entremêlent. Dans "El otoño del patriarca" (1975), le dictateur est représenté comme un archétype mythique son pouvoir se confond avec le temps lui-même, et García Márquez le décrit comme un géant décrépit, aux testicules de taureau et au pied bot, symbole d'un pouvoir à la fois surhumain et pitoyable. Une démesure baroque qui inspire plus tard des auteurs comme Mario Vargas Llosa...

"El otono del patriarca" (L'Automne du patriarche, 1976), de Gabriel Garcia Marquez (1927-2014)
"Le patriarche est un dictateur dans la grande tradition de l'Amérique latine, un despote inculte et ubuesque du colombien qui pourrit dans son palais envahi par les charognards. C'est un vieux général (il a "entre 107 et 232 ans"...), un tyran méfiant et délirant. Les structures minables de son pays le vouent à des aventures cauchemardesques que l'imagination de Garcia Marquez transforme en épopées drolatiques..." (Editions Grasset) Roman souvent sous-estimé en regard de ses oeuvres plus commerciales, Gabriel Garcia Marquez campe ici un dictateur paradoxal, archétype de tous les autocrates qui ont régné au cours du XXe siècle : paradoxe de cruauté et de désespoir, paranoïaque et solitaire, le "patriarche" tient sous son emprise une population qui ne peut échapper à l'aura mythique qu'il s'est forgée. Le tout dans un style débridé et un minimum de ponctuation...

"El General en su laberinto" (1989, Le Général dans son labyrinthe), de Gabriel Garcia Marquez (1927-2014)
Le roman qui semble se donner comme une démystification de la figure de Simon Bolivar en le représentant dans son déclin au cours de son dernier voyage sur le fleuve Magdalena, de Bogota à la côte nord de la Colombie, alors qu'il cherche à quitter l'Amérique du Sud pour s'exiler en Europe, fit scandale. Gabriel Garcia Marquez le montre dans un dénuement tragique, dévoré par la fièvre, consumé par la tuberculose, abandonné à des pratiques médicales personnelles et fantastiques, évoquant dans de brusques mouvements de lucidité ou de fièvre, ses conquêtes, ses infidélités, ses échecs, sa marque dans l'Histoire et le le labyrinthe dans lequel il s'est lui-même, implacablement, enfermé.

"Buen viaje, señor presidente", première des douze récits que comporte le recueil "Doce cuentos peregrinos", Gabriel Garcia Marquez (1927-2014) - Un ancien président d'un pays inconnu des Caraïbes, renversé par un coup d'Etat militaire gagne Genève à la recherche d'un remède qui pourrait le soigner, mais un soir, dans un café, croit reconnaître un homme déjà aperçu en d'autres endroits, il s'agit d'un compatriote, Homero Rey, qui travaille comme chauffeur d'ambulance et ancien membre du parti du président..
"Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón, y pensando en la muerte. Cuando vino a Ginebra por primera vez el lago era sereno y diáfano, y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos, y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las seis de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. Ahora la única mujer posible, hasta donde alcanzaba la vista, era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos no sólo en su vida sino también en el mundo.
Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo, y los ojos alegres. Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel. Y aun así, a los setenta y tres años, seguía siendo de una elegancia principal. Aquella mañana, sin embargo, se sentía a salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio, y ahora sólo permanecían los de la muerte..."
« Il était assis sur le banc de bois, sous les feuilles jaunes du parc solitaire, contemplant les cygnes couverts de poussière, les deux mains posées sur le pommeau d’argent de sa canne, et songeait à la mort. Lorsqu’il était venu à Genève pour la première fois, le lac était serein et diaphane, et il y avait des mouettes apprivoisées qui s’approchaient pour manger dans les mains, et des femmes tarifées qui ressemblaient à des fantômes dès six heures du soir, avec leurs volants d’organdi et leurs ombrelles de soie. Maintenant, la seule femme possible, à perte de vue, était une fleuriste sur le quai désert. Il avait du mal à croire que le temps ait pu faire de tels ravages, non seulement dans sa vie, mais aussi dans le monde.
Il n’était qu’un inconnu de plus dans la ville des illustres inconnus. Il portait l’habit bleu foncé à rayures blanches, le gilet de brocart et le haut-de-forme rigide des magistrats à la retraite. Il avait une moustache altière de mousquetaire, des cheveux bleutés et abondants aux ondulations romantiques, des mains d’harphiste avec l’anneau de veuf à l’annulaire gauche, et des yeux joyeux. La seule chose qui trahissait l’état de sa santé était la fatigue de sa peau. Et pourtant, à soixante-treize ans, il conservait une élégance princière. Ce matin-là, cependant, il se sentait à l’abri de toute vanité. Les années de gloire et de pouvoir étaient derrière lui, sans retour, et il ne lui restait plus que celles de la mort... »
Le réalisme magique du pouvoir selon Gabriel García Márquez : le pouvoir est un récit impossible à vérifier, la voix du tyran se mélange à celles du peuple, des amantes, des sbires, créant une mémoire collective déformée, et les objets s'animent (un palais qui pourrit, des poissons volants), métaphores d'un régime qui défie les lois naturelles, les massacres se répètent, les ministres ressuscitent, le pouvoir est un éternel recommencement, et le Patriarche couche avec des vierges "pour purifier son sang", écho aux excès réels de Trujillo (République dominicaine) ou Somoza (Nicaragua)...
Quant aux citoyens, ils adorent le tyran même lorsqu'il jette des opposants aux requins. García Márquez montre que la dictature est un pacte collectif (une idée reprise par Bolaño dans "2666")...
Les années 1980 se caractérisent par l'apogée puis un reflux des régimes autoritaires. Les nouveaux gouvernements qui s'installent en Argentine et au Brésil naissent d'une aspiration généralisée pour des institutions stables et participatives. Même le régime chilien, qui a longtemps été le symbole de l'autoritarisme, doit organiser dans les formes les plus démocratiques un référendum. Les régimes dictatoriaux prennent ainsi fin en en Bolivie (1982), Uruguay (1985) où les Tupamaros se transforment en mouvement politique légaliste...
Parmi les causes de l'effondrement des régimes militaires, on a pu noter la Crise économique des années 1980 (dette extérieure, inflation), les pressions internationales (États-Unis sous Reagan, Église catholique, droits humains), les mobilisations sociales (Mères de la Place de Mai en Argentine, syndicats au Brésil). Une transition qui a ses limites avec une impunité persistante et une libéralisation souvent brutale (Pinochet laisse un Chili néolibéral).
"La Historia Oficial" (1985), réalisé par Luis Puenzo, film phare du cinéma argentin, est l'un des premiers à affronter ouvertement les traumatismes de la dictature militaire (1976-1983). Son intérêt réside dans sa portée historique, politique et humaine, en explorant la mémoire, le déni et la complicité sociale à travers une histoire intime. Sorti seulement deux ans après la fin de la junte, le film brise le silence sur les 30 000 desaparecidos et les bébés volés aux opposants...
C'est aussi le premier film argentin à obtenir l’Oscar du meilleur film étranger (1986), légitimant internationalement la lutte pour la vérité.
Et le film montre, une fois de plus, que la terreur a persisté grâce à l’indifférence des classes aisées....

Les années 1990 sont dominées par des démocraties fragiles et un néolibéralisme global qui s'installe triomphalement et qui aboutit à l'augmentation des inégalités : et ne freine guère la corruption. Restent des exceptions autoritaires, le Pérou d' Alberto Fujimori (auto-coup d’État en 1992, régime autoritaire jusqu’en 2000) et le maintien du régime castriste malgré l’effondrement de l’URSS.
Les années 2000 amorcent un tournant progressiste, puis un retour des conservatismes, et bien des contradictions. La démocratie ne se réduit pas à des élections : c’est un combat quotidien contre les fantômes de l’autoritarisme, écrira Enrique Krauze, historien mexicain.
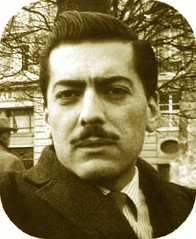
"La fiesta del chivo" (2000), Mario Vargas Llosa (1936-2025)
"La Fiesta del Chivo" est le roman des dictatures du XXIe siècle, là où "El otoño del patriarca" était celui du XXe, a-t-on écrit. La peur était le ciment de son pouvoir. Sans elle, il n’était qu’un vieillard aux intestins pourris. Rafael Trujillo (Dominicaine, 1930-1961) est dépeint non comme un mythe (García Márquez) ni comme un texte à déconstruire (Roa Bastos), mais comme un mécanisme de pouvoir froid et calculateur. Et son obsession pour la propreté, ses routines méticuleuses, sa paranoïa sexuelle (impuissance et violence envers les femmes) révèlent un homme petit derrière le monstre...
Le romancier péruvien Mario Vargas Llosa, auteur bien connu de "Conversacion en la Catedral, 1969) dénonce le terrorisme du "Sendero Luminoso" des années 1980 dans "Lituma en los Andes" (Lituma dans les Andes, 1993), armée sans visage génératrice d'angoisse dans un pays qui ne semble pas pouvoir échapper à une violence native, puis la dictature de Trujillo (1930-1961) en République Dominicaine dans "La fiesta del chivo".
"Que vient chercher à Saint-Domingue cette jeune avocate new-yorkaise après tant d'années d'absence ? Les questions qu'Urania Cabral doit poser à son père mourant nous projettent dans le labyrinthe de la dictature de Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961), au moment charnière de l'attentat qui lui coûta la vie en 1961. Dans des pages inoubliables - et qui comptent parmi les plus justes que l'auteur nous ait offertes -, le roman met en scène le destin d'un peuple soumis à la terreur et l'héroïsme de quatre jeunes conjurés qui tentent l'impossible : le tyrannicide. Leur geste, longuement mûri, prend peu à peu tout son sens à mesure que nous découvrons les coulisses du pouvoir : la vie quotidienne d'un homme hanté par un rêve obscur et dont l'ambition la plus profonde est de faire de son pays le miroir fidèle de sa folie. Jamais, depuis Conversation à «La Cathédrale», Mario Vargas Llosa n'avait poussé si loin la radiographie d'une société de corruption et de turpitude. Son portrait de la dictature de Trujillo, gravé comme une eau-forte, apparaît, au-delà des contingences dominicaines, comme celui de toutes les tyrannies - ou, comme il aime à le dire, de toutes les «satrapies»." (Editions Gallimard, Trad. de l'espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan)
Contrairement à García Márquez ou Roa Bastos , Vargas Llosa dénonce les racines sociales de la tyrannie,
- La bourgeoisie complice : Le père d’Urania, sénateur, livre sa fille au dictateur pour garder son pouvoir. Vargas Llosa expose l’hypocrisie des élites.
- Le peuple et le culte du chef : Scènes de foule en liesse pour Trujillo, malgré les massacres.
- et en fin de compte des assassins de Trujillo motivés par la vengeance personnelle, non par l’idéalisme...

"La dictadura perfecta" (2014), réalisé par le Mexicain Luis Estrada, est une satire politique cinglante qui démonte les mécanismes du pouvoir autoritaire, la collusion entre médias et politique, et l'illusion démocratique au Mexique.
C'est l'un des plus audacieux du cinéma mexicain contemporain.
Le film sort en 2014, sous le gouvernement d'Enrique Peña Nieto (PRI), parti alors au pouvoir depuis des décennies (avec une brève interruption de 2000 à 2012). Le titre fait référence à la célèbre phrase de l’écrivain Mario Vargas Llosa, qui qualifia en 1990 le système politique mexicain de "dictature parfaite" – un régime autoritaire masqué par des élections et un contrôle médiatique.
Un gouverneur corrompu (joué par Damián Alcázar) est filmé en train de recevoir un pot-de-vin. Pour éviter le scandale, une chaîne de télévision (Televisa) monte une opération de manipulation médiatique pour le transformer en héros national et même en candidat présidentiel. Le film montre comment Televisa (représentée par la fictive TV MX) fabrique l’opinion publique : désinformation (montages vidéo, fausses interviews), détournement de l’attention (création de scandales artificiels pour masquer la corruption), cultes de la personnalité (transformation d’un criminel en "sauveur de la nation")
La démocratie comme illusion : les élections sont une mascarade, le peuple vote, mais les résultats sont pré-déterminés par les élites. La corruption est systémique , policiers, journalistes et politiciens sont tous complices.
Les acteurs ont su parfaitement endossés leurs caricatures, Damián Alcázar (le gouverneur véreux) incarne à la perfection le politicien cynique, Silverio Palacios (le patron de TV MX) représente le magnat des médias tout-puissant.
Et le film reste toujours pertinent et principalement dans des états, fussent-ils démocratiques, où persiste la collusion médias-pouvoir. Non, la manipulation médiatique et la corruption politique ne sont pas propres au Mexique ..
