- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Jean Giraudoux (1882-1944), "Suzanne et le Pacifique" (1921), "Siegfried et le Limousin" (1922), "Juliette au pays des hommes" (1924), "La Guerre de Troie n'aura pas lieu" (1935) - ...
Last Update: 11/11/2016
"Auprès du grand public, Giraudoux fut comme l'ambassadeur du nouveau langage; il a acclimaté (en la désamorçant quelque peu) l'irrationalité de la métaphore poétique, à laquelle la narration recourt constamment. Des Provinciales à Électre, de "Suzanne et le Pacifique" (son chef-d'œuvre sans doute) à La Guerre de Troie n'aura pas lieu, son œuvre, qu'elle soit romanesque ou théâtrale, datée des années 20 ou des années 30, est l'une des plus caractéristiques d'un moment. Elle évoque un monde accueillant, luxueux, férial, qui ressemble à un spectacle de gala réglé avec minutie, un monde où chaque chose est à sa place, colle à sa définitíon et, parfaitement justifiée, brille ainsi de son plus pur éclat. Bien loin de transporter dans l'œuvre les problèmes de la vie, comme la génération qui suivra, elle fait de la vie tout entière une sorte de féerie littéraire : et l'on peut dlre de Giraudoux, plus justement encore qu'ii ne le dit de son héros Racine, qu'ii n'est pas en lui un seul sentiment qui ne soit un sentiment littéraire. Aussi, nous voyons bien que la littérature actuelle - celle que nous éprouvons comme nôtre - commence après Cocteau et après Giraudoux comme elle commence après Roger Martin du Gard et François Mauriac...." (Gaëtan Picon).

Jean Giraudoux (1882-1944)
Poésie et préciosité - Jean Giraudoux, né à Bellac en 1882, après avoir été un élève brillant de l'École Normale Supérieure, devint fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères après la guerre de 1914, puis commissaire à l'Information au début de la guerre de 1939.
"Bien qu'ii n'ait écrit d'autres poèmes que ceux qu'ii a introduits dans ses romans (les quelques chansons d' "Elpenor" et de "Suzanne et le Pacifique"), écrit Gaëtan Picon, Giraudoux est constamment un poète. Des analogies qu'ii est seul à percevoir nous imposent un monde imprévu, précieux, scintillant. Épithètes, images, métaphores volent inlassablement à l'appel du chef d'orchestre prestigieux, l'entourant de leur foule domestique et bariolée comme les oiseaux de son ile, Suzanne. Et pour avoir exprimé cet univers poétique dans les genres accessibles du roman et du théâtre, pour avoir compensé le modernisme de la vision et du langage par la culture d'un brillant élève de Rhétorique supérieure, pour avoir adouci par une sorte d'urbanité et d'aménité rassurante la pointe d'une subtilité si souvent agressive, et discipliné la jungle d'une imagination très imprévue et très prolixe par le mécanisme voyant de quelques grandes conventions de style, nul n'a plus efficacement contribué à faire entrer dans le domaine public les hardiesses d'une sensibilité et d'une écriture nouvelles...."
Giraudoux fut un écrivain fécond, romancier subtil de "Siegfried et le Limousin", "Bella", "Simon le Pathétique", "Choix des élues", critique et essayiste brillant des "Cinq tentations de la Fontaine" et de" Littérature", mais par-dessus tout homme de théâtre, principalement après sa rencontre avec le grand acteur Jouvet, dans "Siegfried" (1928), "Amphitryon 38" (1929), "Intermezzo" (1933), "la Guerre de Troie n'aura pas lieu" (1935), "Électre" (1937), "Ondine" (1939). "Sodome et Gomorrhe" sera jouée en 1943, un an avant sa mort.
Les pièces de Giraudoux sont d'une grande variété et d'une grande richesse : tour à tour modernes et antiques, tragiques ou fantaisistes, terribles ou souriantes; on les reconnaît cependant sans peine à une élégance du ton, à une aisance unique qui peut passer pour de la désinvolture ou de la préciosité, mais qui n'est au fond que la poésie du quotidien. Cette facilité s'harmonise avec une sorte d'optimisme poétique, un état d'âme spiritualisé qui fut sans doute le meilleur art de vivre d'une seconde «belle époque» intelligente et artiste, si menacée et si séduisante...
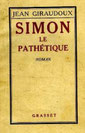
"Simon le pathétique" (1918)
Plutôt qu'un roman, - car il n'y a pas d'intrigue -, c'est une éblouissante suite de variations sur les thèmes de la jeunesse et de l'amour. Simon raconte son enfance studieuse, le lycée, ses maîtres et ses condisciples. "Gontran, inégal, paresseux l'été ...; Georges, qui ne savait que dépeindre les forêts et dans toute narration parvenait à glisser la description d`un taillis, ou d`un étang entouré de futaies. à la rigueur d`une oasis". Simon retrace ses premiers voyages, tout imbus encore des souvenirs d`école, ses premiers pas dans la vie, secrétaire du sénateur Boiny qui n'avait qu'une passion, "passer pour avoir l`âme noble" ..
" Bolny n’avait qu’une ambition, – ambition que peuvent satisfaire dans les villages les adjudants retraités, les vicaires – : passer pour avoir l’âme noble, et il ne parvint jamais à la réaliser, pour la simple raison que cette âme était basse. Non pas que je lui aie vu commettre lui-même de mauvaises actions, mais il faisait porter ses défauts autour de lui par des amis, ou des parents pauvres, ou des familiers : il avait un secrétaire envieux, un cousin lâche, un portier vaniteux. Le monde entier se rendait compte de cette hypocrisie et le boudait, bien qu’il
s’obstinât à être le bienfaiteur de l’humanité, en fondant des piscines, – l’humanité doit être propre –, ou des cours de morale du soir –, l’humanité doit être honnête, en tout cas se coucher honnête. En vain il voulait de bonne foi épurer la magistrature, accélérer la vie des bureaucrates, écarter des rues les pelures d’oranges. — Chantage ! disait-on à chaque tentative… Il avait une façon de condamner les exécutions capitales qui faisait dire : — Tiens ! Bolny est mal avec le bourreau ! Lié par son passé, il subventionnait en maugréant les instituts, les asiles. Inlassablement, il payait à l’ordre de la vertu, de la pudeur, de la propreté, mais toujours inutilement, et il les considérait toutes, après tous ses déboires, comme autant de maîtres chanteurs.
J’étais confus de rentrer dans mon pays, dans mon avenir, par cette presqu’île fangeuse. Je redoutais surtout les matins où il fallait, pour une affaire grave, le surprendre dans son sommeil. Je n’ai jamais vu dormir avec cette laideur : il dormait comme un mort, les yeux blancs, le menton tombé, ne rêvant jamais. On espérait qu’au réveil il aurait tout oublié, sa richesse, sa force, son nom, comment on s’habille et comment on se tient debout.
Mais, ses prunelles à peine rabaissées, il se saisissait avidement, – comme le voyageur assoupi en gare saisit sa valise au premier cri, de la journée et du présent, il parcourait les enveloppes de son courrier, épelant les syllabes de son illustre nom ; il mangeait des fruits de son château, il demandait quel était le temps. On avait parfois la consolation de lui répondre qu’il pleuvait, qu’il neigeait, que Paris était couvert de boue..."
Simon revient à ses camarades, découvre les jeunes filles, des jeunes filles telles que les aime Giraudoux. Louise et Thérèse. Et Gabrielle, qui conduit Simon à Hélène. Hélène qui lui promet Anne, l`amour. Simon va aimer. "Si l`amour consiste à aimer tout, j'aimais déjà..."
".. Je la voyais presque chaque jour. Nous ne parlions guère que de nous ; ou plutôt chacun ne parlait guère que de soi, et découpait sans réserve dans un passé dont l’autre ignorait tout. Les plus grandes confidences n’étaient entre nous deux qu’un des hasards du bavardage. Encore inconnus l’un à l’autre, nous nous amusions à déterrer de notre enfance chaque minute qui pouvait avoir été la même pour nous deux. Nous cherchions des amis communs, à leur défaut des amis symétriques. Il était bien rare que le même enfant, petite fille chez elle, petit garçon chez moi, n’eût pas été près de nous, le jour où nous avions découvert le même coin de notre cœur.."
"La vision de la jeune fille que j'eusse épousée en province, du demi-bonheur dédaigné - du jardin le soir avec ses tomates. de la pêche aux écrevisses -, rendait pénible l'idée du bonheur moins borné, l`idée d'Anne."
C`est le premier baiser, la promenade à la campagne, dans l`enivrement du solstice d`été. Et puis la brouille, l`aveu d`un amour passé : la souffrance, traînée le long des vacances, que ne peut calmer Lyzica, la petite voisine de wagon-lit : que ne peut calmer Geneviève, la tendre amie d`enfance. Et enfin, Anne retrouvée, Anne fiancée à un autre. Anne reconquise. Anne qu`il va revoir demain. "Vais-je l'aimer ? Demain tout recommence..."
"... Il fait froid, il fait sombre. Je vais maintenant pour mon compte. De bons hôtels m’offrent du feu, de la lumière. J’ai faim. Pas un restaurant, et même le plus petit, qui ne m’invite. Un chien dans une boîte cherche les os d’un gros livre, et s’enfuit devant moi… La lune s’est levée. Un chat, au milieu de la rue, assis en équilibre au faîte de l’ombre des toits, franchit ce qu’il croit tout le ciel même pour m’éviter… Les étoiles ont tourné d’un millimètre, juste assez pour que soit neuf le firmament… Ô amis, si l’on permet jamais aux hommes de se créer un nouvel animal, un nouveau compagnon, au pelage noir le jour et blanc la nuit, qui sourira, qui pleurera, – ne trouvez-vous pas qu’il manque ? – et pas infécond, comme tous ceux qu’ils ont formés jusqu’ici, hippogriffes ou licornes, et tel que parfois vous l’imaginez sûrement, dans une île ronde d’Océanie, au bord du lac intérieur où cuit au bain-marie une eau douce délicieuse, veillant sa petite femelle endormie et pensant aux hommes d’Europe… un animal qui vous parle, qui chante… – que l’on me charge de la tâche !
Demain je revois Anne… Vais-je l’aimer ? Demain tout recommence…"
De l`amour à l`état naissant, de l`amour qui s'ignore, de l`amour qui se cherche, à celui qui se fuit et qui joue à cache-cache avec lui-même, qui jongle avec sa joie et avec sa peine, toutes les nuances sont distillées, dans cette transfiguration poétique de la réalité quotidienne, dans ce jaillissement continuel de trouvailles un peu précieuses et que seule empêche d`être mièvres la perfection de la phrase, mais un embrasement de feu d`artifice qu'on ne peut oublier ...

"Suzanne et le Pacifique" (1921)
C'est la première œuvre originale et caractéristique de Jean Giraudoux. dans laquelle il tente d`exprimer sa vision particulière du monde sous une forme romanesque. La jeune Suzanne quitte Bellac, sa ville natale (qui est aussi la patrie de l`auteur), avec l`intention de faire un grand voyage autour du monde. Mais un naufrage la jette. seule, sur une île déserte. Dans une telle conjoncture. elle ne se préoccupera pas, comme un quelconque Robinson, de reconstituer et d'organiser autour d`elle un semblant de vie civilisée dans ses formes pratiques. Non, elle profite au contraire de cette solitude pour se fabriquer une réalité imaginaire faite de rêves. La seule vraie réalité est la réalité poétique. Suzanne, partie de France, le plus "réel" des pays de la Terre, parvient-elle à l`unique évasion vraiment possible, à la découverte du monde intérieur. Mais celui-ci n'est pas, pour Giraudoux, le monde traditionnel des rêveries romantiques. Certes, cette réalité intime, idéale, est bien constituée par des éléments purement subjectifs, des variations pleines de fantaisie sur les données de l`expérience, mais elle offre ceci de particulier qu`elle se construit selon une logique rigoureuse. à la lumière de l`intelligence qui lui fournit les principes pour interpréter le monde extérieur de la façon la plus proche du vrai, et même pour influer résolument sur ce monde, d'où une œuvre dont la saveur inimitable tient de l`étude psychologique paradoxale et des jeux de l`esprit ...
Seule sur son île où elle a fait naufrage, Suzanne, un jour, entend au loin tonner le canon, c'est le combat de Coronel, au large du Chili, du 1er novembre 1914, et qui fut la première défaite de la Royal Navy. Mais voici qu'un noyé aborde à son île, et bientôt sa solitude va être peuplée de corps rejetés par la mer, des noyés qui apportent à la jeune fille le témoignage que la vie des hommes continue là-bas loin d'elle, toujours attirante, en dépit même de la guerre...
"Soudain (j'eus la terreur d'un philosophe qui sentirait sa pensée non se poursuivre par chaînons et écluses mais se reproduire en grouillant comme une culture), je vis des cadavres aborder de partout. Ils abordaient là où eussent abordé des hommes vivants; ils étaient une vingtaine épars à cet assaut; de toutes les petites criques par où je sortais de mon bain, sortait en ce moment un homme. D'autres pris dans le courant passaient au large, chacun avec sa nage propre, champion dans la mort de l'overarm, des épaules hors de l'eau et des bras dressés, là une tête, là une main, là-bas un pied, et en rasant la mer à niveau on eût eu de quoi me refaire le corps entier de Johnny. Mais la plupart collés au rivage s'usaient, inlassables, à la pierre ponce ou à la nacre, avec ces saccadés enfantines que nous donnent à nous les poussées de la mer.
Comme les hommes sont dissemblables, si légers, si pesants, si fins, si grossiers, si vulgaires et si dignes jusque dans la mort, que je devinai dans ces cadavres les reconnaissants et les ingrats! Apres chaque sauvetage, je me reposais, mais déjà presque modelée par une demi-heure de contact ou d'étreinte à certaine forme d'homme, désorientée quelques minutes devant le corps suivant, corps habillé alors que l'autre était nu, souple quand l'autre était raide, forçant mes bras et ma piété à épouser vingt formes différentes. Parfois la lune éclairait le noyé, je m'habituais à son visage; parfois je repêchais un corps dans l'ombre, et plus tard, sur le rivage, je ne le reconnaissais pas, il me semblait venu sans moi. Parfois une vague inattendue poussait le corps, j'avais l'impression qu'il s`aidait... Le soleil revint. A chaque corps retiré de la mer, elle avait changé de couleur..., pourpre à l'avant-dernier, rouge au dernier, et soudain vide de mort, toute bleue. Premier jour cependant où, depuis des années, je ne me baignai pas...
Je les comptai; j'en trouvai d`abord ,dix-sept, puis seize; puis le disparu revint. Les uns avaient la tête, les autres les pieds tournés vers la mer. De la tête s'envolait toujours quelque oiseau, plus curieux que sont les oiseaux des visages que des corps. L'un avait un grelot dans sa poche, et sonnait. Deux avaient des alliances: j'eus désormais deux alliances au même doigt. Le plus jeune, imberbe, avait un veston noir avec des boutons d'or comme les collégiens chez nous; rien n`y manquait, ni la cravate, ni la montre, comme aux collégiens un jour de grande rentrée ; c'était des vêtements faits sur mesure, de ceux que la mer n'arrive pas à enlever au corps, la ceinture était fixée au drap par des boutons-agrafes, et le midship retenait de la main sa casquette, seul objet qu'il eût pu perdre dans le désastre. Toute la douce peur de perdre sa casquette, mélangée à la confiance en son col, en ses brodequins, illuminait et sanctifiait ce visage. Mais à mesure que le soleil chauffait, cette troupe que je croyais d'abord uniforme, je la vis se diviser en deux. L'alliance que tous les noyés ont contre la nuit était rompue. Il y avait deux sortes de tricots, deux sortes de bérets ; c`est qu'il y avait eu deux navires ; il y avait deux sortes de têtes, de mains, même dans la mort deux attitudes; il y avait deux coupes de cheveux: c'est qu'il y avait deux races... Alors je vis la guerre.
D'abord la compagnie de sept géants à chair blanche, jeunes tous et de taille égale comme un peuple mythique, les plus défigurés et les plus gonflés, comme s'ils n'avaient pas, eux, l'habitude de cette mort dans l'Océan, le visage si gras et leurs petites moustaches blondes si pommadées que l'eau restait sur eux en gouttelettes et n'avait pas désuni un poil, l'un avec un maintien-moustache, tous avec des instruments dans leur poche dont on n'a rien à faire au fond des eaux, des harmonicas, de petites flûtes, tous avec leur nom gravé à l'encre indélébile sur leurs tricots, mais sans tatouages et anonymes dès qu'ils étaient nus, les ongles faits au polissoir, chacun rapportant sur son visage non pas, comme d'habitude les morts, une ressemblance avec quelque inconnu entrevu dans un orchestre ou une diligence, mais la ressemblance exacte avec le camarade d'à côté; et dix corps en basane et en muscles, avec des cous d'otarie, avec des fils de laiton pour cheveux, de la corne pour ongles, de l'or pour dents, tous divers ressemblant tous (avais-je donc oublié à quoi ressemblent les hommes ?) à des chiens, à des chevaux, à des dogues, l'un à un chat, le midship à une femme, avec des poches toujours vides si ce n'est de tabac et de pipes, mais dont presque tous les corps portaient le nom et les aventures, l'un avec la même Molly de Dakar, l'autre avec toute la bataille de Hastings, un troisième sa vie décrite depuis le cou en cinq ou six lignes, naissance, engagement, naufrage du Sunbeam, naufrage du Lady-Grey, et il restait pour inscrire sa mort toute une place réservée jalousement, sans doute pour des noms de femmes, tout le sternum...."
Sept matelots allemands contre dix de la Grande-Bretagne, et lorsque Suzanne peut enfin regagner la France, le Prince Charmant qui éveille cette Belle au bois dormant lui dit, "Je suis le contrôleur des poids et mesures, Mademoiselle... Pourquoi pleurer ?... "

"Siegfried et le Limousin" (1922)
Chronique d'une époque, et essai d`ethnologie comparée : la guerre est finie, mais la paix est encore en gestation. Le chroniqueur, Jean, ami d'enfance d'un jeune écrivain français, Jacques Forestier, porté disparu en 1915, lit avec stupéfaction dans les articles, signés S.V.K., d'un journaliste allemand, par ailleurs penseur profond et original. des phrases, des pages entières écrites jadis par son ami. Jean a connu et aimé l'Allemagne, il y a longtemps vécu. Avec l`aide d`un ami retrouvé, le baron von Zelten, en qui s`incarne tout le romantisme allemand, il parvient à approcher Siegfried von Kleist, en Bavière, et à connaître la vérité. De Jacques Forestier, ramassé blessé, nu, amnésique, sur le champ de bataille, la rééducation en un hôpital allemand a fait von Kleist, le grand homme, le guide de l'Allemagne d'après-guerre, en qui les parents de soldats disparus cherchent à reconnaître leur enfant. Jean revoit ses anciens amis, ses amies surtout, ou leurs filles: je redécouvre l`Allemagne. Luttant contre Eva, l'infirmière qui a donné à Siegfried sa seconde existence, défiant les menaces des associations patriotiques dont Eva est la walkyrie, Jean tâche, au cours des leçons de français qu`il donne à Siegfried, de réveiller les souvenirs de l`enfance, du pays natal. Une révolution éphémère porte au pouvoir le chimérique von Zelten; avant de quitter la résidence et le pays pour l'exil, il révèle que Siegfried n'est pas allemand. Siegfried partira avec Jean, sans avoir encore conscience de son être véritable. vers la France, vers ce Limousin où il retrouvera peut-être son passé. La confrontation de l`âme allemande et de l'âme française, du génie des deux peuples, et des lignes de leurs paysages, faite souvent de boutades, d`images frappantes et ingénieuses, cache sous sa fantaisie une intelligente et profonde clairvoyance.
En 1928, Giraudoux portera à la scène l'histoire de Siegfried, une comédie, en quatre actes, jouée par Louis Jouvet au Théâtre des Champs-Elysées, le 3 mai 1928...

"Juliette au pays des hommes" (1924)
Giraudoux reprend ici le sujet de "Suzanne et le Pacifique" mais en le dépouillant de toute aventure et en le réduisant pour ainsi dire à un simple schéma. Juliette est une jeune fille de province, ignorante et intuitive, ingénue et intrépide, qui vient à Paris, "au pays des hommes", parce qu'elle désire connaître le monde et la vie avant d'épouser à Aigueperse son fiancé Gérard. Mais plus encore, elle veut retrouver ou connaître les hommes qui l'ont interpellés fût-ce pour avoir simplement entendu prononcer leur nom. Son intention est "de voir, de toucher les sept ou huit existences qui eussent été, sans Gérard, ses existences possibles". Ce voyage lui confirmera qu'elle n'a rien à regretter, la vie qui l'attend est plus belle que ses rêves d'adolescente. Elle ira jusqu'à faire la connaissance de l'auteur lui-même, qui lui lit sa "Prière sur la Tour Eiffel", le morceau de bravoure de ce bref récit et qui révèle toute l'imagination subtile de l'écrivain. Au détour, lors de la visite de Juliette à l'écrivain Lemançon, Giraudoux en profite pour railler le fameux "monologue intérieur" alors mis à la mode par James Joyce avec son "Ulysse" ; "ainsi, c'était cela le Monologue intérieur! Ainsi il différait si peu des phrases que prononcent les vieillards qui parlent tout seuls..." Après quoi, convaincue, Juliette retourne à sa province. La leçon que l'on en retire est toujours la même, la vie doit être reconstruite idéalement en nous-mêmes. Quant à Giraudoux, il continuait à livrer son combat contre la montée des ténèbres, qu'il s'agisse de la fatalité tragique ou des monstres qui sommeillent en nous...

"Elle n’avait pas le sentiment de contempler Paris, mais d’être contemplée par lui ..."
" Le soir était venu, Juliette redescendit la colline. Peu voyageuse, elle n’avait pas le sentiment de contempler Paris, mais d’être contemplée par lui et par chacun de ses édifices. Devant chaque coupole, chaque clocher, comme devant des microscopes géants, elle se sentait traversée et jugée par un siècle, une vertu, et son squelette, et les parties stables de son âme étaient différents pour chacun de ces radiums. Même devant les monuments dont elle attendait le moins qu’ils l’intimidassent, l’institut océanographique, la Tour Eiffel, – la Tour Eiffel surtout, d’un œil qu’elle s’apprêtait à colorer pour la nuit, – Juliette sentait sa vie et ses secrets à vif. Elle essaya de jouer au plus fort. Comme l’alouette qui n’a d’autre recours que de se poser sur le canon du chasseur, elle alla se placer au centre même du Panthéon, puis devant le tombeau de Victor Hugo lui-même ; elle allia une minute, pour résister à cet examen des édifices illustres, sa jeune vie inconnue aux fantômes de tous ceux qui avaient en France répondu personnellement au Créateur, et qui allongés maintenant dans la crypte semblaient (au contraire de ceux de Saint-Denis, issus d’un seul ancêtre) les ascendants d’un monarque encore à naître. Elle erra parmi ces grandes ombres, chaque vertu et chaque talent en elle décolorés par leur formidable vertu et talent correspondants, sa pauvre sincérité par celle de Rousseau, son petit talent d’impromptu par celui de Voltaire, son habileté à l’aquarelle par celle de Puvis, et elle se sentait un pauvre insecte translucide. Certes, elle avait conscience de posséder une vertu irréductible, qui était la vie. Mais, par modestie et par pitié, elle évitait devant les sarcophages tout geste qui eût pu la montrer trop vivante, et elle sortit du caveau à l’anglaise comme si, venue pour toujours, elle avait oublié là-haut son sac ou son mouchoir.
Elle y avait oublié le soleil, le Luxembourg. Elle s’assit dans le jardin. Chaque vivant, chaque passant redonnait à son âme l’opacité première. Elle retrouvait avec amitié ces plantes jadis indifférentes, ces arums, ces ricins, ces fuchsias rencontrés tout à l’heure à l’École normale et qui ne la transperçaient d’aucun regard, à part un camélia, – en quoi un camélia est-il un édifice ? – sur lequel elle dut poser sa main comme sur les yeux d’un curieux. Les semences jetées dans son âme par le petit préparateur germaient d’ailleurs déjà : de grands platanes avaient poussé pour elle depuis son dernier passage, des rosiers embaumés. La garde républicaine avait terminé son concert, et la foule se distribuait, selon l’effet qu’a sur elle la musique militaire, entre les statues et les eaux. Ce fut l’heure où Juliette, trompée depuis vingt ans par la manie de son oncle et qui n’imaginait plus qu’un obélisque ou une stèle fussent consacrés à d’autres qu’à des traîtres, effleurant une statue d’un regard machinal, vit un visage souriant, s’approcha pour voir l’inscription, et lut : Théodore de Banville. Ce n’était pas Iago, ce n’était pas Ganelon, c’était Théodore de Banville. Elle se leva. Elle caressa le premier visage de pierre qui personnifiait pour elle une vertu ; elle parcourut libérée ce jardin où les félons s’appelaient enfin Zénaïde Fleuriot, Ferdinand Fabre. La race des hommes de pierre était soudain régénérée. La race des hommes de chair y gagna. Chaque être vivant assis ou debout sur la terrasse parut un petit monument élevé à lui-même. Confiante à nouveau, Juliette descendit à grands pas vers la Société d’acclimatation.

"Quelle forme nouvelle de la vie de cette jolie fille apportait-elle ? .."
M. Guillet, le vice-président, était assis devant son courrier du soir. Les lettres étaient nombreuses, car il venait d’être guéri miraculeusement d’une péritonite et les correspondants des sociétés d’acclimatation du monde entier le félicitaient. Chacun, en cadeau de convalescence, lui annonçait sa dernière trouvaille en animaux, en insectes, ou en légumes inconnus et la lui dédiait. L’univers, en l’honneur de cette fistule, avait jusqu’à ce soir pavoisé trente-cinq nouvelles variétés d’êtres, dont douze comestibles. De chaque continent s’élevaient, à la gloire du viceprésident Guillet, une saveur nouvelle, des cris inédits. Aux îles Samoa, aiguille avalée le siècle précédent, le serpent Baya disparu des Indes depuis Dupleix était ressorti de la planète. Du flanc meurtri de M. Guillet, pour le paradis des naturalistes, avaient ainsi surgi l’Hydropotos parisiensis, le Cervus Guilleti, la Lymphea peritonitanea, et que ne surgirait-il pas, pensait mélancoliquement le convalescent, de la terre remuée au jour prochain de sa mort ! Il écrivait justement au tableau tous ces noms latins nouveaux, ces litanies qui n’avaient jamais encore été ni chantées, ni même prévues pour aucun personnage divin, quand Juliette entra avec une rose à son corsage. C’était une rose commune. M. Guillet la regarda un moment comme une rose nouvelle. Cela lui était arrivé d’ailleurs toute la journée pour les œillets, pour la salade. Quelle forme nouvelle de la vie de cette jolie fille apportait-elle ? Il vint l’écouter de tout près, comme si elle allait lâcher un écureuil. D’ailleurs il y avait des grillages aux fenêtres ouvertes, non pas que M. Guillet eût des enfants en bas âge, mais rares étaient les humains qui pénétraient dans ce local sans un petit jaguar dans un panier ou un oiseau dans leur poche.

"Juliette se défiait des hommes ..."
Juliette expliqua quel jeune homme elle recherchait, et donna les repères fournis par les deux dames, initiale du prénom R…, du nom B…, parents célèbres dans l’art d’élever les animaux bizarres. Juliette se défiait des hommes ; elle ne se sentait pas sûre au milieu des animaux ; d’où vient qu’elle se trouvait tellement à l’aise au milieu de ces hommes voués aux animaux ? Car M. Guillet n’était pas seul. Il y avait avec lui les trois êtres humains dont les empreintes digitales peuvent se rencontrer le plus fréquemment sur les bêtes malades, herbivores ou carnivores. Il y avait là le secrétaire de la Société de protection, du corps duquel venait de jaillir un nouveau vêtement, encore pris dans le faux col et le caleçon, un pardessus à boutons cousus à l’envers. Il y avait là M. Du Loas de Ray de Marne-Xaintrailles, ruiné mais épanoui, affamé mais gras, qui signait maintenant Duloasderay-Demarnexaintrailles, car son nom était le miroir de sa vie, qui n’avait guère été qu’une longue série d’apocopes, qui avait été la contraction misérable d’à peu près autant de beaux sentiments qu’il avait de titres ; et, à mesure, faute d’argent, de chance et d’amour, que sa loyauté fusionnait avec son goût pour la bonne chère, son courage avec le non-ressemelage de ses souliers, il laissait le nom de son aïeul Loas, ami de Blanche de Castille, se fondre avec le Ray de l’Ogre, et celui du compagnon de Jeanne d’Arc avec le Marne de Pépin. Il en était aujourd’hui à se demander s’il n’écrirait pas son nom en un unique mot, car sa vie éculée, sa misère uniforme correspondaient assez à Duloasderaydemarnexaintrailles.
Et il y avait aussi là un vieillard, qui n’avait pu se venger sur son nom des infortunes de sa vie, car il s’appelait By, auquel des malheurs particulièrement choisis, mort d’une femme adorée, mort du fils unique, avaient laissé seulement l’apparence d’un être accablé de menus et légers accidents, bousculade, tuile sur l’épaule, et que les plus épouvantables malheurs avaient seulement marqué de plâtre et de cambouis. D’une timidité telle que lorsqu’il avait demandé un numéro au téléphone, on ne le voyait plus, il s’enfuyait de honte, il devenait plusieurs heures invisible. Tels ils étaient tous quatre, qui se croyaient réunis par l’amour du canari huppé, et qu’assemblait en fait l’amour pour les trois autres, l’amour pour ce qu’il y a de plus digne dans l’humanité et de ce que la vie a traité le plus indignement. Ils s’étaient réunis aujourd’hui pour protester contre l’usage fait par les spirites des canaris huppés, race spécialement résistante, dont Eusapia et Éva comprimaient un représentant dans un recoin de leurs voiles ou de leur corps, et le délivraient, quand elles prétendaient ramener leur double astral des Indes ou de Madagascar. Béni soit le canari huppé, qui avait été prendre chacun sur le quai de l’Horloge, l’un d’eux même, M. By, bien plus près de la Seine, par ses vols jusqu’à cette salle, dernière enclave au monde du Paradis, où se continuait par des croisements entre le canari et le bouvreuil la besogne de création interrompue un samedi à minuit par Dieu. Le secrétaire prenait part à la conversation par des phrases qui n’avaient aucun rapport avec elle, mais qui cependant, mieux qu’un résumé textuel et ainsi que l’argument des chants dans les poèmes épiques, exprimaient le ton général et le niveau des âmes. C’est ainsi qu’après l’exposé de M. Du Loas contre Eusapia, il avait dit :
— Un abbé qui a beaucoup voyagé, avait-il dit, m’a dit : « La mer, c’est comme la confession, terrible ou fastidieux ! »
— Évidemment, avaient répondu ses trois amis, et c’est alors que Juliette était entrée, guidée par un canari invisible.

"Eux aussi, mis en confiance, lui racontèrent pourquoi ils avaient manqué leur vie..."
Je ne vous dirai pas tous les détails de la rencontre, ni comment Juliette en les quittant fut amenée à les embrasser tendrement. À leur vue, elle avait éprouvé cet accès de confiance que l’on n’a guère qu’une fois dans sa vie, et encore à l’égard de personnes peu susceptibles de se moquer des secrets ou de les trahir, l’océan, la première étoile, ou la chanson de l’oiseau dans Siegfried. Un accès de confiance tel que le secret à confier n’en a plus d’importance, cède le pas à des descriptions de meubles anciens ou à des histoires de chasse, et disparaît dans une plénitude de sympathie pour l’univers, pour les antiquaires, pour les dadas, comme le soleil d’été dans son rayonnement.
Eux aussi, mis en confiance, lui racontèrent pourquoi ils avaient manqué leur vie.
— J’ai manqué ma vie par ma faute, avoua M. By. Il m’eût suffi peut-être, pour être heureux, de consulter les statistiques. Mais, avec une femme anémique, j’ai accepté un poste dans le département où meurent le plus de pulmonaires. Avec un fils audacieux, j’ai sollicité mon changement pour le département où l’on compte le plus d’accidents de montagne. Maintenant, enfin, par ironie j’habite la ville où il y a le plus de centenaires. Je sais tout cela depuis peu… La statistique m’a vaincu… J’ai suivi l’itinéraire Nice-Grenoble-La Ferté alors que mon bonheur exigeait Pau, Tours, et le Chemin des Dames.
— J’ai manqué ma vie, dit M. Guillet, parce que je n’ai jamais traité un seul être au monde comme il l’aurait fallu. J’ai traité par exemple les hommes comme on traite les femmes, et inversement. Je croyais les hommes sensibles, ardents, nerveux, de santé faible, je les menais à la musique, je les comblais de prévenances, de flatteries ; je croyais les femmes réservées, musculaires, non susceptibles. Je leur disais leur fait, je les réveillais tôt… De là vient que ma vie est perdue… J’ai traité les chats comme on doit traiter les chiens, j’essayais de les convaincre, je les raisonnais, et j’ai été au contraire plein de réserve et de hauteur pour des chiens qui sans nul doute m’ont adoré. J’ai fait le malheur de ma vie… Celui qui ne sait pas se conduire exactement vis-à-vis de chaque espèce est perdu. Vis-à-vis des antilopes seulement j’ai conscience d’avoir réussi. Elles me suivent, elles me lèchent. Tout cela a commencé le jour où, au lycée, j’ai embrassé le pion qui dormait. Heureux ceux qui ont embrassé la bonne !
— Dans les répertoires des vies de héros depuis saint Louis, dit à son tour M. Du Loas, je crois que les Loas, entre toutes les familles de France, revendiquent le plus fort pourcentage. Mais ils ne peuvent être que héros. Dès qu’un Loas admet un rythme moins rapide, ou une conception moins tendue de l’existence, il doit se rendre au Mont-de-Piété et donner des leçons. Seuls les héros et les saints dans ma famille ont réussi à garder leurs diamants. Seuls les Loas martyrs ont été décorés. J’ai essayé de suivre leur exemple, mais l’intensité d’honneur, de témérité, de vertu qu’il m’a fallu porter et maintenir au rouge pendant trois mois, simplement pour passer mon baccalauréat, m’a découragé pour toujours… Et vous, Monsieur le Secrétaire ?
Le secrétaire prit son temps.
— Quand meurt, dit-il enfin, quand meurt une personne aimée à laquelle vous devez une lettre, si vous êtes égoïste, vous vous en réjouissez. Si vous êtes bon, vous n’aurez de tranquillité qu’après avoir écrit cette réponse !
La phrase du secrétaire, servant, on ne sait pourquoi, de transition entre les trois discours et les désirs de Juliette, amena M. Guillet à chercher dans l’annuaire de la Société le jeune homme parfait. Deux collègues répondaient au signalement. Même âge, mêmes initiales : le fils Belvoir et le fils Blanchemarine...."

Prière sur la Tour Eiffel - (Chapitre VI) " Juliette vint me voir aussi. Moi aussi elle me traita toute une matinée comme si j’étais pour elle le représentant au monde de l’inconnu. De ma pendule, de mes glaces, de mes tableaux, de ces objets qui dans une atmosphère et une camaraderie communes avaient perdu pour moi jusqu’à leur style, elle arriva à faire jaillir une sonnerie et une heure mystérieuses, des reflets et des personnages étrangement nouveaux. De ses yeux
étonnés, elle ramena chaque meuble non plus à l’antiquaire qui me l’avait vendu, cousin de Seligmann ou parent de Jonas, mais à son auteur même, élève de Jean Goujon ou de Boulle, et chacun d’eux ne fut plus qu’une ventouse posée sur un siècle ressuscité. Elle avait dans mon bureau les gestes qu’on a au sommet de la Tour Eiffel, s’accoudant à chaque console, à la cheminée comme à un balcon, avec ce petit vacillement que donne l’altitude aux voyageuses les moins sujettes au vertige...." - Ayant la connaissance de l'auteur lui-même, celui-ci lit à Juliette "cette "Prière à la Tour Eiffel" qui saura la convaincre que l'existence doit être construite en nous ...
"C’est le premier mai. Chaque mal infligé à Paris est guéri aujourd’hui par le grand spécialiste. Quand un plomb saute dans un ministère, c’est le fondateur même de l’École supérieure d’électricité qui accourt. Quand un tramway déraille, c’est l’équipe des dix premiers polytechniciens qui vient le remettre dans sa voie. Chaque bourgeois, vers midi, après ces cures merveilleuses, a le sentiment que si son bouton de pardessus sautait on alarmerait la rue de la Paix, et l’Observatoire si sa montre s’arrête. Il est gonflé de plénitude, en ce jour d’ouvriers parfaits, comme au temps, qu’il a oublié, où pour le moindre chagrin il alertait Schopenhauer, pour la moindre joie Rabelais. C’est que les grandes puissances sont seules aujourd’hui face à face avec les grands hommes, le feu en face du directeur du Creusot, le gaz du directeur du gaz, la vapeur face à face avec l’École Centrale. La journée de Paris, que trois millions d’ouvriers ont reposée, tourne sur ses huit rubis.
C’est le premier mai. C’est le jour où l’on reconnaît, à ce qu’elles restent actives, les industries qui mourront le jour de la révolution, qui sont purement bourgeoises, qui mourront bientôt. La maison Falize mourra où étincelle aujourd’hui l’épée de Forain avec la garde de faisceaux de pinceaux, et la coquille en palette d’or. La pharmacie Roberts mourra, avec ses médicaments contre l’abus du bourgogne, différents selon le cru et l’année. Paris est un étang vidé ; de magnifiques étrangers, de superbes hommes d’État, des Rothschild, sautent dans les flaques ou reluisent. Le Panthéon est isolé des autres édifices par l’armée en costume, et ne reçoit que les grands hommes vivants qu’il pourra plus tard recevoir morts. C’est le seul jour où l’on entende en France le burin des graveurs gratter, la plume des écrivains grincer. Tout le vacarme est fait par les métiers libéraux. Le médecin de l’usine est plus bruyant aujourd’hui que l’usine elle-même. On percevrait presque plus le grincement du soleil que celui de la terre… Le soleil est radieux d’ailleurs… Un bourgeois a dû l’appeler pour quelque panaris ou quelque géranium débile. Le ciel est tout bleu, les hirondelles volent, et là-haut aussi, plus haut qu’elles, deux ou trois hommes se maintiennent dans l’air sur des machines, grâce à un truc.
Il en est toujours ainsi, et réciproquement : l’inclination que je nourris depuis ce matin pour les hommes n’a d’autres résultats que de me faire obéir aux éléments. Le moindre vent me dirige. Au lieu de remonter la Seine j’ai suivi son courant. Des patrouilles escortaient ce poète qui allait au travail, – et voici la tour Eiffel ! Mon Dieu, quelle confiance il possédait en la gravitation universelle, son ingénieur ! Sainte Vierge, si un quart de seconde l’hypothèse de la loi de la pesanteur était controuvée, quel magnifique décombre ! Voilà ce qu’on élève avec des hypothèses ! Voilà réalisée en fer la corde que lance au ciel le fakir et à laquelle il invite ses amis à grimper…
J’ai connu Eiffel, je grimpe… Mon Dieu, qu’elle est belle, vue de la cage du départ, avec sa large baguette cousue jusqu’au deuxième, comme à une superbe chaussette ! Mais elle n’est pas un édifice, elle est une voiture, un navire. Elle est vieille et réparée comme un bateau de son âge, de mon âge aussi, car je suis né le mois où elle sortit de terre. Elle a l’âge où l’on aime sentir grimper sur soi des enfants et des Américaines. Elle à l’âge où le cœur aime se munir de T.S.F. et de concerts à son sommet. Tout ce que j’aime dans les transatlantiques je l’y retrouve. Des parfums incompréhensibles, déposés dans un losange d’acier par un seul passant, et aussi fixes dans leur altitude qu’un cercueil dans la mer tenu par son boulet ; mais surtout des noms de Syriens, de Colombiens, d’Australiens, gravés non sur les bastingages mais sur toutes les vitres, car la matière la plus sensible de cette tour et la plus malléable est le verre. Pas un visiteur étranger qui ne soit monté là avec un diamant… On nous change à chaque instant d’ascenseur pour dérouter je ne sais quelle poursuite, et certains voyageurs, débarrassés de leurs noms et prénoms dès le second étage, errent au troisième les yeux vagues, à la recherche d’un pseudonyme ou d’un parrain idéal.
On donne un quart d’heure d’arrêt sur cette plate-forme.
Mais, pour ces quinze minutes d’isolement, Eiffel assembla tout ce qui suffit pour onze mois aux passagers du bateau qui fait le tour du monde, dix jeux de tonneau, dix oracles automatiques,
des oiseaux mécaniques par douzaines, et le coiffeur. Chaque exposition a laissé si haut son alluvion, un peu d’alluvion universelle. Celle de 1889, des appareils stéréoscopes où l’on voit les négresses de chaque peuplade du Congo écarter les yeux et les seins devant un spectacle prodigieux qui ne peut être, tant leurs surprises sont semblables, que l’aspect du photographe.
Celle de 1900 des mots russes. Moscou, Cronstadt sont montées elles aussi graver leur nom… Mais que le musée Galliera est beau d’ici ! Comme ces disputes que mènent en bas Notre-Dame et le Sacré-Cœur, le Panthéon et la gare de Lyon, on voit d’ici qu’elles sont truquées pour amuser un peu les hommes et qu’il n’y a, au contraire, entre tous ces édifices qu’accord et que consentement. Désaxés aujourd’hui par un aimant qui est sans doute l’amitié, c’est tout juste si le pont Alexandre et le pont de la Concorde ne se rapprochent et ne s’accolent pas. Comme d’ici les lois de l’univers reprennent leur valeur ! Comme les savants ont tort, qui disent l’humanité vouée à la mort, un sexe peu à peu prédominant, et comme au contraire ils apparaissent distribués dans les rues, les voitures et aux fenêtres en nombre égal, ces hommes et ces femmes, qui, la journée finie, se retirent pour engendrer et concevoir, grâce à un stratagème.
Que l’on travaille en ce premier mai sur ce faîte ! Un radio envoie vers quatre continents, à travers moi, les nouvelles de Paris. Sur une carte je vois délimité son domaine, si net que par le bottin étranger je peux connaître le nom du dernier épicier brésilien, du dernier rentier de Samarkand effleuré par ses ondes. Tout un orchestre joue aussi pour l’univers, satisfait du seul applaudissement du gardien. Seuls les hommes de lettres ici sont sans voix. Bénie soit l’institutrice qui, lorsque j’eus cinq ans, me montrant le plus beau livre d’images et me bâillonnant hermétiquement de sa main, m’apprit à penser sans avoir à pousser des cris, en deux leçons d’une heure !
Ainsi, j’ai sous les yeux les cinq mille hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Cet air léger, ce vide au-dessous de moi, ce sont les stratifications, combien accumulées, de l’esprit, du raisonnement, du goût. Ainsi tous ces amoindrissements et mutilations qu’ont subis les hommes, il y a plus de chance, ici plus que partout ailleurs, y compris Babylone et Athènes, pour que les aient valus la lutte avec la laideur, la tyrannie et la matière. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il y a plus de chance qu’ailleurs pour que les dos courbés, les rides de ces bourgeois et de ces artisans aient été gagnés à la lecture, à l’impression, à la reliure de Descartes et de Pascal. Pour que ces lorgnons sur ce nez aient été rendus nécessaires par Commines et par Froissart. Pour que cette faiblesse des paupières ait été gagnée à la copie du manuel héraldique, ou dans un atelier, parce que des gens n’ont pas voulu transiger avec certain chrome ou certain écarlate. Pour que ce manchot ait eu le doigt, puis la main, puis l’autre main coupés en retenant près du radium la barque (si vous voulez et si vous avez saisi l’allusion à ce combat de Salamine) de nos maux. Voilà l’hectare où la contemplation de Watteau a causé le plus de pattes-d’oie. Voilà l’hectare où les courses pour porter à la poste Corneille, Racine et Hugo ont donné le plus de varices. Voilà la maison où habite l’ouvrier qui se cassa la jambe en réparant la plaque de Danton. Voilà, au coin du quai Voltaire, le centiare où il fut gagné le plus de gravelle à combattre le despotisme. Voilà le décimètre carré où, le jour de sa mort, coula le sang de Molière. Il se trouve qu’en ce jour de grève où les métiers passent pour chômer dans Paris, où les ouvriers, croyant aller contre leur nature et obéissant seulement à l’habitude ancestrale, ont regagné la campagne, Paris exerce le pur métier de Paris ; et Notre-Dame et le Louvre et tous ses monuments sont aujourd’hui aussi opaques et immobiles que la roue de l’hélice tournant à mille tours…
Mais que vois-je ?
J’ai pu soutenir des maux apprêtés pour des générations de héros et de géants, la guerre, la peste, le naufrage, avec rien autre chose qu’un courage bourgeois. Fils des citoyens de Louis Philippe, je n’ai pas été inégal aux fléaux d’Attila. Mais tout ce que je croyais en moi digne des grandes époques, cet épanouissement quattrocentiste en moi de l’espoir, ce débordement ronsardien en moi de l’amour, chaque année, en face du printemps, ne me fournit que des armes piteuses. Le moindre bourgeon remporte sur moi la victoire. Je suis inférieur à la moindre cascade. Or, soudain, je vois le printemps entourer Paris. Par les brèches des murailles et par les avenues, il se pousse jusqu’à la Seine et seuls les ponts sont encore sans feuillage. En ce jour de repos le vent dans le bois de Boulogne n’est plus qu’un mouvement de croissance. Le printemps, le Bois, croissent comme une mer. Sur la banlieue ressuscitée, lacs, bassins et réservoirs reprennent leur orient. De chacun des sept cimetières, entre les verdures neuves, n’émerge plus qu’un seul monument. Paris n’avoue aujourd’hui que sept morts, et de belles files bleues de fantassins transparaissent sous les rues en veines royales… "
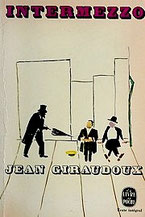
"INTERMEZZO" (1933)
Comédie en trois actes de Jean Giraudoux représentée à Paris, le 1er mars 1933. Un spectre hante une petite ville du Limousin. Un état de délire poétique s'est emparé de tous les habitants, mais l'institutrice, Isabelle. est la plus troublée de tous. Chaque soir, lorsque a sonné le clairon de la caserne, elle va près des roseaux retrouver son fantôme qui l'exhorte à venir avec lui chez les morts. Cette fréquentation de l'au-delà n'a pas été sans affecter le comportement quotidien de l'institutrice : elle a du tout au tout changé l'éducation de ses élèves, fait de la pédagogie dans les champs et remplace les leçons de morale par des hymnes à la beauté physique et végétale. C'en est au point que l'administration supérieure s'émeut : elle dépêche la raison raisonnante dans la petite ville, sous l'espèce d'un gros inspecteur d'académie, anticlérical comme il se doit, partisan convaincu du progrès, méprisant les esprits. Le maire lui avoue que la situation est grave : dans la ville, "tous les vœux s'exaucent... toutes les divagations se trouvent être justes". L'ordre est renversé par les apparitions du spectre : les enfants battus par leurs parents quittent le domicile paternel ; les chiens maltraités mordent leurs bourreaux ; et même à la loterie, "le jeune champion a gagné la motocyclette, et non la supérieure des bonnes sœurs", comme il arrivait chaque année! Il faut agir! Il faut tuer le spectre!
L`inspecteur d`académie charge de l'exécution deux bourreaux en retraite, qui tirent sur le fantôme... lequel renaît aussitôt. Là où l'lnspecteur et la Raison viennent d'échouer, l`amour va réussir. Aidé du droguiste, le contrôleur des poids et mesures, amoureux d'Isabelle, désenchantera l`institutrice. Il ramène la jeune fille sur terre, l`arrache à la poésie de l'au-delà, non par la raison et le manuel, mais en lui apprenant à tout aimer de la vie, et surtout ce qui est en elle de plus humble : les bruits, le vent, les odeurs de fleurs.
Le spectre vaincu, délaissé par Isabelle, s'en va : "Le district est en ordre. L'argent y va de nouveau aux riches, le bonheur aux heureux, la femme au séducteur... Et fini l'intermède !"
On retrouve ainsi le thème familier de Giraudoux, l'acceptation de la vie, la grâce de l`accord avec les humains et la nature. Cette nature, il est vrai, Giraudoux la pare, surtout ici, du sentiment le plus attractif ; il nous la fait sentir dans le charme de l'alliance des mots et des idées. qui font d'Intermezzo un vrai divertissement, où l`on retrouve un Giraudoux à l'état pur, donnant libre cours à ses fantaisies et à sa verve. Une douce philosophie, résignée, mais nullement pessimiste...

LA GUERRE DE TROIE N’AURA PAS LIEU a été représentée pour la première fois le 21 novembre 1935 au Théâtre de l’Athénée, sous la direction de Louis Jouvet.
ACTE PREMIER - Terrasse d’un rempart dominé par une terrasse et dominant d’autres remparts.
SCÈNE PREMIÈRE.
ANDROMAQUE, CASSANDRE, UNE JEUNE SERVANTE
ANDROMAQUE. – La guerre de Troie n’aura pas lieu, Cassandre !
CASSANDRE. – Je te tiens un pari, Andromaque.
ANDROMAQUE. – Cet envoyé des Grecs a raison. On va bien le recevoir. On va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra.
CASSANDRE. – On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène. Et la guerre de Troie aura lieu.
ANDROMAQUE. – Oui, si Hector n’était pas là !… Mais il arrive, Cassandre, il arrive ! Tu entends assez ses trompettes…
En cette minute, il entre dans la ville, victorieux. Je pense qu’il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà trois mois, il m’a juré que cette guerre était la dernière.
CASSANDRE. – C’était la dernière. La suivante l’attend.
ANDROMAQUE. – Cela ne te fatigue pas de ne voir et de ne prévoir que l’effroyable ?
CASSANDRE. – Je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de deux bêtises, celle des hommes et celle des éléments.
ANDROMAQUE. – Pourquoi la guerre aurait-elle lieu ? Pâris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Pâris.
CASSANDRE. – Il s’agit bien d’eux !
ANDROMAQUE. – Il s’agit de quoi ?
CASSANDRE. – Pâris ne tient plus à Hélène ! Hélène ne tient plus à Pâris ! Tu as vu le destin s’intéresser à des phrases négatives ?
ANDROMAQUE. – Je ne sais pas ce qu’est le destin.
CASSANDRE. – Je vais te le dire. C’est simplement la forme accélérée du temps. C’est épouvantable.
ANDROMAQUE. – Je ne comprends pas les abstractions.
CASSANDRE. – À ton aise. Ayons recours aux métaphores. Figure-toi un tigre. Tu la comprends, celle-là ? C’est la métaphore pour jeunes filles. Un tigre qui dort.
ANDROMAQUE. – Laisse-le dormir.
CASSANDRE. – Je ne demande pas mieux. Mais ce sont les affirmations qui l’arrachent à son sommeil. Depuis quelque temps, Troie en est pleine.
ANDROMAQUE. – Pleine de quoi ?
CASSANDRE. – De ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux hommes en général, et aux Troyens ou Troyennes en particulier…
ANDROMAQUE. – Je ne te comprends pas.
CASSANDRE. – Hector en cette heure rentre dans Troie ?
ANDROMAQUE. – Oui. Hector en cette heure revient à sa femme.
CASSANDRE. – Cette femme d’Hector va avoir un enfant ?
ANDROMAQUE. – Oui, je vais avoir un enfant.
CASSANDRE. – Ce ne sont pas des affirmations, tout cela ?
ANDROMAQUE. – Ne me fais pas peur, Cassandre.
UNE JEUNE SERVANTE, qui passe avec du linge. – Quel beau jour, maîtresse !
CASSANDRE. – Ah ! oui ? Tu trouves ?
LA JEUNE SERVANTE, qui sort. – Troie touche aujourd’hui son plus beau jour de printemps.
CASSANDRE. – Jusqu’au lavoir qui affirme !
ANDROMAQUE. – Oh ! justement, Cassandre ! Comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil ? Le bonheur tombe sur le monde !
CASSANDRE. – Une vraie neige.
ANDROMAQUE. – La beauté aussi. Vois ce soleil. Il s’amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu’au fond des mers. De toute maison de pêcheur, de tout arbre sort le murmure des coquillages. Si jamais il y a eu une chance de voir les hommes trouver un moyen pour vivre en paix, c’est aujourd’hui… Et pour qu’ils soient modestes… Et pour qu’ils soient immortels…
CASSANDRE. – Oui les paralytiques qu’on a traînés devant les portes se sentent immortels.
ANDROMAQUE. – Et pour qu’ils soient bons !… Vois ce cavalier de l’avant-garde se baisser sur l’étrier pour caresser un chat dans ce créneau… Nous sommes peut-être aussi au premier jour de l’entente entre l’homme et les bêtes.
CASSANDRE. – Tu parles trop. Le destin s’agite, Andromaque !
ANDROMAQUE. – Il s’agite dans les filles qui n’ont pas de mari. Je ne te crois pas.
CASSANDRE. – Tu as tort. Ah ! Hector rentre dans la gloire chez sa femme adorée !… Il ouvre un œil… Ah ! Les hémiplégiques se croient immortels sur leurs petits bancs !… Il s’étire… Ah ! Il est aujourd’hui une chance pour que la paix s’installe sur le monde !… Il se pourlèche… Et Andromaque va avoir un fils ! Et les cuirassiers se baissent maintenant sur l’étrier pour caresser les matous dans les créneaux !… Il se met en marche !
ANDROMAQUE. – Tais-toi !
CASSANDRE. – Et il monte sans bruit les escaliers du palais. Il pousse du mufle les portes… Le voilà… Le voilà…
La voix d’HECTOR. – Andromaque !
ANDROMAQUE. – Tu mens !… C’est Hector !
CASSANDRE. – Qui t’a dit autre chose ?
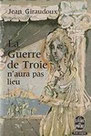
LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU (1935)
Giraudoux est tout entier dans ce titre, avec sa fantaisie qui semble remettre en question, sur un ton de souriante désinvolture, l'existence même des faits historiques, avec sa foi en l'homme, qui lui fait supposer que la lucidité humaine peut s'opposer victorieusement à la fatalité de l'événement. Il a situé de façon originale et subtile l'action de sa pièce, avant le début du légendaire conflit dont l'Iliade d'Homère retraçait un épisode essentiel : Hector, soutenu par sa femme Andromaque, s'efforce de sauver la paix menacée par le scandale national de l'enlèvement d'Hélène. Il espère la remettre aux mains d'Ulysse, venu la réclamer à la tête d'une flotte grecque. Les deux chefs, hommes de bonne volonté et de grande lucidité, sont face à face (II, 13).
L'intérêt dramatique se confond, ici, avec l'approche d'un destin inéluctable à laquelle l'imminence de la guerre franco-allemande ajoutait alors une terrible actualité. L'art de Giraudoux, qui sait montrer à côté des palais majestueux, la terrasse à l'angle du jardin, les hommes en conversation familière, les pétales des magnolias tombant sur leurs épaules, a une valeur d'incantation. Enfin, cette philosophie sensible qui attache tant de prix aux êtres et aux choses, qui "pèse l'homme jeune", "l'enfant à naître", "les chênes phrygiens feuillus et trapus, épars sur les collines avec les bœufs frisés", n'a jamais été si délicatement exprimée, si touchante qu'en l'évocation de ce crépuscule radieux qu'embraseront bientôt les flammes des incendies et les hurlements des victimes....
Hector. - Et voilà le vrai combat, Ulysse?
Ulysse. - Le combat d'où sortira ou ne sortira pas la guerre, oui.
Hector. - Elle en sortira?
Ulysse. - Nous allons le savoir dans cinq minutes.
Hector. - Si c'est un combat de paroles, mes chances sont faibles.
Ulysse. - Je crois que cela sera plutôt une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance. Le poids parlera...
.Hector. - Mon poids? Ce que je pèse, Ulysse? Je pèse un homme jeune, une femme jeune, un enfant à naître. Je pèse la joie de vivre, l'élan vers ce qui est juste et naturel.
Ulysse. - Je pèse l'homme adulte, la femme de trente ans, le fils que je mesure chaque mois avec des encoches contre le chambranle du palais... Mon beau-père prétend que j'abîme la menuiserie... Je pèse la volupté de vivre et la méfiance de la vie.
Hector. - Je pèse la chasse, le courage, la fidélité, l'amour.
Ulysse. - Je pèse la circonspection devant les dieux, les hommes et les choses.
Hector. - Je pèse le chêne phrygien, tous les chênes phrygiens feuillus et trapus, épars sur nos collines avec nos bœufs frisés.
Ulysse. - Je pèse l'olivier.
Hector. - Je pèse le faucon, je regarde le soleil en face.
Ulysse. - Je pèse la chouette.
Hector. - Je pèse tout un peuple de paysans débonnaires, d'artisans laborieux, de milliers de
charrues, de métiers à tisser, de forges et d'enclumes... Oh! pourquoi, devant vous, tous ces
poids me paraissent-ils tout à coup si légers?
Ulysse. - Je pèse ce que pèse cet air incorruptible et impitoyable sur la côte et sur l'archipel.
Hector. - Pourquoi continuer? La balance s 'incline.
Ulysse. - De mon côté?... Oui, je le crois.
Hector. - Et vous voulez la guerre?
Ulysse. - Je ne la veux pas. Mais je suis moins sûr de ses intentions à elle.
Hector. - Nos peuples nous ont délégués tous deux ici pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu...
Ulysse. - Vous êtes jeune, Hector!... A la veille de toute guerre, il est courant que deux chefs des peuples en conflit se rencontrent seuls dans quelque innocent village, sur la terrasse au bord d 'un lac, dans l'angle d'un jardin. Et ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde, et tous deux, à suivre du regard ces reflets et ces rides sur les eaux, à recevoir sur l'épaule ces pétales de magnolias, ils sont pacifiques, modestes, loyaux. Et ils s'étudient. Ils se regardent. Et, tiédis par le soleil, attendris par un vin clairet, ils ne trouvent dans le visage d'en face aucun trait qui justifie la haine, aucun trait qui n'appelle l'amour humain, et rien d'incompatible non plus dans leurs langages, dans leur façon de se gratter le nez ou de boire. Et ils sont vraiment comblés de paix, de désirs de paix. Et ils se quittent en se serrant les mains, en se sentant des frères. Et ils se retournent de leur calèche pour se sourire... Et le lendemain, pourtant, éclate la guerre... Ainsi, nous sommes tous deux maintenant. Nos peuples autour de l'entretien se taisent et s'écartent, mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable. C'est seulement qu'ils nous ont donné pleins pouvoirs, qu'ils nous ont isolés, pour que nous goûtions mieux, au-dessus de la catastrophe, notre fraternité d 'ennemis. Goûtons-la. C 'est un plat de riches. Savourons-la... Mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes d'une terrasse.
Hector. - C'est une conversation d'ennemis que nous avons là?
Ulysse. - C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois, nous nous parlons, une heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous nous réconcilions avant la lutte même, c'est toujours cela. Peut-être, d'ailleurs, avons-nous tort. Si l'un de nous doit un jour tuer l'autre et arracher, pour reconnaître sa victime, la visière de son casque, il vaudrait peut-être mieux qu'il ne lui donnât pas un visage de frère... Mais l'univers le sait, nous allons nous battre.
Hector. - L'univers peut se tromper. C'est à cela qu'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle.
Ulysse. - Espérons-le. Mais quand le destin, depuis des années, a surélevé deux peuples, quand il leur a ouvert le même avenir d'invention et d 'omnipotence, quand il a fait de chacun, comme nous l'étions tout à l'heure sur la bascule, un poids précieux et différent pour peser le plaisir, la conscience et jusqu'à la nature, quand, par leurs architectes, leurs poètes, leurs teinturiers, il leur a donné à chacun un royaume opposé de volumes, de sons et de nuances, quand il leur a fait inventer le toit en charpente troyen et la voûte thébaine, le rouge phrygien et l'indigo grec, l'univers sait bien qu'il n'entend pas préparer ainsi aux hommes deux chemins de couleur et d'épanouissement, mais se ménager son festival, le déchaînement de cette brutalité et de cette folie humaines qui, seules, rassurent les dieux. C'est de la petite politique, j'en conviens. Mais nous sommes chefs d'État, nous pouvons bien entre nous deux le dire : c'est couramment celle du Destin.
Hector. - Et c'est Troie, et c'est la Grèce qu'il a choisies cette fois?
Ulysse. - Ce matin, j'en doutais encore. J'ai posé le pied sur votre estacade et j'en suis sûr.
Hector. - Vous vous êtes senti sur un sol ennemi?
Ulysse. - Pourquoi toujours revenir à ce mot ennemi! Faut-il vous le redire? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Il est des peuples que tout désigne pour une guerre, leur peau, leur langue et leur odeur, ils se jalousent, ils se haïssent, ils ne peuvent pas se sentir... Ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent, ce sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre : ce sont les adversaires.
Hector. - Et nous sommes prêts pour la guerre grecque?
Ulysse. - A un point incroyable. Comme la nature munit les insectes dont elle prévoit la lutte, de faiblesses et d'armes qui se correspondent, à distance, sans que nous nous connaissions, sans que nous nous en doutions, nous nous sommes élevés tous deux au niveau de notre guerre. Tout correspond de nos armes et de nos habitudes, comme des roues à pignon. Et le regard de vos femmes, et le teint de vos filles sont les seuls qui ne suscitent en nous ni la brutalité, ni le désir, mais cette angoisse du cœur et de la joie qui est l'horizon de la guerre. Frontons et leurs soutaches d'ombre et de feu, hennissements des chevaux, péplums disparaissant à l'angle d'une colonnade, le sort a tout passé chez vous à cette couleur d'orage qui m'impose, pour la première fois, le relief de l'avenir. Il n'y a rien à faire. Vous êtes dans la lumière de la guerre grecque.
Hector. - Et c'est ce que pensent aussi les autres Grecs?
Ulysse. - Ce qu'ils pensent n 'est pas plus rassurant. Les autres Grecs pensent que Troie est riche, ses entrepôts magnifiques, sa banlieue fertile. Ils pensent qu'ils sont à l'étroit sur du roc. L'or de vos temples, celui de vos blés et de votre colza, ont fait à chacun de nos navires, de vos promontoires, un signe qu'il n'oublie pas. Il n 'est pas très prudent d 'avoir des dieux et des légumes trop dorés.
Hector. - Voilà enfin une parole franche... La Grèce en nous s'est choisi une proie. Pourquoi alors une déclaration de guerre? Il était plus simple de profiter de mon absence pour bondir sur Troie. Vous l'auriez eue sans coup férir.
Ulysse. - Il est une espèce de consentement à la guerre que donnent seulement l'atmosphère, l'acoustique et l'humeur du monde. Il serait dément d'entreprendre une guerre sans l'avoir. Nous ne l'avions pas.
Hector. - Vous l'avez maintenant !
Ulysse. - Je crois que nous l'avons.
Pâris ayant enlevé Hélène au roi Ménélas, la ville de Troie attend de pied ferme la délégation grecque conduite parUlysse, chargé de la libérer des Troyens. Hector, le fils aîné du roi Priam, revient de la guerre et, ayant promis à sa femme Andromaque que c'était la demière, il ne souhaitequ'une chose: la paix ...
Le prétexte de l'enlèvement d'Hélène lui paraît trop futile pour être la cause d'une guerre. Ainsi essaye-t-il de convaincre son jeune frère Pâris de libérer Hélène. Celui-ci y consent d'autant plus volontiers que leur amour n`était qu'une passade mais la prophétesse Cassandre lui révèle que le roi Priam et les intellectuels de la ville ont déjà pris leur décision. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver celle qu'ils appellent la beauté, au sein de la cité, même si le prix à payer en est la guerre.
Hector, accompagné de sa mère» Hécube, essaye bien de les en dissuader, mais rien n'y fait. Le poète Démokos a déjà organisé un concours d'injures afin d'en abreuver l'ennemi. Hector n'entrevoit qu'une issue: convaincre Hélène de rejoindre les Grecs afin d'éviter cette guerre absurde. Hélène y consentirait bien volontiers, mais elle ne se voit pas rentrer chez les siens. Elle s'y voit d'autant moins qu'elle bénéficie, tout comme Cassandre, du don de double vue et qu'elle est incapable d'entrevoir l'image de la paix que cette dernière tente d'évoquer.
Tandis que le Conseil des Anciens demande au juriste Burisis de présenter le débarquement grec comme une offense à la cité, Hélène taquine le jeune Troilus à qui elle promet un baiser. A sa vue, Andromaque déplore que la cause de la guerre ne soit même pas un grand amour. Hector, de son côté, tente désespérément de contrarier le destin qui pèse sur la ville et prononce un discours de paix bientôt interrompu par l'arrivée d'Ulysse et de ses compagnons. Démokos profite de l'occasion pour exhorter la foule à prendre les armes contre la délégation grecque.
Dans ce climat de tension, le moindre incident peut être l'étincelle d'oü jaillira la guerre. Oiax, un jeune grec ivre, s'en prend à Andromaque et à Hector qu`il gifle en présence de tous. Hector se contient et, afin d'éviter l'irréparable, assure aux Grecs que leur roi peut être tranquille : Hélène n'a pas «connu» Pâris...
Ulysse, qu'un même désir de paix anime, est prêt à croire le Troyen, malgré le démenti que les marins troyens, croyant sauver leur honneur, opposent à cette affirmation.
Au moment où, enfin, la guerre semble évitée, surgit Démokos «qui tente de précipiter l'irréparable en haranguant la foule. Hector n'a d'autre alternative que de le tuer d'un coup de javelot. Dans un dernier sursaut de volonté, Démokos accuse le Grec Oiax de l'avoir assassiné. Ni Hector ni Ulysse ne peuvent désormais arrêter le destin: la guerre de Troie aura bien lieu ...
SCÈNE QUATORZIÈME ...
ANDROMAQUE, CASSANDRE, HECTOR, ABNÉOS, puis OIAX, puis DEMOKOS
HECTOR. – Tu étais là, Andromaque ?
ANDROMAQUE. – Soutiens-moi. Je n’en puis plus !
HECTOR. – Tu nous écoutais ?
ANDROMAQUE. – Oui. Je suis brisée.
HECTOR. – Tu vois qu’il ne faut pas désespérer…
ANDROMAQUE. – De nous peut-être. Du monde, oui… Cet homme est effroyable. La misère du monde est sur moi.
HECTOR. – Une minute encore, et Ulysse est à son bord…
Il marche vite. D’ici l’on suit son cortège. Le voilà déjà en face des fontaines. Que fais-tu ?
ANDROMAQUE. – Je n’ai plus la force d’entendre. Je me bouche les oreilles. Je n’enlèverai pas les mains avant que notre sort soit fixé…
HECTOR. – Cherche Hélène, Cassandre !
Oiax entre sur la scène, de plus en plus ivre. Il voit Andromaque de dos.
CASSANDRE. – Ulysse vous attend au port, Oiax. On vous y conduit Hélène.
OIAX. – Hélène ! Je me moque d’Hélène ! C’est celle-là que je veux tenir dans mes bras.
CASSANDRE. – Partez, Oiax. C’est la femme d’Hector.
OIAX. – La femme d’Hector ! Bravo ! J’ai toujours préféré les femmes de mes amis, de mes vrais amis !
CASSANDRE. – Ulysse est déjà à mi-chemin… Partez.
OIAX. – Ne te fâche pas. Elle se bouche les oreilles. Je peux donc tout lui dire, puisqu’elle n’entendra pas. Si je la touchais, si je l’embrassais, évidemment ! Mais des paroles qu’on n’entend pas, rien de moins grave.
CASSANDRE. – Rien de plus grave. Allez, Oiax !
OIAX, pendant que Cassandre essaie par la force de l’éloigner d’Andromaque et qu’Hector lève peu à peu son javelot. . – Tu crois ? Alors autant la toucher. Autant l’embrasser.
Mais chastement !… Toujours chastement, les femmes des vrais amis ! Qu’est-ce qu’elle a de plus chaste ta femme, Hector, le cou ? Voilà pour le cou… L’oreille aussi m’a un gentil petit air
tout à fait chaste ! Voilà pour l’oreille… Je vais te dire, moi, ce que j’ai toujours trouvé de plus chaste chez la femme… Laissemoi !…Laisse-moi ! Elle n’entend pas les baisers non plus… Ce que tu es forte !… Je viens… Je viens… Adieu. (Il sort.)
Hector baisse imperceptiblement son javelot. À ce moment Demokos fait irruption.
DEMOKOS. – Quelle est cette lâcheté ? Tu rends Hélène ? Troyens, aux armes ! On nous trahit… Rassemblez-vous… Et votre chant de guerre est prêt ! Ecoutez votre chant de guerre !
HECTOR. – Voilà pour ton chant de guerre !
DEMOKOS tombant . – Il m’a tué !
HECTOR. – La guerre n’aura pas lieu, Andromaque !
Il essaie de détacher les mains d’Andromaque qui résiste, les yeux fixés sur Demokos. Le rideau qui avait commencé à tomber se lève peu à peu.
ABNEOS. – On a tué Demokos ! Qui a tué Demokos ?
DEMOKOS. – Qui m’a tué ?… Oiax !… Oiax !… Tuez-le !
ABNEOS. – Tuez Oiax !
HECTOR. – Il ment. C’est moi qui l’ai frappé.
DEMOKOS. – Non. C’est Oiax…
ABNEOS. – Oiax a tué Demokos… Rattrapez-le !… Châtiezle !
HECTOR. – C’est moi, Demokos, avoue-le ! Avoue-le, ou je t’achève !
DEMOKOS. – Non, mon cher Hector, mon bien cher Hector. C’est Oiax ! Tuez Oiax !
CASSANDRE. – Il meurt, comme il a vécu, en coassant.
ABNEOS. – Voilà… Ils tiennent Oiax… Voilà. Ils l’ont tué !
HECTOR, détachant les mains d’Andromaque. . – Elle aura lieu.
Les portes de la guerre s’ouvrent lentement. Elles découvrent Hélène qui embrasse Troïlus.
CASSANDRE. – Le poète troyen est mort… la parole est au poète grec.
Le rideau tombe définitivement.
Ce qui est particulièrement frappant dans l`œuvre de Giraudoux, ce n'est pas la recherche de l'originalité du sujet, mais bien son traitement. L'intelligence plus que la sensibilité donne à ses pièces un ton qui ne se dément pas ...
Ecrite en 1935, "La Guerre de Troie" est avant tout l'expression d'une fatalité et de la lutte inégale qui oppose les hommes à leur destin. Hector, l'ancien combattant, rentre à Troie, persuadé de l'inutilité des guerres, quelles qu'elles soient. Il est l'exacte antithèse de Démokos qui pare la guerre de toutes les vertus (héroïsme, exaltation des morts, bon droit...). Pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont totalement libres de leurs actes ni de leurs pensées.
Dès la première scène, Cassandre attire l'attention du spectateur sur«le destin qui, une fois ébranlé, ne peut être arrêté: «Je tiens seulement compte de deux bêtises: celle des hommes et celle des éléments. » La guerre échappe aux hommes et, quelle que soit leur volonté, des hasards, des éléments incontrôlables (l'enlèvement d'Hélène, Oiax le grec ivre, la mort de Démokos...), président à son déclenchement.
A travers sa vision pessimiste et son scepticisme quant aux chances qu'ont les êtres humains de bonne volonté. de se faire entendre en pareilles circonstances, Giraudoux présentait les événements qui allaient bouleverser le monde en 1940. Mais si la pièce peut être replacée dans un contexte historique, son écriture, sa parenté au thème antique ainsi que la distance par rapport au modèle et aux événements (anachronismes) en font une pièce dont l'actualité risque de ne jamais se démettre.
Et c'est d'abord une mise en garde, un avertissement. Hector, malgré sa bonne volonté et l'ardeur qu'il met à défendre la paix, reste impuissant. Tout comme Démokos, qui semble triompher, ne peut rien sans la foule qui le soutient. C'est le peuple qui lynchera Oiax et rendra la guerre inévitable. La fatalité en soi n'existe donc pas? Pas au sens d'un destin inéluctable.
Ce sont les hommes qui forgent leur destin, qui décident de leur destinée. Selon Giraudoux, le malheur réside dans le fait que ce ne sont pas les intellectuels qui décident en fin de compte mais la foule qu'un hasard, un accident suffit à faire basculer dans un camp ou dans l'autre.

«Les jeunes filles sont toutes faites pour des monstres, beaux ou hideux, et elles sont données à des hommes. De Ià leur vie gâchée. » (Judith II, 7) "
Giraudoux n’écrit que pour soustraire les jeunes filles aux hommes. Des hommes dans son genre, attachés d’ambassade nés dans un paradis provincial, ou éternels premiers, fiers de leur tête trop lourde et de leur front trop grand. Giraudoux n’écrit que pour fixer les traits d’Ondine et de Judith, de Claudie et de Juliette, avant qu’elles pénètrent au pays des hommes. I] choisit ses élues comme Racine choisissait ses héroïnes : il les embauche « sur leur apparence et leur teint, et en bloc, comme des danseuses! ».
Giraudoux enlève les jeunes filles. Il les embarque pour le monde flottant. Il les maquille en syntaxe, leur donne I’allure tranchante des concetti, le naturel des hyperboles. IL leur glisse entre les mains un codex d’angoisses. Il fait d’elles des absentes, des messagères de la préciosité, ce « mal qui consiste à traiter les objets comme des humains, les humains comme s’ils étaient dieux ou vierges, les dieux comme des chats ou des belettes? ». Les héroïnes de Giraudoux sont a l’image de leur créateur, qui pense qu’il n’y a pas d’écrivains naturels en France, qu’une ligne de démarcation sépare le monde de la réalité et celui de la littérature.
En 1939, alors que ses contemporains jettent un regard suspicieux sur le monde, la littérature, le langage, Giraudoux croit sans faillir que l'avenir de l'Europe est dans son style et le prouve dans "Choix des élues".
C’est son dernier roman, avant sa mort en 1944, et le dernier volet de sa trilogie des femmes : Malena ou comment faire soi-méme son propre malheur (Combat avec lange), Nelly ou l'adultére (La Menteuse) et enfin Edmée ou les chemins de la liberté (Choix des élues). C’est aussi, après "Juliette au pays des hommes" et "Les Aventures de Jéréme Bardini", le point d’orgue des romans sur l’art de la fugue. Edmée rejoint dans leur échappée Juliette et Bardini qui avaient un jour décidé de changer l'aiguillage de leur vie.
Edmée fait la belle. Giraudoux la sauve du lit conjugal, des soirs maussades et des « aubes vénéneuses ». IL la sauve de ce mari polytechnicien dont il lui faut enjamber le corps chaque matin au réveil. Il la sauve des grands hommes vénérés par son époux. II l’envoie à Hollywood. Il lui fait aimer des cancres et des bossus, des stars et des "êtres de moindre densité". C’est Clark Gable contre Lavoisier. Les Ziegfeld Follies contre Polytechnique. Les héroïnes de Giraudoux sont de l’étoffe dont on fait les rêves. Elles s’évanouissent. Elles déclenchent une crise. Giraudoux leur accorde, l'espace de quelques centaines de pages, une dispense de pesanteur, une « récréation hors du temps, une détente sans état civil ». L’auteur se fait illusionniste, fabuliste, complice de ces transfuges.
"Choix des élues", dans son élaboration, dans son projet, dans sa forme même, est une fugue. Les premiers chapitres parurent dans la Nouvelle Revue française, alors que Giraudoux n’avait pas terminé d’écrire le livre, commencé lors d’une escapade autour du monde, entre New York et Colombo. Avec ses rebondissements, ses paresses descriptives, ses chassés-croisés de lettres et de personnages, "Choix des élues" échappe à tout genre, à toute définition, et ressemble à une de ces nouvelles manquées dont Giraudoux disait qu’elles étaient plus excitantes a écrire que des romans réussis.
Giraudoux soustrait ses héroïnes aux hommes, au monde, au roman. Pour les rendre à leur virginité première.
L’humain est quelque chose qu’il faut surmonter, Giraudoux le sait, mais il ne croit pas au salut par les grands hommes. Ses romans affichent leur mépris des génies. Ce qui lui valut d’être taxé de gaminerie par Sartre. Le monde de Giraudoux ne fait alliance ni avec l’intelligence ni avec la bêtise, ni avec le tragique ni avec le mesquin. Un monde d’échantillonnages et d’archétypes, « propret, fini, hiérarchisé, rationnel jusqu’à l'os », disait Sartre...."
De et par Linda Lê, qui reprendra ses textes et préfaces écrites pour la collection Le Livre de Poche et les rassemblera sous le titre "Tu écriras sur le bonheur" (Christian Bourgois, 1999).
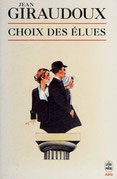
"Choix des élues" (1939)
Dans le dernier roman de Giraudoux. Pierre et Edmée forment un couple parfait : voilà tout
leur malheur. La félicité familiale éloigne Edmée et Claudie, sa fille, de leur époux et père. « J 'ai près de moi, avoue Edmée, un petit dieu de l'indifférence, du dédain, de l`oubli. De là, ma pente vers la pitié et les attachements. D'autant plus qu'il m'aime, qu'il m'admire, qu'il pense à moi sans arrêt". Ces âmes étranges, possédées du besoin de s`analyser, unissent ainsi l'indifférence à la sensibilité, la fidélité à la froideur, l'absence d'angoisse métaphysique au perpétuel besoin d'évasion, la pureté à une sensualité sans objet ni but (une sensualité qu'on pourrait dire transparente), le manque de foi religieuse au souci des dieux; et surtout la peur du bonheur quotidien. Ces méandres psychologiques entraînent l'auteur à d'incessants monologues au mépris de toute action romanesque, de toute intrigue suivie.
Jamais le génie verbal de Giraudoux n'a été, malgré ses plus, ses trop ingénieuses trouvailles, aussi intempérant et, faut-il le dire, aussi irritant. Il n'est pas jusqu`aux objets qui ne se mettent à l'unisson : « Elle [Edmée] alla chercher un cornichon, bien qu'on ne choisisse pas les cornichons ; elle lui obéit, elle prit celui qui par son architecture, sa sculpture, ses reliefs, revendiquait le titre de cornichon du chef de famille." Ces jeux spirituels et lassants montrent que "tout dans le monde de Giraudoux est d'emblée au superlatif, comme il sied dans un univers où il n'y a ni causalité efficiente ni devenir temporel, où le seul changement imaginable est la réalisation, chaque jour un peu plus parfaite pour chaque chose, de son essence" (C.-E. Magny). Toute l'œuvre romanesque de Giraudoux semble être en définitive comme une allégorie, dédiée au plaisir du langage...
"... Elle aimait le tête-à-tête avec les hommes. II suffisait qu’elle fût enfermée avec l’un d’eux pour qu’elle fût dans une île avec l’un d’eux. Elle était naturellement portée à l’intimité avec tout compagnon, méme fugitif. Elle ne se cachait pas qu’elle était une proie pour le tutoiement, la danse, les promenades où les bras sont dessus dessous, les voyages de nuit. II avait fallu la dignité de son mari pour redonner de la gravité au danger et une équivoque au compagnonnage masculin.
L’admiration que Pierre avait pour elle ne lui avait pas appris à s’admirer elle-même, à donner plus de prix a son intimité, mais l’obligeait avec la plupart des hommes à ces rapports compassés qui étaient sa vie avec Pierre. Par contre, l'éducation qu’avait voulu lui donner son mari sur les hommes n’avait pas atteint son but. Edmée n'arrivait pas, malgré les leçons, à distinguer aussi nettement que lui les hommes lâches, paresseux, travailleurs, et même - c’est à cette distinction qu’aurait peut-être le plus tenu Pierre, qui était grand et beau, courageux, intelligent, - les concours de Polytechnique ne sont pas des preuves infaillibles, mais si vous êtes classés premier à l'entrée et premier à la sortie, on ne saurait quand même parler de coïncidence, — mais parce qu’il l’avait le premier demandée en mariage ! C’était là le premier des hommes pour cette jeune fille extraordinaire: le premier qui l’inviterait à monter dans son lit.
Si lui, Pierre, était arrivé un mois plus tard, cela aurait pu être le lit d’un bègue ou d’un bossu !... Ce qui rendait cette perversion plus étonnante encore, c’est qu’Edmée était fine, instruite. Elle lisait Nietzsche dans le texte allemand, elle le lisait sans prétention, alternant avec les Mémoires de Mme de Boigne; elle avait écrit un diplôme sur la répétition dans Gide; elle aurait pu êre virtuose et jouait à quatre mains, avec lui, — les quatre mains du couple soudain déliées et séparées par Liszt ou Brahms, — les concertos les plus durs. Elle chantait, mais jamais au hasard, les jours seulement où |’acoustique du monde, de la famille, exigeait un chant humain, les jours où la femelle chantait, dans la cage des serins.
Elle était subtile, spirituelle ; elle jugeait les événements et les êtres avec une sûreté et une liberté telles que ses paroles semblaient dites au hasard, mais portaient chaque fois, comme celle des huissiers et des dieux.
Pourquoi fallait-il qu’elle réservât son ignorance, son incapacité pour le seul chapitre qui importât à Pierre, le chapitre des hommes ? Pierre, qui, par les leçons d’une vie ardue, de responsabilités magnifiques, par l’effet aussi d’une délicatesse et d’une noblesse innées, les voyait tels qu’ils sont, dans leur "tchin" physique et moral, les voyait comme si chacun avait son prix écrit à la craie sur le dos, les voyait à leur rang d’entrée à Centrale ou à Polytechnique, au Panthéon, au ciel, à l'enfer, était arrivé à ne supporter, à n’admettre pour égaux que ceux qui lui semblaient touchés et mus par l’honneur... Il était même large dans ses discriminations, il admettait l’honneur des voleurs, des déshonorés...
Mais il était sûr, quand par hasard on rencontrait sur la plage de vagues connaissances ou que l’on dînait en ville, qu’il trouverait tôt ou tard sa femme en débat amical avec l’invité sans honneur. Tout ce qui d’elle devait être réservé à l’honneur, le sourire, l’abandon, le bavardage, sa vue seule, elle le prodiguait à cette indignité, à cette infection. Si bien que le soir, une fois couchés, alors que lui devenait dans l’amour un être conscient au maximum de la noblesse de sa vie sur cette terre, conscient de ce qu’étaient sa famille, sa patrie, son foyer, et que tous ses trésors et ses ressources personnelles s’assemblaient autour de lui pour ce mariage, et que le plaisir lui donnait, dans tous les sens, sa plus haute et précise ressemblance avec lui-même, il sentait au contraire Edmée libérée par l’amour de tout ce qui était son rang, sa condition, sa mission, de tout ce qui était en dehors de l’amour, et en premier lieu de lui, Pierre.
C’est de l’union entre ce parangon des vertus humaines et cette femme sans nom, sans visage, de ce mari au plus haut point et de cette épouse déclassée, que les deux enfants étaient nés. Ce sommeil immédiat qui aussitôt prenait Edmée, impossible a éviter et à rompre, alors que lui, au contraire, se sentait plein d’éveil, d’humour, d’inspiration, alors qu’il eût été le plus spirituel des polytechniciens après l’amour, alors qu’il eût bavardé sans fin de l’avenir du fils, des mérites de la patrie, de la nécessité de changer de papier peint, et qu’une béatitude infinie le balançait des histoires d’Olive à Plutarque, lui donnait parfois la crainte qu’Edmée le lendemain aurait tout oublié de leur vie commune, de la vie ..."
