- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes

Roland Barthes (1915-1980), "Le degré zéro de l'écriture" (1953), "Mythologies" (1957), "S/Z" (1970), "L'Empire des signes" (1970), "Fragments d'un discours amoureux" (1977), "L'Aventure sémiologique" (1985) - ....
Last update : 11/11/2016
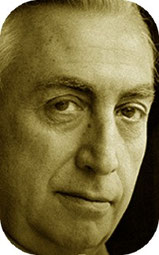
Mythologies, bruissement du langage et frisson du sens, "j'aime le romanesque mais je sais que le roman est mort" - Pour Roland Barthes, que retenir en fin de compte en ces années 1970, que les signes et les symboles imposent à tout lecteur une idéologie sous-jacente par leur simplicité "allant de soi" ...
Au-delà du jargon que nous infligent ses commentateurs, Roland Barthes nous a offert, le sait-on, une boîte à outils critique d'une rare efficacité. Il nous a appris à être méfiants envers les évidences, à questionner les signes qui nous entourent et à revendiquer notre liberté face aux textes et aux images. Son œuvre est plus que jamais d'actualité car nous vivons dans une société saturée de signes, de récits et de mythologies (marketing, réseaux sociaux, médias). Barthes nous équipe pour ne pas en être les consommateurs passifs, mais des lecteurs actifs, critiques et conscients des mécanismes à l'œuvre. Il est un guide essentiel pour naviguer dans la complexité du monde moderne...
Son travail peut se résumer, très simplement, en plusieurs grands apports fondamentaux :
1. Le Décryptage des Mythes Modernes (Mythologies, 1957) ...
C'est peut-être son œuvre la plus célèbre et accessible. Barthes y applique les outils de la sémiologie à la culture populaire de son époque (le catch, les magazines, le vin, la DS de Citroën, le strip-tease).
Le concept clé : Il montre que ces objets culturels apparemment innocents sont en réalité des "mythes", c'est-à-dire des systèmes de signes qui naturalisent une idéologie et la font passer pour une évidence. Le mythe dépolitise et essentialise.
Exemple : Le vin dans la culture française est présenté comme un symbole naturel de convivialité et de force, masquant ainsi les problèmes sociaux liés à l'alcoolisme et les réalités économiques de la production viticole.
2. La Mort de l'Auteur (1967) ...
Cet essai a provoqué une révolution dans la façon d'envisager la critique littéraire.
Le concept clé : Barthes affirme que pour libérer le texte et la lecture, il faut "tuer" l'intention de l'auteur. Le sens d'une œuvre ne réside pas dans ce que son auteur a voulu y mettre, mais dans l'interaction entre le texte et le lecteur.
Conséquence : L'autorité de l'auteur disparaît. C'est le lecteur, avec son propre bagage culturel et subjectif, qui donne son (ou ses) sens au texte. "La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'Auteur."
3. La distinction entre le "Lisible" et le "Scriptible" (*S/Z*, 1970) ...
Le texte "lisible" (ou "lisible") : Un texte classique, réaliste, qui se lit passivement. Le lecteur est un simple consommateur. (Ex. : la plupart des romans du XIXe siècle).
Le texte "scriptible" (ou "scriptable") : Un texte moderne, ouvert, fragmenté, qui exige que le lecteur devienne lui-même producteur de sens, qu'il "écrive" le texte en le lisant. (Ex. : Finnegans Wake de James Joyce).
Cette idée valorise une lecture active et créative.
4. L'analyse des codes narratifs ...
Dans *S/Z*, il dissèque une nouvelle de Balzac (Sarrasine) en identifiant cinq codes de lecture qui structurent tout récit (code herméneutique, code sémique, code symbolique, code proaïrétique, code culturel). Cette grille d'analyse est encore utilisée pour décortiquer n'importe quel type de récit, des romans aux séries TV...
5. La notion de "Plaisir du texte" (1973) ...
Barthes explore la dimension sensuelle, érotique et subjective de la lecture. Il distingue le plaisir (confortable, lié à la culture) et la jouissance (plus disruptive, qui déstabilise le lecteur). Cette approche a réintroduit le corps et la subjectivité dans la théorie littéraire.
Son Œuvre est toujours d'actualité. Les outils conceptuels de Barthes sont incroyablement pertinents pour analyser le monde contemporain,
1. Pour décrypter la culture de masse et la publicité ...
La méthode des "Mythologies" est parfaitement adaptée à notre ère numérique :
Les influenceurs et les marques créent en permanence des "mythes modernes" : le produit "naturel", le voyage "authentique", le style de vie "minimaliste" ou "réussi". Barthes nous apprend à voir l'idéologie (consumériste, individualiste) derrière ces images.
Un iPhone n'est pas présenté comme un simple outil technologique, mais comme un symbole de créativité, d'innovation et d'appartenance à une communauté. Sa valeur symbolique dépasse largement sa fonction utilitaire.
2. Pour comprendre les médias sociaux et la politique ...
La "dépolitisation" des mythes est cruciale pour analyser le discours politique et médiatique. Un slogan, une image de campagne, un fait divers médiatisé sont des "mythes" qu'il s'agit de décoder. Les mèmes Internet sont des systèmes de signes complexes qui fonctionnent exactement comme des mythes : ils véhiculent des idées, des stéréotypes et une vision du monde de manière apparemment humoristique et "naturelle".
3. La "Mort de l'Auteur" à l'ère des polémiques et de l'autofiction ...
Ce débat est extrêmement actuel. Faut-il juger une œuvre à l'aune de la biographie ou des opinions de son auteur ? Barthes répondrait que non, que le sens est du côté du public.
Le phénomène de l'autofiction et la tendance à tout interpréter à travers le prisme de l'auteur montre à quel point sa mise en garde était prophétique. Il nous invite à nous recentrer sur le texte et notre expérience de lecture.
4. Pour analyser les séries TV, les jeux vidéo, les univers narratifs ...
Sa théorie des codes narratifs est un outil remarquable pour comprendre la construction des récits contemporains, bien plus complexes et fragmentés que ceux de l'époque de Balzac.

Roland Barthes, fasciné par le langage, renouvelle dès les années 1950 et sur toute la décennie suivante, l'approche des textes littéraires et des images, de ce qui se donne à travers le discours, qu'il soit "romanesque", le théâtre de Racine, le Nouveau Roman, ou mythique, politique, journalistique.
Proche des structuralistes et de la revue "Tel Quel", il voit dans la pratique littéraire le symptôme des divisions idéologiques d'une société en plein bouleversement et part en quête des mécanismes qui les fondent et les entretiennent symboliquement. Julia Kristeva ("Comment parler à la littérature", revue Tel Quel, n°47, 1971) résume ce qui semble être l'approche fondamentale de Roland Barthes dans la droite ligne de son "Degré zéro de l'écriture" (1953),
- "la matérialité de l'écriture (pratique objective dans le langage) exige sa confrontation avec les sciences du langage (linguistique, logique, sémiotique), mais aussi une différenciation par rapport à elle;
- son immersion dans l'histoire entraîne la prise en considération des conditions sociales et historiques;
- sa surdétermination sexuelle l'oriente vers la psychanalyse et en général vers l'ensemble d'un "ordre" corporel, physique, substantiel".
Une méthode qui, appliquée au théâtre de Racine (Sur Racine, 1963), suscitera polémique dans une Université traditionnelle qui le condamnera dans les années 1965 (Raymond Picard, "Nouvelle Critique ou Nouvelle imposture" - "Critique et vérité", réponse de R. Barthes, 1966). Barthes, ici ne fait alors qu'appliquer une méthode structuraliste à la dramaturgie racinienne, recherche un "jeu de figures purement relationnelles" et dévoile ainsi des structures plus psychiques que sociologiques, des structures psychiques qu'il n'entend pas rattacher à l'inconscient de Jean Racine, mais à ces fibres archétypales qui commandent les émotions humaines, à cette signification mythique qui, à travers un texte, surdétermine socialement et historiquement les structures de l'esprit humain. Le mythe, "parole choisie par l'histoire", "ne saurait surgir de la nature des choses..."

Parler, écouter, écrire, dans une société déchirée idéologiquement - Les "mythes" sont des moyens d'enseigner les réalités inobservables via des symboles observables. La nature contradictoire de la vie sociale peut être ainsi transmise par des porteurs de la tradition, pour que soient comprises les frustrations de l'idéal qu'impose le réel. Puisque les mythes sont transmis oralement, il y aura des lacunes et des distorsions, mais une quasi "partition musicale" qui se répète et véhicule ainsi la structure primitive en dépit des parties manquantes. Il en est de même dans l'image, et dans toutes formes d'expression.
C'est bien la société dans laquelle nous vivons, nous parlons et nous écoutons, et parfois nous écrivons. Roland Barthes, qui a endossé la grande aventure sémiologique, entend désormais interroger le "frisson du sens", "en écoutant le bruissement du langage", de ce langage qui est ma Nature à moi. Mais ne vivons-nous pas, désormais et plus que jamais, dans "une guerre inexpiable des langages", nos langages s'excluent les uns les autres; dans une société divisée par la classe sociale, l'argent, l'origine scolaire, l'indifférence et l'égocentrisme?
Dans cette soit-disante "culture de masse", qui ne recouvre plus grand chose, plus que jamais la division des langages culturels est portée à son comble, une séparation dramatique, qu'entretient, sous couvert d'une "paix culturelle", un nouvel acteur, l'Etat, que l'indifférence démocratique livre à quelques technocrates de la gestion publique, et sous l'égide duquel s'organise ce nouvel espace médiatique du XXIe siècle dans lequel coïncident la "parole" et l' "écoute". Nous y puisons tant nos structures de connaissance que nos sujets de vie, une soumission totale aux stéréotypes, seule à même de résoudre ce 'frisson du sens" que portent les contradictions tant de l'existence que de la société ...

Roland Barthes (1915-1980)
Barthes, après avoir été proche du marxisme théorique, s'est situé dans les années 60 dans le courant structuraliste en réfléchissant sur la notion de texte et en rapportant la critique littéraire à une analyse du discours. Que ce soit avec "Mythologies" – suite d’analyses sarcastiques de quelques représentations de l’idéologie petite-bourgeoise (faits divers, photos, articles de presse...) – ou avec "Le Degré zéro de l’écriture", «histoire du langage littéraire qui ne [serait] ni l’histoire de la langue, ni celle des styles, mais seulement l’histoire des Signes de la Littérature», l’œuvre de Barthes se propose d’emblée comme une critique de la signification. Il retracera dans "L'Aventure sémiologique" sa montée depuis 1956 jusqu'au moment où fut acquise une certaine scientificité, de 1957 à 1963 ...
En 1967, Roland Barthes rédigera un article, "La mort de l'auteur", qui pose les bases d'une nouvelle théorie de la critique littéraire et du courant dit "postmoderniste" : l'interprétation d'un texte n'a pas besoin, pour être valable, de prendre en compte les intentions de son auteur ni le contexte dans lequel celui-ci a pu l'écrire. L'art n'est plus reconnu comme un moyen de communication entre le créateur et son public, seul compte le sens ou le message que l'artiste désire communiquer à travers son oeuvre : "la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur."

1953 – Le Degré zéro de l’écriture
"Le Degré zéro de l’écriture" est le premier livre de Roland Barthes. Son ambition est de réécrire l’histoire de la littérature comme une histoire des « formes de l’écriture ». Le premier chapitre de l’ouvrage, « Qu’est-ce que l’écriture ? », s’attache à éclairer cette notion centrale, qui peut être appréhendée sous deux angles, la langue, collective et codifiée, et le style, individuel et quasi physiologique. Barthes voit dans l’écriture un moyen pour dépasser l’opposition du style et de la langue. : « Ce qu’on veut ici […] c’est affirmer l’existence d’une réalité formelle indépendante de la langue et du style ; c’est essayer de montrer que cette troisième dimension de la Forme attache elle aussi, non sans un tragique supplémentaire, l’écrivain à sa société ». L’étude de l’écriture est donc la finalité de cet essai, elle seule permet de lier la littérature à l’Histoire : « c’est là où l’Histoire est refusée qu’elle agit le plus ... on verra par exemple, écrit Barthes, que l’unité idéologique de la bourgeoisie a produit une écriture unique, et qu’aux temps bourgeois (c’est-à-dire classiques et romantiques), la forme ne pouvait qu’être déchirée puisque la conscience ne l’était pas ; et qu’au contraire, dès l’instant où l’écrivain a cessé d’être un témoin de l’universel pour devenir une conscience malheureuse (vers 1850), son premier geste a été de choisir l’engagement de sa forme soit en assumant, soit en refusant l’écriture de son passé ».
Du rapport, complexe et subtil, Ie plus souvent inconscient, de l'écrivain au langage, mais aussi du sens de l'écriture au XXe siècle. L'art d 'écrire n 'est plus tout à fait innocent au temps des critiques psychanalytiques et marxistes. L'écrivain sert une langue qui lui est extérieure et le style prend sa source dans Ies profondeurs biologiques de son corps propre ...
"On sait que la langue est un corps de prescriptions et d`habitudes, commun à tous les écrivains d'une époque. Cela veut dire que la langue est comme une Nature qui passe entièrement à travers la parole de l'écrivain. sans pourtant lui donner aucune forme, sans même la nourrir : elle est comme un cercle abstrait de vérités hors duquel seulement commence à se déposer la densité d'un verbe solitaire. Elle enferme toute la création littéraire à peu près comme le ciel, le sol et leur jonction dessinent pour l`homme un habitat familier. Elle est bien moins une provision de matériaux qu`un horizon. c`est-à-dire à la fois une limite et une station, en un mot l'étendue rassurante d`une économie. L`écrivain n`y puise rien, à la lettre : la langue est plutôt pour lui comme une ligne dont la transgression désignera peut-être une surnature du langage : elle est l'aire d`une action, la définition et l`attente d`un possible. Elle n`est pas le lieu d`un engagement social. mais seulement un réflexe sans choix, la propriété indivise des hommes et non pas des écrivains : elle reste en dehors du rituel des Lettres ; c`est un objet social par définition, non par élection. Nul ne peut sans apprêts, insérer sa liberté d`écrivain dans l`opacité de la langue, parce qu'à travers elle c'est l`Histoire entière qui se tient, complète et unie à la manière d'une Nature. Aussi, pour l`écrivain, la langue n`est-elle qu'un horizon humain qui installa au loin une certaine familiarité, toute négative d`ailleurs : dire que Camus et Queneau parlent la même langue. ce n`est que présumer, par une opération différentielle, toutes les langues. archaïques ou futuristes, qu'ils ne parlent pas : suspendue entre des formes abolies et des formes inconnues, la langue de l`écrivain est bien moins un fonds qu`une limite extrême ; elle est le lieu géométrique de tout ce qu`il ne pourrait pas dire sans perdre, tel Orphée se retournant, la stable signification de sa démarche et le geste essentiel de sa sociabilité. La langue est donc en deçà de la Littérature. Le style est presque au-delà : des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l'écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. Ainsi sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur, dans cette hypophysique de la parole où se forme le premier couple des mots et des choses, où s`installent une fois pour toutes les grands thèmes verbaux de son existence. Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de brut : il est une forme sans destination, il est le produit d`une poussée, non d`une intention, il est comme une dimension verticale et solitaire de la pensée. Ses références sont au niveau d`une biologie ou d'un passé, non d`une Histoire : il est la "chose" de l`écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa solitude. Indifférent et transparent à la société, démarche close de la personne, il n'est nullement le produit d`un choix, d`une réflexion sur la Littérature. Il est la part privée du rituel, il s`élève à partir des profondeurs mythiques de l`écrivain, et s'éploie hors de sa responsabilité. Il est la voix décorative d`une chair inconnue et secrète : il fonctionne à la façon d`une Nécessité, comme si, dans cette espèce de poussée florale, le style n`était que le terme d`une métamorphose aveugle et obstinée, partie d`un infra-langage qui s`élabore à la limite de la chair et du monde. Le style est proprement un phénomène d'ordre germinatif, il est la transmutation d`une Humeur. Aussi les allusions du style sont-elles réparties en profondeur ; la parole a une structure horizontale, ses secrets sont sur la même ligne que ses mots et ce qu`elle cache est dénoué par la durée même de son continu : dans la parole tout est offert, destiné à une usure immédiate, et le verbe, le silence et leur mouvement sont précipités vers un sens aboli : c`est un transfert sans sillage et sans retard. Le style, au contraire, n`a qu`une dimension verticale, il plonge dans le souvenir clos de la personne, il compose son opacité à partir d`une certaine expérience de la matière ; le style n'est jamais que métaphore, c`est-à-dire équation entre l'intention littéraire et la structure charnelle de l'auteur (il faut se souvenir que la structure est le dépôt d'une durée). Aussi le style est-il toujours un secret. [...] Le type même de l`écrivain sans style, c`est Gide, dont la manière artisanale exploite le plaisir moderne d'un certain éthos classique. tout comme Saint-Saëns a refait du Bach ou Poulenc du Schubert. A l`opposé. la poésie moderne - celle d'un Hugo, d'un Rimbaud ou d'un Char - est saturée de style et n`est art que par référence à une intention de Poésie. C`est l`Autorité du style, c'est-à-dire le lien absolument libre du langage et de son double de chair, qui impose l'écrivain comme une Fraîcheur au-dessus de l'Histoire.... (Le Degré zéro de l'écriture, Seuil).
"Degré zéro de l'écriture"?
L'expression qui donne son titre à l'ouvrage se réfère à une théorie linguistique selon laquelle une opposition signifiante peut être "neutralisée" par un troisième terme appelé "degré zéro". Barthes utilise métaphoriquement cette théorie : il y voit la possibilité de déjouer les assignations fixées par un code. ll donnera à cet usage d'un terme "neutre" tout au cours de son œuvre, des développements considérables. Dans ce premier ouvrage, la métaphore linguistique éclaire une pratique romanesque dont l'exemple privilégié est "L'Etranger" de Camus : "La nouvelle écriture neutre se place au milieu de ces cris et de ces jugements, sans participer à aucun d`eux; elle est faite précisément de leur absence". Si Barthes prend position dans la situation idéologique et esthétique de son temps, il affiche aussi une ambition plus large.
Son ouvrage vise à réécrire l'histoire de la littérature comme une histoire des "formes de l'écriture". Il commence par poser deux réalités stables,
- la "langue", collective et archaïque,
- et le " style", individuel et quasi physiologique.
L'écrivain ne fait le choix que des marques supplémentaires qu'il leur ajoute, et qui témoignent de son insertion dans I'Histoire et dans la société.
La première partie de l'essai est consacrée à l'analyse de divers modes d'écriture. Le mode politique donne lieu à des pages brillantes, souvent polémiques, sur l'écriture révolutionnaire, l`écriture bourgeoise, marxiste ou intellectuelle. Ce sont autant de "mythologies" de la forme écrite, où est dénoncée la fausseté des rapports entre le langage et le monde, dès qu`une médiation s'y agrège de manière parasite. "L'écriture du roman" est décrite comme la fabrication d'une fausse évidence qui masque l'absence de réalité sous une fabulation crédible. Barthes s'attache à deux conventions du roman : le passé simple et la troisième personne. La poésie, quant à elle, et particulièrement la poésie moderne, échapperait au jeu de masques de l' "écriture". Elle ne serait que langue et style, à travers lesquels "l'homme affronte le monde objectif sans passer par aucune des figures de l'Histoire ou de la sociabilité" ...
"ÉCRITURES POLITIQUES
Toutes les écritures présentent un caractère de clôture qui est étranger au langage parlé.
L'écriture n'est nullement un instrument de communication, elle n'est pas une voie ouverte par où passerait seulement une intention de langage. C'est tout un désordre qui s'écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement dévoré qui le maintient en état d'éternel sursis. A l'inverse, l'écriture est un langage durci qui vit sur lui-même et n'a nullement la charge de confier à sa propre durée une suite mobile d'approximations, mais au contraire d'imposer, par l'unité et l'ombre de ses signes, l'image d'une parole construite bien avant d'être inventée. Ce qui oppose l'écriture à la parole, c'est que la première paraît toujours symbolique, introversée, tournée ostensiblement du côté d'un versant secret du langage, tandis que la seconde n'est qu'une durée de signes vides dont le mouvement seul est significatif. Toute la parole se tient dans cette usure des mots, dans cette écume toujours emportée plus loin, et il n'y a de parole que là où le langage fonctionne avec évidence comme une voration qui n'enlèverait que la pointe mobile des mots; l'écriture, au contraire, est toujours enracinée dans un au-delà du langage, elle se développe comme un germe et non comme une ligne, elle manifeste une essence et menace d'un secret, elle est une contre-communication, elle intimide.
On trouvera donc dans toute écriture l'ambiguïté d'un objet qui est à la fois langage et coercition : il y a au fond de l'écriture, une « circonstance » étrangère au langage, il y a comme le regard d'une intention qui n'est déjà plus celle du langage. Ce regard peut très bien être une passion du langage, comme dans l'écriture littéraire ; il peut être aussi la menace d'une pénalité, comme dans les écritures politiques : l'écriture est alors chargée de joindre d'un seul trait la réalité des actes et l'idéalité des fins. C'est pourquoi le pouvoir ou l'ombre du pouvoir finit toujours par instituer une écriture axiologique, où le trajet qui sépare ordinairement le fait de la valeur, est supprimé dans l'espace même du mot, donné à la fois comme description et comme jugement. Le mot devient un alibi (c'est-à-dire un ailleurs et une justification). Ceci, qui est vrai des écritures littéraires, où l'unité des signes est sans cesse fascinée par des zones d'infra- ou d'ultra-langage, l'est encore plus des écritures politiques, où l'alibi du langage est en même temps intimidation et glorification : effectivement, c'est le pouvoir ou le combat qui produisent les types d'écriture les plus purs.
On verra plus loin que l'écriture classique manifestait cérémonialement l'implantation de l'écrivain dans une société politique particulière et que parler comme Vaugelas, ce fut, d'abord, se rattacher à l'exercice du pouvoir. Si la Révolution n'a pas modifié les normes de cette écriture, parce que le personnel pensant restait somme toute le même et passait seulement du pouvoir intellectuel au pouvoir politique, les conditions exceptionnelles de la lutte ont pourtant produit au sein même de la grande Forme classique, une écriture proprement révolutionnaire, non par sa structure, plus académique que jamais, mais par sa clôture et son double, l'exercice du langage étant alors lié, comme jamais encore dans l'Histoire, au Sang répandu. Les Révolutionnaires n'avaient aucune raison de vouloir modifier l'écriture classique, ils ne pensaient nullement mettre en cause la nature de l'homme, encore moins son langage, et un « instrument » hérité de Voltaire, de Rousseau ou de Vauvenargues, ne pouvait leur paraître compromis. C'est la singularité des situations historiques qui a formé l'identité de l'écriture révolutionnaire. Baudelaire a parlé quelque part de « la vérité emphatique du geste dans les grandes circonstances de la vie ». La Révolution fut par excellence l'une de ces grandes circonstances où la vérité, par le sang qu'elle coûte, devient si lourde, qu'elle requiert, pour s'exprimer, les formes mêmes de l'amplification théâtrale. L'écriture révolutionnaire fut ce geste emphatique qui pouvait seul continuer l'échafaud quotidien.
Ce qui paraît aujourd'hui de l'enflure, n'était alors que la taille de la réalité. Cette écriture qui a tous les signes de l'inflation, fut une écriture exacte : jamais langage ne fut plus invraisemblable et moins imposteur. Cette emphase n'était pas seulement la forme moulée sur le drame ; elle en était aussi la conscience. Sans ce drapé extravagant, propre à. tous les grands révolutionnaires, qui permettait au Girondin Guadet, arrêté à Saint-Émilion, de déclarer sans ridicule parce qu'il allait mourir: « Oui, je suis Guadet. Bourreau, fais ton office. Va porter ma tête aux tyrans de la patrie. Elle les a toujours fait pâlir : abattue, elle les fera pâlir encore davantage », la Révolution n'aurait pu être cet événement mythique qui a fécondé 1'Histoire et toute idée future de la Révolution. L'écriture révolutionnaire fut comme l'entéléchie de la légende révolutionnaire : elle intimidait et imposait une consécration civique du Sang.
L'écriture marxiste est tout autre. Ici la clôture de la forme ne provient pas d'une amplification rhétorique ni d'une emphase du débit, mais d'un lexique aussi particulier, aussi fonctionnel qu'un vocabulaire technique; les métaphores elles-mêmes y sont sévèrement codifiées. L'écriture révolutionnaire française fondait toujours un droit sanglant ou une justification morale ; à l'origine, l'écriture marxiste est donnée comme un langage de la connaissance; ici l'écriture est univoque, parce qu'elle est destinée à maintenir la cohésion d'une Nature; c'est l'identité lexicale de cette écriture qui lui permet d'imposer une stabilité des explications et une permanence de méthode; ce n'est que tout au bout de son langage que le marxisme rejoint des comportements purement politiques. Autant l'écriture révolutionnaire française est emphatique, autant l'écriture marxiste est litotique, puisque chaque mot n'est plus qu'une référence exiguë à l'ensemble des principes qui le soutient d'une façon inavouée. Par exemple, le mot « impliquer », fréquent dans l'écriture marxiste, n'y a pas le sens neutre du dictionnaire; il fait toujours allusion à un procès historique précis, il est comme un signe algèbrique qui représenterait toute une parenthèse de postulats antérieurs.
Liée à une action, l'écriture marxiste est rapidement devenue, en fait, un langage de la valeur. Ce caractère, visible déjà. chez Marx, dont l'écriture reste pourtant en général explicative, a envahi complètement l'écriture stalinienne triomphante...."
La seconde partie de l'ouvrage développe l'histoire de l`écriture. Barthes montre la naissance d'une mauvaise conscience de l'écrivain, voire d'un tragique de la littérature dans la France du XIXe siècle. Flaubert en serait l'exemple privilégié. Après lui, la littérature n'aurait pu choisir qu'entre l'exhibition de son propre masque ("Je suis littérature", proclame le roman naturaliste, tout en prétendant dire le réel) et le sabordage, le silence d`un Rimbaud ou d'un Mallarmé. Dans cette situation. le "degré zéro" apparait comme une innocence reconquise. Barthes entrevoit chez certains écrivains de son temps l`utopie d`une réconciliation entre la littérature et le monde, au-delà d'une société qui demeure irréconciliée...

1957 –Mythologies
"Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques : je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique…" - Au travers de la DS, du bifteck-frites, du strip-tease ou du plastique, les Mythologies ne sont pas seulement un formidable portrait d’une France entrant, avec les années 50, dans la culture de masse moderne, elles sont aussi l’invention d’une nouvelle critique de l’idéologie : d’une part celle-ci ne loge pas dans les grandes abstractions mais dans les objets les plus quotidiens, d’autre part elle n’appartient pas au monde des idées, elle est d’abord langage, ou plus précisément un certain système de langage que seule une sémiologie ? une science des signes ? est en mesure de décrypter...
"J`ai indiqué qu'aujourd`hui la publicité des détergents flattait essentiellement une idée de la profondeur : la saleté n`est plus arrachée de la surface, elle est expulsée de ses loges les plus secrètes. Toute la publicité des produits de beauté est fondée, elle aussi, sur une sorte de représentation épique de l`intime. Les petits avant-propos scientifiques, destinés à introduire publicitairement le produit, lui prescrivent de nettoyer en profondeur, bref, coûte que coûte, de s'infiltrer.
Paradoxalement, c`est dans la mesure où la peau est d`abord surface, mais surface vivante, donc mortelle, propre à sécher et à vieillir, qu`elle s'impose sans peine comme tributaire de racines profondes, de ce que certains produits appellent Ia couche basique de renouvellement. La médecine permet d'ailleurs de donner à la beauté un espace profond (le derme et l'épiderme) et de persuader les femmes qu`elles sont le produit d'une sorte de circuit germinatif où la beauté des efflorescences dépend de la nutrition des racines. L`idée de profondeur est donc générale, pas une réclame où elle ne soit présente. Sur les substances à infiltrer et à convertir au sein de cette profondeur, vague total : on indique seulement qu'il s`agit de principes (vivifiants, stimulants, nutritifs) ou de sucs (vitaux, revitalisants, régénérants), tout un vocabulaire moliéresque, à peine compliqué d'une pointe de scientisme (l'agent bactéricide R 51). Non, le vrai drame de toute cette petite psychanalyse publicitaire, c`est le conflit de deux substances ennemies qui se disputent subtilement l'acheminement des "sucs" et des "principes" vers le champ de la profondeur. Ces deux substances sont l`eau et la graisse. Toutes deux sont moralement ambiguës : l'eau est bénéfique, car tout le monde voit bien que la peau vieille est sèche et que les peaux jeunes sont fraîches, pures (d 'une fraîche moiteur, dit tel produit) : le ferme, le lisse, toutes les valeurs positives de la substance charnelle sont spontanément senties comme tendues par l'eau, gonflées comme un linge, établies dans cet état idéal de pureté, de propreté et de fraîcheur dont l'eau est la clef générale. Publicitairement, l'hydratation des profondeurs est donc une opération nécessaire. Et pourtant l`infiltration d`un corps opaque apparaît peu facile à l`eau : on imagine qu`elle est trop volatile, trop légère, trop impatiente pour atteindre raisonnablement ces zones cryptuaires où s`élabore la beauté.
Et puis, l`eau, dans la physique charnelle et à l`état libre, l`eau décape, irrite, elle retourne à l'air, fait partie du feu ; elle n`est bénéfique qu`emprisonnée, maintenue. La substance grasse a les qualités et les défauts inverses : elle ne rafraîchit pas sa douceur est excessive, trop durable, artificielle : on ne peut fonder une publicité de la beauté sur la pure idée de crème, dont la compacité même est sentie comme un état peu naturel. Sans doute la graisse (appelée plus poétiquement huiles, au pluriel comme dans la Bible ou l`Orient) dégage-t-elle une idée de nutrition, mais il est plus sûr de l`exalter comme élément véhiculaire, lubrifiant heureux, conducteur d`eau au sein des profondeurs de la peau. L'eau est donnée comme volatile. aérienne, fuyante, éphémère, précieuse; l'huile au contraire tient, pèse, force lentement les surfaces, imprègne, glisse sans retour le long des "pores" (personnages essentiels de la beauté publicitaire).
Toute la publicité des produits de beauté prépare donc une conjonction miraculeuse des liquides ennemis. déclarés désormais complémentaires ; respectant avec diplomatie toutes les valeurs positives de la mythologie des substances, elle parvient à imposer la conviction heureuse que les graisses sont véhicules d`eau, et qu`il existe des crèmes aqueuses, des douceurs sans luisance. La plupart des nouvelles crèmes sont donc nommément Iiquides, fluides, ultra-pénétrantes. etc. ; l`idée de graisse, pendant si longtemps consubstantielle à l`idée même de produit de beauté, se voile ou se complique, se corrige de liquidité, et parfois même disparaît, fait place à la fluide Iotion au spirituel tonique, glorieusement astringent s`il s`agit de combattre la cirosité de la peau, pudiquement special s`il s`agit au contraire de nourrir grassement ces voraces profondeurs dont on nous étale impitoyablement les phénomènes digestifs. Cette ouverture publique de l'intériorité du corps humain est d`ailleurs un trait général de la publicité des produits de toilette. "La pourriture s`expulse (des dents, de la peau, du sang, de l`haleine)" : la France ressent une grande fringale de propreté..." (Mythologíes. Seuil)
Ecrites d`abord sous forme d'articles, les "Mythologies" sont des chroniques de la société francaise des années 1950, mélange de tradition et de modernisation. On y voit se répandre les conditions modernes de la communication et la culture de masse dans un bric-à-brac d'images qui va du catch à la charité organisée, de la DS aux détergents, de Minou Drouet aux recettes culinaires de Elle...
La campagne de Robert Poujade est l'occasion d`analyser les attitudes fondamentales de la petite bourgeoisie ; le Tour de France cycliste est décrit comme une épopée. Toute la saveur d`une époque renaît au-delà de ses petitesses en un admirable «tableau des mœurs du temps». Car s`il a voulu dénoncer et fustiger, Barthes l`écrivain n`a pu s`empêcher d'aimer la vie française qu`il avait sous les yeux. Ces chroniques comportent aussi une analyse qui tend vers une sociologie de la vie quotidienne. Dans la mesure ou l`analyse repose sur la mise en évidence des « représentations » qui gouvernent la vie sociale, elle a besoin d'une méthode capable d`en rendre compte.
Et Barthes découvre ainsi, a posteriori, une telle méthode dans une sémiologie inspirée de Saussure et du linguiste danois Louis Hjelmslev. ll écrit, pour la reprise en volume de ses articles, une forte Postface intitulée « Le Mythe aujourd'hui ».
Les termes de « mythe » et de « mythologie » font référence au sens ancien de « récit légendaire », dans lequel Barthes privilégie le caractère trompeur des usages sociaux du mythe, destinés à assurer une domination politique et économique. Il définit le mythe comme un « système sémiologique second ». Son analyse, qui prolonge les intuitions du "Degré zéro de l'écriture", recoupe et complète la théorie de la "connotation" présentée dans les "Eléments de sémiologie" parus quelques années plus tard. Barthes comprend ce « système second » comme un appauvrissement du réel concret et un alibi que l'idéologie se donne pour faire croire qu'elle exprime la nature des choses, alors qu`elle procède à une manipulation. « Le mythe, écrit Barthes, est une parole volée et rendue.» , ou encore «l''écœurant dans le mythe, c`est le recours à une fausse nature» ...

"Cuisine ornementale " - "Le journal Elle (véritable trésor mythologique) nous donne à peu près chaque semaine une belle photographie en couleurs d'un
plat monté: perdreaux dorés piqués de cerises, chaud-froid de poulet rosâtre, timbale d'écrevisses ceinturée de carapaces rouges, charlotte crémeuse enjolivée de dessins de fruits confits,
génoises multicolores, etc.
Dans cette cuisine, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé: on s'ingénie visiblement à glacer les surfaces, à les arrondir, à
enfouir l'aliment sous le sédiment lisse des sauces, des crèmes, des fondants et des gelées. Cela tient évidemment à la finalité même du nappé, qui est d'ordre visuel, et la cuisine d'Elle est
une pure cuisine de la vue, qui est un sens distingué. Il y a en effet dans cette constance du glacis une exigence de distinction. Elle est un journal précieux, du moins à titre légendaire, son
rôle étant de présenter à l'immense public populaire qui est le sien (des enquêtes en font foi) le rêve même du chic ; d'où une cuisine du revêtement et de l'alibi, qui s'efforce toujours
d'atténuer ou même de travestir la nature première des aliments, la brutalité des viandes ou l'abrupt des crustacés. Le plat paysan n'est admis qu'à titre exceptionnel (le bon pot-au-feu des
familles), comme la fantaisie rurale de citadins blasés.
Mais surtout, le nappé prépare et supporte l'un des développements majeurs de la cuisine distinguée: l'ornementation. Les glacis d'Elle servent de fonds
à des enjolivures effrénées : champignons ciselés, ponctuation de cerises, motifs au citron ouvragé, épluchures de truffes, pastilles d'argent, arabesques de fruits confits, la nappe sous-jacente
(c'est pour cela que je l'appelais sédiment, l'aliment lui-même n'étant plus qu'un gisement incertain) veut être la page où se lit toute une cuisine en rocaille (le rosâtre est la couleur de
prédilection).
L'ornementation procède par deux voies contradictoires dont on va voir à l'instant la résolution dialectique: d'une part fuir la nature grâce à une
sorte de baroque délirant (piquer des crevettes dans un citron, rosir un poulet, servir des pamplemousses chauds), et d'autre part essayer de la reconstituer par un artifice saugrenu (disposer
des champignons meringués et des feuilles de houx sur une bûche de Noël, replacer des têtes d'écrevisses autour de la béchamel sophistiquée qui en cache les corps). C'est ce même mouvement que
l'on retrouve d'ailleurs dans l'élaboration des colifichets petits-bourgeois (cendriers en selles de cavalier, briquets en forme de cigarettes, terrines en corps de
lièvres).
C'est qu'ici, comme dans tout art petit-bourgeois, l'irrépressible tendance au vérisme est contrariée - ou équilibrée - par l'un des impératifs
constants du journalisme domestique: ce qu'à L'Express on appelle glorieusement avoir des idées. La cuisine d'Elle est de la même façon une cuisine "à idées". Seulement, ici, l'invention,
confinée à une réalité féerique, doit porter uniquement sur la garniture, car la vocation «distinguée» du journal lui interdit d'aborder les problèmes réels de l'alimentation (le problème réel
n'est pas de trouver à piquer des cerises dans un perdreau, c'est de trouver le perdreau, c'est-à-dire de le payer).
Cette cuisine ornementale est effectivement supportée par une économie tout à fait mythique. Il s'agit ouvertement d'une cuisine de rêve, comme en font
foi d'ailleurs les photographies d'Elle, qui ne saisissent le plat qu'en survol, comme un objet à la fois proche et inaccessible, dont la consommation peut très bien être épuisée par le seul
regard. C'est, au sens plein du mot, une cuisine d'affiche, totalement magique, surtout si l'on se rappelle que ce journal se lit beaucoup dans des milieux à faibles revenus. Ceci explique
d'ailleurs cela: c'est parce qu'Elle s'adresse à un public vraiment populaire qu'elle prend bien soin de ne pas postuler une cuisine économique. Voyez L'Express, au contraire, dont le public
exclusivement bourgeois est doté d'un pouvoir d'achat confortable: sa cuisine est réelle, non magique; Elle donne la recette des perdreaux-fantaisie, L'Express, celle de la salade niçoise. Le
public d'Elle n'a droit qu'à la fable, à celui de L'Express on peut proposer des plats réels..."

Le récit - Fait de culture universel, le récit ne peut être analysé qu'en fonction d'un "modèle", d'une "théorie", et Roland Barthes propose de "donner comme modèle fondateur à l'analyse structurale du récit, la linguistique elle-même" ...
"Innombrables sont les récits du monde. C'est d'abord une variété prodigieuse de genres, eux-mêmes distribués entre des substances différentes, comme si toute matière était bonne à l'homme pour lui confier ses récits : le récit peut être supporté par le langage articulé, oral ou écrit, par l'image, fixe ou mobile, par le geste et par le mélange ordonné de toutes ces substances ; il est présent dans le mythe, la légende, la fable, le conte, la nouvelle, l'épopée, l'histoire, la tragédie, le drame, la comédie, la pantomime, le tableau peint (que l'on pense à la Sainte Ursule de Carpaccio), le vitrail, le cinéma, les comics, le fait divers, la conversation. De plus, sous ces formes presque infinies, le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés ; le récit commence avec l'histoire même de l'humanité; il n'y a pas, il n'y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit; toutes les classes, tous les groupes humains ont leurs récits, et bien souvent ces récits sont goûtés en commun par des hommes de culture différente, voire opposée : le récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature : international, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie.
Une telle universalité du récit doit-elle faire conclure à son insignifiance? Est-il général que nous n'avons rien à en dire, sinon à décrire modestement quelques-unes de ses variétés, fort particulières, comme le fait parfois l'histoire littéraire? Mais ces variétés même, comment les maîtriser, comment fonder notre droit à les distinguer, à les reconnaître ? Comment opposer le roman à la nouvelle, le conte au mythe, le drame à la tragédie (on l'a fait mille fois) sans se référer à un modèle commun? Ce modèle est impliqué par toute parole sur la plus particulière, la plus historique des formes narratives. Il est donc légitime que, loin d'abdiquer toute ambition à parler du récit, sous prétexte qu'il s'agit d'un fait universel, on se soit périodiquement soucié de la forme narrative (dès Aristote); et il est normal que cette forme, le structuralisme naissant en fasse l'une de ses premières préoccupations : ne s'agit-il pas toujours pour lui de maîtriser l'infini des paroles, en parvenant â décrire la "langue" dont elles sont issues et à partir de laquelle on peut les engendrer? Devant l'infini des récits, la multiplicité des points de vue auxquels on peut en parler (historique, psychologique, sociologique, ethnologique, esthétique, etc.), l'analyste se trouve à peu près dans la même situation que Saussure, placé devant l'hétéroclite du langage et cherchant à dégager de l`anarchie apparente des messages un principe de classement et un foyer de description. Pour en rester å la période actuelle, les Formalistes russes, Propp, Lévi-Strauss nous ont
appris à cerner le dilemme suivant : ou bien le récit est un simple radotage d'événements, auquel cas on ne peut en parler qu'en s'en remettant à l'art, au talent ou au génie du conteur (de l'auteur) - toutes formes mythiques du hasard - ou bien il possède en commun avec d'autres récits une structure accessible à l'analyse, quelque patience, qu'il faille mettre à l'énoncer; car il y a un abîme entre l'aléatoire le plus complexe et la combinatoire la plus simple, et nul ne peut combiner (produire) un récit, sans se référer à un système implicite d'unités et de règles." (Introduction à l'analyse structurale des récits, in Communications, n° 8, 1966, Seuil, éd.)

1967 – Le Système de la mode
Imprévue et cependant régulière, toujours nouvelle et toujours intelligible, la Mode n'a cessé d'intéresser les psychologues, les esthéticiens, les sociologues. C'est pourtant d'un point de vue nouveau que Roland Barthes l'interroge : la saisissant à travers les descriptions de la presse, il dévoile en elle un système de significations et la soumet pour la première fois à une véritable analyse sémantique : comment les hommes font-ils du sens avec leur vêtement et leur parole ?
Barthes va ainsi répertorier tous les méandres et les subtilités de la rhétorique de mode, le choix des énoncés, suggestifs et quelquefois littéraires, qui font revivre un univers de matières, de textures, de transparences, de formes et motifs, un agencement de phrases évoquant un temps qui n’est pas si éloigné de nous mais qui paraît déjà obsolète.
"J'ouvre un journal de Mode : je vois qu'on traite ici de deux vêtements différents. Le premier est celui qu'on me présente photographié ou dessiné, c'est un vêtement-image. Le second, c'est ce même vêtement, mais décrit, transformé en langage; cette robe, photographiée à droite, devient à gauche : ceinture de cuir au-dessus de la taille, piquée d'une rose, sur une robe souple en shetland; ce vêtement est un vêtement écrit. Ces deux vêtements renvoient en principe à la même réalité (cette robe qui a été portée ce jour-là par cette femme), et pourtant ils n'ont pas la même structure, parce qu'ils ne sont pas faits des mêmes matériaux, et que, par conséquent, ces matériaux sont des formes, des lignes, des surfaces, des couleurs, et le rapport est spatial; dans l'autre, ce sont des mots, et le rapport est, sinon logique, du moins syntaxique; la première structure est plastique, la seconde est verbale. Est-ce à dire que chacune de ces structures se confond entièrement avec le système général dont elle est issue, le vêtement-image avec la photographie, et le vêtement écrit avec le langage? Nullement : la photographie de Mode n'est pas n'importe quelle photographie, elle a peu de rapport avec la photographie de presse ou la photographie d'amateur, par exemple; elle comporte des unités et des règles spécifiques; à l'intérieur de la communication photographique, elle forme un langage particulier, qui a sans doute son lexique et sa syntaxe, ses "tours", interdits ou recommandés. De même, la structure du vêtement écrit ne peut se confondre avec la structure de la phrase; car si le vêtement coïncidait avec le discours, il suffirait de changer un terme de ce discours pour changer du même coup l'identité du vêtement décrit; or, ce n'est pas le cas; le journal peut écrire indifféremment : en été, portez du tussor, ou le tussor convient très bien à l'été, sans rien changer d'essentiel à l'information qu'il transmet à ses lectrices : le vêtement écrit est porté par le langage, mais aussi il lui résiste, et c'est dans ce jeu qu'il se fait. On a donc affaire à deux structures originales, quoique dérivées de systèmes plus communs, ici la langue, là l'image ..."

Entre 1967 ("La Mort de l'Auteur") et 1970 (*S/Z*), Roland Barthes semble prendre ses distances avec le structuralisme "classique" ou "scientifique", non pas qu'il abandonne les outils du structuralisme (l'analyse des signes, des codes, des systèmes), mais il va les dépasser (déconstruire) pour les mettre au service d'une vision plus ouverte, plus libertaire et plus joyeuse du texte et de la signification. Il est passé d'une science des structures à une éthique/esthétique de la lecture....
On peut identifier ce tournant à travers "La Mort de l'Auteur" (1967), un essai bref et provocateur, manifeste théorique de sa rupture avec le structuralisme, et une œuvre charnière et un essai fondateur, "S/Z" (1970) ...
Ainsi, le projet structuraliste aurait été de prendre un corpus de récits (des centaines de contes, de nouvelles) et d'en extraire un "modèle" structurel universel (une "grammaire" narrative), comme Vladimir Propp avec la morphologie du conte. Dans S/Z", Barthes dans fait exactement l'inverse. Il prend une seule nouvelle, Sarrasine de Balzac, et la décortique ligne par ligne. Au lieu de réduire le texte à une structure, il le multiplie, le déplie à l'infini.
En proclamant "la mort de l'Auteur", Barthes coupe définitivement le lien entre le texte et une intention ou une origine unique. Le sens n'est pas à trouver dans une structure fixe déposée par l'auteur, mais il est produit par le lecteur au moment de la lecture.
Cela signifie que le texte n'a pas de structure stable et définitive. Sa "structure" est recréée à chaque lecture. Cette idée est un coup de grâce porté à l'ambition scientifique du structuralisme de trouver la clé de tous les récits.
Ce tournant n'est pas arrivé brutalement. Dès le milieu des années 1960, Barthes exprime des doutes et évolue sous l'influence de plusieurs facteurs ...
1 - L'influence de Jacques Derrida et de la "déconstruction" : Derrida critique le "logocentrisme" et l'idée d'une structure stable et close. Barthes est très sensible à cette pensée.
2 - - L'influence de Julia Kristeva : elle lui apporte les concepts d'intertextualité (tout texte est un tissu de citations) et de phéno-texte/géno-texte, qui déplace l'analyse de la structure visible vers le processus de signification.
Julia Kristeva, jeune doctorante bulgare, arrive à Paris en 1965. Elle est immédiatement remarquée pour son érudition et son accès direct aux théoriciens russes (Bakhtine, l'école formaliste) alors peu connus en France. Roland Barthes, déjà une figure établie, reconnaît immédiatement son talent. Il devient son directeur de thèse et son mentor. C'est lui qui l'introduit dans le cercle très fermé de l'intelligentsia parisienne (Tel Quel, autour de Philippe Sollers, qu'elle épousera plus tard). Barthes la présente souvent comme "la jeune Bulgare qui va nous apprendre des choses".
Kristeva a radicalement infléchi et modernisé la pensée de Barthes. Elle apporte avec elle en effet des outils conceptuels nouveaux qui vont permettre à Barthes de dépasser le structuralisme classique (qui analyse les structures stables) pour aborder le post-structuralisme.
1) L'Intertextualité : C'est Kristeva qui forge ce terme, inspiré par les théories de Bakhtine sur le "dialogisme". Elle postule que tout texte est construit comme une mosaïque de citations, un absorptions et transformations d'autres textes. Cette idée va directement nourrir la réflexion de Barthes, notamment dans son essai "De l'œuvre au texte" (1971), où il définit le Texte comme un tissu de citations, sans origine fixe, ce qui prépare le terrain pour "La Mort de l'Auteur".
2) Le Sémanalyse : Kristeva propose une théorie du langage qui intègre la pulsion, le désir et le corps (influencée par la psychanalyse lacanienne). Elle distingue le phéno-texte (la structure linguistique visible du texte) et le géno-texte (le processus pulsionnel sous-jacent, les "effets de sens" non stabilisés).
3) Le Tournant "Jouissif" de Barthes : L'influence de Kristeva est évidente dans l'évolution de Barthes vers une théorie de la lecture plus sensorielle, corporelle et "jouissive". Son livre "Le Plaisir du texte" (1973) doit beaucoup aux concepts kristeviens de la charge pulsionnelle du langage. La distinction barthesienne entre plaisir (confortable, culturel) et jouissance ( disruptive, qui fait vaciller le sujet) est en résonance directe avec la pensée de Kristeva.
Si tous deux partagent un projet commun, - dépasser le structuralisme statique pour une théorie du texte et du sujet plus dynamique, processuelle et ouverte -, cependant, leurs accents diffèrent...
Chez Barthes, l'Hédoniste et le Moraliste Son approche reste toujours du côté de l'esthétique, de la morale (au sens de style de vie) et de la jouissance subjective. Il utilise la théorie pour défendre une certaine idée de la littérature et de la lecture.
Kristeva est la Théoricienne et la Psychanalyste Son approche est plus systématiquement théorique, politique (dans ses débuts) et ancrée dans la psychanalyse. Elle cherche à construire un modèle général pour penser le sujet dans le langage.
La relation maître-élève se transformera en une amitié et une reconnaissance mutuelle entre pairs. La preuve en est l'hommage que Barthes rend à Kristeva dans son cours au Collège de France, "Le Neutre" (1978). Il lui consacre une séance entière, définissant le "genius" qu'il voit en elle : "Pour moi, le genius, c’est quelqu’un qui invente indéfiniment le pensable, qui en produit la jouissance et l’inquiétude. C’est en ce sens que je dirai que Julia Kristeva a du genius."Cette citation résume parfaitement l'admiration de Barthes pour la capacité de Kristeva à "inventer le pensable", c'est-à-dire à ouvrir sans cesse de nouvelles voies pour la réflexion.
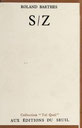
"S/Z" (1970)
Consacré tout entier à l`analyse d'une nouvelle de Balzac, « Sarrasine ». S et Z sont les initiales des protagonistes : Sarrasine, le sculpteur amoureux, et Zambinella, le castrat sous son nom féminisé. La barre symbolise leur opposition : elle met en évidence le contraste des deux consonnes, l`une sourde (s), l`autre voisée (z, pour le castrat dont le chant fascine) ; et elle offre la surface d'un miroir aux arabesques inversées des deux lettres...
S/Z cite deux fois in extenso son texte de référence : une première fois en le découpant en brèves séquences dénommées « lexies », une seconde fois continûment en appendice. Dans son analyse, Barthes dénombre cinq « codes » dont il note minutieusement les apparitions. Il paraphrase brièvement à chaque fois le contenu des « lexies ». De longues digressions viennent interrompre ce pas à pas; elles inscrivent le texte de Balzac dans un tissu de références : la linguistique, la psychanalyse, la philosophie. la sociologie...
Cette manière de faire n'élude pas trois des gestes majeurs de la critique : citer, montrer les éléments significatifs, interpréter. Pourtant on reste sur une équivoque : dans "S/Z", le savoir et l'ambition critique paraissent « joués ». Les cinq "codes" sont censés former un réseau à travers lequel le récit balzacien prend sa forme ; mais le terme même de "code" est ici une métaphore et désigne des organisations floues. Ces "codes" sont nommés :
- «herméneutique» (organisant le récit par énigmes et dévoilements);
- «sémique»(commandant les caractères attribués aux personnages) ;
- «symbolique» (le plus flou, comprenant le langage, les échanges économiques, le corps. le désir);
- «proaïrétique» (dépliant les séquences d'action);
- «culturel» (rassemblant les stéréotypes d`époque en une sorte d'encyclopédie romanesque).
Passé au tamis des cinq « codes », le texte de Balzac prend la forme du savoir de Barthes : sous la dénomination de « code culturel » réapparaît la critique idéologique chère à l`auteur des "Mythologies" ; les séquences d'action répondent à l`approche structurale et narratologique; le code « sémique » rappelle une sémiotique de la connotation; le «symbolique» fait jouer des notions venues dc la psychanalyse (lacanienne). Les sciences humaines des années 70 se voient conférer les attributs et les prestiges d`un jeu sérieux. Mais ce qui importe, c`est qu'à travers elles la nouvelle de Balzac acquiert une intensité et une présence inégalables. Le commentaire nous fait ressentir la tension entre l`esthétique romanesque « réaliste », qui apparaît conventionnelle, et les enjeux humains du récit balzacien : le drame de la castration et de l'amour trompé, le lien qui noue, par l'intermédiaire du récit, le narrateur et ses lecteurs...

1970 - L'Empire des signes
L`Empire des signes est le fruit d 'une heureuse rencontre entre Barthes. penseur du signe, et un pays, le Japon, une contrée dans laquelle la vie sociale
semble privilégier une gestualité extrêmement codée, précise, et bouclant sur elle-même. Le texte de Barthes esquisse un parallèle entre l 'Occident et le Japon : ainsi, ce que nous
appelons "politesse" est là-bas davantage vécu comme un véritable art de vivre à connotation quasi religieuse...
"Pourquoi en Occident, la politesse est-elle considérée avec suspicion ? Pourquoi la courtoisie y passe-t-elle pour une distance (sinon même une fuite) ou une hypocrisie ? Pourquoi un rapport «informel›› (comme on dit ici avec une gourmandise) est-il plus souhaitable qu`un rapport codé ? L`impolitesse de l`Occident repose sur une certaine mythologie de la «personne››.
Topologiquement, l'homme occidental est réputé double, composé d`un «extérieur››, social, factice, faux, et d'un «intérieur›› personnel, authentique (lieu de la communication divine). Selon ce dessin, la «personne›› humaine est ce lieu empli de nature (ou de divinité, ou de culpabilité), ceinturé, clos par une enveloppe sociale peu estimée : le geste poli (lorsqu`il est postulé) est le signe de respect échangé d'une plénitude à l`autre, à travers la limite mondaine (c`est-à-dire en dépit et par l'intermédiaire de cette limite). Cependant, dès lors que c'est l'intérieur de la "personne" qui est jugé respectable, il est logique de reconnaître mieux cette personne en déniant tout intérêt à son enveloppe mondaine : c`est donc le rapport prétendument franc, brutal, mutilé (pense-t-on) de toute signalétique, indifférent à tout code intermédiaire, qui respectera le mieux le prix individuel de l'autre : être impoli, c`est être vrai, dit logiquement la morale occidentale. Car s`il y a bien une "personne" humaine (dense, pleine, centrée, sacrée), c`est sans doute elle que, dans un premier mouvement, l`on prétend "saluer" (de la tête. des lèvres, du corps) ; mais ma propre personne, entrant inévitablement en lutte avec la plénitude de l'autre, ne pourra se faire reconnaître qu'en rejetant toute médiation du factice et en affirmant l'intégrité (mot justement ambigu : physique et moral) de son "intérieur" : et dans un second temps, je réduirai mon salut, je feindrai de le rendre naturel, spontané, débarrassé, purifié de tout code : je serai à peine gracieux, ou gracieux selon une fantaisie apparemment inventée, comme la princesse de Parme (chez Proust) signalant l`ampleur de ses revenus et la hauteur de son rang (c`est-a-dire son mode d`être "pleine" de choses et de se constituer en personne), non par la raideur distante de l`abord, mais par la "simplicité" voulue de ses manières : combien je suis simple, combien je suis gracieux, combien je suis franc, combien je suis quelqu'un, c`est ce que dit l`impolitesse de l`Occidental. L`autre politesse, par la minutie de ses codes, le graphisme net de ses gestes, et alors même qu`elle nous apparaît exagérément respectueuse (c`est-à-dire, à nos yeux, "humiliante") parce que nous la lisons a notre habitude selon une métaphysique de la personne, cette politesse est un certain exercice du vide (comme on peut l`attendre d'un code fort, mais signifiant "rien").
Deux corps s'inclinent très bas devant l`autre (les bras, les genoux, la tête restant toujours à une place réglée), selon des degrés de profondeur
subtilement codés. Ou encore (sur une image ancienne) : pour offrir un cadeau, je m`aplatis, courbé jusqu'à l'incrustation, et pour me répondre, mon partenaire en fait autant : une même ligne
basse, celle du sol, joint l`offrant, le recevant et l`enjeu du protocole, boîte qui peut-être ne contient rien - ou si peu de chose: une forme graphique (inscrite dans l`espace de la pièce) est
de la sorte donnée à l'acte d`échange, en qui, par cette forme, s`annule toute avidité (le cadeau reste suspendu entre deux disparitions). Le salut peut être soustrait à toute humiliation ou à
toute vanité, parce qu'à la lettre il ne salue personne : il n'est pas le signe d'une communication, surveillée, condescendante et précautionneuse, entre deux autarcies, deux empires personnels
(chacun régnant sur son Moi, petit domaine dont il a la "clef") : il n'est que le trait d`un réseau de formes où rien n'est arrêté, noué, profond. Qui salue qui ? Seule une telle question
justifie le salut, l'incline jusqu'à la courbette. L'aplatissement fait triompher en lui, non le sens, mais le graphisme et donne à une posture que nous lisons comme excessive, la retenue même
d`un geste dont tout signifié est inconcevablement absent. La Forme est Vide. dit - et redit - un mot bouddhiste. C'est ce qu`énoncent. à travers une pratique des formes (mot dont le sens
plastique et le sens mondain sont ici indissociables) la politesse du salut, la courbure de deux corps qui s`écrivent mais ne se prosternent pas.
Nos habitudes de parler sont très vicieuses. car si je dis que là-bas la politesse est une religion, je fais entendre qu`il y a en elle quelque chose de
sacré ; l`expression doit être dévoyée de façon à suggérer que la religion n'est là-bas qu`une politesse, ou mieux encore : que la religion a été remplacée par la politesse... " (L'Empire des
signes. Skira).
Barthes goûte à travers "son" Japon le plaisir de se livrer à une écriture libérée des contraintes académiques et vouée à la découverte du monde inconnu et des choix personnels. Une subjectivité jusqu'alors discrète s'affirme dans "L'Empire des signes". Elle dicte notamment le choix des objets : la langue, la nourriture, la ville, les formes de politesse, le haïku, le théâtre Bunraku, les corps et les visages, tout un monde de choses quotidiennes, mêlées sans distinction de niveau à l'art et à la littérature. La subjectivité est présente aussi dans l'interprétation du monde japonais. L'idée de "vide" et d`absence du sens est affirmée à toute occasion et les brefs poèmes japonais rejoignent une rêverie insistante chez Barthes, celle d`un lien immédiat entre les mots et les choses, d'une relation au monde débarrassée des faux-semblants idéologiques. À travers ce Japon idéal, Barthes imagine une pratique des représentations dont le caractère subtil et complètement détaché permettrait de faire s'évanouir le sentiment d'artifice lié pour lui à l'univers symbolique occidental....
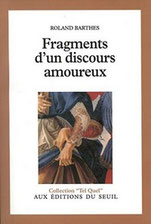
"Fragments d'un discours amoureux" (1977) est l'un des livres les plus singuliers et populaires de Roland Barthes. C'est le livre dans lequel, en savant et en poète, il donne une voix à la figure universelle de l'Amoureux. C'est une tentative réussie de fusionner l'érudition et l'émotion, la structure et le fragment, la culture la plus élevée et l'expérience la plus intime. C'est un anti-manuel qui dit : "Voici les mots de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement un sujet parlant, qui aime."
Après la mort de sa mère en 1977 (événement qui le touche profondément et qui donnera plus tard La Chambre claire), Barthes est dans une période de remise en question. Le professeur au Collège de France, le sémiologue structuraliste renommé, veut désormais écrire autrement. Il cherche à :
- Dépasser le langage scientifique et la froideur de l'analyse structuraliste.
- Intégrer le sujet, l'intime, l'émotion et le corps dans son travail, sans pour autant abandonner la rigueur.
- Écrire un livre qui parle à tout le monde, pas seulement aux universitaires.
D'où le Projet : Donner une Langue à l'Amoureux
Le titre lui-même est une clé. Barthes le explique en ouverture :
- "Discours" : Il ne s'agit pas d'un traité sur l'amour, mais du discours que tient le sujet amoureux, seul, face à lui-même ou à l'autre. C'est la parole interne de celui qui aime, avec ses angoisses, ses élans, ses interrogations.
- "Fragments" : Cette parole n'est pas un récit linéaire. Elle est faite de surgissements, de scènes, d'états qui se répètent, de moments discontinus. La structure en fragments (80 entrées alphabétiques, de s'abîmer à vouloir-saisir) mime parfaitement la pensée de l'amoureux, qui saute d'une idée à l'autre, revient sur ses doutes, ressasse ses joies.
Barthes constate que la société fournit de nombreux langages (la psychanalyse, la religion, la morale), mais aucun langage propre au sujet amoureux. Celui-ci est souvent réduit au silence ou contraint de se faire analyser. Barthes veut lui fournir un répertoire, une "langue" pour se reconnaître et se dire.
"La nécessité de ce livre tient dans la considération suivante : que le discours amoureux est aujourd’hui d’une extrême solitude. Ce discours est peut-être parlé par des milliers de sujets (qui le sait ?), mais il n’est soutenu par personne ; il est complètement abandonné des langages environnants : ou ignoré, ou déprécié, ou moqué par eux, coupé non seulement du pouvoir, mais aussi de ses mécanismes (sciences, savoirs, arts). Lorsqu’un discours est de la sorte entraîné par sa propre force dans la dérive de l’inactuel, déporté hors de toute grégarité, il ne lui reste plus qu’à être le lieu, si exigu soit-il, d’une affirmation. Cette affirmation est en somme le sujet du livre qui commence.
Comment est fait ce livre
Tout est parti de ce principe : qu’il ne fallait pas réduire l’amoureux à un simple sujet symptomal, mais plutôt faire entendre ce qu’il y a dans sa voix d’inactuel, c’est-à-dire d’intraitable. De là le choix d’une méthode « dramatique », qui renonce aux exemples et repose sur la seule action d’un langage premier (pas de métalangage). On a donc substitué à la description du discours amoureux sa simulation, et l’on a rendu à ce discours sa personne fondamentale, qui est le je, de façon à mettre en scène une énonciation, non une analyse. C’est un portrait, si l’on veut, qui est proposé ; mais ce portrait n’est pas psychologique ; il est structural : il donne à lire une place de parole : la place de quelqu’un qui parle en lui-même, amoureusement, face à l’autre (l’objet aimé), qui ne parle pas.
1. Figures
Dis-cursus, c’est, originellement, l’action de courir çà et là, ce sont des allées et venues, des « démarches », des « intrigues ». L’amoureux ne cesse en effet de courir dans sa tête, d’entreprendre de nouvelles démarches et d’intriguer contre lui-même. Son discours n’existe jamais que par bouffées de langage, qui lui viennent au gré de circonstances infimes, aléatoires.
On peut appeler ces bris de discours des figures. Le mot ne doit pas s’entendre au sens rhétorique, mais plutôt au sens gymnastique ou chorégraphique ; bref, au sens grec : σχῆμα, ce n’est pas le « schéma » ; c’est, d’une façon bien plus vivante, le geste du corps saisi en action, et non pas contemplé au repos : le corps des athlètes, des orateurs, des statues : ce qu’il est possible d’immobiliser du corps tendu. Ainsi de l’amoureux en proie à ses figures : il se démène dans un sport un peu fou, il se dépense, comme l’athlète ; il phrase, comme l’orateur ; il est saisi, sidéré dans un rôle, comme une statue. La figure, c’est l’amoureux au travail.
Les figures se découpent selon qu’on peut reconnaître, dans le discours qui passe, quelque chose qui a été lu, entendu, éprouvé. La figure est cernée (comme un signe) et mémorable (comme une image ou un conte). Une figure est fondée si au moins quelqu’un peut dire : « Comme c’est vrai, ça ! Je reconnais cette scène de langage. » Pour certaines opérations de leur art, les linguistes s’aident d’une chose vague : le sentiment linguistique ; pour constituer les figures, il ne faut ni plus ni moins que ce guide : le sentiment amoureux.
Peu importe, au fond, que la dispersion du texte soit riche ici et pauvre là ; il y a des temps morts, bien des figures tournent court ; certaines, étant des hypostases de tout le discours amoureux, ont la rareté même - la pauvreté - des essences : que dire de la Langueur, de l’Image, de la Lettre d’amour, puisque c’est tout le discours amoureux qui est tissé de désir, d’imaginaire et de déclarations ? Mais celui qui tient ce discours et en découpe les épisodes ne sait pas qu’on en fera un livre ; il ne sait pas encore qu’en bon sujet culturel il ne doit ni se répéter, ni se contredire, ni prendre le tout pour la partie ; il sait seulement que ce qui lui passe dans la tête à tel moment est marqué, comme l’empreinte d’un code (autrefois, c’eût été le code d’amour courtois, ou la carte du Tendre).
Ce code, chacun peut le remplir au gré de sa propre histoire ; maigre ou pas, il faut donc que la figure soit là, que la place (la case) en soit réservée. C’est comme s’il y avait une Topique amoureuse, dont la figure fût un lieu (topos). Or, le propre d’une Topique, c’est d’être un peu vide : une Topique est par statut à moitié codée, à moitié projective (ou projective, parce que codée). Ce qu’on a pu dire ici de l’attente, de l’angoisse, du souvenir, n’est jamais qu’un supplément modeste, offert au lecteur pour qu’il s’en saisisse, y ajoute, en retranche et le passe à d’autres : autour de la figure, les joueurs font courir le furet ; parfois, par une dernière parenthèse, on retient l’anneau une seconde encore avant de le transmettre. (Le livre, idéalement, serait une coopérative : « Aux Lecteurs - aux Amoureux - Réunis. »)
Ce qui est lu en tête de chaque figure n’est pas sa définition, c’est son argument. Argumentum : « exposition, récit, sommaire, petit drame, histoire inventée » ; j’ajoute : instrument de distanciation, pancarte, à la Brecht. Cet argument ne réfère pas à ce qu’est le sujet amoureux (personne d’extérieur à ce sujet, pas de discours sur l’amour), mais à ce qu’il dit. S’il y a une figure « Angoisse », c’est parce que le sujet s’écrie parfois (sans se soucier du sens clinique du mot) : « Je suis angoissé ! » « Angoscia! », chante quelque part la Callas. La figure est en quelque sorte un air d’opéra ; de même que cet air est identifié, remémoré et manié à travers son incipit (« Je veux vivre ce rêve », « Pleurez, mes yeux », « Lucevan le stelle », « Piangerò la mia sorte »), de même la figure part d’un pli de langage (sorte de verset, de refrain, de cantilation) qui l’articule dans l’ombre.
On dit que seuls les mots ont des emplois, non les phrases ; mais au fond de chaque figure gît une phrase, souvent inconnue (inconsciente ?), qui a son emploi dans l’économie signifiante du sujet amoureux. Cette phrase mère (ici seulement postulée) n’est pas une phrase pleine, ce n’est pas un message achevé. Son principe actif n’est pas ce qu’elle dit, mais ce qu’elle articule : elle n’est, à tout prendre, qu’un « air syntaxique », un « mode de construction ». Par exemple, si te sujet attend l’objet aimé à un rendez-vous, un air de phrase vient à ressassement dans sa tête : « Tout de même, ce n’est pas chic... » ; « il/ elle aurait bien pu... » ; « il/ elle sait bien pourtant... » : pouvoir, savoir quoi ? Peu importe, la figure « Attente » est déjà formée. Ces phrases sont des matrices de figures, précisément parce qu’elles restent suspendues : elles disent l’affect, puis s’arrêtent, leur rôle est rempli. Les mots ne sont jamais fous (tout au plus pervers), c’est la syntaxe qui est folle : n’est-ce pas au niveau de la phrase que le sujet cherche sa place - et ne la trouve pas - ou trouve une place fausse qui lui est imposée par la langue ? Au fond de la figure, il y a quelque chose de l’« hallucination verbale » (Freud, Lacan) : phrase tronquée qui se limite le plus souvent à sa partie syntaxique (« Bien que tu sois... », « Si tu devais encore... »). Ainsi naît l’émoi de toute figure : même la plus douce porte en elle la frayeur d’un suspense : j’entends en elle le quos ego... neptunien, orageux.
2. Ordre
Tout le long de la vie amoureuse, les figures surgissent dans la tête du sujet amoureux sans aucun ordre, car elles dépendent chaque fois d’un hasard (intérieur ou extérieur). A chacun de ces incidents (ce qui lui « tombe » dessus), l’amoureux puise dans la réserve (le trésor ?) des figures, selon les besoins, les injonctions ou les plaisirs de son imaginaire. Chaque figure éclate, vibre seule comme un son coupé de toute mélodie - ou se répète, à satiété, comme le motif d’une musique planante. Aucune logique ne lie les figures, ne détermine leur contiguïté : les figures sont hors syntagme, hors récit ; ce sont des Érinyes ; elles s’agitent, se heurtent, s’apaisent, reviennent, s’éloignent, sans plus d’ordre qu’un vol de moustiques. Le dis-cursus amoureux n’est pas dialectique ; il tourne comme un calendrier perpétuel, une encyclopédie de la culture affective (dans l’amoureux, quelque chose de Bouvard et Pécuchet).
En termes linguistiques, on dirait que les figures sont distributionnelles, mais qu’elles ne sont pas intégratives ; elles restent toujours au même niveau : l’amoureux parle par paquets de phrases, mais il n’intègre pas ces phrases à un niveau supérieur, à une œuvre ; c’est un discours horizontal : aucune transcendance, aucun salut, aucun roman (mais beaucoup de romanesque). Tout épisode amoureux peut être, certes, doté d’un sens : il naît, se développe et meurt, il suit un chemin qu’il est toujours possible d’interpréter selon une causalité ou une finalité, au besoin, même, de moraliser (« J’étais fou, je suis guéri », « L’amour est un leurre dont il faudra désormais se méfier », etc.) : c’est là l’histoire d’amour, asservie au grand Autre narratif, à l’opinion générale qui déprécie toute force excessive et veut que le sujet réduise lui-même le grand ruissellement imaginaire dont il est traversé sans ordre et sans fin, à une crise douloureuse, morbide, dont il faut guérir (« Ça naît, ça monte, ça fait souffrir, ça passe », tout comme une maladie hippocratique) : l’histoire d’amour (l’« aventure ») est le tribut que l’amoureux doit payer au monde pour se réconcilier avec lui.
Tout autre est le discours, le soliloque, l’a parte, qui accompagne cette histoire, sans jamais la connaître. C’est le principe même de ce discours (et du texte qui le représente) que ses figures ne peuvent se ranger : s’ordonner, cheminer, concourir à une fin (à un établissement) : il n’y en a pas de premières ni de dernières. Pour faire entendre qu’il ne s’agissait pas ici d’une histoire d’amour (ou de l’histoire d’un amour), pour décourager la tentation du sens, il était nécessaire de choisir un ordre absolument insignifiant. On a donc soumis la suite des figures (inévitable puisque le livre est astreint, par statut, au cheminement) à deux arbitraires conjugués : celui de la nomination et celui de l’alphabet. Chacun de ces arbitraires est cependant tempéré : l’un par la raison sémantique (parmi tous les noms du dictionnaire, une figure ne peut en recevoir que deux ou trois), l’autre par la convention millénaire qui règle l’ordre de notre alphabet. On a évité ainsi les ruses du hasard pur, qui aurait bien pu produire des séquences logiques ; car il ne faut pas, dit un mathématicien, « sous-estimer la puissance du hasard à engendrer des monstres » ; le monstre, en l’occurrence, eût été, sortant d’un certain ordre des figures, une « philosophie de l’amour », là où il ne faut attendre que son affirmation...."
La Méthode : Un Bricolage Culturel et Personnel
Barthes ne décrit pas sa propre expérience amoureuse de manière autobiographique. Il utilise une méthode de collage et d'identification :
- Le Texte Source : Il prend comme fil conducteur Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, archétype du discours amoureux dans la culture occidentale.
- Le Bricolage Culturel : Il fait appel à une multitude d'autres sources : Platon, Freud, Nietzsche, La Rochefoucauld, mais aussi des opéras de Wagner, des poèmes, des philosophes présocratiques, etc.
- L'Universel : En mélangeant toutes ces références, Barthes montre que l'"être-aimant" est une figure intemporelle. Les symptômes et les paroles de Werther en 1774 sont les mêmes que ceux d'un amoureux parisien des années 1970.
- Le Jeu des Pronoms : Il utilise un "je" qui n'est ni tout à fait lui, ni tout à fait Werther, ni tout à fait le lecteur. C'est un "je" universel et interchangeable. Le livre devient un miroir où tout lecteur peut se reconnaître.
- La Structure : L'Ordre Alphabétique et le Désordre du Cœur
Le choix de l'ordre alphabétique (et non thématique ou chronologique) est génial :
Il détruit toute hiérarchie entre les concepts. L'Attente n'est pas plus importante que la Jalousie. Il reproduit le hasard et la fragmentation des émotions amoureuses. On peut ouvrir le livre à n'importe quelle page et s'y retrouver. Il refuse de construire une théorie ou un système. L'amour ne se systématise pas ; il se vit par fragments.
"C’est donc
un amoureux
qui parle
et qui dit:
« Je m’abîme, je succombe... »
S’ABÎMER. Bouffée d’anéantissement qui vient au sujet amoureux, par désespoir ou par comblement.
1. Soit blessure, soit bonheur, il me prend parfois l’envie de m’abîmer.
Ce matin (à la campagne), il fait gris et doux. Je souffre (de je ne sais quel incident). Une idée de suicide se présente, pure de tout ressentiment (aucun chantage à personne) ; c’est une idée fade ; elle ne rompt rien (elle ne « casse » rien), s’accorde à la couleur (au silence, à l’abandon) de cette matinée.
Un autre jour, sous la pluie, nous attendons le bateau au bord d’un lac ; de bonheur, cette fois-ci, la même bouffée d’anéantissement me vient. Ainsi, parfois, le malheur ou la joie tombent sur moi, sans qu’il s’ensuive aucun tumulte : plus aucun pathos : je suis dissous, non dépiécé ; je tombe, je coule, je fonds. Cette pensée frôlée, tentée, tâtée (comme on tâte l’eau du pied) peut revenir. Elle n’a rien de solennel.
Ceci est très exactement la douceur.
2. La bouffée d’abîme peut venir d’une blessure, mais aussi d’une fusion : nous mourons ensemble de nous aimer : mort ouverte, par dilution dans l’éther, mort close du tombeau commun.
L’abîme est un moment d’hypnose. Une suggestion agit, qui me commande de m’évanouir sans me tuer. De là, peut-être, la douceur de l’abîme : je n’y ai aucune responsabilité, l’acte (de mourir) ne m’incombe pas : je me confie, je me transfère (à qui ? à Dieu, à la Nature, à tout, sauf à l’autre).
3. Lorsque ainsi il m’arrive de m’abîmer, c’est qu’il n’y a plus de place pour moi nulle part, même pas dans la mort. L’image de l’autre - à quoi je collais, de quoi je vivais - n’est plus ; tantôt c’est une catastrophe (futile) qui semble l’éloigner à jamais, tantôt c’est un bonheur excessif qui me la fait rejoindre ; de toute manière, séparé ou dissous, je ne suis recueilli nulle part ; en face, ni moi, ni toi, ni mort, plus rien à qui parler.
(Bizarrement, c’est dans l’acte extrême de l’imaginaire amoureux - s’anéantir pour avoir été chassé de l’image ou s’y être confondu - que s’accomplit une chute de cet Imaginaire : le temps bref d’un vacillement, je perds ma structure d’amoureux : c’est un deuil factice, sans travail : quelque chose comme un non-lieu.)
4. Amoureux de la mort ? C’est trop dire d’une moitié ; half in love with easeful death (Keats) : la mort libérée du mourir. J’ai alors ce fantasme : une hémorragie douce qui ne coulerait d’aucun point de mon corps, une consomption presque immédiate, calculée pour que j’aie le temps de désouffrir sans avoir encore disparu. Je m’installe fugitivement dans une pensée fausse de la mort (fausse comme une clef faussée) : je pense la mort à côté : je la pense selon une logique impensée, je dérive hors du couple fatal qui lie la mort et la vie en les opposant.
5. L’abîme n’est-il qu’un anéantissement opportun ? Il ne me serait pas difficile de lire en lui non un repos, mais une émotion. Je masque mon deuil sous une fuite ; je me dilue, je m’évanouis pour échapper à cette compacité, à cet engorgement, qui fait de moi un sujet responsable : je sors : c’est l’extase.
Rue du Cherche-Midi, après une soirée difficile, X... m’expliquait très bien, d’une voix précise, aux phrases formées, éloignées de tout indicible, qu’il souhaitait parfois s’évanouir ; il regrettait de ne pouvoir jamais disparaître à volonté.
Ses paroles disaient qu’il entendait alors succomber à sa faiblesse, ne pas résister aux blessures que lui fait le monde ; mais, en même temps, il substituait à cette force défaillante une autre force, une autre affirmation : j’assume envers et contre tout un déni de courage, donc un déni de morale : c’est ce que disait la voix de X...
L’absent
ABSENCE. Tout épisode de langage qui met en scène l’absence de l’objet aimé - quelles qu’en soient la cause et la durée - et tend à transformer cette absence en épreuve d’abandon.
1. Beaucoup de lieder, de mélodies, de chansons sur l’absence amoureuse. Et, cependant, cette figure classique, dans Werther, on ne la trouve pas. La raison en est simple : ici, l’objet aimé (Charlotte) ne bouge pas ; c’est le sujet amoureux (Werther) qui, à un certain moment, s’éloigne. Or, il n’y a d’absence que de l’autre : c’est l’autre qui part, c’est moi qui reste. L’autre est en état de perpétuel départ, de voyage ; il est, par vocation, migrateur, fuyant ; je suis, moi qui aime, par vocation inverse, sédentaire, immobile, à disposition, en attente, tassé sur place, en souffrance, comme un paquet dans un coin perdu de gare. L’absence amoureuse va seulement dans un sens, et ne peut se dire qu’à partir de qui reste - et non de qui part : je, toujours présent, ne se constitue qu’en face de toi, sans cesse absent. Dire l’absence, c’est d’emblée poser que la place du sujet et la place de l’autre ne peuvent permuter ; c’est dire : « Je suis moins aimé que je n’aime. »
2. Historiquement, le discours de l’absence est tenu par la Femme : la Femme est sédentaire, l’Homme est chasseur, voyageur ; la Femme est fidèle (elle attend), l’homme est coureur (il navigue, il drague). C’est la Femme qui donne forme à l’absence, en élabore la fiction, car elle en a le temps ; elle tisse et elle chante ; les Fileuses, les Chansons de toile disent à la fois l’immobilité (par le ronron du Rouet) et l’absence (au loin, des rythmes de voyage, houles marines, chevauchées). Il s’ensuit que dans tout homme qui parle l’absence de l’autre, du féminin se déclare : cet homme qui attend et qui en souffre, est miraculeusement féminisé. Un homme n’est pas féminisé parce qu’il est inverti, mais parce qu’il est amoureux. (Mythe et utopie : l’origine a appartenu, l’avenir appartiendra aux sujets en qui il y a du féminin.)
3. Quelquefois, il m’arrive de bien supporter l’absence. Je suis alors « normal » : je m’aligne sur la façon dont « tout le monde » supporte le départ d’une « personne chère » ; j’obéis avec compétence au dressage par lequel on m’a donné très tôt l’habitude d’être séparé de ma mère - ce qui ne laissa pas, pourtant, à l’origine, d’être douloureux (pour ne pas dire : affolant). J’agis en sujet bien sevré ; je sais me nourrir, en attendant, d’autres choses que du sein maternel.
Cette absence bien supportée, elle n’est rien d’autre que l’oubli. Je suis, par intermittence, infidèle. C’est la condition de ma survie ; car, si je n’oubliais pas, je mourrais. L’amoureux qui n’oublie pas quelquefois, meurt par excès, fatigue et tension de mémoire (tel Werther).
(Enfant, je n’oubliais pas : journées interminables, journées abandonnées, où la Mère travaillait loin ; j’allais, le soir, attendre son retour à l’arrêt de l’autobus Ubis, à Sèvres-Babylone ; les autobus passaient plusieurs fois de suite, elle n’était dans aucun.)
4. De cet oubli, très vite, je me réveille. Hâtivement, je mets en place une mémoire, un désarroi. Un mot (classique) vient du corps, qui dit l’émotion d’absence : soupirer : « soupirer après la présence corporelle » : les deux moitiés de l’androgyne soupirent l’une après l’autre, comme si chaque souffle, incomplet, voulait se mêler à l’autre : image de l’embrassement, en tant qu’il fond les deux images en une seule : dans l’absence amoureuse, je suis, tristement, une image décollée, qui sèche, jaunit, se recroqueville.
(Quoi, le désir n’est-il pas toujours le même, que l’objet soit présent ou absent ? L’objet n’est-il pas toujours absent ? - Ce n’est pas la même langueur : il y a deux mots : Pothos, pour le désir de l’être absent et Himéros, plus brûlant, pour le désir de l’être présent.)
5. Je tiens sans fin à l’absent le discours de son absence ; situation en somme inouïe ; l’autre est absent comme référent, présent comme allocutaire. De cette distorsion singulière, naît une sorte de présent insoutenable ; je suis coincé entre deux temps, le temps de la référence et le temps de l’allocution : tu es parti (de quoi je me plains), tu es là (puisque je m’adresse à toi). Je sais alors ce qu’est le présent, ce temps difficile : un pur morceau d’angoisse.
L’absence dure, il me faut la supporter. Je vais donc la manipuler : transformer la distorsion du temps en va-et-vient, produire du rythme, ouvrir la scène du langage (le langage naît de l’absence : l’enfant s’est bricolé une bobine, la lance et la rattrape, mimant le départ et le retour de la mère : un paradigme est créé). L’absence devient une pratique active, un affairement (qui m’empêche de rien faire d’autre) ; il y a création d’une fiction aux rôles multiples (doutes, reproches, désirs, mélancolies). Cette mise en scène langagière éloigne la mort de l’autre : un moment très bref, dit-on, sépare le temps où l’enfant croit encore sa mère absente et celui où il la croit déjà morte. Manipuler l’absence, c’est allonger ce moment, retarder aussi longtemps que possible l’instant où l’autre pourrait basculer sèchement de l’absence dans la mort.
6. La frustration aurait pour figure la Présence (je vois chaque jour l’autre, et pourtant je n’en suis pas comblé : l’objet est là, réellement, mais il continue à me manquer, imaginairement). La castration, elle, aurait pour figure l’intermittence (j’accepte de quitter un peu l’autre, « sans pleurer », j’assume le deuil de la relation, je sais oublier). L’Absence est la figure de la privation ; tout à la fois, je désire et j’ai besoin. Le désir s’écrase sur le besoin : c’est là le fait obsédant du sentiment amoureux.
(« Le désir est là, ardent, éternel : mais Dieu est plus haut que lui, et les bras levés du Désir n’atteignent jamais la plénitude adorée. » Le discours de l’Absence est un texte à deux idéogrammes : il y a les bras levés du Désir, et il y a les bras tendus du Besoin. J’oscille, je vacille entre l’image phallique des bras levés et l’image pouponnière des bras tendus.)
7. Je m’installe seul, dans un café ; on vient m’y saluer ; je me sens entouré, demandé, flatté. Mais l’autre est absent ; je le convoque en moi-même pour qu’il me retienne au bord de cette complaisance mondaine, qui me guette. J’en appelle à sa « vérité » (la vérité dont il me donne la sensation) contre l’hystérie de séduction où je me sens glisser. Je rends l’absence de l’autre responsable de ma mondanité : j’invoque sa protection, son retour : que l’autre apparaisse, qu’il me retire, telle une mère qui vient chercher son enfant, de la brillance mondaine, de l’infatuation sociale, qu’il me rende « l’intimité religieuse, la gravité » du monde amoureux.
(X... me disait que l’amour l’avait protégé de la mondanité : coteries, ambitions, promotions, manigances, alliances, sécessions, rôles, pouvoirs : l’amour avait fait de lui un déchet social, ce dont il se réjouissait.)
8. Un koan bouddhique dit ceci : « Le maître tient la tête du disciple sous l’eau, longtemps, longtemps ; peu à peu les bulles se raréfient ; au dernier moment, le maître sort le disciple, le ranime : quand tu auras désiré la vérité comme tu as désiré l’air, alors tu sauras ce qu’elle est. »
L’absence de l’autre me tient la tête sous l’eau ; peu à peu, j’étouffe, mon air se raréfie : c’est par cette asphyxie que je reconstitue ma « vérité » et que je prépare l’Intraitable de l’amour."
(...)
Pourquoi ce livre est-il si important ?
- Une Révolution Formelle : C'est un livre de théorie qui n'en a pas l'air. Barthes invente une nouvelle façon de faire de la philosophie et de la sémiologie : une "logique affective" qui parle à l'intelligence et à la sensibilité.
- La Légitimation d'un Sentiment : Barthes prend au sérieux la souffrance et la joie amoureuses, souvent considérées comme futiles ou pathologiques. Il les traite comme un objet de pensée digne d'analyse, leur donnant une noblesse inédite.
- Un Livre-Empathie : Son immense succès populaire vient du fait que des millions de lecteurs s'y sont reconnus. Il offre un vocabulaire à ce qui était indicible et une consolation par la reconnaissance : "Je ne suis pas seul à ressentir cela, et même Goethe et Platon en ont parlé".
- L'Aboutissement d'une Quête : Ce livre est le point de convergence de toutes les préoccupations de Barthes :
- La Mort de l'Auteur : Ici, l'auteur s'efface pour laisser place à une voix collective.
- Le Plaisir du Texte : Le livre est conçu pour procurer à la fois de l'intelligence et de la jouissance.
- La Sémiologie : Même s'il est moins technique, le livre analyse les "signes" que émet et interprète l'amoureux (un retard, un silence, un regard).

"Le bruissement de la langue" (1984, Essais Critiques IV, Seuil)
Nous vivons dans des sociétés marquées par une "guerre généralisée des langages". Et pourtant, le langage ne se réduit pas à la communication simple, c'est bien le sujet humain dans sa totalité qui s'engage dans la parole et se construit à travers elle. "Nous n'atteignons jamais un état où l'homme serait séparé du langage, qu'il élaborerait alors pour exprimer ce qui se passe en lui: c'est le langage qui enseigne la définition de l'homme, non le contraire". Mais alors que les dysfonctionnements de ce langage sot en quelque sorte résumé dans signe sonore, le "bredouillement", il est un autre signe sonore qui marque la bonne marche de celui-ci, c'est le "bruissement", et ce "bruissement de la langue" ne porte-t-il pas cette utopie qui débouche le "frissons du sens", un sens libéré de toutes entraves...
(La paix culturelle)
"Dire qu'íl y a une culture bourgeoise est faux, parce que c'est toute notre culture qui est bourgeoise (et dire que notre culture est bourgeoise est un truisme fatigant, qui traîne dans toutes les universités). Dire que la culture s'oppose à la nature est incertain, parce qu'on ne sait pas très bien où sont les limites de l'une et de l'autre : où est la nature dans l'homme ? Pour se dire homme, il faut à l'homme un langage, c'est-à-dire la culture même. Dans le biologique ? On retrouve aujourd'hui dans l'organisme vivant les mêmes structures que dans le sujet parlant : la vie elle-même est construite comme un langage. Bref, tout est culture, du vêtement au livre, de la nourriture à l'image, et la culture est partout, d'un bout à l'autre des échelles sociales. Cette culture, décidément, est un objet bien paradoxal : sans contours, sans terme oppositionnel, sans reste.
Ajoutons même peut-être : sans histoire - ou du moins sans rupture, soumise à une répétition inlassable. Voici, à la télévision, un feuilleton américain d'espionnage : il y a cocktail sur un yacht, et les partenaires se livrent à une sorte de marivaudage mondain (coquetteries, répliques à double sens, jeux d'intérêts) ; mais cela a déjà été vu ou dit : non seulement dans des milliers de romans et de films populaires, mais dans les oeuvres anciennes, qui ont appartenu à ce qui pourrait passer pour une autre culture, dans Balzac, par exemple : on croirait que la princesse de Cadignan s'est simplement déplacée, qu'elle a quitté le Faubourg Saint-Germain pour le yacht d'un armateur grec. Ainsi, la culture, ce n'est pas seulement ce qui revient, c'est aussi et surtout ce qui reste sur place, tel un cadavre impérissable: c'est un jouet bizarre que l'Histoire ne casse jamais.
Objet unique, puisqu'il ne s'oppose ã rien, objet éternel, puisqu'il ne se casse jamais, objet paisible en somme, dans le sein duquel tout le monde est rassemblé sans conflit apparent : où est donc le travail de la culture sur elle-même, ou sont ses contradictions, où est son malheur ?
Pour répondre, il nous faut, en dépit du paradoxe épistémologique de l'objet, risquer une définition, la plus vague qui soit, bien entendu : la culture est un champ de dispersion. De quoi ? Des langages.
Dans notre culture, dans la paix culturelle, "la Pax culturalis" à laquelle nous sommes assujettis, il y a une guerre inexpiable des langages : nos langages s'excluent les uns les autres; dans une société divisée (par la classe sociale, l'argent, l'origine scolaire), le langage lui-même divise. Quelle portion de langage, moi, intellectuel, puis-je partager avec un vendeur des Nouvelles Galeries ?
Sans doute, si nous sommes tous les deux français, le langage de la communication ; mais cette part est infime : nous pouvons échanger des informations et des truismes ; mais le reste, c'est-à-dire l'immense volume, le jeu entier du langage ? Comme il n'y a pas de sujet hors du langage, comme le langage, c'est ce qui constitue le sujet de part en part, la séparation des langages est un deuil permanent ; et ce deuil, il ne se produit pas seulement lorsque nous sortons de notre « milieu » (là où tout le monde parle le même langage), ce n'est pas seulement le contact matériel d'autres hommes, issus d'autres milieux, d'autres professions, qui nous déchire, c'est précisément cette « culture » que, en bonne démocratie, nous sommes censés avoir tous en commun : c'est au moment même où, sous l'effet de déterminations apparemment techniques, la culture semble s'unifier (illusion que reproduit assez bêtement l'expression « culture de masse »), c'est alors que la division des langages culturels est portée à son comble. Passez une simple soirée à votre poste de télévision (pour nous en tenir aux formes les plus communes de la culture) ; vous y recevrez, en dépit des efforts d'aplatissement général entrepris par les réalisateurs, plusieurs langages différents, dont il est impossible qu'ils répondent tous non seulement å votre désir (j'emploie ce mot au sens fort), mais même à votre intellection : il y a toujours dans la culture une portion de langage que l'autre (donc moi) ne comprend pas ; mon voisin juge ennuyeux ce concerto de Brahms et moi je juge vulgaire ce sketch de variétés, imbécile ce feuilleton sentimental : l'ennui, la vulgarité, la bêtise sont les noms divers de la sécession des langages.
Le résultat est que cette sécession ne sépare pas seulement les hommes entre eux, mais chaque homme, chaque individu est en lui-même déchiré ; en moi, chaque jour, s'accumulent, sans communiquer, plusieurs langages isolés : je suis fractionné, coupé, éparpillé (ce qui, ailleurs, passerait pour la définition même de la «folie»). Et, quand bien même je réussirais, moi, à parler le même langage toute la journée, combien de langages différents je suis obligé de recevoir ! Celui de mes collègues, de mon facteur, de mes étudiants, du commentateur sportif de la radio, de l'auteur classique que je lis le soir : c'est une illusion de linguiste que de considérer à égalité la langue que l'on parle et celle que l'on écoute, comme si c'était la même langue ; il faudrait ici reprendre la distinction fondamentale, proposée par Jakobson, entre la grammaire active et la grammaire passive : la première est monotone, la seconde est hétéroclite, voilà la vérité du langage culturel ; dans une société divisée, même s'il parvient à unifier son langage, chaque homme se débat contre l'éclatement de l'écoute : sous couvert de cette culture totale qui lui est institutionnellement proposée, c'est, chaque jour, la division schizophrénique du sujet qui lui est imposée ; la culture est d'une certaine façon le champ pathologique par excellence, où s'inscrit l'aliénation de l'homme contemporain (bon mot, à la fois social et mental).
Ainsi, semble-t-il, ce qui est recherché par chaque classe sociale, ce n'est pas la possession de la culture (soit qu'on veuille la conserver, soit qu'on veuille l'obtenir), car la culture est là, partout et à tout le monde ; c'est l'unité des langages, la coïncidence de la parole et de l'écoute. Comment donc aujourd'hui, dans notre société occidentale, divisée dans ses langages et unifiée dans sa culture, comment les classes sociales, celles que le marxisme et la sociologie nous ont appris à reconnaître, comment regardent-elles vers le langage de l'Autre ? Quel est le jeu d'interlocution (hélas, fort décevant) dans lequel, historiquement, elles sont prises ?
La bourgeoisie détient en principe toute la culture, mais depuis déjà longtemps (je parle pour la France) elle n'a plus de voix culturelle propre. Depuis quand ? Depuis que ses intellectuels, ses écrivains l'ont lâchée ; l'affaire Dreyfus semble avoir été dans notre pays la secousse fondatrice de ce détachement ; c'est d'ailleurs le moment où le mot «intellectuel» apparaît : l'intellectuel est le clerc qui essaie de rompre avec la bonne conscience de sa classe sinon d'origine (qu'un écrivain soit individuellement sorti de la classe laborieuse ne change rien au problème), du moins de consommation. Ici, aujourd'hui, rien ne s'invente : le bourgeois (propriétaire, patron, cadre, haut fonctionnaire) n'accède plus au langage de la recherche intellectuelle, littéraire, artistique, parce que ce langage le conteste ; il démissionne en faveur de la culture de masse ; ses enfants ne lisent plus Proust, n'écoutent plus Chopin, mais à la rigueur Boris Vian, la pop music. Cependant, l'intellectuel qui le menace n'en est pas plus triomphant pour cela ; il a beau se poser en représentant, en procureur du prolétariat, en oblat de la cause socialiste, sa critique de la culture bourgeoise ne peut emprunter que l'ancien langage de la bourgeoisie, qui lui est transmis par l'enseignement universitaire : l'idée de contestation devient elle-même une idée bourgeoise; le public des écrivains intellectuels a pu se déplacer (encore que ce ne soit nullement le prolétariat qui les lise), non le langage ; certes l'intelligentsia cherche à inventer des langages nouveaux, mais ces langages restent enfermés : rien n'est changé à l'interlocution sociale.
Le prolétariat (les producteurs) n'a aucune culture propre ; dans les pays dits développés, son langage est celui de la petite-bourgeoisie, parce que c'est le langage qui lui est offert par les communications de masse (grande presse, radio, télévision) : la culture de masse est petite-bourgeoise. Des trois classes typiques, c'est aujourd'hui la classe intermédiaire, parce que c'est peut-être le siècle de sa promotion historique, qui cherche le plus à élaborer une culture originale, en ceci qu'elle serait sa culture: il est incontestable qu'un travail important se fait au niveau de la culture dite de masse (c'est-à-dire de la culture petite-bourgeoise) - ce pour quoi il serait ridicule de le bouder. Mais selon quelles voies ?
Par les voies déjà connues de la culture bourgeoise: c'est en prenant et en dégradant les modèles (les patterns) du langage bourgeois (ses récits, ses types de raisonnement, ses valeurs psychologiques) que la culture petite-bourgeoise se fait et s'implante. L'idée de dégradation peut paraître morale, issue d'un bourgeois qui regrette l'excellence de la culture passée; je lui donne, tout au contraire, un contenu objectif, structural : il y a dégradation parce qu'il n'y a pas invention; les modèles sont répétés sur place, aplatis, en ceci que la culture petite-bourgeoise (censurée par l'État) exclut jusqu'à la contestation que l'intellectuel peut apporter å la culture bourgeoise : c'est l'immobilité, la soumission aux stéréotypes (la conversion des messages en stéréotypes) qui définit la dégradation. On peut dire que, dans la culture petite-bourgeoise, dans la culture de masse, c'est la culture bourgeoise qui revient sur la scène de l'Histoire, mais comme une farce (on connaît cette image de Marx).
Un jeu de furet semble ainsi régler la guerre culturelle: les langages sont bien séparés, comme les partenaires du jeu, assis à côté les uns des autres ; mais ce qui passe, ce qui fuit, c'est toujours le même anneau, la même culture: immobilité tragique de la culture, séparation dramatique des langages, telle est la double aliénation de notre société.
Peut-on faire confiance au socialisme pour défaire cette contradiction, à la fois pour fluidifier, pluraliser la culture, et pour mettre fin à la guerre des sens, à l'exclusion des langages ? Il le faut bien ; quel espoir autrement ? Sans s'aveugler cependant devant la menace d'un nouvel ennemi qui guette toutes les sociétés modernes. Il semble bien en effet qu'un nouvel être historique soit apparu, se soit installé et se développe outrageusement, qui complique (sans la périmer) l'analyse marxiste (depuis que Marx et Lénine l'ont établie) : cette nouvelle figure est l'État (c'était là, d'ailleurs, le point énigmatique de la science marxiste) : l'appareil étatique est plus coriace que les révolutions - et la culture dite de masse est l'expression directe de cet étatisme : en France, actuellement, par exemple, l'État veut bien lâcher l'Université, s'en désintéresser, la concéder aux communistes et aux contestataires, car il sait bien que ce n'est pas là que se fait la culture conquérante ; mais pour rien au monde il ne se dessaisira de la Télévision, de la Radio ; en possédant ces voies de culture, c'est la culture réelle qu'il régente, et, en la régentant, il en fait sa culture : culture au sein de laquelle sont obligées de se rejoindre la classe intellectuellement démissionnaire (la bourgeoisie), la classe promotionnelle (la petite-bourgeoisie) et la classe muette (le prolétariat)...."
(La division des langages)
"Notre culture est-elle divisée ? Nullement ; tout le monde, dans notre France d'aujourd'hui, peut comprendre une émission de télévision, un article de France-Soir, l'ordonnance d'un repas de fête ; bien plus, on peut dire que, à part un petit groupe d'intellectuels, tout le monde consomme ces produits culturels : la participation objective est totale; et, si l'on définissait la culture d'une société par la circulation des symboles. qui s'y accomplit, notre culture apparaîtrait aussi homogène et cimentée que celle d'une petite société ethnographique. La différence, c'est que c'est seulement la consommation qui est générale dans notre culture, non la production : nous comprenons tous ce que nous écoutons en commun, mais nous ne parlons pas tous cela même que nous écoutons ; les « goûts » sont divisés, parfois même opposés d'une façon inexpiable : j'aime cette émission de musique classique qui insupporte à mon voisin, cependant que je ne puis supporter les comédies de boulevard qu'il adore; chacun de nous ouvre son poste au moment où l'autre le ferme. Autrement dit, cette culture de notre temps, qui paraît si générale, si paisible, si communautaire, repose sur la division de deux activités de langage : d'un côté l'écoute, nationale, ou, si l'on préfère, les actes d'intellection ; de l'autre, sinon la parole, tout au moins la participation créative, et, pour être plus précis encore, le langage du désir, qui, lui, reste divisé : j'écoute d'un côté, j'aime (ou je n'aime pas) de l'autre : je comprends et je m'ennuie : à l''unité de la culture de masse répond dans notre société une division non seulement des langages, mais du langage lui-même. Certains linguistes - ne s'occupant cependant par statut que de la langue et non du discours - ont eu le pressentiment de cette situation : ils ont suggéré - sans être suivis jusqu'à présent - que l'on distingue franchement deux grammaires : une grammaire active ou grammaire de la langue en tant qu'elle est parlée, émise, produite, et une grammaire passive ou grammaire de la simple écoute. Portée, par une mutation translinguistique, au niveau du discours, cette division rendrait bien compte du paradoxe de notre culture, unitaire par son code d'écoute (de consommation), fragmentée par ses codes de production, de désir : la « paix culturelle » (aucun conflit apparent au niveau de la culture) renvoie ã la division (sociale) des langages.
Scientifiquement, cette division a été jusqu'ici quelque peu censurée. Certes, les linguistes savent qu'un idiome national (le français par exemple) comprend un certain nombre d'espèces; mais la spécification qui a été étudiée, c'est la spécification géographique (dialectes, patois, parlers), non la spécification sociale ; sans doute on la postule, mais en la minimisant, en la réduisant à des « manières » de s'exprimer (argots, jargons, sabirs); et de toute manière, pense-t-on, l'unité idiomatique se reconstitue au niveau du locuteur, pourvu d'un langage à lui, d'une constante individuelle de parole, qu'on appelle un idiolecte : les espèces de langage ne seraient que des états intermédiaires, flottants, « amusants » (relevant d'une sorte de folklore social).
Cette construction, qui prend son origine au XIXe siècle, correspond bien à une certaine idéologie - dont n'était pas exempt Saussure lui-même - qui met d'un côté la société (l'idiome, la langue) et de l'autre l'individu (l'idiolecte, le style) ; entre ces deux pôles, les tensions ne peuvent être que « psychologiques » : l'individu est censé lutter pour faire reconnaître son langage -- ou pour ne pas être complètement étouffé sous le langage des autres.
Encore la sociologie de cette époque n'a-t-elle pu saisir le conflit au niveau du langage : Saussure était plus sociologue que Durkheim n'était linguiste. C'est la littérature qui a pressenti la division des langages (restat-elle psychologique), plus que la sociologie (on ne s'en étonnera pas : la littérature contient tous les savoirs, il est vrai dans un état non scientifique : c'est une Mathèsis).
Le roman, dès lors qu'il est devenu réaliste, a fatalement rencontré sur son chemin la copie des langages collectifs ; mais en général l'imitation des langages de groupe (des langages socio-professionnels) a été déléguée par nos romanciers à des personnages secondaires, à des comparses, chargés de « fixer » le réalisme social, cependant que le héros continue de parler un langage intemporel, dont la « transparence » et la neutralité sont censées s'accorder à l'universalité psychologique de l'âme humaine. Balzac, par exemple, a une conscience aiguë des langages sociaux ; mais, quand il les reproduit, il les encadre, un peu comme des morceaux de bravoure, des pièces emphatiquement rapportées ; il les marque d'un indice pittoresque, folklorique ; ce sont des caricatures de langages : ainsi du jargon de M. de Nucingen, dont le phonétisme est scrupuleusement reproduit, ou du langage-concierge de Mme Cibot, la portière du Cousin Pons; il y a cependant chez Balzac une autre mimèsis du langage, plus intéressante, d'abord parce qu'elle est plus naïve, ensuite parce qu'elle est plus culturelle que sociale : c'est celle des codes d'opinion courante que Balzac reprend souvent à son compte, lorsqu'il commente lui-même incidemment l'histoire qu'il raconte: si par exemple Balzac fait passer dans l'anecdote la silhouette de Brantôme (dans Sur Catherine de Médicis), Brantôme parlera de femmes, exactement comme l'opinion commune (la doxa) attend de Brantôme qu'il honore son « rôle » culturel de « spécialiste » des histoires de femmes - sans qu'on puisse jurer, hélas, que Balzac lui-même soit bien conscient de sa propre démarche : car il croit reproduire le langage de Brantôme, alors qu'en fait il ne copie que la copie (culturelle) de ce langage. Ce soupçon de naïveté (certains diront : de vulgarité), on ne peut le porter sur Flaubert ; celui-là ne se laisse pas aller à reproduire de simples tics (phonétiques, lexicaux, syntaxiques) ; il essaie de prendre dans l'imitation des valeurs de langage plus subtiles et plus diffuses, et de saisir ce que l'on pourrait appeler des figures de discours ..."
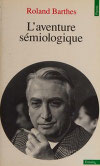
"L'Aventure sémiologique" (1985) n'est pas un livre écrit comme un essai unique par Barthes, mais un recueil d'articles écrits entre 1964 et 1974, rassemblés et publiés après sa mort.
Il constitue une rétrospective de son travail en sémiologie (science des signes) et marque à la fois un aboutissement et un tournant dans sa pensée.
Le titre est très bien choisi : il s'agit bien du récit d'une "aventure" intellectuelle, celle de Barthes lui-même qui, après avoir été un ardent défenseur de l'analyse structuraliste des mythes et des récits, en explore les limites et s'en émancipe pour ouvrir la voie à ce qu'on appellera le post-structuralisme.
Le livre peut se diviser en plusieurs mouvements ou thèmes centraux :
1. La Sémiologie comme Science des Signes
L'héritage de Saussure : Barthes part du projet de Ferdinand de Saussure, qui appelait de ses vœux une "science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale" : la sémiologie.
Un objectif ambitieux : Il s'agit d'appliquer les outils de la linguistique (l'étude du langage) à tous les systèmes de signes de la culture : le vêtement, la nourriture, le mobilier, les rites, les images, les objets publicitaires, etc. L'idée est de révéler les "grammaires" cachées qui structurent notre vie quotidienne.
2. Le Décryptage des Mythologies
L'idéologie naturalisée : C'est le cœur de la première partie de l'ouvrage. Barthes développe sa théorie du mythe comme système de communication ou "parole volée".
Le processus de dénaturalisation : Le mythe ne nie pas les choses, son rôle est de les parler, de les transformer en discours pour leur donner une signification idéologique. Il fonctionne sur deux niveaux :
- Le signe de premier niveau (ex. : une photo d'un soldat noir français saluant le drapeau tricolore).
- Le signe de second niveau : Ce premier signe devient à son tour le signifiant d'un nouveau signifié : l'idéologie de l'impérialisme français ("la France est un empire grand et indiscutable, tous ses fils servent sous son drapeau"). Le mythe dépolitisise et fait passer une construction culturelle et historique pour une évidence naturelle.
3. La Narration et les Codes du Récit
Une "langue" du récit : Barthes cherche à établir une grammaire structurale des récits. Il postule que tous les récits du monde (des contes populaires aux romans modernes) partagent une structure commune.
L'analyse logique des fonctions : Il s'inspire des formalistes russes et de Propp pour décomposer le récit en unités de fonction (noyaux et catalyses) et d'indices.
L'apogée de cette méthode : *S/Z* (1970) est longuement évoqué. C'est ici que l'"aventure" prend un tournant. Au lieu de chercher une structure unique pour tous les récits, Barthes analyse un seul texte (Sarrasine de Balzac) en le déployant à l'infini à travers cinq codes de lecture (code d'action, code herméneutique, code culturel, etc.). Cela marque le passage de la recherche d'une structure unique à la célébration de la pluralité des sens.
4. Le Tournant et l'Émancipation (La "Sortie" de la Sémiologie)
C'est le sens profond du titre Aventure. Barthes raconte comment il a dépassé le projet structuraliste initial.
De la Science à la Jouissance : Il passe d'une sémiologie qui voulait être une science objective à une théorie du texte et de la lecture comme pratique de jouissance.
La Mort de l'Auteur et la Naissance du Lecteur : Le sens n'est plus enfermé dans une structure objective ou dans l'intention de l'auteur. Il est produit par le lecteur. Le texte devient un "tissu de citations", un espace de jeu et de production infinie de sens (c'est le concept d'intertextualité, qu'il emprunte à Julia Kristeva).
Le Plaisir du Texte : La sémiologie ne sert plus à "décrypter" froidement, mais à explorer les affects que le texte produit sur le corps du lecteur (plaisir vs jouissance).
L'Aventure sémiologique est le récit autobiographique d'une pensée en mouvement. Barthes y retrace :
- L'enthousiasme pour un projet scientifique nouveau : appliquer la linguistique à tous les phénomènes culturels.
- La mise en pratique de cette méthode avec les Mythologies et l'analyse structurale des récits.
- La prise de conscience des limites de cette approche trop systématique.
- L'émancipation vers une pensée plus libre, plus subjective, plus éclatée, qui aboutira à ses œuvres ultimes (Fragments d'un discours amoureux, La Chambre claire).
En résumé, ce livre est la carte d'un territoire intellectuel que Barthes a lui-même exploré, cartographié, puis finalement quitté pour aller vers de nouveaux horizons. C'est un texte essentiel pour comprendre l'évolution de la pensée française du structuralisme au post-structuralisme.
