- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

The Globalization of Literature - The Global Novel - Murakami Haruki (1949), "A Wild Sheep Chase" (Hitsuji o meguru bōken, 1982), "The Wind-Up Bird Chronicle"
(Nejimaki-dori kuronikuru, 1994), "Kafka on the Shore" (Umibe no Kafuka, 2002), "What I Talk About When I Talk About Running" (2007, Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto),
"1Q84" (Ichi-kyū-hachi-yon , trois tomes, 2009-2010), "Men Without Women" (Onna no inai otokotachi, 2014) - Yôko Ogawa (1962) - Adam Kirsch (1976) - ...
Last update : 2019/11/11

Entre un Murakami Haruki qui pourrait écrire qu'un écrivain mondialisé n’est pas celui qui plaît à tous, mais celui que tous croient comprendre, et un Emil Cioran qui a pu écrire qu'il n'avait pas de patrie, mais que celle-ci était la langue dans laquelle il écrivait, - et ne visait pas à être compris par tous -, deux époques, que partage une littérature devenue "mondialisée" ...
La mondialisation a influencé profondément la littérature, et si elle n'a pas abouti pour autant à une littérature mondialisée uniforme, elle favorise de bien singulières hybridations sans véritablement renouveler le fonds littéraire que nous avons amassé au cours des quelques siècles que quelques milliers d'écrivain ont parcouru ...
C'est par sa réussite médiatique et ses prouesses économiques que se définit la littérature mondialisée : elle est lisible partout sans être réductible à un pays (une circulation accrue des œuvres), son univers reste personnel tout en épousant des mythes globaux (bien des auteurs ont appris à jouer avec leur multiculturalisme), et la trame narrative parvient à être globale sans être générique. Des romans comme "L'Alchimiste" (Coelho) ou "Da Vinci Code" (Brown) adoptent des schémas universels simplifiés pour toucher un maximum de marchés (la standardisation des récits). Un auteur comme Haruki Murakami écrit des romans japonais d’abord pensés pour une traduction anglaise (dominance de l'anglais). Et bien des romans se déroulent dans des villes interchangeables (New York, Tokyo, Londres) avec des personnages déracinés ("Tokyo Cancelled" de Rana Dasgupta). Un cosmopolitisme urbain et des réoccupations universelles ...
Certains artistes revendiquaient une appartenance nationale comme socle de leur création (les Romantiques allemands, Mishima et le Japon impérial). La culture nationale (mythes, histoire, langue) pouvait nourrir une œuvre (James Joyce et l’Irlande, Gabriel García Márquez et l’Amérique latine). D'autres créateurs refusaient toute allégeance nationale, préférant une posture cosmopolite (Beckett, Nabokov) ou décoloniale (Aimé Césaire). L’art pouvait aussi être un outil de résistance contre le nationalisme (Kenzaburō Ōe critiquant l’empereur).
L’artiste est face à des institutions nationales et le risque de l’instrumentalisation n'est jamais bien loin (en France, bien des intellectuels ont accepté sans même s'interroger de se rendre à des convocations élyséennes, on se courbe devant le pouvoir parce qu'il est le Pouvoir, fut-il institutionnel). Tous les régimes politiques (dictatures, démocraties) cherchent et ont cherché à récupérer les artistes (tant qu'il en existe encore) pour incarner une "identité nationale" (Wagner enrôlé par les nazis). Certains refusent ce rôle (Pablo Neruda fuyant le Chili de Pinochet). Il est aussi des artistes qui s'exilent et leur œuvre se construit souvent contre ou en dehors de la Nation (Kundera et la Tchécoslovaquie, Rushdie et l’Inde/UK).
L’art peut-il dépasser la Nation ? Est-ce une question sans fondement? Un artiste ancré dans une culture locale peut toucher à l’universel (Tolstoï et la Russie, Frida Kahlo et le Mexique)et aujourd’hui, dans la mouvance du postmodernisme, beaucoup d’artistes revendiquent une identité fluide, hors cadres nationaux ..
Mais au-delà de la Nation, l'espace artistique est par essence un espace planétaire qui touche fondamentalement l'être humain au-delà de toute frontière, le romantisme, l'impressionnisme, le réalisme, le naturalisme ont habité nombre de cultures et nourri nombre d'inspirations...
Vint la mondialisation économique et technologique qui colonise notre monde et qui semble intensifier une homogénéisation tant de nos intuitions que de nos appétences artistiques, l'imaginaire épouse la technologie, l'écriture se mondialise, les thématiques se standardisent, les scènes et les intrigues littéraires ne semblent plus que des quasi entremêlements hallucinés de plusieurs contrées de notre planète Terre, notamment d'Amérique, et d'Asie, d'ouest en est...
Assiste-t-on à un tournant dans l'histoire de la littérature et plus encore à une quasi révolution culturelle, ou n'est-ce au fond qu'un épiphénomène sans conséquence réelle? Ainsi, en ce début du XXIe siècle, le romancier japonais Haruki Murakami aborde notre existence de terrien, non pas en en tant qu'écrivain d'une nation particulière, mais en terrien qui se risquerait par ailleurs à ne pas être totalement de ce monde. Au fond ne sommes-nous pas, nous aussi, tous des œuvres littéraires vivantes? Tout débute par une émotion, an emotional loss sur le chemin de la maturité. "Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart" (Kafka on the Shore), "les souvenirs te réchauffent intérieurement, mais ne te déchirent-ils pas aussi....

Dès le milieu du XXe siècle, la culture occidentale, surtout américaine, s'est répandue sur toute la planète, et ce phénomène s'est considérablement accru à la fin du siècle sous l'égide de la mondialisation économique et technologique, voire politique. La planète Terre ouvre désormais un immense espace culturel commun qui permet aux écrivains et scénaristes de s'affranchir des traditions locales pour destiner leurs œuvres à un lectorat universel, et ce faisant privilégier des thématiques et des formes d'expression largement standardisées, non pas seulement "marchandisables", mais aisément intégrables et diffusables "médiatiquement". La réflexion emblématique de Marshall McLuhan, "the medium is the message", est à restructurer: le contenu du message l'emporte sur la nature du média, et non l'inverse. Mais ce contenu est entièrement tributaire d'un espace d'expression mondialisé, sémantiquement homogène, structuré en profondeur par une intense mondialisation de l'économie et de la technologie. La musique, la télévision, le cinéma ont d'emblée une dimension collective et technologique qui leur donne un ascendant sur la littérature, l'écriture reste artisanale et la lecture une activité solitaire. Internet peut offrir à l'écriture cette passerelle vers la mondialisation, mais les véritables modalités d'expression qu'elle offrirait sont encore loin d'être convaincantes.

Qu'est que la littérature mondialisée (the globalized novel)? Elle est apparue d'une part pour relancer un roman occidental en panne de créativité,
puisant sa matière dans une quasi "science fiction du quotidien", et d'autre part dans la lignée de toute une fiction postcoloniale qui pouvait enfin exprimer sa liberté retrouvée et son
expérience d'un monde ni totalement étranger ni totalement familier. Le roman de Salman Rushdie, Midnight's Children (1981), est un mélange parfait de traditions anglaises et indiennes, tant sur
le plan linguistique que thématique. Orhan Pamuk se partage entre l'Orient, sa terre natale, la Turquie, et l'Occident, et brasse indistinctement des registres culturels les plus divers (Le
Château blanc, 1985, Mon nom est Rouge, 1998). Globalement ces écrivains combinent les traditions narrative et poétique du monde dont ils sont issus et tous les motifs et textures que
composèrent toutes les avant-garde qui ont nourri la littérature occidentale. En retour, le réalisme magique, domaine d'expression des cultures asiatiques et latines en contact frontal avec
l'Occident, a renouvelé l'inspiration de nombre d'auteurs occidentaux. Dans les années 1990, un flot d'écrivains sud-asiatiques travaillant en anglais ont incarné une littérature mondiale très
sophistiquée et branchée, mais l'effet de mode s'est estompé..
Plus que toute autre culture, le Japon, sous influence américaine pendant l'occupation militaire de 1945 à 1952, illustre par l'intermédiaire de quelques
écrivains, cette nouvelle trame thématique qui se met en place dans le monde entier, puise ses références culturelles dans le quotidien américain ou européen, en utilise les codes pour tracer son
propre cheminement intérieur. Parmi eux, Murakami Haruki qui vend des millions de livres à travers le monde, de la Corée du Sud à l'Australie, l'Italie, l'Allemagne et la Chine, les
Etats-Unis ; "Norwegian Wood" s'est vendu à environ 11,16 millions d'exemplaires, y compris en livre de poche, et tous les grands ouvrages de Murakami ont dépassé le seuil du 1 million. Des
livres traduits en 42 langues, et sans doute le tout premier auteur nippon à ne pas être perçu comme un auteur japonais (Norwegian Wood, The Wind-up Bird Chronicle, 1Q84, Kafka on the
Shore)....
Haruki Murakami est un paradoxe vivant de la littérature mondialisée : à la fois archétype du romancier global et échappant à toute catégorisation simple ...
Murakami semble en effet "mondialisé" ...
- par son style délibérément transnational (effacement des codes japonais, "Kafka sur le rivage" (2002) pourrait se dérouler à Berlin ou Chicago).
- des références culturelles globales (Jazz (Charlie Parker), rock (The Beatles), littérature occidentale (Dostoïevski, Chandler),un patrimoine partagé par les élites cosmopolites).
- des mécaniques narratives universelles, des schémas reconnaissables (la Quête initiatique dans "1Q84", le Realism magic "light" dans "La Ballade de l'impossible", des personnages interchangeables (de Jeunes solitaires urbains, sans ancrage national marqué)
- un système éditorial globalisé et parfaitement rodé (des traductions simultanées, "Tuer la Commendatore" (2017) paraît en 50 langues en moins d’un an, - un marketing littéraire parfaitement adapté au "monde", des couvertures épurées ...)
Mais on ne peut parler d’une mondialisation littéraire superficielle ...
- en conservant un "Fond sonore" nippon omniprésent.
- en revendiquant une volonté de rupture avec le "Japon littéraire" traditionnel (il rejette à la fois Mishima (nationalisme) et Kawabata (esthétisme), créant un troisième voie).
- en assumant une hybridation unique, Western forms, Japanese ghosts, hardboiled US et yūrei (fantôme japonais).
- en offrant aux non-Japonais une porte d’entrée vers un Japon fantasmé tout en renvoyant aux Japonais un miroir déformé de leur modernité.

Murakami Haruki (1949)
"When I was in my teens, in the 1960s, that was the age of idealism. We believed the world would get better if we tried. People today don’t believe
that, and I think that’s very sad. People say my books are weird, but beyond the weirdness, there should be a better world. It’s just that we have to experience the weirdness before we get to the
better world. That’s the fundamental structure of my stories: you have to go through the darkness, through the underground, before you get to the light." - Le succès littéraire rencontré par
Murakami Haruki depuis les années 1990 montre à quel point, tout comme lui, s'efface lentement de la société nippone la nécessité de s'enraciner dans les seules valeurs et l'histoire ancestrale
du pays du Soleil-Levant. "Je ne pense pas être particulièrement occidentalisé, pas plus que la plupart de mes lecteurs japonais. Led Zeppelin, California Merlot et Tom Cruise font tous partie de
notre quotidien. En fait, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a un échange d'informations très naturel entre l'Est et l'Ouest, du moins à un niveau superficiel. Ces différents points de vue
nous stimulent de diverses manières" (I don’t think I am particularly Westernized nor do most of my Japanese readers. Led Zeppelin, California Merlot, and Tom Cruise are all part of our daily
lives. As a matter of fact one could say that, today, there’s a very natural exchange of information between the East and West, at least on a superficial level. We are variously stimulated by
these differing points of view). Le monde commençait alors à être parfaitement indéchiffrable pour la plupart de ses futurs lecteurs, l'Union Soviétique devenait la Russie, le mur de Berlin
se fissurait, la société vivait une révolution technologique sans précédent, le Japon s'imbriquait au Monde occidental et celui-ci lui absorbait à satiété sa fameuse "user-friendly
technology". Je ne fais pas partie de la tradition immédiate de la littérature japonaise, ajoute Murakami Haruki , mais je pense qu'une nouvelle tradition, qui m'inclura, va peut-être
émerger, une nouvelle tradition qui englobe le monde, n'est-ce-pas?



"Il n'y a pas qu'une seule réalité" - Murakami Haruki est né juste après la seconde guerre mondiale, à Kyoto, son grand-père était prêtre bouddhiste et son père enseignait la langue et la littérature japonaise. Il a grandi, rappelle-t-il, pendant l'occupation américain, dans la culture américaine, de F Scott Fitzgerald, Truman Capote, Raymond Chandler, Kurt Vonnegut, Raymond Carver aux TV shows et au jazz (il est célèbre pour sa collection de 40 000 disques de jazz), "The Many Sides of Gene Pitney" fut son premier album acquis en 1962, sa passion pour le jazz débuta par un concert d'Art Blakey et des Jazz Messengers (1964). Il ouvre un club de jazz à Tokyo en 1974 et de là s'est forgé progressivement son propre style ("Not Japanese or American style, my style"). Il se trouvait dans les gradins d'un stade de baseball 'Meiji Jingū Stadium) en train de regarder le jeu de batte d'un joueur américain, Dave Hilton, lorsqu'il a soudain réalisé qu'il pouvait écrire un roman ("I never thought of being an author. At least until I was 29 years old"), ce fut "Hear the Wind Sing" et "Pinball, 1973" : "There are wells, deep wells, dug in our hearts". Son personnage principal est un observateur détaché de son environnement par des circonstances qui ne cessent de hanter le récit, placide mais parfois déconcerté, et qu'un évènement extérieur, inexplicable, va entraîner dans un univers parallèle, énigmatique ("You have to go through the darkness before you get to the light"). Mais ici, nulle émotion palpable ("Emotional hurt is the price a person has to pay in order to be independent"), nulle envolée littéraire, l'idée, l'intrigue vont surgir le plus simplement du monde de notre intériorité, sombre par définition, et l'écrivain, se gardant bien de toute analyse, enregistre le factuel, sans autre commentaire, - "I’m not a storyteller. I’m a story watcher" - l'intrigue va suivre son cours sans véritable référence culturelle précise, ou du moins celle du monde dans sa globalité. L'histoire est sortie de quelque obscurité de notre humanité et entraîne autant l'écrivain que le lecteur vers un point géographiquement et historiquement non repérable, l'imagination se libère totalement et les références culturelles du monde entier ne cessent d'émailler le récit, la "Sinfonietta", du compositeur Leoš Janáček ou l'album "Louis Armstrong Plays W.C. Handy" côtoient "À la recherche du temps perdu" de Marcel Proust et " Macbeth" de Shakespeare. Au début des années 90, Murakami a déménagé aux États-Unis, où il a commencé à enseigner à l'Université de Princeton, et de là a regardé sa patrie pour la première fois avec les yeux d'un Européen ("Je suis allé aux États-Unis pendant près de cinq ans, et soudain, vivant là-bas, j'ai eu envie d'écrire sur le Japon et les Japonais. Parfois sur le passé, parfois sur la situation actuelle. C'est plus facile d'écrire sur son pays quand on est loin. De loin, vous pouvez voir votre pays tel qu'il est. Je ne voulais pas vraiment écrire sur le Japon avant. Je voulais juste écrire sur moi-même et sur mon monde..."). En 2001, il est retourné au Japon, où il s'est installé au bord de la mer dans la petite ville d'Oiso. Haruki y vit seul avec sa femme...


Les critiques évoquent, parlant de son oeuvre particulièrement abondante, le "post-modernisme" ou le "réalisme magique". Peu importe, Murakami ne s'intéresse pas tant à la société qui l'environne qu'au fonctionnement de notre cerveau d'humain, le monde est en surface plus étrange qu'on ne pense, mais si l'on veut bien gratter un peu, accepter l'inattendu, l'insolite, voire l'invraisemblable, on en revient avec un drôle de petit sentiment d'accomplissement, sans conséquence, au bout du compte ("Je pense que le travail de l'écrivain est d'extraire un grand et profond drame de la petite vie quotidienne"). Quant à Haruki Murakami lui-même, il n'écrit des romans que lorsqu'il se sent inspiré et prêt à le faire, le reste du temps il le passe à traduire des romans américains, Truman Capote, Jérôme D. Salinger, Francis Scott Fitzgerald, John Irving....

"A Wild Sheep Chase" (Hitsuji o meguru bōken, 1982)
La "Trilogy of the Rat" compte trois romans indépendants, "Hear the Wind Sing" (Kaze no uta o kike, 1979), "Pinball, 1973"
(Sen-kyū-hyaku-nana-jū-san-nen no pinbōru, 1980) et "A Wild Sheep Chase" (1982), avec pour épilogue "Dance Dance Dance" (1988), mais un thème récurrent, celui d'un jeune homme dépressif, en quête
de lui-même, "an outcast of the Japanese literary world", et qui trouve dans l'écriture comme au cours des intrigues qui lui donnent existence, une sorte de thérapie personnelle et de libération
affective, mais une libération qui ne peut se concevoir que dans cet autre monde, celui de l'imagination et du rêve éveillé : au fond, Murakami semble hésiter entre réalisation de soi et abandon
de soi, réel et surréel.
C'est avec "A Wild Sheep Chase" (La Course au mouton sauvage) que Murakami trouve son style, l'intrigue est quant à elle particulièrement difficile à
résumer : narrateur anonyme, le voici quittant son existence trop ordinaire de rédacteur publicitaire, sous la menace d'un puissant dirigeant occulte du Japon en quête d'un mouton possédant une
tache de naissance en forme d'étoile et censé posséder des pouvoirs. En fait, le narrateur n'a fait que reproduire dans un bulletin de la compagnie d'assurance une carte postale envoyée par un
ami, le Rat, et représentant un troupeau de moutons en train de paître dans les montagnes reculées d'Hokkaïdo. Il entraîne dans sa quête du mouton sauvage des personnages qui n'ont pas de nom,
mais des surnoms, sa petite amie, qu'il aime pour ses oreilles et qui semble dotée de pouvoirs, le Professeur Mouton, le père du directeur de l'hôtel dans lequel il séjourne et qui affirme que le
mouton est une sorte d'esprit qui poursuit ses propres objectifs en intégrant le corps de ses victimes, the Sheep Man, le contact de l'ami perdu, ...

"Hard-Boiled Wonderland and the End of the World" (La Fin des Temps)
(Sekai no owari to Hādo-boirudo Wandārando, 1985)
"Two people can sleep in the same bed and still be alone when they close their eyes" -Murakami Haruki, dans un roman à l'imagination foisonnante, inaugure
sa thématique des mondes parallèles, et explore à sa manière la nature même de la conscience occidentale sous les traits d'un processeur de données humaines qui finit par apprendre qu'il n'a plus
que 1½ jours pour exister avant de quitter le monde qu'il connaît pour un endroit qu'il a inventé dans son subconscient. Deux mondes et donc deux histoires parallèles anonymement relatées,
"Hard-Boiled Wonderland", au cours duquel la conscience semble lutter contre le piratage et la destruction, et "The End of the World", dans lequel la conscience a été totalement isolée du reste
du monde et les souvenirs supprimés. Le lecteur est alors entraîné dans un accélérateur de particules narratif dans lequel un processeur de données à cerveau fendu, un savant dérangé qui
entreprend une véritable course contre la montre pour inverser la marche inévitable de la perte d'identité totale, son imperturbable petite-fille, Lauren Bacall, Bob Dylan, et divers personnages
des plus absurdes, voyous, bibliothécaires et monstres souterrains qui tous entrent en collision...
"Pays des merveilles - sans merci - 1 - L’ascenseur – Silence – Rondeurs
L’ascenseur continuait à monter avec une extrême lenteur. Du moins je pensais qu’il montait, mais à vrai dire je n’en savais rien. À une vitesse aussi réduite, toute sensation de direction s’efface : il était peut-être en train de descendre, peut-être même qu’il était arrêté. Simplement, compte tenu des circonstances, j’avais décidé de considérer qu’il montait, par esprit de commodité. Pure hypothèse, sans aucun fondement. Il avait peut-être gravi douze étages avant d’en redescendre trois, ou bien il avait déjà fait une rotation autour de la Terre, je n’en sais rien.
Cet engin n’avait rien à voir avec l’ascenseur bon marché de mon immeuble, plutôt simpliste, du style seau de puits légèrement évolué. Deux appareils comme ceux-là ont tellement peu de points communs que l’imagination a du mal à concevoir qu’ils portent le même nom, possèdent la même structure, et aient été construits dans un but identique. Ces deux ascenseurs étaient vraiment aux antipodes l’un de l’autre, à une distance défiant les limites de la pensée.
Primo, question de largeur. L’ascenseur dans lequel je me trouvais était assez large pour y aménager un petit bureau confortable. Même en y mettant une table, des placards, un secrétaire, et en y installant une kitchenette, il serait sûrement encore resté de la place. Si ça se trouve, on aurait pu y faire entrer trois dromadaires et un palmier de taille moyenne. Secundo, question de propreté. Celui-ci était aussi propre qu’un cercueil flambant neuf, avec les murs et le plafond en acier inoxydable immaculé, le sol recouvert d’une épaisse moquette bouclée vert mousse. Tertio, il était mortellement silencieux. Quand j’y étais entré, il n’avait pas fait un bruit – littéralement pas un bruit –, les portes s’étaient refermées en coulissant silencieusement et depuis je n’avais pas entendu un son. À tel point que je ne savais plus s’il progressait ou non. Comme le courant calme et profond d’un fleuve…
Encore une chose : il y manquait la majorité des accessoires dont un ascenseur est normalement pourvu. On notait d’abord l’absence de tout panneau regroupant les divers boutons et interrupteurs. Pas non plus de boutons indiquant les étages, ni de boutons pour l’ouverture et la fermeture des portes, pas de manette d’arrêt d’urgence. Rien du tout, en somme. Je commençais à me sentir plutôt sans défense. Et ce n’était pas qu’une question de boutons : il n’y avait pas non plus de signal lumineux pour indiquer les étages, pas la moindre mise en garde ou limitation du nombre de personnes, même pas une plaque dans un coin pour mentionner le nom du constructeur. Et où se trouvait l’issue de secours ? Mystère. Pas de doute, c’était un véritable cercueil. J’avais beau y réfléchir, je ne comprenais pas comment la compagnie de lutte contre les incendies avait pu donner son accord à la construction d’un ascenseur pareil. Il devait quand même bien y avoir une réglementation sur les ascenseurs ! À force de fixer ces quatre murs d’acier impeccablement lisses, je finis par repenser à Houdini, ce grand illusionniste que j’avais vu en film quand j’étais gamin. Complètement ficelé de cordes et de chaînes, il se faisait enfermer dans une malle entourée elle aussi de lourdes chaînes bien serrées, qui était ensuite jetée d’en haut des chutes du Niagara, ou enfouie dans les glaces de la mer du Nord. Je respirai une fois à fond, lentement, puis essayai de comparer calmement ma situation avec celle de Houdini. Avantage : je n’étais pas attaché, mais, d’un autre côté, je ne connaissais pas les trucages, et ça, c’était plutôt à mon détriment.
En y réfléchissant, les trucages, je n’étais pas près de les découvrir : déjà, je ne savais pas si l’ascenseur marchait ou non. Je toussai une fois, histoire de faire une tentative. Le résultat fut un peu bizarre. Cette toux ne résonnait pas comme une toux, elle rendait un drôle de son mat comme de la glaise molle projetée sur un mur de béton complètement lisse. Je n’arrivais pas à croire que c’était moi qui avais émis ce bruit. Je toussai encore une fois pour vérifier, ça donna le même résultat. Je laissai tomber, et m’arrêtai de tousser.
Je restai debout comme ça dans la même position, pendant un temps relativement long. Les portes ne s’ouvraient toujours pas. Moi et l’ascenseur on était là, silencieusement arrêtés, comme une nature morte intitulée L’Homme et l’Ascenseur. Je commençais à me sentir un peu inquiet.
L’engin était peut-être en panne, ou alors le conducteur de l’ascenseur – en supposant qu’il y ait un personnage remplissant ce rôle – avait peut-être complètement oublié ma présence à l’intérieur de sa boîte. Il arrive de temps en temps que des gens oublient mon existence. De toute manière, dans un cas comme dans l’autre, le résultat était le même : j’étais enfermé dans une boîte d’acier inoxydable hermétiquement close. J’avais beau tendre l’oreille, aucun son ne me parvenait. Je collai mon oreille contre la paroi d’acier : toujours pareil, pas un bruit. Le seul résultat fut la marque de mon oreille en blanc sur le mur. Comme si cet ascenseur était une boîte de métal spécialement construite de façon à absorber le moindre son..." (Traduit du japonais par Corinne Atlan et préfacé par Alain Jouffroy, Seuil)
"Hard-Boiled Wonderland and the End of the World" ( traduit en français sous le titre "La Fin des Temps") est considéré comme une œuvre majeure et un tour de force narratif. C'est l'un des livres où la structure est la plus audacieuse et la plus représentative de son style.
L'histoire alterne entre deux mondes apparemment sans lien,
- « Hard-Boiled Wonderland » (L'Incoulable) : Un Tokyo futuriste et cyberpunk où le narrateur, un "calculeur" de données, est impliqué dans un complot étrange. C'est le côté "polar" et science-fiction.
- « The End of the World » (La Fin du Monde) : Une ville paisible et onirique, entourée d'un mur infranchissable, où le narrateur est arrivé récemment et doit devenir le "Lecteur de rêves" des licornes. C'est le côté "conte philosophique".
Murakami mélange ici le cyberpunk, le polar, la science-fiction et la fantasy onirique avec une maestria déconcertante. C'est un exemple parfait de sa capacité à transcender les catégories littéraires.
Le génie du livre réside dans la manière dont ces deux récits finissent par converger pour explorer des questions profondes sur la nature de la conscience, de l'âme et de la mémoire. La "fin du monde" n'est pas ce que l'on croit.
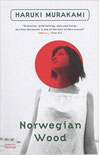
"Norwegian Wood" (1987, Noruwei no mori, La Ballade de l'impossible)
"I was always hungry for love. Just once, I wanted to know what it was like to get my fill of it—to be fed so much love I couldn’t take any more..." - C'est
en Italie et en Grèce que Murakami a écrit ce roman, réaliste, qui lui a valu une renommée mondiale en son temps. "I’m not really interested in writing novels about realism, but Norwegian Wood is
a novel of 100 percent pure realism. I wanted to experiment. I thought it was time to try another genre. And the result was that it sold. I started writing it on a whim, and I didn’t expect it to
become a bestseller, so I was surprised. I personally love this work, but looking at it objectively, I think it is an anomaly among my works. "
"Norwegian Wood" est le roman qui a propulsé Murakami au statut de superstar au Japon, et son œuvre la plus accessible et réaliste. C'est une porte d'entrée parfaite pour son univers.
Contrairement à la plupart de ses autres romans, "Norwegian Wood" contient très peu d'éléments magiques ou surnaturels. C'est une histoire d'amour, de deuil et de nostalgie, racontée avec une simplicité et une mélancolie déchirantes. La chanson des Beatles, "Norwegian Wood", donne son titre au livre et imprègne l'atmosphère de tout le récit. La musique est un personnage à part entière.
Le roman saisit l'esprit d'une jeunesse japonaise des années 60, tiraillée entre les traditions et les mouvements étudiants radicaux, et confrontée à la perte et à la désillusion...
Toru Watanabe se laisse envahir par la nostalgie en écoutant une chanson des Beatles, "Norwegian Wood", se remémore ses dix-huit ans, lorsque, étudiant, son meilleur ami, Kizuki, se suicide et laisse esseulée son amie, Naoko. Toru, en s'efforçant de soutenir Naoko, finit par tomber désespérément amoureux d'elle. Mais la mort de Kizuki (''Death is not the opposite of life but an innate part of life'') a précipité le jeune femme dans la dépression, la voici cherchant de l'aide auprès d'un établissement psychiatrique, tandis que Toru ne cesse de lui rendre visite. Uun début d'intimité se crée entre Toru et Naoko, par le biais de Reiko, co-locataire de la jeune femme. Mais Toru, entre-temps rencontre Midori, une jeune femme aux antipodes de Naoko, et s'ouvre à elle de son histoire d'amour. Les conséquences s'enchaînent, l'état mental de Naoko s'aggrave, Midori rompt toute relation avec Toru, Naoko se suicide. Toru semble avoir tout perdu. Reiko lui redonne goût à la vie. Roman commercial, dira-t-on, mais roman culte d'une génération, qui se vendra à plus de 4 millions d'exemplaires au Japon, 2.5 millions aux USA...

"The Wind-Up Bird Chronicle" (Nejimaki-dori kuronikuru, 1994)
"I realize full well how hard it must be to go on living alone in a place from which someone has left you, but there is nothing so cruel in this world as
the desolation of having nothing to hope for" - "The Wind-Up Bird Chronicle" (Chroniques de l'oiseau à ressort, Seuil), écrit alors que Murakami enseignait à Princeton et à Tufts, est à
la fois roman policier et épopée existentielle de 600 pages d'un mariage qui se désintègre, avec pour toile de fond une banlieue de Tokyo, et pour personnage principal, un jeune homme, Toru
Okada, qui cherche le chat disparu de sa femme, Kumiko Okada, et se retrouve en quête de sa femme elle-même, plongeant dans un monde souterrain ignoré de Tokyo. Okada va rencontrer au gré de son
périple une prostituée psychique, un politicien malveillant et médiocre, une adolescente morbide et un ancien combattant vieillissant qui ne s'est jamais remis de ses campagnes en Mandchourie,
les mille et une facettes d'un monde en partie occulté par la "réalité"...
La Chronique de l'Oiseau à ressort (1994-1995) est le roman le plus ambitieux et le plus politique de Murakami. C'est une œuvre-monstre, à la fois thriller, méditation historique et voyage onirique.
Une plongée dans l'histoire japonaise : Le livre s'mpare du thème du traumatisme de la guerre, en particulier l'incident de Nomonhan (1939) entre le Japon et l'URSS, un sujet encore tabou. Murakami y confronte la mémoire collective refoulée du pays. C'est l'un de ses romans les plus sombres, où la cruauté humaine est décrite avec une froideur et une précision troublantes. Le héros, Toru Okada, descend littéralement et métaphoriquement au fond de lui-même pour affronter ses démons, dans des séquences oniriques d'une intensité rare ...
"When the phone rang I was in the kitchen, boiling a potful of spaghetti and whistling along with an FM broadcast of the overture to Rossini’s The Thieving Magpie, which has to be the perfect music for cooking pasta.
I wanted to ignore the phone, not only because the spaghetti was nearly done, but because Claudio Abbado was bringing the London Symphony to its musical climax. Finally, though, I had to give in. It could have been somebody with news of a job opening. I lowered the flame, went to the living room, and picked up the receiver.
“Ten minutes, please,” said a woman on the other end.
I’m good at recognizing people’s voices, but this was not one I knew.
“Excuse me? To whom did you wish to speak?”
“To you, of course. Ten minutes, please. That’s all we need to understand each other.” Her voice was low and soft but otherwise nondescript.
“Understand each other?”
“Each other’s feelings.”
I leaned over and peeked through the kitchen door. The spaghetti pot was steaming nicely, and Claudio Abbado was still conducting The Thieving Magpie.
“Sorry, but you caught me in the middle of making spaghetti. Can I ask you to call back later?”
“Spaghetti? What are you doing cooking spaghetti at ten-thirty in the morning?”
“That’s none of your business,” I said. “I decide what I eat and when I eat it.”
“True enough. I’ll call back,” she said, her voice now flat and expressionless. A little change in mood can do amazing things to the tone of a person’s voice...."
"1 - Le mardi de l’oiseau à ressort ; six doigts et quatre seins
J’ÉTAIS DEBOUT DANS LA CUISINE, en train de me faire cuire des spaghettis, et je sifflotais en même temps que la radio le prélude de La Pie voleuse de Rossini, musique on ne peut plus appropriée à la cuisson des pâtes, lorsque cette femme me téléphona.
Je fus d’abord tenté d’ignorer la sonnerie et de continuer à préparer tranquillement mes spaghettis. Ils étaient presque prêts, Claudio Abbado et l’orchestre symphonique de Londres étaient en plein crescendo. Réflexion faite, je baissai le gaz, me rendis au salon et décrochai le combiné. On ne sait jamais, ça pouvait être un ami qui m’appelait pour me proposer un job.
— Accorde-moi dix minutes, lança une voix de femme tout à trac.
Je reconnais une voix à coup sûr, quand elle appartient à quelqu’un que j’ai déjà rencontré. Et celle-là, je ne l’avais jamais entendue.
— Excusez-moi, répliquai-je le plus poliment du monde, mais à qui désirez-vous parler ?
— À toi, bien sûr, dit la femme. Je te demande seulement dix minutes de ton temps. Ça nous permettra de mieux nous comprendre.
Elle avait une voix basse, douce, et indéfinissable, au débit rapide et déterminé.
— Nous comprendre ?
— Émotionnellement parlant, répondit-elle succinctement.
Je passai la tête par la porte que j’avais laissée ouverte, pour jeter un coup d’œil dans la cuisine. Une vapeur blanche de bon aloi s’élevait de la casserole, et Abbado conduisait toujours La Pie voleuse de main de maître.
— Écoutez, excusez-moi, mais je suis en train de faire cuire des spaghettis, ils sont presque prêts, et si je parle dix minutes avec vous, ils seront fichus. Est-ce que je peux raccrocher maintenant ?
— Des spaghettis ? s’exclama la femme d’un ton stupéfait. Mais il est dix heures du matin ! Pourquoi fais-tu cuire des spaghettis à une heure pareille ? C’est un peu bizarre, non ?
— Bizarre ou pas, ça ne vous regarde pas. J’ai sauté le petit déjeuner et maintenant j’ai faim. Donc je me fais ces spaghettis dans l’intention de les manger. J’ai le droit de manger ce que je veux à l’heure que je veux, non ?
— Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Bon, eh bien, je raccroche alors, dit la femme d’une voix sirupeuse. (Une voix étrange. Au moindre changement émotionnel, son ton s’altérait du tout au tout, comme si on avait tourné un bouton de fréquence.) Je te rappellerai une autre fois.
— Attendez, dis-je très vite. Si vous essayez de me vendre quelque chose, vous aurez beau rappeler dix fois, le résultat sera le même : je suis au chômage, je n’ai pas les moyens d’acheter quoi que ce soit.
— Je suis au courant, ne t’en fais pas, dit la femme.
— Au courant ? ! Au courant de quoi ?
— Mais que tu es au chômage, voyons ! Je le sais. Bon, si tu retournais à tes spaghettis ?
— Mais qui diable… ?
J’avais à peine commencé ma phrase que la communication fut brutalement coupée.
Interloqué, les émotions se bousculant dans ma tête, je restai un moment à regarder le combiné dans ma main d’un air hébété. Je finis par me rappeler les spaghettis, raccrochai le téléphone et retournai à la cuisine. J’éteignis le gaz, égouttai les pâtes dans une passoire. À cause de cet absurde coup de fil, elles n’étaient plus al dente, mais ce n’était pas fatal.
« Mieux nous comprendre ? » En dix minutes ?
Je repensai à tout ça en mangeant mes pâtes.
Que voulait donc dire cette femme ? Il s’agissait peut-être d’une blague au téléphone ? Ou d’une nouvelle technique de vente ? De toute façon, ça ne me concernait pas.
Je m’installai sur le canapé du salon avec un roman emprunté à la bibliothèque du quartier, mais, tout en lisant, je me mis à jeter de temps en temps de petits coups d’œil en direction du téléphone. Je me demandais, de plus en plus intrigué, ce qu’elle avait bien pu vouloir dire avec son « seulement dix minutes ». Qu’est-ce qu’on pouvait bien « comprendre l’un de l’autre » en dix minutes ? ..." (Traduit du japonais par Corinne Atlan avec Karine Chesneau)

"Underground" (1997, Andāguraundo)
"I’ve found that in this gigantic capitalist society, it is difficult to be an individual' - L'impensable s'est produit le lundi 20 mars 1995 lorsque
cinq membres du culte religieux Aum Shinrikyo ont mené une guerre chimique dans le métro de Tokyo en utilisant du sarin, un gaz toxique vingt-six fois plus dangereux que le cyanure. Un grand
réseau de transport urbain était devenu la cible d'une attaque terroriste. Haruki Murakami décide de comprendre le pourquoi de cette action et se livre à nombre d'entretiens avec des personnes
qui ont vécu la catastrophe, un employé de la Subway Authority coupable d'avoir survécu, un vendeur de mode qui met en cause les médias, un jeune adepte qui, s'il condamne l'attaque, reste fidèle
à Aum. S'il parvient à mettre en lumière bien des aspects singuliers de la psyché japonaise, Murakami reconstruit avec précision un évènement dramatique qui, au fond, aurait pu se produire en
tout lieu et en tout temps. "Why Hayashi—a senior medical doctor with an active “front-line” track record at the Ministry of Science and Technology—was chosen to carry out this mission remains
unclear, but Hayashi himself conjectures it was to seal his lips. Implication in the gas attack cut off any possibility of escape. By this point Hayashi already knew too much. He was devoted to
the Aum cult leader Shoko Asahara, but apparently Asahara did not trust him. When Asahara first told him to go and release the sarin gas Hayashi admitted: “I could feel my heart pounding in my
chest—though where else would my heart be?..."

"Sputnik Sweetheart" (1999, Supūtoniku no koibito, Les Amants du Spoutnik)
“Why do people have to be this lonely? What’s the point of it all? Millions of people in this world, all of them yearning, looking to others to satisfy
them, yet isolating themselves. Why? Was the earth put here just to nourish human loneliness?” - "Sputnik Sweetheart" semble surgir du quotidien de la vie, nous sommes en 1957, et le
satellite russe Spoutnik tourne autour de notre planète, mais nous découvrons progressivement avec le narrateur un monde en proie à des âmes divisées et de mystérieuses disparitions. Et une
fois de plus, Haruki Murakami nous montre des femmes dont la vie intérieure paraît extrêmement compliquée, et qui nous entraînent vers l'autre monde, celui des rêves, avec un personnage central,
masculin, que sa froideur et son détachement de la vie rendent attirant. Le narrateur, K, est un jeune homme de 25 ans, solitaire, réfléchi, amoureux de Sumire, une jeune femme qui a abandonné
l'université et est déterminé à devenir romancière, ne serait-ce déjà par sa façon de vivre, sauvage et dissolue. Ignorant les sentiments de K, elle rencontre Miu, une femme d'affaires coréenne
plus âgée, énigmatique et sophistiquée. Le titre du roman vient d'une conversation dans laquelle Miu et Sumire discutent de Jack Kerouac, et Miu confond le mot "beatnik" avec le mot "Spoutnik".
Spoutnik signifie aussi "compagnon de voyage", ce que Sumire sera plus tard en relation avec Miu. Elles partent en effet toutes deux en voyage, en Europe puis vers une île grecque, c'est alors
que l'intrigue s'emballe, et que Miu en appelle à K : Sumire a disparu, s'est-elle suicidée? K trouve l'ordinateur de Sumire et une disquette contenant deux documents, s'ouvre alors pour lui un
monde parallèle dans lequel Sumire s'est laissée entraînée pour retrouver la véritable nature de Miu. K retourne au Japon, débute une seconde intrigue qui prend fin lorsque K reçoit un appel de
Sumire qui lui demande de venir la chercher...

"After the Quake" (2000)
"Our hearts are not stones. A stone may disintegrate in time and lose its outward form. But hearts never disintegrate. They have no outward form, and
whether good or evil, we can always communicate them to one another. All God’s children can dance." - Chacune des six nouvelles qui composent "After the Quake" se déroule au lendemain du
tremblement de terre de Kobe (The Great Hanshin earthquake) qui frappa le Japon le 16 janvier 1995 (6.437 morts et plus de 40.000 blessés). A l'image d'une sourde et soudaine catastrophe qui
surgit, destructrice, des entrailles de la Terre, au-delà de toute anticipation visible, notre quotidien est lui aussi à sa mesure façonné par de brusques mouvements équivalents, imprévisibles,
psychologiques, émotionnels et violents, et non sans conséquences parfois décisives : et lorsque Murakami, dans un monde où l'on ne peut même pas compter sur le sol sous nos pieds, évoque toute
la palette des émotions humaines, c'est toujours sous un angle des plus étranges et surnaturel, fouiller à la surface des choses n'est jamais suffisant. "UFO in Kushiro" (UFO ga Kushiro
ni oriru) conte l'histoire d'un jeune vendeur d'électronique, Komura, qui part livrer ,à la demande de son associé, un paquet énigmatique à un étranger, après que sa femme l'ait brusquement
quitté après avoir passé des jours entiers à regarder les scènes de dévastation à la télévision. "Landscape with Flatiron" est le titre d'une oeuvre du peintre Miyake qui invite un soir
Junko, qui s'est enfuie de chez elle, et Keisuke, surfeur et passionné de musique rock, pour le rejoindre sur une plage et allumer ensemble un feu de joie, les voici évoquant Jack London et la
Mort.

"All God's Children Can Dance" (Kami no kodomotachi wa mina odoru), suit un jeune homme, Yoshiya, dont la mère lui a répété toute son enfance qu'il était l'enfant de Dieu, et de fait les circonstances de sa naissance sont en effet étranges. Un jour le voici convaincu d'avoir trouvé son père, il suit et entame une danse des plus singulières. Dans "Superfrog Saves Tokyo" (Kaeru-kun, Tōkyō o sukuu), Katagiri, un employé de banque reçoit la visite d'une grenouille géante qui lui demande de l'aider à sauver Tokyo de la destruction, en combattant Worm, un ver monstrueux, une créature souterraine qui absorbe la haine, l'excrétant sous forme de tremblements de terre. Dans "Thailand", Satsuki, endocrinologue, prend des vacances en Thaïlande, avec pour guide son chauffeur, Nimit, sage et plus âgé, qui la conduit, le dernier jour, auprès d'une vieille femme dans un quartier pauvre de la ville. "Honey Pie" met en scène trois personnages, dont Junpei, un jeune écrivain qui écrit des nouvelles et souffre d'un amour non partagé, du moins pense-t-il, sa passion pour Sayoko, la femme d'un ami, Takatsuki, et la réalisation de cette passion constitue la trame de son histoire.

"Kafka on the Shore" (Umibe no Kafuka, 2002)
"Closing your eyes isn’t going to change anything. Nothing’s going to disappear just because you can’t see what’s going on…. Keep your eyes wide open. Only
a coward closes his eyes..." - Souvent considérée comme l'introduction parfaite à l'univers littéraire de Haruki Murakami, "Kafka on the Shore" conte l'histoire de deux personnages, un
adolescent, Kafka Tamura, qui s'enfuit de chez lui pour échapper à une horrible prophétie œdipienne ou pour chercher sa mère et sa sœur longtemps disparues, et Satoru Nakata, une "ardoise
blanche" qui parle aux chats et qui semble attiré vers Kafka pour des raisons qu'il ne comprend pas. Ici les chats parlent et les poissons tombent du ciel, les esprits sortent de leur corps pour
faire l'amour ou commettre un meurtre, Johnnie Walker sanglé dans sa redingote rouge et le haut-de-forme vissé sur le crâne incarne un tueur de chats, les références à la musique classique et à
la culture pop abondent, autant que les protagonistes perdus et errants. David Lynch aurait pu adapter ce roman, selon Haruki Murakami...
Beaucoup considèrent "Kafka sur le rivage" (2002) comme son chef-d'œuvre. C'est une quintessence parfaite du "style Murakami", mêlant de manière virtuose deux récits en apparence indépendants.
L'histoire alterne entre Kafka Tamura, un adolescent en fuite, et Nakata, un vieil homme simple d'esprit qui peut parler aux chats. Le lien entre ces deux récits se révèle peu à peu, dans un puzzle métaphysique fascinant. Le livre est rempli de références (à Œdipe Roi, à la musique de Beethoven, à la philosophie) et de symboles (les pierres, la forêt, les entrées secrètes) qui invitent à de multiples interprétations. Ici, le merveilleux n'est pas une échappatoire, mais une partie intrinsèque de la réalité. Des poissons qui tombent du ciel, un homme qui pourrait être l'incarnation de Johnnie Walker... tout semble possible et presque normal.
"My brain like a sponge, I focused on every word said in class and let it all sink in, figured out what it meant, and committed everything to memory. Thanks to this, I barely had to study outside of class, but always came out near the top on exams. My muscles were getting hard as steel, even as I grew more withdrawn and quiet. I tried hard to keep my emotions from showing so that no one—classmates and teachers alike—had a clue what I was thinking. Soon I’d be launched into the rough adult world, and I knew I’d have to be tougher than anybody if I wanted to survive. My eyes in the mirror are cold as a lizard’s, my expression fixed and unreadable. I can’t remember the last time I laughed or even showed a hint of a smile to other people. Even to myself.
I’m not trying to imply I can keep up this silent, isolated facade all the time. Sometimes the wall I’ve erected around me comes crumbling down. It doesn’t happen very often, but sometimes, before I even realize what’s going on, there I am—naked and defenseless and totally confused. At times like that I always feel an omen calling out to me, like a dark, omnipresent pool of water.
A dark, omnipresent pool of water.
It was probably always there, hidden away somewhere. But when the time comes it silently rushes out, chilling every cell in your body. You drown in that cruel flood, gasping for breath. You cling to a vent near the ceiling, struggling, but the air you manage to breathe is dry and burns your throat. Water and thirst, cold and heat—these supposedly opposite elements combine to assault you. The world is a huge space, but the space that will take you in—and it doesn’t have to be very big—is nowhere to be found. You seek a voice, but what do you get? Silence. You look for silence, but guess what? All you hear over and over and over is the voice of this omen. And sometimes this prophetic voice pushes a secret switch hidden deep inside your brain. Your heart is like a great river after a long spell of rain, full to the banks. All signposts that once stood on the ground are gone, inundated and carried away by that rush of water. And still the rain beats down on the surface of the river. Every time you see a flood like that on the news you tell yourself: That’s it. That’s my heart."
"Je me suis concentré, ai transformé mon cerveau en éponge et me suis imprégné de tout ce qui était dit en classe. J 'ai compris le contenu des cours, l`ai mémorisé dans le temps limité des heures de classe et, grâce à ça, même sans travailler beaucoup en dehors, je suis parvenu à me maintenir en tête aux examens. Je suis devenu aussi fort que si mes muscles étaient en métal, et de plus en plus taciturne. Je me suis efforcé de ne jamais montrer mes émotions, de dissimuler ce que je pensais, aussi bien aux profs qu'à mes camarades de classe. Bientôt, j`allais me retrouver lancé dans le monde sans pitié des adultes et pour pouvoir y survivre seul, il fallait que je devienne plus fort que n'importe qui.
En me regardant dans le miroir, je voyais bien que mes yeux avaient un éclat aussi froid que celui d'un lézard, et que mon visage était de plus en plus inexpressif. Je ne me rappelais plus quand j'avais ri pour la dernière fois. Je n'adressais jamais un sourire à personne. Pas même à mon reflet. Mais je ne pouvais pas me maintenir en permanence dans cette solitude paisible. Le mur que j'avais érigé autour de moi s'écroulait parfois. Pas très souvent, mais cela arrivait. Le mur disparaissait avant même que je m'en sois rendu compte, et je me retrouvais tout nu, exposé au monde. Dans ces moments-là, j'étais dans la confusion la plus totale. Et, il y avait aussi la prédiction.
La prédiction, pareille à une étendue d'eau noire.
La prédiction, constamment présente, telle une mystérieuse étendue d'eau noire.
D'ordinaire, elle se dissimule quelque part dans un lieu inconnu. Mais, quand le moment vient, elle s'avance sans bruit, et vient glacer chaque cellule de ton corps, et toi, tu te noies, pantelant, dans cette eau qui monte implacablement. Tu t'accroches à une bouche d'aération proche du plafond, et essaies désespérément d'aspirer l'air du dehors. Mais l'air que tu respires est sec et te brûle la gorge. Des éléments normalement opposés, l'eau et la sécheresse, le froid et le chaud, rassemblent leurs forces pour te terrasser.
Dans l'immensité du monde, tu ne vois nulle part d'espace pour toi - un espace minuscule te suffirait, pourtant. Tu cherches une voix, mais ne rencontres qu'un profond silence. A l'inverse, quand tu réclames le silence, c'est la voix de la prédiction qui se fait entendre sans fin. Et, de temps en temps, cette voix prophétique appuie sur un bouton secret dissimulé au fond de ton cerveau. Ton esprit ressemble à un vaste fleuve en crue après une longue période de pluies. Tous les poteaux de signalisation ont disparu sous l'eau, et ont peut-être déjà été entraînés vers un lieu obscur. Et la pluie continue à frapper violemment la surface du fleuve. C'est ce que tu te dis chaque fois que tu vois des images d'inondation au journal télévisé: « Voilà exactement à quoi ressemble mon esprit. »
"Before running away from home I wash my hands and face, trim my nails, swab out my ears, and brush my teeth. I take my time, making sure my whole body’s well scrubbed. Being really clean is sometimes the most important thing there is. I gaze carefully at my face in the mirror. Genes I’d gotten from my father and mother—not that I have any recollection of what she looked like—created this face. I can do my best to not let any emotions show, keep my eyes from revealing anything, bulk up my muscles, but there’s not much I can do about my looks. I’m stuck with my father’s long, thick eyebrows and the deep lines between them. I could probably kill him if I wanted to—I’m sure strong enough—and I can erase my mother from my memory. But there’s no way to erase the DNA they passed down to me. If I wanted to drive that away I’d have to get rid of me.
There’s an omen contained in that. A mechanism buried inside of me.
A mechanism buried inside of you.
I switch off the light and leave the bathroom. A heavy, damp stillness lies over the house. The whispers of people who don’t exist, the breath of the dead. I look around, standing stock-still, and take a deep breath. The clock shows three p.m., the two hands cold and distant. They’re pretending to be noncommittal, but I know they’re not on my side. It’s nearly time for me to say good-bye. I pick up my backpack and slip it over my shoulders. I’ve carried it any number of times, but now it feels so much heavier.
Shikoku, I decide. That’s where I’ll go. There’s no particular reason it has to be Shikoku, only that studying the map I got the feeling that’s where I should head".
"Avant de quitter la maison, je me récure les mains et le visage avec du savon. Je me coupe les ongles, me nettoie lol oreilles, me lave les dents. Je prends mon temps pour bien me purifier. Dans certains cas, être propre est la chose la plus importante qui soit. Ensuite je me tourne vers le miroir au-dessus du lavabo, et me regarde attentivement. Ce que je vois là, ce sont les traits que j'ai hérités de mon père et de ma mère - bien qu'en ce qui la concerne, je n'aie plus le moindre souvenir. J 'aurai beau faire tout ce que je peux pour effacer toute expression de mon visage, toute lumière de mon regard, et me bâtir des muscles d'acier, jamais je ne pourrai changer mes traits. Quel que soit le désir que j'en aie, il m'est impossible d'arracher de mon visage les longs sourcils épais que je tiens de mon père et la ride qui se creuse entre eux. Si je le souhaitais vraiment, je pourrais tuer mon père (ce ne serait pas très difficile avec la force que j'ai acquise maintenant), et je serais capable aussi d`effacer complètement de ma mémoire le souvenir de ma mère. Mais je ne peux pas me débarrasser de leurs gènes. Pour cela, il faudrait que je me débarrasse de moi-même.
Et puis, il y a la prédiction. Ce mécanisme enfoui au fond de moi.
Ce mécanisme enfoui au fond de toi.
J'éteins la lumière, je sors de la salle de bains.
Un lourd silence flotte sur la maison. Chuchotements de gens qui n'existent pas, respiration de ceux qui ne sont plus. Je regarde autour de moi, je m'arrête, je prends une inspiration profonde. Les aiguilles de ma montre indiquent trois heures de l'après-midi. Elles ont l'air terriblement distantes. Elles prétendent être neutres, mais, en réalité, elles ne sont pas de mon côté. Il va être temps pour moi de quitter ce lieu. Je prends mon petit sac à dos, le mets sur mes épaules. J 'avais pourtant répété cette scène plusieurs fois, mais il me paraît
soudain plus lourd que prévu.
J'ai décidé de partir pour le Shikoku. Sans raison particulière. Simplement, en regardant la carte, j'ai pensé que c'était là que je devais me rendre... " (Kafka sur le rivage, 1018, traduction du japonais par Corinne Atlan)

"After Dark" (2004, Afutā dāku)
"In this world, there are things you can only do alone, and things you can only do with somebody else. It’s important to combine the two in just the right
amount." - "After Dark" (Le Passage de la nuit), entre minuit (11:56 p.m.) et l'aube, Tokyo se glisse dans la nuit, comme tant d'autres villes sur cette planète, l'horizon de notre monde
devient de plus en plus flou, sans limite de plus en plus tangible, notre logique se dissout, nous entrons insensiblement dans un autre monde, proies féminines, maraudeurs solitaires, forces
de police, camions à ordures, réseaux de fibres optiques, perdant notre singularité dans un mirage collectif sombre et douteux, un "oeil" au-dessus de la ville suit au hasard certains d'entre
nous, gens de la nuit, happés par de sombres desseins qui nous rassemblent jusqu'aux premières lueurs du jour. Juste avant minuit, nous rencontrons Mari, qui fume et lit un livre dans un café le
restaurant Denny's. "Sur sa table, il y a une tasse de café. Et un cendrier. À côté du cendrier, une casquette de baseball bleu marine avec un Boston Red Sox'B'. Il est peut-être un peu trop
grand pour sa tête. Un sac à bandoulière en cuir brun repose sur le siège à côté d'elle. Il bombe comme si son contenu avait été jeté à l'improviste. Elle tend la main à intervalles réguliers et
porte la tasse de café à sa bouche, mais elle ne semble pas apprécier la saveur. Elle boit parce qu'elle a une tasse de café devant elle : c'est son rôle de cliente". Avant l'aube, elle aura
rencontré un tromboniste, Takahashi, Kaoru, le gérant blond et dur à cuire d'un hôtel d'amour local, où une prostituée chinoise est battue par un homme d'affaire mystérieux. Pendant ce temps, la
sœur de Mari, Eri, mannequin de mode, sommeille depuis des mois dans l'oubli, mais survient d'étranges événements dans sa chambre, un téléviseur débranché s'allume, montrant une pièce où un homme
est assis avec un masque en cellophane, et où, plus tard, Eri sera aspirée et piégée : "ses pupilles ont pris une teinte solitaire, comme des nuages gris réfléchis dans un lac
calme.."
"Eyes mark the shape of the city.
Through the eyes of a high-flying night bird, we take in the scene from midair. In our broad sweep, the city looks like a single gigantic creature—or more like a single collective entity created by many intertwining organisms. Countless arteries stretch to the ends of its elusive body, circulating a continuous supply of fresh blood cells, sending out new data and collecting the old, sending out new consumables and collecting the old, sending out new contradictions and collecting the old. To the rhythm of its pulsing, all parts of the body flicker and flare up and squirm. Midnight is approaching, and while the peak of activity has passed, the basal metabolism that maintains life continues undiminished, producing the basso continuo of the city’s moan, a monotonous sound that neither rises nor falls but is pregnant with foreboding.
Our line of sight chooses an area of concentrated brightness and, focusing there, silently descends to it—a sea of neon colors. They call this place an “amusement district.” The giant digital screens fastened to the sides of buildings fall silent as midnight approaches, but loudspeakers on storefronts keep pumping out exaggerated hip-hop bass lines. A large game center crammed with young people; wild electronic sounds; a group of college students spilling out from a bar; teenage girls with brilliant bleached hair, healthy legs thrusting out from micromini skirts; dark-suited men racing across diagonal crosswalks for the last trains to the suburbs. Even at this hour, the karaoke club pitchmen keep shouting for customers. A flashy black station wagon drifts down the street as if taking stock of the district through its black-tinted windows. The car looks like a deep-sea creature with specialized skin and organs. Two young policemen patrol the street with tense expressions, but no one seems to notice them. The district plays by its own rules at a time like this. The season is late autumn. No wind is blowing, but the air carries a chill. The date is just about to change..."
"La ville s'offre à notre regard.
Ce paysage urbain, nous l'observons à travers les yeux d'un oiseau de nuit qui volerait très haut dans le ciel. Depuis ce point de vue panoramique, la ville apparaît comme une gigantesque créature. Ou même comme un agrégat de corps vivants. S'étendant jusqu'à d'insaisissables confins, des vaisseaux sanguins, innombrables, irriguent les cellules, les régénèrent inlassablement. Les vaisseaux convoient des informations nouvelles, recyclent les anciennes. Donnent naissance à des consommations nouvelles, recyclent les anciennes. Créent de nouvelles contradictions, effacent les anciennes. En tous lieux, les corps agrégés clignotent au rythme des battements du cœur, s'échauffent, se meuvent. L'heure est proche de minuit, le pic d'activité est passé mais les échanges élémentaires indispensables au fonctionnement vital restent incessants. Tel un continuo, la ville bruit. Monotone, monocorde, intégrant cependant des pressentiments.
Une zone particulièrement lumineuse attire notre regard. Lequel opère la mise au point. Effectue une descente vers l'amas lumineux. C'est une mer de néons multicolores. Un centre-ville. Les murs d'images sur les buildings se taisent avec l'arrivée de minuit; les haut-parleurs des magasins pourtant ne relâchent pas leur flot de basses, teinté de hip-hop.
Un énorme game-center encombré de jeunes. Exubérance de sons électroniques. Un groupe d'étudiants, de retour de soirée. Des filles, moins de vingt ans, blond platine, exhibant leurs jambes fraîches sous leurs minijupes. Des salary-men qui se pressent sur les passages piétons, pour attraper le dernier train. Malgré l'heure, les rabatteurs des karaokés donnent de la voix. Un monospace tuné, noir, glisse lentement le long du boulevard, jaugeant la marchandise. Vitres opaques, équipées d'un film noir. On dirait une de ces créatures du fond des mers, pourvues d'une carapace et d'appendices respiratoires spéciaux. Deux jeunes policiers font leur ronde sur le boulevard, l'air tendu; personne ne leur prête attention. À cette heure-là, la ville fonctionne selon des principes de base qui lui sont propres. C'est la fin de l'automne. Il n'y a pas de vent mais l'air est froid. Encore un tout petit peu, et ce sera un autre jour... (Le passage de la nuit, 1018, traduction de japonais par Helène Morita).

"What I Talk About When I Talk About Running"
(2007, Hashiru koto ni tsuite kataru toki ni boku no kataru koto)
"Pain is inevitable. Suffering is optional" - "What I Talk About When I Talk About Running" (Autoportrait de l'auteur en coureur de fond) constitue un
recueil très personnel dans lequel Murakami Haruki livre souvenirs et pensées, entrelaçant singulièrement sa passion pour le marathon de New York et celle pour l'écriture.
"I’m on Kauai, in Hawaii, today, Friday, August 5, 2005. It’s unbelievably clear and sunny, not a cloud in the sky. As if the concept clouds doesn’t even exist. I came here at the end of July and, as always, we rented a condo. During the mornings, when it’s cool, I sit at my desk, writing all sorts of things. Like now: I’m writing this, a piece on running that I can pretty much compose as I wish. It’s summer, so naturally it’s hot. Hawaii’s been called the island of eternal summer, but since it’s in the Northern Hemisphere there are, arguably, four seasons of a sort. Summer is somewhat hotter than winter. I spend a lot of time in Cambridge, Massachusetts, and compared to Cambridge—so muggy and hot with all its bricks and concrete it’s like a form of torture—summer in Hawaii is a veritable paradise. No need for an air conditioner here—just leave the window open, and a refreshing breeze blows in. People in Cambridge are always surprised when they hear I’m spending August in Hawaii. “Why would you want to spend summer in a hot place like that?” they invariably ask. But they don’t know what it’s like. How the constant trade winds from the northeast make summers cool. How happy life is here, where we can enjoy lounging around, reading a book in the shade of trees, or, if the notion strikes us, go down, just as we are, for a dip in the inlet..."

"1Q84" (Ichi-kyū-hachi-yon , trois tomes, 2009-2010)
"I’m like someone who’s been thrown into the ocean at night, floating all alone. I reach out, but no one is there. I call out, but no one answers. I have no
connection to anything." - Une oeuvre extravagante de 1000 pages que Murakami Haruki mit 4 ans à écrire et qui fait clairement référence au 1984 de George Orwell, mais sous l'inspiration de
Dostoïevski, ajoutera-t-il (le dernier roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, peut être considéré comme "le but ultime que j'atteins dans mes romans", "il est tout simplement rempli de
toutes sortes d'éléments importants caractéristiques du roman").
1Q84 voit une jeune femme, thérapeute et tueuse à gages, nommée Aomame, à Tokyo, en 1984, se prendre au jeu des suggestions énigmatiques d'un chauffeur de
taxi et commencer à remarquer d'étranges détails dans le monde qui l'entoure, semblant entrer dans une existence parallèle, qu'elle appelle 1Q84 (Q est pour le point d'interrogation).
Parallèlement, un mathématicien, écrivain débutant, Tengo Kawana, se lance dans un projet d'écriture qui imprègne tant sa vie qu'elle s'effrite progressivement. Les deux récits vont ainsi
converger dans un dédale de rencontres imaginaires...
"Don't let appearances fool for you" - "The taxi’s radio was tuned to a classical FM broadcast. Janacek’s Sinfonietta—probably not the ideal music to hear in a taxi caught in traffic. The middle-aged driver didn’t seem to be listening very closely, either. With his mouth clamped shut, he stared straight ahead at the endless line of cars stretching out on the elevated expressway, like a veteran fisherman standing in the bow of his boat, reading the ominous confluence of two currents. Aomame settled into the broad back seat, closed her eyes, and listened to the music.
How many people could recognize Janacek’s Sinfonietta after hearing just the first few bars? Probably somewhere between “very few” and “almost none.” But for some reason, Aomame was one of the few who could.
Janacek composed his little symphony in 1926. He originally wrote the opening as a fanfare for a gymnastics festival. Aomame imagined 1926 Czechoslovakia: The First World War had ended, and the country was freed from the long rule of the Hapsburg Dynasty. As they enjoyed the peaceful respite visiting central Europe, people drank Pilsner beer in cafs and manufactured handsome light machine guns. Two years earlier, in utter obscurity, Franz Kafka had left the world behind. Soon Hitler would come out of nowhere and gobble up this beautiful little country in the blink of an eye, but at the time no one knew what hardships lay in store for them. This may be the most important proposition revealed by history: “At the time, no one knew what was coming.” Listening to Jancek’s music, Aomame imagined the carefree winds sweeping across the plains of Bohemia and thought about the vicissitudes of history.
In 1926 Japan’s Taisho Emperor died, and the era name was changed to Showa. It was the beginning of a terrible, dark time in this country, too. The short interlude of modernism and democracy was ending, giving way to fascism.
1 - Aomamé - Il ne faut pas se laisser abuser par les apparences - "LA RADIO DU TAXI DIFFUSAIT une émission de musique classique en stéréo. C’était la Sinfonietta de Janáček. Était-ce un morceau approprié quand on est coincé dans des embouteillages ? Ce serait trop dire. D’ailleurs, le chauffeur lui-même ne semblait pas y prêter une oreille attentive. L’homme, d’un âge moyen, se contentait de contempler l’alignement sans fin des voitures devant lui, la bouche serrée, tel un vieux marin aguerri, debout à la proue de son bateau, appliqué à déchiffrer quelque sinistre pressentiment dans la jonction des courants marins. Aomamé, profondément enfoncée dans le siège arrière du véhicule, écoutait, les yeux mi-clos.
Combien y aurait-il d’auditeurs, à l’écoute des premières mesures de la Sinfonietta de Janáček, qui reconnaîtraient immédiatement ce morceau ? Disons : entre « très peu » et « presque aucun ». Mais Aomamé, elle, pour une raison ou une autre, en était capable.
Janáček avait composé cette courte symphonie en 1926. Le thème principal avait été conçu à l’origine pour une fanfare à l’occasion d’une rencontre sportive. Aomamé imaginait la Tchécoslovaquie de 1926. Après la Première Guerre mondiale, le pays s’était enfin libéré de la très longue domination des Habsbourg, les gens buvaient de la bière Pilzner dans les cafés, ils fabriquaient des mitrailleuses efficaces et raffinées, ils goûtaient la paix passagère qui visitait l’Europe centrale. Franz Kafka, encore méconnu, avait disparu deux ans auparavant. Bientôt apparaîtrait Hitler, qui ne ferait qu’une bouchée de ce joli petit pays. Mais, en ce temps-là, tout le monde ignorait que des événements aussi terribles allaient advenir. Ce que l’Histoire enseigne de plus important aux hommes pourrait se formuler ainsi : « À l’époque, personne ne savait ce qui allait arriver. »
En écoutant cette musique, Aomamé imaginait les vents qui balayaient sans obstacle les plaines de Bohême et laissait ses pensées vagabonder sur l’Histoire.
1926, c’était la mort de l’empereur Taishô, le commencement d’une ère nouvelle, l’ère Shôwa. Au Japon aussi, ce serait le début d’une époque sombre et terrible. Le modernisme et la démocratie avaient joué leur bref intermède. Celui-ci achevé, le fascisme imposerait sa loi.
L’histoire, comme le sport, était ce qui intéressait le plus Aomamé. Elle ne se lassait pas de lire de nombreux ouvrages historiques, alors qu’elle n’était guère portée sur les romans. En matière d’histoire, elle aimait avant tout que tous les événements soient bien reliés à une chronologie et à un lieu précis. Elle n’avait aucune difficulté à se souvenir des dates. Même quand elle ne l’avait pas apprise par cœur, la chronologie se dessinait automatiquement, du moment qu’elle avait saisi la cohésion d’ensemble des divers événements. Au collège et au lycée, Aomamé avait toujours les meilleures notes de la classe aux contrôles d’histoire, et elle trouvait étrange qu’un élève ait du mal à retenir la succession des dates, alors que c’était si facile d’y parvenir.
Aomamé était son vrai nom. Son grand-père paternel était originaire de la préfecture de Fukushima et là-bas, dans des petites villes ou villages des montagnes, un certain nombre de personnes portaient réellement ce nom d’« Aomamé » – haricots de soja verts. Elle-même ne s’était jamais rendue dans cette région. Avant sa naissance, son père avait rompu avec sa famille. Il en allait de même avec sa lignée maternelle. Par conséquent, Aomamé n’avait jamais rencontré un seul de ses grands-parents. Elle n’avait pour ainsi dire pas voyagé, mais, en de rares occasions, elle avait consulté l’annuaire téléphonique de son hôtel pour chercher si des gens portaient ce patronyme. Jamais elle n’en avait trouvé nulle part, dans aucune ville, grande ou petite. Elle avait chaque fois l’impression d’être une naufragée solitaire jetée dans un immense océan.
Donner son nom était pénible. Dès qu’elle l’avait prononcé, son interlocuteur prenait un air surpris ou la considérait d’un œil embarrassé. Mademoiselle Aomamé ? Oui, c’est bien ça. Et mon nom s’écrit A-o-m-a-m-é, comme les haricots de soja, bleu-vert, oui. Quand elle avait travaillé dans une entreprise et qu’elle avait dû avoir des cartes de visite, les tracasseries avaient été d’autant plus nombreuses. L’autre regardait longuement, d’un œil méfiant, la carte qu’elle lui tendait. Comme si elle lui avait fait lire une lettre maléfique à brûle-pourpoint. Lorsqu’elle se présentait au téléphone, il y avait même des rires étouffés. Dans la salle d’attente de la mairie ou de l’hôpital, dès que son nom était appelé, les gens levaient le nez pour la regarder. Quelle tête pouvait bien avoir quelqu’un affublé d’un nom pareil ?
Parfois, les gens se trompaient et l’appelaient « Edamamé » – haricots de soja encore verts – ou même « Soramamé » – fèves. Chaque fois, elle rectifiait. « Non, ce n’est pas Edamamé (ou Soramamé). Bien sûr, ces noms se ressemblent… » Et la personne de s’excuser avec un petit rire. « Voyez-vous, c’est un nom tellement rare… » En trente ans, combien de fois lui avait-il fallu entendre la même chose ? Combien de plaisanteries stupides ?
Si je n’étais pas née avec un nom pareil, peut-être ma vie aurait-elle pris un tour différent. Si je m’étais appelée « Satô » ou « Tanaka » ou encore « Suzuki », un patronyme bien banal, j’aurais peut-être eu une existence plus tranquille et regardé les autres d’un œil plus tolérant. Possible.
Aomamé, les yeux clos, écoutait la musique avec attention. Elle se laissait envahir par les belles vibrations produites par l’unisson des bois. Brusquement, quelque chose la frappa. La qualité de la musique était trop bonne pour une radio de taxi. Même à faible volume, le son était profond et les harmoniques clairement restitués. Elle ouvrit les yeux, se redressa et examina la stéréo encastrée dans le tableau de bord. L’appareil était tout noir, élégant et brillant. Elle ne pouvait voir le nom du fabricant mais comprenait bien que c’était un modèle de prix, avec ses multiples réglages et son affichage numérique vert en façade. Sans doute un appareil de première qualité. Pour un taxi ordinaire appartenant à une compagnie, une aussi belle installation stéréo, c’était étonnant.
Aomamé examina l’intérieur de la voiture plus attentivement. Elle n’y avait pas vraiment prêté attention en montant, car elle était absorbée dans ses pensées, mais avec un examen plus minutieux elle voyait bien que ce n’était pas un taxi ordinaire. La qualité de l’équipement intérieur était remarquable, le confort des sièges parfait. Et surtout, le calme régnait dans l’habitacle. La voiture semblait être équipée d’un dispositif antibruit, et le vacarme extérieur ne pénétrait pratiquement pas à l’intérieur. Comme dans un studio insonorisé. Peut-être s’agissait-il d’un taxi indépendant ? ..." (Haruki Murakami 2009, et pour la traduction française Belfond, 2011)

"Men Without Women" (Onna no inai otokotachi, 2014)
"Dreams are the kind of things you can–when you need to–borrow and lend out..." - A travers sept récits, - "Drive My Car", "Yesterday", "An Independent
Organ", "Scheherazade", "Kino", "Samsa in Love", "Men Without Women" -, Haruki Murakami observe des hommes qui, qu'ils soient médecins ou étudiants, ex-petits amis ou acteurs, ou personnages
littéraires tels que Gregor Samsa de Kafka, plongent dans la solitude, ayant perdu leurs femmes dans diverses circonstances...
"The call came in after one a.m. and woke me up. Phones ringing in the middle of the night always sound harsh and grating, like some savage metal tool
out to destroy the world. I felt it was my duty, as a member of the human race, to put a stop to it, so I got out of bed, padded over to the living room, and picked up the
receiver.
A man’s low voice informed me that a woman had vanished from this world forever. The voice belonged to the woman’s husband. At least that’s what he
said. And he went on. My wife committed suicide last Wednesday, he said. In any case, I thought I should let you know. In any case. As far as I could make out, there was not a drop of emotion in
his voice. It was like he was reading lines meant for a telegram, with barely any space at all between each word. An announcement, pure and simple. Unadorned reality.
Period..."
"Le téléphone me réveilla peu après 1 heure du matin. La sonnerie d'un téléphone en pleine nuit, c'est toujours brutal. Cela peut faire penser à quelqu'un qui essaierait de démolir le monde à l'aide d'une lourde barre de fer. En tant que membre de l'espèce humaine, il fallait que j'y mette un terme. C'est pourquoi je quittai mon lit, me dirigeai vers le salon et soulevai le combiné.
La voix grave d'un homme m'informa qu'une femme avait quitté notre monde à tout jamais. Le possesseur de cette voix était le mari de cette femme. Du moins se définit-il ainsi. Sa femme avait mis fin à ses jours mercredi de la semaine précédente, dit-il, et, de toute manière, il voulait me faire part de cette nouvelle. "De toute manière." Dans ce que j'en entendis, pas la moindre émotion n'était perceptible au ton de sa voix. Il parlait en style télégraphique.
Sans faire de pause entre les mots. Une pure annonce.
Un fait brut. Point."
(1018, traduction du japonais par Hélène Morita)

"Killing Commendatore" (Kishidancho Goroshi, 2017)
"Killing Commendatore" (Le Meurtre du Commandeur, Éditions Belfond) débute par la découverte par un jeune peintre, retiré dans la solitude, d'une oeuvre
inédite, cachée au fond du grenier, dans la maison d'un artiste célèbre nommé Amad Tomohiko, avec qui lui et son fils sont amis depuis ses études d'art. Notre héros, anonyme, entend parfois des
bruissements dans ce grenier et décide de s'y rendre : il y découvre un tableau enveloppé dans du papier brun, une œuvre inconnue d'Amada, dans laquelle une scène sanglante de Don Juan est
représentée dans le style du Japon ancien (le titre du roman fait lui-même référence à l'opéra de Mozart), parmi les quatre personnages, dans le coin inférieur gauche du tableau, un visage
énigmatique tout en longueur. Le voici entraîné dans une suite d'évènements étranges, il se réveille au milieu de la nuit surpris pas le silence, entre dans la cuisine pour se verser un whisky,
entend les sons lointains d'une cloche, des sons qui proviennent d'un petit sanctuaire, derrière celui-ci, il y a une colline tombale....
"Today when I awoke from a nap the faceless man was there before me. He was seated on the chair across from the sofa I’d been sleeping on, staring
straight at me with a pair of imaginary eyes in a face that wasn’t.
The man was tall, and he was dressed the same as when I had seen him last. His face-that-wasn’t-a-face was half hidden by a wide-brimmed black hat, and
he had on a long, equally dark coat.
“I came here so you could draw my portrait,” the faceless man said, after he’d made sure I was fully awake. His voice was low, toneless, flat. “You
promised you would. You remember?”
“Yes, I remember. But I couldn’t draw it then because I didn’t have any paper,” I said. My voice, too, was toneless and flat. “So to make up for it I
gave you a little penguin charm.”
“Yes, I brought it with me,” he said, and held out his right hand. In his hand—which was extremely long—he held a small plastic penguin, the kind you
often see attached to a cell phone strap as a good-luck charm. He dropped it on top of the glass coffee table, where it landed with a small clunk.
“I’m returning this. You probably need it. This little penguin will be the charm that should protect those you love. In exchange, I want you to draw my
portrait.”
I was perplexed. “I get it, but I’ve never drawn a portrait of a person without a face.”
My throat was parched...."

"Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage" (2013, Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi, L'Incolore Tsukuru Tazaki et
ses années de pèlerinage)
Murakami est devenu un phénomène littéraire mondial qui publie chaque année des fictions qui semblent se composer naturellement et le plus souvent, comme
ici, conte l'histoire d'un jeune Japonais solitaire dont le présent est étrangement vide et le passé marqué par un évènement douloureux dont il ne parvient pas à comprendre la signification.
Adolescent, étudiant, Tazaki Tsukuru a subi une rupture, rejeté du cercle étroit d'amis qui donnait sens à sa vie, des amis qui portaient tous un connotation colorée, Akamatsu (rouge), Oumi
(bleue), Shirane (blanche), Kurono (noir) : mais il s'avère que même lorsque Tsukuru appartenait à ce groupe, il s'y est senti progressivement étranger, progressivement "incolore". Il se sent
confusément manquer de personnalité, le voici hanté par des idées suicidaires, et pourtant menant par ailleurs une vie des plus ordinaires. Il est concepteur de gares ferroviaires, poursuit une
vie amoureuse qui ne mène jamais nulle part jusqu'à ce qu'il rencontre Sara Kimoto, qui travaille dans une agence de voyage de Tokyo. Elle va et vient dans sa vie et le pousse à
entreprendre un voyage sur lui-même, à se lancer dans une quête qui va le ramener dans sa ville natale de Nagoya et même en Finlande, dans l'espoir de reconstituer les détails de son passé
et de découvrir s'il est la cause de l'indifférence qu'il a si douloureusement ressenti de la part de ses amis. Quête au cours de laquelle il va prendre quelque "couleur", et nous entraîner dans
un emboîtement de récits et d'expériences émotionnelles, l'histoire notamment de Fumiaki Haida (Gris), son seul et meilleur ami avec lequel il écoutait Les Années de pèlerinage de Liszt (Le Mal
du Pays), une pièce de musique qui lui reste comme le seul lien de ses amitiés passées. Murakami semble nous dire que notre entourage le plus proche, notre tout premier cercle d'amitié, définit
qui nous sommes, ce que nous devenons, avec le risque de tomber dans un sentiment de vide absolu comme si nous perdions un être cher...
"From July of his sophomore year in college until the following January, all Tsukuru Tazaki could think about was dying. He turned twenty during this
time, but this special watershed—becoming an adult—meant nothing. Taking his own life seemed the most natural solution, and even now he couldn’t say why he hadn’t taken this final step. Crossing
that threshold between life and death would have been easier than swallowing down a slick, raw egg.
Perhaps he didn’t commit suicide then because he couldn’t conceive of a method that fit the pure and intense feelings he had toward death. But method
was beside the point. If there had been a door within reach that led straight to death, he wouldn’t have hesitated to push it open, without a second thought, as if it were just a part of ordinary
life. For better or for worse, though, there was no such door nearby.
I really should have died then, Tsukuru often told himself. Then this world, the one in the here and now, wouldn’t exist. It was a captivating,
bewitching thought. The present world wouldn’t exist, and reality would no longer be real. As far as this world was concerned, he would simply no longer exist—just as this world would no longer
exist for him.
At the same time, Tsukuru couldn’t fathom why he had reached this point, where he was teetering over the precipice. There was an actual event that had
led him to this place—this he knew all too well—but why should death have such a hold over him, enveloping him in its embrace for nearly half a year? Envelop—the word expressed it precisely. Like
Jonah in the belly of the whale, Tsukuru had fallen into the bowels of death, one untold day after another, lost in a dark, stagnant void..."

Yôko Ogawa (1962)
"I myself like to keep a certain distance from my native culture or environment" - Yoko Ogawa découvrit, adolescente et solitaire, "Le Journal d'Anne
Frank", se façonna un univers singulier, à la croisée des cultures orientales et occidentales de ce monde, Jun'ichirō Tanizaki, Haruki Murakami, F. Scott Fitzgerald, Truman Capote, Raymond
Carver, Paul Auster, son regard est celui d'un entomologiste de la psychologie humaine, féminine principalement, - la narratrice est toujours une jeune femme, qui semble ne pas savoir
pourquoi elle fait ce qu'elle fait -, le sens et l'importance du détail, une accumulation de détails, la propension à collectionner les plus infimes objets ou évènements au cours d'une existence
que l'on sait vouée à la mort et à la disparition, ses histoires, écrites avec une étonnante simplicité, pour elle-même, dit-elle, laisse entrevoir sans les expliquer les fêlures de l'existence
humaine. Près de 40 romans et recueils traduits en français (Actes Sud), allemand, anglais (Penguin), italien, grec, espagnol, catalan, chinois, coréen, "The Cafeteria in the Evening and a Pool
in the Rain" fut publié en 2004 dans le New York Times et "The Housekeeper and the Professor" a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires au Japon...
"Juju and I moved here on a foggy morning in early winter. There wasn’t that much to move—just an old wardrobe, a desk, and a few boxes. It was simple
enough. Sitting on the enclosed porch, I watched the small truck rattle off into the mist. Juju sniffed around the house, checking the cinderblock wall and the glass panel in the door, as if to
reassure himself about his new home. He made little grumbling noises as he worked, his head cocked to one side.
The fog was rolling away in gentle waves. It was not the sort of suffocating fog that swallows everything; in fact, this fog seemed pure and almost
transparent, like a cool, thin veil that you could reach out and touch. I stared at it for a long time, leaning against the boxes, until I felt as if I could see each milky droplet. Juju had
grown tired of sniffing and was curled up at my feet. Feeling a chill on my back, I peeled away the tape on the box I had been leaning against, pulled out a sweater, and put it on. A bird flew
straight into the fog and disappeared.
My fiancé fell in love with the house first.
“Doesn’t it seem a little old-fashioned?” I said, rubbing my finger over a faded storm shutter..."

"The Diving Pool", recueil de trois nouvelles, fut la première des oeuvres de Yôko Ogawa à être traduite en anglais. Dans "Daibingu puru" (1990, La Piscine), l'adolescente Aya, secrètement amoureuse de son frère adoptif, Jun, et pensionnaire d'un orphelinat géré par ses parents, l'observe plongeant et nageant, chacun des muscles de son corps qui se tend et se dénoue est une sorte de réponse à quelque mal-être intérieur qui prend rapidement une tournure dramatique. Dans "Pregnancy Diary" (1991, Ninshin Calendar, La Grossesse), une femme suit avec méticulosité la grossesse de sa soeur dans un journal intime qui se révèle être un journal de la répulsion. Dans "Dormitory", une femme, poussée par la nostalgie et pour rendre service à sa cousine qui recherche un logement bon marché, revisite son ancien dortoir universitaire de la banlieue de Tokyo, et se retrouve entraînée dans une énigmatique atmosphère. Autant de personnages féminins qui sélectionnent et observent avec une froide insensibilité certains de leurs proches parmi les plus faibles, ou les moins conscients de leurs êtres.
"Il fait très bon. En arrivant ici, j’ai toujours l’impression d’avoir été engloutie par un monstre. Je m’assieds, et mes cheveux, mes sourcils et le corsage de mon uniforme ne tardent pas à s’imprégner de la chaleur ambiante et à devenir moites. Je baigne dans une humidité plus douce que la transpiration, d’où s’élève une discrète odeur de crésol.
La surface de l’eau, bleu pâle, tremble tout en bas sous mes pieds. J’essaie en vain d’apercevoir le fond, gênée par les petites bulles qui ne cessent de remonter à la surface. Le plafond, vitré, est très haut. Je suis assise, comme accrochée, en plein milieu des gradins réservés au public.
Jun avance sur le plongeoir de dix mètres. Il a pour maillot le slip de bain rouge foncé que j’ai vu hier pendu sous l’auvent de la fenêtre de sa chambre. Arrivé à l’extrémité de la planche, il tourne lentement le dos à la surface de l’eau et aligne les talons. Tous les muscles de son corps sont bandés à l’extrême, comme s’il retenait sa respiration. C’est la ligne musculaire qui part de la cheville pour atteindre la cuisse à ce moment-là que je préfère dans son corps. Elle a l’élégance glacée d’une statue de bronze.
Il m’est arrivé parfois de vouloir essayer de définir la jouissance que j’éprouve au moment où il lève les deux mains comme pour saisir quelque chose dans l’espace avant de disparaître sous l’eau. Mais je n’ai jamais réussi à trouver les mots qui conviennent. Est-ce parce qu’il s’enfonce dans la vallée reculée du temps, là où les mots n’arrivent jamais ?
Je murmure :
“Coup de pied à la lune périlleux et demi au vol groupé.”
C’est raté. Sa poitrine a frappé la surface de l’eau dans un grand bruit. Le choc a été suivi d’éclaboussures blanches à n’en plus finir.
Que l’exécution soit un échec comme maintenant ou qu’elle soit parfaite, sans provoquer aucune gerbe d’eau, mon sentiment reste inchangé. C’est pourquoi je ne prie jamais pour qu’il réussisse son plongeon, pas plus qu’il ne m’arrive d’être déçue ou d’applaudir avec enthousiasme. Le corps souple et élancé de Jun traverse la couche superficielle de mes sentiments pour être absorbé au plus profond de mon être. Dès que sa silhouette apparaît entre les bulles, la surface ébranlée de l’eau suit le contour de ses épaules qu’elle recouvre comme un voile. Avec ce voile sur les épaules, il nage lentement vers le bord de la piscine, d’une brasse ample et précise.
J’ai déjà vu des retransmissions télévisées de compétitions de plongeon avec une caméra installée sous l’eau. Les concurrents qui crèvent la surface vont directement jusqu’au fond dans leur élan. Le bassin est saturé de bleu. Les athlètes se recroquevillent sur eux-mêmes pour changer de direction et donnent un coup de pied au fond pour remonter à la surface. C’est beaucoup plus beau que le reste de l’exécution. Les chevilles et les mains qui écartent l’eau ont des mouvements élastiques, et le corps tout entier baigne dans la pureté du milieu aquatique. Si c’est une femme, ses cheveux ondulent comme sous l’action du vent. Leur expression à tous est si paisible qu’on dirait qu’ils respirent profondément.
Plusieurs concurrents plongent et viennent passer devant la caméra immergée dans un beau mouvement aérodynamique. J’aimerais qu’ils passent plus lentement pour avoir le temps d’observer leur silhouette enveloppée d’eau, mais il suffit de deux ou trois secondes pour que leur visage affleure à la surface. Les voir ainsi me rappelle que tous les êtres humains ont un jour baigné dans du liquide amniotique.
Est-ce que Jun lui aussi laisse flotter ses muscles en liberté au fond de la piscine comme un fœtus dans le ventre de sa mère ? Je crois que je me sentirais bien mieux si je pouvais contempler autant que je veux son corps libéré de toute tension.
Je suis sur les gradins de la piscine réservée au plongeon depuis un temps assez long. J’étais déjà là hier, comme avant-hier, comme il y a trois mois aussi. Je ne pense à rien, je n’attends rien, je n’ai aucune idée de ce qui m’amène ici. Je me contente de regarder le corps mouillé de Jun.
Nous vivons depuis plus de dix ans sous le même toit et nous fréquentons le même lycée, nous nous côtoyons donc plusieurs fois par jour et nous nous adressons la parole régulièrement, mais je sens qu’il est bien plus proche de moi à la piscine. Sans défense dans son maillot de bain, il plonge et replonge sans arrêt, le corps évoluant dans toutes sortes de positions : droit, groupé, carpé. Je dépose mon cartable à mes pieds et je m’assieds sur les gradins, dans ma jupe aux plis bien repassés et mon corsage frais lavé. Je ne peux même pas tendre la main vers lui.
Et pourtant cet endroit est privilégié. C’est une tour de guet réservée à mon usage personnel qui me permet de le voir. Il passe à travers moi sans s’écarter de sa route.
Après avoir marché jusqu’au bout de la rue commerçante du quartier de la gare, dès que j’entre dans la première petite rue au sud en partant de la nationale qui longe la voie ferrée, l’agitation des gens s’éloigne soudain..." (Diving Pool, romans traduits du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle, Babel)
Dans "Amours en marge" (Yohaku no ai, 1991), la narratrice entend des sons qui n'existent pas et tente de comprendre ce qui lui arrive. Dans " L'Annulaire" (Kusuriyubi no hyonhon, 1994), elle devient l'assistante d'un étrange taxidermiste, Deshimaru, qui a pour particularité d'être en capacité de conserver tout ce qui peut l'être. "The Memory Police" (Hisoyaka na kesshō, 1994) se déroule sur une île mystérieuse où un gouvernement autoritaire fait disparaître du jour au lendemain des catégories entières d'objets ou d'animaux, les effaçant de la mémoire des citoyens.
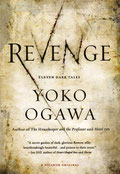
Dans "Hôtel Iris" (Hoteru Airisu, 1996), une jeune fille de dix-sept ans, Mari, qui tient un hôtel au bord de la ruine dans une station balnéaire avec sa mère, s'abandonne à un vieillard, par ailleurs traducteur, qui va progressivement l'initier au sombre royaume de la douleur et du plaisir (he can do what he wants to my body, and my soul), jusqu'au drame. La fascination pour les laboratoires, où l'on classe et analyse, pour le milieu médical, thématique du corps et de l'âme disséquée, de la mort, se retrouvent dans "Une Parfaite chambre de malade" (Kanpekina byoshitsu, 1989) et "La Désagrégation du Papillon" (Agehacho ga kowareru toki, 1988).
"I - Il est arrivé à l’hôtel un peu avant le début de la saison d’été. La pluie qui tombait depuis l’aube n’avait pas cessé de la journée, pour redoubler de violence à la tombée de la nuit. La mer était houleuse et d’une morne couleur grise. À chaque allée et venue des clients, la pluie s’engouffrait en rafales qui venaient mouiller désagréablement le tapis du hall. Toutes les enseignes au néon des magasins du quartier étaient éteintes et il n’y avait personne dans les rues. Lorsque de temps à autre une voiture passait, on distinguait les gouttes de pluie à la lumière des phares.
Je n’allais pas tarder à fermer la caisse, puis éteindre la lumière du hall avant de me retirer. C’est alors qu’un bruit effrayant éclata soudain, comme si quelque chose de lourd venait d’atterrir sur le sol, aussitôt suivi d’un cri de femme.
Ce fut un cri long, interminable. Tellement long qu’on aurait pu penser qu’en réalité elle riait.
— Sale pervers !
La femme sortait en trombe de la 202.
— Espèce de vieux salaud !
Elle se prit les pieds dans le tapis, vint rouler sur le palier d’où, toujours dans la même position, elle continuait à lancer ses insultes en direction de la chambre.
— Ça suffit de prendre les autres pour des imbéciles. Tu n’as aucun droit sur moi. Escroc ! Salaud ! Impuissant !
C’était manifestement une prostituée. Même moi je m’en rendais compte. Elle n’était plus si jeune. Ses cheveux roulaient sur son cou visiblement ridé et son rouge à lèvres brillant et visqueux débordait jusque sur ses joues. Son mascara, qui avait coulé sous l’effet de la transpiration et des larmes, bavait au coin de ses yeux. Les boutons de son corsage étaient défaits, son sein gauche sorti, et ses cuisses, qui dépassaient de sa minijupe, semblaient roses de chaleur. Sa peau témoignait en divers endroits de caresses récentes. Elle n’avait qu’un seul de ses talons hauts bon marché en matière synthétique accroché au pied.
Elle s’interrompait enfin lorsqu’un oreiller projeté hors de la chambre l’atteignit en plein visage. Un nouveau cri s’éleva. L’oreiller déboula au milieu du palier, découvrant une taie maculée de rouge à lèvres.
Les autres clients, éberlués par les cris, venaient en tenue de nuit s’attrouper dans le couloir. Ma mère arriva à son tour..."
(Hoteru Airisu, ACTES SUD, 2000 pour la traduction française)
Dans "Revenge: Eleven Dark Tales" (Kamoku na shigai, Midara na tomurai, 1998), recueil de nouvelles (Tristes revanches), une femme entre dans une boulangerie pour acheter une tarte à la crème à la fraise, une boulangerie immaculée sans la moindre personne pour vous servir : elle attend, un autre client entre, autre client entre, la femme lui raconte qu'elle achète un gâteau à son fils pour chacun de ses anniversaires, même s'il est mort dans un accident à l'âge de six ans. Les récits s'enchaînent avec de nouveaux personnages et des thèmes complémentaires.
"C’était dimanche, et il faisait un temps absolument magnifique. Il n’y avait pas une ombre dans le ciel, un vent sec faisait trembler les feuillages et tout, à perte de vue, était auréolé de lumière. La tenture du marchand de glaces, les yeux d’un chat, le robinet de la fontaine publique, et même le socle de l’horloge recouvert de fientes de pigeon, tout étincelait fièrement.
La place était envahie par des gens qui profitaient joyeusement de leur jour de congé. Le marchand de ballons transformait les baudruches en différentes têtes d’animaux dans un joli petit chuintement. Les enfants levaient la tête vers lui avec curiosité. Une dame était assise sur un banc à tricoter. Un klaxon résonna quelque part, les pigeons s’envolèrent tous ensemble. Surpris, un bébé se mit à pleurer, et sa mère le souleva avec douceur pour le prendre dans ses bras.
Cette scène parfaite, où rien ne manquait, rien n’était abîmé, réfléchissait la lumière. En l’observant intensément, on avait l’impression que l’on pouvait toujours l’inspecter de fond en comble, il n’y avait rien de perdu dans cet univers.
Il n’y avait personne dans la boutique. Je poussai la porte tournante, et dès le moment où je me retrouvai à l’intérieur, le brouhaha de la place s’éloigna. Il fut remplacé par un doux parfum de vanille.
— Il y a quelqu’un ? appelai-je avec hésitation, et comme je n’obtenais pas de réponse, je décidai d’attendre en m’asseyant sur un tabouret dans un coin.
C’était la première fois que j’entrais dans cette boutique. Elle était petite et bien agencée, pas trop décorée et propre. Les gâteaux, les chaussons et les chocolats étaient sagement rangés dans leur vitrine réfrigérée, tandis que de part et d’autre, sur des rayonnages, s’alignaient les boîtes métalliques de biscuits et que sur le comptoir du fond, près de la caisse, s’entassaient des pochettes en papier décorées de jolis petits carreaux orange et bleu ciel..."
(nouvelles traduites du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle, Actes Sud 2004)
Dans "Le Musée du Silence" (Chinmoku Hakubutsukan, 2000), un jeune homme, un muséographe, se voit charger de créer un musée très particulier dans un manoir, aux confins du monde et sous la direction d'une étrange vieille dame, il s'agit de mettre en scène des objets et reliques tous volés quelques heures après la mort de leur propriétaire.

Dans "La Formule préférée du Professeur" (Hakase no aishita sushiki no ai, 2003, The Housekeeper and the Professor), la narratrice est une aide-ménagère placée chez un mathématicien, qui vit seul avec son fils et qui doit tous les jours reconstituer sa mémoire, conséquence d'un accident de voiture il y a de nombreuses années. Mais chaque nouvelle équation, chaque nouvelle énigme mathématique semble forger des liens particuliers entre les trois êtres: "eternal truths are ultimately invisible, and you won’t find them in material things or natural phenomena, or even in human emotions. Mathematics, however, can illuminate them, can give them expression — in fact, nothing can prevent it from doing so.."
Dans "La Marche de Mina" (Mina no koshin, 2006), la narratrice, Tomoko, est une jeune fille de douze ans, de santé fragile, qui vit chez son oncle et sa tante, Rosa, son père étant mort, sa mère partie, elle passe ses journées à lire et à collectionnes des boîtes d'allumettes illustrées, à regarder la télévision et entendre Rosa évoquer son Allemagne natale, un hippopotame nain vit dans le jardin...

La littérature mondialisée n'est peut-être pas aussi artificielle et vaine que nous pourrions le croire, livrée uniquement à une recherche
détaillée de documentation plus que d'inspiration, à la manière de ces nombreux écrivains latino-américains qui tente de partager avec leurs lecteurs et éditeurs le spectacle de la vie
mondialisée, rejetant leurs scènes nationales et en plaçant délibérément leurs fictions dans un coin d'Asie. La croissance rapide et le succès des sociétés asiatiques du Sud-Est les placent en
excellente position pour incarner les processus de mondialisation d'aujourd'hui ou de demain. Le mexicain Jorge Volpi (1958), avec "En busca de Klingsor" (1998), ou l'argentin Patricio Pron
(1975), avec "El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan" (200) ont quant à eux fait le choix de l'Allemagne.
Ou livrée à une écriture simplifiée qui facilite le travail de traduction et la compréhension quelque soit la nationalité de son lectorat, pour privilégier
les fameuse thématiques dites sociétales auxquelles font déjà appel les productions cinématographiques du monde entier. "La mondialisation, comme le bien et le mal, n'est rien en soi ", a rappelé
un jour Le Clézio, c'est la pensée qui la rend ainsi, la littérature reste un art qui s'oppose absolument à toute perte d'identité. "Un homme ne devient réel qu'en faisant face à la solitude", a
écrit Gao Xingjian (1940), écrivain partagé entre deux cultures et auteur engagé de "La Montagne de l'âme" (1990), et ce solitaire qu'est l'être humain est un être pensant, le seul en mesure de
remettre en question le sens de l'existence et de comprendre avec parfois une certaine désespérance, ce qu'est la liberté. "De plus en plus de gens se consacrent à l'écriture. J'espère que la
littérature deviendra un refuge en cette ère de pauvreté spirituelle et laissera des traces de vie, même si elle est petite. Cela nous donne l'espoir que la littérature d'aujourd'hui ne diminuera
pas"...
L'industrie responsable de la production da la romance érotique "Fifty Shades of Grey" est également capable de produire les œuvres du japonais Murakami ou
du chinois Liu Zaifu, de l'allemand Ingo Schulze ou du nigérian Ben Okri. Quelques romans, quelques écrivains, sans frontières établies et pérennes, semblent nous convaincre de cette ouverture
possible, et balaient toutes ces sombres prédictions de la fin de la Littérature victime de la mondialisation : "Snow" (2002), du turc Orhan Pamuk, "2066" (2004), du chilien Roberto Bolaño,
"1Q84" (2009) du japonais Haruki Murakami, "Americanah" (2013), de la nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, "The Reluctant Fundamentalist" (2007), du pakistanais Mohsin Hamid, "Oryx and
Crake" (2003), de la canadienne Margaret Atwood, "L'amica geniale" (2011) ou autres best-sellers traduits dans plus de cinquante pays de l'italienne, pseudonyme ou pas, Elena
Ferrante.

Mais qu'entendons-nous par "littérature de la mondialisation", parlons nous en terme de thématiques mises en oeuvre et partagées par les médias du
monde entier, de lecteurs et d'un public couvrant potentiellement la Terre entière quelque soit leur culture et leur langue, de l'hégémonie prise par une langue sur toutes autres langues
("l'Amérique est un pays si grand et si diversifié qu'il est presque un monde à lui tout seul")? Le critique littéraire américain Adam Kirsch (1976), dans "The Global Novel, Writing the World
in the 21st Century" (2017), partant des écrivains cités précédemment, nous explique que la littérature à l'heure de la mondialisation, sous le vocable de "roman mondial" (global novel),
"n'est pas tant un genre qu'une façon d'imaginer le monde (a way of imagining the world), un genre qui permet au roman d'aborder à la fois les préoccupations contemporaines urgentes, comme le
changement climatique, le génie génétique et l' immigration, et des thèmes intemporels comme la moralité, la société et les relations humaines", avec des intrigues qui situent désormais leurs
personnages dans une perspective globale balayant le spectre le plus large de ce qu'est capable de produire l'imagination humaine. Quant au lectorat (readership), les gens qui lisent cette
littérature mondiale ne sont-ils probablement que des lecteurs pré-existants, cosmopolites dans leurs goûts culturels comme dans leurs opinions politiques. Il est sans doute vain par ailleurs de
vouloir définir une littérature "reflet de la mondialisation", ce serait au fond comme s'interroger sur la possibilité d'une "conscience globale"...
Mais il est indéniable qu'avant d'évoquer la problématique de la littérature d'une manière globale, il nous faut bien reconnaître une formidable
interpénétration des cultures et des langues (homogénéisation et appropriation culturelle), une certaine standardisation à l'échelle de la planète des conditions sociales, économiques et
politiques, des conditions d'exercice de la pensée, et c'est le nombre croissant des populations impactées qui porte les éléments d'une évolution de fond des mentalités. De là, la
littérature creuse son sillon. Tout en admettant que nous construisons tous la réalité de nos existence en partant de notre expérience, c'est-à-dire de situations individuelles et locales pour
nous élever vers l'universel, et c'est vrai qu'au XXIe siècle, nous sommes tous de plus en plus conscients de vivre dans un contexte social mondial, d'une manière qui n'est plus celle des formes
classiques du roman et du romantisme qui n'accédait à l'universel que par les seules énergies de l'individuel.
