- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

Ferdinand Tönnies
(1855-1936), "Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887) - Georg Simmel (1858-1918), "Einleitung in die Möralwissenschaft" (Introduction aux science morales, 1892-1893), "Philosophie des Geldes"
(1900), "Die Großstädte und das Geistesleben" (1903), "Soziologie" (1908), "Leebensanschauung, vier metaphysischeKapitel" (L'Intuition de la vie, 1918) - .....
Last update: 31/11/2016

C'est la révolution industrielle qui a drainé vers les villes et leurs usines, aux Etats-Unis comme en Europe, des millions de travailleurs, industrialisation, essor du capitalisme et vie urbaine constituent les dimensions essentielles de cette modernité qui se construit au tout début du XXe siècle entraînant dans leur sillage nombre de mutations. Karl Marx attribue ces mutations de l'ordre social au capitalisme, Emile Durkheim à l'industrialisation, - la division du travail instaure une "soldiraté organique" qui rend les individus interdépendants (1893), Max Weber à la rationalisation, - tout en s'alarmant de ses effets déshumanisants (1904-1905). Alors que Ferdinand Tönnies, en 1887, déplore le déclin des liens communautaires au profit des relations impersonnelles qui caractérisent la société moderne, Georg Simmel est le premier à pousser l'hypothèse que c'est l'urbanisation elle-même qui modifie les interactions sociales entre les individus. C'est dans "Les Grandes Villes et la vie de l'esprit" que Georg Simmel, en 1903, décrira la ville comme une source d'aliénation et d'indifférence, étudiant tant les formes d'ordre social qui s'y constituent que les effets sur l'existence des individus plongés dans une vie collective d'autant plus vaste qu'ils se retrouvent le plus souvent coupés de leur communauté d'origine et de leur famille. Vingt ans plus tard, dans les années 1920, Robert Ezra Park et ses confrères de l'école de Chicago se consacreront à l'étude de la "vie urbaine" et à celle des structures sociales de la ville ...
- Ludwig Meidner (1884-1966), "Ich und die Stadt" (1913) -

Ferdinand Tönnies et Georg Simmel, deux pères fondateurs de la sociologie allemande, nous ont légué des concepts fondamentaux pour comprendre la modernité via deux paradoxes,
- Le paradoxe de la connexion : nous sommes plus connectés que jamais (Gesellschaft, réseaux), mais cette hyper-connexion s'accompagne souvent d'un sentiment de solitude et d'une quête de liens authentiques (Gemeinschaft).
- Le paradoxe de l'individu : la modernité nous libère des cadres traditionnels pour affirmer notre individualité, mais cette même liberté peut être écrasante et nous pousser à adopter des comportements standardisés (via la mode, les algorithmes) pour exister socialement.
Ferdinand Tönnies (1855-1936) introduit dans son œuvre maîtresse, "Communauté et Société" (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887), une distinction conceptuelle devenue centrale en sociologie ...
- Gemeinschaft (Communauté) : C'est la forme de vie sociale traditionnelle, fondée sur les liens organiques, l'affectivité, la parenté, le voisinage, les traditions partagées et un fort sentiment d'appartenance. La famille, le village, les communautés religieuses en sont des exemples. Les relations sont une fin en soi.
Les réseaux sociaux numériques , sont-ils une nouvelle forme de Gemeinschaft (communautés en ligne, groupes d'intérêt, sentiment d'appartenance) ?
- Gesellschaft (Société) : C'est la forme de vie sociale moderne, fondée sur l'association volontaire, le contrat, l'intérêt individuel, l'échange marchand et la rationalité. Les relations y sont souvent un moyen pour atteindre un but (travailler, échanger, négocier). La grande ville, l'entreprise, l'État moderne en sont des archétypes.
Les réseaux sociaux numériques sont-ils l'archétype de la Gesellschaft (relations instrumentalisées, marchandisation des données, individualisme et "personal branding") ? Ils sont les deux à la fois, Gemeinschaft et Gesellschaft, ce qui explique sans doute leurs ambivalences.
Pour Tönnies, le passage historique de la Gemeinschaft à la Gesellschaft est le trait marquant de la modernisation.
Georg Simmel (1858-1918) est le sociologue de la modernité urbaine et des formes subtiles des interactions sociales. Il a analysé les conséquences psychologiques et sociales de la vie moderne ...
- Dans "Die Großstädte und das Geistesleben" (1903, "Les grandes villes et la vie de l'esprit"), il décrit comment l'environnement surstimulant de la grande ville (les flux, les bruits, les rencontres anonymes) pousse l'individu à développer une attitude de réserve, une "attitude blasée" et un intellectualisme pour se protéger. C'est la naissance de l'individualité moderne. Simmel ne se contente pas de décrire une "pathologie" urbaine mais tente d'expliquer comment l'environnement de la grande ville fabrique un nouveau type de personnalité individuelle, à la fois plus libre et plus distante.
- Dans "Philosophie des Geldes" (1900, La Philosophie de l'argent), Simmel montre comment l'argent, en tant qu'outil purement quantitatif et impersonnel, rationalise les relations sociales, les rendant plus libres (on n'est plus lié par des statuts fixes) mais aussi plus froides et calculatrices. Notre vie est de plus en plus régie par des logiques financières et des métriques (likes, indicateurs de performance, scores de crédit). Simmel nous fournit les outils pour comprendre les effets de cette quantification sur nos relations et notre psyché.
- Enfin, son analyse de "l'étranger" (celui qui est à la fois dans le groupe et en dehors, "Exkurs über den Fremden") est d'une pertinence brûlante pour penser les questions d'immigration, d'intégration et de cosmopolitisme. Elle figure dans son œuvre majeure de sociologie, tout simplement intitulée "Sociologie : Recherches sur les formes de la socialisation" (Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung), publiée en 1908.

Georg Simmel (1858-1918)
Né à Berlin, élève du grand historien allemand Theodor Mommsen, puis professeur de philosophie dont les idées furent peu partagées par les autorités de l'université de Berlin, malgré le soutien de Weber et de Tönnies, Simmel rejette la conception de Kant qui aboutit à maintenir comme un absolu les formes de la pensée, des catégories. Pour Simmel, il n'y a pas un "esprit" mais autant de conception du monde que d'individus. Et plus encore, il n'y a pas "une" philosophie, mais des contenus de pensée générés par des circonstances individuelles ou collectives, et qui n'ont donc de valeur que comme des témoignages historiques de l'humanité. Comment donc appréhender ces réalités sociales qui résultent d'une multitude d'actions individuelles, si ce n'est en s'appuyant des "formes", des constructions mentales : Simmel apparaît ainsi comme le fondateur de la "sociologie formelle". Il est assez proche de l' "idéal-type" qu'utilise Max Weber, mais aux antipodes d'un Durkheim qui entend dégager des sociologiques universelles. Par le biais de ces "formes", Simmel va tenter de rendre compréhensibles certaines situations sociales , mais il lui paraît inutile de chercher à reproduire une réalité qui reste inaccessible par sa complexité. Et plus encore, cette recherche de régularités sociales macroscopiques universelles est totalement sans intérêt. C'est avec cette démarche intellectuelle que Simmel construit sa fameuse "Philosophie de l'argent"(Philosophie des Geldes, 1900)...

"Philosophie de l'argent"(Philosophie des Geldes, 1900)
"Die Ordnung der Dinge, in die sie sich als natürliche Wirklichkeiten einstellen, ruht auf der Voraussetzung, daß alle Mannigfaltigkeit ihrer Eigenschaften von einer Einheit des Wesens getragen werde: die Gleichheit vor dem Naturgesetz, die beharrenden Summen der Stoffe und der Energien, die Umsetzbarkeit der verschiedenartigsten Erscheinungen ineinander versöhnen die Abstände des ersten Anblicks in eine durchgängige Verwandtschaf, in eine Gleichberechtigtheit aller."
Simmel, dans cet ouvrage, entend répondre à deux questions fondamentales, comment l'échange monétaire entre les hommes a-t-il été rendu possible, quelles sont les conséquences de l'invention et de la généralisation de l'argent comme intermédiaire universel des échanges entre les hommes? Il engage ainsi une réflexion philosophique sur la culture, empreinte de cette nostalgie que l'on retrouve chez Oswald Spengler : Les hommes et les valeurs se sont effacés au profit des objets, de la quantité, la spécificité de l'argent est bien cette indifférence à toute valeur, ce n'est qu'un modèle de l'enchaînement des moyens et des fins.
« Il y a société, au sens large du mot, partout où il y a action réciproque des individus. Depuis la réunion éphémère de gens qui vont se promener ensemble jusqu’à l’unité intime d’une famille ou d’une ghilde du moyen âge, on peut constater les degrés et les genres les plus différents d’association. Les causes particulières et les fins, sans lesquelles naturellement il n’y a pas d’association, sont comme le corps, la matière du processus social ; que le résultat de ces causes, que la recherche de ces fins entraîne nécessairement une action réciproque, une association entre les individus, voilà la forme que revêtent les contenus. Séparer cette forme de ces contenus, au moyen de l’abstraction scientifique, telle est la condition sur laquelle repose toute l’existence d’une science spéciale de la société. Car il apparaît tout de suite que la même forme, la même espèce d’association peut s’adapter aux matières, aux fins les plus différentes. Ce n’est pas seulement l’association d’une façon générale qui se trouve aussi bien dans une communauté religieuse que dans une conjuration, dans une alliance économique que dans une école d’art, dans une assemblée du peuple que dans une famille, mais des ressemblances formelles s’étendent encore jusqu’aux configurations et aux évolutions spéciales de ces sociétés. Dans les groupes sociaux, que leurs buts et leurs caractères moraux font aussi différents qu’on peut l’imaginer, nous trouvons par exemple les mêmes formes de la domination et de la subordination, de la concurrence, de l’imitation, de l’opposition, de la division du travail, nous trouvons la formation d’une hiérarchie, l’incarnation des principes directeurs des groupes en symboles, la division en partis, nous trouvons tous les stades de la liberté ou de la dépendance de l’individu à l’égard du groupe, l’entrecroisement et la superposition des groupes mêmes, et certaines formes déterminées de leur réaction contre les influences extérieures. Cette ressemblance des formes et des évolutions qui se produit souvent au milieu de la plus grande hétérogénéité des déterminations matérielles des groupes, y révèle, en dehors de ces déterminations, l’existence de forces propres, d’un domaine dont l’abstraction est légitime ; c’est celui de l’association en tant que telle et de ses formes. Ces formes se développent au contact des individus, d’une façon relativement indépendante des causes matérielles (actuelles, singulières) de ce contact, et leur somme constitue cet ensemble concret qu’on appelle, par abstraction, société.
A vrai dire, dans les phénomènes historiques particuliers, le contenu et la forme sociale constituent en fait une combinaison indissoluble ; il n’y a pas de constitution ou d’évolution sociale qui soit purement sociale, et qui ne soit pas en même temps constitution ou évolution d’un contenu. Ce contenu peut être d’espèce objective : la production d’une œuvre, le progrès de la technique, le règne d’une idée, la prospérité ou la ruine d’un groupe politique, le développement du langage ou des mœurs. Il peut être aussi de nature subjective, c’est-à-dire concerner les innombrables parties de la personne que la socialisation renforce, satisfait, développe dans la direction de la moralité ou de l’immoralité. Mais cette pénétration absolue du contenu et de la forme, telle qu’elle se présente dans la réalité historique, n’empêche pas la science de les dissocier par l’abstraction; c’est ainsi que la géométrie ne considère que la forme spatiale du corps, qui, cependant, n’existe pas pour elle seule, mais toujours dans et avec une matière, laquelle est l’objet d’autres sciences. Même l’historien, au sens étroit du mot, n’étudie qu’une abstraction des événements réels. Lui aussi, il détache de l’infinité des actions et des paroles réelles, de la somme de toutes les particularités intérieures et extérieures les processus qui rentrent sous des concepts déterminés. Ce n’est pas tout ce que Louis XIV ou Marie-Thérèse ont fait du matin au soir, ce ne sont pas tous les mots de hasard dont ils ont couvert leurs résolutions politiques, ni tous les innombrables événements psychiques qui les ont précédés, rattachés à elles par une nécessaire liaison de fait, mais non par un rapport objectif, ce n’est pas tout cela qui entrera dans l’« histoire » ; mais le concept de l’importance politique sera appliqué aux événements réels, on ne recherchera et on ne racontera que ce qui lui appartient, ce qui, à vrai dire, en fait, n’a pas été ainsi réel, c’est-à-dire n’est pas arrivé selon cette pure cohérence intérieure et conformément à cette abstraction. De même l’histoire économique isole en quelque sorte tout ce qui concerne les besoins corporels de l’homme et les moyens d’y satisfaire de la totalité des événements, quoique, peut-être, il n’y ait pas un seul de ceux-ci qui n’ait, en réalité, quelque rapport à ces besoins. La sociologie comme science particulière ne procédera pas autrement. Elle abstrait, pour en faire l’objet d’une observation spéciale, les éléments, le côté purement social de la totalité de l’histoire humaine, c’est-à-dire de ce qui arrive dans la société - autrement dit, pour l’exprimer avec une concision un peu paradoxale, elle étudie dans la société ce qui n’est que « société ». ( "Comment les formes sociales se maintiennent", Article de l'Année sociologique, 1896-1897)
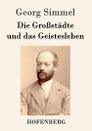
"Les grandes Villes et la vie de l'esprit" (Die Großstädte und das Geistesleben, 1903)
"Die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Individuums, die Selbständigkeit und Eigenart seines Daseins gegen die Übermächte der Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens zu bewahren – die letzterreichte Umgestaltung des Kampfes mit der Natur, den der primitive Mensch um seine leibliche Existenz zu führen hat."
"Ce qui frappe d’emblée, à la lecture des « Grandes villes et la vie de l’esprit », c’est son ancrage contemporain. À la différence de ses collègues Max Weber et Werner Sombart, qui se sont principalement intéressés à l’histoire économique et sociale de la ville médiévale et moderne, comme lieu de naissance de la bourgeoisie2, Simmel porte exclusivement son attention sur l’émergence de la métropole contemporaine (Großstadt), dont Berlin est alors le paradigme en Allemagne. Même si la ville sur la Spree n’est mentionnée qu’une fois dans l’essai, il ne fait aucun doute qu’elle constitue le creuset dans lequel s’origine la pensée de Simmel..." (Préface)
Simmel cherche à comprendre l'impact psychologique et social de la métropole moderne sur l'individu. Sa thèse est que l'environnement surstimulant de la grande ville provoque le développement d'une attitude intellectuelle, rationnelle et blasée comme mécanisme de défense et d'adaptation. Cette attitude constitue le fondement de la liberté individuelle moderne, mais au prix d'une certaine froideur dans les relations sociales...
"Le citadin type se crée un organe protecteur contre le déracinement dont le menacent les courants divergents de son milieu externe". La révolution industrielle du XIXe siècle entraîne une forte urbanisation, et la ville porte en elle un nouvel environnement paradoxal, un moyen de s'affranchir des contraintes sociales traditionnelles mais aussi division et spécialisation du travail et nouvelles formes d'aliénation. Simmel tente de comprendre comment l'être humain de la cité parvient à maintenir son autonomie et la singularité de son existence. Face au rythme de cette nouvelle vie urbaine, le citadin doit réagir non plus avec le "coeur" mais avec "l'intellect", il doit ériger autour de lui un rempart d'indifférence affectée qui permet la survie sociale. Et c'est au détour de cette analyse que surgit la célèbre digression de Simmel sur la figure de l'étranger qu'il développera dans "Soziologie" (1908) : l' "étranger" est désormais une figure incontournable du paysage urbain qui s'installe, il est "celui qui vient aujourd'hui et qui reste demain", à la fois proche et éloigné, analysé par Simmel non comme un "individu" mais comme un "type social" (Exkurs über den Fremden, 1908).
"Les problèmes les plus profonds de la vie moderne découlent de la tentative de l'individu de maintenir l'indépendance et l'individualité de son existence contre les puissances souveraines de la société, contre le poids du patrimoine historique et la culture et la technique extérieures de la vie. L'antagonisme représente la forme la plus moderne du conflit que l'homme primitif doit exercer sur la nature pour sa propre existence corporelle. Le dix-huitième siècle peut avoir appelé à la libération de tous les liens qui ont grandi historiquement dans la politique, la religion, la morale et l'économie, pour permettre à la vertu naturelle originelle de l'homme, égale en chacun, de se développer sans inhibition; Le dix-neuvième siècle a pu chercher à promouvoir, outre la liberté de l'homme, son individualité (qui est liée à la division du travail) et ses réalisations qui le rendent unique et indispensable, mais qui le rend d'autant plus dépendant L'activité complémentaire des autres; Nietzsche peut avoir vu la lutte acharnée de l'individu comme la condition préalable à son développement complet, tandis que le socialisme a trouvé la même chose dans la suppression de toute concurrence - mais dans chacun d'eux le même motif fondamental était à l'œuvre, à savoir la résistance de l'individu à être nivelé, englouti dans le mécanisme socio-technologique..."
Le Choc des Stimuli : La Base du Problème - La grande ville se caractérise par une intensité et une rapidité inédites des stimuli nerveux : flux incessants de personnes, de véhicules, de publicités, de bruits, et d'interactions sociales brèves et anonymes. Contrairement au milieu rural où la vie est plus lente et les stimuli plus rares et familiers, la métropole expose l'individu à un bombardement sensoriel permanent.
Les Mécanismes de Défense Psychique - Pour se protéger de cette surcharge et éviter la désintégration psychique, l'individu métropolitain développe trois attitudes principales ...
- L'Intellectualité (l'Attitude de l'Esprit) : L'individu réagit de manière plus cognitive qu'émotionnelle. Il remplace les réactions impulsives et sentimentales par un calcul rationnel. Cette intellectualisation est une "protection de la vie intérieure" contre le chaos extérieur.
- L'Attitude Blasée : L'individu élève son seuil de réactivité. Rien ne semble plus devoir l'impressionner. Cette indifférence est le résultat de l'usure des nerfs face à des stimuli trop nombreux et changeants. Elle mène à une incapacité à distinguer les valeurs et les choses, qui paraissent toutes également insignifiantes et grises.
- La Réserve et l'Indifférence : Pour gérer l'anonymat et la promiscuité avec des inconnus, l'individu adopte une barrière intérieure de réserve et de discrétion. Cette indifférence mutuelle est une forme de politesse urbaine qui permet la coexistence pacifique dans la foule.
"... Il n’y a peut-être pas de phénomène de l’âme qui soit plus incontestablement réservé à la grande ville que le caractère blasé. Il est d’abord la conséquence de ces stimulations nerveuses qui changent sans cesse, étroitement enfermées dans leurs contradictions, et nous sont apparues comme les raisons du progrès de l’intellectualité dans la grande ville : c’est pourquoi aussi les hommes sots qui a priori n’ont pas de vie spirituelle ne sont pas blasés habituellement. De même qu’une vie de jouissance sans mesure rend blasé parce qu’elle excite les nerfs jusqu’aux réactions les plus fortes, si longtemps que finalement ils n’ont plus aucune réaction, chez eux les impressions, les plus anodines comprises, provoquent des réponses si violentes par leurs changements rapides et contradictoires, les bousculent si brutalement qu’ils donnent leur dernière réserve de forces et que, restant dans le même milieu, ils n’ont pas le temps d’en rassembler une nouvelle. L’incapacité qui en résulte, de réagir aux nouvelles stimulations avec l’énergie qui leur est appropriée, est justement ce caractère blasé que montre déjà tout enfant de la grande ville en comparaison des enfants de milieux plus tranquilles et moins changeants.
À cette source physiologique du caractère blasé de la grande ville s’ajoute l’autre source qui a cours dans l’économie monétaire. L’essence du caractère blasé est d’être émoussé à l’égard des différences entre les choses, non pas au sens où celles-ci ne seraient pas perçues comme c’est le cas pour les crétins, mais au contraire de telle sorte que l’on éprouve comme nulles l’importance et la valeur des différences entre les choses, et, par là, des choses elles-mêmes. Aux yeux du blasé, elles apparaissent d’une couleur uniformément terne et grise, indigne d’être préférée à l’autre. Cette attitude d’âme est le reflet subjectif fidèle de la parfaite imprégnation par l’économie monétaire ; pour autant que l’argent évalue de la même façon toute la diversité des choses, exprime par des différences de quantité toutes les différences respectives de qualité, pour autant que l’argent avec son indifférence et son absence de couleurs se pose comme le commun dénominateur de toutes les valeurs, il devient le niveleur le plus redoutable, il vide irrémédiablement les choses de leur substance, de leur propriété, de leur valeur spécifique et incomparable. Elles flottent toutes d’un même poids spécifique dans le fleuve d’argent qui progresse, elles se trouvent toutes sur le même plan et ne se séparent que par la taille des parts de celui-ci qu’elles occupent. Dans le détail, cette coloration ou plutôt cette décoloration des choses par leur équivalence avec l’argent peut être imperceptible ; mais dans le rapport que le riche a aux objets qui peuvent être acquis pour de l’argent et même peut-être déjà dans le caractère global que l’esprit public attribue maintenant partout à ces objets, il est amoncelé à une hauteur très remarquable...."
L'Économie Monétaire et la Rationalité - Simmel lie cette transformation psychique à l'économie dominante en ville : l'économie monétaire. L'argent est l'archétype de la rationalité et de la quantification. Il réduit toutes les qualités (la beauté, l'utilité, le sentiment) à une simple question de quantité. Cette logique imprègne la vie sociale : les relations deviennent plus calculées, impersonnelles et orientées vers un but. L'argent favorise ainsi l'intellectualité et la précision, mais au détriment des relations personnelles et affectives. Dans sa "Philosophie de l’argent", Simmel a longuement évoqué la façon dont l’économie monétaire a renforcé dans les grandes villes la propension à l’intellectualisation au détriment de la sensibilité5. Mais, dans l’essai de 1903, il insiste surtout sur la façon dont l’économie monétaire se ramifie dans les activités les plus ordinaires de la vie urbaine et s’imprègne dans la psyché des citadins.
L'Émergence de l'Individualité - Ce processus n'est pas seulement négatif. Pour Simmel, c'est le creuset de l'individualité moderne. En se libérant des contraintes émotionnelles et des contrôles sociaux étouffants des petites communautés (la Gemeinschaft de Tönnies), l'individu en ville gagne en liberté personnelle et en autonomie. La réserve et l'attitude blasée créent un "espace intérieur" où l'individu peut se développer de manière unique, loin du regard normatif et constant du village. L'excentricité et la singularité sont des produits de la métropole.
"L’individualisme de la vie moderne
Les problèmes les plus profonds de la vie moderne prennent leur source dans la prétention de l’individu à affirmer l’autonomie et la spécificité de son existence face aux excès de pouvoir de la société, de l’héritage historique, de la culture et de la technique venue de l’extérieur de la vie – figure ultime du combat contre la nature que l’homme primitif doit mener pour son existence physique. Le XVIIIe siècle a beau appeler à la libération de tous les liens qui se sont développés historiquement, entre l’État et la religion, entre la morale et l’économie, afin que la nature, bonne à l’origine, et identique chez tous les êtres humains, se développe sans entraves ; le XIXe siècle a beau revendiquer, à côté de la liberté pure et simple, la particularité de l’être humain et de sa production dans la division du travail, particularité qui constitue, sans comparaison ni exception possibles, l’individu, mais qui, de ce fait, lui impose d’autant plus d’être complété par tous les autres ; Nietzsche a beau voir dans le combat le plus dénué d’égards entre les particuliers la condition pour le complet développement des individus, et le socialisme a beau la trouver dans la réduction de toute concurrence – en tout ceci est à l’œuvre le même thème fondamental : l’opposition du sujet à être utilisé et nivelé dans un mécanisme, technico-social. Là où les produits de la vie spécifiquement moderne sont interrogés sur leur réalité intérieure, pour ainsi dire le corps de la culture est interrogé sur son âme – ce qui m’incombe aujourd’hui au sujet de nos métropoles –, la réponse devra rechercher l’équation, qui fonde une telle formation entre les contenus individuels de la vie et ses contenus supra-individuels, et rechercher les adaptations de la personnalité grâce auxquelles elle s’accommode des forces qui lui sont extérieures.
L’intellectualité de la vie dans la grande ville
La base psychologique, sur laquelle repose le type des individus habitant la grande ville, est l’intensification de la vie nerveuse, qui résulte du changement rapide et ininterrompu des impressions externes et internes. L’homme est un être différentiel, c’est-à-dire que sa conscience est stimulée par la différence entre l’impression du moment et la précédente ; des impressions persistantes, l’insignifiance de leurs différences, la régularité habituelle de leur cours et de leurs oppositions ont besoin de beaucoup moins de conscience que la poussée rapide d’images changeantes, ou l’écart frappant entre des objets qu’on englobe d’un regard, ou encore le caractère inattendu d’impressions qui s’imposent. Tandis que la grande ville crée justement ces conditions psychologiques – à chaque sortie dans la rue, avec le rythme et la diversité de la vie sociale, professionnelle, économique –, elle établit dès les fondements sensibles de la vie de l’âme, dans la quantité de conscience qu’elle réclame de nous en raison de notre organisation comme être différentiel, une profonde opposition avec la petite ville et la vie à la campagne, dont le modèle de vie sensible et spirituel a un rythme plus lent, plus habituel et qui s’écoule d’une façon régulière.
C’est pour cette raison que devient compréhensible avant tout le caractère intellectuel de la vie de l’âme dans la grande ville, par opposition à cette vie dans la petite ville, qui repose plutôt sur la sensibilité et les relations affectives. Car celles-ci s’enracinent dans les couches les moins conscientes de l’âme et s’accroissent le plus dans l’harmonie tranquille d’habitudes ininterrompues. Le lieu de l’intellect au contraire, ce sont les couches supérieures, conscientes, transparentes de notre âme ; il est la force la plus capable d’adaptation de nos forces intérieures ; pour s’accommoder du changement et de l’opposition des phénomènes, il n’a pas besoin des ébranlements et du retournement intérieur, qui seuls permettraient à la sensibilité, plus conservatrice, de se résigner à suivre le rythme des phénomènes. Ainsi, le type de l’habitant des grandes villes – qui naturellement existe avec mille variantes individuelles – se crée un organe de protection contre le déracinement dont le menacent les courants et les discordances de son milieu extérieur : au lieu de réagir avec sa sensibilité à ce déracinement, il réagit essentiellement, avec l’intellect, auquel l’intensification de la conscience, que la même cause produisait, assure la prépondérance psychique. Ainsi la réaction à ces phénomènes est enfouie dans l’organe psychique le moins sensible, dans celui qui s’écarte le plus des profondeurs de la personnalité.
L’impersonnalité des échanges
Pour autant que l’intellectualité est reconnue comme une protection de la vie subjective à l’encontre du pouvoir oppresseur de la grande ville, elle se ramifie en de multiples manifestations particulières et par leur moyen. Les grandes villes ont toujours été le siège de l’économie monétaire dans laquelle la multiplicité et la concentration des échanges économiques confèrent aux moyens d’échange eux-mêmes une importance que la limitation du commerce rural n’aurait pu permettre. Mais l’économie monétaire et la domination exercée par l’intellect sont en intime corrélation. Elles ont en commun la pure objectivité dans la façon de traiter les hommes et les choses, et, dans cette attitude, une justice formelle est souvent associée à une dureté impitoyable. L’homme purement rationnel est indifférent à tout ce qui est proprement individuel parce que les relations et les réactions qui en dérivent ne peuvent être entièrement épuisées par l’intellect logique – exactement de la même façon que l’individualité des phénomènes n’intervient pas dans le principe économique. L’argent n’implique de rapport qu’avec ce qui est universellement commun et requis pour la valeur d’échange, et réduit toute qualité et toute individualité à la question : combien ? Toutes les relations affectives entre les personnes se fondent sur leur individualité, tandis que les relations rationnelles traitent les êtres humains comme des nombres, des éléments indifférents par eux-mêmes, dont l’intérêt n’est que dans leur rendement objectif et mesurable – c’est ainsi que l’habitant de la grande ville traite ses fournisseurs, ses clients, ses domestiques et même les personnes envers qui il a des obligations sociales ; au contraire, dans un milieu plus restreint, l’inévitable connaissance des individualités engendre tout aussi inévitablement une tonalité plus affective du comportement, un dépassement de la simple évaluation objective de ce qu’on produit et de ce qu’on reçoit en contrepartie.
Du point de vue de la psychologie économique, l’essentiel est ici que, dans les rapports primitifs, on produit pour le client qui commande la marchandise, de sorte que production et client se connaissent mutuellement. Mais la grande ville moderne se nourrit presque complètement de ce qui est produit pour le marché, c’est-à-dire pour des clients tout à fait inconnus qui ne sont jamais vus par le producteur lui-même. C’est pourquoi une objectivité impitoyable affecte l’intérêt des deux parties ; leur égoïsme économique qui fait des calculs rationnels n’a nullement à craindre d’être dévié par les impondérables des relations personnelles. Et manifestement l’économie monétaire qui domine dans les grandes villes, qui en a chassé les derniers restes de la production personnelle et du troc et qui réduit de jour en jour le travail à la demande, est en corrélation si étroite avec cette objectivité rationnelle que personne ne saurait dire si ce fut d’abord cette conception issue de l’âme, de l’intellect, qui exerça son influence sur l’économie monétaire, ou si celle-ci fut le facteur déterminant pour la première. Il est seulement sûr que la forme de la vie des grandes villes est le sol le plus fécond pour cette corrélation ; j’en veux encore pour preuve le plus important historien anglais des constitutions ; dans le cours de toute l’histoire anglaise, Londres ne s’est jamais comporté comme le cœur de l’Angleterre, mais souvent comme sa raison et toujours comme son porte-monnaie !
L’exactitude des rapports
D’une façon non moins caractéristique, les mêmes courants de l’âme s’unissent à la surface de la vie en un trait apparemment insignifiant. L’esprit moderne est devenu de plus en plus calculateur. À l’idéal des sciences de la nature, qui est de faire entrer le monde dans un modèle numérique, de réduire chacune de ses parties en formules mathématiques, correspond l’exactitude calculatrice de la vie pratique, que lui a donnée l’économie monétaire ; c’est elle qui a rempli la journée de tant d’hommes occupés à évaluer, calculer, déterminer en chiffres, réduire les valeurs qualitatives en valeurs quantitatives. L’essence calculable de l’argent a fait pénétrer dans le rapport des éléments de la vie une précision, une sécurité dans la détermination des égalités et des inégalités, une absence d’ambiguïté dans les accords et les rendez-vous, ce qui est manifesté par la diffusion universelle des montres. Or, ce sont les conditions de la grande ville qui sont aussi bien cause qu’effet de ce trait. Les relations et les affaires de l’habitant type de la grande ville sont habituellement si diverses et si compliquées, et avant tout la concentration d’hommes si nombreux avec des intérêts si différenciés fait de ses relations et de ses actions un organisme si complexe, que, sans la ponctualité la plus exacte dans les promesses et dans leurs réalisations, tout s’écroulerait en un inextricable chaos. ..."
(Les grandes villes et la vie de l’esprit suivi de Sociologie des sens par Georg Simmel - Traduit de l’allemand par Jean-Louis Vieillard-Baron et par Frédéric Joly. Préface de Philippe Simay. - Éditions Payot)
Un Modèle Trop Généralisant ?
Simmel présente un modèle unique de l'expérience métropolitaine. Il ne rend peut-être pas assez compte de la diversité des vécus selon la classe sociale, le genre, l'origine ethnique ou le quartier. Un riche banquier et un livreur immigré ne développent pas la même "attitude blasée".
Une Vision Trop Négative des Émotions ? Sa dichotomie entre la raison (ville) et l'émotion (campagne) est peut-être trop rigide. Les villes sont aussi des lieux de passions, de solidarités et de mobilisations collectives intenses. L'émotion n'y disparaît pas, elle change de forme.
Simmel se concentre sur la psychologie de l'individu face à son environnement. Son approche, dite "formelle", néglige les structures économiques et politiques plus larges (le capitalisme industriel, l'État) qui façonnent la ville. Un marxiste lui reprocherait de ne pas assez parler des rapports de classe et de l'exploitation.
Sa description est profondément ancrée dans la Vienne ou le Berlin de la Belle Époque. Est-elle entièrement transposable aux mégalopoles du Sud global, comme Lagos ou Mumbai, où les dynamiques sociales et culturelles sont différentes ?
L'essai nous offre une grille de lecture intemporelle pour comprendre le prix psychique de la vie moderne, qu'elle soit urbaine ou numérique. Il nous rappelle que notre "moi" est toujours le produit d'une négociation constante avec un environnement social qui le dépasse et le forme. Malgré ses limites, sa puissance explicative en fait un texte incontournable pour quiconque cherche à comprendre les racines de notre condition moderne.

"Soziologie" (1908)
C'est dans "Soziologie" que Georg Simmel présente ses fameuses "digressions sur l'étranger", une figure qui n'est plus, en milieu urbain, aussi rare er passagère qu'elle le fut en milieu rural, une figure qui se lie à la communauté plus spatialement que socialement. C'est ainsi que se constitue le "type social" de l' "étranger" : on voit ainsi le citadin-type se créer un "organe protecteur contre le déracinement dont le menacent les courants divergents de son milieu externe..."
Principal représentant du relativisme philosophique contemporain, Simmel aboutit, dans la dernière partie de son œuvre, à une philosophie de l`existence considérée comme synthèse dynamique des rapports qui déterminent le réel. Le relativisme en tant que méthode consiste essentiellement à substituer à la définition, conception abstraite et unilatérale d'un domaine ou d'un aspect de la réalité, une analyse des structures complexes des rapports qui le constituent et le déterminent. Ainsi dans son Introduction aux sciences morales (Einleitung in die Moralwissenschaft, 1892), Simmel renonce-t-il à toutes les idéologies simplificatrices de l`expérience morale et aux concepts qui les expriment, pour n'examiner que les rapports diversement articulés qui déterminent la structure de cette expérience et qui constituent la sígnification intuitive de ces concepts.
Dans le domaine de la sociologie, Simmel rejette la conception positiviste de cette discipline en tant que théorie de la société et de tous ses contenus. ou en tant qu'explication des événements historiques d`après les forces et la configuration d`une société. Il estime qu'elle implique. d`une part, une indétermination foncière et, de l`autre, une idée tout à la fois abstraite et partielle de la société et de ses structures. A ses yeux, "la sociologie, en tant que science particulière, trouve son objet en considérant les faits selon un plan", selon un système de rapports qui est loin de les résumer tous, mais qui en détermine quelques aspects typiques. Ce plan est celui de la sociabilité...
"Une sociologie proprement dite étudiera uniquement ce qui est proprement social, la forme et les formes de l'association en tant que telle, abstraction faite des intérêts et des objets particuliers qui se réalisent dans l`association et grâce à l`association". Le concept de société est pris ici en une acception purement formelle, puisqu`il y a société "partout où plusieurs individus entrent en relation mutuelle". La sociologie étudie les formes de cette association, les divers types de rapports par lesquels les individus entrent en contact et constituent une unité. Une sociologie ainsi conçue, pure et formelle, est indépendante aussi bien de la philosophie que de l`histoire.

"Lebensanschauung, vier metaphysische Kapitel" (L'intuition de la vie, quatre chapitres métaphysiques, 1918)
Considéré comme la plus représentative, avec les "Problèmes fondamentaux de la philosophie", de la pensée de Georg Simmel, elle sera publiée l'année même de la mort de l`auteur. Le thème central est celui de la "transcendance de la vie". La vie est toujours enserrée dans des limites qu`elle franchit sans cesse, donnant lieu à des créations qui échappent à son propre flux et, de ce fait. la transcendent ; ainsi en va-t-il de toutes les formes spirituelles (science, art, religion. loi morale, etc.), surgies du flux concret de la vie qui conditionne leur actualisation. Mais elles échappent ensuite à ce flux, acquièrent une complète autonomie idéale, et retournent enfin dans la vie en tant que conscience directrice. La vie est donc "plus vie", par sa capacité d`assimiler des contenus qui ne lui appartiennent pas en propre, du moins à l`origine : et "plus que vie", parce que capable de se transcender elle-même. Une des limites rencontrées et surmontées par la vie est constituée par la mort : la mort est étroitement rattachée à l'individualité et même, métaphysiquement, s`identifie à elle ; seul l`individu meurt, et il meurt dans la mesure où son individualité est forte et bien marquée. Mais les contenus typiques et universels qu`il a produits lui survivent, d`où il semble que doit survivre l`essentiel de l`individualité : un tel fait trouve son expression dans le mythe de l`immortalité de l'âme. L`individu ne doit pas être entendu comme sujet biologique car il constitue lui-même une forme d`auto-transcendance de la vie, un universel typique, c`est-à-dire concret : la loi morale n'est donc pas une norme qui le transcende, mais un élément constitutif de son être propre; aussi, dire avec Simmel que la loi morale est individuelle ne signifie nullement qu'elle dépend de l'arbitraire des sujets empiriques, mais de l'essence même de la personnalité.
Simmel surmonte ainsi l`opposition entre vitalisme et intellectualisme ; s'il est vrai que les valeurs et la vérité dépendent et naissent de la vie, il n`en est pas moins vrai qu'elles se développent, selon leurs lois propres, sur un plan de complète autonomie, dont elles tirent des normes pour la vie elle-même.

Ferdinand Tönnies (1855-1936)
"La communauté est par essence plus ancienne que ses sujets ou que ses membres".
Né à Riep (Schesweig), agrégé de philosophie de l'université de Kiel en 1881, il n'est âgé que de ving-deux ans lorsqu'il fit paraître son ouvrage le plus connu, "Communauté et Société", dans lequel il replace au devant de la réflexion la notion de "communauté", notion jadis familière aux philosophes de l’Antiquité et aux théologiens de l’époque médiévale.
Partant du constat de la destruction du lien social liée à la montée de l’individualisme, Tönnies porte une vision qui influencera tant Max Weber que Georg Simmel.
Mais la vision de Tönnies est très conservatrice, il déplore la disparition de la communauté au profit de la modernité, il revient à Weber de développer à partir de ses intuitions le rôle de la volonté et de l'intuition.
Par la suite, il devint président de la société allemande de sociologie (Deutsche Gesellschaft für Soziologie, 1909) avec Werner Sombart et Max Weber, et en 1933, son opposition au national-socialisme lui valut d'être déchu de la dignité de professeur émérite. Son itinéraire spirituel est remarquablement restitué dans "Die Philosophie der Gegenwart in Selstdarstellungen" (1822).

Dans "Communauté et société" (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887), Tönnies, le premier, propose une analyse des formes d'appartenance aux groupes et de leurs fondements en partant des conséquences au niveau humain du passage de l'ère préindustrielle à l'ère industrielle. Les liens de nature individuelle, fondés sur le sang, l'affection, le respect et la crainte de la communauté traditionnelle, ont été remplacé par des liens d'ordre rationnel fondés sur le contrat et l'intérêt de la société moderne. Et tout concourt pour prévoir une société future, certes économiquement plus efficace, mais psychologiquement déprimante.
C'est dans ce cadre qu'il élabore donc sa célèbre distinction entre "Gemeinschaft" et "Gesellschaft", au fond entre société traditionnelle et société moderne.
- La Gemeinschaft ("communauté") décrit tout groupement "naturel", à forte dimension émotionnelle, fondé sur des liens objectifs (famille, ethnie, religion, appartenance villageoise, traditions, langue, références historiques...), et basée sur une "volonté organique". La communauté forme ainsi un tout homogène, un ensemble de consciences fortement dépendantes les unes des autres, une unité harmonieuse et spontanée où se réalise la fusion des membres, la communauté des traditions s’ajoutant à la communauté de sang, exprimant ainsi une morale "spontanée".
- La Gesellschaft ("société") est un groupement fondé sur le consentement et l'adhésion volontaire, un pur "produit de la pensée" (Gedankenprodukt), au fond une juxtaposition d’individus différents qui ne peuvent constituer une réelle unité que par suite d’un contrat ou d’un accord réfléchi. Le fait que cette repose désormais sur un lien rationnel et individualiste, permet de s'interroger sur sa solidité et sur l'organisation juridique qui le sous-tend, en comparaison du lien de solidarité ancré dans la Gemeinschaft.

Dans "Communauté et Société" (1887), Tönnies n'entend pas élaborer une description historique pure, mais proposer une opposition idéal-typique entre deux formes fondamentales de la vie sociale, deux modèles conceptuels permettant de comprendre l'évolution des sociétés occidentales...
- La Gemeinschaft (Communauté) est une forme de vie sociale organique, traditionnelle et fondée sur le sentiment d'appartenance. En son fondement, la volonté organique (Wesenwille), une volonté intrinsèque, naturelle, issue des traditions, des habitudes et des affections. Dans ce contexte, les liens sociaux sont primaires, intimes, durables et désintéressés. Ils précèdent l'individu et le constituent. Parmi les exemples types, la famille (lien du sang), le village (lien du voisinage), la paroisse (lien spirituel). La régulation sociale s'effectue par les coutumes, la religion, le droit coutumier. Les valeurs privilégient la solidarité, la confiance, l'entraide, la recherche du bien commun.
- La Gesellschaft (Société) est une forme de vie sociale artificielle, moderne et fondée sur l'intérêt et le calcul. A son origine, la volonté réfléchie (Kürwille), une volonté instrumentale, rationnelle, qui calcule les moyens pour atteindre une fin. Ici les liens sociaux sont secondaires, contractuels, impersonnels et temporaires. L'individu est premier ; il entre en relation avec les autres par choix. Les exemples types : la ville (anonymat), l'entreprise (contrat de travail), l'État moderne (contrat social). La régulation se fait par le droit positif, les contrats, la réglementation. Les valeurs associées sont l'intérêt individuel, la compétition, l' échange, l'efficacité.
- De la transition historique Gemeinschaft / Gesellschaft ...
Pour Tönnies, l'histoire de l'Occident est marquée par un passage progressif, et souvent regretté, de la Gemeinschaft à la Gesellschaft. La modernité (industrialisation, urbanisation, capitalisme) détruit les solidarités communautaires traditionnelles pour les remplacer par des relations impersonnelles et marchandes. C'est une vision souvent interprétée comme pessimiste.

La distinction de Tönnies semble extrêmement pertinente pour analyser les réseaux sociaux numériques, qui semblent mêler les deux logiques de manière paradoxale ...
- Les réseaux sociaux comme "Société" (Gesellschaft)
En s'inscrivant, l'utilisateur accepte des conditions d'utilisation (CGU), un contrat. Les individus gèrent stratégiquement leur image (personal branding), cherchent à maximiser leur audience (likes, abonnés) et monétisent parfois leur présence. Les interactions peuvent être très superficielles, avec des "amis" que l'on ne connaît pas vraiment. Les plateformes sont des entreprises qui monétisent les données des utilisateurs (capitalisme de surveillance). Sous cet angle, les réseaux sociaux sont l'archétype de la Gesellschaft moderne, un espace de connexions larges mais faibles, fondé sur l'intérêt et la performance individuelle.
- La quête de "Communauté" (Gemeinschaft) dans les réseaux sociaux
Paradoxalement, les réseaux sociaux sont aussi le lieu d'une recherche effrénée de communauté. Les groupes Facebook, les serveurs Discord ou les subreddits recréent des micro-communautés basées sur des passions communes (un hobby, une maladie, un lieu de résidence), une identité partagée ou des convictions. Dans ces espaces, on peut observer de l'entraide, du partage désintéressé et la formation de véritables liens d'amitié ou de solidarité. Ces groupes fournissent un "chez-soi" virtuel, une reconnaissance que l'individu ne trouve plus toujours dans son environnement géographique.
Les réseaux sociaux apparaissent ainsi comme un hybride complexe qui offre l'infrastructure technique de la Gesellschaft (plateforme marchande et contractuelle) pour y loger des expériences sociales qui aspirent à la Gemeinschaft (communauté, authenticité, solidarité). Cette tension est au cœur de nombreuses frustrations et espoirs liés à ces plateformes.
Le concept de "communautarisme" semble directement éclairé par la grille de Tönnies ...
- Le communautarisme comme réaction à la Société (Gesellschaft)
La montée des revendications communautaires (ethniques, religieuses, culturelles, LGBTQ+, etc.) peut être interprétée comme une réaction à l'individualisme et à l'impersonnalité de la Gesellschaft. Dans une vaste société individualiste et compétitive, l'individu peut se sentir perdu et anonyme (perte de repères). Le repli sur une communauté (réelle ou choisie) offre un cadre rassurant, un sentiment d'identité collective et des liens de solidarité concrets que la société globale ne fournit plus (Besoin d'identité et de solidarité). Le communautarisme peut s'apparenter à une recherche de Gemeinschaft dans un monde dominé par la logique de la Gesellschaft.
Une analogie qui n'est pas sans limites. Les communautés de Tönnies étaient souvent héritées (famille, village). Les communautés modernes sont fréquemment choisies ou revendiquées, ce qui est un acte d'individu typique de la Gesellschaft. La notion de "communauté" peut être instrumentalisée pour créer des frontières et de l'exclusion, ce qui est éloigné de l'idéal de solidarité organique de Tönnies. Enfin, la logique communautaire (Gemeinschaft) entre souvent en tension avec les valeurs universalistes et citoyennes de la société moderne (Gesellschaft), qui prône l'égalité des individus abstraction faite de leurs appartenances particulières.

Bien des auteurs ont largement repris la distinction de Tönnies, mais en la complexifiant : elle n'est plus vue comme une succession historique linéaire, mais comme deux logiques sociales qui coexistent et s'entremêlent dans les sociétés contemporaines.
Les communautés, par exemple, ne sont plus seulement héritées (famille, village), mais de plus en plus choisies, électives et fluides (réseaux en ligne, tribus, groupes d'affinité). Et la Gesellschaft (capitalisme, mondialisation, réseaux techniques) fournit souvent l'infrastructure sur laquelle se reconstruisent les nouvelles formes de Gemeinschaft. La distinction de Tönnies n'est donc pas, loin de là, une relique du passé, mais un outil heuristique remarquablement ouvert qui continue d'inspirer les analyses des bouleversements sociaux liés au numérique et aux recompositions identitaires ..
Barry Wellman et la "Communauté en réseau" (Networked Individualism)
Wellman est un auteur clé qui a modernisé les concepts de Tönnies. Pour lui, les sociétés développées sont passées de groupes sociaux liés à un territoire (le village, la Gemeinschaft) à des réseaux personnels individualisés. C'est une nouvelle forme sociale. Les individus ne sont plus enfermés dans des communautés uniques et contraignantes, mais construisent et entretiennent eux-mêmes leurs réseaux personnels à travers différentes sphères (travail, amis, famille en ligne, centres d'intérêt).
Cette "communauté en réseau" combine des aspects des deux modèles,
- Gesellschaft : L'individu est au centre, il choisit stratégiquement ses liens (volonté réfléchie).
- Gemeinschaft : Ces réseaux peuvent fournir un soutien émotionnel, une solidarité et un sentiment d'appartenance très forts (volonté organique), mais de manière éclatée et non-localisée.
Les "Communautés imaginées" en ligne (Benedict Anderson)
Benedict Anderson, pour décrire les nations, a forgé le concept de "communautés imaginées" (des gens qui ne se connaîtront jamais mais qui partagent un sentiment de fraternité). Ce concept est largement appliqué aux communautés en ligne. Les groupes sur Facebook, les "fandoms" sur Twitter (X), les joueurs d'un même MMORPG forment des "communautés imaginées" numériques. Cela correspond à une Gemeinschaft moderne : le sentiment d'appartenance est réel et puissant, mais il est construit sur une base symbolique et médiatique, et non sur des interactions face-à-face continues.
La recherche de l'authenticité et les "Communautés affectives" (Zygmunt Bauman)
Le sociologue Zygmunt Bauman, avec son concept de "société liquide", offre une relecture pessimiste. Pour Bauman, la modernité est le triomphe de la Gesellschaft : les liens sont fragiles, temporaires et remplaçables ("amitiés" Facebook, relations "jetables"). Dans ce contexte, les réseaux sociaux sont le lieu d'une quête désespérée de communauté (Gemeinschaft). Les individus cherchent des "tribus", des groupes de reconnaissance, pour échapper à la liquidité et à l'anonymat de la société moderne. Cependant, ces communautés en ligne sont souvent elles-mêmes "liquides" : on y adhère et on les quitte facilement. Elles deviennent des "coquilles vides de communauté" où la performance de l'authenticité prime parfois sur l'authenticité elle-même.

Pour analyser le communautarisme, des auteurs s'appuient sur Tönnies pour en comprendre les ressorts profonds...
- Michel Maffesoli et les "Nouvelles Tribus"
Maffesoli est probablement l'auteur qui a le plus directement revitalisé le concept de Gemeinschaft pour analyser la postmodernité. Il théorise l'émergence de "tribus" postmodernes : des micro-groupes éphémères, fluides, fondés sur l'émotion partagée, l'esthétique commune, le style de vie (les "tribus" musicales, sportives, les groupes de militants, etc.). Ces tribus sont une résurgence de la logique communautaire (Gemeinschaft) au sein de la grande société (Gesellschaft). Elles ne sont plus fondées sur la terre ou le sang, mais sur l'affect et le sentiment d'appartenance. C'est donc une vision plus positive que celle de Tönnies ou Bauman. Maffesoli y voit une reviviscence du lien social organique et une réponse à l'individualisme froid de la modernité.
- Dominique Schnapper et la "Communauté des Citoyens"
Dans son analyse du modèle républicain français face au communautarisme, Schnapper reprend implicitement la distinction. La "communauté des citoyens" de l'État-nation est une tentative de créer une Gemeinschaft moderne, abstraite et politique, transcendant les communautés particulières (ethniques, religieuses). Le communautarisme est alors vu comme un retour des Gemeinschaften primaires (de sang, de croyance, de culture) qui menacent de fragmenter la Gesellschaft nationale unifiée. La tension entre l'universel (la Société) et le particulier (la Communauté) est au cœur de son analyse.
- Amitai Etzioni et le Communautarianisme (mouvement intellectuel)
Le mouvement communautarien, notamment avec Amitai Etzioni, est une reprise politique et normative des concepts de Tönnies. Les communautariens critiquent l'excès d'individualisme (Gesellschaft) qui mène à l'anomie et à la fragmentation sociale. Aussi prônent-ils un retour à des communautés (Gemeinschaft) de plus petite échelle, mais modernes et choisies (les associations, les quartiers, les groupes de citoyens), pour recréer du lien social, des valeurs partagées et un sens du bien commun. Ils cherchent ainsi un équilibre entre les droits de l'individu (valeur de la Gesellschaft) et ses responsabilités envers la communauté.
