- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact

John Galsworthy (1867-1933), "The Forsyte Saga", "The Man of Property" (1906), "To Let", 1921), "The White Monkey" (1924) - ......
Last update : 18/12/2016
"The idea of making The Man of Property the first volume of a trilogy cemented by Indian Summer of a Forsyte and another short episode came to me on Sunday, July 28th, and I started the same day. This idea, if I can ever bring it to fruition, will make The
Forsyte Saga a volume of half a million words nearly; and the most sustained and considerable piece of fiction of our generation at least." - "The Forsyte Saga", publié pour la première fois sous ce nom en 1922, est une série de trois romans et de deux intermèdes publiés entre 1906 et 1921 par l'auteur anglais John Galsworthy, lauréat du prix Nobel de littérature. Il y relate les vicissitudes des membres dirigeants d'une grande famille anglaise de la haute société commerciale, semblable à la propre famille de Galsworthy. À quelques générations seulement de leurs ancêtres fermiers, les membres de la famille sont parfaitement conscients de leur statut de "nouveaux riches".
Le personnage principal, Soames Forsyte, se considère comme un "homme de propriété" en raison de sa capacité à accumuler des biens matériels, mais cela, et c'est bien l'élément central de l'intrigue, ne parvient pas à lui procurer la satisfaction et le plaisir tant convoité.
Et parmi ces plaisirs tant convoités, une femme, sa femme, l’énigmatique Irene. Mais il suffit que celle-ci tombe amoureuse de Bosinney, un architecte sans le sou qui rejette complètement les valeurs de Forsyte, pour que s'ensuive inexorablement la série d’événements qui ne peuvent conduire qu'au désastre : ici John Galsworthy aborde un thème qui lui est cher, celui de la disparition des classes moyennes supérieures, avec ironie mais une pointe de compassion ...

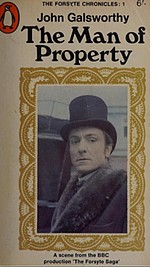
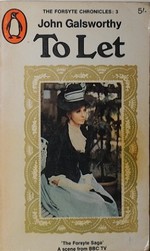
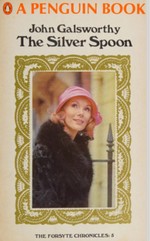
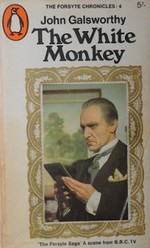
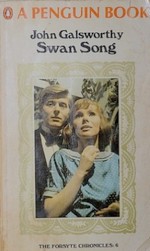
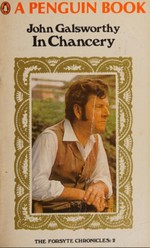
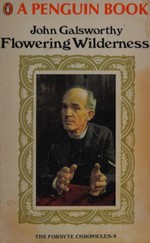

John Galsworthy (1867-1933)
Les romans de John Galsworthy (la Saga des Forsyte, 1906-1921 ; Une comédie moderne, 1924-1928) et son théâtre (Justice, 1910) donnent une peinture critique de la grande bourgeoisie et des conventions sociales, critique d'autant plus percutante qu'elle émane d'un nanti, représentatif d'une haute société anglaise qui fut d'abord victorienne, puis édouardienne et georgienne. Il fit des études de droit sans jamais exercer de profession et, parmi ses relations, on compte surtout Joseph Conrad, qu'il soutint financièrement, Gilbert Murray et Ralph Mottram. Il épousa Ada (femme de son cousin Arthur John Galsworthy) après une longue liaison, dont on retrouve le personnage dans son oeuvre.
C'est en 1901, dans une longue nouvelle, "The Salvation of Swithin Forsyte" qu'il introduisit le nom de la célèbre famille de la haute bourgeoisie dont il
allait plus tard écrire la chronique. Il peint alors une forte crique d'une société anglaise passionnément attachée à la propriété (The Island Pharisees, 1904; Fraternity, 1909; The Patrician,
1911; The Dark Flower, 1913; A Saint's Progress, 1919), puis avec "The Forsyte Saga" que Galsworthy conquiert la célébrité : The Man of Property, 1906; Indian Summer of a Forsyte, 1918
(nouvelle); In Chancery, 1920; Awakening, 1920 (nouvelle); To Let, 1921. L'écriture de Galsworthy est d'une telle justesse que ses lecteurs furent innombrables et ce quelque soit leur
milieu social. L'auteur fut aussi connu pour son engagement en faveur des victimes de la société.
"Au coeur de tout cela, pensa-t-il, est la propriété, mais il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas qu'on le dise ainsi. Pour eux, il s'agit du caractère sacré du mariage; mais le caractère sacré du mariage dépend du caractère sacré de la famille, et le caractère sacré de la famille dépend du caractère sacré de la propriété" (The core of it all, he thought, is property, but there are many of people who would not like it put that way. To them it is the sanctity of the marriage tie; but the sanctity of the marriage tie is dependent on the sanctity of the family, and the sanctity of the family is dependent on the property..).

The Forsyte Saga, six volumes
Chronique de trois générations de Forsyte, représentative de la haute bourgeoisie anglaise édouardienne, mais marquée, sous la respectabilité de façade, par "la perte et la mort de la réalité au coeur de l'intimité domestique". L'aspect impitoyable de cette collectivité familiale, imposant à chaque membre de la famille une histoire partagée, est personnalisé par Soames Forsyte, que la passion de posséder conduit au viol de sa femme, Irene Heron, drame de rupture et source d'un déséquilibre permanent dans cette quête familiale de la beauté et de la puissance.
"The Man of Property" est considéré comme le roman le plus personnel de Galsworthy et son exploration des différents aspects du mariage dans la grande bourgeoisie rejoint l'expérience qu'il traversa avec Ada, femme divorcée qu'il épousa et qui ne fut jamais reçue dans les salons londoniens si ce n'est lorsqu'il atteint lui-même la gloire littéraire : une femme n'existe que grâce à la situation de son mari, abandonnée ou divorcée, elle perd toute raison d'être et ne peut plus paraître dans les cercles mondains. Et si Galsworthy éprouve tant de sympathie pour ces femmes qui suivent leurs émotions et se rebellent contre la dictature bien-pensante de la société, contre l'obéissance exigée d'elles en échange d'une vie décorative emprunte de luxe, elles n'atteindront ici jamais le statut social des hommes grâce à leurs seules qualités professionnelles. Et plus subtil encore, les incartades d'une femme n'ont finalement que peu d'importance tant qu'elles ne compromettent pas la généalogie de la famille. Irene va ainsi rompre le contrat qui l'unit à Soames, lui qui désirait par-dessus tout une descendance digne de lui, un Soames qui incarne le grand bourgeois typique de l'ère victorienne, mais un Soames qui émeut Galsworthy tant cet homme éprouve de la passion pour sa femme...
"..an unhappy marriage. No ill-treatment - only that indefinable malaise, that terrible blight which killed all sweetness under heaven; and so from day to day, from night to night, from week to week, from year to year, till death should end it..."
"..un mauvais mariage. Sans maltraitance : seulement ce malaise indéfinissable, ce terrible malheur qui anéantit toute la tendresse du monde; et c'est ainsi jour après jour; nuit après nuit; semaine après semaine, année après année, jusqu'à ce que la mort y mette un terme..."
Galsworthy affirme que son œuvre a sauvé la classe moyenne supérieure de son époque de l'oubli en la fossilisant dans la littérature. Il n'en fait pas l'éloge, mais en dresse un portrait si précis et complet qu'il en fait un objet d'étude éternel.
La métaphore de Galsworthy est à la fois puissante et cynique. Il ne parle pas d'une disparition physique, mais d'une disparition par fossilisation et par mise sous cloche...
- "Évoluer vers l'amorphisme" : L'« amorphisme » signifie l'absence de forme définie. Galsworthy suggère que, dans la réalité, la classe moyenne supérieure est destinée à se dissoudre, à perdre ses contours distincts et à se fondre dans une masse informe au gré des changements sociaux.
- "Marinée dans ces pages, elle repose sous verre" : C'est ici que réside l'ironie et le cœur de son projet d'écrivain. En écrivant La Saga des Forsyte, Galsworthy empêche cette dissolution. Il "mariné" cette classe dans le jus de sa propre narration (le "propre jus" de ses valeurs) et la place "sous verre" comme un spécimen dans un musée.
- "Le musée des Lettres" : La littérature devient un musée, un lieu de conservation. Les romans sont les vitrines où les générations futures peuvent venir "contempler" ce qu'était cette classe sociale.
- "Le sens de la propriété" : C'est le spécimen conservé, la caractéristique essentielle de la classe moyenne supérieure victorienne/édouardienne que Galsworthy dissèque. Pour les Forsyte, la propriété (biens immobiliers, argent, mais aussi les femmes, considérées comme des possessions) est le principe cardinal qui régit leur vie, leurs relations et leur vision du monde.
PREFACE, JOHN GALSWORTHY
THE Forsyte Saga was the title originally destined for the part of it which is called The Man of Property, and to adopt it for the collected chronicles of the Forsyte family has indulged the Forsytean tenacity which is in all of us. The word Saga might be objected to on the ground that it connotes the heroic and that there is little of heroism in these pages. But it is used with a suitable irony; and, after all, this long tale, though it may deal with folk in frock coats, furbelows, and a gilt-edged period, is not devoid of the essential heat of conflict. Discounting for the gigantic stature and blood-thirstiness of old days, as they have come down to us in fairy-tale and legend, the folk of the old Sagas were Forsytes, assuredly, in their possessive instincts, and as little proof against the inroads of beauty and passion as Swithin, Soames, or even young Jolyon. And if heroic figures, in days that never were, seem to startle out from their surroundings in fashion unbecoming to a Forsyte of the Victorian era, we may be sure that tribal instinct was even then the prime force, and that ‘family’ and the sense of home and property counted as they do to this day, for all the recent efforts to ‘talk them out.’
La saga des Forsyte était le titre initialement prévu pour la partie de l'ouvrage intitulée "L'homme de la propriété", et l'adoption de ce titre pour l'ensemble des chroniques de la famille Forsyte a permis de satisfaire la ténacité forsytéenne qui est en chacun de nous. On pourrait objecter que le terme de Saga évoque l'héroïsme et qu'il n'y a pas grand-chose d'héroïque dans ces pages. Mais il est utilisé avec une ironie appropriée, les personnages des anciennes sagas étaient des Forsytes, assurément, dans leurs instincts possessifs, et aussi peu à l'abri des incursions de la beauté et de la passion que Swithin, Soames, ou même le jeune Jolyon. Et si les figures héroïques, à une époque qui n'a jamais existé, semblent se détacher de leur environnement d'une manière qui ne sied pas à un Forsyte de l'ère victorienne, nous pouvons être sûrs que l'instinct tribal était déjà à l'époque la force première, et que la "famille" et le sens du foyer et de la propriété comptaient comme ils le font encore aujourd'hui, malgré tous les efforts récents pour les "dissocier".
So many people have written and claimed that their families were the originals of the Forsytes, that one has been almost encouraged to believe in the typicality of that species. Manners change and modes evolve, and ‘Timothy’s on the Bayswater Road’ becomes a nest of the unbelievable in all except essentials; we shall not look upon its like again, nor perhaps on such a one as James or old Jolyon. And yet the figures of Insurance Societies and the utterances of Judges reassure us daily that our earthly paradise is still a rich preserve, where the wild raiders, Beauty and Passion, come stealing in, filching security from beneath our noses. As surely as a dog will bark at a brass band, so will the essential Soames in human nature ever rise up uneasily against the dissolution which hovers round the folds of ownership.
Tant de personnes ont écrit et affirmé que leurs familles étaient les originaux des Forsytes, que l'on a presque été encouragé à croire à la typicité de cette espèce. Les manières changent et les modes évoluent, et "Timothy's on the Bayswater Road" devient un nid d'incroyables, à l'exception de l'essentiel ; nous ne reverrons plus jamais ce genre de famille, ni peut-être un homme tel que James ou le vieux Jolyon. Et pourtant, les chiffres des sociétés d'assurance et les déclarations des juges nous rassurent chaque jour sur le fait que notre paradis terrestre est encore une riche réserve, où les pillards sauvages, la beauté et la passion, viennent voler la sécurité sous notre nez. Aussi sûrement qu'un chien aboie contre une fanfare, les Soames essentiels de la nature humaine s'élèveront toujours avec inquiétude contre la dissolution qui plane autour des plis de la propriété.
‘Let the dead Past bury its dead’* would be a better saying if the Past ever died. The persistence of the Past is one of those tragi-comic blessings which each new age denies, coming cock-sure on to the stage to mouth its claim to a perfect novelty. But no Age is so new as that! Human Nature, under its changing pretensions and clothes, is and ever will be very much of a Forsyte, and might, after all, be a much worse animal.
Looking back on the Victorian era, whose ripeness, decline, and ‘fall-off is in some sort pictured in The Forsyte Saga, we see now that we have but jumped out of a fryingpan into a fire. It would be difficult to substantiate a claim that the state of England was better in 1913 than it was in 1886, when the Forsytes assembled at Old Jolyon’s to celebrate the engagement of June to Philip Bosinney. And in 1920, when again the clan gathered to bless the marriage of Fleur with Michael Mont, the state of England is as surely too molten and bankrupt as in the eighties it was too congealed and low-percented. If these chronicles had been a really scientific study of transition, one would have dwelt probably on such factors as the invention of bicycle, motorcar, and flying machine; the arrival of a cheap Press; the decline of country life and increase of the towns; the birth of the Cinema. Men are, in fact, quite unable to control their own inventions; they at best develop adaptability to the new conditions those inventions create.
Laissons le passé mort enterrer ses morts "* serait un meilleur dicton si le passé était mort. La persistance du passé est l'une de ces bénédictions tragi-comiques que chaque nouvelle ère nie, en montant sur scène avec assurance pour revendiquer une parfaite nouveauté. Mais aucune époque n'est aussi nouvelle que celle-là ! La nature humaine, sous ses prétentions et ses vêtements changeants, est et sera toujours un Forsyte, et pourrait, après tout, être un animal bien pire.
En regardant l'époque victorienne, dont la maturité, le déclin et la chute sont en quelque sorte illustrés dans La Saga des Forsyte, nous constatons aujourd'hui que nous n'avons fait que sauter d'une poêle à frire dans un feu de paille. Il serait difficile de prouver que l'état de l'Angleterre était meilleur en 1913 qu'en 1886, lorsque les Forsyte se sont réunis chez Old Jolyon pour célébrer les fiançailles de June avec Philip Bosinney. Et en 1920, lorsque le clan se réunit à nouveau pour bénir le mariage de Fleur avec Michael Mont, l'état de l'Angleterre est aussi sûrement trop fondu et en faillite que dans les années quatre-vingt il était trop congelé et à faible pourcentage. Si ces chroniques avaient été une étude vraiment scientifique de la transition, on se serait probablement attardé sur des facteurs tels que l'invention de la bicyclette, de l'automobile et de la machine volante ; l'arrivée d'une presse bon marché ; le déclin de la vie à la campagne et l'augmentation des villes ; la naissance du cinéma. En fait, les hommes sont tout à fait incapables de contrôler leurs propres inventions ; ils développent tout au plus une capacité d'adaptation aux nouvelles conditions créées par ces inventions.
But this long tale is no scientific study of a period; it is rather an intimate incarnation of the disturbance that Beauty effects in the lives of men. The figure of Irene, never, as the reader may possibly have noticed, present, except through the senses of other characters, is a concretion of disturbing Beauty impinging on a possessive world.
One has noticed that readers, as they wade on through the salt waters of the Saga, are inclined more and more to pity Soames, and to think that in doing so they are in revolt against the mood of his creator. Far from it! He, too, pities Soames, the tragedy of whose life is the very simple, uncontrollable tragedy of being unlovable, without quite a thick enough skin to be thoroughly unconscious of the fact.
Mais ce long récit n'est pas l'étude scientifique d'une époque, il est plutôt l'incarnation intime du trouble que la Beauté opère dans la vie des hommes. La figure d'Irène, qui n'est jamais présente, comme le lecteur l'a peut-être remarqué, qu'à travers les sens d'autres personnages, est une concrétisation de la Beauté troublante qui s'immisce dans un monde possessif.
On a remarqué que le lecteur, au fur et à mesure qu'il avance dans les eaux salées de la saga, est de plus en plus enclin à plaindre Soames, et à penser qu'il se révolte ainsi contre l'état d'esprit de son créateur. Loin de là ! Lui aussi a pitié de Soames, dont la tragédie de la vie est la tragédie toute simple et incontrôlable d'être mal-aimé, sans avoir la peau assez épaisse pour ne pas s'en rendre compte.
Not even Fleur loves Soames as he feels he ought to be loved. But in pitying Soames readers incline, perhaps, to animus against Irene. After all, they think, he wasn’t a bad fellow, it wasn’t his fault; she ought to have forgiven him, and so on! And, taking sides, they lose perception of the very simple truth, which underlies the whole story, that where sex attraction is utterly and definitely lacking in one partner to a union, no amount of pity, or reason, or duty, or what not, can overcome a repulsion implicit in Nature.
Whether it ought to, or no, is beside the point; because in fact it never does. And where Irene seems hard and cruel— as in the Bois de Boulogne, or the Goupenor Gallery—she is but wisely realistic, knowing that the least concession is the inch which precedes the impossible, the repulsive ell.
Même Fleur n'aime pas Soames comme il pense qu'il devrait être aimé. Mais en plaignant Soames, les lecteurs sont peut-être enclins à s'animer contre Irène. Après tout, pensent-ils, il n'était pas méchant, ce n'était pas sa faute, elle aurait dû lui pardonner, et ainsi de suite ! Et en prenant parti, ils perdent de vue la vérité toute simple qui sous-tend toute l'histoire, à savoir que lorsque l'attirance sexuelle fait totalement et définitivement défaut à l'un des partenaires d'une union, aucune pitié, aucune raison, aucun devoir, ou quoi que ce soit d'autre, ne peut vaincre une répulsion implicite dans la nature.
Qu'il le faille ou non n'a rien à voir avec la question, parce qu'en fait, il ne le fait jamais. Et là où Irène semble dure et cruelle - comme au Bois de Boulogne ou à la Galerie Goupenor - elle n'est que sagement réaliste, sachant que la moindre concession est le pouce qui précède l'impossible, le repoussoir.
In criticism on the last phase of the Saga one might complain that Irene and Jolyon—those rebels against property—claim spiritual property in their son Jon. But, in truth, it would be hypercriticism of the story as told. For no father and mother could have let the boy marry Fleur without knowledge of the facts; and the facts determine Jon, not the persuasion of his parents. Moreover, Jolyon’s persuasion is not on his own account, but on Irene’s, and Irene’s persuasion becomes a reiterated: ‘Don’t think of me, think of yourself!’ That Jon, knowing the facts, realises his mother’s feelings, can hardly with justice be held proof that she is, after all, a Forsyte.
En critiquant la dernière phase de la saga, on pourrait se plaindre qu'Irène et Jolyon - ces rebelles contre la propriété - revendiquent la propriété spirituelle de leur fils Jon. Mais, en vérité, il s'agirait d'une hypercritique de l'histoire telle qu'elle est racontée. En effet, aucun père ni aucune mère n'aurait pu laisser le garçon épouser Fleur sans connaître les faits ; et ce sont les faits qui déterminent Jon, et non la persuasion de ses parents. De plus, la persuasion de Jolyon n'est pas de son fait, mais de celui d'Irène, et la persuasion d'Irène devient une réitération : Ne pensez pas à moi, pensez à vous ! Le fait que Jon, en connaissance de cause, comprenne les sentiments de sa mère peut difficilement être considéré comme une preuve qu'elle est, après tout, une Forsyte.
But, though the impingement of Beauty, and the claims of Freedom, on a possessive world, are the main prepossessions of The Forsyte Saga, it cannot be absolved from the charge of embalming the upper-middle class. As the old Egyptians placed around their mummies the necessaries of a future existence, so I have endeavoured to lay beside the figures of Aunts Ann and Juley and Hester, of Timothy and Swithin, of old Jolyon and James, and of their sons, that which shall guarantee them a little life hereafter, a little balm in the hurried Gilead* of a dissolving ‘Progress.’
If the upper-middle class, with other classes, is destined to ‘move on’ into amorphism, here, pickled in these pages, it lies under glass for strollers in the wide and ill-arranged museum of Letters to gaze at. Here it rests, preserved in its own juice: The Sense of Property.
Mais, bien que l'empiètement de la beauté et les revendications de la liberté sur un monde possessif soient les principales prépositions de la Saga des Forsyte, on ne peut l'absoudre de l'accusation d'embaumer la classe moyenne supérieure. De même que les anciens Égyptiens plaçaient autour de leurs momies les éléments nécessaires à une existence future, je me suis efforcé de placer à côté des figures des tantes Ann, Juley et Hester, de Timothy et Swithin, des vieux Jolyon et James, et de leurs fils, ce qui leur garantirait une vie future, une vie de famille et une vie de famille. Jolyon et James, et de leurs fils, ce qui leur garantira un peu de vie dans l'au-delà, un peu de baume dans le Gilead* pressé d'un "Progrès" en voie de dissolution.
Si la classe moyenne supérieure, comme d'autres classes, est destinée à "évoluer" vers l'amorphisme, ici, marinée dans ces pages, elle repose sous verre et peut être contemplée par les promeneurs dans le vaste et mal organisé musée des Lettres. C'est ici qu'il repose, conservé dans son propre jus : Le sens de la propriété.
La saga a été écrite et publiée par épisodes entre 1906 et 1928. Elle est traditionnellement divisée en deux grandes séries de romans, séparées par un "interlude". Galsworthy a reçu le Prix Nobel de Littérature en 1932, en grande partie pour cette œuvre....
La saga raconte l'histoire de plusieurs générations de la famille Forsyte, une grande famille bourgeoise victorienne de Londres, sur une période allant des années 1880 aux années 1920. Le cœur de l'intrigue tourne autour de Soames Forsyte, un avoué prospère, incarnation du "sens de la propriété". Son mariage malheureux avec la belle et éthérée Irene est le catalyseur de la première trilogie. Soames considère Irene comme sa possession la plus précieuse ; son refus de se soumettre et son amour pour l'architecte Philip Bosinney (fiancé à la sœur de Soames) mènent à une tragédie. Les romans suivants explorent les conséquences de ce drame sur la génération suivante, notamment la relation entre Fleur, la fille de Soames, et Jon, le fils d'Irene et de son second mari, le cousin de Soames, Jolyon.
La saga est un pont entre deux époques. Elle oppose le monde stable, matérialiste et conventionnel des Forsyte aînés au monde plus instable, émotionnel et artistique de leurs enfants, qui héritent des conséquences des actes de leurs parents....
La Saga originale (The Forsyte Saga) : C'est le noyau fondateur. Elle couvre l'apogée et le début du déclin de la famille, se concentrant sur la génération de Soames et les répercussions de ses actes. C'est une tragédie familiale aux accents victoriens.
- The Man of Property (Le Propriétaire) - 1906
- Indian Summer of a Forsyte (Interlude) - 1918
- In Chancery (Aux prises avec la justice) - 1920
- Awakening (Interlude) - 1920
- To Let (A Louer) - 1921
L'Interlude (Indian Summer of a Forsyte et Awakening, 1920) : Ces nouvelles courtes servent de ponts émotionnels et temporels entre les romans principaux, permettant de montrer l'évolution des personnages et le passage du temps de manière plus intime.
La Suite (A Modern Comedy) : Cette seconde trilogie est tout aussi cruciale. Elle transporte l'histoire dans l'après-Première Guerre mondiale, l'ère du "Jazz Age". Elle montre comment la nouvelle génération (Fleur et Jon) est à la fois libérée et hantée par le passé de ses parents. Elle conclut le destin des Forsyte en les confrontant à un monde moderne qu'ils ne comprennent plus tout à fait.
- The White Monkey (Le Singe blanc) - 1924
- The Silver Spoon (La Cuiller d'argent) - 1926
- Swan Song (Le Chant du cygne) - 1928
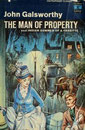
"Le Propriétaire" (The Man of Property, 1906), premier volume de la saga...
Un monde sans propriété est inconcevable ( (qu'il s'agisse de biens, d'art ou de personnes) ...
Le premier volume de la saga débute par une réunion de famille qui a lieu le 15 juillet 1886 à l'occasion des fiançailles de June Forsyte avec l'architecte Philip Bosinney. Y sont présents les dix enfants de Jolyon Forsyte I. qui fit la fortune de la famille au temps de la grande expansion économique qui marqua la première moitié du siècle. Ce sont dix vieillards solides et résolus (car la longévité, outre le respect des convenances. est l'apanage des Forsyte). Parmi eux se trouvent Jolyon le Vieux, James, George, Timothy. Jolyon le Jeune manque à la réunion; c'est en effet un caractère indépendant, passionné et sentimental. qui est brouillé avec son père et toute la famille à cause de sa rupture avec sa première femme ; il avait refait sa vie. Le représentant typique de la seconde génération est Soames, le fils de James : c'est le "propriétaire" actuel; il est accompagné de sa femme, la belle Irène. Celle-ci et Bosinney. le fiancé de June, se plaisent tout de suite et Soames va favoriser leurs rencontres en chargeant le jeune architecte de construire pour lui la belle demeure de Robin Hill, près de Londres.
Irène, qui n`a jamais aimé Soames qu`avec tiédeur, en vient à éprouver de l`aversion pour lui; elle le lui avoue avec loyauté. Bosinney rompt avec June. Celle-ci se résigne, mais Soames ne peut admettre que sa femme cesse de lui appartenir. Pour se venger, il intente un procès à Bosinney au sujet de la construction de Robin Hill et obtient le droit de rompre son contrat avec lui. La situation financière de Bosinney devient donc précaire. D`autre part, Soames, sortant de sa réserve de galant homme, use de ses droits envers sa femme de façon brutale. Bosinney, hors de lui, torturé par la jalousie, erre comme un malheureux, parcourant la ville en tous sens, lorsqu'il tombe victime d`un accident. Soames, comme le dit George Forsyte, est responsable de sa mort.

"Those privileged to be present at a family festival of the Forsytes have seen that charming and instructive sight — an upper middle-class family in full plumage. But whosoever of these favoured persons has possessed the gift of psychological analysis (a talent without monetary value and properly ignored by the Forsytes), has witnessed a spectacle, not only delightful in itself, but illustrative of an obscure human problem. In plainer words, he has gleaned from a gathering of this family — no branch of which had a liking for the other, between no three members of whom existed anything worthy of the name of sympathy — evidence of that mysterious concrete tenacity which renders a family so formidable a unit of society, so clear a reproduction of society in miniature. He has been admitted to a vision of the dim roads of social progress, has understood something of patriarchal life, of the swarmings of savage hordes, of the rise and fall of nations. He is like one who, having watched a tree grow from its planting — a paragon of tenacity, insulation, and success, amidst the deaths of a hundred other plants less fibrous, sappy, and persistent — one day will see it flourishing with bland, full foliage, in an almost repugnant prosperity, at the summit of its efflorescence.
On June 15, eighteen eighty-six, about four of the afternoon, the observer who chanced to be present at the house of old Jolyon Forsyte in Stanhope Gate, might have seen the highest efflorescence of the Forsytes..."
RÉCEPTION CHEZ LE VIEUX JOLYON - Ceux qui ont eu le privilège d'assister à une fête de famille chez les Forsyte ont vu ce spectacle charmant et instructif : une famille de la riche bourgeoisie en grand appareil. Mais quelqu'un de ces privilégiés était-il doué de clairvoyance psychologique (un don qui n'a point de valeur monétaire et que les Forsyte ignorent), il a été le témoin d'une scène qui jette une lumière sur un obscur problème humain.
En d'autres termes, de la réunion de cette famille - dont on n'aurait pu désigner trois membres liés seulement par un sentiment qui méritât le nom de sympathie - s'est dégagée pour lui l'évidence de cette mystérieuse et concrète cohésion qui fait de la famille une si formidable unité sociale, une si exacte miniature de la société. Il a été admis à la vision des routes confuses que suit le progrès social, il a compris quelque chose de la vie patriarcale, du fourmillement des hordes sauvages, de la croissance et de la chute des nations. C'est comme si, ayant regardé grandir, depuis le jour de la plantation, un arbre admirable de vitalité, au milieu de cent autres plantes qui, moins riches de fibre. de sève et d'endurance, succombaient, il le voyait épanouir un jour tout son feuillage épais et pacifique, au point culminant de sa prospérité.
Le 15 juin de l`année 1886, vers quatre heures de l`après-midi, un observateur qui se serait trouvé dans la maison du vieux Jolyon Forsyte à Stanhope Gale, aurait pu contempler la suprême efflorescence des Forsyte. La maison célébrait les fiançailles de Mlle June Forsyte, petite-fille du vieux Jolyon, avec M. Philip Businney. Dans ses plus beaux atours, gants clairs, gilets chamois, plumes, robes de cérémonie, la famille entière était présente. La tante Ann elle-même était venue, elle qui ne quittait plus que rarement le coin du salon vert de son frère Timothy où, sous un plumet d`herbe teinte des pampas, s'élevant d`un vase bleu clair, elle restait assise tout le jour, à lire ou à tricoter, entourée par les effigies de trois générations de Forsyte. Oui, la tante Ann elle-même était là, son dos inflexible et la dignité de sa calme vieille figure personnifiant ce rigide esprit de possession qui était l'âme de la famille,
Quand un Forsyte naissait, se fiançait, se mariait, les Forsyte étaient présents : quand un Forsyte mourait - mais aucun Forsyte n`était mort jusqu'à ce jour... lls ne mouraient pas, la mort étant contraire à leur principes; ils prenaient des précautions contre elle, les précautions d'une puissante vitalité qui repousse tout empiétement.
Les Forsyte qui se mêlaient ce jour-là à la foule des autres invités semblaient mieux soignés et plus fringants qu'à l`ordinaire; ils avaient une assurance alerte, un air de respectabilité brillante; on eût dit qu`ils s'étaient parés pour défier quelque chose. L'air de méfiant dédain habituel à la physionomie de Soames Forsyte avait gagné tous les rangs; ils étaient sur leurs gardes. Cette attitude inconsciemment agressive de la famille, ce jour-là, chez le vieux Jolyon, signale un moment psychologique de son histoire et le prélude du drame qui doit la déchirer.
Quelque chose excitait leur hostilité, celle du groupe plutôt que des individus. Ce sentiment s'exprimait par la perfection accrue de leur toilette, par une expansion de cordialité familiale, une exagération de l'importance de la famille et par l'imperceptible expression de méfiance et de dédain. Le danger - qui seul peut faire apparaître la qualité fondamentale de toute société, groupe ou individu, - voilà ce que flairaient les Forsyte, Le pressentiment du danger les mettait dans leur attitude de défense. Pour la première fois, ils paraissaient avoir, comme famille, l'intuition qu`ils sc trouvaient en contact avec une chose étrange et inquiétante.
Appuyé derrière le piano, se tenait un homme de puissante stature, qui portait deux gilets sur sa vaste poitrine, deux gilets et rubis à sa cravate au lieu de l'unique gilet et de l`épingle de diamant qu'il mettait dans les occasions plus ordinaires. Sa vieille figure carrée, couleur de cuir pâle. avec des yeux pâles, portait au-dessus du col de soie son expression la plus digne. C'était Swithin Forsyte. Près de la fenêtre où il pouvait absorber plus que sa part d'air frais, son jumeau James qui était comme le massif Swithin haut de plus de six pieds, mais très maigre comme s'il avait été destiné dès sa naissance à rétablir l'équilibre d'une bonne moyenne - le gros et le maigre de la même tranche, disait le vieux Jolyon en parlant des deux frères - James, toujours courbé, méditait ce qu'il voyait. Ses yeux gris semblaient fixement absorbés par quelque secret tracas. mais de temps à autre faisaient un rapide et furtif examen de ce qui se passait alentour. Ses joues amincies par deux rides parallèles et sa lèvre supérieure longue et rasée étaient encadrées de favoris. Il tournait et retournait dans
sa main un bibelot de porcelaine. Non loin de là, écoutant ce que lui disait une femme en robe marron, son fils unique, Soames, pâle et complètement rasé, brun, un peu chauve, levait obliquement son menton et portait son nez avec cet air de méfiant dédain dont il a déjà été parlé. comme s`il faisait fi d'un oeuf qu'il savait ne pouvoir digérer.
Derrière lui son cousin, le grand George, fils de Roger le cinquième Forsyte. préparait avec un air de pince-sans-rire sur sa figure charnue une de ses sardoniques plaisanteries.
Quelque chose de spécial à la circonstance les affectait.
Trois vieilles dames étaient assises en rang, tout à côté l`une de l'autre : tante Ann, tante Hester, les deux vieilles filles de la famille Forsyte et Juley (diminutif de Julia), qui autrefois, n'étant déjà plus dans sa prime jeunesse, s'était oubliée au point d'épouser Septimus Small, un homme de pauvre santé. Elle lui survivait depuis de longues années. Avec son aînée et sa cadette, elle habitait maintenant la maison de Timothy, leur sixième et plus jeune frère, dans Bayswater Road. Chacune de ces dames tenait un éventail à la main, quelque note de couleur dans leur toilette, quelque broche ou quelque plume évidente attestant la solennité de l'occasion.
Au centre de la pièce, sous le lustre comme il convenait à l'hôte. se tenait le chef de la famille. le vieux Jolyon lui-même. Avec ses quatre-vingts ans, ses beaux cheveux blancs, son front pareil à un dôme, ses petits yeux gris foncé et une énorme moustache blanche qui tombait et s`étalait plus bas que sa forte mâchoire, il avait un air de patriarche et, en dépit de ses joues maigres et des creux de ses tempes, il semblait posséder la jeunesse éternelle. Il se tenait extrêmement droit et son regard sagace et ferme n'avait rien perdu de sa lumière. Il donnait l`impression d'être au-dessus de ces doutes et de ces aversions qui agitent les hommes plus petits. Ayant toujours accompli sa volonté depuis tant d'années qu'on ne les comptait pas, il avait conquis comme un droit imprescriptible à la domination. Il ne serait jamais venu à l'esprit du vieux Jolyon qu`il fût nécessaire d'assumer une attitude d`inquiétude ou de défi...."
C'est la pierre angulaire de toute la saga. Galsworthy y établit sa critique féroce du « sens de la propriété » qui corrode les relations humaines. Le conflit entre le matérialisme de Soames et l'idéal de beauté et de liberté représenté par Irene et Bosinney est au cœur du livre. C'est une tragédie victorienne classique : la société étouffe l'amour et la passion au nom de la convention et de la possession...
"The Indian Summer of a Forsyte", 1917
Irène, horrifiée. s'enfuit. On la retrouvera dans ce prélude au deuxième volume qu'est Dernier été (The Indian Summer of a Forsyte, 1917). Elle est alors installée à Robin Hill, que le vieux Jolyon a acheté pour son fils avec lequel il s'est réconcilié. C`est un épisode plein de charme; le vieil homme, le seul des Forsyte qui ait une certaine liberté d'esprit, comprend la jeune femme et l'aime tendrement. Irène l'écoute parler de son fils qui est au loin et qui a perdu la femme qu'il aimait ; elle l`assiste à ses derniers moments : la mort vient le prendre doucement. un bel après-midi d'été. alors qu'il est assis à l'ombre d`un arbre...
Cette courte nouvelle (L'Été de la Saint-Martin d'un Forsyte), située chronologiquement après les événements du premier livre, se concentre sur le vieux Jolyon Forsyte. Maintenant veuf et ayant hérité de la fortune de son frère, il vit retiré à Robin Hill, la maison que Soames a finalement été obligé de vendre. Sa petite-fille June étant souvent absente, il mène une existence solitaire mais paisible. Il retrouve par hasard Irene, qui est revenue vivre discrètement à Londres. Plein d'une sympathie paternelle pour elle (et toujours un peu rancunier envers Soames pour avoir brisé le cœur de June), le vieux Jolyon lui offre une rente pour qu'elle puisse vivre indépendante. Une amitié tendre et mélancolique s'installe entre le vieil homme, en pleine « été de la Saint-Martin » de sa vie, et la jeune femme meurtrie. L'interlude se termine par la mort paisible du vieux Jolyon, assis sous un arbre à Robin Hill, heureux d'avoir offert un peu de réconfort à Irene.
Cet interlude est un moment de grâce et de rédemption. Il adoucit la fin brutale du premier livre et offre un portrait touchant de la vieillesse et du regret. Le vieux Jolyon, qui représentait l'austérité Forsyte, révèle une profonde humanité. C'est aussi un moyen de réintroduire Irene dans le récit et de montrer qu'elle trouve un semblant de paix et de protection au sein même de la famille qui l'a rejetée.

"Aux aguets" (In Chancery, 1920), deuxième volume de la saga...
Irène, persécutée par Soames. s`enfuit à Paris où elle retrouve Jolyon le Jeune. Celui-ci, fidèle au désir de son père, l`accueille, et ces deux êtres, blessés par la vie, se rapprochent et finissent par s'aimer. Soames. à Londres, est séduit par la beauté provocante d'une jeune Française, Annette. fille du propriétaire d'un grand restaurant; il décide de divorcer pour des raisons assez obscures qu'il ne s'avoue pas toutes, mais dont les principales sont son mépris pour Irène et le désir d'avoir un fils. Il rompt donc avec la tradition des Forsyte et fait scandale en recherchant les preuves de l'adultère d'Irène avec Jolyon et en la traînant devant les tribunaux pour obtenir le divorce. Irène et Jolyon, quoique innocents, ne se défendent pas; les circonstances les incitent à lier leurs existences et ils se marient. Soames épouse Annette; Fleur, leur fille, naît le jour même de la mort du père de Soames.
"Chez Timothy - LORSQUE Susan Hayman, celle des sœurs Forsyte qui était mariée, fut incinérée en 1895 après être allée rejoindre son mari à l'âge ridiculement peu avancé de soixante-quatorze ans, les six Forsyte de la vieille génération qui étaient encore de ce monde n'en furent que peu troublés.
Deux raisons déterminaient leur apathie. Tout d'abord, le premier des Forsyte qui eût déserté le tombeau familial de Highgate, le vieux Jolyon, s'était fait enterrer pour ainsi dire clandestinement, en 1892, à Robin Hill. Survenant une année après les funérailles parfaitement correctes de Swithin, cet enterrement avait défrayé de nombreuses conversations à la Bourse des Forsyte, la maison que Timothy Forsyte habitait dans Bayswater Road, à Londres, et qui continuait à rassembler et à disséminer les petits potins de la famille. Des lamentations de la tante Juley à cette affirmation, franchement émise par Francie, qu'on « avait rudement raison de ne pas aller moisir à Highgate », toutes sortes d'opinions furent exprimées à son sujet.
En ces dernières années, en fait depuis l'étrange et lamentable histoire du jeune Bosinney, l'amoureux de sa petite-fille June, avec Irène, la femme de son neveu Soames Forsyte, l'oncle Jolyon avait manifestement agacé les nerfs de la famille; on avait commencé à trouver quelque peu perverse son habituelle originalité. La veine de philosophie qu'il portait en lui avait toujours eu une tendance trop marquée à affleurer à la surface des sédiments du pur Forsytisme; aussi ses parents n'avaient-ils pas été trop surpris par son inhumation en un lieu étrange.
Mais toute l'affaire était singulière, et lorsque le contenu de son testament était devenu monnaie courante, le clan tout entier en avait frissonné : sur sa fortune (145 304 livres, chiffre brut, avec un passif de 35 livres 7 shillings et 4 pence), il avait bel et bien légué 15 000 « de toutes les personnes concevables, à qui, ma chère? A Irène! » cette épouse fugitive de son neveu Soames; Irène, une femme qui avait déshonoré la famille et – chose encore plus stupéfiante – ne lui était pas unie par les liens du sang. Pas en toute propriété, bien sûr, rien qu'en rente viagère, – rien quo le revenu de la somme.
Mais enfin le legs était là; et le vieux Jolyon fut déchu une, fois pour toutes de ses, prétentions à réaliser le type du parfait Forsyte. Telle était donc la première raison qui empêcha les obsèques de Susan Hayman – à Woking – de provoquer beaucoup d'agitation.
La deuxième raison qui empêcha les obsèques de Susan de provoquer une agitation excessive, Euphemie, la pâle, l'exprima non sans audace : « Mon .vis à moi, dit-elle, c'est que les gens sont maîtres de leur corps même après leur mort. » Dans la bouche d'une fille de Nicholas, libéral de la vieille école et extrêmement tyrannique, cette opinion était fort surprenante; elle révélait dans un éclair quelle quantité d'eau était passée sous les ponts depuis la mort de la tante Ann, en 1886. Euphemie, bien sûr, parlait en enfant sans expérience; car, bien qu'ayant largement dépassé la trentaine, elle s'appelait encore Forsyte.
Mais il n'était pas possible de nier le mouvement de révolte qui soulevait les Forsyte de la seconde génération contre l'idée d'appartenir à autrui. Ils étaient tous mariés maintenant, sauf George, fermement attaché au Turf et à l'Iseum Club; Francie, qui poursuivait sa carrière musicale dans un atelier voisin de King's Road, dans le quartier de Chelsea, et continuait à emmener des « adorateurs » au bal; Euphemie, qui se plaignait de son père Nicholas, avec qui elle demeurait; et enfin ces deux Dromios, Giles et Jesse Hayman.
La troisième génération n'était guère nombreuse – Jolyon le jeune avait trois enfants, Winifred Dartie quatre, Nicholas le jeune six déjà, Roger le jeune en avait un, Marian Tweetyman un, Saint-John Hayman deux. Mais les dix qui restaient, sur les seize qui s'étaient mariés – c'est-à-dire Soames, Rachel et Cecily, de la famille de James; Eustache et Thomas de celle de Roger; Ernest, .Archibald et Florence, de celle de Nicholas; Augustus et Annabel Spender, de celle de Hayman – descendaient le cours des ans sans progéniture.
Toutefois la dégradation globale des Forsyte, ou plutôt leur dispersion dont toutes ces choses étaient symptomatiques, n'était pas encore assez avancée pour les empêcher de se ressaisir à la mort de Roger Forsyte, en 1899. L'été avait été superbe, et ils étaient à peu près tous rentrés à Londres, après avoir passé leurs vacances à l'étranger ou à la mer, lorsque Roger rendit brusquement le dernier soupir, d'une manière qui rappelait sa vieille originalité d'allures, dans sa propre maison de Prince's Gardens. Chez Timothy, on chuchota avec tristesse que le pauvre Roger avait toujours témoigné de quelque excentricité sur le chapitre de ses digestions – ne préférait-il pas, par exemple, le mouton d'Allemagne à tous les autres ?
Quoi qu'il en soit de ce point, ses funérailles à Highgate avaient été parfaites. Après y avoir assisté, Soames Forsyte se dirigea presque automatiquement vers la maison de son oncle Timothy, dans Bayswater Road. Les « vieilles », les tantes Juley et Hester seraient heureuses de savoir comment les choses s'étaient passées. En raison de ses quatre-vingt-huit ans, son père James ne s'était pas senti de force à supporter les fatigues de la cérémonie; Timothy lui-même n'y était pas allé, naturellement; si bien que les frères n'y avaient été représentés que par
Nicholas. Malgré cela, il y avait eu assez de monde, et les tantes Juley et Hester seraient réconfortées de l'apprendre. Cette aimable pensée n'était pas sans s'accompagner de l'inévitable désir de tirer profit de tout ce qu'on fait, qui est la principale caractéristique des Forsyte et, à la vérité, des éléments sains de toutes les nations. En allant discuter les affaires de la famille chez Timothy, Soames ne faisait que marcher sur les traces de son père, qui avait coutume de rendre visite à ses sœurs, dans Bayswater Road, une fois au moins chaque semaine.
Il n'y avait renoncé qu'à l'âge de quatre-vingt-six ans, lorsqu'il avait vu ses forces décliner et était devenu incapable de sortir sans Emily. Il était inutile d'y aller en compagnie d'Emily : le moyen en effet d'avoir en présence de sa femme une conversation digne de ce nom ? Comme James autrefois, Soames trouvait le temps d'aller passer quelques instants, à peu près tous les dimanches, dans le petit salon de ses tantes. C'était une pièce dans laquelle, avec son indubitable bon goût, il avait introduit de nombreux changements et aussi, en guise de cadeaux de Noël, des porcelaines qui n'atteignaient pas tout à fait le niveau fixé par sa propre délicatesse, et au moins deux toiles de l'école de Barbizon dont l'authenticité était douteuse.
Personnellement, après avoir très bien réussi dans les Barbizon, il était passé aux Marises, aux Israels, et aux Mauves, et il espérait mieux encore. Dans la maison qu'il habitait maintenant au bord de l'eau, près de Mapledurham, il avait une collection de tableaux, magnifiquement accrochés et éclairés, que connaissaient presque tous les marchands de Londres. Elle constituait encore une attraction, le dimanche après-midi, au cours des réceptions que ses sœurs Winifred et Rachel se chargeaient à l'occasion d'organiser pour son compte.
Il avait beau n'être qu'un cicerone taciturne, sa tranquille et simple détermination ne manquait pas d'impressionner ses invités, car ils savaient que sa réputation n'était pas fondée sur le simple caprice esthétique, mais sur sa capacité à prévoir l'avenir des valeurs marchandes. Lorsqu'il allait chez Timothy, il avait presque toujours à relater un petit triomphe remporté sur un marchand et il goûtait un rare plaisir à entendre le léger gloussement d'orgueil dont ses tantes le saluaient immanquablement.
Cette après-midi-là toutefois, à son retour des obsèques de Roger, et vêtu d'un irréprochable complet de couleur sombre – pas entièrement noir, car après tout un oncle n'est qu'un oncle, et son âme exécrait tout étalage excessif des sentiments –, il était dans une tout autre disposition d'esprit. Renversé dans une chaise de marqueterie et contemplant, dans le prolongement de son nez levé, les murs azurés semés de cadres dorés, il gardait un silence remarquable.
Que ce fût ou non parce qu'il revenait d'un enterrement, on voyait sous son meilleur jour, cette après-midi-là, ce qu'il y avait de particulier aux Forsyte dans la coupe de son visage – un visage concave et long, dont la mâchoire aurait paru extravagante sans les chairs qui la recouvraient, un visage tout en menton, mais qui n'était pas du tout laid. Il sentait plus fortement que jamais que la maison de Timothy était désespérément vieux jeu, et l'âme de ses tantes une lamentable survivance du milieu de l'ère victorienne.
La question dont seule il désirait parler – sa situation de non-divorcé –, il ne pouvait l'aborder. Et pourtant elle occupait son esprit à l'exclusion de tout le reste depuis le printemps. C'est alors seulement qu'avait pris naissance un sentiment qui le poussait à faire ce qu'il savait fort bien pouvoir, chez un Forsyte de quarante-cinq ans, n'être qu'une sottise...."
L'action donc reprend près de vingt ans après "The Man of Property". Soames, maintenant âgé de 45 ans, est toujours obsédé par Irene et rongé par le désir d'un héritier. N'ayant pu obtenir l'annulation de son mariage, il entame une procédure de divorce pour adultère, mais doit pour cela prouver qu'Irene a eu une relation. Pendant ce temps, Jeune Jolyon (le fils du vieux Jolyon et père de June), devenu un artiste établi et l'exécuteur testamentaire de son père, se rapproche d'Irene, dont il était secrètement amoureux. Ils finissent par tomber amoureux et vivent ensemble. Soames, de son côté, poursuit une jeune Française, Annette Lamotte, qu'il envisage d'épouser. Le drame juridique et sentimental culmine lorsque Soames, apprenant la relation entre Irene et Jolyon, obtient enfin son divorce pour adultère. Presque simultanément, Irene et Jeune Jolyon se marient, tandis que Soames épouse Annette. Les deux femmes tombent enceintes. Irene donne naissance à un fils, Jon. Annette, après une grossesse difficile, donne naissance à une fille, Fleur, mettant fin au rêve de Soames d'avoir un héritier mâle.
Le titre fait référence aux lourdeurs de la justice ("In Chancery" désigne la Cour de Chancellerie), mais aussi à l'état d'emprisonnement dans lequel se trouvent tous les personnages, pris au piège du passé. Le livre explore les thèmes de l'obsession, de la renaissance et de l'ironie du destin. La naissance des deux enfants, Jon et Fleur, crée la faille dramatique qui portera la génération suivante : ils sont les enfants innocents d'une haine familiale ancestrale.
Ainsi s`achèvent les deux premiers livres, où l'écrivain, après avoir tracé l'histoire de la première génération des Forsyte, solide et immuable, a étudié la crise de la deuxième, c`est-à-dire les heurts entre les principes traditionnels et les passions. ces passions que, dans son puritanisme austère et aveugle, la société victorienne se refusait d'admettre....
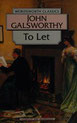
"A louer" (To Let, 1921), le troisième volume de la saga...
Le récit se place vingt ans plus tard; la Première Guerre mondiale a eu lieu; la mentalité anglaise a évolué; il y a plus d'audace, plus de liberté dans la pensée et dans les mœurs.
La première génération des Forsyte a disparu, la seconde a vieilli et cède la place à la troisième qui a vingt ans : Fleur, fille de Soames et d'Annette; Jon, fils d'Irène et de Jolyon; Holly, fille du premier amour de Jolyon, demi-sœur de Jon, qui, elle aussi a épousé un Forsyte. Ils se retrouvent tous chez June, laquelle tient une galerie de peinture (signe des temps) où Soames, amateur de peinture classique et traditionnelle, contemple, scandalisé, des toiles d'avant-garde. Jon et Fleur s'éprennent l'un de l'autre ; ils ont toutes les facilités, grâce aux mœurs nouvelles, pour se fréquenter.
Leurs deux familles s'opposent fermement à leur mariage. Jon, qui est très attaché à ses parents, est prêt à se résigner, mais Fleur est plus combative; il y a alors certaines scènes pénibles au cours desquelles Jon apprend les raisons de l'aversion de sa mère pour Soames et sa famille. Jolyon, déjà âgé, meurt, tourmenté de savoir dans quelle situation morale se trouve sa femme. Soames, qui a une adoration pour sa fille, s'humilie devant Irène, mais en vain, car Jon, laissé libre, sacrifie son amour à sa mère. Irène et Jon quittent l'Angleterre pour la Colombie britannique, et l'on voit écrit sur la vieille maison de Robin Hill : "À louer".
Chapitre premier - Une rencontre
"LE 12 mai 1920, dans l'après-midi, Soames Forsyte sortait de l'hôtel Knightsbridge où il était descendu, pour visiter une exposition de peinture à la Galerie de Cork Street, et prendre ainsi un aperçu de l'avenir.
Il allait à pied. Depuis la guerre il ne prenait jamais de taxis sans nécessité, tenant les chauffeurs pour des êtres grossiers; comme tous les gens de leur classe, ils le faisaient penser vaguement à la révolution. La terrible anxiété de la guerre, les émotions plus vives encore que la paix lui avait apportées avaient profondément marqué sa nature tenace. Il avait si souvent envisagé la ruine, qu'il avait cessé de la croire possible. Payer quatre mille livres par an d'impôts sur le revenu et de super-taxe, la situation ne pouvait guère être pire... Une fortune d'un quart de millier de livres, sans autres charges que celles d'une femme et d'une fille, et très divisée comme placements, est une garantie sérieuse, même contre cette idée folle : le prélèvement sur le capital. Quant à la confiscation des profits de guerre, il l'approuvait pleinement, n'en ayant pas réalisé. "C'est bien fait pour eux", se disait-il.
D'autre part le prix des tableaux était plutôt en hausse; sa collection lui avait donné, depuis le commencement de la guerre, plus de satisfaction que jamais. Les raids aériens eux-mêmes avaient exercé une influence favorable sur son esprit trop circonspect et avaient achevé d'endurcir un caractère déjà bien trempé. Le risque d'une dispersion totale de sa personne lui faisait paraître moins redoutables les dispersions partielles telles que les impôts et les prélèvements; son habitude de fulminer contre les Allemands s`était peu à peu transformée en propos indignes contre le parti socialiste, formulés sinon ouvertement, du moins tout bas.
Il marchait, il avait le temps; Fleur lui avait donné rendez-vous à l'exposition, à quatre heures, et il n'était que deux heures et demie. Marcher lui faisait du bien, car il avait mal au foie et les nerfs un peu fatigués. Sa femme, quand elle était en ville, ne restait jamais à la maison, sa fille était toujours en l'air, comme la plupart des jeunes. Encore s`estimait-il heureux qu'elle eût été trop enfant pour entreprendre quoi que ce fût pendant la guerre.
Certes, il avait approuvé la guerre des le début, de toute son âme, mais de là à laisser sa femme et sa fille payer de leurs personnes, il y avait un abîme, que des préventions d'un autre temps, son horreur de toute exagération sentimentale rendaient infranchissable. C'est ainsi qu'il s'était opposé de toutes ses forces à laisser Annette, si séduisante encore à trente-cinq ans, retourner à sa France natale, sa chère Patrie, comme elle l'appelait dans la fièvre du moment, pour soigner ses "braves poilus" au risque de ruiner sa santé, sa beauté, comme si elle était réellement infirmière! Il y avait mis son veto.
Qu`elle tricote pour les blessés, à la maison, ou qu'elle cause! Donc, elle n'était pas partie, mais elle avait changé. La désagréable petite tendance qu`elle avait à se moquer de lui, non pas ouvertement mais d'une façon imperceptible, s'était encore accrue.
Quant à Fleur, la guerre avait tranché l'irritant problème de son éducation à la maison ou en pension. Elle était mieux loin de sa mère dans l'état d'esprit de cette dernière, à l'abri des gothas, et soustraite à la tentation de faire des choses extraordinaires. Il l'avait donc mise dans un pensionnat situé aussi loin dans l'Ouest qu'il était possible sans sacrifier l'excellence de l'instruction. Et elle lui avait terriblement manqué. Fleur! Il n'avait jamais regretté le nom un peu bizarre qu'il lui avait donné le jour de sa naissance, quoique ce fût une concession marquée à l'influence française.
Fleur! Un joli nom. Une jolie enfant, mais qu'elle était donc agitée, trop agitée et volontaire, et connaissant si bien son influence sur son père! Soames réfléchissait souvent aux inconvénients qu'il y avait à gâter sa fille, à être vieux et faible! Soixante-cinq ans. Il vieillissait, mais sans en souffrir, car son second mariage avec Annette, si jeune et si belle, avait heureusement tourné de façon bien calme. Il n`avait aimé avec passion qu'une fois, sa première femme, Irène...."
"To Let" est la conclusion tragique de la première saga. C'est la pièce qui montre comment les péchés des pères retombent sur les enfants. Le titre ne se réfère pas seulement à la maison, mais à l'état des cœurs : le bonheur est "à louer", temporaire, jamais pleinement acquis. Le livre est un adieu à l'ère victorienne et une entrée douloureuse dans l'ère moderne, où les jeunes héritent d'un monde brisé par les générations précédentes. Le renoncement de Jon est l'acte final qui brise la malédiction, mais au prix du bonheur des deux amants.
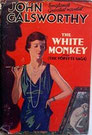
"Le Singe blanc" (The White Monkey, 1924], quatrième livre de la Saga ..
Le titre du présent livre est central pour comprendre l'œuvre. Il renvoie à un tableau étrange et fascinant, acheté par Soames, représentant un singe blanc qui, ayant mangé des fruits, tient dans sa patte la pelure vide et fixe le spectateur avec une interrogation mélancolique. Ce singe symbolise le désenchantement et l'absence de sens de la génération de l'après-Première Guerre mondiale. Il a tout ce qu'il veut (la satisfaction matérielle), mais il se retrouve vide, confronté à l'absurdité de l'existence. C'est l'emblème parfait des "Années Folles" et de leur frénésie superficielle qui cache un profond malaise existentiel.
"Le Singe blanc" est le premier volume de la seconde trilogie, Une Comédie Moderne (A Modern Comedy). Il se déroule en 1922-1923, soit juste après les événements de A Louer. Le changement d'époque est radical : on est passé du monde étouffant et structuré de l'ère victorienne/édouardienne au monde chaotique, cynique et désorienté de l'après-guerre. Si la première saga était une "tragédie", celle-ci est une "comédie" au sens classique : une satire des mœurs d'une époque, où les personnages sont davantage guidés par leurs défauts et leurs illusions que par un destin tragique.
L'histoire se concentre sur la jeune génération, principalement Fleur Forsyte et son mari Michael Mont.
- Le Mariage de Fleur et Michael : Fleur, meurtrie par son renoncement à Jon Forsyte, épouse rapidement Michael Mont, un jeune aristocrate aimant, gentil et légèrement naïf. Leur mariage semble heureux, mais il est miné par un secret : Fleur n'a pas oublié Jon et son amour pour Michael n'est pas aussi profond et passionné.
- La Vie Mondaine : Fleur, en quête perpétuelle de distraction et de prestige, fait de leur maison un salon à la mode, le lieu de rendez-vous des artistes et des esprits "modernes". Elle s'entoure de figures ambiguës, comme l'écrivain cynique Wilfrid Desert, qui tombe amoureux d'elle.
- Les Préoccupations de Michael : Alors que Fleur navigue dans le monde frivole, Michael, devenu député, est rongé par un idéalisme sincère. Il travaille pour une maison d'édition et s'inquiète sincèrement des problèmes sociaux, notamment du chômage et de la condition des anciens combattants. Il incarne une tentative de moralité dans un monde amoral.
- La Crise : Wilfrid Desert avoue son amour à Fleur. Celle-ci, flattée et excitée par le danger, entretient une relation émotionnellement adultère. La situation culmine lorsque Michael découvre la vérité. Il confronte Fleur avec une dignité et une douleur qui la forcent à regarder sa propre frivolité en face.
- Le Dénouement : Fleur, réalisant qu'elle risque de perdre la stabilité et l'amour sincère que Michael lui offre, met fin à sa relation avec Wilfrid. Le roman se termine sur une apparence de réconciliation, mais avec un sentiment de fragilité. Fleur annonce qu'elle est enceinte, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir, mais laissant planer le doute sur sa capacité à être une bonne mère.
"1 - Promenade Par un après-midi de cette mi-octobre de 1922 si lourde de conséquences, sir Lawrence Mont, neuvième baronet du nom, descendait les marches de l’édifice baptisé Snook’s Club par George Forsyte à la fin des années 1880. Il pointa son nez aristocratique en direction du vent d’est, détendit ses jambes maigres et partit d’un pas rapide.
Politicien par naissance plutôt que par nature, il considérait avec un détachement mêlé d’humour la révolution qui venait de rendre le pouvoir à son parti. Comme il passait devant le Remove Club, il songea : « Ils ne doivent pas en mener large, ici ! Finis, les petits plats fins. Une simple bécasse nature, pour varier leur menu ! »
Quand il avait été élu au Snook’s, les grandes vedettes avaient déjà quitté le club. Il n’en était pas, ah ! certes non ! de cette bande de démagogues, aujourd’hui congédiés ; des gens qui avaient tourné casaque à l’instant où se terminait la guerre ! Pouah !
Il venait de passer une heure à écouter des propos dans lesquels son esprit alerte et retors, solidement accroché au passé, sceptique en matière de présent et de toutes les professions de foi politiques, avait noté avec amusement la confusion qui s’établissait entre le patriotisme et les attaques personnelles dans cette assemblée fatale. Comme la plupart des propriétaires terriens, il se méfiait des doctrines. La seule conviction politique qu’il possédât était la nécessité d’une taxe sur le blé, et il lui semblait en être l’unique partisan. Mais il n’était pas en campagne électorale, de sorte que son credo ne risquait pas d’être ébranlé par le souci du vote des acheteurs de pain.
« Au fond, songea-t-il, les principes sont une valeur » ; et il regretta que les gens n’eussent pas carrément la franchise de l’avouer ! « Une valeur au sens profond du terme : l’intérêt personnel de chacun en tant que membre d’une communauté définie… et comment diantre cette communauté définie, la nation anglaise, pourrait-elle continuer d’exister, avec un sol de moins en moins cultivé et des docks et des navires menacés de destruction par les aéroplanes ? »
Il avait vainement attendu pendant cette heure une seule allusion à la terre. Pas une ! Il s’agissait bien de politique pratique avec ces hommes-là ! Le diable les confonde ! Briguer des places et s’y cramponner jusqu’à user leurs culottes, bon Dieu ! voilà à quoi ils étaient bons ! Mais quel rapport entre les postérieurs et la postérité ? Le mot « postérité » lui rappela soudain que la femme de son fils ne lui en préparait pas encore. Deux ans de mariage ! Il était temps de penser aux enfants. L’habitude de n’en pas avoir pouvait devenir dangereuse alors qu’un titre et un domaine en dépendaient.
Un sourire contracta ses lèvres et ses sourcils qu’il avait touffus, noirs et broussailleux. « Une jolie femme, pensa-t-il, extrêmement séduisante, et elle ne l’ignore pas, loin de là ! Qui n’arrive-t-elle pas à attirer chez elle ? Lions, tigres, singes et chats… tous se donnent le mot pour accourir dans sa maison qui est en passe de devenir une véritable ménagerie de célébrités plus ou moins illustres. Un peu factice, tout cela, je le crains ! »
Devant un des lions emblématiques de Trafalgar Square, sir Lawrence se dit : « En voilà encore un qu’elle finira par amener chez elle, un de ces jours ! Elle a la manie de la collection. Prends garde, Michael ! Dans la maison d’un collectionneur, il y a toujours un cabinet de débarras pour le fatras qui a cessé de plaire, et les maris sont exposés à y être fourrés. Cela me rappelle que je lui ai promis un ministre chinois. Il va falloir qu’elle attende jusqu’après les élections législatives. »
Près de Whitehall, les tours de Westminster se profilèrent un instant sur le ciel gris… « Ça aussi, se dit-il, c’est bien facile !… Michael et ses marottes !… Enfin, c’est la mode ! Des principes socialistes et une femme riche, sacrifice et sécurité, paix et abondance ! Remèdes de charlatan, dix pour un penny ! »
À Charing Cross, fuyant le vacarme des crieurs de journaux rendus hystériques par la crise politique, il tourna à gauche et se dirigea vers la maison Danby et Winter, éditeurs, dont son fils était l’associé.
Un nouveau sujet de livre avait commencé à hanter son esprit ; il avait déjà donné, après une Vie de Montrose, son Cathay lointain, récit d’un voyage en Extrême-Orient, et une conversation imaginaire entre les ombres de Gladstone et de Disraeli, intitulée Duo.
Depuis qu’il était sorti du club, chacun des pas qui le conduisait vers l’est semblait prêter un aspect plus insolite à sa mince et droite silhouette, serrée dans un manteau au col d’astrakan, à son maigre visage barré d’une moustache grise où le monocle cerclé d’écaille s’encastrait sous le sourcil vigoureux et sombre. Cette singularité alla s’accentuant au point de sembler quasi phénoménale dans la ruelle sordide où les voitures s’agglutinaient, telles des mouches en hiver, et où circulaient des hommes portant des livres sous le bras, comme des intellectuels.
Il avait presque atteint la porte des éditeurs lorsqu’il rencontra deux jeunes gens. L’un d’eux était, à n’en pas douter, son fils. Mieux habillé depuis son mariage, il fumait un cigare, Dieu merci ! au lieu de ses éternelles cigarettes ! Quant à l’autre – mais oui ! –, c’était le poète en herbe, le garçon d’honneur de Michael ; tête haut dressée, une tête lisse sous un chapeau de feutre taupé !
— Eh ! Michael ! dit-il.
— Hello, Bart !
— Tu connais mon père, Wilfrid ? Wilfrid Desert, l’auteur de Monnaie de billon, un vrai poète, Bart, vous pouvez m’en croire. Il faut que vous le lisiez. Nous rentrons. Vous venez avec nous ?
Sir Lawrence leur emboîta le pas.
— Quoi de neuf au club ?
— Le roi est mort, vive le roi ! Les travaillistes peuvent commencer à débiter leurs mensonges, Michael : les élections sont pour le mois prochain.
— Bart a été élevé, Wilfrid, à une époque où l’on ne connaissait pas Demos.
— Dites-moi, monsieur Desert, trouvez-vous le moindre souci de réalisme dans notre politique actuelle ?
— En trouvez-vous dans quoi que ce soit, monsieur ?
— Dans l’impôt sur le revenu, peut-être !
Michael rit silencieusement.
— Au-dessus du rang de chevalier, il n’existe plus de foi toute simple.
— Supposez que vos amis arrivent au pouvoir – ce qui ne serait pas un mal à certains égards, ça les mûrirait –, que pourraient-ils bien faire ? Pourraient-ils ressusciter le patriotisme ? Abolir le cinéma ? Enseigner aux Anglais l’art de cuisiner ? Empêcher les autres nations de nous menacer de la guerre ? Nous faire produire notre propre subsistance ? Arrêter l’exode vers les villes ? Est-ce qu’ils pendraient tous ceux qui s’occupent de gaz toxiques ? Pourraient-ils interdire l’aviation en temps de guerre ? Seraient-ils capables d’affaiblir l’instinct de la propriété, où que ce soit ? Ou de faire autre chose que de changer quelques détails à l’ordre établi ? Toute politique de parti vise trop haut. Nous sommes dirigés par des technocrates et par la nature humaine. Résultat : nous voilà dans le lac, monsieur Desert !
— C’est bien mon avis, monsieur.
Michael brandit son cigare :
— Vous êtes d’affreux fossiles, vous deux !
Comme ils passaient devant le Cénotaphe, ils se découvrirent.
— Curieusement symptomatique, ce monument ! dit sir Lawrence. Il semble érigé à la terreur de la gloriole… c’est très net. Et la terreur de la gloriole…
— Allez-y, Bart, dit Michael.
— Beauté, sublime, magnificence, tout cela est du passé. Plus de perspectives à longue échéance, plus de vastes projets, plus de grandeur, qu’il s’agisse de principes, de religion ou d’art. À la place, une esthétique de cliques et de chapelles ; de petits hommes sous de petits chapeaux.
— Comme le cœur soupire après Byron, Wilberforce et le monument de Nelson, mon pauvre vieux Bart ! Qu’en penses-tu, Wilfrid ?
— Oui, monsieur Desert, qu’en pensez-vous ?
La sombre figure de Wilfrid se contracta.
— Notre époque est celle du paradoxe, dit-il. Nous réclamons impatiemment la liberté, et les seules institutions qui gagnent en force sont le socialisme et l’Église catholique romaine. Nous sommes terriblement férus d’art, et le seul qui progresse, c’est le cinéma. Nous sommes entichés de la paix, et tout ce que nous faisons pour elle, c’est de perfectionner les gaz toxiques.
Sir Lawrence dévisagea furtivement ce jeune homme si débordant d’amertume.
— Comment marchent les affaires, Michael ? demanda-t-il.
— Eh bien, Monnaie de billon s’enlève comme des petits pains, et Duo a l’air de bien démarrer. Que diriez-vous de cette réclame ? « Duo, de sir Lawrence Mont, baronet, la conversation la plus distinguée qui se soit jamais tenue au royaume des morts. » Cela pourrait attirer les adeptes du spiritisme. De son côté, Wilfrid suggère : « Le Grand Vieux et Dizzy, transmis par sans-fil de l’enfer. » Que préférez-vous ?
Ils étaient arrivés devant un agent qui, la main dressée sous le nez d’un cheval attelé à une voiture, arrêtait toute la circulation. Les moteurs des automobiles ronronnaient au ralenti ; leurs conducteurs fixaient avidement l’espace interdit ; une jeune fille à bicyclette regardait distraitement autour d’elle tout en s’agrippant à l’arrière de la voiture où un gamin, assis de biais, tendait les jambes vers elle.
Sir Lawrence examina de nouveau Wilfrid Desert à la dérobée. Le visage mince, d’une pâleur mate, était beau, mais inquiétant, mal équilibré ; rien d’outré ni dans la tenue ni dans les manières, et pourtant, un genre à part, impossible à classer dans une catégorie sociale définie ; il paraissait moins animé que son énergumène de fils, mais il devait être aussi instable et plus sceptique encore… un écorché vif au fond, sûrement !
L’agent abaissa le bras.
— Avez-vous fait la guerre, monsieur Desert ?
— Naturellement.
— Aviation ?
— Et infanterie. Un peu des deux.
— Dure épreuve pour un poète !
— Pas du tout. La poésie n’est possible que si l’on frôle la mort à chaque instant ou si l’on habite un faubourg comme Putney.
Sir Lawrence leva les sourcils :
— Vraiment ?
— Tennyson, Browning, Wordsworth, Swinburne… voyez comment ils s’en sont tirés ; ils vivaient, mais si peu !
— Ne pensez-vous pas qu’il existe encore une troisième circonstance qui incite à la poésie ?
— Laquelle, monsieur ?
— Comment la définirai-je ? Une certaine agitation cérébrale relative à la femme ?
Le visage de Desert se contracta et parut s’assombrir.
Michael introduisit sa clef dans la serrure de la porte d’entrée...."
Mordre dans la vie à belles dents et en jeter J’écorce à la face du monde sans souci des conséquences, telle semble être la maxime qu’illustre le singe blanc du tableau que Soames Forsyte donne à sa fille, Fleur Mont. Si l’oeuvre est très ancienne, sa maxime est au goût du jour et Fleur s’applique de son mieux à la mettre en pratique. Pour l’instant, cela se résume à rassembler autour d’elle les célébrités de l’heure. Elle collectionne les gens comme son père les tableaux, à ceci près que les premiers ne se laissent pas toujours manipuler docilement. Le poète Wilfrid Desert en donne la preuve accablante. Ami intime de son mari, Michael Mont, Wilfrid déclare l’aimer et vouloir être payé de retour, sinon il partira. Perdre le fleuron de sa collection ou... ou quoi? Michael n’a jamais été qu’un pis-aller. Alors? Michael, qui le sait, attend en silence que la balance penche d’un côté ou de l’autre. Se dire que l’homme, à l’échelle de l'univers, est un simple moucheron et ses peines de coeur dérisoires est un piètre réconfort, et ce ne sont pas les démêlés de son beau-père avec le chômage qui pourraient le consoler, mais la combinaison de l’esprit de jouissance et du cynisme ne produit pas toujours un mélange détonant.
C’est sur une note d’optimisme que s’achève cet épisode décisif pour la dynastie des Forsyte et des Mont — premier tome de La Comédie moderne qui fait suite à La Saga des Forsyte.
"... L’instinct de propriétaire des Forsyte avait contribué à faire acheter cette habitation. Soames l’avait dénichée, à peine achevée, pour sa fille, au moment critique de l’inflation.
Fleur s’était immédiatement mise en rapport avec l'architecte — de ces gens que Soames n‘avait jamais pu « avaler » — et elle avait décidé qu'il n’y aurait pas plus de trois styles dans sa maison : le chinois, l'espagnol, et le sien propre. Le chinois régnait à gauche de l’entrée dans une pièce qui occupait toute la profondeur de l’immeuble : elle avait des panneaux en ivoire, un plancher de cuivre, le chauffage central et des lustres en cristal.
On y voyait quatre tableaux, tous quatre chinois, — la seule école de laquelle son père ne s’était pas encore occupé. Une cheminée importante s’ornait de chiens chinois, debout sur des carreaux de faïence chinoise. Deux coffrets à thé anciens, noirs, des merveilles, venaient de chez Jobson, ot Soames les avait découverts et payés un bon prix. Pas de piano, instrument trop encombrant, et d’un occidentalisme irrémédiable. Fleur tenait à l’espace, aimant collectionner les êtres plus que les bibelots ou les meubles.
Les fenêtres se faisaient vis-à-vis, mais la lumière qu’elles déversaient n’avait malheureusement rien de chinois. Fleur se mettait parfois au centre de son salon et réfléchissait : comment placerait-elle ses invités, comment donner à la pièce un aspect plus chinois encore, sans en compromettre le confort ? comment parler politique et littérature en femme pour qui l'une et l'autre n'ont plus aucun secret ? comment accepter tous les cadeaux de son père, sans lui faire sentir que son goût n’était plus celui du temps; comment conserver son empire sur Sibley Swan, la nouvelle étoile littéraire, tout en faisant la conquête de Gurdon Minho, la vieille étoile ? Et ce Wilfrid Desert, il commençait vraiment à trop l’aimer... et quel genre de toilette adopterait-elle? .. et Michael... pourquoi avait-il de si drôles d’oreilles ? Et parfois aussi, elle demeurait là sans pensée, tourmentée d’une vague souffrance.
Quand les trois hommes entrèrent, Fleur, assise devant une table en laque rouge, achevait de goûter. Elle faisait toujours servir le thé d’assez bonne heure, de maniére à s’assurer une bonne petite bombance préliminaire à elle toute seule : elle n’avait pas encore vingt et un ans, et, à ce moment de I’après- midi, il lui plaisait de se sentir jeune.
A son côté, Ting-a-Ling, dressé sur ses pattes de derrière, ses minuscules pattes de devant posées sur un tabouret chinois, tournait son museau camard, noir et feu, vers les objets de ses réflexions.
« Suffit! Ting! Assez, mon trésor ! tu entends ? »
L’expression de Ting-a-Ling répondait : « Bien ! mais alors arrête-toi aussi : et cesse de me soumettre à la torture! »
Michael avait acheté le petit chien, âgé de quinze mois, l'année précédente, et l’avait offert à sa femme pour son vingtième anniversaire. Fleur portait toujours sa coiffure de jeune fille, ses cheveux châtain foncé coupés très courts; pourtant, le mariage l’avait modifiée : il avait accentué la décision de sa bouche mobile et le charme de ses yeux noisette aux cils noirs; il avait mis dans sa démarche plus de rythme et de fermeté, arrondi sa poitrine et ses hanches, tandis que s'amincissaient sa taille et ses jambes; son visage, d’un teint plus pâle, s’était affiné, et sa voix, plus chaude, avait pris des inflexions caressantes.
Debout derrière le plateau, elle tendait son bras blanc et rond sans rien dire. Elle évitait toujours ces banalités de l’accueil et de l’adieu qu'il lui eût fallu répéter trop souvent, et les remplaçait volontiers par un regard, une pression de la main, une inclinaison de la tête.
- « Asseyez-vous, dit-elle. De la crème, monsieur ? Du sucre, Wilfrid ? Ting a déjà trop mangé; ne lui donnez plus rien! Passe donc les gâteaux, Michael. Je sais tout ce qui s’est dit à la réunion du Snook’s. Tu ne vas pas, j’espère, faire campagne pour les travaillistes, Michael; ces campagnes sont si bêtes. Si l'on s’avisait de vouloir influencer mon choix, je voterais immédiatement en sens contraire. — Sans doute, chérie, mais tu n’es pas l’électeur moyen ! »
Fleur le regarda : ç'avait été très gentiment dit.
Elle constata d’un coup d’oeil que Wilfrid se mordait les lèvres, que Sir Lawrence s’en apercevait, que ses jambes gainées de soie se montraient un peu trop, que ses tasses noir et crème attendaient... Un cillement de ses paupières et Desert cessa de se mordre
les lévres; un mouvement de son pied, et Sir Lawrence s'arrêta de la regarder. Elle offrit les tasses et demanda : « Pourquoi ? Vous ne me trouvez pas assez moderne ? »
Desert, tout en remuant une petite cuiller brillante dans sa tasse pie, répondit sans lever les yeux : « D’autant plus moderne parmi les modernes, que vous tes plus classique.
— Gare à la poésie », dit Michael, et il emmena son père voir les nouvelles caricatures d’Aubrey Greene.
Alors, elle se tourna vers Wilfrid : « Ayez la bonté de m’expliquer ce que vous avez voulu dire.
— A quoi bon ? répondit Desert, et sa voix semblait lui échapper. Ne perdons pas notre temps sur ce sujet.
— Mais je veux savoir. Vos paroles ont sonné, tout à l'heure, comme un sarcasme.
— Un sarcasme ? De ma part ? Fleur...
— Alors, expliquez-vous.
— Eh bien, j'ai voulu dire que vous avez toute l’inquiétude des modernes, tout leur arrivisme et leur sens pratique, Mais vous avez aussi, Fleur, ce qui leur manque, le pouvoir de tourner les têtes. Et la mienne est tournée, vous le savez bien.
— Comment Michael prendrait-il ces paroles, venant de vous, Wilfrid, son témoin ? »
Desert s’approcha rapidement de la fenêtre. Elle prit Ting-a-Ling sur ses genoux. De semblables déclarations, elle en avait déjà reçu; mais de la part de Wilfrid c’était sérieux ..."
Fleur a épousé, sans amour, Michael Mont, le fils d'un baronnet qui est codirecteur d`une grande maison d'édition. Lancée dans une trépidante vie mondaine. elle s'entoure d'une société brillante et disparate qui peuple son "salon chinois" où l'on voit un tableau représentant un singe blanc tenant un fruit dans sa main. Décidée à jouir de la vie, elle n`est pas sans avoir quelques flirts, mais elle s'efforce d'éviter toute complication sentimentale. Cette mentalité est bien dépeinte dans l'épisode principal; un jeune poète, Wilfrid Deserd. affolé par sa coquetterie et sa beauté, se prend pour elle d`une violente passion. Michael s`en émeut; conscient de n'avoir jamais inspiré d'amour à sa femme, il est prêt à se sacrifier ; mais Fleur se reprend et rompt cyniquement avec le jeune poète qui, désespéré, part pour les colonies.
Le sixième volume se déroulera en partie pendant la grève générale de 1926; nous assistons au retour de Jon et à la reprise, entre lui et Fleur, de leur amour d'adolescents. L'énergie de Soames évite de justesse un scandale. Soames meurt dans un incendie, en essayant de sauver sa collection de tableaux, et avec lui disparaît le dernier des "vrais" Forsyte.
La disparition des classes moyennes supérieures est un thème est un classique de la littérature, surtout aux XIXe et XXe siècles, période de transformations sociales accélérées (révolutions industrielles, guerres mondiales, montée de nouvelles idéologies). Les auteurs l'ont abordée sous plusieurs angles ..
a) Les contemporains de Galsworthy, le crépuscule d'un monde ...
- Émile Zola (France) : Dans sa série "Les Rougon-Macquart", Zola documente l'ascension et souvent la chute ou la dégénérescence de familles bourgeoises sous le Second Empire. Dans La Curée, il peint une bourgeoisie nouvelle, spéculative et corrompue, déjà en proie à ses propres excès. La "disparition" est ici morale et sociale.
- Thomas Mann (Allemagne) : "Les Buddenbrook" (1901) est l'exemple par excellence. Le roman décrit sur quatre générations le déclin inexorable d'une grande famille de marchands Lübeckois. La fortune s'érode, la vitalité commerciale fait place à une sensibilité artistique et à une morbidité qui signent la fin de la lignée. C'est la disparition par épuisement interne et inadaptation.
- Marcel Proust (France) : "À la recherche du temps perdu" est une vaste fresque sur la transformation de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie française. Le narrateur assiste à la montée sociale des Verdurin (bourgeois vulgaires qui finissent par s'imposer) et à la lente déchéance du faubourg Saint-Germain. La "disparition" est celle d'un monde clos dont les codes sont balayés par le temps et l'arrivisme.
b) Une critique plus acerbe et une nécrologie anticipée ...
- Franz Kafka (Tchécoslovaquie) : Dans "Le Procès" et "Le Château", la classe moyenne (représentée par K.) est écrasée par des systèmes bureaucratiques et opaques dont elle ne comprend ni les règles ni la logique. La disparition est ici celle de l'individu et de son agency face à un pouvoir impersonnel qui le nie.
- George Orwell (Royaume-Uni) : Dans "1984", la classe moyenne supérieure (les "membres extérieurs" du Parti) est surveillée, contrôlée et broyée par l'État totalitaire. Sa disparition est programmée en tant que classe autonome ; elle doit être absorbée dans la masse docile des "proles" ou anéantie.

Un jalon essentiel de l'histoire de la télévision ...
"The Forsyte Saga" (BBC, 1967) fut un feuilleton télévisé britannique en 26 épisodes de 50 minutes en noir et blanc, adapté du roman éponyme de John Galsworthy et diffusé entre le 7 janvier et le 1 juillet 1967 sur le réseau BBC Two, puis en France, à partir du 3 octobre 1970 sur la première chaîne de l'ORTF, et rediffusé en 1976 sur Antenne 2. Ce fut un énorme succès mondial et est considérée comme une pierre angulaire de l'histoire de la télévision ...
- un audience massive : La série a captivé le public britannique, rassemblant régulièrement plus de 6 millions de téléspectateurs (un chiffre énorme pour l'époque et pour BBC Two, une chaîne plus récente et culturelle). Elle a créé un véritable phénomène de société, avec des rues littéralement désertes pendant sa diffusion.
- un succès critique : acclamée par la critique pour sa fidélité à l'esprit de Galsworthy, la qualité de son scénario (signé par Donald Wilson), ses décors somptueux, ses costumes et surtout ses performances d'acteurs exceptionnelles (notamment Eric Porter en Soames, Nyree Dawn Porter en Irene, Kenneth More en Young Jolyon et Susan Hampshire en Fleur).
La série a été vendue dans plus de 26 pays, un exploit pour l'époque. Elle a été diffusée en France et dans de nombreux autres pays européens (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Scandinavie, etc.), rencontrant un grand succès critique et public. Aux États-Unis, sa diffusion sur les réseaux de télévision publique (PBS) dans le cadre de "Masterpiece Theatre" à partir de 1969 a été un triomphe retentissant. Elle a attiré des audiences record pour la télévision publique et a joué un rôle crucial dans l'établissement et la popularisation de "Masterpiece Theatre" comme une institution culturelle américaine. Son succès a été tel qu'elle a suscité des remakes et adaptations dans d'autres pays (comme l'URSS) peu après.
Elle a prouvé qu'une série télévisée pouvait attirer un large public adulte avec un contenu littéraire sophistiqué, des thèmes complexes (amour, possession, jalousie, conflits de classe, évolution sociale) et un ton souvent sombre. Son impact sociétal au Royaume-Uni et son succès international sans précédent ont établi un nouveau modèle ...
