- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki

Stefan Zweig (1881-1942), "Amok" (1922), "Der Kampf mit dem Dämon" (1925), "Verwirrung der Gefühle" (La Confusion des sentiments, 1926), "Ungeduld des Herzens" (La Pitié dangereuse, 1938), "Ving-quatre heures de la vie d'une femme" (1934), "Die Welt von gestern" (Le Monde d'hier, 1942) - ...
Last update: 29/11/2016

Littérature allemande des années 1920-1930
En Allemagne, les 15 années qui suivirent la fin de la Première Guerre mondiale sont marquées par une inflation démesurée et un chômage généralisé. Paradoxalement, cette époque est aussi celle de la culture de Weimar marquée par une effervescence jusque-là inconnue tant au niveau artistique que scientifique. Au niveau artistique, la littérature allemande, celle de Hermann Hesse (1877-1962), "Le Loup des steppes" (1927), Alfred Döblin (1878-1957), "Berlin Alexanderplatz" (1929), Thomas Mann (1875-1955), "La Montagne magique" (1924), Robert Musil (1880-1942), "L'Homme sans qualités" (1930), Leo Perutz (1882-1957), "Le maître du jugement dernier" (1923), Stefan Zweig (1881-1942), "La Confusion des sentiments" (1926), veut exprimer la complexité d'un monde moderne qui s'installe dans la confusion la plus extrême...
(Hans Baluschek (1898) "Monday Morning" - Stiftung Stadtmuseum Berlin)
Dans quel contexte s'élabore cette singulière écriture ? En tout premier constat, l'existence de la foule, de la foule urbaine, et de l'expérience de cette foule pour tout individu...
"L'individu naît avec la foule ; sans elle, il disparaît. Chacun de nous, consciemment ou non, dépend de son pouvoir. L'homme moderne ne saurait se soustraire à l'influence des autres hommes. Ce n'est plus l'homme des champs, berger ou chasseur, qui ne dépendait que de la colère du ciel, des caprices de la terre, des orages et de la grêle, du hasard enfin, qu'il revêt de l'image auguste de son Dieu. Les sentiments de l'homme moderne sont déterminés par le milieu auquel il appartient. Le monde l'entraîne dans sa marche et lui impose ses propres instincts. Nous sentons tous socialement, et pas un instant notre imagination ne peut supprimer ceux qui nous précèdent et ceux qui nous environnent, et qui sont comme l'air que nous respirons. Nous pouvons fuir leur présence ; mais ce qui a pénétré d'eux-mêmes en nous est inéluctable. Comme une force de la nature, la foule nous domine et nous nourrit de ses sentiments. L'homme non social est une fiction pure. Dans une grande ville, fût-on retiré au plus profond dune chambre, on ne peut échapper au bruit et au rythme de la rue. Ainsi est-il impossible de tenir sa pensée isolée, et son âme à l'écart des grandes excitations intellectuelles de la foule. Verhaeren lui-même l'avait essayé, au temps où il écrivait ces vers, "Mon rêve, enfermons-nous dans ces choses lointaines Comme en de tragiques tombeaux". Mais la vie réelle l'a ressaisi ; car la société anéantit qui se détourne d'elle comme qui vivrait loin de l'air pur. Le poète, lui aussi, doit malgré lui penser à la foule et d'accord avec elle.
Certes la démocratie a exercé sur tout son action niveleuse, elle a limité les individualités et assigné au poète un rang dans la classe bourgeoise ; certes elle a atténué les contrastes de la destinée. Mais elle a porté à sa pleine maturité une puissance nouvelle en sa multiplicité même. En elle le poète peut trouver une explication directe aux phénomènes qui forçaient les anciens à inventer des dieux : c'est-à-dire à toutes ces forces incalculables et mystérieuses qui agissent sur les hommes. La ville, la foule puise son énergie dans son infinie plénitude et multiplie sa propre puissance. Tout ce que l'individu a perdu se retrouve en elle : l'enthousiasme sublime, l'enthousiasme extatique. Elle est l'in tarissable source de l'inattendu et de l'incalculable. C'est une nouveauté, et chacun ignore le terme de sa grandeur. Avoir reconnu là, au lieu d'une diminution, un enrichissement de l'instinct poétique, tel fut un des principaux mérites de Verhaeren. Tandis que la plupart des poètes d'aujourd'hui en restent encore à la fiction du solitaire, de l'isolé, tandis que dans leur horreur ils fuient la foule comme la peste, qu'ils se confinent dans une solitude artificielle et qu'ils n'ont que du mépris pour la locomotive et le télégraphe, pour les banques et les usines, Verhaeren boit avidement à cette fontaine d'où ruisselle une énergie nouvelle : "Comme une vague en des fleuves perdue, Comme une aile effacée, au fond de l'étendue, Engouffre-toi, Mon cœur, en ces foules battant les capitales! Réunis tous ces courants Et prends Si large part à ces brusques métamorphoses D'hommes et de choses, Que tu sentes l'obscure et formidable loi Qui les domine et les opprime Soudainement, à coups d'éclairs, s'inscrire en toi."
C'est que, en effet, la foule est, de nos jours, la grande transformatrice de valeurs. Elle transforme les hommes, qui, pour se réunir en son sein, se précipitent vers elle des quatre points cardinaux. Nul de nous n'échappe à cette force qui veut tout niveler. Dans le formidable réservoir qu'est la Ville, les races les plus éloignées se mélangent. Elles s'adaptent les unes aux autres, et voici qu'éclot tout à coup un produit nouveau, différent : une race neuve, celle de l'homme contemporain, qui s'est réconcilié avec l'atmosphère de la grande ville. Cet homme sent douloureusement peser sur lui les lourdes murailles, il souffre de l'éloignement de la nature ; mais il trouve dans l'omniprésence humaine à se créer une énergie, une divinité nouvelles. Le plus grand mérite que possède la masse, c'est de pouvoir accélérer les transvaluations. Tout l'élément individuel disparaît au profit de la communauté qui se constitue ainsi en tant que personnalité. Les anciennes communautés se disloquent pour en voir jaillir de nouvelles. L'Amérique en est le premier exemple. Là, en cent ans, faite des forces de mille peuples divers, s'est développée une fraternité, grandiose et une ; un type s'est créé : le type américain. Déjà dans nos capitales, à Paris, à Berlin, à Londres, grandissent des générations d'hommes qui ne sont plus des Français ni des Allemands, mais avant tout des Parisiens et des Berlinois. Ils ont un accent à eux, des façons de penser particulières : pour eux, la grande ville est devenue une patrie. Si l'un d'eux est poète, son poème sera social ; est-il penseur, son intelligence et son instinct se confondront avec ceux de la masse. Avoir tenté, pour la première fois, l'analyse poétique de la psychologie de cette foule est une des grandes audaces dont nous devons être reconnaissants à Verhaeren.."
Et Zweig de poursuivre, dans sa biographie du poète Emile Verhaeren, le poète des "Villes tentaculaires", une biographie publiée en 1910...
"La surexcitation est le rythme même de la vie moderne. La ville et la foule qui y circule ne connaissent jamais de parfait repos. Jusque dans leur silence trépide encore l'inquiétude secrète d'une passion contenue : c'est une attente, une tension nerveuse, une fièvre lente. L'énergie fait partie intégrante des foules et des grandes villes, au point que jamais ne s'arrête leur activité. Le sentiment du repos leur est contraire; il annihilerait, anéantirait au plus intime d'elles cet élément de nouveauté. Certes, la ville et la foule ne connaissent pas tous les jours ces grandes explosions de la passion, qui les font ressembler à des volcans, au moment desquels les rues, pareilles à de grandes artères, semblent charrier des fleuves de sang, où tous leurs muscles paraissent contractés, où les cris et les enthousiasmes jaillissent ainsi qu'une flamme. Mais il est en elles comme un ferment qui paraît n'attendre pour lever que cet instant, de même que tout homme moderne éprouve au fond de son âme comme une attente, une inquiétude devant la nouveauté, devant l'avenir que lui réserve demain la vie. Les villes et la foule de leurs habitants sont dans une incessante vibration. Si l'individu, pris en particulier, ne connaît pas d'excitation, si ses nerfs ne vibrent pas toujours d'une agitation personnelle, ils vibrent cependant comme de la résonnance de la note sourde du monde. Les oscillations de la grande ville se prolongent jusque dans notre sommeil. Le rythme nouveau, celui de notre vie, n'est qu'une perpétuelle agitation..."

Stefan Zweig (1881-1942)
Ecrivain autrichien, Stefan Zweig est l'un des plus traduits des écrivains de langue allemande. Pourtant, il n'accordait à l'écriture que peu d'importance, un simple moyen pour saisir le drame de l'existence de façon plus claire et plus intelligible.
Il vouait en fait son existence à "vivre" la culture de son temps, à réunir autour de lui tant les écrivains que les compositeurs, à parcourir un monde
littéraire apaisé et profondément humaniste. Les deux guerres mondiales successives auxquelles il fut confronté, ébranlèrent totalement cet idéal de stabilité et d'enracinement dans l'Europe des
hommes de culture. Fortement ébranlé par ces déferlements de violences, emporté par la certitude de leur inéluctabilité, son suicide mit un terme à ce sentiment désespéré et sans appel
d'être désormais exilé de ce monde.

Stefan Zweig est né le 28 novembre 1881 à Vienne, en Autriche. Fils d'un riche industriel israélite, il put mener ses études en toute liberté, goûtant la
littérature, la philosophie et l'histoire. L'atmosphère cosmopolite de la Vienne impériale favorisa chez le jeune Zweig la curiosité du vaste monde, curiosité qui le poussant vers toutes les
premières théâtrales, toutes les nouvelles parutions non encore saluées par la critique, toutes les nouvelles formes de culture. Il y fit ses études, et, à 23 ans, fut reçu docteur en
philosophie. Il obtint le prix de poésie Bauernfeld, une des plus hautes distinctions littéraires de son pays. Zweig publiait alors une plaquette de vers, une traduction des meilleures
poésies de Verlaine, et écrivait des nouvelles. Passionné de théâtre, il se mit bientôt à écrire des drames : "Thersite"(1907), "La Maison au bord de la mer"(1911). A partir de 1904, il séjourna
à Paris à plusieurs reprises et se lia d'amitié avec Jules Romains. Lorsque éclata la 1ère Guerre Mondiale, Zweig, comme son ami Romain Rolland en France, ne put se résigner à sacrifier la
culture aux nationalismes déchaînés. Infatigable voyageur, toujours en quête de nouvelles cultures, il se rend en Belgique, y rencontre Emile Verhaeren, à Rome, à Florence, en Angleterre,
parcourt les Etats-Unis, le Canada, Cuba, le Mexique. Vers 1915, il épouse Friederike von Winternitz. Il quitte Vienne en 1919 et vient s'installer à Salzbourg, d'où il écrit en moins de dix ans
plus d'une dizaine de nouvelles ("Vingt-quatre heures de la vie d'une femme", "Amok", "La Confusion des Sentiments"... ), autant d'essais (sur Dostoïevski, Tolstoï, Nietzsche, Freud) et d'écrits
biographiques (Fouché, Marie Stuart, Erasme). Mais en 1933, Hitler proclame l’avènement du Troisième Reich et débute sa sanglante répression. Zweig voit avec désespoir revenir les mêmes forces
brutales et destructrices que lors de la 1ère Guerre Mondiale, sous la forme, pire encore, du nazisme.

En 1934, il fuit en Angleterre, à Bath. Il rencontre Lotte Altmann, originaire de Silésie, qui devient sa secrétaire et qu'il épousera en 1938 : 27 ans les séparent, elle devait lui redonner la joie de vivre. Tourmenté par la montée des périls; il gagne les Etats-Unis lorsque la guerre éclate. Le 15 août 1941, il s'embarque pour le Brésil et s'établit à Pétropolis où il espère encore trouver la paix de l'esprit. En vain. Le 22 février 1942, Stefan Zweig rédige la lettre d'adieu suivante : "Avant de quitter la vie de ma propre volonté et avec ma lucidité, j'éprouve le besoin de remplir un dernier devoir : adresser de profonds remerciements au Brésil, ce merveilleux pays qui m'a procuré, ainsi qu'à mon travail, un repos si amical et si hospitalier. De jour en jour, j'ai appris à l'aimer davantage et nulle part ailleurs je n'aurais préféré édifier une nouvelle existence, maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même. Mais à soixante ans passés il faudrait avoir des forces particulières pour recommencer sa vie de fond en comble. Et les miennes sont épuisées par les longues années d'errance. Aussi, je pense qu'il vaut mieux mettre fin à temps, et la tête haute, à une existence où le travail intellectuel a toujours été la joie la plus pure et la liberté individuelle le bien suprême de ce monde. Je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit ! Moi je suis trop impatient, je pars avant eux." Le lendemain, Stefan Zweig n'était plus. Sa seconde épouse, Lotte Altmann, l'avait suivi dans la mort....
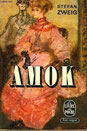
Amok ou Le Fou de Malaisie (Der Amokläufer), 1922
"Avec les trois longues nouvelles qui composent ce recueil (Amok, Lettre d’une inconnue, La Ruelle au clair de lune), Stefan Zweig nous plonge dans l'enfer
de la passion, "l'enfer au fond duquel se tord, brûlé, mais éclairé par les flammes de l'abîme, l'être essentiel, la vie cachée", écrivait Romain Rolland dans sa préface enthousiaste à la
première édition française". (Livre de poche)
Dans « Amok », un jeune médecin raconte comment, dans la jungle malaise, sa vie a basculé en quelques instants, comment une jeune femme jusque-là inconnue a déchaîné en lui l'amour et la
folie. « Lettre d'une inconnue », un des textes les plus déchirants qui soient, souvent adapté au théâtre, est la confession, à la veille de sa mort, d'une femme à un homme qu'elle a
aimé toute sa vie et qui ne l'a jamais vraiment "vue", jamais vraiment regardée. « La ruelle au clair de lune » nous entraîne jusqu'au plus profond de l'humiliation où la passion -
toujours elle - peut parfois faire tomber l'être humain.
"Au mois de mars 1912, il se produisit dans le port de Naples, lors du déchargement d’un grand transatlantique, un étrange accident sur lequel les journaux donnèrent des informations abondantes, mais parées de beaucoup de fantaisie. Bien que passager de l’Océania, il ne me fut pas plus possible qu’aux autres d’être témoin de ce singulier événement, parce qu’il eut lieu la nuit, pendant qu’on faisait du charbon et qu’on débarquait la cargaison et que, pour échapper au bruit, nous étions tous allés à terre passer le temps dans les cafés ou les théâtres. Cependant, à mon avis, certaines hypothèses qu’en ce temps-là je ne livrai pas à la publicité contiennent l’explication vraie de cette scène émouvante ; et maintenant l’éloignement des années m’autorise sans doute à tirer parti d’un entretien confidentiel qui précéda immédiatement ce curieux épisode...."

"La Confusion des sentiments", 1926 (Verwirrung der Gefühle)
Recueil de trois nouvelles comprenant "La Confusion des sentiments" (Verwirrung der Gefühle), "Vingt-quatre heures de la vie d'une femme" (Vierundzwanzig
Stunden aus dem Leben einer Frau) et "Destruction d’un cœur" (Untergang eines Herzens).
Dans "La Confusion des sentiments", ou "Notes intimes du professeur R de D", l'une des plus célèbres de ses nouvelles, un homme se penche sur son passé : il revoit le moment précis de son
existence où, renonçant à sa vie de libertin, il plonge éperdument dans le monde du savoir. Un vieux professeur et sa femme assistent, complices, à la naissance de cette "ardente curiosité" qui a
tous les caractères de la passion charnelle : ils la partageront avec lui jusqu'à brûler eux-mêmes dans l'enfer de la passion...
"Fils de proviseur, je haïssais depuis l'enfance la philologie. Entouré de livres de tous côtés, je méprisais les livres ; toujours poussé par mon père
vers les choses de l'esprit, je me révoltais contre toute forme de culture transmise par l'écriture.
A Berlin où l'on m'avait envoyé faire des études, j'appris avec une rapidité étonnante, la vanité et la fainéantise des piliers de café. Les conquêtes
féminines m'intéressaient plus que tout. Jamais jeune homme ne gaspilla son temps plus sottement que je ne le fis ces mois-là. Il est fort probable que je serais tombé complètement dans la
fainéantise noire ou dans l'abêtissement si un hasard ne m'avait pas retenu sur la pente de la chute intérieure. Mon père ayant compris que je perdais mon temps à Berlin m'envoya dans une petite
ville de province, située dans l'Allemagne centrale. Comparée à Berlin, cette ville semblait plongée dans l'engourdissement.
Le premier jour je visitai les lieux lorsque je poussai par hasard la porte d'une salle de cours. Un groupe de jeunes gens passionnément attentifs se
serraient autour d'un homme qui leur parlait, assis de biais sur une table. Et il ne me fallut que peu de minutes pour que moi-même je sentisse la force fascinante de son discours agir
magnétiquement. Jamais encore je n'avais entendu un être humain parler avec tant d'enthousiasme et d'une façon si véritablement captivante ; pour la première fois j'assistais à ce que les Romains
appelaient raptus, c'est à dire à l'envol d'un esprit au-dessus de lui-même.
Passionné comme je l'étais, et capable seulement de saisir les choses d'une manière passionnée, dans l'élan fougueux de tous mes sens, je venais pour la
première fois de me sentir conquis par un maître, par un homme ; je venais de subir l'ascendant d'une puissance devant laquelle c'était un devoir et une volupté de
s'incliner.
C'est à cette époque que je me vouai tout entier à l'étude, comme par une sorte de vœu monastique, ignorant en vérité la haute ivresse que la science me
réservait et ne me doutais pas que, dans ce monde supérieur de l'esprit aussi, l'aventure et le risque sont toujours à la portée d'un être impétueux. Dans la maison du professeur, une vieille
petite femme, s'occupait avec les soins touchants d'une mère des étudiants de passage, je lui louai une gentille petite chambrette. Aussitôt installé, je tirai de ma malle le Shakespeare que par
hasard j'avais apporté. Ma curiosité avait été enflammée jusqu'à la passion par le discours du professeur et je lus l'œuvre du poète anglais comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Tout à
coup, je découvrais dans ce texte un univers ; les mots se précipitaient sur moi, comme s'ils me cherchaient depuis des siècles ; le vers courait, en m'entraînant, comme une vague de feu,
jusqu'au plus profond de mes veines, de sorte que je sentais à la tempe cette étrange sorte de vertige éprouvé en rêvant qu'on vole au-dessus de la terre. Je passai les deux semaines qui
suivirent dans une fureur passionnée de lire et d'apprendre. Ce qui enflammait de telle sorte mon zèle, c'était surtout la vanité de produire sur mon maître une impression avantageuse, de ne pas
décevoir sa confiance, d'obtenir de lui un sourire d'approbation et de l'attacher à moi, comme j'étais attaché à lui. Sentait-il lui-même ce qu'il était pour moi, ou bien s'était-il mis à aimer
cette fougue de mon être ? Toujours est-il que mon maître me distingua bientôt d'une manière particulière, en me manifestant un intérêt visible. La première fois que je fus invité à sa table et
que je le vis avec sa femme, j'eus le singulier soupçon que la communauté de vie qu'il y avait entre eux était tout à fait bizarre ; et plus je pénétrai dans le cercle intime de cette maison,
plus ce sentiment devint troublant pour moi. Une absence complète de tout sentiment d'affection ou de désaffection les enveloppait et les rendait impénétrables d'une manière si étrange. Je voyais
qu'elle était entièrement exclue du monde intellectuel du professeur. Pour la première fois je pressentis combien de choses secrètes cache la façade d'un mariage. J'observais sa femme et, cette
nature faite d'agilité et de brillante sensualité qu'était la sienne formait une opposition si troublante avec la forme de vie de mon maître que je me demandais avec étonnement ce qui avait bien
pu unir ces deux êtres essentiellement dissemblables. Combien j'ai souffert à cause de cet homme aussi changeant que la température, passant brusquement du chaud au froid, qui inconsciemment
m'enflammait pour me glacer aussitôt, et qui par sa fougue exaltait tout mon être, pour me fouetter ensuite soudain d'une remarque ironique ! Oui, j'avais le sentiment cruel que plus je
m'approchais de lui, plus il me repoussait avec dureté et même avec inquiétude. Rien ne devait, rien ne pouvait le pénétrer, pénétrer son secret. Car (j'en avais de plus en plus vivement
conscience) un secret, un étrange et redoutable secret se dissimulait au cœur enfoui de sa magique attraction.
J'appris par mes camarades qu'assez fréquemment pendant la nuit il disparaissait : un étudiant l'avait rencontré à quatre heures du matin dans une rue
de Berlin, un autre dans un cabaret d'une ville étrangère. Il partait soudain, et revenait ensuite sans que personne sût où il était allé. Je me consumais en hypothèses confuses, qui n'étaient
pas dépourvues de jalousie ; et même un peu de haine et de colère surgit en moi à l'égard de sa taciturnité, qui me laissait en dehors de sa véritable vie, comme un mendiant sous le froid
glacial, moi qui brûlais d'y participer. Ensemble nous avions entrepris d'écrire son livre. Le professeur dictait, j'écrivais. Tout entier voué à cette tâche qui me dérobait peu à peu toute la
vue du monde extérieur, je ne vivais qu'intérieurement, dans l'obscurité de la maison, dans la présence enveloppante et enfiévrée de cet homme. Chaque fois que je me sentais blessé par lui, je me
réfugiais auprès de sa femme. Elle me disait " Vous êtes véritablement un enfant, un nigaud d'enfant qui ne remarque rien, ne voit rien et ne sait rien. Mais il vaut mieux qu'il en soit ainsi,
sinon vous seriez encore plus troublé. A l'intérieur d'un cauchemar sans issue, je luttais de toutes mes forces pour trouver une explication et pour sortir de la confusion mystérieuse de ces
sentiments contradictoires.

"Quatre mois s'étaient passés de la sorte. Le semestre courait vers sa fin. Ce soir-là
la première partie de son ouvrage fut terminée. Les pupilles de mon maître qui d'habitude n'avaient de couleur que par intermittence, se remplirent de ce bleu clair et plein d'âme que seules,
entre tous les éléments, peuvent former la profondeur de l'eau et la profondeur du sentiment humain.
" Je sais, fit alors sa voix, que sans vous je n'aurais point commencé ce travail : jamais je ne l'oublierai. Vous avez donné à ma lassitude l'élan
sauveur, vous avez sauvé ce qui reste encore de ma vie perdue et dispersée, vous, vous seul ! Personne n'a pour moi fait davantage, personne ne m'a aidé si fidèlement. Il m'attira doucement vers
la table et prit la bouteille préparée. Il y avait deux verres. Mais la bouteille était bouchée et nous n'avions pas de tire-bouchon. Je sortis pour aller à la cuisine en chercher un. Lorsque je
fus dans le couloir qui n'était pas éclairé, je heurtais dans l'obscurité quelque chose de doux, qui céda aussitôt : c'était la femme de mon maître, qui, manifestement, avait écouté à la porte.
Tous deux nous étions muets, honteux l'un devant l'autre, elle surprise en flagrant délit d'espionnage, moi figé par la surprise de cette rencontre. Il y avait dans son attitude immobile quelque
chose de sombre, qui ressemblait à un avertissement et à une menace. Mais elle ne prononça pas une parole. La joie immense que j'éprouvais un instant plus tôt avait fait place à une anxiété
étrange et glaciale.
Mais lui, avec quelle insouciance il m'attendait ! Mais maintenant que pour la première fois la paix brillait sur ce front cordialement tourné vers moi,
la parole me manquait ; toute ma joie secrète s'en allait par des pores secrets. Confus, même honteux, je l'écoutais me remercier encore et je ne pensais qu'à cette curiosité ennemie et jalouse
que je supposais aux aguets. Plein d'une crainte inexplicable je me retirai d'un pas mal assuré. En tâtonnant je parvins dans ma chambre et je me jetai sur le lit ; mais je ne pus dormir. Il
était déjà tard lorsque je crus d'entendre un pas dans l'escalier. Il y avait là quelqu'un qui montait en tâtonnant, comme un aveugle, les degrés de l'escalier, d'un pas prudent, hésitant et mal
assuré : seul un intrus, un criminel pouvait s'approcher ainsi de la porte, mais non pas un ami. J'étais figé d'horreur. Soudain j'ouvris la porte. Et, mon maître était là, la bougie à la main.
Il me regarda sans parler ; quelque chose, à lui aussi, lui ôtait la parole. Il était là, debout, les yeux baissés, comme un voleur pris sur le fait. Et cette angoisse, cette attitude, étaient
quelque chose d'insupportable. Soudain la faible silhouette se secoua. Elle s'approcha de moi : un sourire, méchant et faunesque, puis une voix, pointue comme la langue bifide d'un serpent, fit
entendre ces paroles sifflantes :
- Je voulais seulement vous dire…qu'il vaut mieux que nous ne nous tutoyions pas, ..ce…ce…ce serait incorrect entre un élève et son maître…comprenez
vous…il faut garder les distances…les distances…les distances…
Et, en même temps, il me regardait, avec une telle haine, avec une méchanceté si offensante, que ses mains se crispaient malgré lui, comme des griffes.
Etait-il devenu fou ? Etait-il ivre ? Mais cette chose horrible ne dura qu'une seconde ; ce regard agressif rentra précipitamment sous ses paupières. Le professeur se retourna, murmura quelque
chose qui ressemblait à une excuse et saisit la bougie. Comme un diable noir et empressé il s'en alla avant que j'eusse eu la force de trouver un seul mot. Le lendemain il n'était plus à la
maison.
Pourquoi avait-il fui, pourquoi me laissait-il seul ? Toujours plus violente la colère jalouse me montait à la gorge ; de nouveau montait en moi le
désir trouble et insensé de faire contre lui quelque chose de méchant et de haineux.
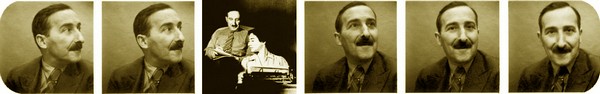
J'ai de tout temps exécré l'adultère, parce que presque toute femme, dans ces moments-là trahit ce qu'il y a de plus secret chez son mari. Chacune est
une Dalila qui dérobe à celui qu'elle trompe son intimité la plus humaine, pour la jeter en pâture à un étranger… Ce n'est pas le fait d'avoir trouvé un refuge, moi qui étais égaré par un
désespoir aveugle et furieux, dans les embrassements de sa femme, d'abords faits uniquement de compassion et ensuite seulement devenus pleins de tendresse ; ce n'est pas cela que je juge encore
aujourd'hui comme la bassesse la plus misérable de ma vie, mais c'est de m'être laissé raconter, sur le moite oreiller, des confidences sur le compte de mon maître, c'est d'avoir permis à cette
femme irritée de trahir l'intimité de son mariage. Pourquoi tolérai-je, sans la repousser, qu'elle me confiât que depuis des années il n'avait pas de commerce charnel avec elle, et qu'elle se
répandît en allusions obscures ? Et tandis que nos corps se cherchaient, nous ne pensions tous les deux qu'à lui et nous ne parlions tous les deux que de lui, toujours et sans cesse. Et en
frissonnant je baisai la lèvre qui trahissait l'homme qui m'était le plus cher au monde.
Le lendemain je réalisai qu'il n'y avait plus qu'une ressource : la fuite. Alors que j'emballais mes affaires mon maître fut là. Etonné, bouleversé
devant mes préparatifs de voyage il me posait des questions :
- Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose de moi ? Où bien est-ce à cause d'une femme ? Ma femme ?… -
Je continuai de me taire et il comprit.
- A vrai dire j'aurai dû y penser ! Tu es jeune, tu es limpide et beau…tu étais près de nous, ..comment ne t'aurait-elle pas aimé
?-
Soudain sa voix se mit à trembler et il se pencha près de moi, si près que son souffle glissa sur mon visage et murmura tout bas " Je…, je…t'aime, moi
aussi ". Lorsque le mot " amour " fut prononcé par cette bouche barbue, avec un accent de tendresse sensuelle, un frissonnement à la fois doux et effrayant passa bruyamment dans mes
tempes.
- En guise d'adieu, me dit-il encore je te raconterai toute ma vie -
Morceau par morceau cet homme arrachait maintenant son existence de sa poitrine, et, en cette heure là, moi, qui étais encore presque un enfant,
j'aperçus pour la première fois, d'un œil hagard, les profondeurs inconcevables du sentiment humain. Cet homme à la haute intellectualité, qui dans son esprit ne connaissait que la pureté, avait
éprouvé sur des chemins glissants, toutes les humiliations, toutes les hontes et toutes les violences que ses sens allaient rechercher. Avec étonnement je voyais maintenant ce que j'avais été
pour lui, moi, le garçon timide, dont il aimait l'enthousiasme pressant, comme la plus sainte surprise de son âge. Et, en frissonnant, je me rendais compte aussi des luttes que sa volonté avait
dû soutenir à cause de moi, car précisément il ne voulait recevoir de moi, qu'il aimait d'un amour pur, ni raillerie, ni brutale rebuffade. Il ne voulait pas livrer à ses sens, pour un jeu
lascif, cette dernière faveur d'un destin ennemi. Je compris combien il avait souffert à cause de moi et quel héroïsme il avait déployé pour se dompter. Cette voix dans l'obscurité, cette voix
dans les ténèbres qui avaient envahi le bureau, je la sentais pénétrer jusque dans la structure la plus intime de la poitrine ! Puis la voix se tut et il n'y eut plus entre nous que l'obscurité.
Enfin il se leva, il m'attira à lui, ses lèvres pressèrent avidement les miennes, en un geste nerveux, et dans une sorte de convulsion frémissante il me tint serré contre son corps. Ce fut un
baiser comme je n'en ai jamais reçu d'une femme, un baiser sauvage et désespéré comme un cri mortel. Je frémis, en proie à une double sensation, à la fois étrange et terrible : mon âme
s'abandonnait à lui, et pourtant j'étais épouvanté jusqu'au tréfonds de moi-même par la répulsion qu'avait mon corps à se trouver ainsi au contact d'un homme - affreuse confusion de sentiments
qui faisait durer cette seconde, pendant laquelle je ne m'appartenais plus, à tel point que j'en avais perdu la notion du temps.
Jamais je ne l'ai revu. Jamais je n'ai reçu de lui ni lettre ni nouvelle. Nul ne se souvient de lui en dehors de moi. Mais encore aujourd'hui, comme
autrefois le garçon ignorant que j'étais, je sens que je ne dois davantage à personne qu'à cet homme, ni à mon père ni à ma mère, avant lui, ni à ma femme et à mes enfants, après lui, et que je
n'ai aimé personne plus que lui. "

"Lettre d'une inconnue", 1927 (Brief einer Unbekannten)
Un écrivain viennois, reçoit un jour, une lettre bouleversante d’une femme qui l’a bien connu. Amnésie ou omission, notre écrivain n’a aucun souvenir de cette jeune femme... Comment vivra t’il ce qu’il apprendra dans ce courrier? Cette femme dont on ne connaîtra pas le nom est tombée amoureuse à l’âge de 13 ans de son voisin. Pendant des années, elle a guetté ses faits et gestes, grappillé des miettes d’attention. Puis elle a perdu son honneur avec cet homme, trouvant le bonheur dans les quelques nuits offertes, alors même qu’il ne la reconnaissait pas. Trouvant son bonheur dans l’enfant conçu au cours d’une de ces nuits... La finesse de l’analyse des sentiments humains est la marque d’écriture de Zweig. Le drame de cette femme, c’est la passion face à l'indifférence.
"R…, le romancier à la mode, rentrait à Vienne de bon matin après une excursion de trois jours dans la montagne. Il acheta un journal à la gare ;
ses yeux tombèrent sur la date, et il se rappela aussitôt que c’était celle de son anniversaire. « Quarante et un ans », songea-t-il, et cela ne lui fit ni plaisir ni peine. Il
feuilleta sans s’arrêter les pages crissantes du journal, puis il prit un taxi et rentra chez lui. Son domestique, après lui avoir appris que pendant son absence il y avait eu deux visites et
quelques appels téléphoniques, lui apporta son courrier sur un plateau. Le romancier regarda les lettres avec indolence et déchira quelques enveloppes dont les expéditeurs l’intéressaient. Tout
d’abord, il mit de côté une lettre dont l’écriture lui était inconnue et qui lui semblait trop volumineuse. Le thé était servi ; il s’accouda commodément dans son fauteuil, parcourut encore
une fois le journal et quelques imprimés ; enfin il alluma un cigare et prit la lettre qu’il avait mise de côté.
C’étaient environ deux douzaines de pages rédigées à la hâte, d’une écriture agitée de femme, un manuscrit plutôt qu’une lettre. Involontairement, il
tâta encore une fois l’enveloppe pour voir s’il n’y avait pas laissé quelque lettre d’accompagnement. Mais l’enveloppe était vide et, comme les feuilles elles-mêmes, elle ne portait ni adresse
d’expéditeur, ni signature. « C’est étrange », pensa-t-il, et il reprit les feuilles. Comme épigraphe ou comme titre, le haut de la première page portait ces mots : À toi qui ne
m’as jamais connue. Il s’arrêta étonné. S’agissait-il de lui ? S’agissait-il d’un être imaginaire ? Sa curiosité s’éveilla. Et il se mit à lire.
Mon enfant est mort hier – trois jours et trois nuits, j’ai lutté avec la mort pour sauver cette petite et tendre existence ; pendant quarante
heures je suis restée assise à son chevet, tandis que la grippe secouait son pauvre corps brûlant de fièvre. J’ai rafraîchi son front en feu ; j’ai tenu nuit et jour ses petites mains
fébriles. Le troisième soir, j’étais à bout de forces. Mes yeux n’en pouvaient plus ; ils se fermaient d’eux-mêmes à mon insu. C’est ainsi que je suis restée trois ou quatre heures endormie
sur ma pauvre chaise, et pendant ce temps, la mort a pris mon enfant. Maintenant il est là, le pauvre et cher petit, dans son lit étroit d’enfant, tout comme au moment de sa mort ;
seulement, on lui a fermé les yeux, ses yeux sombres et intelligents ; on lui a joint les mains sur sa chemise blanche, et quatre cierges brûlent haut, aux quatre coins du lit. Je n’ose pas
regarder ; je n’ose pas bouger, car, lorsque les flammes vacillent, des ombres glissent sur le visage et sur la bouche close, et il me semble que ses traits s’animent et je pourrais croire
qu’il n’est pas mort, qu’il va se réveiller et, de sa voix claire, me dire quelques mots de tendresse enfantine. Mais je le sais, il est mort, et je ne veux plus regarder, pour n’avoir plus
encore à espérer et pour n’être plus encore une fois déçue. Je le sais, je le sais, mon enfant est mort hier – maintenant, je n’ai plus que toi au monde, que toi qui ne sais rien de moi et qui, à
cette heure, joues peut-être, sans te douter de rien, ou qui t’amuses avec les hommes et les choses. Je n’ai que toi, toi qui ne m’as jamais connue et que j’ai toujours
aimé.
J’ai pris le cinquième cierge et je l’ai posé ici sur la table, sur laquelle je t’écris. Car je ne peux pas rester seule avec mon enfant mort, sans
crier de toute mon âme. Et à qui pourrais-je m’adresser, à cette heure effroyable, sinon à toi, toi qui as été tout pour moi et qui l’es encore ? Je ne sais si je m’exprime assez clairement,
peut-être ne me comprends-tu pas ? – ma tête est si lourde ; mes tempes battent et bourdonnent ; mes membres me font si mal. Je crois que j’ai la fièvre ; et peut-être aussi
la grippe, qui maintenant rôde de porte en porte, et cela vaudrait mieux, car ainsi je partirais avec mon enfant, et je ne serais pas obligée de me faire violence. Parfois un voile sombre passe
devant mes yeux ; peut-être ne serai-je même pas capable d’achever cette lettre ; mais je veux recueillir toutes mes forces pour te parler une fois, rien que cette seule fois, ô mon
bien-aimé, toi qui ne m’as jamais connue.
C’est à toi seul que je veux m’adresser ; c’est à toi que, pour la première fois, je dirai tout ; tu connaîtras toute ma vie, qui a toujours
été à toi et dont tu n’as jamais rien su. Mais tu ne connaîtras mon secret que lorsque je serai morte, quand tu n’auras plus à me répondre, quand ce qui maintenant fait passer dans mes membres à
la fois tant de glace et tant de feu m’aura définitivement emportée. Si je dois survivre, je déchirerai cette lettre, et je continuerai à me taire, comme je me suis toujours tue. Mais si elle
arrive entre tes mains, tu sauras que c’est une morte qui te raconte sa vie, sa vie qui a été à toi, de sa première à sa dernière heure de conscience. N’aie pas peur de mes paroles : une
morte ne réclame plus rien ; elle ne réclame ni amour, ni compassion, ni consolation. La seule chose que je te demande, c’est que tu croies tout ce que va te révéler ma douleur qui se
réfugie vers toi. Crois tout ce que je te dis, c’est la seule prière que je t’adresse ; on ne ment pas à l’heure de la mort de son unique enfant."

"Je veux te révéler toute ma vie, cette vie qui véritablement n’a commencé que du jour où je t’ai connu. Auparavant, ce n’était qu’une chose trouble et confuse, dans laquelle mon souvenir ne se replongeait jamais ; c’était comme une cave où la poussière et les toiles d’araignée recouvraient des objets et des êtres aux vagues contours, et dont mon cœur ne sait plus rien. Lorsque tu arrivas, j’avais treize ans, et j’habitais dans la maison que tu habites encore, dans cette maison où tu tiens maintenant entre tes mains cette lettre, mon dernier souffle de vie ; j’habitais sur le même palier, précisément en face de la porte de ton appartement. Tu ne te souviens certainement plus de nous, de la pauvre veuve d’un fonctionnaire des finances (elle était toujours en deuil) et de sa maigre adolescente ; nous vivions tout à fait retirées et comme perdues dans notre médiocrité de petits-bourgeois. Tu n’as peut-être jamais connu notre nom, car nous n’avions pas de plaque sur notre porte, et personne ne venait nous voir, personne ne venait nous demander. C’est qu’il y a si longtemps déjà, quinze à seize ans ! Certainement tu ne te le rappelles plus, mon bien-aimé ; mais moi, oh ! je me souviens passionnément du moindre détail ; je sais encore, comme si c’était hier, le jour et même l’heure où j’entendis parler de toi pour la première fois, où pour la première fois je te vis, et comment en serait-il autrement puisque c’est alors que l’univers s’est ouvert pour moi ? Permets, mon bien-aimé, que je te raconte tout, tout depuis le commencement ; daigne, je t’en supplie, ne pas te fatiguer d’entendre parler de moi pendant un quart d’heure, moi qui, toute une vie, ne me suis pas fatiguée de t’aimer...."

"Vingt-Quatre Heures de la vie d'une femme", 1929
(Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau)
Au début du siècle, une petite pension sur la Côte d'Azur, ou plutôt sur la Riviera, comme on disait alors. Grand émoi chez les clients de l'établissement :
la femme d'un des pensionnaires, Mme Henriette, est partie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature sans moralité. Et
il ne trouvera comme alliée qu'une vieille dame anglaise, sèche et distinguée. C'est elle qui, au cours d'une longue conversation, lui expliquera quels feux mal éteints cette aventure a ranimés
chez elle. Stefan Zweig est né à Vienne en 1881. Il s'est essayé aux genres littéraires les plus divers : poésie, théâtre, traductions, biographies romancées et critiques littéraires. Mais ce
sont ses nouvelles qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier.
"Dans la petite pension de la Riviera où je me trouvais alors (dix ans avant la guerre), avait éclaté à notre table une violente discussion qui
brusquement menaça de tourner en altercation furieuse et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n’ont qu’une imagination émoussée. Ce qui ne les touche pas
directement, en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau, n’arrive guère à les émouvoir ; mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit quelque
chose, même de peu d’importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors ils compensent, dans une certaine mesure, leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et
exagérée.
Ainsi en fut-il cette fois-là dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois, qui d’habitude se livraient paisiblement à de small talks et à de
petites plaisanteries sans profondeur, et qui le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersaient : le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo, le Danois
rondelet pour pratiquer l’art monotone de la pêche, la dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres, les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo, et moi pour paresser sur
une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée ; et si l’un de nous se levait brusquement, ce
n’était pas comme d’habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l’ai déjà indiqué, revêtait des formes presque
furieuses.
Il est vrai que l’événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La pension dans laquelle nous habitions tous les
sept, se présentait bien de l’extérieur sous l’aspect d’une villa séparée (ah ! comme était merveilleuse la vue qu’on avait des fenêtres sur le littoral festonné de rochers), mais en
réalité, ce n’était qu’une dépendance, moins chère, du grand Palace Hôtel et directement reliée avec lui par le jardin, de sorte que nous, les pensionnaires d’à côté, nous vivions malgré tout en
relations continuelles avec les clients du Palace. Or, la veille, cet hôtel avait eu à enregistrer un parfait scandale.
En effet, au train de midi, exactement de midi vingt (je dois indiquer l’heure avec précision parce que c’est important, aussi bien pour cet épisode que
pour le sujet de notre conversation si animée), un jeune Français était arrivé et avait loué une chambre donnant sur la mer : cela seul annonçait déjà une certaine aisance pécuniaire. Il se
faisait agréablement remarquer, non seulement par son élégance discrète, mais surtout par sa beauté très grande et tout à fait sympathique : au milieu d’un visage étroit de jeune fille, une
moustache blonde et soyeuse caressait ses lèvres, d’une chaude sensualité ; au-dessus de son front très blanc bouclaient des cheveux bruns et ondulés ; chaque regard de ses yeux doux
était une caresse ; tout dans sa personne était tendre, flatteur, aimable, sans cependant rien d’artificiel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il rappelait d’abord un peu ces figures de
cire de couleur rose et à la pose recherchée qui, une élégante canne à la main, dans les vitrines des grands magasins de mode, incarnent l’idéal de la beauté masculine. Mais dès qu’on le
regardait de plus près, toute impression de fatuité disparaissait, car ici (fait si rare !) l’amabilité était chose naturelle et faisait corps avec l’individu. Quand il passait, il saluait
tout le monde d’une façon à la fois modeste et cordiale, et c’était un vrai plaisir de voir comment à chaque occasion sa grâce toujours prête se manifestait en toute
liberté.
Si une dame se rendait au vestiaire, il s’empressait d’aller lui chercher son manteau ; il avait pour chaque enfant un regard amical ou un mot de
plaisanterie ; il était à la fois sociable et discret ; bref, il paraissait un de ces êtres privilégiés, à qui le sentiment d’être agréable aux autres par un visage souriant et un
charme juvénile donne une grâce nouvelle. Sa présence était comme un bienfait pour les hôtes du Palace, la plupart âgés et de santé précaire ; et grâce à une démarche triomphante de
jeunesse, à une allure vive et alerte, à cette fraîcheur qu’un naturel charmant donne si superbement à certains hommes, il avait conquis sans résistance la sympathie de tous. Deux heures après
son arrivée, il jouait déjà au tennis avec les deux filles du gros et cossu industriel lyonnais, Annette, âgée de douze ans, et Blanche qui en avait treize ; et leur mère, la fine, délicate
et très réservée Mme Henriette, regardait en souriant doucement, avec quelle coquetterie inconsciente les deux fillettes toutes novices flirtaient avec le jeune étranger. Le soir, il nous
regarda pendant une heure jouer aux échecs, en nous racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger du tout ; il se promena à plusieurs reprises, assez longtemps, sur
la terrasse avec Mme Henriette, dont le mari comme toujours jouait aux dominos avec un ami d’affaires ; très tard encore, je le trouvai en conversation suspecte d’intimité avec la
secrétaire de l’hôtel, dans l’ombre du bureau...."
Publié en 1929, à la veille de grandes crises (krach boursier, montée des totalitarismes), "Vingt-Quatre Heures de la vie d'une femme" nous offre une réflexion sur l'individu face aux forces qui le dépassent, qu'elles soient intérieures (la passion) ou extérieures (la société). Il est rapidement devenu un immense succès international, consolidant la réputation de Zweig comme l'un des plus grands écrivains de son temps.
Au cœur du récit, une passion amoureuse irraisonnée et obsessive, en particulier celle d'une femme "respectable" pour un joueur pathologique qu'elle vient de rencontrer. En 1929, décrire avec une telle intensité l'abandon social, moral et physique d'une femme d'un certain âge (veuve d'un homme haut placé) était extrêmement osé. Zweig explore sans jugement les zones d'ombre de l'âme humaine, les pulsions inavouables et la puissance destructrice de l'amour-passion, un thème qui a toujours fasciné mais qui était rarement traité avec une telle franchise.
La nouvelle est un portrait psychologique d'une profondeur remarquable. L'auteur dissèque avec une précision chirurgicale les émotions de son héroïne, Mme Henriette, sa fascination initiale pour l'égarement du jeune homme, son désir maternel et salvateur qui se transforme en passion charnelle, l'engrenage de l'obsession où la raison est complètement vaincue par les sens, la honte et le silence qui suivent l'épisode.
La scène initiale dans une pension de famille où des pensionnaires débattent d'un scandale, celui d'une femme qui a quitté son mari pour suivre un inconnu après seulement 24 heures, un débat moralisateur qui va servir de repoussoir. Une narratrice plus âgée (Mme Henriette) décide alors de raconter sa propre histoire de 24 heures, survenue des années auparavant, pour montrer que la réalité des passions est bien plus complexe que les jugements hâtifs que porte l'assemblée. C'est une confession, le secret de toute une vie, qui nous est ainsi livrée.
Le tour de force narratif : se focaliser sur une très courte période (24 heures), unité de temps mais aussi de lieu (la salle de jeu et une chambre d'hôtel) créant ainsi une tension dramatique extrême. Cette brièveté concentre toute l'énergie du récit sur la métamorphose psychologique du personnage, sans aucune digression ...

La pitié dangereuse" (1939, Ungeduld des Herzens)
"Wer da hat, dem wird gegeben«, dieses Wort aus dem Buche der Weisheit darf jeder Schriftsteller getrost in dem Sinne bekräftigen: »Wer viel erzählt
hat, dem wird erzählt. Nichts Irrtümlicheres als die allzu umgängliche Vorstellung, in dem Dichter arbeite ununterbrochen die Phantasie, er erfinde aus einem unerschöpflichen Vorrat pausenlos
Begebnisse und Geschichten..."
« Celui qui a beaucoup raconté, on lui racontera. » : C'est le cœur de son argument. Zweig suggère que plus un écrivain est à l'écoute des histoires des autres (les récits de vie, les confidences), plus son propre réservoir d'inspiration est riche. La création naît moins d'une imagination purement solitaire que de l'écoute, de l'observation et de l'assimilation des expériences humaines. Il rejette l'image romantique de l'artiste constamment en proie à une frénésie créatrice. Pour lui, les histoires sont souvent le fruit d'un échange avec le monde, et non le produit d'un esprit fermé sur lui-même...
Et c'est ici le seul roman achevé de Zweig. Toute son œuvre narrative est principalement constituée de nouvelles (Amok, La Confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d'une femme) et de novellas. La Pitié dangereuse est une œuvre de grande envergure, avec une intrigue développée, une galerie de personnages plus importante et une construction dramatique en plusieurs actes. C'est l'aboutissement de sa carrière de narrateur, le passage à une forme plus ambitieuse...
Zweig l'a écrit entre 1938 et 1939, alors qu'il était en exil, témoin de l'effondrement de son monde et de la montée de la barbarie nazie. "La Pitié dangereuse" est imprégnée de ce désespoir profond. Le thème de la lâcheté et de l'incapacité à s'engager (la "impatience du cœur" du titre original) peut être lu comme une métaphore de la passivité des démocraties face au nazisme, ou plus généralement de la faillite de l'humanisme face à la brutalité.
C'est une œuvre sur l'échec et la culpabilité sans rédemption. Le ton est bien plus sombre que dans ses autres œuvres, où une forme de beauté ou d'absolu émerge souvent de la passion, même destructrice. Ici, il n'y a que des ruines.
"En 1913, dans une petite ville de garnison autrichienne, Anton Hofmiller, jeune officier de cavalerie, est invité dans le château du riche Kekesfalva. Au cours de la soirée, il invite la fille de son hôte à danser, ignorant qu'elle est paralysée. Désireux de réparer sa maladresse, Anton accumule les faux pas qu'il attribue à ce que Stefan Zweig appelle l'« impatience du cœur ». Les personnages du seul roman que Stefan Zweig ait achevé sont les spectateurs hébétés de leur tragédie, symboles d'une civilisation décadente mais incapable de résister à l'ivresse d'une dernière valse. La prose de Stefan Zweig, brillante et raffinée, est comme le vestige de cette civilisation engloutie par la folie du XXe siècle. Une histoire d'amour déchirante où la fatalité aveugle ceux qu'elle veut perdre ...." (Livre de poche)
"Toute l’affaire commença par une maladresse commise en toute innocence, une « gaffe », comme disent les Français. Puis vint le désir de réparer ma bêtise. Mais quand on veut remettre trop vite en place une roue dans une montre, on finit le plus souvent par en briser tout le mécanisme. Même aujourd’hui, après des années, je n’arrive pas à fixer la limite où a fini ma maladresse et où a commencé ma faute. Il est probable que je ne le saurai jamais.
J’avais à cette époque vingt-cinq ans et j’étais lieutenant d’active au x-ième régiment de uhlans. Que j’aie jamais eu une passion spéciale ou une vocation véritable pour le métier de soldat, c’est ce que je ne saurais prétendre. Mais quand dans la maison d’un fonctionnaire de la vieille Autriche il y a deux petites filles et quatre garçons affamés autour d’une table pauvrement garnie, on n’a pas le loisir d’interroger les enfants sur leurs goûts, on les case au plus vite dans une profession, pour qu’ils ne pèsent pas trop longtemps sur la famille. Mon frère Ulrich, qui déjà à l’école communale s’était abîmé les yeux à force d’étudier, fut envoyé au séminaire ; quant à moi, je dus à ma forte constitution d’être dirigé sur l’école militaire.
De là le fil de la vie se déroule automatiquement, sans qu’on ait à le tirer. L’Etat s’occupe de tout. En quelques années il fait, sans qu’il vous en coûte rien, d’après un modèle fixé à l’avance, d’un pâle adolescent un enseigne à la barbe naissance, qu’il livre, prêt à servir, à l’armée. Un beau jour, qui était l’anniversaire de l’empereur – je n’avais pas encore dix-huit ans – je fus passé en revue et peu de temps après une première étoile apparut à mon col. J’avais franchi la première étape, et désormais tout le cycle de l’avancement pouvait se poursuivre mécaniquement, avec les pauses indispensables, jusqu’à la retraite et la goutte. De même, servir dans la cavalerie, cette arme hélas des plus coûteuses, n’avait jamais été mon désir personnel, mais la marotte de ma tante Daisy, laquelle avait épousé en secondes noces le frère aîné de mon père, au moment où il venait de quitter le ministère des Finances pour le poste plus lucratif de directeur de banque. Riche et snob à la fois, elle ne pouvait accepter qu’un Hofmiller quelconque fît honte à la famille en servant dans l’infanterie. Et comme elle appuyait cette marotte d’un subside de cent couronnes par mois, je devais encore, en toute occasion, lui en manifester de la reconnaissance.
Quant à savoir s’il me plaisait ou non de servir dans la cavalerie ou même de faire une carrière d’officier, cela, personne ne se l’était jamais demandé, moi pas plus que les autres. Du moment que j’étais en selle, je me sentais bien et je ne pensais pas plus loin que l’encolure de mon cheval...."
La rencontre d'Edith von Kekesfalva avec le protagoniste, Antoine Hofmiller, est un moment capital soigneusement construit par Zweig pour installer d'emblée tous les enjeux du récit. C"est cette rencontre qui installe la "pitié dangereuse" ...
La première émotion d'Antoine pour Edith est un mélange écrasant de honte (pour sa gaffe) et de pitié (pour son sort). Cette pitié est le moteur de tout le reste. Elle n'est pas noble ; elle est née d'un sentiment de culpabilité et de gêne. Elle crée un lien de dette et de culpabilité : Antoine se sent redevable. Il doit se racheter. Toute sa relation avec Edith sera bâtie sur ce fondement malsain.
Dès le premier instant, Edith, bien que physiquement faible, prend le pouvoir psychologique. Antoine est dès lors en position de faiblesse, de quémandeur de pardon. Elle, par sa souffrance même, détient une autorité morale qui le domine.
Sans cette maladresse initiale, Antoine ne se serait pas senti obligé de revenir, de consacrer du temps à Edith, d'alimenter malgré lui ses espoirs. Cette rencontre est le grain de sable qui engrange la machine implacable du destin....
Edith est une jeune fille de dix-sept ans, fille du riche M. de Kekesfalva, un homme d'origine modeste qui a acquis une fortune et un titre. Elle est caractérisée par plusieurs dimensions qui la rendent profondément tragique : Edith est paralysée. Confinée dans un fauteuil roulant ou sur une chaise longue, son corps est incapable de suivre les impulsions de son esprit. Cette paralysie est le fait central de son existence et détermine toutes ses interactions. Et c'est un personnage de contrastes violents, directement causés par sa condition. Elle est hypersensible, pleine d'une honte profonde et d'une conscience aiguë de son infirmité qui la rend susceptible, orgueilleuse et facilement blessée, mais posède une volonté de fer et une passion contenue ... Son corps est immobile, mais son âme est d'une "impatience" (comme l'indique le titre original) bouillonnante. Elle est intelligente, pleine de désirs refoulés (danser, vivre une vie normale, aimer) et capable de colères terribles. Cette énergie vitale, n'ayant pas d'autre exutoire, se concentre avec une force terrible sur ceux qui l'approchent, notamment Antoine. Prisonnière de son corps, de sa richesse (qui isole) et de l'amour étouffant de son père, elle est l'âme captive d'un monde doré mais mortifère.
La rencontre entre le jeune lieutenant Antoine Hofmiller et Edith n'est pas anodine ; c'est une scène cruciale, mise en scène avec une grande habileté psychologique par Zweig.
Antoine, officier jeune, naïf et soucieux des convenances, est invité par hasard au château des Kekesfalva. Il ignore tout de la famille et de l'infirmité d'Edith, et le choc connaît plusieurs temps
- La soirée se passe admirablement bien. Antoine est séduit par le luxe, la nourriture, les vins et l'accueil chaleureux de son hôte. Dans un état de légère euphorie et de gratitude, il invite spontanément la jeune fille à danser. C'est un geste de jeunesse, de galanterie automatique, dicté par les codes sociaux de son milieu.
- Sa proposition déclenche un silence de mort dans la pièce. La famille et les domestiques se figent. Antoine comprend immédiatement qu'il a commis une faute immense, impardonnable, sans encore en connaître la nature.
- C'est à ce moment qu'il voit vraiment Edith pour la première fois. Son regard se porte sur elle et il comprend, avec une horreur rétrospective, que la jeune fille est paralysée. La honte l'envahit.
- Le renversement C'est ici que le génie de la scène apparaît. Edith ne fond pas en larmes ou ne se renferme pas. Au contraire. Elle éclate d'un rire strident et forcé. Une réaction de défense ultime. Il est destiné à briser la gêne insupportable et à prendre l'ascendant sur la situation. Ce n'est plus elle la victime de la maladresse, c'est elle qui domine et martyrise le jeune homme par les mots. Cette réaction révèle d'emblée toute la complexité de son caractère : sa fierté meurtrie, son intelligence acérée et sa cruauté potentielle née de la souffrance ....
"Il n’y avait plus moyen de s’échapper. Le plus facile me parut de dire la vérité, mais il me fallait la dire avec prudence, en l’enjolivant. Aussi commençai-je sur un ton d’apparente désinvolture.
« Mais, chère mademoiselle Edith, ne cherchez pas chez moi des motifs mystérieux. Vous me connaissez assez pour savoir que je suis un homme qui ne se pose pas beaucoup de questions sur lui-même. L’idée, je vous le jure, ne m’est pas encore venue de m’examiner et de me demander pourquoi je vais chez un tel ou un tel, pourquoi j’aime celui-ci et pas celui-là. Ma parole, je ne peux vraiment rien vous dire de plus intelligent ni de plus bête que ceci : je viens chez vous parce que… je m’y trouve bien, je m’y sens mille fois mieux que partout ailleurs. Vous vous représentez, je crois, nos officiers de cavalerie un peu trop d’après les opérettes, toujours chics, toujours gais, vivant dans une sorte de fête perpétuelle. Mais vues du dedans, les choses ne sont pas aussi belles ; notre solidarité si réputée, par exemple, n’est parfois qu’un vain mot. Quand dix hommes ont les mêmes visées, ils ne font pas de sentiment, et quand il s’agit de promotion et d’avancement on se marche souvent sur les pieds. Il faut surveiller le moindre mot que l’on prononce, et l’on n’est jamais sûr de ne pas indisposer les gros bonnets, sur quoi on est bon pour un sérieux savon. Faire son “ service ”, c’est presque “ servir ”, et servir… c’est être dépendant. Et puis une caserne et une table d’auberge ne sont pas un vrai foyer. On n’y est attaché à personne, et personne n’est attaché à vous. Certes parfois on a d’excellents camarades, mais il subsiste toujours une certaine réserve, la confiance n’est jamais totale. Lorsque par contre je viens chez vous, je mets de côté toute réserve en même temps que je dépose mon sabre au vestiaire, et quand ensuite je bavarde avec vous si cordialement, alors… j’ai le sentiment…
— Quel sentiment ?… » Dans son impatience, elle ne se retint pas.
« Eh bien… vous allez peut-être trouver inconvenant que je m’exprime si franchement… alors, je m’imagine que vous avez plaisir à me voir chez vous, que je fais partie de la maison, que je suis cent fois plus chez moi ici que nulle part ailleurs. Toujours, quand je vous regarde, j’ai le sentiment… »
Je m’arrêtai involontairement. « Quel sentiment ?… » fit-elle de nouveau avec véhémence.
« … qu’il y a là quelqu’un auprès de qui je ne suis pas aussi terriblement inutile qu’auprès des autres à la caserne… Je le sais, cela ne tient pas beaucoup à ma personne et parfois je m’étonne que je ne vous sois pas devenu ennuyeux à la longue… Souvent… vous ne savez pas combien de fois je me suis demandé si vous n’en aviez pas assez de moi… mais ensuite je pense à votre solitude dans cette grande maison vide, et que vous serez peut-être heureuse que quelqu’un vienne vous voir. Voyez-vous, cela me donne le courage d’oser, à chaque fois… Et quand je vous retrouve sur votre terrasse ou dans votre chambre, je me dis que j’ai bien fait de venir, de ne pas vous laisser là si seule toute la journée. Vous ne pouvez pas comprendre cela ? »
Ce qui se produisit alors m’étonna. Les yeux gris cessèrent de remuer, leur pupille se figea. Par contre, les doigts nerveux se mirent à tâter les bras du fauteuil et à tambouriner, d’abord doucement, puis de plus en plus fort contre le bois. La bouche se tordit et me cria d’un seul coup, méchamment :
« Oui, je comprends. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire… Vous avez… maintenant, je crois, dit la vérité. Vous vous êtes exprimé d’une façon très polie et très habile. Mais je vous ai compris tout de même. Parfaitement bien compris… Vous venez, dites-vous, parce que je suis si “ seule ”, autrement dit, pour parler net : parce que je suis clouée à ce maudit fauteuil. C’est seulement pour cela que vous venez tous les jours, comme un bon Samaritain, pour rendre visite à la pauvre enfant malade… c’est ainsi que vous m’appelez tous quand je ne suis pas là, je le sais. Ce n’est que par pitié que vous venez, oui, je vous crois, allez ! pourquoi le nier ?… par pitié ! Vous êtes, n’est-ce pas, ce qu’on appelle un homme “ bon ” et vous vous laissez volontiers nommer ainsi par mon père. Des hommes “ bons ” comme vous ont pitié de tout chien battu et de tout chat galeux… pourquoi pas aussi d’une infirme ? »
Et soudain un soubresaut agita tout son corps raide, et elle se cabra :
« Mais grand merci ! Je me fiche de cette sorte d’amitié qui ne s’adresse qu’à mon infirmité !… Oui, ne faites pas des yeux si contrits ! Cela vous ennuie bien sûr d’avoir ainsi laissé échapper la vérité, d’avoir avoué que vous ne venez que parce que “ je fais pitié ”, comme disait la servante tchèque – elle, du moins, l’a dit sincèrement, franchement. Tandis que vous vous exprimez comme un homme bon, avec plus de délicatesse, plus de tact. Vous dites, avec des circonlocutions : parce que je suis “ si seule toute la journée ”. Il y a longtemps que je le devinais, c’est par pitié, que vous venez et vous voudriez encore qu’on vous admirât pour votre beau sacrifice, mais je regrette, je ne veux pas de sacrifice ! Je n’en veux de personne, et de vous encore moins… je vous le défends, vous entendez, je vous le défends… Croyez-vous que je sois vraiment réduite à votre compagnie, à vos regards “ compatissants ”, vos regards humides, spongieux, à votre bavardage plein de ménagements… Non, Dieu merci, je n’ai pas besoin de vous tous… Je me débrouillerai bien moi-même, je m’en tirerai bien sans vous. Et quand j’en aurai assez, je sais comment faire… Tenez ! (elle me tendit soudain sa main à l’envers) regardez cette cicatrice ! Une fois déjà j’ai essayé avec des ciseaux, seulement j’ai été maladroite, je n’ai pas réussi à trouver l’artère. Et malheureusement ils sont arrivés à temps et m’ont fait un bandage, sinon j’en aurais fini avec vous tous et votre sale pitié ! Mais la prochaine fois je serai plus adroite, soyez-en sûrs ! Ne croyez pas que je vous sois livrée pieds et poings liés ! Plutôt crever que d’être celle que l’on plaint. Voyez-vous (elle se mit à rire soudain d’un rire violent et déchirant) mon père précautionneux n’a pas songé à tout, lorsqu’il a fait construire cette terrasse. Il s’est dit uniquement que j’aurais une belle vue. Beaucoup de soleil et du bon air, a dit le médecin. Mais personne n’a pensé, ni mon père, ni le médecin, ni l’architecte, que… Regardez donc – elle s’était soudain redressée, et d’une poussée avait jeté son corps oscillant jusqu’à la balustrade qu’elle serrait furieusement de ses deux mains – nous sommes à une hauteur de quatre ou cinq étages et en bas c’est de la pierre bien dure… c’est suffisant… et j’ai, heureusement ! assez de vigueur pour passer par dessus la balustrade, car à force de marcher avec des béquilles certains muscles deviennent vigoureux. Un seul élan et je serai délivrée une fois pour toutes de votre maudite pitié, et vous serez soulagés, mon père, Ilona et vous, vous tous pour qui je suis un cauchemar… Voyez-vous, c’est très facile, il suffit de se pencher ainsi un tout petit peu et puis… »
Très inquiet, j’avais bondi au moment où, les yeux brillants, elle s’était couchée sur la balustrade et je l’avais saisie par le bras. Mais comme si le feu lui eût brûlé la peau, elle sursauta et me cria :
« Laissez-moi !… Vous osez me toucher !… Retirez-vous… J’ai bien le droit de faire ce que je veux !… Lâchez-moi tout de suite !… »
Et comme je n’obéissais pas, comme je m’efforçais au contraire de l’éloigner de la balustrade, elle se tourna soudain vers moi et me donna un coup en pleine poitrine. Alors il arriva une chose terrible ; elle perdit son point d’appui, et l’équilibre en même temps. Ses genoux branlants cédèrent comme si on lui eût fauché les jambes. Elle s’effondra brutalement et, ayant voulu s’accrocher à la table, elle l’entraîna dans sa chute. Soucoupes, tasses, cuillers, vases se renversèrent avec fracas sur elle et sur moi, qui m’étais précipité pour la retenir, cependant que la grande cloche de bronze roulait avec un bruit de tonnerre le long de la terrasse.
Pitoyable et recroquevillée sur elle-même, la jeune fille gisait à terre, impuissante, un paquet frémissant de colère, sanglotant de rage et de honte. J’essayai de la soulever, mais elle se défendit et me hurla au visage :
« Allez-vous-en… allez-vous-en… espèce de brute, sale brute ! »
En même temps elle agitait ses bras autour d’elle, en essayant de se relever sans mon aide. Chaque fois que je m’avançais pour l’assister, elle se recroquevillait avec fureur et me répétait dans sa folle exaspération : « Allez-vous-en… ne me touchez pas !… Partez !… » Jamais je n’avais vu chose si effroyable.
A cet instant, un bourdonnement se fit entendre derrière nous. C’était l’ascenseur qui montait. La cloche en tombant avait sans doute fait assez de bruit pour alerter le domestique, toujours prêt à accourir au premier appel. Il s’approcha vite en baissant aussitôt les yeux, souleva sans me regarder le corps palpitant de la jeune fille (il devait en avoir l’habitude) et la porta dans l’ascenseur, qui redescendit aussitôt. Je demeurai seul à côté de la table renversée, des tasses brisées, des objets éparpillés dans un désordre tel qu’on eût dit que la foudre était soudain tombée, dans un ciel sans nuages.
Je ne sais combien de temps je restai là parmi les assiettes et les tasses en morceaux, tout perplexe, ne m’expliquant pas cette brusque explosion. Qu’avais-je dit de si insensé ? Comment avais-je pu provoquer cette colère ? Derrière moi, le bruit familier de l’ascenseur qui remontait vint m’arracher à mes réflexions. Joseph s’avança, une étrange ombre de tristesse sur son visage rasé. Je pensai qu’il ne venait que pour mettre de l’ordre et me sentis confus de lui être un embarras au milieu de ces débris. Mais il s’approcha de moi les yeux baissés, et, ramassant une serviette à terre, il me dit de sa voix assourdie et comme remplie de déférence (c’était un vrai domestique à l’ancienne mode autrichienne…) : « Pardon, monsieur le lieutenant, permettez-moi d’essuyer vos vêtements. »
C’est seulement alors que, suivant des yeux le mouvement de ses doigts affairés, je remarquai sur mon dolman et mon pantalon Pejacsévich clair de grandes taches qu’il s’efforçait de sécher. Au moment où j’essayai de retenir la jeune fille, une des tasses de thé renversées m’avait sérieusement éclaboussé. Tandis qu’il frottait et tapotait avec une serviette humide, je regardais le haut de sa bonne tête, et les cheveux gris bien peignés de ce fidèle serviteur. Le soupçon me vint malgré moi que le vieil homme faisait exprès de se pencher si bas pour que je ne voie pas sa figure et son regard ému.
« Non, ça ne va pas, fit-il au bout d’un moment, l’air affligé, sans lever la tête… Le mieux serait, monsieur le lieutenant, que j’envoie le chauffeur à la caserne vous chercher d’autres vêtements. Monsieur le lieutenant ne peut pas sortir ainsi. Mais qu’il s’en remette à moi, dans une heure tout sera sec et repassé. »
Ces remarques, il les faisait d’une façon neutre en apparence, mais il y avait dans sa voix un ton compatissant et consterné. Et lorsque je lui déclarai que ce n’était pas la peine, qu’il devait plutôt téléphoner pour faire venir une voiture et que de toute façon je voulais rentrer aussitôt, il toussa légèrement, et levant vers moi ses bons yeux fatigués et un peu suppliants :
« Que monsieur le lieutenant veuille bien rester encore un peu. Ce serait terrible si monsieur le lieutenant partait maintenant. Je suis sûr que mademoiselle sera vraiment chagrinée, si monsieur le lieutenant n’attend pas encore un petit peu. En ce moment Mlle Ilona est encore auprès d’elle… et… l’a mise au lit. Mais Mlle Ilona m’a chargé de dire qu’elle va venir tout de suite et que surtout monsieur le lieutenant veuille bien l’attendre. »
Malgré moi, j’étais profondément ému. Comme ils aimaient tous cette malade ! Comme ils l’excusaient et la dorlotaient ! Je sentis le besoin de dire quelques paroles cordiales à ce bon vieillard, qui, effrayé de son audace, s’était remis à essuyer mon dolman. Je lui tapotai doucement l’épaule.
« Laissez donc, mon cher Joseph, ne vous tracassez pas. Ça séchera tout seul avec le soleil, et j’espère que votre thé n’est pas assez fort pour laisser des traces. Occupez-vous de la vaisselle cassée. J’attendrai Mlle Ilona.
— Oh ! c’est bien que monsieur le lieutenant consente à attendre, dit-il avec un soupir de soulagement. Et de plus M. de Kekesfalva sera bientôt de retour et se réjouira de saluer monsieur le lieutenant. Il m’a chargé expressément… »
Mais déjà un pas léger se faisait entendre. C’était Ilona. Elle aussi, comme tout à l’heure le domestique, tenait les yeux baissés en s’approchant de moi...." (Traduction Grasset & Fasquelle, 1939).
Zweig est le maître de l'analyse psychologique, souvent centrée sur les passions destructrices. Mais ici, la psychologie atteint une complexité morale inédite ...
- Le grand thème est la distinction centrale entre deux types de pitié, exposée dans le prologue. La pitié "lâche" (mitleid), celle qui veut avant tout se soustraire à la souffrance d'autrui pour son propre confort moral. C'est l'impulsion première du héros, Antoine Hofmiller. Elle est égoïste, impulsive et dangereuse. Et la pitié "vraie" (mit-leid, littéralement "souffrir avec"), celle qui est un engagement total, inconditionnel. Elle est rare et exigeante.
Cette dissection minutieuse d'un sentiment a priori positif (la pitié) pour en révéler le potentiel destructeur est un sommet dans l'œuvre de Zweig. Ce n'est plus une passion qui consume, mais une faiblesse morale aux conséquences tragiques.
Contrairement à ses nouvelles qui sont souvent des confessions rétrospectives, "La Pitié dangereuse" a la structure d'une tragédie classique. L'histoire est inexorable. Chaque geste "gentil" d'Antoine, dicté par sa pitié lâche et son incapacité à dire non, l'enfonce un peu plus dans un piège dont il ne peut s'échapper. La progression est logique, cumulative et mène inévitablement à la catastrophe finale (le suicide d'Edith et la ruine morale d'Antoine). C'est une mécanique du destin beaucoup plus rigoureuse que dans ses autres récits.
L'action se déroule à la veille de la Première Guerre mondiale, dans l'Empire austro-hongrois décadent. Le microcosme de la caserne et du château de Kekesfalva est une allégorie de la société viennoise de l'époque ...
- L'aristocratie (le père d'Edith) est riche mais sans noblesse réelle, rongée par le secret et la honte.
- L'armée (Antoine) est figée dans des codes d'honneur superficiels qui étouffent les sentiments authentiques.
- Tous les personnages jouent un rôle, comme la société elle-même va s'effondrer avec la guerre. Cette dimension socio-historique, absente ou très secondaire dans ses nouvelles, donne au roman une résonance bien plus large : la tragédie individuelle est le reflet d'une tragédie collective à venir.

"La Guérison par l'esprit"(Die Heilung durch den Geist : Franz Anton Mesmer, Mary Baker-Eddy, Sigmund Feud, 1931)
"On connaît l'intérêt passionné du romancier d'Amok et du Joueur d'échecs pour les zones inexplorées et obscures de l'esprit humain. Biographe érudit et passionnant, il évoque ici trois figures historiques qui ont été parmi les premières a s'y aventurer. A la fin du XVIIIe siècle, le magnétiseur Mesmer s'intéresse à l'hypnose. Un siècle après, Mary Baker-Eddy, une Américaine, fondatrice d'une secte, prétend guérir par l'extase de la foi. Dans le même temps, à Vienne, Freud donne naissance à la psychanalyse. Trois expériences auxquelles l'histoire et la science devaient donner leur juste place, mais qui toutes trois marquèrent leur temps. Dans ce livre trop méconnu, témoignage de son inlassable curiosité intellectuelle, le grand écrivain autrichien nous convie à une réflexion fondamentale sur les pouvoirs de l'esprit."

"La Peur" (Angst, 1935)
"Un recueil de six nouvelles illustrant parfaitement le style de Zweig : "résumer le destin d’un individu dans un minimum d’espace et donner dans une
nouvelle la substance d’un livre" (Livre de Poche). La nouvelle qui donne son titre à l'ouvrage, "Angst", publiée dès 1910, conte l'histoire d'une trentenaire bourgeoise qui trompe son mari,
lequel lui tend un piège avec le concours d'une actrice qui joue les maîtres-chanteurs. Roberto Rossellini réalisa en 1954 une adaptation avec Ingrid Bergman. Les nouvelles suivantes :
"Révélation inattendue d'un métier" (Unerwartete Bekanntschaft mit einem Handwerk), en l'occurrence celui d'un pickpocket; "Leporella", "Le Bouquiniste Mendel"
(Buchmendel), "La Collection invisible - Un épisode de l’inflation en Allemagne" (Die unsichtbare Sammlung - Eine Episode aus der deutschen Inflation), "La femme et le paysage
"(Die Frau und die Landschaft).
"Lorsque Irène quitta l’appartement de son amant et descendit l’escalier, cette peur irraisonnée s’empara d’elle à nouveau, tout à coup. Une forme noire
se mit soudain à tourbillonner devant ses yeux comme une toupie, une affreuse raideur paralysa ses genoux, et elle fut obligée de se retenir très vite à la rampe pour ne pas tomber brutalement en
avant. Ce n’était pas la première fois qu’elle osait prendre le risque de venir ici, et cette terreur soudaine ne lui était pas du tout inconnue ; elle avait beau lutter de tout son être, chaque
fois qu’elle repartait elle succombait à ces accès de peur absurdes et ridicules. Aller au rendez-vous était beaucoup plus aisé. Elle faisait arrêter la voiture au coin de la rue et, sans lever
les yeux, franchissait très vite les quelques mètres qui la séparaient de la porte cochère ; puis elle montait à la hâte les marches de l’escalier, sachant qu’il l’attendait déjà derrière la
porte, prêt à ouvrir. Cette première angoisse, à laquelle se mêlait cependant une brûlante impatience, se dissipait dans l’étreinte passionnée des retrouvailles. Mais ensuite, quand elle
s’apprêtait à rentrer chez elle, c’était un frisson différent, une mystérieuse terreur, confusément liée cette fois à l’horreur de la faute commise et à cette illusion absurde que, dans la rue,
chaque regard étranger pouvait, en la regardant, deviner d’où elle venait, et adresser un sourire insolent à son désarroi. Les dernières minutes passées auprès de lui étaient déjà empoisonnées
par l’inquiétude croissante causée par son appréhension ; au moment de partir, elle était si pressée et si nerveuse que ses mains tremblaient, elle percevait ce qu’il disait d’une oreille
distraite et repoussait d’un geste impatient les derniers élans de sa passion. Partir, c’était alors la seule chose qu’elle désirait, de tout son être, quitter cet appartement, cet immeuble, fuir
l’aventure, retrouver la tranquillité de son univers bourgeois. [C’est à peine si elle osait se regarder dans le miroir, redoutant la suspicion dans son propre regard, mais il lui fallait
pourtant vérifier si aucun désordre dans ses vêtements ne trahissait ces moments de passion.] Venaient ensuite ces ultimes paroles qui se voulaient rassurantes et que dans son énervement elle
entendait à peine, puis le moment d’écouter, à l’abri derrière la porte, si personne ne montait ou descendait l’escalier. Mais dehors, impatiente de se saisir d’elle, la peur l’attendait déjà,
lui étreignait si impérieusement le cœur qu’elle était toujours à bout de souffle avant même d’avoir descendu les quelques marches [et qu’elle sentait toutes ses forces, rassemblées au prix d’une
extrême tension de ses nerfs, l’abandonner].
Elle resta une minute ainsi, les yeux fermés, respirant avec avidité la fraîcheur dans l’obscurité de l’escalier. Alors une porte se referma à l’un des
étages supérieurs : effrayée, elle se ressaisit et se dépêcha de descendre, en ajustant sur son visage, d’un geste machinal, son épaisse voilette. Maintenant se rapprochait ce moment ultime, le
plus effrayant : la panique de gagner la rue en sortant d’une maison qui n’était pas la sienne [, et de se heurter peut-être à une personne connue passant par là, qui insisterait pour savoir d’où
elle venait, la plongeant dans le trouble et le péril d’un mensonge]. Elle baissa la tête, comme un athlète qui prendrait son élan pour sauter, puis, soudain résolue, se précipita vers la porte
cochère entrouverte.
Elle se cogna alors brutalement à une femme qui avait tout l’air de vouloir entrer. – Pardon – fit-elle toute confuse en essayant de se faufiler. Mais
la femme lui barrait le passage et la dévisageait avec colère, avec un mépris non dissimulé, aussi. « Ah, j’vous y prends cette fois ! » cria-t-elle d’une voix vulgaire sans se gêner le moins du
monde. « Et bien sûr, une dame comme il faut, enfin soi-disant ! Ça se contente pas d’avoir un mari, beaucoup d’argent et tout le reste, il faut encore que ça vienne chiper l’amant d’une pauvre
fille…
– Pour l’amour du ciel, qu’avez-vous… ? Vous vous trompez !… » bredouilla Irène en tentant maladroitement de s’esquiver ; mais la bonne femme lui boucha
le passage de toute la largeur de son corps massif, et l’invectiva d’une voix perçante : « Non, je ne me trompe pas… j’vous connais…, vous venez de chez Édouard, mon ami… Maintenant que j’vous
tiens enfin, j’comprends pourquoi il s’intéressait si peu à moi ces derniers temps… C’est donc à cause de vous… espèce de… !
– Pour l’amour du ciel », l’interrompit Irène d’une voix défaillante, « mais ne criez pas comme cela ! » et elle recula instinctivement sous le porche
de l’immeuble. La femme la regarda d’un air moqueur : la voir ainsi trembler de peur, en plein désarroi, semblait d’une certaine façon la remplir d’aise, car elle se mit à examiner sa victime
avec arrogance, avec un sourire sarcastique et suffisant. Une satisfaction vulgaire enflait sa voix en lui donnant une sorte d’ampleur ostentatoire.
– Voilà donc à quoi elles ressemblent, ces dames mariées, ces grandes dames distinguées, quand elles viennent nous voler nos hommes. Avec une voilette,
bien sûr, une voilette, pour pouvoir ensuite jouer partout les honnêtes femmes…
– Mais… Mais que me voulez-vous donc ?… Je ne vous connais pas… Il faut que je parte.
– Partir, c’est ça bien sûr… pour retrouver Monsieur votre époux… dans votre appartement douillet, pour jouer les grandes dames avec des domestiques qui
les aident à se déshabiller. Mais notre sort à nous autres, qu’on crève la faim ou non, vous la grande dame, vous vous en fichez, hein ?… Ces honnêtes femmes, ça vous dépouille de tout ce que
vous avez… »
Irène fit un effort sur elle-même et, obéissant à une vague inspiration, saisit son porte-monnaie et prit les billets qui lui tombaient sous la main. «
Tenez… voilà… mais laissez-moi maintenant… je ne viendrai plus jamais ici… je vous le jure. »
Avec un regard mauvais, la femme prit l’argent en grommelant : « Garce ! » À ce mot Irène tressaillit, mais elle vit que l’autre s’écartait de la porte,
et elle se précipita dehors, hébétée et haletante, comme un désespéré du haut d’une tour.

Tandis qu’elle courait, elle avait l’impression que les visages défilaient sur son passage comme des masques grimaçants ; déjà tout devenait noir devant
ses yeux, et elle eut beaucoup de peine à parvenir jusqu’à une automobile arrêtée au coin de la rue. Elle se laissa tomber comme une masse sur la banquette, puis tout en elle devint inerte et
pétrifié ; lorsque le chauffeur étonné finit par demander à cette singulière cliente où il fallait aller, elle le fixa un instant, le regard vide, jusqu’à ce que son cerveau engourdi eût enfin
saisi ses paroles. « À la Gare du Sud » s’empressa-t-elle de répondre ; et pensant tout à coup que cette femme pourrait la suivre, elle ajouta : « Vite, vite, dépêchez-vous !
»
C’est seulement pendant le trajet qu’elle se rendit compte que cette rencontre l’avait bouleversée au plus profond d’elle-même. Elle sentit ses mains
rigides et glacées qui pendaient le long de son corps, comme sans vie, et fut prise soudain de frissons si violents qu’elle en était toute secouée. Un goût amer lui monta à la gorge et elle eut
envie de vomir, tandis qu’une fureur aveugle et insensée lui donnait comme des convulsions dans la poitrine. Elle aurait voulu crier ou donner des coups de poing pour se délivrer de l’horreur de
ce souvenir, fiché dans son cerveau comme un hameçon, oublier la laideur de ce visage, son rire sardonique, la vulgarité qui émanait de l’haleine fétide de cette prolétaire, cette bouche horrible
qui lui avait craché en pleine figure des paroles si haineuses et si infâmes, et ce poing rouge qu’elle avait levé pour la menacer. Cette sensation de nausée augmentait et lui montait de plus en
plus à la gorge, d’autant plus que la voiture, qui roulait à vive allure, la projetait d’un côté à l’autre. Elle allait signifier au chauffeur de ralentir, lorsqu’elle pensa, juste à temps,
qu’elle n’aurait peut-être plus assez d’argent sur elle pour le payer, puisqu’elle avait donné tous ses billets à cette extorqueuse. Elle lui fit aussitôt signe de s’arrêter et descendit
brusquement, ce qui étonna de nouveau le chauffeur. Par bonheur il lui restait assez d’argent. Mais elle se retrouva dans un quartier tout à fait inconnu, perdue dans une foule de gens affairés,
dont le moindre mot, le moindre regard lui causaient une souffrance physique. De plus, ses jambes étaient comme amollies par la peur et refusaient presque de la porter plus loin ; il fallait
pourtant qu’elle rentrât. Rassemblant toute son énergie, elle avança péniblement d’une rue à l’autre, au prix d’un effort surhumain, comme si elle traversait un marais ou s’enfonçait dans la
neige jusqu’aux genoux. Elle arriva enfin devant son immeuble et s’élança dans l’escalier, avec une précipitation qu’elle refréna aussitôt, pour ne rien laisser paraître de son
trouble.
À présent que la bonne lui enlevait son manteau, qu’elle entendait dans la pièce voisine son petit garçon jouer avec sa sœur cadette, et que son regard
apaisé rencontrait partout des choses familières, bien à elle et rassurantes, elle retrouva une apparence de calme, tandis que les vagues souterraines de l’émotion agitaient encore
douloureusement sa poitrine oppressée. Elle ôta sa voilette et s’efforça de détendre ses traits, bien décidée à paraître naturelle ; puis elle entra dans la salle à manger, où son mari lisait le
journal devant la table mise pour le dîner.
« Il est bien tard ma chère Irène », fit-il sur un ton d’aimable reproche. Il se leva et l’embrassa sur la joue ; elle en éprouva malgré elle un pénible
sentiment de honte. Ils se mirent à table et, se détournant à peine de son journal, il demanda d’un air indifférent : « Où étais-tu pendant tout ce temps ?
– J’étais… chez… chez Amélie… elle avait encore une course à faire… et je l’ai accompagnée », ajouta-t-elle, aussitôt furieuse contre elle-même d’avoir
répondu sans réfléchir, en mentant aussi mal. D’ordinaire elle fourbissait toujours à l’avance un mensonge ingénieux, capable de résister à toutes les vérifications éventuelles, mais aujourd’hui
la peur le lui avait fait oublier, la contraignant à une improvisation aussi maladroite. Et, songea-t-elle soudain, si son mari téléphonait pour se renseigner, comme dans la pièce de théâtre
qu’ils avaient vue récemment…
« Qu’as-tu donc ?… tu parais bien nerveuse… et pourquoi n’enlèves-tu donc pas ton chapeau ? » demanda-t-il. Elle tressaillit en s’apercevant que son
trouble venait à nouveau de la trahir, se leva précipitamment et alla dans sa chambre pour enlever son chapeau : là, elle s’observa dans le miroir jusqu’à ce que son regard inquiet lui parût
avoir retrouvé toute son assurance. Puis elle retourna dans la salle à manger.
La bonne servit le dîner, et ce fut une soirée comme toutes les autres, peut-être un peu plus silencieuse et moins cordiale que d’habitude, une soirée
où la conversation fut morne, sans entrain, souvent hésitante. Les pensées d’Irène refaisaient sans cesse le chemin, et chaque fois qu’elle revivait l’horrible moment où elle était tombée sur
cette extorqueuse, elle était saisie d’épouvante. Elle levait alors les yeux pour se rassurer, son regard caressait les uns après les autres les objets autour d’elle qui tous avaient une âme :
chacun se trouvait là, chargé de souvenir et de signification ; elle retrouvait alors un certain calme. Et la pendule, dont le lent rythme d’acier arpentait le silence, redonnait
imperceptiblement à son cœur un peu de son insouciante et imperturbable régularité."

"Les prodiges de la vie" (Die Wunder des Lebens) 1904
Cette nouvelle, l'une des premières de Stefan Zweig, publiée dans le recueil "Die Liebe der Erika Ewald", se déroule à Anvers, à la veille de la guerre
d'indépendance des Pays-Bas. Articulé autour de la création et de la destruction d'un tableau religieux, ce récit poétique raconte comment un vieux peintre, chargé de faire le portrait d'une
madone pour une église, la voit s'incarner sous les traits d'une jeune juive. L'élaboration du tableau est difficile. Pour la jeune fille, réchappée d'un pogrome et restée à l'écart de la vie
réelle, il s'agit d'une véritable initiation. Saura-t-elle y faire face ? La plupart des thèmes chers à Stefan Zweig sont déjà présents dans ce texte qui est également une réflexion métaphysique
sur ce que certains nomment le hasard, et, d'autres, le destin. Présentation et notes d'Isabelle Hausser.

"Brûlant Secret" (Brennendes Geheimnis, 1911)
"Comment le désir et la passion, enracinés au fond de chaque être, peuvent le révéler à lui-même et bouleverser son destin : tel est le secret que tentent
de percer les quatre récits qui composent ce volume. L’éveil de la jalousie chez un garçon de douze ans, qui a innocemment rapproché sa mère et le jeune vacancier oisif dont l’amitié l’emplissait
de fierté ; la dérive nocturne d’un homme qui découvre au contact des voyous et des prostituées une part inconnue de lui-même ; le mystère d’une jeune femme qui se donne sans vouloir révéler son
identité ; la rivalité de deux sœurs, l’une religieuse et l’autre courtisane : dans des situations très diverses, l’auteur de Vingt-quatre heures de la vie d’une femme explore avec audace des
sentiments troubles et fascinants", "Brûlant secret" (Brennendes Geheimnis), "Conte crépusculaire", "La nuit fantastique" (Phantastische
Nacht), "Les deux jumelles" ...
(Brûlant secret) - Un jeune fonctionnaire en villégiature dans une station du Semmering se languit de Vienne et de ses plaisirs. L'exercice de la séduction offrant un dérivatif à son ennui, il jette son dévolu sur une jeune femme qui réside dans le même hôtel, en compagnie de son fils, un garçon d'une douzaine d'années venu fortifier sa constitution chétive au grand air des montagnes. C'est à travers cet enfant que le jeune homme entreprend la conquête de l'inconnue. Il semble pouvoir y réussir, mais l'enfant délaissé, qui comprend que l'on s'est servi de lui, fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire obstacle au séducteur ...
"La locomotive fit entendre un rauque sifflement : on était arrivé au Semmering. Pendant une minute les noirs wagons stationnèrent sous la lumière faiblement argentée du ciel ; ils rejetèrent un mélange de personnes et en avalèrent d’autres ; des voix nerveuses résonnèrent çà et là, puis la machine siffla de nouveau et entraîna bruyamment la chaîne sombre des wagons dans la gueule du tunnel. Et la paix régna de nouveau sur le vaste paysage aux clairs arrière-plans balayés par le vent humide.
L’un des arrivants, un jeune homme, qui attirait la sympathie et l’attention par son costume de bon goût et par l’élasticité naturelle de sa marche, prit vite, avant tous les autres, un fiacre pour le conduire à l’hôtel. Les chevaux gravirent sans hâte le chemin montant. Il y avait du printemps dans l’air. Dans le ciel flottaient de blancs et turbulents nuages comme on n’en voit qu’en mai et juin –, ces compagnons toujours jeunes et volages, qui courent en jouant sur la piste bleue pour se cacher soudain derrière de hautes montagnes, qui s’embrassent et ensuite se fuient, qui tantôt se chiffonnent comme des mouchoirs et tantôt s’effilochent en bandeaux et qui, finalement, comme pour leur faire une niche, mettent sur la tête des monts de blancs bonnets. Il y avait aussi de l’agitation là-haut dans le vent, qui secouait si violemment les maigres arbres encore tout mouillés par la pluie, que leurs articulations craquaient doucement et que mille gouttelettes en jaillissaient, comme des étincelles. Parfois aussi le parfum de la neige semblait apporter sa fraîcheur du haut des montagnes ; alors on sentait dans sa respiration quelque chose qui était à la fois doux et piquant. Tout dans l’air et sur la terre était mouvement, bouillonnement et impatience. Maintenant qu’ils dévalaient la pente du chemin, les chevaux couraient en soufflant légèrement et le tintement de leurs grelots s’entendait de très loin.
À l’hôtel, la première chose que fit le jeune homme fut de consulter la liste des hôtes, qu’il parcourut, bientôt déçu. « Pourquoi donc suis-je ici ? » se demanda-t-il tout d’abord avec inquiétude. « Être seul, dans la montagne, sans société, c’est pire que le bureau. Il est clair que je suis arrivé trop tôt, ou trop tard. Je n’ai jamais de chance avec mes vacances. Pas un seul nom connu parmi tous ces gens-là. Si, du moins, il y avait quelques femmes, la possibilité d’un petit flirt – à la rigueur même innocent – pour ne pas passer cette semaine trop tristement. » Le jeune homme, un baron de cette noblesse autrichienne de peu d’éclat issue de la bureaucratie, était employé de ministère. Il avait pris ce petit congé sans aucun besoin, simplement parce que tous ses collègues avaient obtenu en cette saison printanière une semaine de vacances et qu’il ne voulait pas faire cadeau de la sienne à l’administration. Quoique ne manquant pas d’une certaine personnalité, il était d’une nature essentiellement mondaine, recherché pour cela, et bien vu dans tous les milieux. Il avait pleinement conscience de son incapacité à supporter la solitude, à rester seul en face de lui-même, et il évitait autant que possible ces moments-là parce qu’il ne voulait pas du tout faire plus intimement connaissance avec son moi. Il savait qu’il avait besoin du contact des hommes pour faire briller tous ses talents, pour animer la chaleur et la pétulance de son cœur, et que, laissé à lui seul, il était sans valeur et froid comme une allumette dans sa boîte.
Mécontent, il se mit à aller et venir dans le hall vide, tantôt feuilletant les journaux avec indécision, tantôt entamant une valse sur le piano du salon sans que ses doigts pussent en trouver le rythme parfait. Enfin, il s’assit dans un coin, de mauvaise humeur, regardant l’obscurité tomber lentement et le brouillard sortir des pins sous forme de vapeurs grises. Il émietta ainsi une heure sans aucun agrément et dominé par ses nerfs. Puis il se réfugia dans la salle à manger.
Il n’y avait d’abord que quelques tables d’occupées et il en fit le tour d’un regard rapide. Vainement. Il ne connaissait personne sauf, là-bas (et il rendit négligemment un salut), un entraîneur qu’il avait connu aux courses, puis, ailleurs, un visage qu’il avait croisé sur le Ring… c’est tout. Pas une femme qui lui permît d’espérer ne fût-ce qu’une fugitive aventure. Son humeur devint plus impatiente. C’était un de ces hommes qui doivent beaucoup de bonnes fortunes à leur joli visage et chez qui, à chaque moment, tout est prêt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle expérience amoureuse ; un de ces jeunes hommes qui sont toujours au potentiel voulu pour se précipiter dans l’inconnu d’une aventure, que rien ne surprend, parce que, sans cesse à l’affût, ils ont tout calculé ; qui ne manquent aucune occasion galante parce que leur premier regard pénètre, inquisiteur, dans la sensualité charnelle de chaque femme, sans faire de différence entre l’épouse de leur ami et la servante qui leur ouvre la porte. Lorsque, avec un certain dédain superficiel, on appelle ces gens-là des « chasseurs de femmes », c’est sans savoir combien de vérité positive incarne ce mot, car, effectivement, tous les instincts passionnés de la chasse, le flair, l’excitation et la cruauté mentale, s’agitent dans l’attitude de ces hommes. Ils sont sans cesse aux aguets, toujours prêts, et résolus à suivre jusqu’au bord de l’abîme la moindre piste d’aventure. Ils sont toujours chargés de passion, non pas de la passion, estimable, de l’amant, mais de celle du joueur, froide, calculatrice et périlleuse. Il y en a parmi eux d’une ténacité extraordinaire dont, même au-delà de leur jeunesse, toute l’existence se passe dans l’attente de l’éternelle aventure ; pour qui la journée se divise en cent petits événements sensuels (un coup d’œil en passant, un sourire glissé en coulisse, un genou effleuré quand on est assis en face l’un de l’autre) et l’année, à son tour, en une centaine de ces jours-là ; pour qui, enfin, l’événement sensuel est la source éternellement jaillissante, nourricière, et brûlante de la vie.
Ici il n’y avait pas de femme, pas de partenaire. Et il n’est pas d’irritation plus vive que celle du joueur, assis les cartes à la main devant le tapis vert, conscient de sa supériorité, et qui attend en vain un partenaire. Le baron demanda un journal et laissa couler ses regards maussades sur les lignes imprimées ; mais ses pensées étaient paralysées et trébuchaient contre les mots comme un homme ivre.
Soudain il entendit derrière lui le frou-frou d’une robe et une voix légèrement irritée qui disait avec un accent affecté : « Mais tais-toi donc, Edgar. »
Une robe de soie crissa en passant contre sa table ; il vit une silhouette de femme, grande et bien en chair, avec derrière elle, vêtu d’un costume de velours noir, un petit garçon pâle, dont le regard l’effleura avec curiosité. Tous deux s’assirent en face l’un de l’autre, à la table réservée, l’enfant s’efforçant visiblement d’observer une correction qui paraissait en contradiction avec l’agitation de ses yeux noirs. La dame (le jeune baron ne faisait attention qu’à elle) était très soignée, et mise avec une élégance recherchée. En outre elle avait un type qu’il aimait beaucoup : c’était une de ces juives un peu grasses, à la veille de dépasser la maturité, manifestement passionnée, elle aussi, mais habile à cacher son tempérament derrière une mélancolie distinguée. Il ne put tout d’abord voir ses yeux, mais il admira la ligne bien formée des sourcils, s’arrondissant avec pureté au-dessus d’un nez délicat, qui, à vrai dire, trahissait la race, mais qui par sa noblesse rendait le profil de cette femme net et intéressant. Ses cheveux, comme tout ce qu’il y avait de féminin dans ce corps épanoui, étaient d’une luxuriance remarquable, et sa beauté, dans la fière conscience qu’elle avait d’être très admirée, paraissait rassasiée et orgueilleuse. Elle commanda le repas d’une voix très basse, rappela encore à l’ordre le gamin qui faisait du bruit en jouant avec sa fourchette, tout cela avec une apparente indifférence devant le regard glissant et prudent du baron, dont elle avait l’air de ne pas remarquer la présence, tandis qu’en réalité c’était la vigilance active de celui-ci qui lui imposait cette réserve soucieuse...."
(La Nuit fantastique) Par un radieux dimanche du printemps 1913, un dandy au coeur insensible, et dont les nombreux succès féminins ne parviennent pas à dissiper l'ennui chronique, s'aventure à son insu sur le dangereux chemin qui le mène à la découverte de lui-même. D'un élégant champ de courses jusqu'aux allées mal famées du Prater, cette quête jalonnée de rencontres inquiétantes constitue à sa manière une dernière promenade dans une Vienne impériale sur son déclin, "la molle et voluptueuse ville de Vienne qui, comme nulle autre, fait de la promenade, de la rêverie oisive et de l'élégance une sorte de perfection artistique et un but qui suffit à satisfaire une existence..."
".. Cependant. je puis dire avec certitude qu'à cette époque-là je ne me trouvais pas du tout malheureux, car presque jamais mes désirs ne restaient insatisfaits et ce que je demandais à la vie m'était presque toujours accordé. Cependant, le fait que je m'étais habitué à recevoir du destin tout ce que je voulais et que je ne trouvais rien d'autre à exiger de lui pouvait de plus, en plus faire conclure à un certain manque d'intensité et à une vie en elle-même peu vivante. Ce qui alors inconsciemment s'éveillait en moi, en mainte heure de sourde aspiration où je me trouvais dans une sorte de demi-connaissance, ce n'étaient pas, à vrai dire, des désirs, mais simplement le désir d'en éprouver, le besoin de nourrir des vues plus larges, plus fortes, des ambitions moins facilement satisfaites, le besoin de vivre davantage et peut-être aussi de souffrir.
Par une technique trop raisonnable, j'avais éliminé de mon existence toute résistance, et ce manque de résistance faisait tort à ma vitalité. Je remarquais que mes désirs devenaient de moins en moins nombreux et toujours plus faibles, qu'il y avait une sorte d'engourdissement de ma sensibilité et que (c'est peut-être la meilleure expression à employer) je souffrais d'une impuissance morale, d'une incapacité de prendre passionnément possession de la vie. Je reconnus cette lacune qui était en moi d'abord à de petits signes. Je m'aperçus que je négligeais très souvent d'assister à certains spectacles sensationnels, que je commandais des livres qui m'avaient été vantés et les laissais ensuite sans les couper pendant des semaines sur ma table; que si je continuais à acheter machinalement des cristaux et des antiques, c'était sans procéder ensuite à leur classement et sans me réjouir de l'acquisition inespérée d'une pièce rare et longtemps cherchée.
Néanmoins je n'eus vraiment conscience de cette diminution progressive, quoique légère, de ma force de réaction intellectuelle qu'à propos d'une circonstance dont il me souvient encore nettement. Cet été-là (du fait de mon étrange paresse qui ne se sentait attirée par aucune nouveauté) j'étais resté à Vienne, lorsque soudain je reçus d'une ville d'eaux la lettre d'une femme avec qui j'entretenais depuis trois ans une liaison intime et que même je croyais aimer d'une façon sincère.
Elle m'écrivait dans quatorze pages pleines d'émotion qu'au cours des dernières, semaines elle avait fait la connaissance d'un homme qui lui était devenu très cher, qui même était tout pour elle, de sorte qu'elle allait l'épouser à l'automne et que notre liaison devait prendre fin. Elle pensait sans regret, disait-elle, et même avec bonheur au temps que nous avions vécu ensemble; mon souvenir l'accompagnerait dans sa nouvelle vie comme ce qu'il y avait de plus précieux dans sa vie passée et elle espérait que je lui pardonnerais une résolution si brusque. Après cette information objective, la lettre, qui prenait un ton très ému, se répandait en objurgations tout à fait touchantes, me suppliant de ne pas me fâcher et de ne pas trop souffrir de cette défection imprévue. Mon amie me conjurait de ne pas essayer de la retenir par la violence, de ne pas commettre contre moi-même une folie, elle m'invitait à chercher des consolations auprès d'une femme meilleure qu'elle et à lui écrire tout de suite, car elle était inquiète de la façon dont j'accueillerais cette nouvelle. Et en post-scriptum, au crayon, elle avait encore écrit: "Ne fais rien de déraisonnable, comprends-moi, pardonne-moi."
Je lus donc cette lettre, d'abord surpris de la nouvelle et puis, après l'avoir achevée, je la relus, mais, cette fois-ci, avec une certaine honte qui, prenant conscience d'elle-même, s'accentua bientôt jusqu'à devenir une épouvante intérieure, car de tous les sentiments puissants et, à vrai dire, naturels que mon amie supposait devoir s'éveiller en moi, comme une chose qui va de soi, je n'en avais éprouvé aucun, ne fût-ce que dans une faible mesure. La nouvelle ne m'avait pas fait souffrir, je ne m'étais pas fâché contre mon amie, je n'avais pas songé une seconde à un acte de violence contre elle ou contre moi, et cette froideur de sentiments était si singulière qu'il était forcé que je m'en effrayasse moi-même.
Voilà que s'éloignait de moi une femme qui avait été la compagne de ma vie pendant des années, dont le corps ardent s'était élastiquement prêté au mien, dont l'haleine s'était confondue avec la mienne pendant de longues nuits, et rien ne remuait en moi. Rien ne protestait, rien ne cherchait à la reconquérir, rien ne s'éveillait dans ma sensibilité de ce que le simple instinct de cette femme supposait devoir être une chose naturelle chez un homme normal.
C'est à ce moment-là que je me rendis compte pour la première fois, d'une manière complète, combien le processus d'engourdissement s'était développé en moi; je ne faisais que glisser comme sur une eau courante et miroitante, sans m'attacher à rien, sans m'être enraciné nulle part et je savais bien que cette froideur était quelque chose de cadavérique, sur quoi, il est vrai, ne s'élevait pas encore la pestilence de la corruption, mais qui, malgré tout, était déjà une torpeur sans espoir, une froide et effrayante insensibilité et, par conséquent, comme la minute qui précède la mort véritable, la mort physique, la fin, visible même extérieurement, de toutes choses.
Depuis cet épisode, je me mis à m'observer avec attention, à observer cette étrange apathie qui était en moi, comme un malade observe sa maladie. Lorsque, peu de temps après, un de mes amis vint à mourir et que je suivis son cercueil, j'auscultai mon âme pour savoir si le deuil, si la douleur ne la faisaient pas vibrer, s'il n'y avait pas dans mon être quelques fibres sensibles, en constatant que cet homme que je connaissais depuis mon enfance était à jamais perdu pour moi. Mais rien ne bougeait; je me considérais moi-même comme un objet en verre à travers lequel brillent d'autres objets, mais qui ne les contient pas. et j'eus beau m'efforcer, en cette circonstance et en beaucoup d'autres semblables, de ressentir quelque chose, j'eus beau même chercher à contraindre ma sensibilité par des raisons intellectuelles, aucune réponse ne sortit de cette rigidité intérieure. Les hommes me quittaient, les femmes allaient et venaient, cela ne faisait pas plus d'impression sur moi qu'en fait, sur quelqu'un qui est assis dans sa chambre, la pluie qui tombe sur la vitre ; entre moi et la réalité immédiate, il y avait une cloison de verre que je n'avais pas la force de briser. ..."
(traduction Alzir Hella, B.Grasset)

"L’Amour d’Erika Ewald" (Die Liebe der Erika Ewald, 1904)
"« Notre vie possède des courants plus profonds que les éléments extérieurs, qui nous rapprochent et nous séparent. Une intense magie de la vie, accessible
à notre seule émotion et non pas à nos sens, gouverne nos destins, même quand nous croyons les diriger nous-mêmes. » Ainsi l’auteur d’ Amok et de La Confusion des sentiments définissait-il
l’unité de ces quatre récits parus en 1904 et salués par le grand écrivain suisse Hermann Hesse. Que l’histoire se situe sur la Riviera au début du siècle, à Anvers au temps des guerres de
Religion ou à Jérusalem le jour de la crucifixion du Christ, les thèmes majeurs de l’œuvre apparaissent : l’amour générateur de souffrances secrètes, qui conduisent à la mort ou à la
purification, les correspondances secrètes des êtres par-delà l’absurdité des destinées."

Clarissa (Clarissa. Ein Romanentwurf)
«Le monde entre 1902 et le début de la Seconde
Guerre mondiale, vu à travers les yeux d’une femme » : ainsi Stefan Zweig résumait-il le thème de ce roman, entrepris dans les derniers temps de sa vie et retrouvé dans ses archives. Clarissa,
fille d’un militaire autrichien, est née en 1894. A l’aube du premier conflit mondial, elle rencontre à Lucerne, en Suisse, un jeune socialiste français, Léonard, qui n’est pas sans évoquer
Romain Rolland. La guerre les sépare, mais Clarissa attend un enfant. Dans l’Europe déchirée, en proie à l’hystérie nationaliste, son acceptation de cette maternité va devenir, plus qu’une
décision personnelle : un destin et un symbole. Une œuvre testamentaire où le grand écrivain autrichien résume, de façon poignante, son idéal humaniste et son désespoir.

"Le combat avec le démon" (Der Kampf mit dem Dämon, 1925)
"Kleist, Hölderlin, Nietzsche : trois destinées fulgurantes et sombres, où les éclairs du génie créateur illuminent des vies brèves, en proie à l’excès, à la démesure, à la folie. Comme il l’a fait dans Trois poètes de leur vie , Stefan Zweig rapproche ici ces figures animées par un même mouvement intérieur. Pour ces errants, à peu près ignorés de leur vivant, la pensée ou la création ne sont pas cette sereine construction d’un idéal d’harmonie et de raison dont Goethe donne l’exemple accompli ; elles ne peuvent naître que dans le corps à corps avec un démon intérieur qui fait d’eux les fils de Dionysos, déchiré par ses chiens. C’est en romancier, grâce à l’intuition et à la fraternité d’âme, que l’auteur d’ Amok et du Joueur d’échecs , fasciné par les dimensions les plus mystérieuses de l’esprit humain, mène ces évocations, dont bien des pages sont d’inoubliables morceaux littéraires."

Nietzsche (1925)
"Nietzsche est l’un des trois essais biographiques que compte Le Combat avec le démon , écrit par Stefan Zweig en 1925. Il s agit d'une interprétation
personnelle mais argumentée de la vie du célèbre philosophe allemand. Les premières touches de ce portrait laissent entrevoir un être déraciné, quasi-aveugle, tourmenté par de violentes migraines
et de terribles maux d'estomac, qui mène une existence solitaire dans des pensions anonymes. Mais ce quotidien austère, fait de souffrances, n'intéresse Zweig que dans la mesure où il est, selon
lui, indissociable du cheminement intellectuel de Nietzsche. En effet, si la condition physique du philosophe a influencé sa réflexion, lui soufflant des concepts aussi fondamentaux que la
volonté de puissance, sa pensée a en retour façonné sa façon d être au monde et aux autres. Car relativiste, amoral, Nietzsche l'a été jusque dans sa vie, dans ses rapports à autrui. Mû par une
passion excessive de la vérité qui excluait toute concession, laissant sans cesse derrière lui ses croyances perdues, il est allé jusqu à sacrifier ses amitiés au nom de son insatiable besoin de
connaissances et de nouveauté. Cette course vers l'abîme, Stefan Zweig en exprime toute la profondeur, toute la beauté à travers les événements et les oeuvres qui jalonnent la vie de
Nietzsche."
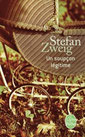
"Un soupçon légitime" (War er es, 1940)
"Un soupçon légitime, écrite entre 1935 et 1940 et publiée de façon posthume en 1987, raconte l'histoire d'un homme dont les passions vont causer le malheur de son entourage. John Limpley s'installe à la campagne avec son épouse et adopte un chien, Ponto. Adulé par son maître, l'animal se transforme en tyran... jusqu'au jour où il est délaissé, lorsque la jeune femme tombe enceinte. Le drame qui va suivre est d'autant plus tragique qu'il reste inexpliqué. Dans cette nouvelle angoissante, inédite en français, on retrouve le style inimitable de Zweig et sa finesse dans l'analyse psychologique. Comme dans Lettre d'une inconnue ou Le joueur d'échecs, il dépeint avec virtuosité les conséquences funestes de l'obsession et de la démesure des sentiments."

"Le Joueur d'échecs" (Schachnovelle, 1943)
"Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gäste vom Land drängten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben, Telegraphenboys mit schiefen Mützen schossen Namen ausrufend durch die Gesellschaftsräume, Koffer und Blumen wurden geschleppt, Kinder liefen neugierig treppauf und treppab, während das Orchester unerschütterlich zur Deckshow spielte. ..."
"Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Czentovic, le champion mondial des échecs, véritable prodige aussi fruste qu'antipathique ? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas joué depuis plus de vingt ans ? Voilà un mystère que les passagers oisifs de ce paquebot de luxe aimeraient bien percer. Le narrateur y parviendra. Les circonstances dans lesquelles l'inconnu a acquis cette science sont terribles. Elles nous reportent aux expérimentations nazies sur les effets de l'isolement absolu, lorsque, aux frontières de la folie, entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés les plus étranges. Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit le personnage avec une ironie douloureuse, « pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons »."
En août 1941, Zweig effectue sa dernière traversée entre New York et Rio et, pour oublier ce monde en perdition, s'offre un manuel d'échecs et s'initie à ce jeu avec Lotte. On a pu métaphoriquement rapprocher cette nouvelle du sentiment d'impasse, ou d'échec, dans lequel il se trouvait. Le monde semble ainsi réduit à 64 cases, terrain d'un combat méthodique qui vise à l'anéantissement, mais jeu tout de même où l'esprit ne sombre pas malgré sa défaite...
"Sur le grand paquebot qui à minuit devait quitter New York à destination de Buenos-Aires, régnait le va-et-vient habituel du dernier moment. Les
passagers embarquaient, escortés d’une foule d’amis : des porteurs de télégrammes, la casquette sur l’oreille, jetaient des noms à travers les salons : on amenait des malles et des
fleurs, des enfants curieux couraient du haut en bas du navire, pendant que l’orchestre accompagnait imperturbablement ce grand spectacle, sur le pont.
Un peu à l’écart du mouvement, je m’entretenais avec un ami, sur le pont-promenade, lorsque deux ou trois éclairs jaillirent tout près de nous –
apparemment, un personnage de marque que les reporters interviewaient et photographiaient encore, juste avant le départ. Mon compagnon regarda dans cette direction et sourit : « Vous
avez à bord un oiseau rare : Czentovic. » Et, comme je n’avais pas vraiment l’air de comprendre ce qu’il voulait dire, il ajouta en guise d’explication : « Mirko Czentovic, le
champion mondial des échecs. Il a traversé les États-Unis d’est en ouest, sortant vainqueur de tous les tournois, et maintenant il s’en va cueillir de nouveaux lauriers en
Argentine. »
Je me souvins alors de ce jeune champion et de quelques particularités de sa fulgurante carrière. Mon ami, qui lisait les journaux mieux que moi,
compléta mes souvenirs d’une quantité d’anecdotes.
Il y avait environ un an, Czentovic était devenu tout d’un coup l’égal des maîtres les plus célèbres de l’échiquier, comme Aljechin, Capablanca,
Tartakower, Lasker ou Bogoljubow. Depuis qu’en 1922, Rzecewski, le jeune prodige de sept ans, s’était distingué au tournoi de New York, on n’avait vu personne d’aussi obscur attirer avec autant
d’éclat l’attention du monde sur l’illustre confrérie des joueurs d’échecs. Car les facultés intellectuelles de Czentovic n’eussent permis en aucune façon de lui prédire un brillant avenir.
D’abord tenu secret, le bruit courut bientôt que ce champion était incapable en privé d’écrire une phrase, même dans sa propre langue, sans faire des fautes d’orthographe, et que, selon la
raillerie d’un partenaire rageur, « son inculture dans tous les domaines était universelle ».
Czentovic était le fils d’un misérable batelier slave du Danube, dont la toute petite embarcation fut coulée une nuit par un vapeur chargé de blé. Son
père mourut : l’enfant qui avait alors douze ans, fut recueilli par le charitable curé de son village et l’excellent prêtre s’efforça honnêtement de faire répéter à ce garçon au large front,
apathique et taciturne, les leçons qu’il n’arrivait pas à retenir à l’école. Mais ses tentatives demeurèrent vaines. Mirko fixait d’un œil vide les caractères d’écriture qu’on lui avait déjà
expliqués cent fois : son cerveau fonctionnant avec effort était impuissant à assimiler, même les notions les plus élémentaires. À quatorze ans, il s’aidait encore de ses doigts pour compter
et quelques années après, il ne lisait encore un livre ou un journal qu’au prix des plus grands efforts. On n’eût pu dire cependant qu’il y mettait de la mauvaise volonté ou de l’entêtement. Il
faisait avec docilité ce qu’on lui ordonnait, portait l’eau, fendait le bois, travaillait aux champs, nettoyait la cuisine : bref, il rendait consciencieusement, bien qu’avec une lenteur
exaspérante, tous les services qu’on lui demandait. Mais ce qui chagrinait surtout le bon curé, c’était l’indifférence totale de son bizarre protégé. Il n’entreprenait rien de son propre chef, ne
posait jamais une question, ne jouait pas avec les garçons de son âge et ne s’occupait jamais spontanément, si on ne lui demandait rien : sitôt sa besogne finie, on voyait Mirko s’asseoir
quelque part dans la chambre, avec cet air absent et vague des moutons au pâturage, sans prendre le moindre intérêt à ce qui se passait autour de lui. Le soir, le curé allumant sa longue pipe
rustique, faisait avec le maréchal des logis ses trois parties d’échecs quotidiennes. L’adolescent approchait alors de la table sa tignasse blonde et fixait en silence l’échiquier, avec des yeux
qu’on croyait endormis et indifférents sous leurs lourdes paupières.
Un soir d’hiver, tandis que les deux partenaires étaient plongés dans leur jeu, on entendit tinter de plus en plus près les clochettes d’un traîneau qui
glissait à fond de train dans la rue. Un paysan, la casquette blanche de neige, entra précipitamment, demandant au prêtre s’il pouvait venir sur-le-champ administrer l’extrême-onction à sa
vieille mère qui se mourait. Le curé le suivit sans tarder. Le maréchal des logis, qui n’avait pas encore vidé son verre de bière, ralluma encore une dernière pipe et se mit en devoir de renfiler
ses lourdes bottes pour s’en aller, lorsqu’il s’aperçut tout à coup que le regard de Mirko restait obstinément fixé sur l’échiquier et la partie commencée.
« Eh bien ! veux-tu la finir ? » dit-il en plaisantant, car il était persuadé que le jeune endormi ne saurait pas déplacer un seul
pion correctement sur l’échiquier. Le garçon leva timidement la tête, fit signe que oui, et s’assit à la place du curé. En quatorze coups, voilà le maréchal des logis battu et en plus, obligé de
reconnaître qu’il ne devait pas sa défaite à une négligence de sa part. La seconde partie tourna de même.
« Mais c’est l’âne de Balaam ! » s’écria l’ecclésiastique stupéfait, lorsqu’il rentra. Et il expliqua au maréchal des logis, moins versé
que lui dans les Écritures, comment, deux mille ans auparavant, semblable miracle s’était produit, une créature muette ayant soudain prononcé des paroles pleines de sagesse. Malgré l’heure
avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable, et ne relevait jamais son large front,
penché sur l’échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable : ni le maréchal des logis ni le curé ne parvinrent, les jours suivants, à gagner une seule partie contre lui. Le
prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d’autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus
sérieux. Il conduisit Mirko chez le barbier du village, fit tailler sa tignasse couleur de paille, pour le rendre plus présentable : après quoi, il l’emmena en traîneau à la petite ville
voisine. Il connaissait là quelques joueurs d’échecs enragés, plus forts que lui, et toujours attablés dans un coin du café de la Grand-Place. Quand le curé entra, poussant devant lui ce garçon
de quinze ans aux cheveux blonds, aux joues rouges, les épaules couvertes d’une peau de mouton retournée et chaussé de grosses bottes lourdes, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune gars
resta planté là, le regard timidement baissé, jusqu’à ce qu’on l’appelât à l’une des tables d’échecs. Il perdit la première partie, n’ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu’on
appelle l’ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société, et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous l’un après
l’autre....."

Le monde d'hier, Souvenirs d'un Européen - autobiographie, 1948
(Die Welt von Gestern - Erinnerungen eines Europäers)
Zweig écrit depuis son exil au Brésil en 1941-42, au moment où l’Europe est en ruine et où son propre monde a disparu. Ce n’est pas une autobiographie narcissique : il insiste dès la préface qu’il raconte moins sa propre vie que “celle de sa génération”. Et il se positionne en “Européen” plus qu’en Autrichien ou en Juif, affirmant une identité transnationale au moment où l’Europe est déchirée. Il s'agit bien d'une tentative de résister à l’oubli, de laisser un témoignage avant que tout ne s’efface dans la guerre. Le livre est publié à titre posthume (Zweig s’est suicidé quelques jours après avoir achevé le manuscrit). Il est immédiatement lu comme une épitaphe pour l’Europe d’avant la Seconde Guerre mondiale.Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands témoignages sur le “long XIXᵉ siècle” et sa destruction au XXᵉ siècle. Et quand Zweig décrit la montée des nationalismes, l’illusion de sécurité, la passivité des élites culturelles, ou la perte des repères face aux crises, ces thèmes résonnent fortement aujourd’hui....
(Préface) - "... Le monde dans lequel j’ai grandi, et celui d’aujourd’hui, et ceux qui s’insèrent entre eux, se séparent de plus en plus, dans mon sentiment, en autant de mondes totalement distincts ; chaque fois qu’au cours d’une conversation je rapporte à des amis plus jeunes des épisodes de l’époque antérieure à la Première Guerre, je remarque à leurs questions étonnées combien ce qui est encore pour moi la plus évidente des réalités est devenu pour eux de l’histoire, ou combien il leur est impossible de se le représenter. Et un secret instinct en moi leur donne raison : entre notre aujourd’hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts sont rompus. Moi-même, je ne puis m’empêcher de m’étonner de l’abondance, de la variété que nous avons condensées dans l’étroit espace d’une seule existence — à la vérité fort précaire et dangereuse, surtout quand je la compare avec le genre de vie de nos devanciers.
Mon père, mon grand-père, qu’ont-ils vu ? Ils vivaient leur vie tout unie dans sa forme. Une seule et même vie du commencement à la fin, sans élévations, sans chutes, sans ébranlements et sans périls, une vie qui ne connaissait que de légères tensions, des transitions insensibles. D’un rythme égal, paisible et nonchalant, le flot du temps les portait du berceau à la tombe. Ils vivaient sans changer de pays, sans changer de ville, et même presque toujours sans changer de maison ; les événements du monde extérieur ne se produisaient à vrai dire que dans le journal et ne venaient pas frapper à la porte de leur chambre. De leur temps, il y avait bien quelque guerre quelque part, mais ce n’était jamais qu’une petite guerre, rapportée aux dimensions de celles d’aujourd’hui, et elle se déroulait loin à la frontière, on n’entendait pas les canons, et au bout de six mois elle était éteinte, oubliée, elle n’était plus qu’une page d’histoire pareille à une feuille desséchée, et l’ancienne vie reprenait, toujours la même.
Nous, en revanche, nous avons tout vécu sans retour, rien ne subsistait d’autrefois, rien ne revenait ; il nous a été réservé de participer au plus haut point à une masse d’événements que l’histoire, d’ordinaire, distribue à chaque fois avec parcimonie à tel pays, à tel siècle. Au pis aller, une génération traversait une révolution, la deuxième un putsch, la troisième une guerre, la quatrième une famine, la cinquième une banqueroute de l’État — et bien des peuples bénis, bien des générations bénies, rien même de tout cela. Mais nous, qui à soixante ans pourrions légitimement avoir encore un peu de temps devant nous, que n’avons-nous pas vu, pas souffert, pas vécu ? Nous avons étudié à fond et d’un bout à l’autre le catalogue de toutes les catastrophes imaginables (et nous n’en sommes pas encore à la dernière page).
A moi seul, j’ai été le contemporain des deux plus grandes guerres qu’ait connues l’humanité, et je les ai même vécues sur deux fronts différents : la première sur le front allemand, la seconde sur le front opposé. J’ai vécu dans l’avant-guerre la forme et le degré les plus élevés de la liberté individuelle et, depuis, le pire état d’abaissement qu’elle eût subi depuis des siècles, j’ai été fêté et proscrit, j’ai été libre et asservi, riche et pauvre. Tous les chevaux livides de l’Apocalypse se sont rués à travers mon existence : révolution et famine, dévalorisation de la monnaie et terreur, épidémies et émigration ; j’ai vu croître et se répandre sous mes yeux les grandes idéologies de masse, fascisme en Italie, national-socialisme en Allemagne, bolchevisme en Russie, et avant tout cette plaie des plaies, le nationalisme, qui a empoisonné la fleur de notre culture européenne. Il m’a fallu être le témoin sans défense et impuissant de cette inimaginable rechute de l’humanité dans un état de barbarie qu’on croyait depuis longtemps oublié, avec son dogme antihumaniste consciemment érigé en programme d’action. Il nous était réservé de revoir après des siècles des guerres sans déclaration de guerre, des camps de concentration, des tortures, des spoliations massives et des bombardements de villes sans défense, tous actes de bestialité que les cinquante dernières générations n’avaient plus connus et que les futures, espérons-le, ne souffriront plus. Mais, paradoxalement, dans ce même temps, alors que notre monde régressait brutalement d’un millénaire dans le domaine de la moralité, j’ai vu cette même humanité s’élever dans les domaines de l’intelligence et de la technique à des prodiges inouïs, dépassant d’un coup d’aile tout ce qu’elle avait accompli en des millions d’années : la conquête de l’éther par l’avion, la transmission à la seconde même de la parole terrestre sur toute la surface de notre globe et, de ce fait, la domination de tout notre espace, la fission de l’atome, la victoire remportée sur les maladies les plus insidieuses, la réalisation presque journalière de nouveaux exploits qui semblaient hier encore impossibles. Jamais jusqu’à notre époque l’humanité dans son ensemble ne s’est révélée plus diabolique par son comportement et n’a accompli tant de miracles qui l’égalent à la divinité.
Il me paraît de mon devoir de rendre témoignage de cette vie tendue, dramatique, riche en surprises qui aura été la nôtre car, je le répète, chacun a été témoin de ces prodigieuses transformations, chacun a été forcé d’être témoin.
Pour notre génération, il n’y avait point d’évasion possible, point de mise en retrait : grâce au synchronisme universel de notre nouvelle organisation, nous étions constamment engagés dans notre époque. Quand les bombes réduisaient les maisons en miettes à Shanghai, nous le savions en Europe, dans nos chambres, avant que les blessés eussent été retirés des décombres. Ce qui se passait à un millier de milles au-delà des mers bondissait jusqu’à nous en images animées. Il n’y avait point de protection, point de sûreté contre cette information et cette participation permanentes. Il n’y avait point de pays où l’on pût se réfugier, point de solitude silencieuse que l’on pût acheter ; toujours et partout, la main du destin se saisissait de nous pour nous entraîner de nouveau dans son jeu insatiable.
On était constamment tenu de se soumettre aux exigences de l’État, de se livrer en proie à la plus stupide politique, de s’adapter aux changements les plus fantastiques, on était toujours enchaîné irrésistiblement. Quiconque a traversé cette époque ou, pour mieux dire, y a été chassé et traqué — nous avons eu peu de répit — a vécu plus d’histoire qu’aucun de ses ancêtres. Aujourd’hui encore, nous nous trouvons une fois de plus face à un tournant, à une conclusion et à un nouveau début. Ce n’est donc absolument pas sans dessein que j’arrête à une date précise ce regard rétrospectif sur ma vie. Car cette journée de septembre 1939 met un point final à l’époque qui a formé et instruit les sexagénaires dont je suis. Mais si, par notre témoignage, nous transmettons à la génération qui vient ne serait-ce qu’une parcelle de vérité, vestige de cet édifice effondré, nous n’aurons pas œuvré tout à fait en vain.
Je suis conscient des conditions défavorables, mais très caractéristiques de notre époque, dans lesquelles j’entreprends de donner forme à mes souvenirs. Je les rédige en pleine guerre, je les rédige à l’étranger sans la moindre pièce d’archives qui puisse secourir ma mémoire. Je ne dispose dans ma chambre d’hôtel ni d’un exemplaire de mes livres, ni d’une note, ni d’une lettre d’ami. Nulle part je ne puis me procurer de renseignements, car dans le monde entier les relations postales de pays à pays sont rompues ou entravées par la censure. Nous vivons aussi isolés les uns des autres qu’il y a des centaines d’années ..."
La table des matières du livre, telle qu’on la trouve dans l’édition allemande (par ex. l’édition originale Bermann-Fischer, Stockholm, 1942, ou les rééditions chez Fischer Verlag), compte les 16 chapitres suivants ...
- "Die Welt der Sicherheit" — Le monde de la sécurité
Zweig décrit l’Autriche-Hongrie avant la Première Guerre mondiale comme une époque de certitudes : stabilité politique, monnaie fiable, ordre social fort, vie bourgeoise sécurisée. On savait ce que serait le futur, on campait sur des positions stables. Il raconte la condition de sa famille, surtout son père, et comment leur existence s’inscrit dans cette “monde de sécurité” : épargne, prudence, valeurs conservatrices de la classe moyenne juive de l’Empire.
C'est bien le pilier fondateur de tout le livre. Zweig y décrit l'univers de sa jeunesse, l'Autriche-Hongrie de la fin du XIXe siècle, caractérisée par une foi inébranlable dans le progrès, l'ordre et la stabilité. Ce chapitre crée le contraste absolu avec tout ce qui va suivre. En peignant cet "Âge d'or" idéalisé, Zweig donne toute sa mesure à l'effondrement traumatique que va vivre sa génération. Sans lui, on ne comprendrait pas la profondeur de la perte.
- "Die Schule im vorigen Jahrhundert" — L’école au siècle passé
Zweig évoque l’éducation à Vienne dans les dernières années de l’Empire : discipline stricte, respect de l’autorité, enseignement classique, mais aussi l’éveil aux idées nouvelles malgré les contraintes. Il parle du contraste entre la rigueur scolaire et la pousse d’intérêt pour la littérature, la philosophie, la poésie chez les jeunes. Le sentiment d’une jeunesse qui commence à aspirer à autre chose que la conformité.
C'est dans ce chapitre que Zweig évoque son travail de jeune collaborateur sous la direction de Herzl et décrit l'impact de sa mort et de ses funérailles, un événement fondateur pour sa conscience juive.
- "Eros Matutinus" — L’éveil érotique
Ce chapitre est centré sur la jeunesse, ses désirs, ses émotions naissantes, la curiosité érotique. Zweig se souvient de l’éveil sexuel, des idéaux, des tourments des jeunes garçons et filles, des craintes, de la morale de l’époque, de ce qui était dit ou non. C’est l’époque de la découverte de soi, des émotions intenses, avant que le monde ne soit secoué.
- "Universitas vitae" — Université de la vie
Ici, Zweig compare l’école et l’université à ce qu’il appelle “l’univers de la vie” : les sciences, les lettres, les voyages, les rencontres, les voyages intellectuels. Ce n’est pas seulement le lieu formel d’étude, mais l’ensemble d’expériences qui forment, encouragent l’indépendance d’esprit. Il parle de ses premiers succès littéraires, de la publication de ses poèmes, de son émergence en tant qu’écrivain.
- "Paris, die Stadt der ewigen Jugend" — Paris, la ville de la jeunesse éternelle
Zweig raconte ses voyages à Paris, la fascination qu’il éprouve pour cette ville cosmopolite, ses cafés, ses salons littéraires, l’art, l’effervescence intellectuelle et artistique. C’est pour lui un lieu d’inspiration, mais aussi un miroir contrasté avec Vienne : plus ouvert, plus vivant, plus moderne, plus expérimental. Il compare les vivacités de Paris à la sécurité et la tradition de sa patrie.
- "Umwege auf dem Wege zu mir selbst" — Détours sur le chemin vers moi‐même
Des chemins détournés : Zweig évoque les échecs, les hésitations, les changements de direction dans sa vocation littéraire. Il raconte comment il a dû s’orienter, tâtonner entre traductions, écriture, rencontres, doutes intérieurs. Ce chapitre marque une période de maturation, de cheminement personnel, d’affirmation progressive de son identité d’écrivain.
- "Über Europa hinaus" — Au-delà de l’Europe
Zweig lie ses propres voyages et son rayonnement international : la reconnaissance hors des frontières, les rencontres avec des auteurs étrangers, participation à la vie intellectuelle européenne. Il réfléchit sur l’identité européenne, sur ce que cela signifie d’être citoyen culturel du continent. Toutefois, il évoque aussi le contraste entre les horizons qu’il imaginait et la réalité des divisions grandissantes.
- "Glanz und Schatten über Europa" — Lumières et ombres sur l’Europe
Ce chapitre montre l’Europe sous deux facettes : d’un côté, les grandes avancées culturelles, artistiques, sociales, la paix qui semblait possible, le rayonnement intellectuel, les idéaux de progrès ; de l’autre, les tensions montantes, les nationalismes, les crises, les prémonitions de guerre, les conflits latents. C’est une sorte de bilan avant la catastrophe : ce que l’Europe a de beau, mais aussi ce qui la menace.
- "Die ersten Stunden des Krieges von 1914" — Les premières heures de la guerre de 1914
Zweig raconte le déclenchement de la Première Guerre mondiale : les nouvelles, les réactions, les espoirs et la confusion. Il décrit l’effet sur la population, sur lui-même, sur ses amis, l’irruption de l’absurde dans la vie quotidienne. Le bouleversement brutal d’une époque qui avait cru à la permanence de l'ordre. Mais aussi le changement d'état d'esprit de la population, ivre d'un enthousiasme patriotique et guerrier qu'il trouve lui-même effrayant. C'est la fin concrète du "Monde de la sécurité".
"... Peu à peu, au cours de ces premières années de la guerre de 1914, il devint impossible d’échanger avec quiconque une parole raisonnable. Les plus pacifiques, les plus débonnaires, étaient enivrés par les vapeurs de sang. Des amis que j’avais toujours connus comme des individualistes déterminés, voire comme des anarchistes intellectuels, s’étaient transformés du jour au lendemain en patriotes fanatiques, et de patriotes en annexionnistes insatiables. Toutes les conversations se terminaient par des phrases aussi sottes que celle-ci : « Qui ne sait haïr ne sait pas non plus aimer vraiment », ou encore par de grossières accusations. Des camarades avec qui je n’avais jamais eu de querelle depuis des années m’accusaient avec la dernière rudesse de n’être plus un Autrichien ; je n’avais qu’à aller là-bas, en France ou en Belgique. Ils insinuaient même prudemment que l’on devrait en fait dénoncer aux autorités des opinions comme celle que cette guerre était un crime, car les « défaitistes » — ce beau mot venait d’être inventé en France — étaient les pires criminels envers la patrie.
Il ne restait dès lors qu’une chose à faire : se replier sur soi-même et se taire aussi longtemps que dureraient la fièvre et le délire des autres. Cela n’était pas facile. Car même vivre en exil — je l’ai éprouvé surabondamment — n’est pas si terrible que d’être seul dans sa patrie. A Vienne, je m’étais aliéné mes anciens amis, ce n’était pas le moment d’en chercher de nouveaux...."
- "Der Kampf um die geistige Brüderschaft" — Le combat pour la fraternité intellectuelle
Pendant la guerre, Zweig observe comment la communauté des intellectuels tente de maintenir des liens : échanges, correspondances, efforts pour préserver l’esprit pacifique. Il évoque l’amitié avec des auteurs étrangers, une solidarité morale, mais aussi la difficulté de tenir face aux propagandes, à la haine, à la division. C’est le chapitre où la culture comme résistance apparaît.
"... Car ce qui distinguait heureusement la Première Guerre de la Seconde, c’est qu’alors la parole avait encore du pouvoir. Elle n’avait pas encore été entraînée dans une chevauchée de la mort par le mensonge organisé, par la « propagande ». Les hommes étaient encore attentifs à la parole écrite, ils l’attendaient. Tandis qu’en 1939 pas une seule déclaration d’écrivain ne produisit le moindre effet soit en bien, soit en mal, tandis que jusqu’à présent aucun livre, aucune brochure, aucun article, aucun poème n’a touché le cœur des masses ou n’a influencé leur pensée, en 1914, un sonnet, comme ce « Chant de haine », de Lissauer, une manifestation insensée comme celle des « Quatre-vingt-treize intellectuels allemands », et de l’autre côté un essai de huit pages comme cet Au-dessus de la mêlée, de Rolland, un roman comme Le Feu, de Barbusse, faisaient figure d’événements. La conscience morale du monde n’était pas encore harassée et lessivée comme aujourd’hui, elle réagissait avec véhémence à chaque mensonge manifeste, à chaque outrage au droit des gens et à l’humanité, avec toute la force d’une conviction plusieurs fois centenaire. Une violation du droit comme l’invasion par l’Allemagne de la Belgique neutre, qui, aujourd’hui que Hitler a fait du mensonge une chose qui va de soi et a élevé l’inhumanité à la dignité d’une loi, ne saurait plus guère être blâmée, avait alors le pouvoir de susciter l’émotion d’un bout à l’autre du monde...."
- "Im Herzen Europas" — Au cœur de l’Europe
Zweig parle de ses œuvres pendant la guerre et leurs effets dans différents milieux européens. Il évoque Jeremias, son drame, et comment il fut accueilli dans divers pays, malgré la guerre, malgré les préjugés. Il montre aussi comment la guerre affaiblit les idéaux européens, comment elle provoque l’usure morale, la désillusion parmi ceux qui croyaient à une Europe des lettres.
- "Heimkehr nach Österreich" — Retour en Autriche
Après la guerre, Zweig revient en Autriche. Il décrit le retour, les changements — sociaux, politiques, économiques — dans son pays natal. L’effondrement de l’Empire, les nouvelles frontières, l’inflation, la perte d’illusion. Il raconte ce que c’est que de revenir dans une patrie transformée, de retrouver des souvenirs, des lieux, des gens, dans un contexte nouveau.
- "Wieder in der Welt" — De nouveau dans le monde
Ce chapitre retrace les premières “années du retour” après les crises : les années d’après‐guerre, l’instauration de nouvelles formes de vie, le tentatif de remise en route, de relance culturelle, intellectuelle, sociale. Zweig évoque les difficultés matérielles, les rancœurs, mais aussi les espoirs, les rencontres, les voyages retrouvés.
- "Sonnenuntergang" — Crépuscule
Entre 1924 et 1933, la période est plus stable, plus sereine. Zweig raconte ce “décennie d’or” relatif, où il voyage beaucoup, assiste à maintes expositions, lit, écrit, mais toujours avec une menace sous‐jacente. Le calme avant la tempête : l’esprit d’Europe est de plus en plus instable, malgré les apparences de liberté. Zweig ressent la nostalgie de ses voyages de jeunesse et compare comment les voyages ont changé.
- "Incipit Hitler"— “Hitler commence”
Zweig décrit l’ascension des nazis, ses premières manifestations, les effets dans les arts, la culture, l’intimidation. Il évoque des épisodes tels que la censure, les attaques contre artistes, son inquiétude croissante. Il prend conscience que le monde d’hier est menacé non seulement extérieurement mais de l’intérieur, par l’intolérance, le totalitarisme.
Ce chapitre est le point de pivot du livre vers la tragédie finale. Zweig n'y raconte pas la vie d'Hitler, mais analyse l'impact de son arrivée au pouvoir sur la société et sur la condition individuelle. Il décrit la terreur qui s'installe progressivement, la destruction des consciences et la mise au pas de toute une nation. C'est une plongée dans la mécanique totalitaire.
"... nous n’étions toujours pas conscients du danger. Le petit nombre des écrivains qui s’étaient vraiment donné la peine de lire le livre de Hitler, au lieu de s’occuper sérieusement de son programme, raillaient l’enflure de sa méchante prose. Les grands journaux démocratiques, au lieu de mettre en garde leurs lecteurs, les rassuraient quotidiennement : ce mouvement, qui en vérité ne finançait qu’à grand-peine son énorme agitation avec les fonds de l’industrie lourde et en s’enfonçant jusqu’au cou dans les dettes, devait inévitablement s’effondrer de lui-même le lendemain ou le surlendemain. Mais peut-être n’a-t-on jamais bien compris, à l’étranger, la raison pour laquelle l’Allemagne a, à tel point, durant ces années, sous-estimé et minimisé la personne et la puissance croissante de Hitler : l’Allemagne n’a pas seulement toujours été un Etat formé de classes séparées : avec cet idéal de classes, elle a toujours été affectée d’une surestimation et d’une déification inébranlables de la « culture ». A l’exception de quelques généraux, toutes les hautes charges de l’État demeuraient exclusivement réservées à ceux qui avaient une « culture universitaire » ; tandis qu’en Angleterre un Lloyd George, en Italie un Garibaldi et un Mussolini, en France un Briand étaient vraiment sortis du peuple pour s’élever aux plus hautes fonctions publiques, en Allemagne on ne pouvait concevoir qu’un homme qui n’avait pas même achevé ses études primaires et qui, à plus forte raison, n’avait pas fréquenté l’université, qui avait couché dans des asiles de nuit et, pendant des années, gagné sa vie par des moyens aujourd’hui encore demeuré obscurs, pût jamais approcher seulement une place qu’avaient occupée un baron vom Stein, un Bismarck, un prince von Bülow. Rien n’a autant aveuglé les intellectuels allemands que l’orgueil de leur culture, en les engageant à ne voir en Hitler que l’agitateur des brasseries qui ne pourrait jamais constituer un danger sérieux, alors que depuis longtemps, grâce à ses invisibles tireurs de ficelles, il s’était déjà fait des complices puissants dans les milieux les plus divers. Et même quand, en ce jour de janvier 1933, il fut devenu chancelier, la grande masse et même ceux qui l’avaient poussé à ce poste le considérèrent comme un simple intérimaire et le gouvernement national-socialiste comme un simple épisode...."
- "Die Agonie des Friedens" — L’agonie de la paix
C’est le dernier chapitre. Zweig parle des dernières années, de l’exil, du sentiment d’impuissance. Même quand la paix semble revenue, elle est fragile, instable. Il décrit la perte progressive de droits, de libertés, le harcèlement, la peur, l’exil, le déracinement. La paix est agonisante parce que les certitudes ont disparu, les structures rassurantes se disloquent, et que l’ombre de la guerre prochaine plane déjà.
Le cœur de la démonstration de Zweig sur l'aveuglement des démocraties. Il y décrit les années 1930, où Hitler teste et défie les autres puissances européennes, qui, par peur ou incompréhension, cèdent toujours plus, sacrifiant la paix par lâcheté ou calculs politiques shorts. C'est une analyse prophétique de l'engrenage qui mène inéluctablement à la guerre.
