- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille - Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Lewin - Mayo - Maslow
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), "Voyage au bout de la nuit" (1932), "Mort à crédit" (1936), "Bagatelles pour un massacre" (1937), "Les Beaux Draps" (1941), "Féérie pour une autre fois" (1952), "Normance" (1954), "D'un château à l'autre" (1957), - ...
Last update: 11/11/2016

Littérature française des années 30
La France dans les années 1930 traverse une période difficile de transition. Elle est affectée, vers 1931, par la crise économique mondiale. Une période d'agitation intellectuelle s'empare des esprits, à la base de la création de nombreuses ligues d'extrême droite lors des deux Cartels des gauches. La menace fasciste contribue à la création d’une stratégie d’union de la gauche pour la reconquête du pouvoir. Le Front Populaire, qui rassemble une large coalition de radicaux, socialistes et communistes soutenus par les syndicats de gauche voit le jour en juillet 1935. Mais dès 1938, au moment où Hitler annexe l’Autriche, le front populaire n’existe plus. Après l’enthousiasme des "années folles", le roman des années trente revient vers les préoccupations de l’époque : Saint-Exupéry publie "Vol de Nuit" (1931), qui illustre les progrès de l’aviation, Malraux publie "La Condition humaine" (1933), une chronique de la révolution de 1927 à Shanghai, et s’inspire de la guerre d’Espagne (L’Espoir, 1937). Une littérature du désespoir apparaît, qui annonce l’existentialisme de l’après-guerre, et qui atteint un paroxysme avec les romans de Céline, "Voyage au bout de la nuit" (1932) et "Mort à crédit" (1936). Bernanos, malgré son passé d’homme de droite, prend le parti des révolutionnaires de la guerre civile en Espagne; Brasillach et Drieu la Rochelle optent quant à eux pour les fascismes. "L'imbécile, écrira Bernanos, est d'abord un être d'habitude et de parti pris. Arraché à son milieu il garde, entre ses deux valves étroitement closes, l'eau du lagon qui l'a nourri. Mais la vie moderne ne transporte pas seulement les imbéciles d'un lieu à un autre, elle les brasse avec une sorte de fureur...", ce brassage existentiel caractérise bien toute la singularité de ces années 1930..
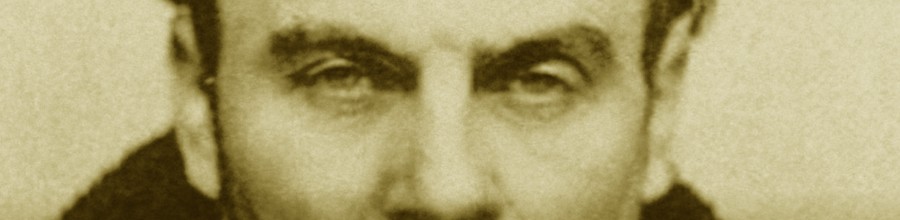
"Une haine immense me tient en vie", écrira Céline, il écrivit "les tripes à l'air', a-t-on dit, épopée du dégoût plus que de la révolte, il en était semble-t-il conscient, "ils ont l'air de rien les mots, on se méfie pas d'eux", et pourtant ... - Céline (1894-1961) de son vrai nom Louis-Ferdinand Destouches est à sa manière un aventurier qui après avoir tâté de divers métiers modestes, après avoir participé à la guerre de 1914, après avoir parcouru l'Afrique, trouve le moyen de faire des études de médecine et de s'installer comme praticien dans la banlieue parisienne. A cette personnalité d'exception va correspondre une œuvre d'exception elle aussi, dont le coup d'essai est un coup de maître : "Le Voyage au bout de la nuit" (1932). Rompant violemment avec la rhétorique blafarde de son époque, Céline donne ses lettres de noblesse à l'injure, au cri, et dans une invention toujours renouvelée, fait subir aux mots du langage commun de telles violences inattendues qu'on peut estimer qu'il a créé un nouveau style dont le paroxysme est le trait le plus frappant. Des qualités qui seront précieuses au polémiste engagé de "Mort à crédit" (1936), "Bagatelle pour un massacre" (1938), "Les Beaux draps" (1940). A la Libération on lui reprochera vivement, et avec raison, un antisémitisme détestable (il fut même emprisonné). De nos jours, la critique moderne s'intéresse à l'écriture si originale de ses œuvres ...

Louis-Ferdinand Céline (1894-1961)
La personnalité de Céline comme son oeuvre, en grande partie autobiographique, suscitèrent admirations et controverses passionnées : la crudité de son style, à l'image de son absence de toute soumission aux conventions littéraires ou sociales, traduit sa volonté de restituer le plus fidèlement possible ce qu'il appelle la charge émotive déposée en lui par la vie....
Louis-Ferdinand Destouches est né à Coubevoie en 1894. Il commence sa vie en multipliant les petits métiers, avant de se porter volontaire en 1914. Grièvement blessé dès la première année du conflit, il quitte le front. Entre 1919 et 1923, il fait des études de médecine puis entre au service d'hygiène de la Société des Nations et accomplit plusieurs voyages. Il s'installe en région parisienne en 1927, et commence à écrire. Il publie, en 1932, "Voyage au bout de la nuit", puis "L'Église" en 1933, et "Mort à crédit" trois ans plus tard: il y renouvelle complètement l’écriture romanesque en supprimant toute frontière entre l’écrit et l’oral; le roman a pour intention de recréer l’intensité de l’émotion. Violemment anticommuniste et antisémite, il publie des pamphlets orduriers comme Bagatelles pour un massacre en 1937, et l'École des cadavres l'année suivante. Il collabore activement durant la guerre, puis inquiété à la Libération, il part en 1944 pour l'Allemagne, puis le Danemark où il est emprisonné l'année suivante. Jusqu'en 1951, année où il est amnistié, ses engagements politiques lui valent de nombreux démêlés avec la justice.

1932 – Voyage au bout de la nuit
C'est un de ces livres qui s'impose d'emblée et qui fait date dans l'histoire de la littérature. Le livre décontenança tous les critiques. Le
scandale qu'il provoqua lors de sa publication tenait d'abord à ce que Céline s`y créait un style fondé sur le français oral et populaire que la littérature française avait pendant trois siècles
pratiquement ignoré. Et qui plus est, il mettait cette langue au service d'une vigoureuse dénonciation sociale qui en tirait une force inédite, et il en usait même pour une interrogation
métaphysique sur l`homme et la condition humaine. La première cible de la dénonciation est la guerre, en l'occurrence la guerre de 14. Louis-Ferdinand Destouches a participé à la Première Guerre
mondiale. Celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde et sa folie, allant même jusqu'à la qualifier « d'abattoir international en folie ». Il expose ainsi ce qui est pour lui la seule façon
raisonnable de résister à une telle folie : la lâcheté. Ferdinand Bardamu est un personnage romanesque d’un type nouveau, le "héros" n'est qu'un lâche haineux qui, en traversant la guerre,
l'Afrique coloniale, l'Amérique des financiers et du taylorisme, la banlieue parisienne, n'y voit qu'un vaste "merdier", un "dispensaire nauséabond", une société à l'envers où chacun exploite,
maltraite, prostitue, assassine autrui. Le réel n'est plus corps, gestes, attitudes, cris, violence, et ne peut être exprimé que par un langage cru, obscène, brutal. Tous les beaux discours
ont pour Céline dissimuler ou justifier les pires atrocité en ce monde, et les mots manquent et bafouillent lorsqu'on tente d'évoquer la plus crue des réalités qu'est la mort..
"Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un
camarade. On se rencontre donc place Clichy. C’était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. « Restons pas dehors ! qu’il me dit. Rentrons ! » Je rentre avec lui. Voilà. « Cette
terrasse, qu’il commence, c’est pour les oeufs à la coque ! Viens par ici ! » Alors, on remarque encore qu’il n’y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur ; pas de voitures, rien.
Quand il fait très froid, non plus, il n’y a personne dans les rues ; c’est lui, même que je m’en souviens, qui m’avait dit à ce propos : « Les gens de Paris ont l’air toujours d’être occupés,
mais en fait, ils se promènent du matin au soir ; la preuve, c’est que, lorsqu’il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus ; ils sont tous dedans à prendre des
cafés crème et des bocks. C’est ainsi ! Siècle de vitesse ! qu’ils disent. Où ça ? Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et
c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés ! Deux ou trois par-ci, par-là, des petits… » Bien fiers alors d’avoir fait
sonner ces vérités utiles, on est demeurés là assis, ravis, à regarder les dames du café.
Après, la conversation est revenue sur le Président Poincaré qui s’en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens ; et
puis, de fil en aiguille, sur le Temps où c’était écrit. « Tiens, voilà un maître journal, le Temps ! » qu’il me taquine Arthur Ganate, à ce propos. « Y en a pas deux comme lui pour défendre la
race française ! – Elle en a bien besoin la race française, vu qu’elle n’existe pas ! » que j’ai répondu moi pour montrer que j’étais documenté, et du tac au tac.
« Si donc ! qu’il y en a une ! Et une belle de race ! qu’il insistait lui, et même que c’est la plus belle race du monde et bien cocu qui s’en dédit ! »
Et puis, le voilà parti à m’engueuler. J’ai tenu ferme bien entendu.
« C’est pas vrai ! La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont
échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis
c’est ça les Français.
– Bardamu, qu’il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n’en dis pas de mal !…
– T’as raison, Arthur, pour ça t’as raison ! Haineux et dociles, violés, volés, étripés et couillons toujours, ils nous valaient bien ! Tu peux le dire
! Nous ne changeons pas ! Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d’opinions, ou bien si tard, que ça n’en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève nous autres ! Soldats gratuits, héros
pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du Roi Misère. C’est lui qui nous possède ! Quand on est pas sages, il serre… On a ses doigts autour du cou,
toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger… Pour des riens, il vous étrangle… C’est pas une vie…
– Il y a l’amour, Bardamu !
– Arthur, l’amour c’est l’infini mis à la portée des caniches et j’ai ma dignité moi ! que je lui réponds.
– Parlons-en de toi ! T’es un anarchiste et puis voilà tout ! »
Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d’ici, et tout ce qu’il y avait d’avancé dans les opinions.
« Tu l’as dit, bouffi, que je suis anarchiste ! Et la preuve la meilleure, c’est que j’ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu
vas me dire tout de suite des nouvelles : LES AILES EN OR ! C’est le titre !… » Et je lui récite alors :
Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout,
le ventre en l’air, prêt aux caresses, c’est lui, c’est notre maître. Embrassons-nous !
« Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j’en suis, moi, pour l’ordre établi et je n’aime pas la politique. Et d’ailleurs le jour où la patrie me
demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera moi bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. » Voilà ce qu’il m’a répondu.
Justement la guerre approchait de nous deux sans qu’on s’en soye rendu compte et je n’avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion
m’avait fatigué. Et puis, j’étais ému aussi parce que le garçon m’avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était
du même avis sur presque tout.
« C’est vrai, t’as raison en somme, que j’ai convenu, conciliant, mais enfin on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu
peux pas venir me dire le contraire !… Assis sur des clous même à tirer tout nous autres ! Et qu’est-ce qu’on en a ? Rien ! Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des
vacheries encore. On travaille ! qu’ils disent. C’est ça encore qu’est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puants, suintants des
rouspignolles, et puis voilà ! En haut sur le pont, au frais, il y a les maîtres et qui s’en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfums sur les genoux. On nous fait monter sur
le pont. Alors, ils mettent leurs chapeaux haut de forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça : “Bandes de charognes, c’est la guerre ! qu’ils font. On va les aborder,
les saligauds qui sont sur la patrie n° 2 et on va leur faire sauter la caisse ! Allez ! Allez ! Y a de tout ce qu’il faut à bord ! Tous en choeur ! Gueulez voir d’abord un bon coup et que ça
tremble : Vive la Patrie n° 1 ! Qu’on vous entende de loin ! Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus ! Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever
sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre où c’est fait bien plus vite encore qu’ici !”
– C’est tout à fait comme ça ! » que m’approuva Arthur, décidément devenu facile à convaincre.
Mais voilà-t-y pas que juste devant le café où nous étions attablés un régiment se met à passer, et avec le colonel par-devant sur son cheval, et même
qu’il avait l’air bien gentil et richement gaillard, le colonel ! Moi, je ne fis qu’un bond d’enthousiasme...."

Le personnage narrateur, Bardamu, est donc engagé par surprise, et il y découvre d'un seul coup l`horreur de la tuerie et la guerre interne que la hiérarchie militaire livre contre les sans-grade qu`elle envoie à la mort. Bardamu s`en tire grâce à une blessure, mais, soigné dans divers hôpitaux de la région parisienne. il y trouve le même antagonisme entre civils profitant de la guerre de mille manières et combattants réduits à l'état de chair à canon. Même les médecins ici, démentant leur vocation. se retrouvent auxiliaires de la mort. Le français populaire de Bardamu fait à chaque page justice de la rhétorique patriotique qui ici est dans toutes les bouches.
Bardamu réformé croit bien faire en fuyant loin du théâtre des opérations, en Afrique, dans la colonie de la Bambola-Bragamance. Il s`engage comme gérant d`un comptoir commercial situé en pleine forêt tropicale. Mais le voyage en bateau sur l'Amiral-Bragueton, puis son séjour à Fort-Gono ont tôt fait de lui montrer que, sous d`autres formes. la guerre se poursuit là, comme il la retrouvera aussi bien dans d'autres étapes de ses pérégrinations. Partout les privilégiés exploitent les autres. De ce point de vue, la colonie offre le spectacle instructif d`un monde divisé en castes ou les Blancs, tous également minés par un climat pour lequel leur organisme n`est pas fait, et exploités par les propriétaires parisiens de la Compagnie pordurière ou autres supérieurs, se briment les uns les autres en fonction de la hiérarchie, et maltraitent tous les Noirs qu'ils prétendent civiliser...
" Dans cette colonie de la Bambola-Bragamance, au dessus de tout le monde, triomphait le Gouverneur. Ses militaires et ses fonctionnaires osaient à peine respirer quand il daignait abaisser ses regards jusqu’à leurs personnes.
Bien au-dessous encore de ces notables les commerçants installés semblaient voler et prospérer plus facilement qu’en Europe. Plus une noix de coco, plus une cacahuète, sur tout le territoire, qui échappât à leurs rapines. Les fonctionnaires comprenaient, à mesure qu’ils devenaient plus fatigués et plus malades, qu’on s’était bien foutu d’eux en les faisant venir ici, pour ne leur donner en somme que des galons et des formulaires à remplir et presque pas de pognon avec. Aussi louchaient-ils sur les commerçants. L’élément militaire encore plus abruti que les deux autres bouffait de la gloire coloniale et pour la faire passer beaucoup de quinine avec et des kilomètres de Règlements.
Tout le monde devenait, ça se comprend bien, à force d’attendre que le thermomètre baisse, de plus en plus vache. Et les hostilités particulières et collectives duraient interminables et saugrenues entre les militaires et l’administration, et puis entre cette dernière et les commerçants, et puis encore entre ceux-ci alliés temporaires contre ceux-là, et puis de tous contre le nègre et enfin des nègres entre eux. Ainsi, les rares énergies qui échappaient au paludisme, à la soif, au soleil, se consumaient en haines si mordantes, si insistantes, que beaucoup de colons finissaient par en crever sur place, empoisonnés d’eux-mêmes, comme des scorpions.
Toutefois, cette anarchie bien virulente se trouvait renfermée dans un cadre de police hermétique, comme les crabes dans leur panier. Ils bavaient en vain les fonctionnaires, et le Gouverneur trouvait d’ailleurs à recruter pour maintenir sa colonie en obédience, tous les miliciens miteux dont il avait besoin, autant de nègres endettés que la misère chassait par milliers vers la côte, vaincus du commerce, venus à la recherche d’une soupe. On leur prenait à ces recrues le droit et la façon d’admirer le Gouverneur. Il avait l’air le Gouverneur de promener sur son uniforme tout l’or de ses finances, et avec du soleil dessus c’était à ne pas y croire, sans compter les plumes.
Il s’envoyait Vichy chaque année le Gouverneur et ne lisait que le Journal officiel. Nombre de fonctionnaires avaient vécu dans l’espérance qu’un jour il coucherait avec leur femme, mais le Gouverneur n’aimait pas les femmes. Il n’aimait rien. À travers chaque nouvelle épidémie de fièvre jaune, le Gouverneur survivait comme un charme alors que tant parmi les gens qui désiraient l’enterrer crevaient eux comme des mouches à la première pestilence.
On se souvenait qu’un certain « Quatorze Juillet » alors qu’il passait devant le front des troupes de la Résidence, caracolant au milieu des spahis de sa garde, seul en avant d’un drapeau grand comme ça, certain sergent que la fièvre exaltait sans doute, se jeta au-devant de son cheval pour lui crier : « Arrière grand cocu ! » Il paraît qu’il fut fort affecté le Gouverneur, par cette espèce d’attentat qui demeura d’ailleurs sans explication.
Il est difficile de regarder en conscience les gens et les choses des Tropiques à cause des couleurs qui en émanent. Elles sont en ébullition les couleurs et les choses. Une petite boîte de sardines ouverte en plein midi sur la chaussée projette tant de reflets divers qu’elle prend pour les yeux l’importance d’un accident. Faut faire attention. Il n’y a pas là-bas que les hommes d’hystériques, les choses aussi s’y mettent. La vie ne devient guère tolérable qu’à la tombée de la nuit, mais encore l’obscurité est-elle accaparée presque immédiatement par les moustiques en essaims. Pas un, deux ou cent, mais par billions. S’en tirer dans ces conditions-là devient une œuvre authentique de préservation. Carnaval le jour, écumoire la nuit, la guerre en douce.
Quand la case où l’on se retire et qui a l’air presque propice est enfin devenue silencieuse, les termites viennent entreprendre le bâtiment, occupés qu’ils sont éternellement, les immondes, à vous bouffer les montants de la cabane. Que la tornade arrive alors dans cette dentelle traîtresse et des rues entières seront vaporisées.
La ville de Fort-Gono où j’avais échoué apparaissait ainsi, précaire capitale de la Bragamance, entre mer et forêt, mais garnie, ornée cependant de tout ce qu’il faut de banques, de bordels, de cafés, de terrasses, et même d’un bureau de recrutement, pour en faire une petite métropole, sans oublier le square Faidherbe et le boulevard Bugeaud, pour la promenade, ensemble de bâtisses rutilantes au milieu des rugueuses falaises, farcies de larves et trépignées par des générations de garnisaires et d’administrateurs dératés..."

Parvenu à son comptoir de Bikobimbo, Bardamu peut mesurer toute l'absurdité de cette situation. Il y retrouve inopinément en la personne de son prédécesseur un compatriote qu'il avait déjà rencontré par deux fois dans la guerre. Robinson, qui ne cessera de le hanter partout comme une sorte de double.
Malade, délirant, Bardamu est transporté jusqu'à la côte et embarqué sur ce qui lui paraît être une galère vers le Nouveau Monde qu'il désirait connaitre, La première vision de New-York, "ville debout", l`impressionne. Mais cet eldorado se protège, il n'est pas facile d`y pénétrer. Bardamu doit pour cela s`inventer agent compte-puces au bénéfice des services d`immigration. Les pauvres, aux Etats-Unis ne vivent pas mieux qu'ailleurs. On a inventé pour eux. Bardamu le découvre à l`usine Ford de Detroit, une forme nouvelle d`esclavage qui est le travail à la chaîne. Bardamu ne devra de pouvoir s`y soustraire qu'à la tendresse intelligente d`une prostituée. Molly lui offre pour le reste de sa vie la perspective d`un bonheur tranquille qu`il ne parvient pas à accepter.
Le voici donc de retour à Paris. Le récit passe en quelques lignes sur les années d`études, au terme desquelles Bardamu se retrouve médecin. Installé en banlieue à "Rancy ", il y découvre d`autres formes de la difficulté de vivre...
Marche dans la nuit ...
" J’aurais été content de ne jamais avoir à retourner à Rancy. Depuis ce matin même que j’étais parti de là-bas j’avais presque oublié déjà mes soucis ordinaires ; ils y étaient encore incrustés si fort dans Rancy qu’ils ne me suivaient pas. Ils y seraient peut-être morts mes soucis, à l’abandon, comme Bébert, si je n’étais pas rentré. C’étaient des soucis de banlieue. Cependant vers la rue Bonaparte, la réflexion me revint, la triste. C’est une rue pourtant qui donnerait plutôt du plaisir au passant. Il en est peu d’aussi bienveillantes et gracieuses. Mais, en m’approchant des quais, je devenais tout de même craintif. Je rôdais. Je ne pouvais me résoudre à franchir la Seine. Tout le monde n’est pas César !
De l’autre côté, sur l’autre rive, commençaient mes ennuis. Je me réservai d’attendre ainsi de ce côté gauche jusqu’à la nuit. C’est toujours quelques heures de soleil de gagnées, que je me disais. L’eau venait clapoter à côté des pêcheurs et je me suis assis pour les regarder faire. Vraiment, je n’étais pas pressé du tout moi non plus, pas plus qu’eux. J’étais comme arrivé au moment, à l’âge peut-être, où on sait bien ce qu’on perd à chaque heure qui passe. Mais on n’a pas encore acquis la force de sagesse qu’il faudrait pour s’arrêter pile sur la route du temps et puis d’abord si on s’arrêtait on ne saurait quoi faire non plus sans cette folie d’avancer qui vous possède et qu’on admire depuis toute sa jeunesse. Déjà on en est moins fier d’elle de sa jeunesse, on ose pas encore l’avouer en public que ce n’est peut-être que cela sa jeunesse, de l’entrain à vieillir.
On découvre dans tout son passé ridicule tellement de ridicule, de tromperie, de crédulité qu’on voudrait peut-être s’arrêter tout net d’être jeune, attendre la jeunesse qu’elle se dé tache, attendre qu’elle vous dépasse, la voir s’en aller, s’éloigner, regarder toute sa vanité, porter la main dans son vide, la voir repasser encore devant soi, et puis soi partir, être sûr qu’elle s’en est bien allée sa jeunesse et tranquillement alors, de son côté, bien à soi, repasser tout doucement de l’autre côté du Temps pour regarder vraiment comment qu’ils sont les gens et les choses.
Au bord du quai les pêcheurs ne prenaient rien. Ils n’avaient même pas l’air de tenir beaucoup à en prendre des poissons. Les poissons devaient les connaître. Ils restaient là tous à faire semblant. Un joli dernier soleil tenait encore un peu de chaleur autour de nous, faisant sauter sur l’eau des petits reflets coupés de bleu et d’or. Du vent, il en venait du tout frais d’en face à travers les grands arbres, tout souriant le vent, se penchant à travers mille feuilles, en rafales douces. On était bien. Deux heures pleines, on est resté ainsi à ne rien prendre, à ne rien faire. Et puis, la Seine est tournée au sombre et le coin du pont est devenu tout rouge du crépuscule. Le monde en passant sur le quai nous avait oubliés là, nous autres, entre la rive et l’eau.
La nuit est sortie de dessous les arches, elle est montée tout le long du château, elle a pris la façade, les fenêtres, l’une après l’autre, qui flambaient devant l’ombre. Et puis, elles se sont éteintes aussi les fenêtres.
Il ne restait plus qu’à partir une fois de plus.
Les bouquinistes des quais fermaient leurs boîtes. « Tu viens ! » que criait la femme par-dessus le parapet à son mari, à mon côté, qui refermait lui ses instruments, et son pliant et les asticots. Il a grogné et tous les autres pêcheurs ont grogné après lui et on est remontés, moi aussi, là-haut, en grognant, avec les gens qui marchent. Je lui ai parlé à sa femme, comme ça pour lui dire quelque chose d’aimable avant que ça soye la nuit partout. Tout de suite, elle a voulu me vendre un livre. C’en était un de livre qu’elle avait oublié de rentrer dans sa boîte à ce qu’elle prétendait. « Alors ce serait pour moins cher, pour presque rien… » qu’elle ajoutait. Un vieux petit « Montaigne » un vrai de vrai pour un franc. Je voulais bien lui faire plaisir à cette femme pour si peu d’argent. Je l’ai pris son « Montaigne ».
Sous le pont, l’eau était devenue toute lourde. J’avais plus du tout envie d’avancer. Aux boulevards, j’ai bu un café crème et j’ai ouvert ce bouquin qu’elle m’avait vendu. En l’ouvrant, je suis juste tombé sur une page d’une lettre qu’il écrivait à sa femme le Montaigne, justement pour l’occasion d’un fils à eux qui venait de mourir. Ça m’intéressait immédiatement ce passage, probablement à cause des rapports que je faisais tout de suite avec Bébert. Ah ! qu’il lui disait le Montaigne, à peu près comme ça à son épouse. T’en fais pas va, ma chère femme ! Il faut bien te consoler !… Ça s’arrangera !… Tout s’arrange dans la vie… Et puis d’ailleurs, qu’il lui disait encore, j’ai justement retrouvé hier dans des vieux papiers d’un ami à moi une certaine lettre que Plutarque envoyait lui aussi à sa femme dans des circonstances tout à fait pareilles aux nôtres… Et que je l’ai trouvée si joliment bien tapée sa lettre ma chère femme, que je te l’envoie sa lettre !… C’est une belle lettre ! D’ailleurs je ne veux pas t’en priver plus longtemps, tu m’en diras des nouvelles pour ce qui est de guérir ton chagrin !… Ma chère épouse ! Je te l’envoie la belle lettre ! Elle est un peu là comme lettre celle de Plutarque !… On peut le dire ! Elle a pas fini de t’intéresser !… Ah ! non ! Prenez-en connaissance ma chère femme ! Lisez-la bien ! Montrez-la aux amis. Et relisez-la encore ! je suis bien tranquille à présent ! Je suis certain qu’elle va vous remettre d’aplomb !… Vôtre bon mari. Michel. Voilà que je me dis-moi, ce qu’on peut appeler du beau travail. Sa femme devait être fière d’avoir un bon mari qui s’en fasse pas comme son Michel. Enfin, c’était leur affaire à ces gens. On se trompe peut-être toujours quand il s’agit de juger le cœur des autres. Peut-être qu’ils avaient vraiment du chagrin ? Du chagrin de l’époque ?
Mais pour ce qui concernait Bébert, ça me faisait une sacrée journée. Je n’avais pas de veine avec lui Bébert, mort ou vif. Il me semblait qu’il n’y avait rien pour lui sur la terre, même dans Montaigne. C’est peut-être pour tout le monde la même chose d’ailleurs, dès qu’on insiste un peu, c’est le vide.
Y avait pas à dire, j’étais parti de Rancy depuis le matin, fallait y retourner, et j’avais rien rapporté. J’avais rien absolument à lui offrir, ni à la tante non plus.
Un petit tour par la place Blanche avant de rentrer.
Je vois du monde tout le long de la rue Lepic, encore plus que d’habitude. Je monte donc aussi, pour voir. Au coin d’un boucher c’était la foule. Fallait s’écraser pour voir ce qui se passait, en cercle. Un cochon c’était, un gros, un énorme. Il geignait aussi lui, au milieu du cercle comme un homme qu’on dérange, mais alors énormément. Et puis, on arrêtait pas de lui faire des misères. Les gens lui tortillaient les oreilles histoire de l’entendre crier. Il se tordait et se retournait les pattes le cochon à force de vouloir s’enfuir à tirer sur sa corde, d’autres l’asticotaient et il hurlait encore plus fort à cause de la douleur.
Et on riait davantage.
Il ne savait pas comment se cacher le gros cochon dans le si peu de paille qu’on lui avait laissée et qui s’envolait quand il grognait et soufflait dedans. Il ne savait pas comment échapper aux hommes. Il le comprenait. Il urinait en même temps autant qu’il pouvait, mais ça ne servait à rien non plus. Grogner, hurler non plus. Rien à faire. On rigolait. Le charcutier par-derrière dans sa boutique, échangeait des signes et des plaisanteries avec les clients et faisait des gestes avec un grand couteau.
Il était content lui aussi. Il avait acheté le cochon, et attaché pour la réclame. Au mariage de sa fille il ne s’amuserait pas davantage. Il arrivait toujours plus de monde devant la boutique pour voir le cochon crouler dans ses gros plis roses après chaque effort pour s’enfuir. Ce n’était cependant pas encore assez. On fit grimper dessus un tout petit chien hargneux qu’on excitait à sauter et à le mordre à même dans la grosse chair dilatée. On s’amusait alors tellement qu’on ne pouvait plus avancer. Les agents sont venus pour disperser les groupes.
Quand on arrive vers ces heures-là en haut du pont Caulaincourt on aperçoit au-delà du grand lac de nuit qui est sur le cimetière les premières lumières de Rancy. C’est sur l’autre bord Rancy. Faut faire tout le tour pour y arriver. C’est si loin ! Alors on dirait qu’on fait le tour de la nuit même, tellement il faut marcher de temps et des pas autour du cimetière pour arriver aux fortifications.
Et puis ayant atteint la porte, à l’octroi, on passe encore devant le bureau moisi où végète le petit employé vert. C’est tout près alors. Les chiens de la zone sont à leur poste d’aboi. Sous un bec de gaz, il y a des fleurs quand même, celles de la marchande qui attend toujours là, les morts qui passent d’un jour à l’autre, d’une heure à l’autre. Le cimetière, un autre encore, à côté, et puis le boulevard de la Révolte. Il monte avec toutes ses lampes droit et large en plein dans la nuit. Y a qu’à suivre, à gauche. C’était ma rue. Il n’y avait vraiment personne à rencontrer. Tout de même, j’aurais bien voulu être ailleurs et loin. J’aurais aussi voulu avoir des chaussons pour qu’on m’entende pas du tout rentrer chez moi. J’y étais cependant pour rien, moi, si Bébert n’allait pas mieux du tout. J’avais fait mon possible. Rien à me reprocher. C’était pas de ma faute si on ne pouvait rien dans des cas comme ceux-là. Je suis parvenu jusque devant sa porte, et je le croyais, sans avoir été remarqué. Et puis, une fois monté, sans ouvrir les persiennes j’ai regardé par les fentes pour voir s’il y avait toujours des gens à parler devant chez Bébert. Il en sortait encore quelques-uns des visiteurs de la maison, mais ils n’avaient pas le même air qu’hier les visiteurs. Une femme de ménage des environs, que je connaissais bien pleurnichait en sortant. « On dirait décidément que ça va encore plus mal, que je me disais. En tout cas, ça va sûrement pas mieux… Peut-être qu’il est déjà passé ? que je me disais. Puisqu’il y en a une qui pleure déjà !… » La journée était finie.
Je cherchais quand même si j’y étais pour rien dans tout ça. C’était froid et silencieux chez moi. Comme une petite nuit dans un coin de la grande, exprès pour moi tout seul. De temps en temps montaient des bruits de pas et l’écho entrait de plus en plus fort dans ma chambre, bourdonnait, s’estompait… Silence. Je regardais encore s’il se passait quelque chose dehors, en face. Rien qu’en moi que ça se passait, à me poser toujours la même question.
J’ai fini par m’endormir sur la question, dans ma nuit à moi, ce cercueil, tellement j’étais fatigué de marcher et de ne trouver rien."

Médecin de clientèle puis de dispensaire, confronté sans cesse par métier à la maladie et à la mort, il découvre à leur lumière un monde qui est d'abord celui de la petite bourgeoisie. Dans les personnages d`un couple de retraités, les Henrouille, ou de la mère d'une jeune femme mourant d`une fausse couche, l'esprit de calcul, la mesquinerie et la morale deviennent à leur tour des auxiliaires de la mort. La mort la plus insupportable est celle d`un enfant. La typhoïde finit par emporter le jeune Bébert, malgré les efforts désespérés de Bardamu. En cette occasion. la recherche médicale incarnée par le Dr Parapine, d'un Institut "Bioduret" (que tout identifie à l`Institut Pasteur), s`est révélée une imposture.
Autour de Bardamu devenu sédentaire commence à se nouer une intrigue...
Les Henrouille ont eu l'idée de se débarrasser d`une mère âgée, d`abord en la faisant interner. puis, Bardamu ayant refusé de se prêter à l`opération. en montant un accident qui doit l`éliminer. L'homme auquel ils ont recours pour cela n'est autre que Robinson, que Bardamu avait de nouveau rencontré à Detroit, et qui désormais rôde autour de lui à Rancy. Mais Robinson, posant un pétard sur une cage à lapin, ne réussit qu'à se blesser les yeux. Les Henrouille sont obligés de le recueillir aveugle. Un curé, l'abbé Protiste, les met à même, avec la complicité de Bardamu, de se débarrasser à la fois de la mère et de Robinson en procurant à ceux-ci à Toulouse la gestion d`un caveau d`église dont les momies font une attraction touristique.
Bardamu, cependant, a quitté Rancy. Il s`est fait engager un temps comme figurant au "Tarapout", music-hall des boulevards. La proximité et la facilité des girls lui ont fait une vie facile. A la même époque. il a encore élargi sa connaissance de la vie en fréquentant un proxénète du quartier des Batignolles, Pomone. Sa curiosité finit par le conduire à Toulouse, voir ce que deviennent Robinson et la vieille Henrouille. Il trouve celle-ci plus gaillarde que jamais. Robinson. lui, est encore presque aveugle, et dolent. Pourtant un mariage se dessine avec la fille de la marchande de cierges de l'église, Madelon, qui ne se montre pas farouche avec Bardamu en lui faisant visiter le fameux caveau.
Au cours de son séjour, Bardamu n`en a pas moins l'occasion, au cours d`une partie de campagne, de surprendre entre les deux fiancés un dialogue amoureux des plus passionnés. Deux jours plus tard. apprenant qu`un "accident" mortel vient d`arriver à la vieille Henrouille. il quitte Toulouse à l`instant.
"Moi et Léon nous prîmes les strapontins de devant et les deux femmes occupèrent le fond du taxi. Les soirs de fête, c’est très encombré la route d’Argenteuil, surtout jusqu’à la Porte.
Après, il faut encore compter une bonne heure pour arriver à Vigny à cause des voitures. C’est pas commode de rester une heure sans rien se dire, face à face, à se regarder, surtout quand il fait sombre et qu’on est un peu inquiets les uns à cause des autres.
Toutefois, si nous étions restés comme ça, vexés, mais chacun pour soi, rien ne serait arrivé. C’est encore aujourd’hui mon opinion quand j’y repense.
Somme toute c’est à cause de moi qu’on s’est reparlé et que la dispute a repris alors tout de suite et de plus belle. Avec les mots on ne se méfie jamais suffisamment, ils ont l’air de rien les mots, pas l’air de dangers bien sûr, plutôt de petits vents, de petits sons de bouche, ni chauds, ni froids, et facilement repris dès qu’ils arrivent par l’oreille par l’énorme ennui gris mou du cerveau. On ne se méfie pas d’eux des mots et le malheur arrive.
Des mots, il y en a des cachés parmi les autres, comme des cailloux. On les reconnaît pas spécialement et puis les voilà qui vous font trembler pourtant toute la vie qu’on possède, et tout entière, et dans son faible et dans son fort… C’est la panique alors… Une avalanche… On en reste là comme un pendu, au-dessus des émotions… C’est une tempête qui est arrivée, qui est passée, bien trop forte pour vous, si violente qu’on l’aurait jamais crue possible rien qu’avec des sentiments… Donc, on ne se méfie jamais assez des mots, c’est ma conclusion. Mais d’abord que je raconte les choses… Le taxi suivait doucement son tram à cause des réparations… « Rron… et rron… » qu’il faisait. Un caniveau chaque cent mètres… Seulement ça ne me suffisait pas à moi le tram devant. Toujours bavard et enfantin, je m’impatientais… Ça ne m’était pas supportable cette petite allure d’enterrement et cette indécision partout… Je me dépêchais de le casser le silence pour tâcher de savoir ce qu’il pouvait bien avoir dans le derrière. J’observai, ou plutôt j’essayai d’observer, puisqu’on n’y voyait presque plus, dans son coin à gauche, dans le fond du taxi, Madelon. Elle gardait la figure tournée vers le dehors, vers le paysage, vers la nuit à vrai dire. Je constatai avec dépit qu’elle était toujours aussi entêtée. Un vrai emmerdeur, moi, d’autre part. Je l’interpellai, rien que pour lui faire tourner la tête de mon côté.
« Dites donc Madelon ! que je lui demandai. Vous avez peut-être un projet d’amusement vous que vous n’osez pas nous confier ? Voulez-vous qu’on s’arrête quelque part avant de rentrer ? Dites-le tout de suite ?…
– S’amuser ! s’amuser ! qu’elle m’a répondu comme insultée. Vous ne pensez jamais qu’à ça vous autres ! À l’amusement !… » Et du coup, toute une série de soupirs qu’elle a poussés, profonds, comme j’en ai rarement entendu de si touchants.
« Je fais ce que je peux ! que je lui réponds. C’est dimanche !
– Et toi Léon ? qu’elle lui demande alors à lui. Toi, est-ce que tu fais aussi tout ce que tu peux, dis ? » C’était direct.
« Tu parles ! » qu’il lui a répondu.
Je les regardais tous les deux dans le moment où on passait devant les réverbères. C’était la colère. Madelon s’est alors penchée comme pour l’embrasser. C’était dit décidément que ce soir-là on raterait pas une seule gaffe à faire.
Le taxi allait à nouveau tout à fait doucement à cause des camions, partout échelonnés devant nous. Ça l’agaçait lui justement d’être embrassé et il l’a repoussée assez brusquement faut le dire. Bien sûr, c’était pas aimable comme geste, surtout que ça se passait devant nous autres."

La dernière étape de Bardamu est un établissement psychiatrique de la région parisienne, dans lequel il se fait embaucher et où il retrouve Parapine. Il devient le confident du propriétaire, le Dr Baryton, adversaire de la psychanalyse. Bardamu semble avoir trouvé le refuge idéal. Mais le solide Baryton, ayant eu l'idée de profiter de Bardamu pour étudier l`anglais, est saisi par l'instabilité. ll finit par quitter à jamais la clinique en la confiant à Bardamu. Sur ces entrefaites surgit une fois de plus Robinson, qui a recouvré la vue, mais qui n`a pu supporter l`idée d'une vie de bonheur conjugal avec Madelon. ll a donc fui celle-ci, dont il connaît la ténacité, et demande à Bardamu de le cacher dans la clinique. En effet, Madelon ne tarde pas à paraître à son tour, elle accuse Bardamu de tout et ressaisit Robinson. Bardamu, à cette époque, jouit des faveurs d`une infirmière slovaque de la clinique, Sophie. Pour se réconcilier avec Madelon, il a la maladresse de proposer une sortie à quatre a la fête des Batignolles. C'est bien-entendu la Catastrophe. Dans le taxi qui les ramène à la clinique, Robinson résiste aux avances de Madelon, et finit par la provoquer en lui disant ce qu`il pense de l`amour dont elle le poursuit. Elle le tue avec un revolver. Ayant assisté à l'agonie de Robinson et témoigné au poste de police, Bardamu se retrouve a l'aube devant un canal. ll repense a la manière dont "Ça a débuté", les premiers mots du roman. Un sifflement sur le canal le fait songer à un remorqueur qui traînerait derrière lui le monde entier, "qu`on n'en parle plus".

Chemin faisant, Bardamu ne s`est pas contenté de dénoncer toutes les institutions et toutes les injustices de la société. A la guerre, face aux balles, il a conçu vis-à-vis de la mort une lâcheté définitive et revendiquée, et ceux de ses camarades qui manifestaient du courage, ou seulement de l`obéissance aux ordres, étaient des hommes à qui cette singulière prise de conscience faisait défaut. Mais, dans cette même guerre, Bardamu a aussi découvert en flagrant délit des hommes qui collaboraient avec la mort en envoyant leurs semblables se faire tuer. Et ceux-ci, était-ce seulement aliénation patriotique ou manque de recul, qui les faisaient obéir? Dans cette expérience, Bardamu en vient à soupçonner qu'il puisse exister en l'être humain des désirs, ordinairement masqués, de meurtre et même peut-être de mort. Autant de questions sans réponse qui alimente une inquiétude qui lui interdit de se satisfaire d`une vie stable, normale, dite heureuse.
Comme un chien ...
".. On pouvait se demander encore ce qu’il allait faire, pour en finir. Son ventre gonflait, il nous regardait Léon, bien fixe déjà, il geignait, mais pas trop. C'était comme une espèce de calme. Je l’avais vu déjà bien malade moi, et dans bien des endroits différents, mais cette fois-ci c’était une affaire où tout était nouveau, les soupirs et les yeux et tout. On ne le retenait plus qu’on aurait dit, il s’en allait de minute en minute. Il transpirait des si grosses gouttes que c’était comme s’il avait pleuré avec toute sa figure.
Dans ces moments-là, c’est un peu gênant d’être devenu aussi pauvre et aussi dur qu’on est devenu. On manque de presque tout ce qu’il faudrait pour aider à mourir quelqu’un. On à plus guère en soi que des choses utiles pour la vie de tous les jours, la vie du confort, la vie à soi seulement, la vacherie. On a perdu la confiance en route. On l’a chassée, tracassée la pitié qui vous restait, soigneusement au fond du corps comme une sale pilule. On l’a poussée la pitié au bout de l’intestin avec la merde. Elle est bien là qu’on se dit.
Et je restais, devant Léon, pour compatir, et jamais j’avais été aussi gêné. J’y arrivais pas... Il ne me trouvait pas... Il en bavait... Il devait chercher un autre Ferdinand, bien plus grand que moi, bien sûr, pour mourir, pour l’aider à mourir plutôt, plus doucement. Il faisait des efforts pour se rendre compte si des fois le monde aurait pas fait des progrès. Il faisait l’inventaire, le grand mal heureux, dans sa conscience... S’ils avaient pas changé un peu les hommes, en mieux, pendant qu’il avait vécu lui, s’il avait pas été des fois injuste sans le vouloir envers eux... Mais il n’y avait que moi, bien moi, moi tout seul, à côté de lui, un Ferdinand bien véritable auquel il manquait ce qui ferait un homme plus grand que sa simple vie, l’amour de la vie des autres. De ça, j’en avais pas, ou vraiment si peu que c’était pas la peine de le montrer.
J’étais pas grand comme la mort moi. J’étais bien plus petit. J’avais pas la grande idée humaine moi. J’aurais même le crois senti plus facilement du chagrin pour un chien en train de crever que pour lui Robinson, parce qu’un chien c’est pas malin, tandis crue lui il était un peu malin malgré tout Léon.
Moi aussi l’étais malin, on était des malins... Tout le reste était parti au cours de la route et ces grimaces mêmes qui peuvent encore servir auprès des mourants, je les avais perdues, j’avais tout perdu décidément au cours de la route, je ne retrouvais rien de ce qu’on a besoin pour crever, rien que des malices. Mon sentiment c’était comme une maison où on ne va qu’aux vacances. C’est à peine habitable. Et puis aussi c’est exigeant un agonique.
Agoniser ne suffit pas. Il faut jouir en même temps qu’on crève, avec les derniers hoquets faut jouir encore, tout en bas de la vie, avec de l’urée plein les artères.
Ils pleurnichent encore parce qu’ils ne jouissent plus assez les mourants... Ils réclament... Ils protestent. C’est la comédie du malheur qui cherche à passer de la vie dans la mort même.
Il a repris un peu de ses sens quand Parapine lui a eu fait sa piqûre de morphine. Il nous a même raconté des choses alors à propos de ce qui venait d’arriver. « C’est mieux que ça se finisse comme ça... » qu’il a dit, et puis « Ça fait pas si mal que j’aurais cru... » Lorsque Parapine lui a demandé à quel endroit qu’il souffrait exactement, on voyait bien qu’il était déjà un peu parti, mais aussi qu’il tenait malgré tout à nous dire encore des choses... La force lui manquait et puis les moyens. Il pleurait, il étouffait et il riait tout de suite après. C’était pas comme un malade ordinaire, on ne savait pas comment se tenir devant lui.
C’était comme s’il essayait de nous aider à vivre à présent nous autres.
Comme s’il nous avait cherché à nous des plaisirs pour rester. Il nous tenait par la main. Chacun une. Je l’embrassai. Il n’y a plus que ça qu’on puisse faire sans se tromper dans ces cas-là. On a attendu. Il a plus rien dit. Un peu plus tard, une heure peut-être, pas davantage, c’est! hémorragie qui s’est décidée, mais alors abondante, interne, massive. Elle l’a emmené. Son coeur s’est mis à battre de plus en plus vite et puis tout à fait vite. Il courait son coeur après son sang, épuisé, là-bas, minuscule déjà, tout à la fin des artères, à trembler au bout des doigts. La pâleur lui est montée du cou et lui a pris toute la figure. Il a fini en étouffant. Il est parti d’un coup comme s’il avait pris son élan, en se resserrant sur nous deux, des deux bras. Et puis il est revenu là, devant nous, presque tout de suite, crispé, déjà en train de prendre tout son poids de mort.
On s’est levés nous, on s’est dégagés de ses mains. Elles sont restées en l’air ses mains, bien raides, dressées toutes jaunes et bleues sous la lame: Dans la chambre ça faisait comme un étranger à présent Robinson, qui viendrait d’un pays atroce et qu’on n’oserait plus lui parler."

1936 – Mort à crédit
"Cet ouvrage va encore plus loin que le précédent dans la remise en cause des conventions de la langue écrite, en adoptant un lexique familier, voire
trivial, et en mettant à mal toute règle syntaxique (en particulier utilisation de phrases courtes, produisant un rythme saccadé, et usage abondant des points de suspension et d’exclamation).
Cette nouvelle épopée burlesque et désespérée, où l’argot est inextricablement lié à la poésie, narre, avec une rare crudité, l’histoire d’une enfance misérable au passage Choiseul, marquée par
une figure maternelle extraordinaire et par la rencontre d’un inventeur. "Voyage au bout de la nuit" narrait le passage initiatique de Bardamu dans le monde des adultes ; "Mort à crédit" revient
en arrière pour retracer les années de jeunesse du personnage. Mais, alors que le récit d’enfance et d’adolescence propose souvent la vision idéalisée du passé et l’exaltation nostalgique d’un
paradis perdu, Céline rédige ici la chronique noire d’existences sordides.
C’est à Paris, vers 1900, entre la Bourse et les grands boulevards, dans un Paris populaire de petits artisans et commerçants, que se déroule l’enfance de
Ferdinand, fils unique d’un rédacteur aux Coccinelle-Assurances et d’une marchande de dentelles. La famille réside passage des Bérésinas, galerie couverte empuantie par l’éclairage au gaz, dans
un petit logis au dessus de la boutique : « Ma mère escaladait sans cesse, à cloche-pied. Ta ! pa ! pam ! Ta ! pa ! tam ! Elle se retenait à la rampe. Mon père ça le crispait de l’entendre. Déjà
il était mauvais à cause des heures qui passaient pas. Sans cesse il regardait sa montre. Maman en plus, et sa guibole, ça le foutait à cran pour des riens. » Entre les coups de sang d’un père
velléitaire et les jérémiades d’une mère boiteuse, Ferdinand y apprend les premières leçons de la vie : la gêne des petites gens, les courbettes devant les clients, les combines, le linge
douteux, tous les vices des adultes…."
"... Flossie, elle fumait en cachette, je l’ai paumée un joui dans le jardin... On lavait rien à la maison, on descendait tout le linge en ville à une buanderie spéciale, au diable, plus loin que les casernes. Avec Jonkind, ces jours-là c’était pas de la pause, on remontait, descendait la côte des quantités de fois avec des bardas énormes... A qui porterait davantage, le plus vite en haut... C’est un sport que je comprenais... ça me rappelait les jours des boulevards... Quand la flotte devenait si lourde, si juteuse, que le ciel s’écroulait dans les toits, se cassait partout en trombes, en cascades, en furieuses rigoles, ça devenait nos sorties des excursions fantastiques... On se rapprochait tous les trois pour résister à la tourmente... Nora, ses formes, ses miches, ses cuisses, on aurait dit de l’eau solide tellement l’averse était puissante, ça restait tout collé ensemble... On n’avançait plus du tout... On pouvait plus prendre l’escalier, le nôtre, celui qui montait notre falaise... On était forcés de nous rabattre vers les jardins... de faire un détour par l’église. On restait devant la chapelle... sous le porche... et on attendait que ça passe.
L’idiot, la pluie ça le faisait jouir... Il sortait exprès de son abri... Il se renversait toute la tronche, en plein sos la flotte... La gueule grande ouverte, comme ça... Il avalait les gouttières, il se marrait énormément... Il se trémoussait, il devenait tout fanatique... il dansait la gigue dans les flaques, il sautait comme un farfadet... Il voulait qu’on gigote aussi... C’était son accès, sa crise... Je commençais à bien le comprendre, c’était dur pour le calmer... Il fallait tirer sur sa corde... l’amarrer après le pied du banc.
Je les connaissais moi, mes parents, le coup du complet bariolé, il pouvait pas coller du tout, je m’en gourais il avance... Ils ont répondu, en retard, ils en revenaient pas encore, ils en poussaient les hauts cris, ils croyaient que je me foutais d’eux, que je me servais d’un subterfuge pour maquiller des folles dépenses... Ils en profitaient pour conclure que si je perdais mes journées à taper dans un ballon c'était plus du tout surprenant que j’apprenne pas un sou de grammaire... C’était leur dernier avis!... Le sursis final !... Que je m’entête pas sur l’accent... Que je retienne n'importe lequel !... pourvu qu’on arrive à me comprendre c'était amplement suffisant... On a encore lu la lettre avec Nora et son dabe... Elle restait ouverte sur la table... Certains passages ils pigeaient pas. Ça leur semblait tout obscur, tout extraordinaire... J’ai rien expliqué... Ça faisait quatre mois que j’étais là, c’était pas à cause d’un veston que je me lancerais dans les fadaises... Et pourtant ça les tracassait... Même Nora elle semblait soucieuse... que je veuille pas me revêtir en sport, avec la roupane uniforme et la gâpette panachée... Sans doute pour promener en ville, c'était la réclame du «Meanwell» surtout moi qu’étais le plus grand, le plus dégingandé de l’ensemble... ma démise sur le terrain, elle faisait honte au collège. Enfin, à force qu'ils se lamentaient... j’ai molli un peu... j’ai bien voulu d'un compromis, essayer un rafistolage... un que Nora «avait constitué, dans deux vieilles pelures à son daron... Un arrangement composite... j’étais mimi ainsi sapé... j’étais encore bien plus grotesque, j’avais plus de forme, ni de milieu, mais ça m’évitait les soupirs... Dans la même inspiration j’ai hérité d’une casquette, une bicolore armoriée, une minuscule calotte d’orange... Sur ma bouille énorme, elle faisait curieux... Mais tout ça leur semblait utile au prestige de la maison... L’honneur fut ainsi rétabli... On me promena délibérément, on avait plus besoin d’excuses...
Pourvu qu’on parte en vadrouille et qu’on me force pas aux confidences... Je trouvais que c’était l’essentiel, que ça pouvait pas aller mieux... Je me serais même fendu d’un haut-de-forme s’ils avaient seulement insisté... pour leur faire un grand plaisir... Ils s’en posaient un eux le dimanche pour aller pousser des cantiques à leur messe protestante... Ça marchait à la claquette : Assis! Debout! dans leur temple... Ils me demandaient pas mon avis... ils m’emmenaient aux deux services... ils avaient peur que je m’ennuie seul à la maison... Là encore, entre les chaises il fallait surveiller Jonkind, c’était un moment à passer... Entre tous les deux Nora, il se tenait assez peinard.
Dans l’église, Nora elle me faisait l’effet d’être encore plus belle que dehors, moi je trouvais du moins. Avec les orgues, et les demi-teintes des vitraux, je m’éblouissais dans son profil... Je la regarde encore à présent... Y a bien des années pourtant, je la revois comme je veux. Aux épaules, le corsage en soie il fait des lignes, des détours, des réussites de la viande, qui sont des images atroces, des douceurs qui vous écrabouillent... Oui, je m’en serais pâme dans les délices, pendant qu’ils gueulaient, nos lardons, les psaumes à Saül...
L’après-midi du dimanche, ça repiquait à la maison le coup du cantique, j’étais à genoux à côté d’elle... Le vieux, il faisait une longue lecture, je me retenais le panais à deux mains, je me l’agrippais au fond de la poche. Le soir l’envie était suprême à la fin des méditations... Le petit môme qui venait me dévorer, il était fadé le dimanche soir, il était nourri... Ça me suffisait pas quand même, c’est elle que j’aurais voulue, c’est elle tout entière à la fin !... C’est toute la beauté la nuit... ça vient se rebiffer contre vous... ça vous attaque, ça vous emporte... C’est impossible à supporter.,, A force de branler des visions j’en avais la tête en salade.,, Moins on brifait au réfectoire plus je me tapais des rassis.,, Il faisait si froid dans la crèche qu’on se rhabillait entièrement une fois que le vieux était tiré...
Le réverbère, sous notre fenêtre, celui des rafales, il arrêtait plus de grincer... Pour perdre encore moins de la chaleur, on restait couchés deux par deux... On se passait des branlées sévères... Moi, j’étais impitoyable, j’étais devenu comme enragé, surtout que je me défendais à coups d’imagination... Je la mangeais Nora dans toute la beauté, les fentes... J’en déchirais le traversin. Je lui aurais arraché la moule, si j’avais mordu pour de vrai, les tripes, le jus au fond, tout bu entièrement... je l’aurais toute sucée moi, rien laissé, tout le sang, pas une goutte... J’aimais mieux ravager le pageot, brouter entièrement les linges... que de me faire promener par la Nora et puis par une autre ! J’avais compris moi, s’il vous plaît, le vent des grognasses, le cul c’est la farandole ! C’est la caravane des paumés ! Un abîme, un trou, voilà!... Je me l’étranglais moi, le robinet... Je rendais comme un escargot, mais il giclait pas au-dehors... Ah! mais non! Miteux qui trempe est pire qu’ordure !... A l’égout la vache des aveux!... Ouah! Ouah ! Je t’aime ! Je t’adore ! Ouin ! Ouin ! A qui vous chie sur l’haricot !... Faut plus se gêner c’est la fête ! On rince ! C’est nougat! C’est innocent!... Petit j’avais compris berloque moi ! Au sentiment ! Burnes ! C’est jugé ! A la gondole!... Vogue hé charogne!... Je me cramponnais à ma burette, j’avais la braguette en godille ! Ding Ding Dong ! Je veux pas crever comme un miché ! La gueule en poème ! Ouin !
En plus du truc des prières, j’ai subi encore d’autres assauts... Il arpentait tous les sentiers, il se tenait derrière chaque buisson l’esprit malin des enculages... Comme on se tapait d’immenses parcours avec l’idiot et la si belle, j’ai traversé toute la campagne de Rochester et par tous les temps...
On a connu tous les vallons, toutes les routes et les traversières. Je regardais beaucoup le ciel aussi, pour me détourner l’attention. Aux marées, il changeait de couleurs... Au moment des accalmies, il arrivait des nuages tout roses, sur la terre et sur l’horizon... et puis les champs devenaient bleus...
Comme c’était disposé la ville, les toits des maisons dévalaient en pente vers le fleuve, on aurait dit toute une avalanche, des bêtes et des bêtes... un énorme troupeau tour noir et tassé dans les brumes qui descendait de la campagne... Tout ça fumait dans les buées... jaunes et mauves...
Elle avait beau faire des détours et des longs repos propices, ça me portait pas aux confidences... même quand ça durait des heures, qu’on passait par des petites rues pour revenir à la maison.. Même un soir, qu'il faisait déjà nuit sur le pont qui passe à Stroude.."
A la recherche d'un emploi ...
"On m'a équipé à nouveau, pour me rendre plus séduisant. Je devenais coûteux comme un infirme. J'avais usé tout mon complet... J'avais traversé mes tatanes... En plus des guêtres assorties j'ai eu la neuve paire de tatanes, des chaussures Broomfield, la marque anglaise, aux semelles entièrement débordantes, des vraies sous-marines renforcées. On a pris la double pointure, pour qu'elles me durent au moins deux ans... Je luttais fort résolument contre l'étroitesse et I 'entorse. Je faisais scaphandre sur les Boulevards...
Une fois, comme ça rafistolé, on a mis le cap sur les adresses, avec ma mère dès le lendemain. L'oncle Édouard, il nous en passait, toutes celles qui lui venaient des amis, nous trouvions les autres dans le Bottin. Madame Divonne, c'est elle qui gardait la boutique jusqu'à midi tous les matins, pendant que nous on traçait dehors à la recherche d'une position. ll fallait pas flâner, je l'assure. Tout le Marais on l'a battu, porte après porte, et encore les transversales, rue Quincampoix, rue Galante, rue aux Ours, la Vieille-du-Temple... Tout ce parage-là, on peut le dire, on l'a dépiauté par étages...
Ma mère clopinait à la traîne... Ta ! ga! dac! Ta! ga! dac !... Elle me proposait aux familles, aux petits façonniers en cambuse, accroupis derrière leurs bocaux... Elle me proposait gentiment... Comme un ustensile en plus... Un petit tâcheron bien commode... pas exigeant... plein d'astuce, de zèle, d'énergie... Et puis surtout courant vite! Bien avantageux en somme... Bien dressé déjà, tout obéissant... A notre petit coup de sonnette, ils entrebâillaient la lourde... ils se méfiaient d'abord... cibiche en arrêt... ils me visaient dessus leurs lunettes... lls me reluquaient un bon coup... Ils me trouvaient pas beau... Devant leurs blouses gonflées en plis, ma mère poussait la chansonnette :
- Vous n'auriez pas des fois besoin d'un tout jeune représentant? Monsieur... C'est moi, la maman. J'ai tenu à l'accompagner... Il ne demande qu'à bien faire... C'est un jeune homme très convenable. D'ailleurs, rien n'est plus facile, vous pouvez prendre vos renseignements... Nous sommes établis depuis douze années, Passage des Bérésinas... Un enfant élevé dans
le commerce l... Son père travaille dans un bureau à la «Coccinelle-lncendie»... Sans doute que vous connaissez ?... Nous ne sommes pas riches ni l'un ni l'autre, mais nous n'avons pas un sou de dettes... Nous faisons honneur à nos affaires... Son père dans les assurances...
Par matinée, en général, on s'en tapait une quinzaine, de tous les goûts et couleurs... Des sertisseurs, des lapidaires, des petits chaînistes, des timbaliers et même des fiotes qu'ont disparu comme des orfèvres dans le vermeil et des ciseleurs sur agates.
Ils recommençaient à nous bigler... lls posaient leurs loupes pour mieux voir... Si on n'était pas des bandits... des escarpes en rupture de tôle l... Rassurés, ils devenaient aimables et même complaisants!... Seulement ils voulaient de personne... Pas pour le moment ! Ils avaient pas de frais généraux... Ils visitaient en ville eux-mêmes... Ils se défendaient en famille, tous ensemble, dans leurs réduits minuscules... Sur les sept étages de la cour c'était comme creusé leurs crèches, ça faisait autant de petites cavernes, des alvéoles d'ateliers dans les belles maisons d'autrefois... C'était fini les apparences. Ils s'entassaient tous là-dedans. L'épouse, les loupiots, la grand'mère, tout le monde s'y collait au business... A peine en plus un apprenti, au moment des fêtes de Noël...
Quand ma mère, à bout de persuasion, pour malgré tout les séduire, leur offrait de me prendre à l'œil... ça leur foutait un sursaut. Ils se ratatinaient brutalement. Ils reflanquaient la lourde sur nous! Ils s'en méfiaient des sacrifices! C'était un indice des plus louches. Et tout était à recommencer! Ma mère tablait sur la confiance, ça semblait pas donner beaucoup.
Me proposer tout simplement comme apprenti en sertissure ou pour "la fraise" des petits métaux ?... Déjà il était bien trop tard... Je serais jamais habile de mes doigts... Je pouvais plus faire qu'un baveux, un représentant du dehors, un simple "jeune homme"... je ratais l'avenir dans tous les sens...
Quand on rentrait à la maison, mon père il demandait des nouvelles... A force qu'on remporte que des pipes, il en serait devenu dingo. Il se débattait toute la soirée, parmi des mirages atroces... Il tenait de quoi, dans le cassis, meubler vingt asiles... Maman, à force d'escalades, elle en avait les jambes tordues... Ça lui faisait si drôle qu'elle pouvait plus s'arrêter... Elle faisait des terribles grimaces tout autour de notre table... Ça lui tiraillait les cuisses... C'est les crampes qui la torturaient...
Quand même le lendemain de bonne heure, on fonçait vite sur d'autres adresses... rue Réaumur, rue Greneta... La Bastille et les Jeûneurs... les Vosges surtout... Après plusieurs mois comme ça de quémandages et d'escaliers, d'approches et d'essoufflements, de peau de zébi, maman, elle se demandait tout de même, si ca se voyait pas sur mon nez, que j'étais qu'un petit réfractaire, un garnement propre à rien ?... Mon père, il avait même plus de doutes... Depuis longtemps il était sûr... Il renforçait sa conviction chaque soir quand on rentrait bredouille... Ahuris, pantelants, croulants, trempés d'avoir bagotté vite, mouillés par-dessus, par-dessous, de sueur et de pluie...
"C'est plus difficile de le caser, que de liquider toute la boutique !... et pourtant, ça tu le sais, Clémence, c'est un tintouin bien infernal !"
ll était pas instruit pour rien, il savait comparer, conclure. Déjà mon costard précédent, il godaillait de partout, aux genoux j'avais d'énormes poches, les escaliers c'est la mort.
Heureusement que, pour les chapeaux, j'empruntais un vieux à mon père. On avait la même pointure. Comme il n'était pas très frais, je le gardais tout le temps à la main. Je l'ai usé par la bordure... C'est effrayant, en ce temps-là, ce qu'on était polis..."
"Bagatelles pour un massacre" (1937)
Un pamphlet antisémite redoutable, c'était l'époque, qui, avec par exemple "Les Décombres", écrit de juillet 1940 à mai 1942 par Lucien Rebatet, rencontreront un énorme succès sous l'Occupation, le fascisme et l'antisémitisme avaient bien le soutien d'un large public, on ne peut l'oublier, et cette indigne réalité est loin d'avoir déserté le peu d'esprit des générations suivantes. Le démoniaque antisémitisme, comme tout racisme, couve sous les braises. Comment comprendre cela. Céline aimait la danse, les danseuses. De là à écrire l'argument d'un ballet ("... au lever du rideau, les petits esprits de la forêt dansent, sautent, virevoltent... C’est la ronde des lutins, des farfadets, des elfes... Leur chef est un lutin couronné, le Roi des Lutins agile, preste, toujours aux aguets... Ils jouent... saute-mouton... Avec eux, dans la ronde joyeuse... une biche frêle et timide... leur petite compagne... Et puis un gros compagnon, le gros hibou... Il danse aussi par ci, par là... mais tranquillement, un peu en retrait toujours... Il est le conseiller, le sage de la petite bande... toujours un peu boudeur... Le petit lapin est là aussi... avec son tambour... On entend les cris d’une bande joyeuse...") ... Restait à convaincre un musicien, à séduire un directeur de théâtre, chose plus difficile. Et ce fut une vive déception ...
Ulcéré, l'auteur se mit à ruminer, rendit les Juifs responsables de son échec, il n'y en a que pour eux, des propos tristement communs. Puis vint le délire, d'une consternante façon. Quand il écrivit "Bagatelles", Céline semble en proie à une espèce de fièvre chaude, qui embruma entièrement son cerveau. Peur panique de la guerre ou amertume due à l'insuccès des ballets? Pourquoi ce déferlement, en un temps où la tentation était forte de penser qu'après tout Hitler n'était pas plus mal qu'un autre (Le "massacre", dans la pensée de l’auteur, est évidemment celui qu’il prévoit, en 1937, comme ce qui arriverait s’il éclatait une deuxième guerre mondiale), que de la Russie à l'Amérique, tous les gouvernements étaient des émanations d'exploitants face à des exploités, et donc se valaient tous à peu près.
".. Le monde est pourri, c’est un fait par le cinéma, le cabotinage... (O ces charges de cavaleries légères !...) Le matuvuisme le plus exorbitant, le plus indécent est à la base, au fond. de tous les grands mouvements d’Idées actuels, inséparable.... Le monde était en 14 beaucoup plus simpliste, plus nature, plus sincère, beaucoup moins ficelle, moins vicieux qu’aujourd’hui. En 37, le cabotinage, le phrasage s’étale partout, domine tout, mine tout, même le peuple, hélas ! Lui-même déjà très faisandé, bien avancé en pourriture cabotine... Je me souviens d’être monté en rifle avec des combattants bretons. Ils ne savaient pas lire, ni écrire, brigadiers compris... Ils inspiraient une confiance absolue, qui ne s’est jamais démentie ! "Ac cadaver". Je me méfie beaucoup des soldats qui savent lire... qui vont au cinéma... Qui sait lire devant le péril devient facilement raisonneur, un peu hésitant, subtil... Il se croit au cinéma, il demande à voir la suite... Il n’y a pas de suite !... Attention !... Il faudra dans les rangs oublier le cinéma !... Voici qui promet beaucoup de travail à la Prévôté... Elle ne chômera guère. Elle sera sur les dents derrière tous ces "spectateurs". Les pelotons non plus ne chômeront pas... Les recommandations non plus..."
Les neuf dixièmes de "Bagatelles" sont sans aucun doute indignes d'être lus, - on connaît les pauvres et lamentables arguments, on exhibe des chiffres, des noms bien-sûr, des faits pour démontrer que les Israélites sont des sous-hommes, mais qu'à force d'ignominie ils imposent leur loi aux "Français" qui, bien qu'assez stupides pour les subir, leur sont incomparablement supérieurs. Après une digression sur la Russie communiste, un pays peuplé de "Judéo-Mongols", où du reste on refuse, aussi impitoyablement qu'en France, de mettre en musique et de monter ses ballets. Le contenu est inepte, l'énormité est ici la seconde nature de Céline, mais le style et la forme sont grandioses, c'est un véritable et désespérant sabotage d'un talent sans autre exemple dans la littérature française. Peut-on considérer que son inconscience est à la hauteur de son génie?
"L'Ecole des cadavres", qui en constitue la suite, en 1938, accumulera les diatribes haineuses, pesantes, monotones et si outrées que même les antisémites et les fascistes en furent gênés. Outre "Bagatelles" et ce volume, sont de la même veine, malheureusement, "Mea culpa" (1936) et "Les Beaux Draps" (1941). « Si pénibles soient-ils, [ces livres] commandent moins le dégoût ou la réprobation qu'une solidarité déchirante pour l'homme en proie aux obsessions de la persécution et de la haine - ou aux prophéties de fin du monde", écrira Gaëtan Picon. Est-ce toutefois et malgré une littérature à lire? Non, et d'autant plus qu'on n'y trouve guère que les poncifs, en partie toujours bien vivants chez nombre de nos concitoyens, des réflexes de langage, mais non pas les raisons qui poussent à de telles stigmatisations et déferlement de haines, ce qui nous importe de combattre ...

"Guignol's Band" (1944)
Burlesque et amertume s'équilibrent dans un livre dans lequel Céline semble guetter sans cesse les réactions de ses lecteurs, jouir de ses effets, et rebondir en laissant venir à lui de nouveaux détails. Le premier chapitre décrit un bombardement en termes apocalyptiques, on y a vu un Céline qui, en commençant certains de ses livres, après s'être lancé avec impétuosité sur un sujet, ne savait pas toujours de quoi il parlerait....
Le second chapitre de Guignol's Band nous conduit à Londres. pendant la guerre de 14. L'auteur a profité d'une convalescence pour s`y enfuir. Un ami qu'il a connu à l'hôpital et qui, finalement, a été fusillé pour mutilation volontaire lui a donné l`adresse de son oncle, un certain "Cascade". Ce personnage, un proxénète, a bien des soucis. L'un après l`autre, ses collègues français, sont saisis, pour d'obscures raisons, d`une poussée de fièvre patriotique, et décident de s`engager. Mais que faire de leur "patrimoine", si ce n'est le confier à Cascade. Celui-ci hésite, mais, lui dit-on, s'il refuse, il va falloir brader es filles de France à des Italiens et des Arabes. Cascade va donc se dévouer, et homme habile sachant s`entendre avec la police anglaise (représentée par l'inoubliable inspecteur Meadows), se plaît à jouer au sultan. Au fond, il n'est pas fâché d'avoir autour de lui toute une cour. Il lui manque cependant un eunuque pour faire régner la discipline dans son harem, - ces dames ont une fâcheuse tendance à se crêper le chignon. Le goût prononcé d'un certain Boro, pianiste par nécessité et chimiste par plaisir, pour les engins explosifs oblige l'auteur à s'installer chez un sultan pratiquant un métier différent mais aussi lucratif, le prêteur sur gages Titus Van Claben. Celui-ci s`habille à l'orientale, tient fermées des fenêtres qui donnent sur un parc magnifique, vit dans un bric-à-brac effarant et aime la musique, faiblesse que l`inévitable Boro va exploiter sans vergogne. Mais qui dit Boro dit finalement explosion, l'auteur échappe de justesse à la mort et, craignant d`être arrêté à la place du cynique pianiste, court au consulat de France, vocifère qu`il a déserté. qu`il en a honte, qu`il veut reprendre sa place au front. Il en fait tant qu'il est expulsé et trouve son chemin un nouveau guignol, Sosthène de Rodiencourt : celui-ci, affublé d`une femme particulièrement ardente mais relativement jeune, médite un voyage mirifique au Tibet...

"Féérie pour une autre fois" (1952)
Louis-Ferdinand Céline, auquel on reprochait d`avoir proclamé à voix très haute sa sympathie pour le nazisme, fut, en 1945. mis en prison à Copenhague, où il s`était réfugié. "Féerie" évoque ce séjour dans les geôles danoises, décousu, fiévreux, un livre qui ne s`arrête jamais au détail d`une vie quotidienne végétative et choisit de rendre compte de son expérience d'une façon tout à la fois plus globale, plus hautaine, plus rigoureusement poétique, écriront certains. Un roman à part pour cet orgueil, ce besoin d`absolu, ce dégoût de toute facilité, de toute complaisance classent ce roman un peu à part dans son oeuvre. Il nous livre un monologue fermé sur son propre délire, fantômes et hantises jaillissent, disparaissent, resurgissent et s`entrecroisent dans des pages qui témoigne de la souffrance de l`auteur, lui qui se raidit pour la dissimuler.
Sur la fin, le livre, soudain, bifurque et, remontant le temps, revient à Paris en 1944 : une chronique débute, oubliant sa prison, l'auteur ressuscite un nommé Julot, sculpteur et cul-de-jatte. qui était son voisin à Montmartre, c'est alors retrouver le Céline familier, fort en gueule, qui va écrire "Normance" (1954), "D'un château l'autre" (1957), "Nord" (1960), autant de péripéties de son odyssée à travers l'Allemagne démantelée de l'hiver 1944-1945 ...
"... Je repense à Rueil, là d'y repenser... les beaux arbres... les péniches au long... ma Maison de Repos ! quel coup de poisse ! Il finissait sa rhétorique le môme là juste... Il a hérité de tous mes livres le môme... C'est la fatalité de ma vie, je peux rien garder jamais, nulle part, un seul livre... Le Destin me fauche tout !
Le proprio allait tout me vendre... je les alerte : amis servez-vous ! Ils emballent ma bibliothèque... le môme la lecture ! la mère les instruments de cuisine ! Marcel, la cave !
Rien m'enivre comme les forts désastres, je me saoule facilement des malheurs, je les recherche pas positivement, mais ils m'arrivent comme des convives, qu'ont des sortes de droits... Je vous parlais donc de Rueil, du moment où tout naufrageait ! Ah, l'entreprise ! Deux huissiers de Chatou au cul ! J'appelle au secours mes braves amis... Je veux dire Arlon, Clémence, le môme... Les cires déjà sur mes serrures ! la vente le lendemain ! S'ils se magnent ! Tout pour l'amitié ! Ils foncent... ces agiles ! ils amènent même une tante de Nantes, une qu'ils hébergeaient pour deux jours ! ils me carriolent tout mon matériel ! en une nuit ! la cloche ! de Rueil à chez eux ! un charme ! sur les endosses puis voiture à bras, à l'allée et venue ça aurait rempli trois camions ! En plus de la Bibliothèque, et au moins douze casiers de bouteilles, cinq armoires à médicaments, un Poupinel, deux autres étuves, vingt-quatre lits complets, la cuisine entière...
J'étais ébaubi... Il me restait plus au lever du jour que cinquante Revues des Deux Mondes... je veux dire reliées, en bel état, et une moto avec side-car, et un tensiomètre « Pachon » et cinq seringues... Pour pas dire que je laissais rien... la valeur d'au moins deux quittances. Ah pour une capilotade ! mais ce qui me consolait un petit peu c'est que Marcel, sa femme et le môme et la tante en avaient sauvé ! pas pour moi ! pour eux ! J'aime pas les reliques, personnellement... je crois toujours qu'elles trimbalent une poisse... je voulais repartir à zéro, rattaquer la vie d'un autre sens... plus à l'enthousiasme !... Au gros zèle ! non ! Et plus toute cette complication, toutes ces idéalités ! plans sur la comète !... Salle à manger, salon, vingt chambres, standing bourgeois, contributions !... flûte ! Juste mon stéthoscope, un stylo, une table bois blanc... pas de frais !... pas de décors !
Allez vous fourrer ! Billevesées ! Votre bazar vous retombe ! la vie vous rattrape ! Pas de quartier ! Vous redéboulez votre toboggan, voguez, ramponnez, drossez ! encore plus bas ! Gnions, loques, bourre ! Le Destin c'est du pire en rond, savonneux...
Tomber plus bas qu'en réclusion c'est difficile ! En plus de l'exil !... Gâté l'enfant ! Combien que le toboggan m'a pris ? Cinquante ans d'acharné labeur, d'effroyables surhumains efforts... C'est pas mal joué ! Ruiné, si détesté partout, con perclus que c'en est une merveille que je bêle encore... Ma pauvre femme là sur l'autre grabat, ma danseuse, juste opérée... Le Moyen Âge avait du bon... une petite complainte vous viviez... maintenant faut écrire des gros livres... vous connaissez rue Réaumur la cour des Miracles ? Ces jours : cinéma ! Plus d'aumônes ! Avant l'ère des Libérations un prince vous sortait de cellule d'un mot ! un Noël ! Maintenant ! allez voir ! Ah la situation est toque !
Le roi Oluf, là d'où je me ronge, il pourrait pas me sortir d'un mot ! Il se ferait fesser par la foule si il lui venait la moindre fredaine. « Élargissez-moi cet homme ! » on l'assomme.
Je vous l'écris de partout par le fait ! de Montmartre chez moi ! du fond de ma prison baltave ! et en même temps du bord de la mer, de notre cahute !
Confusion des lieux, des temps ! Merde ! C'est la féerie vous comprenez...
Féerie c'est ça... l'avenir ! Passé ! Faux ! Vrai ! Fatigue ! Tout de même je réfléchis à une chose, c'est que le dernier clebs en rupture là qui vadrouille au ruisseau, fouine, mettons qu'il s'appelle Piram, a moins à redouter que mézigue !... hanté comme pas chien ! Pas hanté par son nom Piram ! c'est un nom supportable Piram !... Piram c'est pas une catastrophe !
Mais c'est pas tout mon nom immonde !
Y a la maladie ! y a l'envie ! y a les espions d'un peu partout... Vous verrez au cours des chapitres... si j'ai déjoué des stratagèmes ! si j'ai voyagé largement ! On a voyagé !... Lili et l'Ulysse... Sans incident un peu piquant je pourrais toujours vous tendre mon urne... pas drôle vous me lireriez jamais ! Ah mais m'achetez que clandestin ! Au jour tout est saisi d'avance ! (arrêt du 23 février) et cent mille dettes encore en retard ! et d'autres jugements et des appels et Super-Cour, etc.! plus la prison !
L'indignation ! Dégradation ! Tout !... Le toboggan c'est une force qu'une fois aspiré par l'abîme vous prenez chaque volte des horions, de ces ruées de coups plein la gueule, et plus en plus bas, que vous êtes plus que bouillie et larmes.
Réfléchissez ! la centrifugation des haines ! ..."

"Normance" (1954)
On fera de "Normance", - peinture d'un bombardement mais écrit par un visionnaire qui met en scène toute une atmosphère délirante -, le plus célinien de tous les romans de Céline... Ici les bombes se répètent, des bombes bêtes et bruyantes comme, hélas, les hommes qui les reçoivent. Et ce n'est pas tant de peindre une réalité qui passionne l'auteur mais de rendre compte d'un phénomène global, hallucinant. Le cul-de-jatte emboîté dans une caisse à roulettes qui, malgré mille et mille secousses plus violentes les unes que les autres, parvient comme en se jouant à se maintenir en équilibre au sommet d'un moulin, un moulin se dresse juste devant la fenêtre de Céline qui, par jalousie, déteste l`infirme et lui hurle, le cul-de-jatte lui répond par des mimiques et fait des signes aux avions comme s`il orchestrait leurs évolutions. Pendant ce temps, la foule des locataires de l`immeuble s`écrase dans la loge de la concierge, une foule ahurie, criarde, des querelles éclatent, de plus en plus vives à mesure qu`avance la nuit. Calant un demi-buffet prêt à s'effondrer, le pachydermique Normance ronfle, et dès qu'elles l'entendent grogner, sa femme et sa belle-sœur l`adjurent de e pas bouger, mais l'échafaudage s'écroule, la femme gît, inanimée, on réclame Céline, qui n`arrive pas à se frayer un passage jusqu`à elle. Se servant du mari comme bélier. on défonce la porte d`un appartement, on le pille, on s`enívre, on se débarrasse de Normance, on le jette dans une crevasse qui s'est ouvert sous l`ascenseur. A l`aube, les avions s`éloigneront, un grand calme tombe avec un beau matin tout blanc, Céline se rend compte, au bruit décroissant de leurs disputes, que les gens se séparent. Malade, il est hissé chez lui par un copain, il y retrouve sa femme et son chat qui avaient passé, ensemble, la nuit sur le toit. Mais les sirènes, à nouveau, hurlent...
"... Les locataires sous la table ils comprennent même pas le maléfice ! que c'est lui là-haut qui branle tout !... qu'attise les tonnerres ! pas un qui regarde par la fenêtre !... pas un qui voie Jules !... ils voient dalle !... ils voient même pas le buffet qui hausse... tangue... le buffet qui se soulève... quelque chose comme buffet ! une énormité pour une loge !... si il culbute, si il s'abat le buffet, le meuble Henri III d'avant-guerre... ça va être la bouillie totale ! je parle sous la table !... ah, le « feuilleté » de locataires ! charnier au jus ! Ils voient rien ! ils sont trop pris par eux-mêmes, par leur propre grouillement... ils sont à la strangulation et à se retourner les bras, les têtes, les genoux...
– Assassin ! mon œil ! oh, la frappe ! tu me tiens André ! Butor ! mon chéri ! Monsieur ! « mosquito » ! mon bébé ! mon amour ! Adèle !...
– Flûte les bébés ! c'est Jules ! c'est Jules !
Y a des dénonceurs de périls ! je suis de ceux ! je suis de ceux ! pourquoi ?
Alas ! Vanitatas ! pas un locataire m'écoute ! un peu plus de nerf, de dignité, on s'élancerait tous à l'assaut ! et à la ballotte !... au feu ! au feu ! sorcier canaille cul-de-jatte acrobate ! au four !... je leur répète !... je leur hurle !...
– C'est Jules ! C'est Jules ! À l'assaut !
Brrroum ! Brrroum ! ça serait que des brrroum mon récit si je me laissais ahurir... mais non ! mais non !... les détails ! des exactitudes ! je vous égare pas dans les broum !... tous ces emmêlés sous la table, viandes la trouille, voient plus rien, comprennent plus rien... le vrai péril : dalle ! ils se replient dessous les uns autres... ils se ratatinent compriment tant plus !... ils voient pas le buffet !... moi, je le vois !... il s'hausse le buffet !... d'un mètre !... je vous ai dit ! au moins un mètre ! je visionne pas !! un mètre au moins !... au moment d'un choc du fond ! et vrrac ! et que ça y est ! qu'il croule s'abat ! et vrang ! fend ! voilà, ce qui est arrivé !
Les « sous la table », alors, ces cris ! Delphine jaillit ! de la compression ! elle s'envole ! elle plane au couloir ! pflaf ! plat ventre !... Je suis là, je vois, et elle appelle : « Marius !... aaaah ! René ! Justin ! Clément ! docteur ! docteur ! »
On est beaucoup auxquels elle pense...
– Qu'est-ce que vous voulez ?
C'est Lili qui répond pour elle :
– Café ! café !
Ah, café ! ce mot !
– Grue ! salope !
Je la corrigerais !...
– Jules, le café ! Va le chercher garce !
– Les lumières, Louis ! Regarde les lumières !
La diversion avec les femmes ! Vous savez plus ! avancez plus ! vous existez plus...
– Quoi ? quoi ? lumières ?
C'est vrai que c'est des nouveaux feux... depuis qu'ils vous sonnent, picratent, jamais eu encore des feux mauves... va pour les « mauves » ! zut ! ça fait combien d'heures qu'ils nous secouent ? Faut pas demander sous la table !... mon verre de montre ? cassé !... cassé !... sous la table ils se rattrapent les têtes... ils se trompent de pieds...
– À moi, voyou ! taisez-vous, garce ! malhonnête salaud !
Je dirais que ma cabèche moi vrombit des échos des engins dans l'air en plus du moulin d'en face ! le piaulement furieux de ce moulin ! des ailes ! c'est merveille qu'il s'envole pas ! quatre géantes ailes ! et le signalisateur à foudres avec ! ah, pas de danger ! maléficieux ! il décollera pas de la plate-forme !
Je remarque, justement, pour les bruits, je suis plus sensible à certains que d'autres... j'ai toute une usine dans la tête... vous diriez vous-même, vous auriez !... des tours, des pilons, des courroies, des véritables bancs d'essai, certains moments... j'aurais pas mon caractère, optimiste bien qu'il en paraisse, et Arlette et la jalousie, mon compte avec un certain Jules, et le voyou chat encore en fugue, et mes manuscrits là-haut, que merde j'ai laissés sur la planche, la tête donc très préoccupée, plus mes malades au dispensaire, je me laisserais peut-être obséder ? hanter ? oisif, je serais peut-être perdu ! oh, mais aucun risque !... je devrais être à Bécon maintenant ! voilà qui me hante ! je devrais pas être là, à rouler, d'un mur l'autre, avec ces ignobles ! je devrais être à Bécon, au Devoir !
Par exemple un peu mal au cœur...
– Lili !... Lili !... ça va pas !
Elle rit Lili... elle rit... la disposition de cette petite !... joyeuse ! aimable... amène !... amène, oui ! brroum ! brroum !... et les cieux crèvent !... flammes... grenailles... phosphores... rien lui fait perdre sa gentillesse !... Jules la fait rire ! Perché-la-gondole-l'acrobate !... elle le trouve pas méchant du tout ! et que je suis même très dur avec lui !...
Brrroum ! la loge entière hausse, hoque, incline !... un tremblement de terre et de plancher !... et la table et le Normance en dessous ! tout se soulève ! s'enlève ! et le buffet ! tout rabat ! culbute ! tout le poids... Ah, ils étaient au moins vingt-cinq ! cinquante... femmes... enfants... ratatinés... recroquevillés !... ça s'ébroue debout... bute... titube... l'énorme Normance se retrouve plus... il échoue assis sur une chaise... sa femme l'étreint... et le quitte pas ! blottie sur ses genoux... heureusement, le buffet est redressé... ils l'ont redressé... ils le calent !... pas le buffet entier... le demi !... l'autre moitié est partie au vent ! à l'avenue !... fendu l'Henri III !... fendu !... mais ce qui reste c'est encore du meuble !
– Bouge plus André ! Bouge plus !
Elle pleure.
Broum ! une autre levée du séisme ! tout le bastringue verse ! tous les locataires, raplatis ! rejetés sous la table ! et d'autres en plus qu'arrivent d'en haut... et du dehors !..."

"D'un Château à l'autre" (1957)
Louis-Ferdinand Céline a dépassé la soixantaine, mais n'a pas perdu une miette de sa véhémence, il en joue, ne mâche pas ses mots, et les mâche si peu qu'il faut se garder de prendre ce qu'il dit à la lettre : il n'a peut-être jamais dû en penser le dixième. Avant tout, on l'a dit, c'est un comédien, de tempérament, qui livre bruts des matériaux dont d'autres eussent tiré, en prenant du recul et après un effort de composition, une œuvre plus traditionnelle, mais presque aussi sûrement plus froide et plus fade. On l'a dit et répété, son pouvoir créateur est primitif, mais énorme.
Ayant pour théâtre trois châteaux où Céline est passé, ce roman retrace trois étapes successives de son existence mouvementée, les dernières. Entre Sigmaringen et la villa de Bellevue, la prison et l'hôpital de Copenhague font figure de parents pauvres : il n'a pas trouvé grand-chose à en dire. On a l'impression qu'il a souffert de ne pas pouvoir s'agiter. La réflexion et l'analyse ne sont pas son fort, il lui faut une riche matière à exploiter, de la vie et du mouvement à brasser. Pour cette raison, les pages les plus réussies et les plus passionnantes de cette oeuvre sont celles qui dépeignent le petit monde qui, la guerre finissant, s'entassa, à la suite de Pétain et de son gouvernement, dans la bourgade de Sigmaringen. Il sait, avec ses tournures populaires, ses répétitions savamment rythmées, sa gouaille et ses enflures, via une emphase faussement naïve, faire ressortir ce qu'il voit partout : le navrant, le pitoyable, le grotesque, la mesquinerie et la laideur ...
De plus affolés, les réfugiés ne cessent d'affluer, alors que la nourriture, le charbon, les chambres, les médicaments, les installations sanitaires viennent à manquer, les avions alliés pilonnent le pays, des tyranneaux allemands, désemparés mais encore arrogants, maintiennent l'ordre à coups de cravache, leurs filles traînent à la gare où manœuvrent, interminablement, des trains bondés de soldats désœuvrés. Et pendant que les obscurs et les sans-grade piétinent, attendant d'imaginaires distributions de pain, le Maréchal et ses ministres vont se promener à la queue-leu-leu, en respectant l'ordre hiérarchique. Jumelles aux yeux, un amiral frais émoulu surveille le Danube. Laval, en échange d'un peu de cyanure, nomme l'auteur gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon....
" … je veux, y avait du monde au Château !… tous les étages !… quatorze ministres, plus le Brinon… quinze généraux… sept amiraux… et un Chef d’Etat !… les états-majors et les suites !… mais elle on l’avait jamais vue… planquée boudeuse !… ni Lili, ni moi… surtout Lili qu’allait partout !… elles devaient vivre au fond d’un tunnel… et elles sortaient juste pour la boule !… au moment de la grande ripopée !… que les insurgés se tenaient plus !… vrrang ! et brrang !… qu’ils cognaient tous ?… que le pontlevis cède !… vrrang !… et les injures !… Hermilie digne, et son ombrelle, rien à faire avec ces voyous !… parlait qu’à sa dame !… oh ! mais qu’elle tenait dur à sa boule !… nun ! nun ! te relançait sa dame timide !… nun ! nun ! qu’elle cogne aussi ! qu’elle cogne avec ! qu’elle laisse pas passer son tour et ces 1142 gueulards ! brang ! pftouf ! comme si la boule leur était due ! ils frappent ! frappent ! effrontée horde ! au moment là juste le clairon !… oui !… juste !… de l’autre côté du rempart !… « aux champs ! » la garde du Château !… pas des clairons boches, les boches font bugles !… non ! des vrais clairons !… vous auriez dit Lunéville… ou la Pépinière… le pont-levis branle… ses chaînes… ses poulies… le tablier bouge… du bout tout en l’air… baisse… s’abaisse tout lentement… blang ! vlang !…, ça y est ! il a posé !… au niveau !… là alors on pouvait s’attendre à plein de larbins chargés de paniers, pleins de boules, brioches, saucisses et petits fours !… la distribution formidable !
Zébi !… des flics qui émergent !… trois quatre d’abord… et puis bien cinquante schuppos dans un gros camion gazogène… et puis encore une bande de flics… une autre police française !… et puis après eux… le Maréchal ! oui !… lui !… Debeney à sa gauche, en retrait… le général Debeney, l’amputé… mais pas plus de « boules » que de beurre au chose !… la promenade du Maréchal !… voilà ce qu’ils avaient attendu les 1142 lustrucs… vous auriez pu croire… rien du tout !… qu’ils allaient l’agonir affreux… que c’était la honte ! l’infamie ! pas du tout !… lui, ses 16 cartes !… tout le monde le savait !… et qu’il se les tapait !… qu’il en laissait miette à personne ! et que c’était le fameux appétit !… en plus le confort total !… crèche comme un roi !… et qu’était responsable de tout ! Verdun ! Vichy ! et du reste ! et de la misère qu’on se trouvait ! la faute à Pétain ! à lui ! lui, là-haut, soigné, comme un rêve !… tout son étage pour lui tout seul !… chauffé ! quatre repas par jour ! 16 cartes, plus les cadeaux du führer, café, eau de Cologne, chemises de soie… un régiment de flics à sa botte !… un général d’état-major… quatre autos… Vous auriez pu vous attendre que ce ramas de loquedus sursaute ! se jette dessus ! l’étripe !… pas du tout !… juste un peu de soupirs !… ils s’écartent !… ils le regardent partir en promenade… la canne en avant ! et hop !… et digne ! il répond à leurs saluts… hommes et rombières… les petites filles : la révérence !… la promenade du Maréchal !… mais pas plus de pain que de saucisson… Hermilie de Hohenzollern salue pas, elle !… encore plus rêche, revêche qu’avant… Komm ! Komm !… que sa demoiselle vienne !… elles redisparaissent… elles nous disent même pas au revoir !… le trou par où elles étaient venues… la sorte de fente dans les cailloux… elle et sa suivante… juste à peine le temps qu’elles se faufilent… plus d’Hermilie !… plus de demoiselle !… elles étaient reparties sous le Château… ah ! elles avaient pas eu de pain non plus !… zut !… nous non plus !… flûte !… Lili, moi, Bébert on était venus un peu pour ça… pas le temps d’être tristes… je vois Marion ! je l’aperçois… Marion, le seul qu’a eu du cœur, qui nous a jamais oubliés… qu’est toujours venu nous apporter tout ce qu’il pouvait au « Löwen »… pas grand-chose !… des petits restes… surtout des petits pains… y avait des petits pains au Château… pas beaucoup, mais enfin trois quatre par ministre… ça compte d’être ministre, des moments… Marion pensait toujours à nous, et à Bébert… sa grande rigolade c’était que Bébert lui fasse Lucien… Lucien Descaves… Bébert, je lui mettais mon cache-nez… avec ses moustaches en bataille il faisait très bien Lucien Descaves… c’était notre moment de plaisanterie… ah ! que c’est loin !… j’y pense… fini Lucien !… fini Marion !… fini Bébert !… partis tous !… les souvenirs aussi !… tout doucement…
Je vous disais donc… j’aperçois Marion ! lui aussi était de la promenade… mais à grande distance de Pétain !… ils étaient pas à se parler… oh ! du tout !… tous les régimes, tous les temps, les ministres s’haïssent… et pire, au moment que tout croule, culbute !… fâcherie absolue !… l’effrénésie de toutes les rancœurs !… là, c’était au point qu’ils osaient même plus se regarder !… qu’ils en avaient sur la patate, qu’ils se seraient massacrés là à table, aux repas, d’un œil de travers !… ils aiguisaient leurs couteaux entre la poire et le fromage d’une façon si menaçante que toutes les épouses se levaient !… « Viens ! Viens !… » te faisaient sortir leurs ministres, généraux, amiraux !… qu’étaient imminents d’en découdre ! bouillants ! oh ! partout pareil !… que ce soit Berchtesgaden, Vichy, Kremlin, Maison-Blanche, entre la poire et le fromage, c’est pas des endroits à se trouver !… chez les Hanovre-Windsor non plus !… entre poire fromage… donc vous comprenez la promenade… distances ! Protocole !… pas question de bras-dessus bras-dessous !… très loin !… très loin les uns des autres !… le Maréchal, Chef de l’État, très en avant, et tout seul ! son chef d’État-Major Debeney, le manchot, trois pas en arrière, et à gauche… plus loin, un ministre… plus loin encore, un autre ministre… queue leu leu… séparés par au moins cent mètres… et puis les flics… la procession sur au moins trois kilomètres… on pourra dire tout ce qu’on voudra, je peux en parler à mon aise puisqu’il me détestait, Pétain fut notre dernier roi de France. « Philippe le Dernier »… la stature, la majesté, tout !… et il y croyait !… d’abord comme vainqueur de Verdun… puis à soixante-dix ans et mèche promu Souverain ! qui qui résisterait ?… raide comme ! « Oh ! que vous incarnez la France, monsieur le Maréchal ! » le coup d’« incarner » est magique !… on peut dire qu’aucun homme résiste !… on me dirait « Céline ! bon Dieu de bon Dieu ! ce que vous incarnez bien le Passage ! le Passage c’est vous ! tout vous ! » je perdrais la tête ! prenez n’importe quel bigorneau, dites-lui dans les yeux qu’il incarne !… vous le voyez fol !… vous l’avez à l’âme ! il se sent plus !… Pétain qu’il incarnait la France il a godé à plus savoir si c’était du lard ou cochon, gibet, Paradis ou Haute Cour, Douaumont, l’Enfer, ou Thorez… il incarnait !… le seul vrai bonheur de bonheur l’incarnement !… vous pouviez lui couper la tête : il incarnait !… la tête serait partie toute seule, bien contente, aux anges ! Charlot fusillant Brasillach aux anges aussi ! il incarnait ! aux anges tous les deux !… ils incarnaient tous les deux !… et Laval alors ? Dans bien plus modeste, plus pratique aussi, le truc d’« incarner » vous fait encore de ces petits miracles ! .."
