- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

Mystery & Suspense - Dashiell Hammett (1894-1961), "The Maltese Falcon" (1930), "Red Harvest" (1929), "The Dain Curse " (1930), "The Glass Key" (1931), "The Thin Man" (1934); "Woman in the Dark" (1933) - James M. Cain (1892-1977), "The Postman Always Rings twice" (1934), "Double Indemnity" (1936), "Mildred Pierce" (1941) - Horace McCoy (1897-1955), "They Shoot Horses, Don't They?" (1935) - William R. Burnett (1899-1982), "Little Caesar" (1929), "Dark Hazard" (1933), "The Asphalt Jungle" (1950 - Ellery Queen (1929-1958), "The Siamese Twin Mystery" (1933) - ...
Last update : 02/02/2018

"Hammett gave murder back to the kind of people who do it for a reason, not just to provide a corpse; and with means at hand, not with handwrought dueling pistols, curare, and tropical fish", écrira Raymond Chandler. Dashiell Hammett a créé la célèbre "the hardboiled school of detective fiction" qui mettra en scène Sam Spade, le détective dur des durs qui combat les gangs du crime organisé tout en conservant un certain cynisme face au cycle de la violence et de la corruption qui règne dans le monde qui l’environne. Par-delà l'intrigue et le suspense, il donne une image frappante de l'Amérique de la prohibition, de ses moeurs politiques liées à la montée du gangstérisme, démonte les rouages du "Big Business" voué à la lutte sans merci du pouvoir et de l'argent. "The Maltese Falcon" va constituer le modèle du nouveau roman policier américain, l'action y est constante et chaque nouveau personnage qui surgit dans le fil du récit ajoute au suspense. Spade est quant à lui un détective peu banal, terriblement vivant et humain avec sa lassitude, sa corpulence d'homme plus très jeune mais aimant les femmes et étant aimé d`elles, assez lucide toutefois pour ne pas se laisser berner en dernier ressort, un personnage qui ne cessera de faire école....




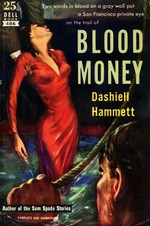
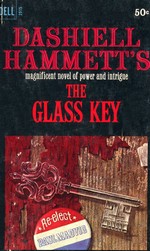


Dashiell Hammett (1894-1961)
Natif du Maryland, le futur Detective-story master Hammett quitte l'école à quatorze ans pour exercer nombre de petits métiers puis devient détective pour l'agence Pinkerton. La Première guerre mondiale le voit malade, traîner d'hôpital militaire en hôpital militaire, et se met alors à écrire : "Red Harvest" (La Moisson rouge), "The Dain Curse" (Sang maudit), "The Maltese Falcon" (1929), "The Glass Key" (1931, La Clé de verre), "The Thin Man" (1934, L'Introuvable), et des nouvelles réunies en 1966 sous le titre "The big knock over". A 48 ans, il participe à la Seconde guerre mondiale. En 1951, le maccarthisme lui vaut de la prison. C'est avec Dashiell Hammet que le roman policier acquiert ses lettre de noblesse, il donne non seulement une image percutante de l'Amérique de la prohibition et de la montée du gangstérisme, si proche du "business" qui étend ses rouages à l'ensemble de la société dominante, mais, écrira Chandler, il aura réussi à faire ce que "seuls les meilleurs écrivains peuvent faire, écrire des scènes qui semblent n'avoir jamais été écrites auparavant..."

"The Maltese Falcon" (1929, Le Faucon maltais)
"Talking is something you can't do judiciously unless you keep in practice." - "Le faucon maltais" est la meilleure œuvre de Hammett, notamment parce que son protagoniste est le détective privé désormais archétypal, Sam Spade, embauchée par une femme fatale sous de faux prétextes, Brigid O’Shaughnessy qui prétend à la recherche de sa sœur disparue ... C'est, avec Raymond Chandler, à Hammett que I'on doit la transformation du roman policier: l'ancien modèle du maître détective qui s'attaque à un crime insondable est remplacé par une approche plus «quotidienne ››. Cette transition a été de toute évidence influencée par la croissance rapide de l'espace urbain, des grandes entreprises et de la corruption, facteurs qui semblent tous caractériser les années 1920 et 1930 en Amérique du Nord. Tout en brossant une vaste fresque, Hammett présente dans son œuvre divers protagonistes, des lieux à la fois réels et fictifs et des descriptions très "ouvertes". Ses intrigues alambiquées offrent une série apparemment interminable de rebondissements, en opposition aux miasmes de corruption qui enveloppent l'œuvre de Chandler. Sam Spade est l'un des nombreux détectives créés par Hammett. Il se meut dans un univers violent et sordide, où tout un chacun s'avère égoïste, malhonnête et traître. Ce héros qui bluffe les voyous comme un vrai archétype de roman de gare est tout aussi amateur de bagarres et de jurons que des coups de génie, dans la veine d'un Sherlock Holmes ou d'un Dupin. C'est cette nature composite qui prime dans Le Faucon maltais, fusion de romans policiers où certains éléments historiques de ce genre littéraire se mêlent à des scènes d'action et d'aventure, dans un univers où l'on se fera soit voler soit tuer si l'on respecte les règles....
I. Spade & Archer
"Samuel Spade's jaw was long and bony, his chin a jutting v under the more flexible v of his mouth. His nostrils curved back to make another, smaller, v. His yellow-grey eyes were horizontal. The V motif was picked up again by thickish brows rising outward from twin creases above a hooked nose, and his pale brown hair grew down-from high flat temples-in a point on his forehead. He looked rather pleasantly like a blond Satan.
He said to Effie Perine: "Yes, sweetheart?"
She was a lanky sunburned girl whose tan dress of thin woolen stuff clung to her with an effect of dampness. Her eyes were brown and playful in a shiny boyish face. She finished shutting the door behind her, leaned against it, and said: "There's a girl wants to see you. Her name's Wonderly."
"A customer?"
"I guess so. You'll want to see her anyway: she's a knockout."
"Shoo her in, darling," said Spade. "Shoo her in."
Effie Perine opened the door again, following it back into the outer office, standing with a hand on the knob while saying: "Will you come in, Miss Wonderly?"
A voice said, "Thank you," so softly that only the purest articulation made the words intelligible, and a young woman came through the doorway. She advanced slowly, with tentative steps, looking at Spade with cobalt-blue eyes that were both shy and probing. She was tall and pliantly slender, without angularity anywhere. Her body was erect and high-breasted, her legs long, her hands and feet narrow. She wore two shades of blue that had been selected because of her eyes. The hair curling from under her blue hat was darkly red, her full lips more brightly red. White teeth glistened in the crescent her timid smile made.
"La mâchoire de Samuel Spade était longue et osseuse, son menton était un v en saillie sous le v plus souple de sa bouche. Ses narines se recourbent pour former un autre V, plus petit. Ses yeux jaune-gris sont horizontaux. Le motif du V est repris par des sourcils épais qui s'élèvent vers l'extérieur à partir de deux plis jumeaux au-dessus d'un nez crochu, et ses cheveux brun pâle descendent, à partir de tempes hautes et plates, en une pointe sur son front. Il ressemblait agréablement à un Satan blond.
Il dit à Effie Perine : "Oui, ma petite ?"
C'était une jeune fille maigre, brûlée par le soleil, dont la robe bronzée en laine fine lui collait à la peau avec un effet d'humidité. Ses yeux étaient bruns et enjoués dans un visage brillant de garçon. Elle finit de fermer la porte derrière elle, s'y adosse et dit : "Une fille veut vous voir. Elle s'appelle Wonderly."
"Une cliente ?"
"Je suppose que oui. Vous voudrez la voir de toute façon : elle est superbe."
"Fais-la entrer, ma petite", dit Spade. "Fais-la entrer."
Effie Perine ouvrit à nouveau la porte, la suivit jusqu'au bureau extérieur et resta debout, la main sur la poignée, tout en disant : "Voulez-vous entrer, Mlle Wonderly ?"
Une voix dit "Merci", si doucement que seule l'articulation la plus pure rendait les mots intelligibles, et une jeune femme franchit le seuil de la porte. Elle avança lentement, à pas hésitants, regardant Spade avec des yeux bleus cobalt à la fois timides et pénétrants. Elle était grande et mince comme une plume, sans aucune angularité. Son corps était droit et sa poitrine haute, ses jambes longues, ses mains et ses pieds étroits. Elle portait deux nuances de bleu qui avaient été choisies en raison de ses yeux. Les cheveux qui bouclaient sous son chapeau bleu étaient d'un rouge sombre, ses lèvres pleines d'un rouge plus vif. Ses dents blanches brillaient dans le croissant que formait son timide sourire.
Spade rose bowing and indicating with a thick-fingered hand the oaken armchair beside his desk. He was quite six feet tall. The steep rounded slope of his shoulders made his body seem almost conical — no broader than it was thick — and kept his freshly pressed grey coat from fitting very well.
Miss Wonderly murmured, “Thank you,” softly as before and sat down on the edge of the chair’s wooden seat.
Spade sank into his swivel-chair, made a quarter-turn to face her, smiled politely. He smiled without separating his lips. All the v’s in his face grew longer.
The tappity-tap-tap and the thin bell and muffled whir of Effie Perine’s typewriting came through the closed door. Somewhere in a neighboring office a power-driven machine vibrated dully. On Spade’s desk a limp cigarette smoldered in a brass tray filled with the remains of limp cigarettes. Ragged grey flakes of cigarette-ash dotted the yellow top of the desk and the green blotter and the papers that were there. A buff-curtained window, eight or ten inches open, let in from the court a current of air faintly scented with ammonia. The ashes on the desk twitched and crawled in the current.
Miss Wonderly watched the grey flakes twitch and crawl. Her eyes were uneasy. She sat on the very edge of the chair. Her feet were flat on the floor, as if she were about to rise. Her hands in dark gloves clasped a flat dark handbag in her lap.
Spade rocked back in his chair and asked: “Now what can I do for you, Miss Wonderly?”
She caught her breath and looked at him. She swallowed and said hurriedly:
“Could you — ? I thought — I — that is—” Then she tortured her lower lip with glistening teeth and said nothing. Only her dark eyes spoke now, pleading.
Spade smiled and nodded as if he understood her, but pleasantly, as if nothing serious were involved. He said: “Suppose you tell me about it, from the beginning, and then we’ll know what needs doing. Better begin as far back as you can.”
“That was in New York.”
“Yes.
Spade se leva en s'inclinant et en indiquant d'une main aux doigts épais le fauteuil en chêne qui se trouvait à côté de son bureau. Il mesurait près d'un mètre quatre-vingt-dix. La pente raide et arrondie de ses épaules donnait à son corps un aspect presque conique - pas plus large qu'épais - et empêchait son manteau gris fraîchement repassé de lui aller très bien.
Mlle Wonderly murmura " Merci " tout bas, comme auparavant, et s'assit sur le bord du siège en bois de la chaise.
Spade s'enfonça dans son fauteuil pivotant, fit un quart de tour pour lui faire face et lui sourit poliment. Il sourit sans séparer les lèvres. Tous les v de son visage s'allongèrent.
La porte fermée laissait entendre le tappity-tap-tap, la cloche fine et le ronronnement sourd de la machine à écrire d'Effie Perine. Quelque part dans un bureau voisin, une machine à moteur vibrait sourdement. Sur le bureau de Spade, une cigarette molle fumait dans un plateau en laiton rempli de restes de cigarettes molles. Des flocons gris et déchiquetés de cendres de cigarettes parsemaient le plateau jaune du bureau, le buvard vert et les papiers qui s'y trouvaient. Une fenêtre à rideau de couleur chamois, ouverte de huit ou dix pouces, laissait entrer de la cour un courant d'air légèrement parfumé à l'ammoniaque. Les cendres sur le bureau remuaient et rampaient dans le courant.
Mlle Wonderly regardait les flocons gris se tortiller et ramper. Ses yeux étaient inquiets. Elle s'assit sur le bord de la chaise. Ses pieds étaient posés à plat sur le sol, comme si elle s'apprêtait à se lever. Ses mains gantées de noir tenaient un sac à main plat et sombre sur ses genoux.
Spade se renversa dans son fauteuil et demanda : "Que puis-je faire pour vous, Mlle Wonderly ?"
Elle reprit son souffle et le regarda. Elle déglutit et dit précipitamment :
"Pourriez-vous... ? Je pensais - je - c'est-à-dire -" Puis elle se tortura la lèvre inférieure avec des dents étincelantes et ne dit plus rien. Seuls ses yeux sombres parlaient maintenant, suppliants.
Spade sourit et hocha la tête, comme s'il la comprenait, mais de façon plaisante, comme si rien de sérieux n'était en jeu. Il reprit : "Si vous me racontiez tout, depuis le début, nous saurions ce qu'il faut faire. Commencez par le plus loin possible."
"C'était à New York."
"Oui.
(...)
Apparu pour la première fois dans le magazine Black Mask, The Maltese Falcon a été publié en série dans cinq numéros de septembre 1929 à janvier 1930, avant de paraître sous forme de livre le mois suivant. Situé en 1928 à San Francisco, le héros du roman est Sam Spade, un détective privé en partenariat avec Miles Archer. Une « Miss Wonderly » les engage pour retrouver sa sœur cadette, qui s’est enfuie avec un homme nommé Thursby. Elle veut que les détectives le suivent pour savoir où il est. Elle s’arrange pour rencontrer Thursby et Archer prend le premier quart, mais est tué dans une ruelle, abattu par un revolver anglais. La police contacte Spade, qui vient sur la scène de crime, mais il refuse de voir le corps d’Archer et part brusquement. Lorsque Thursby se retrouve mort devant son hôtel, Spade devient immédiatement suspect… Il ne fait aucun doute que Hammett et son éditeur connaissaient immédiatement l’importance de ce roman célèbre et tant vénéré. Joseph Shaw, rédacteur en chef de Black Mask, écrivait dans la publicité du magazine : "We want to go on record as saying that this story is a marvellous piece of writing — the finest detective story it has been our pleasure to read in book form, in any magazine of any kind, or in manuscript..".
Sam Spade, appelé à l 'aide par une jolie fille en détresse, s 'aperçoit rapidement qu 'elle lui cache une partie de la vérité...
She got up from the settee and went to the fireplace to poke the fire. She changed slightly the position of an ornament on the mantelpiece, crossed the room to get a box of cigarettes from a table in a corner, straightened a curtain, and returned to her seat. Her face now was smooth and unworried. Spade grinned sidewise at her and said: “You’re good. You’re very good.”
Her face did not change. She asked quietly: “What did he say?”
“About what?”
She hesitated. “About me.”
“Nothing.” Spade turned to hold his lighter under the end of her cigarette.
His eyes were shiny in a wooden satan’s face.
“Well, what did he say?” she asked with half-playful petulance.
“He offered me five thousand dollars for the black bird.”
She started, her teeth tore the end of her cigarette, and her eyes, after a swift alarmed glance at Spade, turned away from him.
“You’re not going to go around poking at the fire and straightening up the room again, are you?” he asked lazily.
She laughed a clear merry laugh, dropped the mangled cigarette into a tray, and looked at him with clear merry eyes. “I won’t,” she promised. “And what did you say?”
“Five thousand dollars is a lot of money.”
She smiled, but when, instead of smiling, he looked gravely at her, her smile became faint, confused, and presently vanished. In its place came a hurt, bewildered look. “Surely you’re not really considering it,” she said.
“Why not? Five thousand dollars is a lot of money.”
“But, Mr. Spade, you promised to help me.” Her hands were on his arm. “I trusted you. You can’t—” She broke off, took her hands from his sleeve and worked them together.
Spade smiled gently into her troubled eyes. “Don’t let’s try to figure out how much you’ve trusted me,” he said. “I promised to help you — sure — but you didn’t say anything about any black birds.”
“But you must’ve known or — or you wouldn’t have mentioned it to me. You do know now. You won’t — you can’t — treat me like that.” Her eyes were cobalt-blue prayers.
“Five thousand dollars is,” he said for the third time, “a lot of money.”
She lifted her shoulders and hands and let them fall in a gesture that accepted defeat. “It is,” she agreed in a small dull voice. “It is far more than I could ever offer you, if I must bid for your loyalty.”
Spade laughed. His laughter was brief and somewhat bitter. “That is good,” he said, “coming from you. What have you given me besides money? Have you given me any of your confidence? any of the truth? any help in helping you? Haven’t you tried to buy my loyalty with money and nothing else?
Well, if I’m peddling it, why shouldn’t I let it go to the highest bidder?”
“I’ve given you all the money I have.” Tears glistened in her white-ringed eyes. Her voice was hoarse, vibrant. “I’ve thrown myself on your mercy, told you that without your help I’m utterly lost. What else is there?” She suddenly moved close to him on the settee and cried angrily: “Can I buy you with my body?”
Their faces were a few inches apart. Spade took her face between his hands and he kissed her mouth roughly and contemptuously. Then he sat back and said: “I’ll think it over.” His face was hard and furious.
She sat still holding her numbed face where his hands had left it.
He stood up and said: “Christ! there’s no sense to this.” He took two steps towards the fireplace and stopped, glowering at the burning logs, grinding his teeth together.
She did not move.
"- Qu'a-t-il dit ? demanda-t-elle tranquillement.
"- A quel sujet?
Elle hésita.
- A mon sujet.
- Rien, dit Spade en tournant pour tenir la flamme de son briquet sous l'extrémité de sa cigarette. Ses yeux brillaient dans son visage triangulaire.
- Voyons, qu'a-t-il dit ? interrogea-t-elle avec une animation soudaine.
- Il m'a offert cinq mille dollars pour l'oiseau noir. [...] .
- Et qu'avez-vous répondu ?
- Que cinq mille dollars étaient une jolie somme.
Elle sourit. Il la regarda gravement et son sourire s'effaça faisant place à une expression de surprise peinée.
- Vous n'envisagez tout de même pas... balbutia-t-elle.
- Pourquoi pas ? Cinq mille dollars, c'est un joli magot.
- Mais, monsieur Spade, vous avez promis de m'aider. (Elle saisit son bras à deux mains.) Je me suis confiée à vous, vous ne pouvez pas...
Elle s'interrompit, lâcha le bras du détective et se tordit les mains. Spade sourit doucement et la regarda droit dans les yeux.
- Ne cherchons pas à calculer dans quelle mesure vous vous êtes confiée à moi, dit-il. J 'ai promis de vous aider, bien sûr, mais vous ne m'avez jamais parlé du moindre oiseau noir.
- Mais vous deviez le savoir... ou vous ne m'en auriez pas parlé... Vous le savez maintenant. Vous ne pouvez... Vous ne pouvez, pas me traiter comme ça.
Ses yeux étaient deux lumineuses prières bleu de cobalt.
- Cinq mille dollars, dit-il pour la troisième fois, c'est une jolie somme...."

"The Maltese Falcon" - Une première adaptation cinématographique fut produite en 1931 avec Ricardo Cortez dans le rôle de Spade et Bebe Daniels dans celui de Ruth Wonderly. Une version comique vit le jour en 1936, le titre "Satan Met a Lady", avec Bette Davis et Warren William. Puis ce fut la célèbre version de John Huston, en 1941,"avec Humphrey Bogart , tenant le rôle de Sam Spade, Mary Astor, Sydney Greenstreet, et Peter Lorre, une adaptation qui en effacerait l'oeuvre initiale tant le film est devenu un film culte dans la grande tradition des films noirs.

"The Thin Man" (1932)
Hammett introduit un nouveau type de détective: Sam Spade ou Marlowe n'existent pas véritablement en dehors des affaires dont ils s'occupent, ici au contraire les enquêteurs, Nick, le 'bon vivant distingué" et la séduisante Nora Charles, sont mariés, possèdent un schnauzer adoré, et leur très riche vie sociale est décrite en détails par l'auteur. Nous ne sommes plus face à des tempéraments solitaires et mythiques menant des enquêtes conventionnelles du genre noir, notre couple de détective mène au contraire grand train dans une luxueuse chambre d'hôtel et participe à des soirées somptueuses, toile de fond de l'affaire sur laquelle ils travaillent. Hammett était conscient de l'omniprésence de la corruption,y compris au sein des classes sociales les plus aisées, élément caractéristique selon lui de l'Amérique, et qui doit être représenté comme tel. Les relations mondaines et personnelles servent ici de révélateur au long d'une dynamique narrative parfois complexe qui se joue des identités et des faux-semblants, les dialogues entre nos deux héros sont particulièrement rapides et pleins de sous-entendus teintés d'érotisme. Le roman s'est bien vendu, 34 000 exemplaires à 2 $ chacun au cours des 18 premiers mois, mais ce sont les droits cinématographiques (William Powell et Myrna Loy incarneront notre couple de détectives) qui permettront à Hammett de pouvoir enfin dépenser sans compter...
"J’étais appuyé contre le bar dans un bar clandestin de la cinquante-deuxième rue, attendant que Nora finisse ses achats de Noël, quand une fille s’est levée de la table où elle était assise avec trois autres personnes et est venue me voir. Elle était petite et blonde, et que vous regardiez son visage ou son corps dans des vêtements de sport bleu poudre, le résultat était satisfaisant. « N’êtes-vous pas Nick Charles? » demanda-t-elle.
J’ai dit : « Oui. »
"I WAS LEANING against the bar in a speakeasy on Fifty-second Street, waiting for Nora to finish her Christmas shopping, when a girl got up from the table where she had been sitting with three other people and came over to me. She was small and blonde, and whether you looked at her face or at her body in powder-blue sports clothes the result was satisfactory. “Aren’t you Nick Charles?” she asked.
I said: “Yes.”
She held out her hand. “I’m Dorothy Wynant. You don’t remember me, but you ought to remember my father, Clyde Wynant. You—”
“Sure,” I said, “and I remember you now, but you were only a kid of eleven or twelve then, weren’t you?”
“Yes, that was eight years ago. Listen: remember those stories you told me? Were they true?”
“Probably not. How is your father?”
She laughed. “I was going to ask you. Mamma divorced him, you know, and we never hear from him — except when he gets in the newspapers now and then with some of his carryings on. Don’t you ever see him?”
My glass was empty. I asked her what she would have to drink, she said Scotch and soda, I ordered two of them and said: “No, I’ve been living in San Francisco.”
She said slowly: “I’d like to see him. Mamma would raise hell if she found it out, but I’d like to see him.”
“Well?”
“He’s not where we used to live, on Riverside Drive, and he’s not in the phone book or city directory.”
“Try his lawyer,” I suggested.
Her face brightened. “Who is he?”
“It used to be a fellow named Mac-something-or-other — Macaulay, that’s it, Herbert Macaulay. He was in the Singer Building.”
“Lend me a nickel,” she said, and went out to the telephone. She came back smiling. “I found him. He’s just round the corner on Fifth Avenue.”
“Your father?”
“The lawyer. He says my father’s out of town. I’m going round to see him.”
She raised her glass to me. “Family reunions. Look, why don’t—”
Asta jumped up and punched me in the belly with her front feet. Nora, at the other end of the leash, said: “She’s had a swell afternoon — knocked over a table of toys at Lord & Taylor’s, scared a fat woman silly by licking her leg in Saks’, and’s been patted by three policemen.”
I made introductions. “My wife, Dorothy Wynant. Her father was once a client of mine, when she was only so high. A good guy, but screwy.”
“I was fascinated by him,” Dorothy said, meaning me, “a real live detective, and used to follow him around making him tell me about his experiences.
He told me awful lies, but I believed every word.”
I said: “You look tired, Nora.”
“I am. Let’s sit down.
(...)
Initialement publié dans l’édition de décembre 1933 du magazine Redbook, ce roman est paru sous forme de livre le mois suivant. L’histoire se déroule à New York, en décembre 1932, pendant les derniers jours de la prohibition. L’ancien détective Nick Charles est approché par Dorothy, la fille d’un ancien client, Clyde Wynant, alors qu’il fait ses courses de Noël avec sa femme. Dorothy cherche son père et Charles la dirige vers l’avocat de Wynant, Herbert MacCauley. MacCauley déjeune avec Charles et lui dit qu’il ne sait rien de Wynant. Puis la femme de Nick, Nora, lui fait remarquer un reportage - Julia Wolf a été retrouvée tuée par balle dans son appartement. Wolf était la secrétaire de Clyde Wynant. Un Charles réticent, avec l’aide d’un approvisionnement régulier en alcool, enquête… "The most entertaining detective story to reach the market in many months?" Les critiques ont adoré ce roman, le mystère du meurtre lui-même en devenant presque d’une importance secondaire ...

"The Thin Man" - Le livre a été adapté au cinéma, sous le même titre, en 1934, mettant en vedette William Powell et Myrna Loy, réalisé par W. S. Van Dyke. Il fut très bien accueilli et nominé pour l’Oscar du meilleur film. Il donnera à cinq autres suites, culminant avec "Song of the Thin Man" en 1947 : "After the Thin Man" (1936), "Another Thin Man" (1939), "Shadow of the Thin Man" (1947), "The Thin Man Goes Home" (1945) ...

"Red Harvest" (1929, La Moisson rouge)
Le premier roman de Hammett a été publié dans Black Mask et sérialisé pendant les deux derniers mois de 1927 et les deux premiers mois de 1928. La revue Black Mask a été lancée en 1920 par le journaliste H. L. Mencken et le critique dramatique George Jean Nathan. "Red Harvest" est ensuite publié sous forme de livre par Knopf en janvier 1929. Il raconte l’histoire d’un détective, connu seulement sous le nom de The Continental Op, qui est appelé dans la ville minière occidentale de Personville — connue sous le nom de Poisonville par les habitants — par l’éditeur de journal Donald Willsson. Mais Willsson est assassiné avant qu’il ait une chance de le rencontrer. Le détective enquête, rencontre le père de Willsson, Elihu, un industriel local : la ville entière est aux mains d'une bande de gangsters. Willsson Senior promet de payer 10 000 $ à la Continental Detective Agency pour nettoyer la ville. Pour assainir la situation, avec l'aide involontaire de Dinah Brand, la courtisane locale, Notre détective met au point une méthode infaillible : dresser les truands les uns contre les autres jusqu'à élimination totale. L'opération semble réussir, mais Willsson Senior tente de revenir sur sa promesse ..…
Hammett en vint plus tard à considérer "Red Harvest" comme son meilleur roman, "It is the liveliest detective story that has been published in a decade", écrira Herbert Asbury, auteur de Gangs of New York, « C’est l’histoire de détective la plus vivante qui ait été publiée depuis une décennie. » ...
I. A Woman in Green and a Man in Gray
"I FIRST HEARD Personville called Poisonville by a red-haired mucker named Hickey Dewey in the Big Ship in Butte. He also called his shirt a shoit. I didn’t think anything of what he had done to the city’s name. Later I heard men who could manage their r’s give it the same pronunciation. I still didn’t see anything in it but the meaningless sort of humor that used to make richardsnary the thieves’ word for dictionary. A few years later I went to Personville and learned better.
Using one of the phones in the station, I called the Herald, asked for Donald Willsson, and told him I had arrived.
“Will you come out to my house at ten this evening?” He had a pleasantly crisp voice. “It’s 2101 Mountain Boulevard. Take a Broadway car, get off at Laurel Avenue, and walk two blocks west.”
I promised to do that. Then I rode up to the Great Western Hotel, dumped my bags, and went out to look at the city.
The city wasn’t pretty. Most of its builders had gone in for gaudiness. Maybe they had been successful at first. Since then the smelters whose brick stacks stuck up tall against a gloomy mountain to the south had yellow-smoked everything into uniform dinginess. The result was an ugly city of forty thousand people, set in an ugly notch between two ugly mountains that had been all dirtied up by mining. Spread over this was a grimy sky that looked as if it had come out of the smelters’ stacks.
The first policeman I saw needed a shave. The second had a couple of buttons off his shabby uniform. The third stood in the center of the city’s main intersection — Broadway and Union Street — directing traffic, with a cigar in one corner of his mouth. After that I stopped checking them up.
At nine-thirty I caught a Broadway car and followed the directions Donald Willsson had given me. They brought me to a house set in a hedged grassplot on a corner.
The maid who opened the door told me Mr. Willsson was not home. While I was explaining that I had an appointment with him a slender blonde woman of something less than thirty in green crêpe came to the door. When she smiled her blue eyes didn’t lose their stoniness. I repeated my explanation to her.
“My husband isn’t in now.” A barely noticeable accent slurred her s’s. “But if he’s expecting you he’ll probably be home shortly.”
She took me upstairs to a room on the Laurel Avenue side of the house, a brown and red room with a lot of books in it. We sat in leather chairs, half facing each other, half facing a burning coal grate, and she set about learning my business with her husband.
“Do you live in Personville?” she asked first.
“No. San Francisco.”
“But this isn’t your first visit?”
“Yes.”
“Really? How do you like our city?”
“I haven’t seen enough of it to know.” That was a lie. I had. “I got in only this afternoon.”
Her shiny eyes stopped prying while she said:
“You’ll find it a dreary place.” She returned to her digging with: “I suppose all mining towns are like this. Are you engaged in mining?”
“Not just now.”
She looked at the clock on the mantel and said:
“It’s inconsiderate of Donald to bring you out here and then keep you waiting, at this time of night, long after business hours.”
I said that was all right.
“Though perhaps it isn’t a business matter,” she suggested. I didn’t say anything.
She laughed — a short laugh with something sharp in it.
"Le patelin n`était pas joli. La majorité des propriétaires devaient aimer le genre tape-à-l'œil. L'effet avait peut-être réussi au début. Mais, depuis, la fumée jaune des fonderies, dont les cheminées de brique s'élevaient au sud devant une morne colline, avait tout revêtu d'une teinte uniforme et sinistre. Par là-dessus s`étalait un ciel gras qu'on aurait dit également vomi par les cheminées des usines. Le premier flic que j'aperçus avait une barbe de huit jours. Le second portait un uniforme minable auquel il manquait deux boutons. Un troisième, planté au milieu du principal carrefour de la ville - le croisement entre Broadway et Union Street - dirigeait la circulation le cigare au bec. Après celui-là, je cessai de les passer en revue.
A neuf heures trente, j'attrapai un tram dans Broadway et me mis en devoir de suivre les instructions de Donald Willsson. J'arrivai devant une maison située au milieu d'une pelouse entourée d'une haie qui faisait l'angle d'une rue. La bonniche qui vint m'ouvrir me déclara que M. Willsson n'était pas chez lui. Pendant que je lui expliquais que j`avais rendez-vous avec lui, une mince créature blonde, paraissant un peu moins de trente ans, vint à la porte. Elle avait une robe de crêpe de chine vert. Lorsqu'elle sourit, ses yeux bleus ne perdirent rien de leur dureté minérale. Je lui répétai mon explication.
_ Mon mari n'est pas là pour le moment. Mais s`il vous attendait, il ne va probablement pas tarder à rentrer.
Elle me fit alors monter dans une pièce donnant sur Laurel Avenue. C'était un salon dans les tons brun et rouge, bourré de bouquins. Lorsque nous fûmes assis sur des chaises de cuir, à demi tournés l'un vers l”autre et à proximité du charbon qui rougeoyait dans une grille, elle se mit à me cuisiner.
- Vous habitez Personville ? commença-t-elle.
- Non, San Francisco.
-- Mais ce n`est pas la première fois que vous venez ?
-- Si.
-- Vraiment? Comment trouvez-vous la ville?
- Je n'en ai pas vu assez pour être fixe. - C'était un mensonge, je l'étais. - Je ne suis arrivé que cet après-midi.
- Vous allez sans doute trouver l'endroit bien rnorne, observa-t-elle en détournant les yeux.
Puis elle revint à son enquête :
- Mais je suppose que tous les centres miniers se ressemblent. Vous travaillez dans les mines?
- Pas en ce moment.
Elle jeta un coup d'œil vers la pendule et dit :
- Ce n'est pas bien de la part de Donald de vous avoir fait venir ici à une heure pareille pour vous faire attendre.
Je l'assurai que c'était sans importance.
- Mais vous n'êtes peut-être pas venu pour affaires ? suggéra-t-elle.
Je ne répondis pas.
Elle se mit à rire d'un rire bref nuancé d'âpreté.
“I’m really not ordinarily so much of a busybody as you probably think,”
she said gaily. “But you’re so excessively secretive that I can’t help being curious. You aren’t a bootlegger, are you? Donald changes them so often.”
I let her get whatever she could out of a grin.
A telephone bell rang downstairs. Mrs. Willsson stretched her greenslippered feet out toward the burning coal and pretended she hadn’t heard the bell. I didn’t know why she thought that necessary.
She began: “I’m afraid I’ll ha—” and stopped to look at the maid in the doorway.
The maid said Mrs. Willsson was wanted at the phone. She excused herself and followed the maid out. She didn’t go downstairs, but spoke over an extension within earshot.
I heard: “Mrs. Willsson speaking… . Yes… . I beg your pardon? … Who? … Can’t you speak a little louder? … What? … Yes… . Yes… . Who is this? … Hello! Hello!”
The telephone hook rattled. Her steps sounded down the hallway — rapid steps.
I set fire to a cigarette and stared at it until I heard her going down the steps. Then I went to a window, lifted an edge of the blind, and looked out at Laurel Avenue, and at the square white garage that stood in the rear of the house on that side.
Presently a slender woman in dark coat and hat came into sight hurrying from house to garage. It was Mrs. Willsson. She drove away in a Buick coupé. I went back to my chair and waited.
Three-quarters of an hour went by. At five minutes after eleven, automobile brakes screeched outside. Two minutes later Mrs. Willsson came into the room. She had taken off hat and coat. Her face was white, her eyes almost black.
“I’m awfully sorry,” she said, her tight-lipped mouth moving jerkily, “but you’ve had all this waiting for nothing. My husband won’t be home tonight.”
I said I would get in touch with him at the Herald in the morning.
I went away wondering why the green toe of her left slipper was dark and damp with something that could have been blood.
- Je ne suis pas d'ordinaire aussi indiscrète que vous pouvez le croire, dit-elle d'un ton léger. Mais vous êtes tellement renfermé que je n'ai pu m'empêcher de me sentir curieuse. Vous n'êtes pas bootlegger, par hasard? Donald en change si souvent...
J 'ébauchai un vague sourire. Le téléphone sonna quelque part en bas. Mme Willsson tendit vers le feu un pied chausse d'un escarpin vert, et fit mine de n'avoir pas entendu. Je ne
m'expliquais pas le pourquoi de cette mímique. Elle commença. « Je crains bien d'être obligé de... », puis s'interrompit pour regarder la bonne qui venait d'apparaître à la porte.
Celle-ci annonça qu'on demandait Mme Willsson à l'appareil. Elle s'excusa et sortit derrière la bonne. Elle ne descendit pas au rez-de-chaussée, mais utilisa un appareil placé à portée de voix. J 'entendis :
- Ici, Mme Willsson . Oui... Je vous demande pardon ?... Qui?... Vous ne pourriez pas parler un peu plus haut... Quoi?... Oui... Oui... Qui parle ?... Allô! Allô!
Le crochet de l'appareil cliqueta et des pas rapides s'éloignèrent dans le hall. J'allumai une cigarette et gardai les yeux fixés dessus jusqu'à ce que j'eusse entendu descendre
l'escalier. Je m'approchai alors d'une fenêtre. Soulevant un coin du store, je jetai un regard dans Laurel Avenue et sur le cube blanc d'un garage qui se trouvait de ce côté sur les derrières de la maison. Bientôt, une mince silhouette féminine, en manteau et chapeau noirs, sortit de la maison et se hâta vers le garage. C'était Mme Willsson. Elle s`éloigna au volant d'un coupé Buick. Je retournai à ma chaise et attendis. Trois quarts d'heure s'écoulèrent. Cinq minutes après onze heures, les freins d'une automobile grincèrent au-dehors. Deux minutes après, Mme Willsson entrait dans la pièce. Chapeau et manteau avaient disparu. Son visage était livide, ses yeux presque noirs.
- Je suis absolument désolée, dit-elle avec un mouvement convulsif de ses lèvres minces, mais je crains que vous n'ayez attendu pour rien, mon mari ne rentrera pas ce soir.
Je lui dis que je tâcherais de l'atteindre le lendemain matin au Herald. Puis je pris congé en me demandant pourquoi le bout vert de son soulier gauche portait une tache sombre et humide qui ressemblait à du sang. J'allai à pied jusqu'à Broadway où je sautai dans un tram.
I walked over to Broadway and caught a street car. Three blocks north of my hotel I got off to see what the crowd was doing around a side entrance of the City Hall.
Thirty or forty men and a sprinkling of women stood on the sidewalk looking at a door marked Police Department. There were men from mines and smelters still in their working clothes, gaudy boys from pool rooms and dance halls, sleek men with slick pale faces, men with the dull look of respectable husbands, a few just as respectable and dull women, and some ladies of the night.
On the edge of this congregation I stopped beside a square-set man in rumpled gray clothes. His face was grayish too, even the thick lips, though he wasn’t much older than thirty. His face was broad, thick-featured and intelligent. For color he depended on a red Windsor tie that blossomed over his gray flannel shirt.
“What’s the rumpus?” I asked him.
He looked at me carefully before he replied, as if he wanted to be sure that the information was going into safe hands. His eyes were gray as his clothes, but not so soft.
“Don Willsson’s gone to sit on the right hand of God, if God don’t mind looking at bullet-holes.”
“Who shot him?” I asked.
The gray man scratched the back of his neck and said:
“Somebody with a gun.”
I wanted information, not wit. I would have tried my luck with some other member of the crowd if the red tie hadn’t interested me. I said:
“I’m a stranger in town. Hang the Punch and Judy on me. That’s what strangers are for.
Trois blocks avant mon hôtel, je descendis en marche pour découvrir la raison d'un rassemblement formé devant une entrée latérale du city-hall. Trente ou quarante bonshommes et une poignée de femelles étaient massés sur le trottoir, regardant une porte marquée "Police department". Il y avait là des mineurs et des ouvriers des fonderies encore en vêtements de travail, des gigolos de dancing et des habitués d'académies de billard, minces avec de minces figures pâles, des types aux gueules sinistres, de bons pères de famille, une pincée de femmes du même acabit et quelques horizontales. Je m'approchai et m'arrêtai à côté d°un individu trapu vêtu d'un costume gris tout froissé. Son large visage aux traits épais et intelligents et ses lèvres charnues étaient également grisâtres. La seule note de couleur de l'ensemble était fournie par une cravate rouge qui tranchait sur sa chemise de flanelle grise.
- Qu'est-ce qui se passe ? demandai-je.
Il me détailla soigneusement avant de répondre comme s'il avait voulu s'assurer que son renseignement s'adressait au bon endroit.
- Don Willsson est monté poser ses fesses à la droite du Père .. si les types transformés en écumoire ne lui font pas mal aux yeux.
- Qui l'a descendu? demandai-je.
Le type en gris se gratta la nuque et déclara:
- Un mec avec un pétard..."
(traduction PJ.Herr et Henri Robillot, Gallimard)
"Red Harvest" - Une adaptation cinématographique moins que fidèle, "Roadhouse Nights", fut réalisée par Paramount en 1930, avev Jimmy Durante. En 1972, Bernardo Bertolucci tenta de produire une nouvelle version, mais bien que Jack Nicholson et Debra Winger soient à bord, il n’obtint le financement nécessaire....

"The Glass Key" (1931, La Clé de verre)
C'est dans le monde politique, celui de la conquête du pouvoir et de la corruption qui s'ensuit, que nous entraîne Hammet, nous sommes à la veille d'élections qui opposent deux clans, le clan Henry et le clan Shad O'Rory, et, sous couvert d'un roman policier, la dénonciation des moeurs politiques américaines est bien présente et redoutable d'efficacité.
Publiée pour la première fois dans le magazine Black Mask entre mars et juin 1930, la version livre de "The Glass Key" est publiée l’année suivante. Le roman raconte l’histoire du joueur et racketteur Ned Beaumont, le meilleur ami de Paul Madvig, un patron politique véreux. Quand Beaumont trouve le corps du fils d’un sénateur dans la rue, Madvig lui demande d’étouffer l’enquête du procureur, car il veut que le sénateur corrompu épouse sa fille Janet. Quelqu’un envoie une série de lettres aux proches du crime suggérant que Madvig était le meurtrier et que la fille de Madvig, Opal, est le principal suspect, car elle était la petite amie de la victime. Madvig déclare alors la guerre à O’Rory, un chef de la mafia rival et, pour Beaumont, l’enfer éclate…
" ... Ned Beaumont took his hands away from the dead man and stood up. The dead man’s head rolled a little to the left, away from the curb, so that his face lay fully in the light from the corner street-lamp. It was a young face and its expression of anger was increased by the dark ridge that ran diagonally across the forehead from the edge of the curly fair hair to an eyebrow.
Ned Beaumont looked up and down China Street. As far up the street as the eye could see no person was there. Two blocks down the street, in front of the Log Cabin Club, two men were getting out of an automobile. They left the automobile standing in front of the Club, facing Ned Beaumont, and went into the Club.
Ned Beaumont, after staring down at the automobile for several seconds, suddenly twisted his head around to look up the street again and then, with a swiftness that made both movements one continuous movement, whirled and sprang upon the sidewalk in the shadow of the nearest tree. He was breathing through his mouth and though tiny points of sweat had glistened on his hands in the light he shivered now and turned up the collar of his overcoat.
He remained in the tree’s shadow with one hand on the tree for perhaps half a minute. Then he straightened abruptly and began to walk towards the Log Cabin Club. He walked with increasing swiftness, leaning forward, and was moving at something more than a half-trot when he spied a man coming up the other side of the street. He immediately slackened his pace and made himself walk erect. The man entered a house before he came opposite Ned Beaumont...."
Dashiell Hammett dénonce ici le "gangstérisme" politique, une dénonciation magistrale servie par un style sec et nerveux est à la fois, point de départ d'une littérature qui, sous l'apparence du "policier" , fait en fait le procès des mœurs politiques américaines. L'âpre bataille que se livrent, à la veille des élections, le clan Henry et le clan Shad O'Rory est significative de la corruption et des dégradations qu'entraîne la conquête du pouvoir. L'action débute dans la maison de jeux du maire sortant, Paul Madving, supporter du sénateur Ralph Bancroft Henry. A la veille de souper chez le sénateur, il reçoit la visite de Ned Beaumont, qui essaie de le persuader que Janet Henry se moque de lui en acceptant ses hommages et n'a en fait comme souci que l'intérêt de son père. Ce même soir, dans la nuit, Ned Beaumont bute,
devant la maison du sénateur, contre le cadavre de son fils, Taylor Henry. Il alerte Madving et téléphone à la police. La bande de Shad O'Rory, retranchée dans sa propre maison de jeux, ne manque pas d'exploiter ce meurtre, tandis que Ned le rapproche de la disparition d'un bookmaker, Bernie Despain, qui lui a volé trois mille deux cent cinquante dollars. Ned part pour New York sur les traces de son débiteur, récupère son argent, tout en progressant dans l'enquête menée au sujet de la mort de Taylor. La jeune Opal Madving croit son père coupable du meurtre de Taylor Henry, qui était son amant, et, pour se venger, elle se rapproche de la bande de Shad O'Rory, qui a un journal à sa solde, l'Observer. Ned, qui a échappé aux Shad O`Rory en piteux état, apprend que M. Farr, l'attorney du district, est déjà au courant d'une dispute qui aurait éclaté entre Taylor Henry et Madving, le soir du souper chez le sénateur. Pressé par Ned, Madving avoue. L'explication ne satisfait pourtant pas Ned qui, avec l'aide de Janet, la fille du sénateur, tente de découvrir la vérité. C'est le sénateur, en s'interposant entre les deux hommes, qui a fait tomber son fils contre le trottoir où il a buté malencontreusement et s`est tué. En laissant la dépouille de son fils sur le trottoir pour éviter de susciter un scandale préjudiciable à sa réélection, le sénateur a montré une bassesse que Janet ne lui pardonnera pas. (Trad. Gallimard, 1949).
Paramount comptait dès 1931 produire une adaptation de "The Glass Key" Gary Cooper, mais ce n'est qu'en 1935 que le film fut réalisé, George Raft pour jouer Ed Beaumont et Edward Arnold, Paul Madvig. Un nouveau film fut produit sept ans plus tard avec Alan Ladd dans le rôle d'Ed Beaumont et Brian Donlevy dans celui de Madvig...






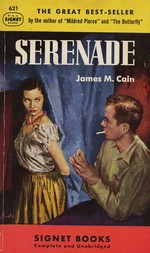

James M. Cain (1892-1977)
"James M. Cain, the quintessential hard-boiled writer" - Journaliste, scénariste, romancier, Cain semble obsédé par cette relation triangulaire qui noue tragiquement une femme et deux hommes, et son personnage masculin principal est le plus souvent d'une immaturité affective telle qu'il sombre littéralement, implacablement, dans les noirs desseins de la femme fatale: "The Postman Always Rings twice", "Double Indemnity" (Assurance sur la mort, 1936), "Mildred Pierce" (1941), trois romans immortalisés dans des films hollywoodiens classiques, "Serenade" (1937), "The Butterfly"(1947), "Sinful Woman" (1948), "Jealous Woman" (1950), mais aussi “Pastorale", “The Baby in the Icebox", “Dead Man", "Brush Fire" et "The Girl in the Storm"- En tant qu’écrivain californien, Cain est inévitablement rapproché de Dashiell Hammett, Raymond Chandler et, dans une moindre mesure, de Ross Macdonald. Ce sont des écrivains «tough guy» comme John Steinbeck, Ernest Hemingway, Horace McCoy et B. Traven. Le critique Edmund Wilson a qualifié Cain et ses pairs de «poets of the tabloid murder» parce qu’ils ont produit un nouveau style de littérature qui doit être pris au sérieux....

"The Postman Always Rings twice" (1934, Le facteur sonne toujours deux fois)
"Love, when you get fear in it, it's not love any more. It's hate" - Ce chef-d'œuvre du roman de gare, récit gothique des sombres conditions de vie en Californie durant la Grande Dépression, raconte l'histoire d'un amour voué à l'échec. Cain se demande à quel point ses protagonistes, Frank et Cora, sont capables d'agir indépendamment des forces politiques, économiques et sexuelles qui semblent déterminer leur vie. La capacité d'introspection de Frank est limitée; même s'il se veut libre de toute attache, il se laisse vite entraîner dans une relation passionnée et destructrice. Les aspirations petites-bourgeoises de Cora la poussent à assassiner son mari pour hériter de son café. Dépourvu de toute moralité et de sens du moi, Frank accepte rapidement de l'aider dans son dessein. Sur une route au bord d'une falaise, ils font boire le mari de Cora, l'assoient derrière le volant et l'envoient à sa mort. Lorsque les amants se retournent l'un contre l'autre, ils sont à la merci de la loi qui se révèle plus amorale qu'eux encore. La conclusion souligne comme l'existence humaine, voire le bonheur, est à la fois fugitive et arbitraire. Le Facteur sonne toujours deux fois a été filmé à trois reprises, et l'influence de Cain est immense dans le cinéma; il est par exemple difficile d'imaginer les frères Coen sans cet auteur...
Franck, une sorte de vagabond, vient donc d'être engagé dans la station-service de Papadakis. Il est immédiatement envoûté par Cora, la femme de son patron....
“What’s more, I don’t even come from around here. I come from Iowa.”
“Smith, hey. What’s your first name?”
“Cora. You can call me that, if you want to.”
I knew for certain, then, what I had just taken a chance on when I went in there. It wasn’t those enchiladas that she had to cook, and it wasn’t having black hair. It was being married to that Greek that made her feel she wasn’t white, and she was even afraid I would begin calling her Mrs. Papadakis.
“Cora. Sure. And how about calling me Frank?”
She came over and began helping me with the wind wing. She was so close I could smell her. I shot it right close to her ear, almost in a whisper. “How come you married this Greek, anyway?”
She jumped like I had cut her with a whip. “Is that any of your business?”
“Yeah. Plenty.”
“Here’s your wind wing.”
“Thanks.”
I went out. I had what I wanted. I had socked one in under her guard, and socked it in deep, so it hurt. From now on, it would be business between her and me. She might not say yes, but she woudn’t stall me. She knew what I meant, and she knew I had her number.
That night at supper, the Greek got sore at her for not giving me more fried potatoes. He wanted me to like it there, and not walk out on him like the others had.
“Give a man something to eat.”
" They’re right on the stove. Can’t he help himself?”
“It’s all right. I’m not ready yet.”
He kept at it. If he had had any brains, he would have known there was something back of it, because she wasn’t one to let a guy help himself, I’ll say that for her. But he was dumb, and kept crabbing. It was just the kitchen table, he at one end, she at the other, and me in the middle. I didn’t look at her. But I could see her dress. It was one of these white nurse uniforms, like they all wear, whether they work in a dentist’s oɽce or a bakeshop. It had been clean in the morning, but it was a little bit rumpled now, and mussy. I could smell her.
“Well for heaven’s sake.”
She got up to get the potatoes. Her dress fell open for a second, so I could see her leg. When she gave me the potatoes, I couldn’t eat ...
"- Je ne suis même pas d'ici. Je viens de l'Iowa.
- Et quel est votre prénom ?
- Cora. Vous pouvez m'appeler Cora si vous voulez.
[...]
- C'est entendu, Cora. Et vous, appelez-moi Frank.
Elle s'est approchée et m`a aidé à nettoyer le pare-brise. Elle était si près de moi que je respirais son odeur. Je lui ai glissé juste dans l'oreille :
- Comment as-tu pu épouser ce Grec ?
Elle a sursauté comme si je l'avais cinglée avec un fouet.
- Ça vous regarde ?
- Oui, beaucoup.
- Voilà votre pare-brise.
- Merci.
Je suis sorti. Je savais ce que je voulais savoir. Je l'avais coincée au toumant, et j'avais touché juste, elle avait marqué le coup. Dès maintenant nous étions liés, elle et moi. Elle pourrait ne pas dire oui, mais, au moment voulu, elle ne canerait pas. Elle avait compris et savait que je l'avais repérée.
[...]
Nous mangions sur la table de la cuisine, lui à un bout, elle à l'autre bout, et moi au milieu. Je ne la regardais pas, mais je voyais sa robe. C'était une de ces blouses blanches d'infirmière, pareilles à cet uniforme qu'elles portent toutes, qu'elles travaillent chez un dentiste ou chez un boulanger. Elle avait dû être propre le matin, mais maintenant elle était un peu froissée et souillée. Je sentais l'odeur de la femme.
- Oh! ça va!
Elle s'est levée pour prendre les pommes de terre. Sa blouse s'est ouverte une seconde et j'ai vu ses jambes. Quand elle m'a servi les frites, je n'ai pas pu manger..."
(...)















The Postman Always Rings Twice, 1946, by Tay Garnett, with Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway, Hume Cronyn, Leon Ames, and Audrey Totter....

"Three of A Kind" - "Double Indemnity" (1936, Assurance sur la mort)
C'est dans "Three of A Kind" , un recueil de nouvelles de James Mallahan Cain publié en 1936 dont le titre original signifie littéralement "trois du même genre", que l'on retrouve l'une de ses plus célèbres nouvelles, "Double Indemnity", à côté de "Sinful Woman", et "The Embezzler". Walter Huff est un vendeur d’assurance avec un instinct infaillible pour les clients qui pourraient être en difficulté, et son instinct le conduit vers Phyllis Nirdlinger. Phyllis voudrait acheter une police d’assurance-accidents pour son mari, mais elle voudrait aussi que son mari ait un accident. Et Walter, plus qu'attirée par Phyllis, accepte de commettre le meurtre parfait qui permettrait d'éliminer son encombrant mari. James M. Cain s'est inspiré d'un cas réel qu'il avait connu lorsqu'il , travaillait comme journaliste à New York : Albert Snyder fut assassiné en 1927 par sa femme, Ruth Brown Snyder, et son amant, un vendeur de corsets nommé Henry Judd Gray; avant de commettre le meurtre, Brown avait souscrit une police d’assurance vie de 100000 $ sur son mari, puis avait essayé de le supprimer à plusieurs reprises, mais sans succès; elle s’était finalement tournée vers Gray pour obtenir de l’aide et tous les deux furent finalement exécutés pour le meurtre en 1928...
" I pitched my hat on the sofa. They’ve made a lot of that living room, especially those “blood-red drapes.” All I saw was a living room like every other living room in California, maybe a little more expensive than some, but nothing that any department store wouldn’t deliver on one truck, lay out in the morning, and have the credit O.K. ready the same afternoon. The furniture was Spanish, the kind that looks pretty and sits stiff. The rug was one of those 12 x 15’s that would have been Mexican except it was made in Oakland, California. The blood-red drapes were there, but they didn’t mean anything. All these Spanish houses have red velvet drapes that run on iron spears, and generally some red velvet wall tapestries to go with them. This was right out of the same can, with a coat-of-arms tapestry over the fireplace and a castle tapestry over the sofa. The other two sides of the room -were windows and the entrance to the hall.
“Yes?”
A woman was standing there. I had never seen her before. She was maybe thirty-one or -two, with a sweet face, light blue eyes, and dusty blonde hair. She was small, and had on a suit of blue house pajamas. She had a washed-out look.
“I wanted to see Mr. Nirdlinger.”
“Mr. Nirdlinger isn’t in just now, but I am Mrs. Nirdlinger. Is there something I could do?”
There was nothing to do but spill it. “Why no, I think not, Mrs. Nirdlinger, thanks just the same. Huff is my name, Walter Huff, of the General Fidelity of California. Mr. Nirdlinger’s automobile coverage runs out in a week or two, and I promised to give him a reminder on it,
so I thought I’d drop by. But I certainly didn’t mean to bother you about it.”
“Coverage?”
“Insurance. I just took a chance, coming up here in the daytime, but I happened to be in the neighborhood, so I thought it wouldn’t hurt.
When do you think would be a good time to see Mr. Nirdlinger? Could he give me a few minutes right after dinner, do you think, so I wouldn’t cut into his evening?”
“What kind of insurance has he been carrying? I ought to know, but I don’t keep track.”
“I guess none of us keep track until something happens. Just the usual line. Collision, fire, and theft, and public liability.”
“Oh yes, of course.”
“It’s only a routine matter, but he ought to attend to it in time, so he’ll be protected.”
“It really isn’t up to me, but I know he’s been thinking about the Automobile Club. Their insurance, I mean.”
“Is he a member?”
“No, he’s not. He’s always intended to join, but somehow he’s never got around to it. But the club representative was here, and he mentioned insurance.”
“You can’t do better than the Automobile Club. They’re prompt, liberal in their view of claims, and courteous straight down the line. I’ve not got a word to say against them.”
That’s one thing you learn. Never knock the other guy’s stuff.
“And then it’s cheaper.”
“For members.”
“I thought only members could get it.”
“What I mean is this. If a man’s going to join the Automobile Club anyway, for service in time of trouble, taking care of tickets, things like that, then if he takes their insurance too, he gets it cheaper. He certainly does. But if he’s going to join the club just to get the insurance, by the time he adds that $16 membership fee to the premium rate, he’s paying more. Figure that in, I can still save Mr. Nirdlinger quite a little money.”
J’ai lancé mon chapeau sur le divan. Des salons de ce genre, à « tentures rouge sang », on en voit des tas ici. C’était donc un living-room pareil à tous les autres, un peu plus coûteux sans doute, mais exactement du modèle que n’importe quel grand magasin peut livrer avec un seul camion et installer dans une matinée afin que les traites soient signées l’après-midi même. Les meubles étaient espagnols, assez agréables à voir mais raides. Le tapis était un de ces échantillons de quatre mètres sur cinq qu’on croit mexicains, mais qui sont fabriqués à Oakland, en Californie. Il y avait bien les fameuses tentures rouge sang, mais ça ne voulait rien dire.
Toutes ces maisons espagnoles ont des tentures de velours rouge sombre posées sur des tringles en fer et assorties généralement aux tapisseries de velours rouge. Tout ça était bien du même tonneau, ainsi que la tapisserie blasonnée sur la cheminée et celle au-dessus du divan. Des baies vitrées et l’entrée du hall formaient les deux côtés de la pièce.
« Vous désirez ? »
Une femme était là, debout. Je ne l’avais jamais vue auparavant. Elle avait trente ou trente-deux ans, un visage doux, des yeux bleu clair, des cheveux blond cendré. Elle était petite et portait un pyjama d’intérieur bleu. Elle avait l’air las.
« Je voulais voir Mr. Nirdlinger.
— Mr. Nirdlinger n’est pas là. Je suis Mrs. Nirdlinger. Puis-je le remplacer ? »
Je n’avais plus qu’à la mettre au courant.
« Je ne crois pas, Mrs. Nirdlinger. Merci quand même. Mon nom est Huff. Walter Huff, de la General Fidelity de Californie. L’assurance automobile de Mr. Nirdlinger doit être renouvelée dans une semaine ou deux. Je lui avais promis de le lui rappeler, c’est pourquoi je suis venu le voir en passant. Mais je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça…
— C’est seulement pour la voiture ?
— Oui. Je savais bien que dans la journée je risquais de ne pas le trouver, mais comme j’étais par ici, je suis venu quand même. A quel moment pourrai-je voir Mr. Nirdlinger ? Pensez-vous qu’il m’accorderait quelques minutes, juste après le dîner, afin de ne pas gâcher sa soirée ?
— Quelle assurance avait-il pris ? J’ai dû le savoir, mais je l’ai oublié.
— En général, personne ne s’en souvient, tant qu’il n’arrive rien. C’est l’assurance habituelle : accidents, incendie et vol, responsabilité envers les tiers.
— Ah ! Oui, naturellement !
— Ce n’est qu’une formalité, mais il faut la renouveler à temps, de manière à être garanti.
— A vrai dire, je ne m’occupe pas de tout ça. Mais je sais qu’il m’a parlé d’une assurance que lui propose l’Automobile-Club.
— Est-il membre du club ?
— Non, il a toujours voulu en faire partie et il n’a jamais fait le nécessaire pour cela. Mais le représentant du club est venu ici et lui a parlé d’assurances.
— Ils ont une organisation parfaite : rapide, assez large pour les déclarations de dommages et courtoise jusqu’au bout des ongles. Je n’ai rien à dire contre eux… »
Ça, c’est un truc qu’on apprend dès le début dans mon métier : ne jamais déprécier les affaires des collègues…
« Et ils sont moins chers ?
— Pour les membres, oui.
— Je croyais que l’assurance était réservée aux membres ?
— C’est à dire que si l’on adhère entièrement au club pour tout : réparations, abonnement de stationnement, etc., alors, si l’on prend en plus l’assurance, c’est moins cher. Bien sûr. Mais si on adhère seulement pour l’assurance, avec les seize dollars de cotisation à ajouter à la prime, c’est plus cher. Dans ce dernier cas, moi, je peux faire économiser une jolie somme à Mr. Nirdlinger. »
She talked along, and there was nothing I could do but go along with it. But you sell as many people as I do, you don’t go by what they say. You feel it, how the deal is going. And after a while I knew this woman didn’t care anything about the Automobile Club. Maybe the
husband did, but she didn’t. There was something else, and this was nothing but a stall. I figured it would be some kind of a proposition to split the commission, maybe so she could get a ten-spot out of it without the husband knowing. There’s plenty of that going on. And I
was just wondering what I would say to her. A reputable agent don’t get mixed up in stuff like that, but she was walking around the room, and I saw something I hadn’t noticed before. Under those blue pajamas was a shape to set a man nuts, and how good I was going to sound when I started explaining the high ethics of the insurance business I didn’t exactly know.
But all of a sudden she looked at me, and I felt a chill creep straight up my back and into the roots of my hair. “Do you handleaccident insurance?
Maybe that don’t mean to you what it meant to me. Well, in the first place, accident insurance is sold, not bought. You get calls for other kinds, for fire, for burglary, even for life, but never for accident. That stuff moves when agents move it, and it sounds funny to be asked about it.
In the second place, when there’s dirty work going on, accident is the first thing they think of. Dollar for dollar paid down, there’s a bigger face coverage on accident than any other kind. And it’s the one kind of insurance that can be taken out without the insured knowing a thing about it. No physical examination for accident. On that, all they want is the money, and there’s many a man walking around today that’s worth more to his loved ones dead than alive, only he don’t know it yet.
“We handle all kinds of insurance.”
She switched back to the Automobile Club, and I tried to keep my eyes off her, and couldn’t.
Elle m’a répondu et je n’ai pu que continuer aussi. Mais quand on « démarche » autant de gens que je le fais, on ne se base pas sur ce qu’ils disent. On sent comment l’affaire tourne. Au bout d’un moment, j’ai compris que cette femme se fichait absolument de l’Automobile-Club. Son mari s’y intéressait peut-être, mais elle, non. J’ai senti vite qu’elle cherchait simplement à gagner du temps.
Je me suis imaginé qu’elle voulait me proposer de partager la commission afin de rabioter en douce quelques dollars à son mari. Ça se fait beaucoup. Je cherchais déjà ce que je répondrais. Un agent sérieux ne s’embarque jamais là-dedans. C’est alors que je vis quelque chose dont je ne m’étais pas aperçu avant. Elle marchait de long en large dans la pièce et sous son pyjama bleu on devinait des formes capables de rendre un homme fou. Je devais avoir une drôle de tête quand j’ai commencé à lui expliquer les grands principes moraux des affaires d’assurances…
Tout à coup, elle m’a regardé et j’ai senti un frisson glacé me grimper du dos jusqu’à la racine des cheveux. « Est-ce que vous vous occupez d’assurances-accidents ? »
Ceci n’a peut-être pas, pour vous, le sens que cela a eu pour moi. Voilà. D’abord, une police-accidents, on ne vous la demande pas, c’est vous qui la proposez. On vous parle d’incendie, de cambriolage, de vie même, mais jamais d’accidents personnels. Ce rayon ne marche que lorsque les agents y poussent, et ça paraît toujours un peu bizarre d’être questionné à ce sujet.
Ensuite, quand les gens manigancent quelque chose de pas propre, c’est toujours à l’assurance-accidents qu’ils pensent en premier. Les plus grosses indemnités sont payées pour les accidents personnels, plutôt que pour n’importe quel autre risque. De plus, cette assurance peut être souscrite sans que l’assuré en sache rien. Pas d’examen médical pour les
accidents. Dans ces affaires, ce que les gens veulent, c’est de l’argent. C’est pourquoi pas mal d’hommes ont beaucoup plus de valeur morts que vivants aux yeux de leurs chers parents. Seulement, eux, ils l’ignorent !
« Bien sûr. Comme de toutes les autres. »
Elle a reparlé de l’Automobile-Club, et j’ai essayé de détacher mes yeux d’elle, mais je n’ai pas pu.
(...)

"Double Indemnity", porté à l'écran en 1944, scénarisé avec le concours de Raymond Chandler, est un chef-d’œuvre dans les filmographies de Billy Wilder. Il met en vedette Barbara Stanwyck, Fred MacMurray, et Edward G. Robinson, et constitue sans doute le premier véritable exemple de film noir...

"Mildred Pierce" (1941)
Le roman se déroule sur les neuf ans de la vie d'une femme, Mildred Pierce, et de l'évolution de ses relations avec son mari, Bert, qui la quitte pour Maggie, jugée plus maternelle, et Veda, l'une de ses filles, avec laquelle se noue un conflit obsessionnel permanent. En toile de fond, Los Angeles des années 1930 dans lequel elle tente de survivre socialement. James M. Cain quitte ici le roman noir pour une fiction qui sait exprimer tant l'environnement social d'une classe moyenne qui tente de sortir de son infériorité que la violence émotionnelle dévastatrice d'une héroïne dont les ambitions et les souffrances s'incarnent plus que toute autre dans une dévotion filiale exacerbée...
Mildred tente par tous les moyens d'attirer Veda dans sa vie, qui dans le même temps la repousse constamment et non sans dureté jusqu'à ne souhaiter que d'être littélement éjectée de la maisonnée. Il est vrai que l'enjeu est émotionnellement considérable, l'amour maternel de notre héroïne, excessif, ambigü, n'est pas sans connotations sexuelles, nous les verrons entrer en compétitivité et Mildred Pierce user de la jalousie d'un amant blessé lorsque elle apprendre que Veda avait fait chanter une famille riche avec une fausse grossesse,...
(Chapter 13) ...
" “Let go of me! What are you pushing me for? What do you mean I’ll do nothing of the kind?”
“If you go to the sheriff office, they’ll bring young Mr. Forrester back. And if they bring him back, he’ll want to marry me, and that doesn’t happen to suit me. It may interest you to know that he’s been back. He sneaked into town, twice, and a beautiful time I had of it, getting him to be a nice boy and stay where Mamma put him. He’s quite crazy about me. I saw to that. But as for matrimony, I beg to be excused. I’d much rather have the money.”
Mildred took off her hat, and stared at the cold, beautiful creature who had sat down opposite her, and who was now yawning as though the whole subject were a bit of a bore. The events of the last few days began ticking themselves oʃ in her mind, particularly the strange relationship that had sprung up, between Veda and Wally.
The squint appeared, and her face grew hard. “Now I know what that woman meant by blackmail. You’re just trying to shake her down, shake the whole family down, for money. You’re not pregnant, at all.”
“Mother, at this stage it’s a matter of opinion, and in my opinion, I am.”
Veda’s eyes glinted as she spoke, and Mildred wanted to back down, to avoid one of those scenes from which she always emerged beaten, humiliated, and hurt. But something was swelling within her, something that began in the sick jealously of a few nights before, something that felt as though it might presently choke her.
Mildred ôta son chapeau et regarda la belle et froide créature qui s'était assise en face d'elle et qui baillait maintenant comme si le sujet était un peu ennuyeux. Les événements des derniers jours commencèrent à se bousculer dans son esprit, en particulier l'étrange relation qui s'était nouée entre Veda et Wally.
Elle se mit à plisser les yeux et son visage se durcit. "Maintenant, je sais ce que cette femme entendait par chantage. Tu essaies juste de la faire tomber, de faire tomber toute la famille, pour de l'argent. Tu n'es pas du tout enceinte."
"Mère, à ce stade, c'est une question d'opinion, et à mon avis, je le suis".
Les yeux de Veda brillaient en parlant, et Mildred voulait reculer, pour éviter une de ces scènes dont elle sortait toujours battue, humiliée et blessée. Mais quelque chose enflait en elle, quelque chose qui avait commencé par la jalousie maladive de quelques nuits auparavant, quelque chose qui semblait pouvoir l'étouffer.
Her voice shook as she spoke. “How could you do such a thing? If you had loved the boy, I wouldn’t have a word to say. So long as I thought you had loved him, I didn’t have a word to say, not one word to blame you. To love is a woman’s right, and when you do, I hope you give everything you have, brimming over. But just to pretend you loved him to lead him on, to get money out of him— how could you do it?”
“Merely following in my mother’s footsteps.”
“What did you say?”
“Oh, stop being so tiresome. There’s the date of your wedding, and there’s the date of my birth. Figure it out for yourself. The only difference is that you were a little younger at that time than I am now—a month or two anyway. I suppose it runs in families.”
“Why do you think I married your father?”
“I rather imagine he married you. If you mean why you got yourself knocked up, I suppose you did it for the same reason I did — for the money.”
“What money?”
Sa voix tremblait lorsqu'elle parlait. "Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Si tu avais aimé ce garçon, je n'aurais pas eu un mot à dire. Tant que j'ai cru que tu l'avais aimé, je n'ai pas eu un mot à dire, pas un mot pour te blâmer. Aimer est un droit de la femme, et quand on aime, j'espère qu'on donne tout ce qu'on a, jusqu'à l'épuisement. Mais faire semblant de l'aimer pour l'entraîner, pour lui soutirer de l'argent, comment as-tu pu faire ça ?"
"Simplement en suivant les traces de ma mère."
"Qu'est-ce que tu as dit ?"
"Oh, arrêtez d'être si ennuyeux. Il y a la date de ton mariage, et il y a la date de ma naissance. Fais le calcul toi-même. La seule différence, c'est que tu étais un peu plus jeune que moi à l'époque, d'un mois ou deux en tout cas. Je suppose que c'est une question de famille".
"Pourquoi pensez-vous que j'ai épousé votre père ?"
"J'imagine plutôt qu'il t'a épousée. Si tu veux dire pourquoi tu t'es fait engrosser, je suppose que tu l'as fait pour la même raison que moi - pour l'argent."
"Quel argent ?"
“Mother, in another minute I’ll be getting annoyed. Of course he has no money now, but at the time he was quite rich, and I’m sure you knew it. When the money was gone you kicked him out. And when you divorced him, and he was so down and out that the Biederhof had to keep him, you quite generously stripped him of the only thing he had left, meaning this lovely, incomparable, palatial hovel that we live in.”
“That was his idea, not mine. He wanted to do his share, to contribute something for you and Ray. And it was all covered with mortgages, that he couldn’t even have paid the interest on, let alone —”
“At any rate, you took it.”
By now, Mildred had sensed that Veda’s boredom was pure affectation. Actually she was enjoying the unhappiness she inflicted, and had probably rehearsed her main points in advance. This, ordinarily, would have been enough to make Mildred back down, seek a reconciliation, but this feeling within kept goading her. After trying to keep quiet, she lashed out: “But why? Why—will you tell me that? Don’t I give you everything that money can buy? Is there one single thing I ever denied you? If there was something you wanted, couldn’t you have come to me for it, instead of resorting to — blackmail. Because that woman was right! That’s all it is! Blackmail! Blackmail! Blackmail!”
In the silence that followed, Mildred felt first frightened, then coldly brave, as the feeling within drove her on. Veda puffed her cigarette, reflected, and asked: “Are you sure you want to know?"
“I dare you to tell me!”
A présent, Mildred avait compris que l'ennui de Veda n'était que pure affectation. En fait, elle se réjouissait du malheur qu'elle infligeait, et avait probablement répété ses principaux arguments à l'avance. En temps normal, cela aurait suffi à faire reculer Mildred, à la réconcilier, mais ce sentiment intérieur ne cessait de l'aiguillonner. Après avoir essayé de se taire, elle s'emporta : "Mais pourquoi ? Pourquoi me dire cela ? Ne t'ai-je pas donné tout ce que l'argent peut acheter ? Y a-t-il une seule chose que je t'ai refusée ? Si tu voulais quelque chose, n'aurais-tu pas pu venir me le demander, au lieu d'avoir recours au chantage ? Parce que cette femme avait raison ! C'est tout ce que c'est ! Du chantage ! Le chantage ! Du chantage !"
Dans le silence qui suivit, Mildred se sentit d'abord effrayée, puis froidement courageuse, car le sentiment qui l'habitait la poussait à aller de l'avant. Veda tira une bouffée sur sa cigarette, réfléchit et demanda : "Es-tu sûre de vouloir savoir ?"
"Je te défie de me le dire !"
“Well, since you ask, with enough money, I can get away from you, you poor, half-witted mope. From you, and your pie wagon and your chickens, and your waffles, and your kitchens, and everything that smells of grease. And from this shack, that you blackmailed out of my father with your threats about the Biederhof, and its neat little two-car garage, and its lousy furniture. And from Glendale, and its dollar days, and its furniture factories, and its women that wear uniforms and its men that wear smocks. From every rotten, stinking thing that even reminds me of the place — or you.”
“I see.”
Mildred got up and put on her hat. “Well it’s a good thing I found out what you were up to, when I did. Because I can tell you right now, if you had gone through with this, or even tried to go through with it, you’d have been out of here a little sooner than you expected.”
She headed for the door, but Veda was there first. Mildred laughed, and tore up the card Mr. Simons had given her. “Oh you needn’t worry that I’ll go to the sheriff’s office now. It’ll be a long time before they find out from me where the boy is hiding, or you do either.”
Again she started for the door, but Veda didn’t move. Mildred backed off and sat down. If Veda thought she would break, she was mistaken. Mildred sat motionless, her face hard, cold, and implacable. After a long time the silence was shattered by the phone. Veda jumped for it. After four or five brief, cryptic monosyllables, she hung up, turned to Mildred with a malicious smile. “That was Wally. You may be interested to know that they’re ready to settle.”
“Are you?”
“I’m meeting them at his office.”
“Then get out. Now.”
“I’ll decide that. And I’ll decide when.”
“You’ll get your things out of this house right now or you’ll find them in the middle of Pierce Drive when you come back.”
Veda screamed curses at Mildred, but presently she got it through her head that this time, for some reason, was diʃerent from all other times. She went out, backed her car down to the kitchen door, began carrying out her things, and packing them in the luggage carrier. Mildred sat quite still, and when she heard Veda drive off she was consumed by a fury so cold that it almost seemed as though she felt nothing at all. It didn’t occur to her that she was acting less like a mother than like a lover who has unexpectedly discovered an act of faithlessness, and avenged it.
(...)
"Mildred Pierce" fut adapté cinématographiquement par Michael Curtiz en 1945 avec Joan Crawford, Jack Carson et Zachary Scott, mais aussi Eve Arden, Ann Blyth et Bruce Bennett. Ce fut le premier rôle de Crawford pour Warner Bros., après avoir quitté Metro-Goldwyn-Mayer, et elle remporta l’Oscar de la meilleure actrice...
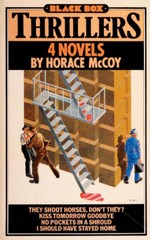

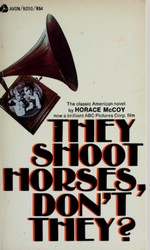


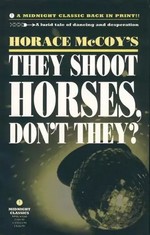



Horace McCoy (1897-1955)
La Dépression va réduire hommes et femmes à un degré de déchéance rarement atteint dans l'histoire américaine. Au centre des romans d'Horace McCoy, une analyse froide et violente de "paumés" engloutis sans recours possible par un monde urbain violent et cynique : danseurs de concours dans "On achève bien les chevaux" (1935), journalistes miteux dans "Un linceul n'a pas de poche" (1937), délinquants en cavale dans "Adieu la vie, adieu l'amour" (1948). Natif de Nashville dans le Tennessee, Horace McCoy commence à travailler dès l'âge de douze ans comme vendeur de journaux. Héroïque bombardier et observateur aérien pendant la guerre de 1914, chauffeur de taxi et représentant de commerce, journaliste sportif après la guerre, il commence à écrire ses premières nouvelles dans les magazines de pulps à la fin des années 1920, mais en 1929 perd son emploi, se retrouve ouvrier saisonnier, serveur, garde du corps, gagne enfin en 1931 Hollywood pour y écrire une quarantaine de scénarios de films (The Turning Point, The Lusty Men, 1952). Ses romans policiers révèlent un style concis, des phrases percutantes, souvent comparé à Hemingway - "The impact of the bullet had turned her head away from me; I did not have a perfect profile view, but I could see enough of her face and her lips to know she was smiling": "They Shoot Horses, Don't They?" (1935), "No Pockets in a Shroud" (1937), "I Should Have Stayed Home" (1937), "Kiss Tomorrow Good-bye" (1948), "Scalpel" (1952), "Corruption City ou This Is Dynamite" (1953)...
C'est en France et non aux Etats-Unis qu'il trouvera un éditeur et terminera sa vie dans la plus totale indifférence à Beverly Hills...
"It’s little wonder that McCoy was taken up with particular seriousness in France, where he was raised to the same pantheon as Faulkner and Hemingway, the mixture of fatalism and realism in his work seen as the burgeoning of American existentialism."
Il n’est pas étonnant que McCoy ait été pris avec un sérieux particulier en France, où il a été élevé au même panthéon que Faulkner et Hemingway, le mélange de fatalisme et de réalisme dans son travail considéré comme l’émergence de l’existentialisme américain. Aux États-Unis, il était beaucoup plus susceptible d’être lié à un autre écrivain de "noirish tales" des années de la dépression, James M. Cain, une comparaison avec laquelle McCoy était moins heureux. Comme il l’a dit à ses éditeurs, s’ils continuaient à l’étiqueter comme étant « of the Cain school», il serait forcé de trancher la gorge de Caïn ou la sienne.
Ce que le travail de McCoy montre, plus clairement peut-être que celui de Cain ou de tout autre des "hard-boiled American writers", à l’exception possible de Hammett, est un sens fort et clairement exprimé des façons dont le sort des individus est inextricablement lié à des mouvements politiques et sociaux plus larges, une position fortement de gauche (the ways in which the fate of individuals is inextricably linked to broader political and social movements, a strongly left-wing), anti-capitaliste étant le plus clairement exprimé dans "No Pockets in a Shroud", dans lequel le journaliste héros est assassiné pour l’empêcher d’exposer la vérité. Il y a aussi une légèreté du toucher dans la dureté du monde (a lightness of touch within the harshness of the world) que représente McCoy. Comme il l’a déclaré dans une allocution adressée aux aspirants écrivains, rapportée dans le Pasadena Star-News, l’une de ses principales intentions lorsqu’il écrivait était de «dwelling on the lyrical quality that lies in any dramatic action and the transfer of that lyrical quality to the pages of a book by means of graphic and telling words» ( se concentrer sur la qualité lyrique qui se trouve dans toute action dramatique et le transfert de cette qualité lyrique aux pages d’un livre au moyen de mots graphiques et parlants) ... (cf. John Harvey).

"They Shoot Horses, Don't They?" (1935, On achève bien les chevaux)
Sous-estimé à sa parution, le premier roman noir d'Horace McCoy, "On achève bien les chevaux", taken from his experience as a bouncer at a marathon dance contest, a été réhabilité dans les années 1940 par Marcel Duhamel,fondateur dela Série noire, pour qui McCoy soutenait la comparaison avec Hemingway. Particulièrement noir et désespéré, il s'attache à explorer l'envers du décor en décrivant la misère de ceux prêts à toutes les humiliations pour pouvoir gagner simplement de quoi survivre. Les deux protagonistes du roman, Robert et Gloria, rêvent d'une célébrité hollywoodienne, mais ne trouvent que monotonie et vanité avant de mourir dans le Los Angeles médiocre et morne de la Grande Dépression. Le marathon de danse, une forme de spectacle où les concurrents circulent interminablement autour d'une piste plusieurs jours d'affilée dans l'espoir de résister plus longtemps que tous les autres constitue une métaphore parfaite de l'absurdité de la vie et de son caractère aléatoire. Après avoir combattu l'épuisement, Robert et Gloria échouent dans leur poursuite du prix lorsqu'un coup de feu accidentel met bizarrement fin à la manifestation. Gloria, qui part alors à la dérive, persuade Robert de réaliser son ambition suicidaire en arguant que la vie est dépourvue de sens. À travers le marathon de danse, l'auteur critique la nature abusive des divertissements populaires, et l'avilissement qu'entraîne le capitalisme. Contrairement à la banalité doucereuse des films hollywoodiens, le marathon de danse s'avère imprévisible, douloureux, violent et nihiliste. Les concurrents ne sont que du bétail, des chevaux que l'on peut abattre une fois que l'on a fini d'en tirer profit. Ce sont là les germes de la critique sociale de McCoy, qui, comme le marathon de danse, ne mène nulle part et ne produit rien (Gallimard, traduction Marcel Duhamel).
"..A la fin du premier tour, Mack Aston et Bess Cartwright piquèrent un sprint et nous enlevèrent la seconde place. Je commençai à faire du talon-pointe du pied plus vite que je n'avais encore jamais fait. Je savais qu'il le fallait. Tous les demi-portions avaient été éliminés. Tous ces couples qui restaient en piste étaient des cracks.
Je restai en troisième position durant six ou sept tours, mais le public commença à faire du raffut et à nous crier de regagner notre place perdue. J'avais peur de tenter le coup, car on ne peut doubler une équipe rapide qu'au virage et cela demande un effort terrible. Jusque-là, Gloria s'était très bien défendue, mais je ne tenais pas à la pousser trop. Je n'étais pas inquiet tant que je la sentais capable de se propulser par ses propres moyens...
Au bout de huit minutes, je commençai à avoir chaud. Je me dépouillai de mon maillot et l'expédiai à un soigneur. Gloria en fit autant. La plupart des filles étaient maintenant sans maillot et la salle hurlait.
"Maintenant, on est bien partis, si quelqu'un ne nous attaque pas", me dis-je.
A ce moment précis nous fûmes attaqués. Pedro Ortega et Lilian Bacon s'amenèrent à toute vitesse à nos côtés, s'efforçant de passer à la corde au virage. C'était à peu près le seul moyen de dépasser un couple, mais ce n'était pas si facile que ça en avait l'air. Il fallait gagner au moins deux pas dans la ligne droite et alors virer d'une secousse en tournant. C'était ce que Pedro avait derrière la tête. Ils nous accrochèrent au tournant, mais Gloria réussit à garder son équilibre; je la tirai en avant et nous conservâmes nos places.
J'entendis la foule haleter et je savais que cela signifiait que quelqu'un titubait. Un moment après, j'entendis le choc d'un corps sur le plancher. Je ne me détournai pas. Je continuai à marteler la piste. Ce genre de choses avait cessé de m'émouvoir. Quand je fus sur la ligne droite et que je pus regarder, je vis que c'était Mary Hawley, la partenaire de Lee Lowell, qui venait d'aller au quartier. Infirmières et soigneurs s'affairaient autour d'elle et le docteur se servait de son. stéthoscope.
- Laissez le solo pousser à la corde, les enfants. . . , brailla Rollo.
Je m'écartai et Lee me doubla. Désormais, il lui faudrait faire deux tours contre nous un. Il eut un bref regard en passant du côté du quartier; l'angoisse lui crispait le visage. Je savais qu'il ne souffrait pas, mais qu'il se demandait simplement quand sa partenaire sortirait...; à son quatrième tour en solo, elle se leva et revint s'accoupler.
Je fis signe à l'infirmière de m'envoyer une serviette humide et, au tour suivant, elle me la plaqua autour du cou. J'en fourrai l'extrémité entre mes dents.
- Encore quatre minutes ! hurla Rocky.
..Ce derby était l'un des plus serrés que nous eussions jamais faits. Le Kid et Jackie menaient un train effarant. Je savais que Gloria et moi nous ne risquions rien si nous pouvions conserver notre allure, mais on ne sait jamais quand le partenaire va flancher. A partir d'une certaine limite, on continue à se mouvoir automatiquement, sans même se rendre compte que l`on bouge. A un moment donné, on se trouve avancer à toute allure et à la minute d'après on commence à s'effondrer. C'était cela que je craignais avec Gloria..., qu`elle ne s'écroulât brusquement. Elle commençait à se laisser un peu traîner... "Avance, avance !" lui hurlai-je en pensée, ralentissant d'un cheveu dans l'espoir d'alléger un peu sa fatigue. De toute évidence, Pedro et Lilian n'attendaient que ce moment. Ils nous dépassèrent en trombe et prirent la troisième place. Immédiatement derrière nous, j'entendis un pilonnement impressionnant et je me rendis compte que tout le peloton était sur les talons de Gloria. Je n'avais plus la moindre marge, désormais. Je levai haut la hanche. C'était le signal pour Gloria d'avoir à faire porter son poids de l'autre côté. Elle obéit, tirant maintenant de la main droite sur ma ceinture. "Dieu soit loué !" me dis-je. C'était bon signe. Ça prouvait qu'elle avait encore toute sa tête...
- Plus qu'une minute..., annonça Rocky...
A partir de cet instant, je mis toute la vapeur. Kid Kamm et Jackie avaient quelque peu ralenti l'allure, forçant ainsi les tandems Mack et Bess et Pedro-Lilian à ralentir. Gloria et moi étions placés entre eux et les autres. C'était une mauvaise position. Je priai mentalement que personne derrière nous n'eût la force de tenter un démarrage, car je me rendais compte que le moindre accrochage couperait les jambes à Gloria et la flanquerait par terre. Et si quelqu'un ramassait une pelle maintenant...
J 'utilisai jusqu'à ma dernière parcelle d'énergie pour me maintenir un pas, un simple pas en avant, pour écarter cette menace que je sentais dans mon dos... quand retentit le coup de pistolet de la fin de course; je me retournai pour rattraper Gloria, mais elle ne s'évanouit pas. Elle chancela et je la reçus dans mes bras, luisante de sueur, cherchant désespérément à retrouver son souffle.
- Voulez-vous une infirmière, hurla Rocky, de l'estrade.
- Ça va, dis-je. Y a qu'à la laisser se reposer une minute...
On dut soutenir la plupart des filles pour les mener au vestiaire, mais les garçons se massèrent autour de l'estrade pour voir qui avait été disqualifié. Les arbitres avaient remis leurs feuilles de pointage à Rocky et à Rollo, qui les vérifiaient...."

"No Pockets in a Shroud" (1937, Un linceul n’a pas de poches)
"When Dolan got the call to go up to the managing editor’s office he knew this was going to be the blow-off, and all the way upstairs he kept thinking what a shame it was that none of the newspapers had any guts anymore" - Ce livre de McCoy est le réquisitoire le plus violent - le plus dépourvu d'espoir aussi - qui puisse être dressé contre ce qu'on appelle «l'ordre établi» - Mike Dolan abandonne son emploi de reporter au journal où il travaille pour pouvoir en toute liberté dénoncer les milieux corrompus du pouvoir - . Un réquisitoire qui dépasse de beaucoup l'époque de la civilisation qu'il vise pour atteindre ce qu'il y a de plus ancien, et peut-être d'éternel, dans la condition de l'homme : la perpétuelle soumission de la vérité au mensonge, par la lâcheté et l'hypocrisie des individus (Gallimard, traduction Marcel Duhamel).

"Kiss Tomorrow Good-bye" (1948, Adieu la vie, adieu l'amour...)
Méconnu, pourtant sans doute l'un des meilleurs romans noirs jamais écrits. L'histoire d'un jeune lettré, Ralph Cotter, hanté par une peur inexplicable qui finit par faire de lui un criminel féroce. Enfant perdu qui, défiant les lois et l'ordre, est entraîné irrésistiblement vers le mal, une amoralité impitoyable qui se nourrit auprès de femmes sensuelles et vénéneuses et des policiers et avocats véreux. C'est la course au pouvoir d'un être dévoré par un complexe obscur dont l'origine ne nous sera dévoilée qu'à la fin et que l'auteur a menée avec une étrange et terrifiante dextérité (Gallimard, traduction Marcel Duhamel). Gordon Douglas en fit une magnifique adaptation en 1951 avec James Cagney...

Graham Green (1904-1991) a toujours nié avoir voulu écrire des romans policiers, pourtant, à lire "A Gun for Sale" (1936, Tueur à gages), lorsque Raven, l'homme au bec-de-lièvre, s'apprête à commettre le crime qui lui a été commandé...
"Pour Raven, un meurtre ne signifiait pas grand-chose. C'était une besogne comme une autre. Il s'agissait de penser à tout. Il fallait faire travailler ses méninges. La haine n'y était pour rien. Il n'avait vu le ministre qu'une fois : on le lui avait montré, qui traversait le nouveau lotissement, entre les petits arbres de Noël illuminés, un homme vieux, à l'air négligé, sans amis, mais qui, disait-on, aimait l'humanité. Dans la large Continental Street, le vent froid lui coupa la figure. Ce fut une bonne excuse pour relever le col de son pardessus bien au-dessus de sa bouche. Un bec-de-lièvre était un sérieux désavantage dans son métier; on le lui avait mal recousu à la naissance, en sorte qu'il avait maintenant la lèvre supérieure tordue et balafrée. Quand on porte sur soi un moyen d'identification aussi visible, on ne peut éviter quelque brutalité dans ses méthodes. Depuis le début, Raven avait toujours été forcé d'éliminer tous les témoignages. Il portait une petite valise. Il ressemblait à n'importe quel homme assez jeune qui rentre chez lui après son travail; son pardessus foncé avait un air ecclésiastique. Il remontait la rue d'un pas ferme, comme des centaines d'autres gens. Un tram passa, brillamment éclairé dans le crépuscule : il ne le prit pas. On aurait pu penser que ce jeune homme économe ménageait son argent, en prévision du foyer qu'il voulait fonder. Peut-être allait-il justement retrouver sa petite amie. Mais Raven n'avait jamais eu de petite amie : le bec-de-lièvre le lui interdisait. Dès son plus jeune âge, il avait su qu'il était repoussant. Il pénétra dans une des hautes maisons grises et, l'air crispé, revêche, aigri, il en monta l'escalier..."








William R. Burnett (1899-1982)
Natif de Springfield, Ohio, William Riley Burnett, un temps journaliste et statisticien, gagne Chicago à 28 ans, devient réceptionniste d'un hôtel minable, y observe boxers, clochards et voyous, cette expérience lui inspire "Little Caesar" (1929), roman policier qui connaît un succès fulgurant et lui vaut une place de scénariste à Hollywood. Dès 1931, Mervyn LeRoy en réalise une adaptation qui révèle Edward G. Robinson. La prose de Burnett, inspirée des naturalistes européens, est d'une simplicité désarmante, et parmi les treize hard-boiled novels qu'il écrivit, certains aboutirent à des films devenus des classiques du film noir: "High Sierra" (1941), "The Asphalt Jungle" (1950, Quand la ville dort), et le scénario de "Scarface" (1932) est un de la cinquante de scripts qu'il produisit avec les plus grands réalisateurs (Wake Island, 1942, The Great Escape, 1963) . Alors que la criminalité et la déchéance consument les petites villes du centre des Etats-Unis, ses gangsters ont cette singularité de ne pas être totalement antipathiques, ils semblent emportés inexorablement par leur destin et pourtant recèlent tous une certaine innocence, un peu de pureté, la nostalgie d'un paradis verdoyant perdu à jamais.


"Little Caesar" (1929)
Petits criminels sans grande envergure, Caesar Enrico "Rico" Bandello et son ami Joe Massara déménagent à Chicago pour tenter de faire fortune, récit d'une ascension criminelle, Rico, aidé par Joe, son bras droit, combat puis élimine les gangsters rivaux et parvient à prendre le contrôle total de la ville, avec ses trafics et ses tripots. Mais à la suite de la trahison d'une femme, il est tué par la police. Réalisé par Mervyn LeRoy, sorti en 1931, le film et la performance d'Edward G. Robinson dans le rôle de Rico Bandello, renforcèrent la notoriété du stéréotype de gangster urbain contemporain...
"De son fauteuil près de la fenêtre, Sam Vettori regardait machinalement dans Halstead Street. Gras comme un porc, le teint brun et huileux, les cheveux noirs et crépus, Sam Vettori avait, au repos, un air de bonhomie léthargique derrière lequel se dissimulait un caractère morose, coléreux et sournois. De temps à autre, il sortait de la poche de son gilet une énorme montre en or qu’il considérait en pinçant les lèvres.
Assis près de lui autour d’une table ronde, Otero, dit « le Grec », Tony Passa et Rico, le lieutenant de Sam Vettori, jouaient à la passe anglaise pour des enjeux insignifiants. Sous l’abat-jour vert de la lampe, le visage naturellement foncé d’Otero paraissait cadavérique ; que le sort lui fût favorable ou contraire, il restait figé sur sa chaise sans prononcer une parole. Tony, robuste et rose, à peine âgé de vingt ans, s’intéressait passionnément à la partie, débordant de joie quand la chance lui souriait, jurant lorsqu’il perdait, moins à cause des enjeux que par besoin de s’exciter. Rico gardait son chapeau baissé sur ses yeux ; il avait les traits tirés et ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. Rico jouait toujours pour gagner.
Tirant une bouffée de son cigare, Vettori se leva et se mit à arpenter la pièce.
— Où peut-il être ? demanda-t-il, les yeux au plafond. Je lui ai dit à 8 heures, il est 8 h 1/2.
— Joe n’est jamais à l’heure, fit Tony.
— Joe est un propre à rien, répliqua Rico, sans lever les yeux de ses cartes, c’est une chiffe.
— C’est possible, dit Vettori qui s’ennuyait à tel point qu’il s’arrêta un instant près de la table pour suivre le jeu ; c’est possible, n’empêche que nous ne pouvons pas nous passer de lui, Rico. Tu comprends, il peut s’introduire n’importe où, ce gars-là ; il dégote, voilà ce que c’est. Les
palaces ? ça ne l’impressionne pas. Il dit à l’employé : « Je voudrais un appartement, s’il vous plaît. » Un appartement ! Non, mais tu te rends compte ! Tu vois bien, Rico, on ne peut pas se passer de lui.
Rico se remit à tambouriner ; son visage s’empourpra légèrement.
— C’est bon, Sam ; un jour il se dégonflera. Rappelle-toi ce que je te dis : il n’est pas régul. Et d’abord qu’est-ce que c’est que ce métier-là ! Quand on est un homme, on ne se fait pas payer pour danser avec des femmes.
Sam éclata de rire.
— Voyons, tu ne connais pas Joe.
Tony regarda fixement Rico et lui dit :
— Joe est régulier, Rico, je sais ce que je dis ; la danse n’est qu’un prétexte, et il est adroit. Est-ce qu’il s’est jamais fait poisser ?
Rico jeta violemment ses cartes sur la table. Il haïssait Joe et savait que Tony et Vettori ne l’ignoraient pas.
— Ça va, dit-il, rappelez-vous ce que je vais vous dire. Il se dégonflera, un de ces jours. Quand on est un homme on ne se fait pas payer pour danser.
— C’est moi qui gagne, annonça Otero.
Poussant l’argent vers lui, Rico se leva :
— En tout cas, déclara-t-il, s’il ne s’amène pas d’ici dix minutes, je sors faire un tour.
— Tu me feras le plaisir de rester là ! lança Vettori, le visage légèrement contracté.
Tony jaugea les deux hommes. Otero continuait à compter son argent.
Vettori avait dit un jour : « Rico, tu deviens trop grand pour tes bottes. »
Tony se souvint de l’expression qu’avaient eue les yeux de Rico à ce moment-là. Tout récemment encore, ils en avaient reparlé ; Rico devenait trop grand pour eux. Comme l’avait dit Scabby, l’indicateur de la bande :
« Ça sera Rico ou Sam, l’un ou l’autre. »
— J’attendrai dix minutes, déclara Rico.
Vettori reprit sa place près de la fenêtre et regarda machinalement dans la rue.
— Deux cent cinquante, fit Otero en ramassant son gain.
— Je te les joue, lui dit Tony.
— Non.
Joe Massara ouvrit la porte et fit son entrée dans la pièce....
(trad. M. Duhamel, Gallimard).

"Dark Hazard" (1933)
Un joueur compulsif détruit ici toute son existence, et ce malgré l'amour que lui porte une jeune femme qui l'épouse et toutes les promesses faites en vain...
"L'horloge située au-dessus du standard égrenait lentement les douze coups de minuit; chaque tintement était précédé d'un ronronnement prémonitoire, faible et laborieux ; puis le mécanisme bourdonna après le dernier coup et reprit son tic-tac. Au standard, l'employé de nuit lisait l'Examiner; il ne leva pas les yeux. La discrète sonnerie de l'horloge s'intégrait parfaitement au silence audible qui se refermait sur lui chaque nuit. Au fond du hall d'entrée, un radiateur cognait doucement contre le mur; dehors, le vent soufflait, et d'épais flocons blancs venaient se jeter contre les vitres; on entendait le klaxon affaibli des taxis dans Sheridan Road. Tout était absolument normal. L'employé de nuit lisait à la lumière d'une lampe à abat-jour vert; il se sentait très bien au cœur du silence noir et venteux de cette nuit d'hiver de Chicago. Il ne pensait pas aux vagues sombres du Lac Michigan qui battaient les quais et les plages déserts; il ne pensait pas aux faibles lumières qui bordaient les rues sur des kilomètres dans toutes les directions; il ne pensait à rien d'autre qu'à ce qu'il lisait : les "Cubs" allaient s'entraîner à Catalina, Mickey Walker avait remporté un combat de plus, les canassons entamaient la saison des courses à Agua Caliente le jour de Noël. L'employé de nuit n'avait pas l'air d'un employé de nuit. C'était un homme robuste, âgé de trente-quatre ans, qui avait les cheveux clairs, de fortes et robustes épaules, un cou puissant s'élargissant à la base et un visage carré aux traits masculins prononcés; deux arêtes osseuses surplombaient ses yeux gris, et son front, de hauteur moyenne, était très large. Il avait essayé de plaquer ses cheveux blonds et rebelles selon la mode mais des épis se dressaient sur l'arrière de son crâne. Il portait ses habits d'employé de nuit avec une discrète élégance, mais les muscles se devinaient sous le vêtement de fonction et son nœud de cravate était de travers. Une seule chose l'empêchait de paraître redoutable : un air de bonhomie indolente qui n'était pas sans rappeler celui d'un ours apprivoisé.
Le standard signala un appel, un appel venant de l'intérieur, et l'employé de nuit sourit lorsqu'il vit le numéro : 632. C'était sa femme qui l'appelait pour lui souhaiter bonne nuit; Marg perchée là-haut au-dessus de sa tête dans leur petit appartement douillet du sixième étage. Il se représenta les oreillers épars sur le divan; l'abat-jour marron clair de la lampe discrète qui donnait une lumière si agréable pour la lecture ; la petite radio et son minuscule cadran illuminé. Un endroit drôlement agréable, ça oui; sacrément confortable pour Marg, et pour lui aussi.
- Bonsoir Mrs Turner.
Marg rit.
- Bonsoir Mr Turner.
- Joyeux Noël, chérie.
- Il est déjà minuit ? Joyeux Noël, Jim. Désolée que tu ne sois pas ici avec moi.
- Et moi, je l'suis pas?
- Tu n'es pas quoi? Et arrête de dire "j'suis pas".
- J'suis pas désolé?
- Je crois que je vais me coucher, Jim. A demain matin.
- Dis donc, c'est pas une nuit comme les autres, hein, chérie ? C'est Noël. Pourquoi tu ne descendrais pas prendre une tasse de café avec moi? J'expédierai le nègre dehors. Ça ne gênera pas Mr Plummer. De toute façon, il est de sortie.
- Tu crois que ça ne posera pas de problème ? Tu ne tiens pas à ce que Mr Plummer soit mécontent, Jim. Nous sommes drôlement bien installés ici.
- Ah, allez, viens! Qu'est-ce qu'un type peut bien trouver à redire à ça la nuit de Noël? Ça serait une andouille de trouver quelque chose à redire...
- Entendu. Il faut que je remette mes vêtements.
- J'vais pas m'en aller, assura Jim en riant avant de couper le communication.
Comme s'il risquait de s'en aller; nuit après nuit de huit heures du soir à huit heures du matin. Parfois, Plummer était pris d'un accès de bonté et lui donnait sa nuit, mais pas très souvent. En temps ordinaire, un employé de nuit pouvait râler sérieusement s'il n'obtenait pas une nuit de congé par semaine, mais pas maintenant qu'il y avait dix gars pour une place. Bon sang! De toute façon, où pouvait-il bien aller, à part au ciné ? Marg aimait le ciné; elle aimait verser une larme sur le triste sort du gamin abandonné ou de la mère aux cheveux gris, ce genre de truc; bien qu'elle ait honte de l'admettre et qu'elle soit plutôt dure elle aussi. Dure à sa manière à elle, c'est-à-dire dans le bon sens; elle était pas née d'hier et on ne risquait pas de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Jim soupira. Dire qu'une femme comme Marg était tombée amoureuse de lui ! Surtout qu'elle était gentille et bien éduquée et qu'elle sortait d'une bonne famille de Barrowville, dans l'Ohio. Son oncle avait été pasteur méthodiste et son père pendant longtemps, le directeur du collège de Barrowville. Quelle chance ç'avait été pour lui le jour où il avait fait la connaissance de Marg! Elle l'avait regardé de haut avec son air de dire "Qu'est-ce qu'il y a encore ?", et quand il avait ôté son chapeau et essuyé ses grands pieds elle avait dit, "Comment allez-vous ? ", de cette voix froide qu'elle était capable d'adopter lorsqu'elle était mécontente. Ma Mayhew avait accepté Jim comme pensionnaire; les Mayhew avaient été durement touchés lorsque les Usines Métallurgiques de Barrowville avaient périclité; Pa avait perdu tout son argent, était tombé malade et ne pouvait plus travailler. Mais Marg n'était pas fille à rester assise à pleurer comme beaucoup d'autres; elle avait réuni le peu d'argent en sa possession et acheté une boutique de modiste. Et elle l'avait gérée efficacement. Marg, c'était quelqu'un de bien.
Jim s'agita nerveusement en froissant son journal. Un nom familier parmi les partants des courses d'Agua Caliente le mettait légèrement mal à l'aise. Demain, les chevaux allaient galoper là-bas au Mexique où il faisait chaud et où on pouvait flâner en manches de chemise, boire de la bonne bière et jouer Gonfallon au Pari-Mutuel dans la sixième à condition, bien sûr, que l'on ait un tant soit peu d'argent. Mais sacré bon sang! Si on était libre... Jim envoya le journal dinguer au loin, se leva, s'étira, et marcha de-ci de-là pendant une ou deux minutes. Cette nuit, pour la première fois, il regarda véritablement autour de lui; véritablement, c'est-à-dire qu'il concentra son attention sur le hall trop familier et en enregistra tous les détails. C'était un endroit d'une élégance dérisoire; un hôtel de troisième catégorie à huit kilomètres au nord du Loop, bourré de minables de toute espèce : un hypnotiseur au chômage, une fille de cabaret s'exhibant trois fois par jour, des employés, des commis, des représentants en assurance, deux coiffeurs, une sténo ou deux, tous ou presque tous d'une prétention aussi dérisoire que le hall rouge et brun avec ses faux tableaux de maîtres, son mobilier surabondant et trop capitonné, sa radio imitation acajou..." (traduction Pierre et Danièle Bondil, Editions de l'Ombre).

"The Asphalt Jungle" (1950, Quand la ville dort)
Le roman de W.R. Burnett sur un vol de bijoux ambitieux orchestré par une bande de criminels excentriques a solidifié un peu plus la réputation déjà impressionnante de John Huston en tant que maître écrivain et réalisateur. Immédiatement après avoir été libéré de prison, « Doc » Riedenschneider s’associe à l’avocat corrompu « Lon » Emmerich pour braquer une bijouterie. et recrutent pour cela plusieurs experts criminels pour effectuer le vol. Malgré une planification minutieuse, les choses tournent rapidement mal. Sterling Hayden, Louis Calhern, Jean Hagen, James Whitmore et Sam Jaffe sont à l'affiche de cet incontournable du cinéma noir..


Ellery Queen (1929-1958)
Manford (Emanuel) Lepofsky, alias Manfred Bennington Lee (1905-1971), et Daniel Nathan, alias Frederic Dannay (1905-1982), tous deux nés à Brooklyn, signèrent sous le pseudonyme d'Ellery Queen une série de policiers dont le héros, un jeune détective amateur, flegmatique et intellectuel à lorgnons, aura pour nom...Ellery Queen. "Grand, mince, un front de penseur et des mains d'athlète, Ellery vit dans un appartement de la 87e Rue, à New York, en compagnie de son père, l'inspecteur Richard Queen, et d'un jeune Gitan, Djuna, qui tient la maison depuis la mort de sa mère en 1922. Avec Ellery Queen, toute enquête se révèle un exercice intellectuel de haute volée, "les cinq premières minutes sont souvent celles qui comptent le plus...". La série débute en 1929, avec "The Roman Hat Mystery" (Le Mystère du chapeau de soie), "The Dutch Shoe Mystery" (1931, Le Mystère du soulier blanc), "The Greek Coffin Mystery" (1932, Deux morts dans un cercueil), "The Siamese Twin Mystery" (1933), et évoluera au fur et à mesure que les décennies passent, romans d'énigme classiques jusqu'à "The Adventures of Ellery Queen" (1935), pointe de suspense avec "The Door Between" (1937, Le Mystère du grenier), "The New Adventures of Ellery Queen" (1940), puis chronique dans les années 1950 de tous les maux de la société américaine représentés dans le contexte d'une petite agglomération imaginaire de la Nouvelle-Angleterre, Wrightville, avec "Calamity Town" (1942), "Ten Days' Wonder" (1948, La Décade prodigieuse) ou "Cat of Many Tails" (1949, Griffes de velours). . Les années 1960 voient apparaître de nouveaux contributeurs qui participent au cycle....

"The Siamese Twin Mystery" (1933, Le Mystère des frères siamois)
Septième roman de la série du détective Ellery Queen qui compte comme souvent dans cette première série, un défi lancé au lecteur qui a pu disposer de tous les éléments nécessaires à la résolution de l'énigme. Ici, les Queen, père et fils, se trouvent contraints de trouver refuge dans une riche mais sinistre demeure, avec d'autres personnes, dont deux jeunes jumeaux siamois, l'incendie menaçant les forêts dans lesquelles ils se trouvaient pour les vacances. Le propriétaire est assassiné, puis son frère, et chaque victime est découverte avec à la main la moitié d'un valet de carreau...
"...La pièce, dans laquelle ils pénétrèrent tenait à la fois du salon de musique et de la salle de jeu. Un piano à queue occupait un angle, entouré de fauteuils et de lampes disposés avec goût, mais la pièce était surtout meublée par des tables, de toutes sortes : tables pour les échecs, les dames, le bridge, le ping-pong. Il y avait même un billard. Outre celle par où ils étaient entrés, la pièce comptait trois portes : l'une à leur gauche, une autre qui donnait dans le couloir - c'était par là qu'ils avaient entendu des gens chuchoter - et enfin une troisième, en face, qui devait conduire, d'après ce qu'on pouvait apercevoir, à une bibliothèque. A droite, du côté de la façade, plusieurs portes-fenêtres ouvraient sur la terrasse.
Ellery embrassa le tout d'un coup d'oeil rapide, non sans remarquer des cartes à jouer étalées sur deux tables, ce qui ne manqua pas de le frapper. Puis, suivant le docteur et son père, il porta toute son attention sur les quatre personnes qui se trouvaient là. Dès l'abord, une chose lui parut certaine : tous les quatre étaient en proie à une intense agitation intérieure, que les hommes, d'ailleurs, trahissaient plus que les femmes. Les deux hommes s'étaient levés, mais aucun n'avait regardé les Queen en face. L'un des deux, un grand blond aux épaules larges et au regard vif - c'était le frère du docteur Xavier, cela ne faisait pas de doute - dissimulait son trouble en faisant des gestes; la tête baissée il était occupé à écraser une cigarette à peine entamée dans un cendrier posé sur une table de bridge. Pour quelque raison inconnue, l'autre rougit. C'était un jeune homme aux traits délicats, mais à la mâchoire carrée et aux yeux bleus perçants avec des cheveux bruns et des doigts tachés visiblement par des produits chimiques. "L'assistant, se dit Ellery. Charmant jeune homme. Quel que soit le secret de tous, ces gens-là, il le partage, mais manifestement çà n'a pas l'air de l'amuser." Les femmes, elles, avec cette aptitude qu'a le sexe faible à s'adapter aux circonstances, trahissaient à peine leur nervosité. L'une était jeune, l'autre sans âge. La jeune était grande, distinguée, dans les vingt-cinq ans et, apparemment, pas empruntée du tout. L'air calme, des yeux bruns pleins de vie, un visage agréable au charme indéfinissable, et une immobilité voulue qui annonçait la capacité d'agir, le cas échéant, de façon énergique et décisive. Elle se tenait assise, immobile, les mains croisées sur les genoux, arborant même un vague sourire. Seuls, ses yeux la trahissaient, des yeux brillants, dévorés d'inquiétude.
Mais le personnage le plus marquant des quatre, c'était sa compagne. Paraissant grande, même assise, la poitrine généreuse, un regard sombre et fier, des cheveux d'un noir de jais rehaussé de quelques fils d'argent, le teint mat, à peine maquillée, elle avait tout ce qu'il fallait pour attirer l'attention. Elle pouvait aussi bien avoir trente-cinq ans que cinquante. Et puis, il y avait en elle quelque chose de très français qu'Ellery ne parvenait pas à analyser. C'était visiblement une femme au tempérament passionné, dangereuse quand elle haïssait et redoutable quand elle aimait. Son type allait très bien avec des mouvements rapides et une vivacité qui annonçait une nature enjouée. En fait, elle restait assise sur sa chaise, si rigoureusement immobile qu'on l'aurait crue en état d'hypnose. Les yeux noirs et noyés étaient immobiles eux aussi, fixés sur un point situé à peu près à égale distance entre Ellery et son père. Ellery baissa les yeux, se composa un visage de circonstance et sourit..."
