- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

Karl Jaspers (1883-1969) - "Allgemeine Psychopathologie" (1913), "Die Geistige Situation der Zeit" (1931) - ...
Last update: 11/11/2016

Martin Heidegger et Karl Jaspers, de six ans son aîné, entretinrent une correspondance entre 1920 et 1963, 155 lettres ont été conservées et publiées (Correspondance de Martin Heidegger avec Karl Jaspers (1920-1963) suivi de Correspondance de Martin Heidegger avec Elisabeth Blochmann, Gallimard). Tous deux partagent à l'origine un rejet de la propension à l'abstraction que cultive l'Université, tous deux interrogent l' "existence", le hasard, la culpabilité ou la mortalité.
En 1920, Karl Jaspers est docteur en médecine, assistant dans une clinique psychiatrique, et vient de publier le "Manuel de psychopathologie générale" et "Psychologie des conceptions du monde". Heidegger, quant à lui, est alors privatdozent et assistant de Husserl à Fribourg et n'a encore rien publié, mais déjà sa renommée ne cesse de grandir. En 1927 paraît l'oeuvre principale de Heidegger, "Etre et Temps", suivra en 1932 "Philosophie", de Jaspers. Devenu en 1928 le successeur de Husserl à Fribourg, Heidegger, est nommé en 1933 Recteur de cette université, et, le 1er mai, adhère au NSDAP. Il se rend à Heidelberg pour une conférence sur «L'université dans le nouveau Reich», le 30 juin, et rend sa dernière visite à Jaspers qui découvre avec consternation ses dispositions au national-socialisme.
A la rigueur morale d'un Jaspers qui se tient toujours dans une expectative prudente, s'oppose la sympathie évidente de Heidegger pour "die völkische Blut-und-Boden-Politik der Nazis". Mais nulle trace de véritables échanges d'idées ou de confrontation dans une correspondance qui s'interrompt entre 1936 et 1949. Marié à une Juive, Gertrud Jaspers, le philosophe sera en 1937 interdit d'enseignement et de publication. En 1946, l'heure est aux justifications et à l'épuration, Jaspers, qui porte en lui la culpabilité de l'Allemagne, rédige le rapport qui aboutit à l'interdiction d'enseignement d'Heidegger. Au cours de la trentaine de lettres que les deux philosophes vont encore s'échanger entre 1949 et 1963, se poursuit cet étrange dialogue de deux pensées qui tentent la compréhension mais ne peuvent réellement se confronter tant elles sont aux antipodes l'une de l'autre...
Jaspers est l'un des pères de l'existentialisme allemand, avec Heidegger. Sa philosophie est une quête de la liberté et du sens face aux limites de l'existence...
- Les Situations-Limites (Grenzsituationen) : Ce sont des situations inévitables et insurmontables de l'existence humaine : la mort, la souffrance, la lutte, la culpabilité. Ce n'est pas en les fuyant, mais en les affrontant que l'être humain accède à son Existence authentique.
- L'Existence (Existenz) : Ce n'est pas simplement "exister". C'est la possibilité pour l'être humain de se transcender, de prendre des décisions libres et de se réaliser comme un être unique et irremplaçable, en lien avec ce que Jaspers appelle le Transcendant (ou l'Être, Dieu, l'Enveloppe).
- La Communication : C'est le cœur de sa pensée. L'Existence ne se réalise pas dans la solitude, mais dans et par la communication authentique avec autrui. La "lutte amoureuse" (liebender Kampf) est ce dialogue où chacun se révèle à l'autre dans sa vérité. C'est un antidote direct à la violence et à l'aliénation.
- La Foi Philosophique : Face à l'effondrement des religions traditionnelles, Jaspers propose une foi qui n'est pas basée sur la révélation, mais sur l'expérience intérieure de la liberté et de la transcendance dans les situations-limites.
Son existentialisme, plus accessible et humain que celui de Heidegger, a marqué la philosophie continentale. Son insistance sur la communication et la liberté reste d'une actualité brûlante à l'ère des réseaux sociaux et des discours non-dialogiques....

«Une philosophie de l'existence comme celle de Karl Jaspers n'est pas seulement l'itinéraire d'une conscience individuelle ; elle fait appel à d'autres consciences individuelles et tente à l'extrême de communiquer avec elles, à la faveur d'un langage commun. Mais en retour, si le langage est commun, la pensée qu'il véhicule ne peut être chaque fois qu'individuelle. Je pense, tu penses, et nul ne peut produire à ma place ce courage et cette docilité par quoi la pensée est toujours l'action intérieure d'un individu. Seuls les mots, l'appareil des concepts, la carcasse des arguments, sont entre les consciences, couchés dans les livres, radicalement anonymes, et attendant d'être vivifiés par une expérience unique comme celle de leur auteur et naissant en liaison avec celle-ci. On n'entre donc point en curieux dans une telle pensée, mais par une sympathie active qui n'est d'abord qu'un risque gratuit, mais qui peut devenir un dialogue fécond, même - et surtout - si le dialogue doit être ce combat amoureux qui figure, selon Jaspers lui-même, la forme la plus haute de la communication des consciences.» (Mikel Dufrenne, Paul Ricœur, Karl Jaspers et la Philosophie de l'existence, 1947)

Karl Jaspers (1883-1969)
Karl Jaspers naquit à Oldenbourg, non loin des côtes de la mer du Nord. Après quelques semestres de droit, il fit ses études de médecine, travailla pendant plusieurs années comme assistant à la clinique psychiatrique de Heidelberg et obtint son doctorat en médecine. Dès 1913, il enseigna la psychologie à la faculté des lettres de Heidelberg, avant de devenir dans cette même faculté professeur de philosophie en 1921, puis à Bâle, où il s'était réfugié. Il considère la réflexion philosophique non comme une activité théorique, mais comme une pratique d'un genre unique, impliquant sagesse et expérience. Sa philosophie s'éclaire et se déploie en fonction d'une double référence : « C'est à Kierkegaard que je dois le concept d' "existence", dont je me suis servi depuis 1916 pour désigner ce que j'avais jusqu'alors cherché dans la peine et l'inquiétude. Mais tout aussi chargé d'énergie et d'exigence était pour moi le concept de "raison", tel que Kant n'a cessé de l'éclairer. » Il pense que la politique et l'histoire font partie de cette réflexion car elles manifestent la présence de l'Être dans le monde.
Sa démarche philosophique naît d'un constat d'insuffisance de la psychopathologie générale et s’accentue, dans la "Psychologie der Weltanschauungen" [Psychologie des conceptions du monde] de 1919, lorsque, s’agissant d’analyser les positions idéologiques, conceptions du monde et types d’esprits, l’approche exclusivement psychologique se heurte aux "situations-limites" (souffrance, combat, culpabilité, mort, hasard) : "L'homme ne prend conscience de son être que dans les situations limites. C'est pourquoi, dès ma jeunesse, j'ai cherché à ne pas me dissimuler le pire. Ce fut l'une des raisons qui me firent choisir la médecine et la psychiatrie : la volonté de connaître la limite des possibilités humaines, de saisir la signification de ce que d'ordinaire on s'efforce de voiler ou d'ignorer. "
Le second thème concerne le rapport à l'autre : « L'être humain ne se trouve lui-même qu'avec l'autre être humain, et jamais par le seul savoir. Nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre devient lui-même, nous ne devenons libres que dans la mesure où l'autre le devient aussi. » Mais, « dans ces deux directions, ajoute-t-il, je ne suis jamais arrivé à un terme ».
Il a écrit "Die geistige Situation der Zeit" (1931), "Existenzphilosophie" (1938), "Die Atombombe und die Zukunft des Menschen" (1958).
La vie et l'œuvre de Jaspers sont marquées par plusieurs contextes décisifs ...
- Contexte historique : Il traverse les deux guerres mondiales, le nazisme et la reconstruction. Allemand et marié à une femme juive, Gertrud Mayer, il est considéré comme un "ennemi de l'État" par le régime nazi. Il est écarté de son poste universitaire en 1937 et vit sous la menace constante de la déportation. Cette expérience de la limite et de la fragilité de la civilisation marquera profondément sa pensée.
- Contexte intellectuel :
Psychiatrie : Formé à la médecine, il est déçu par le réductionnisme des explications purement biologiques des maladies mentales de son époque.
Philosophie : Il évolue dans un milieu intellectuel riche (il est l'ami et le rival de Martin Heidegger) et est influencé par Kierkegaard et Nietzsche, les pères de l'existentialisme. Il cherche une philosophie qui réponde aux crises de sens de l'époque moderne.
Politique : Après 1945, il devient une conscience morale de l'Allemagne de l'Ouest, réfléchissant aux conditions d'une démocratie et aux responsabilités collectives face à la barbarie nazie.
La Culpabilité Allemande et les Valeurs Démocratiques ...
Après-guerre, Jaspers intervient directement dans le débat public : "La Culpabilité Allemande" (1946). Il distingue quatre types de culpabilité,
- Criminelle (celle des bourreaux).
- Politique (celle des citoyens, qui engage la réparation).
- Morale (celle de l'individu qui a fermé les yeux).
- Métaphysique (celle de l'être humain qui n'a pas su empêcher l'horreur).
Cette analyse subtile refuse à la fois l'idée d'une culpabilité collective indistincte et celle d'une innocence générale. C'est un appel à un examen de conscience national.
"Karl Jaspers exerce sa critique dans l'esprit du médecin face à son malade. Il accueille les thèmes intellectuels comme autant de symptômes d'une existence, afin de se prononcer, au vu de ce matériel, sur la "substance" de cette existence exactement comme sur la santé d'un organisme. Sa réflexion rapporte les contenus philosophiques à la démarche de leur exposition et à la façon d'être de celui qui les expose..." (J.Habermas, Profils philosophiques et politiques)

Dans son premier grand ouvrage, "La Philosophie" (1932), Jaspers montre les limites de la connaissance scientifique : l'être est réduit à ce qui peut être étudié de l'extérieur. Cette première approche ne nous permet donc pas de comprendre l'être que je suis moi-même, parce que je ne puis me connaître moi-même que de l'intérieur. La tâche de l'élucidation de l'existence est de mettre tout individu sur le chemin des origines de son être-soi, dont il doit prendre conscience et qu'il est seul à pouvoir réaliser. Mais comme l'homme vit d'emblée dans une sorte de quiétude assoupie, et dans des conditions extérieures qui lui semblent aller de soi, il a besoin d'une impulsion particulière qui va le confronter à sa propre existence : cette impulsion est fournie par la confrontation à des situations limites que sont la mort, le combat, la souffrance, la faute.
Rejeté sur moi-même à l'épreuve des situations limites, l'existence a toutefois besoin d'autrui pour se réaliser : ce n'est qu'à travers l'autre que l'homme parvient à se comprendre lui-même. Enfin l'existence s'appuie sur autre origine, la transcendance, que Jaspers développe dans son deuxième ouvrage important, "De la Vérité" (1947), en introduisant la théorie de l'englobant : l'englobant est ce qui englobe tout être individuel sans être soi-même englobé par un autre, c'est l'être lui-même.

1913. Allgemeine Psychopathologie
Pour comprendre la philosophie de Jaspers, il est essentiel de se souvenir que c'est par la voie de la science qu'il est devenu philosophe. Après avoir obtenu, en 1908, le doctorat en médecine, Jaspers travaille jusqu'en 1915 comme «assistant volontaire» à la Clinique psychiatrique d'Heidelberg. La fréquentation des malades, l'examen critique de la littérature médicale et l'étude de cette réalité complexe que constituent les malades mentaux font mûrir en lui l'idée féconde que les réalités aperçues et les théories qui les interprètent ne se situent pas toutes sur le même plan, car elles dépendent du questionnement, des présupposés et des méthodes, qui ne dévoilent jamais qu'un aspect particulier de la réalité. La "Psychopathologie générale", avec laquelle Jaspers obtient en 1913 l'habilitation au professorat de psychologie, décrit les différents moyens par lesquels s'éclairent divers aspects de la réalité, finalement toujours insondable, du malade mental. L'observation de faits isolés, l'étude de leurs rapports et l'appréhension des ensembles se conditionnent et s'étayent mutuellement. Expliquer et comprendre sont des méthodes indispensables dont seule la pluralité est à la mesure de la pluridimensionnalité de l'être humain. Seule la multiplicité des théories peut rendre compte de l'homme dans sa totalité.
En Psychiatrie, Jaspers, fondateur de la Psychopathologie Compréhensive ...
Avant Jaspers, la psychiatrie était souvent descriptive et organiciste. Son livre "Psychopathologie générale" (1913) est une révolution.
Distinction "Comprendre" vs "Expliquer" ...
- Comprendre (Verstehen) : Saisir les connexions mentales "de l'intérieur". Par exemple, comprendre comment un deuil peut mener à une dépression. C'est la compréhension de la psyché humaine dans sa logique propre.
- Expliquer (Erklären) : Constater des causalités organiques ou biologiques externes. Par exemple, expliquer des hallucinations par une lésion cérébrale.
- Importance de la subjectivité : Il introduit la phénoménologie en psychiatrie, décrivant avec précision l'expérience vécue (vécu subjectif) du patient, sans la réduire à un simple symptôme. C'est la base de l'entretien clinique moderne.
- La notion de "Processus" : Il distingue les développements psychologiques compréhensibles (ex: une névrose) des "processus" maladies (comme la schizophrénie) qui sont incompréhensibles et relèvent d'une causalité organique à expliquer.
Son apport est ainsi fondateur pour la psychiatrie clinique et la thérapie centrée sur le patient.
La psychopathologie compréhensive est enseignée dans le monde entier. Des auteurs majeurs comme Ludwig Binswanger (phénoménologie) et toute l'école de l'antipsychiatrie s'en réclament. Son approche humaniste est un contrepoint essentiel aux approches purement pharmacologiques et neurobiologiques d'aujourd'hui...

1932 – Philosophie
(Philosophie. 3 Bände (I. Philosophische Weltorientierung; II. Existenzerhellung; III. Metaphysik)
Non seulement l'homme est là, mais il veut être soi, c'est ce que Jaspers développe en 1932 dans les trois volumes de sa "Philosophie", qui se subdivise en "Orientation dans le monde", ou investigation de la réalité objective, en "Eclairement de l'existence", ou appel à l'être-soi, et en "Métaphysique" ou évocation de la transcendance. Une place privilégiée est désormais faite à l'homme en tant qu'existence possible dont la connaissance échappe à l'investigation qui procède par concepts, et ne peut être éclairée que par la réflexion philosophique qui use de signes (Signa). Ce n'est qu'indirectement qu'on peut diriger l'attention sur l'être-soi de l'homme, qui n'est jamais objet pour lui-même, mais n'est véritablement et ne se révèle que dans la «communication» avec autrui, prend forme «historique», affirme sa «liberté» dans la décision inconditionnelle, accède à la conscience en «situation-limite», acquiert la certitude de lui-même dans des actions inconditionnelles, s'accomplit comme «conscience absolue».

Mais qu'est-ce que la philosophie?, s'interroge Karl Jaspers en 1950 dans une série d'allocutions radiophoniques. Il retrouve ainsi la question que ne cessent de se poser tous les philosophes. D'autant que personne ne s'accorde sur ce qu 'elle est, ni sur ce qu'elle vaut. Il entreprend alors la question par un biais qui peut paraître surprenant:
"Un signe admirable du fait que l'être humain trouve en soi la source de sa réflexion philosophique, ce sont les questions des enfants. On entend souvent, de leur bouche, des paroles dont le sens plonge directement dans les profondeurs philosophiques.
En voici quelques exemples :
L'un dit avec étonnement : "J'essaie toujours de penser que je suis un autre, et je suis quand même toujours moi." Il touche ainsi à ce qui constitue l'origine de toute certitude, la conscience de l'être dans la connaissance de soi. Il reste saisi devant l'énigme du moi, cette énigme que rien ne permet de résoudre. Il se tient là, devant cette limite, il interroge.
Un autre, qui écoutait l`histoire de la Genèse : «"Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre...", demanda aussitôt : "Qu'y avait-il donc avant le commencement ?" Il découvrait ainsi que les questions s`engendrent à l'infini. que l'entendement ne connaît pas de borne à ses investigations et que, pour lui, il n`est pas de réponse vraiment concluante.
Une petite fille fait une promenade ; à l'entrée d'une clairière, on lui raconte des histoires d'elfes qui y dansent la nuit. "Mais pourtant, ils n'existent pas..." On lui parle alors des choses réelles, on lui fait observer le mouvement du soleil, on discute la question de savoir si c'est le soleil qui se meut ou la terre qui tourne, on produit les raisons de croire à la forme sphérique de la terre et à son mouvement de rotation... "Mais ce n'est pas vrai, dit la fillette en frappant du pied le sol, la terre ne bouge pas. Je ne crois que ce que je vois." On lui réplique : "Alors tu ne crois pas au bon Dieu, tu ne le vois pas non plus." La petite semble interloquée, puis déclare résolument : «"S'il n'existait pas, nous ne serions pas là." Elle avait été saisie d'étonnement devant la réalité du monde : il n'existe pas par lui-même. Et elle comprenait la différence qu`il y a entre un objet faisant partie du monde et une question concernant l'être et notre situation dans le tout.
Une autre enfant va faire une visite et monte un escalier. Elle prend conscience du fait que tout change sans cesse, que les choses s'écoulent et passent comme si elles n`avaient pas existé. "Mais il doit pourtant bien y avoir quelque chose de solide. Je monte maintenant, ici, un escalier pour aller chez ma tante, ça je veux le garder." Sa surprise et sa frayeur devant l`écoulement universel et l'évanescence de tout lui faisaient chercher à tout prix une issue.
En collectionnant des remarques de ce genre. on pourrait constituer toute une philosophie enfantine. On alléguera peut-être que les enfants répètent ce qu`ils entendent de la bouche de leurs parents et des autres adultes : cette objection est sans valeur lorsqu'il s'agit de pensées aussi sérieuses. On dira encore que ces enfants ne poussent pas plus loin la réflexion philosophique et que, par conséquent, il ne peut y avoir là chez eux que l'effet d`un hasard. On négligerait alors un fait; ils possèdent souvent une génialité qui se perd lorsqu'ils deviennent adultes. Tout se passe comme si, avec les années, nous entrions dans la prison des conventions et des opinions courantes. des dissimulations et des préjugés, perdant du même coup la spontanéité de l'enfant, réceptif à tout ce que lui apporte la vie qui se renouvelle pour lui à tout instant ; il sent, il voit, il interroge, puis tout cela lui échappe bientôt. Il laisse tomber dans l'oubli ce qui s'était un instant révélé à lui, et plus tard il sera surpris quand on lui racontera ce qu'il avait dit et demandé.
Une recherche philosophique jaillie de l'origine ne se manifeste pas seulement chez les petits. mais aussi chez les malades mentaux. Il semble parfois - rarement - que chez eux le bâillon de la dissimulation générale s'est relâché et nous entendons alors parler la vérité. Au stade où des troubles mentaux commencent à se manifester, il arrive que se produisent des révélations métaphysiques saisissantes. Leur forme et leur langage, il est vrai. ne sont pas tels que, publiées, elles puissent prendre une signification objective, à moins de cas
exceptionnels comme celui du poète Hölderlin ou du peintre Van Gogh. Mais lorsqu'on assiste à ce processus, on a malgré soi l'impression qu'un voile se déchire. celui sous lequel nous continuons, nous, notre vie ordinaire. Beaucoup de gens bien portants ont fait aussi l'expérience suivante: ils s'éveillent avec le sentiment d'avoir aperçu dans leur sommeil le sens de choses étrangement profondes, et celles-ci se dérobent au moment où ils sont parfaitement éveillés. en laissant seulement derrière elle une sensation d'impénétrabilité. Le dicton selon lequel "la vérité sort de la bouche des enfants et des fous" recèle un sens profond. Pourtant ce n'est pas là que réside l'originalité créatrice à laquelle nous devons les grandes pensées philosophiques ; elle est le fait d'un petit nombre de grands esprits, d'une fraîcheur et d'une indépendance exceptionnelles, surgis au cours des millénaires...."
(Introduction à la philosophie)
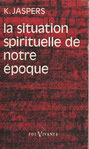
1931. Die Geistige Situation der Zeit (Situation spirituelle de notre époque)
La tâche du philosophe est de comprendre l'homme dans le temps, de le ramener aux mesures de l'humanité, de le replacer devant la Transcendance : "Le tourbillon de l'existence moderne nous empêche de saisir ce qui se passe réellement. Nous flottons dans l'existence comme sur une mer, sans pouvoir lui échapper et nous accrocher à un rivage d'où il nous serait possible d'embrasser la totalité dans une pure contemplation. Le tourbillon ne nous révèle que ce que nous pouvons apercevoir dans le mouvement même qui nous entraîne avec lui. On s'accorde aujourd'hui, dans une évidence universelle, à considérer l'existence comme un processus destiné à assurer le bien-être des masses au moyen d'une production rationnelle basée sur des inventions techniques. C'est comme si la totalité pouvait être amenée à une organisation parfaite par l'intelligence seule. Mais si cette connaissance de la totalité d'un processus intelligible suivant lequel s'instaure un monde humain se transforme en une connaissance décisive de l'être du présent, et si, par là même, la réalité de l'homme apparaît n'être au fond rien d'autre qu'une organisation des masses destinée à assurer leur existence, alors ce qui nous tient prisonnier, ce n'est plus ce tourbillon aux possibilités imprévisibles, mais bien ces mécanismes dont le fonctionnement engendre un développement économique conçu comme nécessaire.
Cependant l'organisation de l'existence se révèle toujours faussée; elle menace de s'effondrer; elle apparaît comme irréalisable. La question est de savoir si elle peut déjà par elle-même constituer pour nous la totalité, ou bien si elle n'est pas englobée dans une totalité plus large. Les limites de l'organisation de l'existence font apparaître l'Etat, l'esprit et l'humanité elle-même comme des sources d'activité humaine qui ne se laissent pas absorber par aucune forme d'organisation de l'existence, bien que cette organisation elle-même ne soit possible que par elles.
La réalité de l'homme ne devient sa situation spirituelle que grâce à la connaissance qu'il se construit de cette réalité à partir de ses sources ..."

Jaspers définit sa philosophie en tant que "philosophie de l'existence":
"La sociologie, la psychologie et l'anthropologie nous apprennent à considérer l'homme comme un objet susceptible d'être soumis à des expériences et d'être modifié par des procédés appropriés : elles atteignent ainsi, sans doute, certains aspects de l`homme, mais pas l'homme lui-même. L'homme en tant que spontanéité ouverte sur le possible ne peut se réduire à l'état d'un pur résultat. Les constructions de la sociologie, de la psychologie ou de l'anthropologie ne sont nullement contraignantes pour l'individu. Celui-ci se libère de l'emprise que les sciences essayent de prendre sur lui - de façon apparemment définitive - en prenant conscience du caractère particulier et relatif de ses connaissances. Il se rend compte que les sciences, au moment où elles portent sur l'être une affirmation dogmatique. dépassent les limites du connaissable et deviennent alors un substitut illusoire de l'activité philosophique ; car dès qu'on veut échapper à la liberté, on essaye de se justifier au nom d'une pseudo-science de l'être.
Dans chaque situation et dans chaque profession l'homme a besoin, pour son action, de connaissances techniques spécialisées qui portent sur les choses et sur sa propre existence. Mais jamais ces connaissances techniques ne peuvent lui suffire. Car elles ne tirent leur sens que de celui qui les possède. Ce qu'il peut en faire. ce n'est que son vouloir authentique qui peut le déterminer. Les meilleures lois, les institutions les plus parfaites, les résultats scientifiques les plus exacts, les techniques les plus efficaces peuvent être utilisés à contresens. Ils perdent toute valeur lorsque l'homme ne leur fait pas correspondre une réalité significative. Il n'est donc pas possible de modifier le cours des événements par une simple amélioration des connaissances techniques : seul l'être de l'homme peut le déterminer de façon décisive : ce qui est à la source de l`action de l'homme, c'est son attitude intérieure, la conscience qu'il prend de sa situation dans le monde, le contenu de ses satisfactions.
La philosophie de l'Existence est un mode de pensée qui se sert de toutes les connaissances techniques. mais qui les dépasse, un mode de pensée grâce auquel l`homme peut devenir lui-même. Elle ne porte pas sur des réalités objectives mais elle éclaircit et en même temps elle conduit à son accomplissement l'être de celui qui l`exerce. Mise en branle par une opération qui consiste à dépasser toutes les formes de connaissance du monde, qui fixent l'être (à ce niveau, elle est orientation philosophique sur le monde), elle en appelle a la liberté de l'homme (et ici elle devient éclaircissement de l'Existence) et lui fournit l`espace de son agir inconditionné par l`évocation de la transcendance (elle s`achève ainsi en métaphysique).
Cette philosophie de l'Existence ne peut pas prendre la forme parfaite d`un ouvrage déterminé, ni trouver son accomplissement définitif dans l'existence d'un penseur. C'est Kierkegaard qui est à l'origine de sa forme actuelle ; il lui a d`ailleurs donné une extension incomparable. Après avoir fait sensation, de son temps, à Copenhague, il fut bientôt oublié, et il n'a été redécouvert que peu après la guerre mondiale ; son influence n'est toutefois devenue décisive qu'aujourd'hui. Dans sa dernière philosophie. Schelling a amorcé un dépassement de l'idéalisme allemand dans le sens de la philosophie existentielle. Mais, de même que Kierkegaard chercha en vain une méthode de communication et s'aida de sa technique des pseudonymes et de ses "expérimentations psychologiques", Schelling étouffa sa propre inspiration et trahit ses intuitions en les intégrant dans la perspective idéaliste qu'il avait créée lui-même, à laquelle il était attaché depuis sa jeunesse et dont il ne put jamais se débarrasser. Kierkegaard porta tous ses efforts sur le problème le plus profond de la philosophie - celui de la communication -, en essayant d'atteindre une communication indirecte, il fut conduit a un mode d`expression qui déforme singulièrement sa pensée, mais qui reste cependant capable de réveiller tout lecteur. Schelling, au contraire, resta comme inconscient et il ne peut être découvert qu'a travers Kierkegaard. Partant d'une autre base, et sans connaître ni Kierkegaard ni Schelling, Nietzsche développa une philosophie qui se trouve aussi sur la voie de la philosophie de l`Existence.
[...]
La philosophie de l'Existence ne peut pas trouver de solution, mais elle ne peut être réalisée que par une pluralité de penseurs communiquant les uns avec les autres, chacun à partir de son propre fondement. Son temps est venu, mais déjà, aujourd'hui elle apparaît surtout sous la forme de contrefaçons : déjà elle est devenue la proie de l'agitation qui fait, de tout ce qui survient au monde, un tumulte incongru.
La philosophie de l'Existence se perdrait si elle s'imaginait, elle aussi, savoir ce qu'est l'homme. Elle aussi donnerait alors des cadres pour l`étude des types de la vie humaine et animale et deviendrait à son tour anthropologie, psychologie, sociologie. Elle ne peut prendre son sens que si elle se refuse à se fixer dans son objet. Elle éveille des possibilités qu'elle ne connaît pas, elle éclaircit et elle met en mouvement mais elle ne fixe pas. Elle est le moyen qui permet à l'homme qui se cherche de se maintenir dans sa direction et de réaliser les moments les plus hauts de sa vie.
La philosophie de l'Existence peut dégénérer en pure subjectivité, si elle fait, à tort, de l`être-soi un ego qui s'enferme dans une existence solipsiste et prétend s'y limiter. La vraie philosophie de l'Existence est la mise en question par laquelle l'homme fait appel à ce qui lui permettra de se retrouver lui-même. On comprend dès lors qu'elle ne puisse se maintenir qu'à la condition de rester l'enjeu d'une conquête. En la confondant avec la pensée sociologique, psychologique et anthropologique, on lui prête un déguisement sophistiqué; tantôt on la blâme sous prétexte qu'elle est individualiste. tantôt on l`utilise pour justifier sa propre impudeur. et on en fait ainsi le champ d`une dangereuse activité philosophique de type hystérique. Mais dans la mesure où elle est reste fidèle à elle-même. elle est seule à rendre saisissable la manifestation de l`homme authentique.."

"Quelles forces vous font vivre ? " Karl Jaspers, dans un texte de 1962, prolongement de son Autobiographie philosophique de 1957, entreprend de répondre à cette interrogation....
"Il est impossible de résoudre sans contradictions le cercle à l`intérieur duquel nous sommes donnés à nous-mêmes et agissons librement. le cercle du fondement de la liberté et de la liberté elle-même. Il est "englobé" par la transcendance. La réalité de la transcendance et la façon dont elle devient réelle s`expriment par la clarté qu'apporte l'activité philosophique; mais cette activité ne suffit pas à créer la transcendance. Lorsque j`étais jeune, je trouvai cette clarté chez Spinoza, plus tard chez Kant, et enfin dans la Bible et dans Platon. Jamais je ne passai par une collectivité institutionnelle. Enfant, j`ignorai la réalité ecclésiale. Ceux de ses représentants que j`approchai me la rendirent antipathique par son insincérité, puis elle me fut indifférente. C'est dans ma vieillesse seulement que j'ai compris, à ma façon, ce qu'elle représentait et que j'ai approuvé son existence, bien que je sois personnellement resté à l'écart. Le dialogue silencieux avec certains êtres permet d`éprouver l'Englobant de la transcendance. Mon activité philosophique a consisté à attirer l`attention sur ces choses. C'est de là que j'ai reçu le moi que j`ai été, mais que les formules générales ne permettaient plus de traduire.
La question posée demandait une réponse où il eût été question des forces qui, à notre époque, sont secourables et salutaires. Si je m`étais livré a la vaine tentative de mettre en lumière les forces que l'on pourrait aujourd'hui voir objectivement, et sur lesquelles on pourrait compter, j'aurais participé aux illusions pernicieuses de notre temps. En fait. on ne peut compter sur rien, ni sur l'Etat ni sur l'Eglise. Au cours du XXe siècle, les puissants de ce monde nous ont amèrement déçus, dans presque toutes les situations concrètes sans exception. Seul l'oubli universel peut détourner notre attention de ce fait. Les seuls sur lesquels chacun ait pu compter ont été ses proches parents ou amis, et tous ceux qui, ici ou là, ont joué leur rôle de prochain. L'insécurité actuelle favorise l'affermissement des autorités traditionnelles, la création d'autorités inédites, la recherche de l'irresponsabilité dans l'obéissance. Or cela n'ébranle pas l`insincérité dont nous devons absolument sortir, mais au contraire cela l'encourage.
Puisque nous ne pouvons plus attendre ni de l`Eglise, ni de l'Etat la réponse à la question de savoir où chercher le salut, la seule réponse que nous puissions obtenir, dans l'abîme où nous sommes tombés, est une réponse personnelle et individuelle. Nous nous portons secours mutuellement, dans la mesure où nous sommes véritablement humains. Chacun de nous prête attention, au passage, à ses compagnons de route. Aucun d'entre nous n'est un modèle, mais chacun peut participer à la libération qui procède de la transcendance.
Comme d'autres, je ressens mon échec, tout en ayant la force de vivre. Qu'il s'agisse de l'instinct d'exister, de l'attraction exercée par l'être ou des forces sur lesquelles je dirige ma réflexion, il s'agit toujours là en définitive d'un grand miracle : c'est non seulement la force de vivre, mais le fait de pressentir, grâce à cette force, l'éternité à travers la vie.
N'étant qu'un homme parmi des milliards. me satisfaisant moi-même si peu, et n'ayant pas le moindre goût pour la prophétie ou l'autorité, j`ai cependant tenté de répondre à la question qui m'était posée en même temps qu'à d'autres. Pourquoi l'ai-je fait ? Les conceptions de la vie et les diverses façons de la vivre peuvent différer jusqu'à ne se ressembler en rien, car les origines ne sont jamais les mêmes ; derrière cette diversité, cependant, se cache un élément commun. Chacun est donc en droit de dire quelles expériences il a faites. Son récit présentera un aspect nécessairement fragmentaire et particulier de l'expérience humaine, mais il pourra peut-être attirer l'attention d'un autre homme, soit qu'il provoque son hostilité, soit qu'il suscite sa sympathie, soit qu'il l'incite à la réflexion, soit qu'il lui ouvre une voie.
Le monde ne pourra être sauvé que si chacun entreprend de réaliser le salut en lui-même, ce salut qui consiste à être donné à soi, l'on ne sait d'où. Mais chacun a également besoin d'un monde qui l'adopte. Parmi les ruines du monde passé, au milieu des organes toujours plus pensants qui nous facilitent l'existence tout en lui fixant des limites. un monde nouveau se dégagera. Chacun de nous peut contribuer à le créer. Aujourd'hui. chaque homme est appelé à ne pas renoncer sous prétexte qu'il se sent isolé. Pour cela, l'homme a besoin de l'homme, son compagnon de route. C`est la que se trouvent notre enracinement. notre genèse et nos origines. La vérité, dit Nietzsche, commence à deux !"
(Réponse à la question "Quelles forces nous font vivre?", in "Essais philosophiques", traduction Hersch, Payot.

"Einführung in die Philosophie" (Introduction à la Philosophie, 1950)
Contrairement à la science, la philosophie n`est pas réservée aux seuls professionnels, tout être humain peut prétendre à son maniement : la tâche qu`elle assume étant de définir la condition humaine. Un individu, quel qu`il soit, a donc le droit de philosopher sur son destin propre, sur son expérience personnelle. L`origine de la philosophie se trouverait dans le mélange d`étonnement et de doute provoqué par la conscience que chacun a d`être perdu au sein de la multiplicité de ce monde et de l'existence. Le besoin se fait alors sentir de la philosophie, dont le caractère essentiel est de pouvoir communiquer avec autrui.
Par ailleurs, elle favorise la reconnaissance de soi et du monde, la mise en œuvre de l`amour et la plénitude de la sérénité. Jaspers envisage l`idée de Dieu que l`homme s`est construite en se fondant sur la Bible, et sur la mythologie grecque. Le croyant a toujours été ouvert à la philosophie qui, s`il reste sec et pauvre, ne peut lui apprendre que ce qu'il sait déjà. Elle ne donne rien, elle ne peut qu'éveiller. L`homme atteint par moments l`absolu, par exemple dans l'amour ou dans le combat. Sénèque, Giordano Bruno et d`autres encore en sont des exemples qui nous donnent de véritables encouragements. tandis que les saints "ne résistent pas à un examen réaliste". Cet absolu signifie participation à l'éternel, à l`être. Le centre de l`absolu se manifeste par l`opposition du bien et du mal, car c`est le choix du bien qui détermine l`absolu.
Dans un chapitre sur l`homme, Jaspers essaie de définir ce qu`est l`homme. Il se distingue principalement de toutes les autres créatures vivantes par la liberté et la transcendance. Le problème qui se pose à ce propos est que l'Eglise condamne toute tentative d'entrer en rapport avec Dieu quand elle s`étaye sur des données philosophiques ; cela est dû au fait que les prêtres confondent l`obéissance à Dieu avec l'obéissance à des instances nées du monde, comme les Eglises, les Livres sacrés ou les Lois. Or le monde s`interpose entre Dieu et l`existence : la façon d`appartenir au monde peut s`exprimer par un mythe. Dans le mythe chrétien, le monde n`existe pas par lui-même, il n`est qu'une réalité passagère inhérente au cours d`un processus surnaturel. Ce qui est réel, c'est Dieu et l'existence. Celui qui ne croit pas en Dieu est abusé par des lumières qui correspondent à une recherche trop poussée des raisons objectives de la foi. Néanmoins la vraie loi ne peut être ni imposée ni détruite par une quelconque critique. On critique ceux qui ont perdu la foi sans se rendre compte qu'ils ne l`ont jamais eue.
Un chapitre est consacré à l'histoire de l`humanité, à son importance pour l'homme actuel, à son sens et finalement à son dépassement qui doit aboutir à une entrée dans l`essence toute pure des choses. L'indépendance philosophique a toujours été le but des penseurs ; elle n`est toutefois devenue possible qu`à notre époque, car on peut œuvrer sans conditionnement.
La dernière partie du livre nous mène à travers l'histoire de la philosophie et des problèmes qui ont toujours dominé les relations entre l`Eglise et la philosophie.
Chapitre I - QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ?
"On n’est d’accord ni sur ce qu’est la philosophie, ni sur ce qu’elle vaut. On attend d’elle des révélations extraordinaires, ou bien, la considérant comme une réflexion sans objet, on la laisse de côté avec indifférence. On vénère en elle l’effort lourd de signification accompli par des hommes exceptionnels, ou bien on la méprise, n’y voyant que l’introspection obstinée et superflue de quelques rêveurs. On estime qu’elle concerne chacun et doit être simple et facile à comprendre, ou bien on la croit si difficile que l’étudier apparaît comme une entreprise désespérée. Et en fait, le domaine compris sous ce nom de « philosophie » est assez vaste pour expliquer des estimations aussi contradictoires.
Pour quiconque croit à la science, le pire est que la philosophie ne fournit pas de résultats apodictiques, un savoir qu’on puisse posséder. Les sciences ont conquis des connaissances certaines, qui s’imposent à tous ; la philosophie, elle, malgré l’effort des millénaires, n’y a pas réussi. On ne saurait le contester : en philosophie il n’y a pas d’unanimité établissant un savoir définitif. Dès qu’une connaissance s’impose à chacun pour des raisons apodictiques, elle devient aussitôt scientifique, elle cesse d’être philosophie et appartient à un domaine particulier du connaissable.
A l’opposé des sciences, la pensée philosophique ne paraît pas non plus progresser. Nous en savons plus, certes, qu’Hippocrate, mais nous ne pouvons guère prétendre avoir dépassé Platon. C’est seulement son bagage scientifique qui est inférieur au nôtre. Pour ce qui est chez lui à proprement parler recherche philosophique, à peine l’avons-nous peut-être rattrapé.
Que, contrairement aux sciences, la philosophie sous toutes ses formes doive se passer du consensus unanime, voilà qui doit résider dans sa nature même. Ce que l’on cherche à conquérir en elle, ce n’est pas une certitude scientifique, la même pour tout entendement ; il s’agit d’un examen critique au succès duquel l’homme participe de tout son être. Les connaissances scientifiques concernent des objets particuliers et ne sont nullement nécessaires à chacun. En philosophie, il y va de la totalité de l’être, qui importe à l’homme comme tel ; il y va d’une vérité qui, là où elle brille, atteint l’homme plus profondément que n’importe quel savoir scientifique.
L’élaboration d’une philosophie reste cependant liée aux sciences ; elle présuppose tout le progrès scientifique contemporain. Mais le sens de la philosophie a une autre origine : il surgit, avant toute science, là où des hommes s’éveillent.
Cette philosophie sans science présente quelques caractères remarquables :
1° Dans le domaine philosophique, presque chacun s’estime compétent. En science, on reconnaît que l’étude, l’entraînement, la méthode sont des conditions nécessaires à la compréhension ; en philosophie, au contraire, on a la prétention de s’y connaître et de pouvoir participer au débat, sans autre préparation. On appartient à la condition humaine, on a son destin propre, une expérience à soi, cela suffit, pense-t-on.
Il faut reconnaître le bien-fondé de cette exigence selon laquelle la philosophie doit être accessible à chacun. Ses voies les plus compliquées, celles que suivent les philosophes professionnels, n’ont de sens en effet que si elles finissent par rejoindre la condition d’homme ; et celle-ci se détermine d’après la manière dont on s’assure de l’être et de soi-même en lui.
2° La réflexion philosophique doit en tout temps jaillir de la source originelle du moi et tout homme doit s’y livrer lui-même.
3° Un signe admirable du fait que l’être humain trouve en soi la source de sa réflexion philosophique, ce sont les questions des enfants. On entend souvent, de leur bouche, des paroles dont le sens plonge directement dans les profondeurs philosophiques. En voici quelques exemples :
L’un dit avec étonnement : « J’essaie toujours de penser que je suis un autre, et je suis quand même toujours moi. » Il touche ainsi à ce qui constitue l’origine de toute certitude, la conscience de l’être dans la connaissance de soi. Il reste saisi devant l’énigme du moi, cette énigme que rien ne permet de résoudre. Il se tient là, devant cette limite, il interroge.
Un autre, qui écoutait l’histoire de la Genèse : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre…» demanda aussitôt : « Qu’y avait-il donc avant le commencement ? » Il découvrait ainsi que les questions s’engendrent à l’infini, que l’entendement ne connaît pas de borne à ses investigations et que, pour lui, il n’est pas de réponse vraiment concluante...."
"Chapitre II - ORIGINES DE LA PHILOSOPHIE
L’histoire de la philosophie a commencé sous la forme d’un effort de pensée méthodique il y a deux mille cinq cents ans ; sous la forme d’une pensée mythique, beaucoup plus tôt.
Mais un commencement, c’est autre chose qu’une origine : le commencement est historique et procure aux successeurs une quantité croissante d’éléments fournis par le travail intellectuel déjà accompli. Tandis que l’origine, c’est la source d’où jaillit constamment l’impulsion à philosopher. C’est par elle seulement qu’une philosophie contemporaine devient quelque chose d’essentiel, par elle que l’on comprendra la philosophie du passé.
Cet élément originel est multiple. L’étonnement engendre l’interrogation et la connaissance ; le doute au sujet de ce qu’on croit connaître engendre l’examen et la claire certitude ; le bouleversement de l’homme et le sentiment qu’il a d’être perdu l’amène à s’interroger sur lui-même. Précisons d’abord ces trois facteurs.
1° Platon a dit que l’origine de la philosophie, c’est l’étonnement. Notre œil nous a fait « participer au spectacle des étoiles, du soleil et de la voûte céleste ». Ce spectacle nous « a incités à étudier l’univers entier. De là est née pour nous la philosophie, le plus précieux des biens que les dieux aient accordé à la race des mortels ». Et Aristote : « Car c’est l’émerveillement qui poussa les hommes à philosopher : ils s’étonnèrent d’abord des choses étranges auxquelles ils se heurtaient ; puis ils allèrent peu à peu plus loin et se posèrent des questions concernant les phases de la lune, le mouvement du soleil et des astres, et la naissance enfin de l’univers entier. »
S’étonner, c’est tendre à la connaissance. En m’étonnant, je prends conscience de mon ignorance. Je cherche à savoir, mais seulement pour savoir « et non pour contenter quelque exigence ordinaire ».
Philosopher, c’est s’éveiller en échappant aux liens de la nécessité vitale. Cet éveil s’accomplit lorsque nous jetons un regard désintéressé sur les choses, le ciel et le monde, lorsque nous nous demandons : « Qu’est-ce que tout cela ? D’où tout cela vient-il ? » Et l’on n’attend pas que les réponses à ces questions aient une quelconque utilité pratique, mais qu’elles soient en elles-mêmes satisfaisantes.
2° Une fois mon étonnement et mon émerveillement apaisés par la connaissance du réel, voici que surgit le doute. Les connaissances, il est vrai, s’accumulent, mais pour peu qu’on se livre à un examen critique, plus rien n’est certain. Les perceptions sensibles sont conditionnées par nos organes et elles nous trompent, en tout cas elles ne coïncident pas avec ce qui existe en soi hors de nous, indépendamment de la perception que nous en avons. Les formes de notre pensée appartiennent à notre entendement humain. Elles s’emmêlent en d’insolubles antinomies. Partout des affirmations s’opposent à d’autres affirmations. Si je veux philosopher, je me saisis du doute, j’essaie de le pousser jusqu’au bout. Ce faisant, je peux soit me livrer à la volupté de nier – car le doute, sans permettre un seul pas en avant fait que rien ne vaut désormais – soit rechercher une certitude qui lui échappe et résiste à tout examen critique loyal.
La célèbre formule de Descartes, « je pense donc je suis, » lui est apparue indubitable au moment où il doutait de tout le reste. Car si même, sans m’en rendre compte, je me trompe totalement pour tout ce que je crois connaître, il n’est pas possible que je me trompe encore sur le fait que j’existe malgré tout, alors même qu’on m’induit en erreur.
Le doute devenu méthodique entraîne un examen critique de toute connaissance. D’où il découle que sans doute radical, il n’est pas de philosophie véritable. Mais ce qui est décisif, c’est de voir comment et où le doute lui-même permet de conquérir le fondement d’une certitude.
3° Quand je suis absorbé par la connaissance des objets dans le monde, par le déploiement du doute qui doit me conduire à la certitude, je m’occupe des choses, je ne pense pas à moi, à mes fins, à mon bonheur, mon salut. Au contraire, je suis content de m’oublier moi-même en acquérant ces nouvelles connaissances.
Cela change lorsque je prends conscience de moi-même dans ma situation.
Epictète, le stoïcien, a dit : « L’origine de la philosophie, c’est l’expérience que nous faisons de notre propre faiblesse et de notre impuissance. » Comment me tirer d’affaire, dans cette impuissance ? Il a donné la réponse suivante : il faut que je considère tout ce qui n’est pas en mon pouvoir, de par sa nécessité propre, comme indifférent pour moi ; en revanche il m’appartient d’amener par la pensée tout ce qui dépend de moi, notamment le mode et le contenu de mes représentations, à la clarté et à la liberté.
Considérons un peu quelle est notre condition, à nous, hommes. Nous nous trouvons toujours dans des situations déterminées. Les situations changent, des occasions se présentent. Quand on les manque, elles ne reviennent plus. Je peux travailler moi-même à changer une situation. Mais il en est qui subsistent dans leur essence, même si leur apparence momentanée se modifie et si leur toute-puissance se dissimule sous un voile : il me faut mourir, il me faut souffrir, il me faut lutter ; je suis soumis au hasard, je me trouve pris inévitablement dans les lacets de la culpabilité. Ces situations fondamentales qu’implique notre vie, nous les appelons situations-limites. Cela veut dire que nous ne pouvons pas les dépasser, nous ne pouvons pas les transformer. En prendre conscience, c’est atteindre, après l’étonnement et le doute, l’origine plus profonde de la philosophie. Dans la vie courante nous nous dérobons souvent devant elles ; nous fermons les yeux et nous vivons comme si elles n’existaient pas. Nous oublions que nous devons mourir, nous oublions que nous sommes coupables, que nous sommes à la merci d’un hasard. Nous n’avons dès lors affaire qu’à des situations concrètes que nous manœuvrons à notre avantage et auxquelles nous réagissons en dressant des plans d’action pratique dans le monde, poussés que nous sommes par nos intérêts vitaux. En revanche, nous réagissons aux situations-limites soit en nous les dissimulant, soit – lorsque nous les voyons clairement – par le désespoir et une sorte de rétablissement : nous devenons nous-mêmes, par une métamorphose de notre conscience de l’être.
Nous pouvons aussi nous faire une idée plus claire de notre condition d’hommes par une voie différente, en considérant qu’il est impossible de compter sur quoi que ce soit dans le monde. Quand nous ne nous posons pas de questions, le monde nous apparaît comme l’être en soi. Dans le bonheur, nous jouissons de notre force, nous avons une confiance tout irréfléchie, nous ne connaissons rien d’autre que notre présent. Dans la douleur, la faiblesse, l’impuissance, nous désespérons. Et quand ce désespoir est dépassé et que nous vivons encore, nous nous oublions à nouveau et nous nous laissons glisser dans l’hédonisme.
C’est par de telles expériences que l’homme s’est instruit ; sous la menace, il cherche la sécurité. Maîtrise de la nature, communauté organisée des hommes, voilà qui doit garantir la vie.
L’homme s’empare de la nature afin de la réduire à son service ; la connaissance et la technique doivent permettre de compter sur elle.
Pourtant, jusque dans la domination sur la nature, persiste l’imprévisibilité, et avec elle une menace constante, et finalement, l’échec sur toute la ligne. La dure loi du travail, la vieillesse, la maladie et la mort ne sauraient être supprimées. Lorsque la nature enfin maîtrisée nous offre quelque sécurité, ce n’est là qu’un fait isolé au sein d’une insécurité totale.
Et l’homme s’organise en communauté pour limiter le combat sans fin de tous contre tous et pour y mettre un terme ; il essaie de trouver sa sécurité dans l’entraide.
Mais ici encore une limite persiste. La justice et la liberté ne pourraient régner à l’intérieur des États que si chaque citoyen se comportait envers autrui conformément à l’exigence d’une solidarité absolue. C’est dans ce cas seulement que tous s’opposeraient comme un seul homme à l’injustice commise à l’égard d’un seul. Il n’en a jamais été ainsi. Cette solidarité qui groupe les hommes autour d’un de leurs semblables, dans les pires moments, fût-ce dans l’impuissance, n’a jamais existé que dans des cercles restreints ou chez quelques individus isolés. Aucun État, aucune Église, aucune société ne donne une protection absolue. Ou nourrissait cette belle illusion dans les époques paisibles où la limite restait voilée.
Ce monde décevant a cependant sa contrepartie : il s’y trouve aussi ce qui est digne de foi, ce qui attire la confiance, il y a le sol qui nous porte, patrie et paysage, parents et ancêtres, frères, sœurs, amis, il y a l’épouse. Il y a le fondement créé par la tradition, au fil de l’histoire : la langue maternelle, la foi, l’œuvre des penseurs, des poètes et des artistes. Mais l’ensemble de cette tradition ne nous fournit pas d’asile sûr, nous ne pouvons pas non plus compter absolument sur elle. Car telle qu’elle nous atteint, elle est tout entière œuvre humaine. Dieu n’est nulle part dans le monde. Toute tradition reste en même temps une interrogation. Les yeux fixés sur elle, il faut sans cesse que l’homme trouve à la source de lui-même la certitude, l’être, la force sur laquelle il peut compter. Un avertissement nous est donné, semble-t-il, d’un doigt autoritaire : on ne peut compter sur rien de ce qui est du monde ; il nous est interdit de nous en contenter. Cet index nous désigne autre chose.
Les situations-limites – mort, hasard, culpabilité, impossibilité de compter sur le monde – me révèlent mon échec. Que puis-je faire devant cet échec absolu dont je ne puis loyalement nier l’évidence ?
Le stoïcisme conseillait à l’homme de se retirer dans sa liberté propre qui est celle de la pensée indépendante. Cela ne nous suffit pas. Le stoïcisme se trompait, car il ne voyait pas l’impuissance de l’homme dans toute sa radicalité. Il n’a pas vu que la pensée même est dépendante, étant en soi vide et obligée de recourir à ce qui lui est donné ; et il n’a pas vu non plus que la folie reste possible. Il nous abandonne à la désolation d’une pensée qui n’est indépendante que faute de tout contenu. Il nous laisse sans espoir parce qu’il exclut toute tentative de victoires intérieures spontanément obtenues, toute plénitude par le don de soi à soi qu’accomplit l’amour, toute attente et tout espoir devant le possible.
Mais ce que veut le stoïcisme, c’est la philosophie dans toute son authenticité. L’homme qui a fait l’expérience originelle des situations-limites est poussé du fond de lui-même à chercher à travers l’échec le chemin de l’être. La façon dont il fait cette expérience de l’échec est pour lui décisive : l’échec peut lui demeurer caché et finir par l’écraser, en fait seulement ; l’homme peut au contraire le contempler en face et le garder présent à son esprit comme la limite constante de sa vie ; il peut recourir contre lui à des solutions et à des apaisements imaginaires, ou bien au contraire l’accepter loyalement en gardant le silence devant l’inexplicable. La manière dont l’homme fait l’expérience de l’échec détermine ce qu’il va devenir.
Dans les situations-limites, on rencontre le néant, ou bien on pressent, malgré la réalité évanescente du monde et au-dessus d’elle, ce qui est véritablement. Le désespoir lui-même, du fait qu’il peut se produire dans le monde, nous désigne ce qui se trouve au-delà.
Autrement dit : l’homme veut être sauvé. Le salut lui est offert par les grandes religions universelles qui ont pour signe distinctif d’offrir une garantie objective de la vérité et de la réalité du salut. Leur voie, c’est celle où s’accomplit l’acte individuel de la conversion. Cela, la philosophie ne peut pas le donner. Et pourtant, philosopher, c’est toujours vaincre le monde, c’est quelque chose d’analogue au salut...."
(EINFÜHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE - TRADUIT DE L’ALLEMAND PAR JEANNE HERSCH - PARIS LIBRAIRIE PLON)

"Karl Jaspers et la Philosophie de l'existence" (1947), Ricœur, Paul & Dufrenne, Mikel
( Éd. Seuil, Couleur des idées, 1947)
Ce livre n'est pas neutre, mais une interprétation puissante et engagée, un acte philosophique qui a contribué à imposer Jaspers en France et a offert une voie existentialiste différente, plus spiritualiste et communicationnelle. Pour Ricœur lui-même, ce travail a été fondateur. On y perçoit déjà les thèmes qui deviendront centraux dans son œuvre : l'attention au symbole et au "chiffre", une herméneutique de la foi, et une réflexion sur la faute et la culpabilité.
À une époque où "existentialisme" rimait souvent avec "athéisme", Ricœur et Dufrenne ont offert la lecture la plus claire et la plus convaincante de l'existentialisme religieux ou métaphysique de Jaspers. La critique la plus forte que l'on peut adresser à Jaspers (et que Ricœur souligne en filigrane) est celle de l'impuissance de sa métaphysique. Si la Transcendance ne se donne que dans l'échec et le silence, que peut-on vraiment en dire ? N'est-ce pas une philosophie qui, en voulant tout englober, risque de ne rien affirmer de concret ? Elle court le risque de devenir une incantation pieuse. Mais, bien que critique, l'ouvrage est globalement très favorable à Jaspers...
"Karl Jaspers devant sa propre situation historique
La situation historique dans laquelle la philosophie de Jaspers a conscience de se produire peut être caractérisée par deux traits, dont le premier désigne la crise de la métaphysique classique d’où elle essaie de déboucher à son tour, et le second le couple d’influences qui l’a aidé à se trouver elle-même.
La fin de l’idéalisme allemand
La philosophie occidentale, de Héraclite et Parménide à Hegel, est arrivée avec le plus grand système philosophique de l’idéalisme allemand à un point extrême à partir duquel elle ne peut plus que décliner. Cet effort gigantesque pour fertiliser par la raison les sables de l’irrationnel, en annexant à l’esprit l’historique, l’obscur, le vital, le minéral même, et en englobant toutes les contradictions dans l’harmonie du système, a fait de son triomphe même la suprême trahison : le sens de la réalité et son pouvoir de mordre et de combler tout à la fois, — le sentiment d’être soi-même un foyer unique de décision, — l’assurance enfin d’être en procès comme liberté avec un être que je ne suis pas et que je ne survole même pas, tout cela qui fait le piquant de la vie humaine fut englouti dans une construction splendide, dérisoire palais que l’on bâtit mais que l’on n’habite pas. Hegel est la fin de la philosophie occidentale conçue comme savoir universel, total, systématique.
Or, les générations qui nous séparent de Hegel ont été la proie de philosophes qui avaient perdu le sens hégélien de la grandeur et ne proposaient plus qu’une réflexion étriquée, axée sur la méthode des sciences, sur l’histoire et sur la sociologie. Ces philosophies, creuses et sans vie, rêvant pour elles-mêmes d’un progrès à l’image de celui des sciences, étaient en réalité le suicide de la philosophie. Pendant un temps, les étudiants, déçus par une philosophie dégénérée, ont cru trouver dans la science non seulement des connaissances, mais une leçon de vie et même une sorte de foi. Ce vœu déraisonnable ne pouvait conduire qu’à une crise, non point certes de la science, mais de la conscience en face de la science : ou bien on embrassait un culte superstitieux de la science, où s’abîmait plus sûrement que dans l’idéalisme le triple sens de la réalité, de l’individu libre et de l’être absolu, ou bien on dénonçait la science comme ruineuse pour la vie et pour toute foi, et on lui opposait les besoins du sentiment, par une exaltation aveugle de l’irrationnel. Cette double corruption, — cette superstition et ce recours à l’effusion, — appelaient le retour à une grande philosophie, mais qui fût en même temps une vraie critique des sciences, c’est-à-dire qui tout à la fois comprît les limites des sciences et aperçût dans la science sa propre condamnation comme savoir pseudo-scientifique ; car si la science est la mesure du savoir universel, c’est elle aussi qui doit donner le contraste fondamental du savoir et du non-savoir et condamner désormais toute confusion de la science et de la philosophie : nous avons perdu la naïveté.
Par le détour de cette crise de la conscience en face de la science, nous sommes ramenés à notre point de départ : l’impossibilité du système après Hegel. La victoire à la Pyrrhus de l’idéalisme, la victoire à la Pyrrhus de l’esprit scientifique nous mettent au cœur une grande espérance et une grande déception ; nous avons la nostalgie d’une philosophie à la mesure des ambitions hégéliennes, qui se proposerait de retrouver une forte idée de la réalité, une forte idée de l’individu et une forte idée de l’être absolu, mais qui commencerait par enregistrer la fin de l’ère des systèmes.
Le choc de l’exception : Kierkegaard et Nietzsche
Or, à l’époque même où triomphait l’hégélianisme et où la critique des sciences développait tous ses prestiges et toutes ses déceptions, deux voix inquiétantes se faisaient entendre qui ébranlaient les fondements de l’édifice hégélien et, par-delà Hegel lui-même, remettaient en question le principe même de la philosophie, sa confiance dans la raison. Ces deux penseurs, Kierkegaard et Nietzsche, qui ne se sont pas connus, doivent être compris l’un par l’autre5, en dépit de la différence fondamentale de leur intuition centrale, l’un embrassant avec crainte et tremblement le paradoxe absurde du Dieu-Homme, de l’éternité temporelle, de l’absolu contingent, l’autre revendiquant le courage de survivre solitaire à la « mort de Dieu ». Mais, pris ensemble et éclairés l’un par l’autre, ils se frayent mutuellement la voie, cumulent leur effet, et en même temps, par leur insoutenable contradiction, nous renvoient à nous-mêmes (car tout à l’heure il faudra les laisser à leur solitude). Quel est donc leur message commun ? On peut dire d’un mot qu’ils sont en marge de toute philosophie qui ne serait que rationnelle, les témoins de l’existence au sens fort que Jaspers donne à ce mot (lequel n’appartient pas à la langue de Nietzsche, mais de Kierkegaard). L’existence, — le maître-mot de la philosophie de Jaspers avec la transcendance, — l’existence c’est l’individu au sens le plus élevé du mot : non pas l’individu biologique défini par le souci vital, mais l’individu libre défini par le souci de l’être ; non pas l’homme pensant universellement et défini par un faisceau de règles intellectuelles, intemporelles et incorruptibles, — car « la forme est éternellement sauve », elle ne peut même pas être menacée6 — mais l’homme qui joue son destin dans le temps, devant la mort, dans l’Etat et avec ses amis, l’homme qui, par sa décision, peut se perdre ou se gagner, ou, comme dit Jaspers, « venir à soi » ou « se manquer ». Ce pouvoir d’être ou de ne pas être, lié à une décision que nul ne peut prendre pour lui, ne peut qu’ébranler profondément l’individu qui soudain le découvre, par-delà l’habitude de vivre, par-delà toutes les garanties sociales et même ecclésiastiques ; ce frémissement de la liberté la plus personnelle, Kierkegaard l’avait appelé « l’angoisse » et Nietzsche « danger ». Or, cette découverte fondamentale, qui désormais donne son nom à la philosophie de l’existence7 et en détermine l’axe et le pivot, suscite en même temps un en deçà et un au-delà ; car cette découverte chez Kierkegaard et chez Nietzsche dépasse quelque chose, et tend à se dépasser soi-même ou à être dépassée par autre chose. L’en deçà, c’est la pensée universelle elle-même, qui doit retrouver le principe de sa critique dans le destin même de la liberté ; la leçon de Kierkegaard et de Nietzsche, c’est que découvrir l’existence de l’individu c’est critiquer le savoir, mais non point renoncer à penser jusqu’à l’extrême, car ni l’un ni l’autre n’ont recouru à l’effusion ; c’est plutôt de l’excès et de l’échec du savoir, du malaise de la réflexion infinie qu’ils ont tenté de faire jaillir la certitude de la liberté. C’est seulement quand il est un moyen d’éluder la rencontre décisive avec soi-même, un masque, un prétexte pour « l’inauthenticité » et la « déloyauté » que le savoir trahit l’existence ; l’existence est à l’extrême du savoir.
D’autre part, en même temps qu’ils naissaient à l’existence, en liaison et en opposition tout à la fois avec le savoir, Kierkegaard et Nietzsche savaient que le dernier mot de la méditation sur l’existence n’est ni dans le rapport de la conscience d’être libre avec la connaissance objective, ni même dans le rapport de l’existence avec elle-même ; le cœur du drame est dans le rapport de l’existence avec quelque transcendance qu’elle n’est pas elle-même et qui est pourtant sa raison et son ultime paix. Mais c’est ici que Kierkegaard et Nietzsche en annonçant un au-delà de l’individu se séparent l’un de l’autre et peut-être de quiconque. Car Kierkegaard d’un côté voit la mesure de l’individu dans la rencontre bouleversante du Crucifié ; mais la Croix c’est « l’Absurde », et l’Absurde s’élève sur les ruines de toute apologétique, de toute théologie, de tout catéchisme ; il dénonce la faillite du christianisme moderne, tant protestant que catholique ; il invoque un impossible christianisme radicalement contemporain des premiers disciples dans la « décision négative » du martyre : telle est la Transcendance par-delà toute justification, toute communauté, toute continuité, toute autorité. Face à Kierkegaard, Nietzsche ; pour lui Dieu est mort. Mais à la lumière de Kierkegaard, Nietzsche est à sa façon un témoin d’une certaine transcendance, aussi absurde en un sens que celle de Kierkegaard : son athéisme même, aussi éloigné qu’il est possible de l’athéisme plat et du matérialisme vulgaire, est le manteau protecteur de sa transcendance ; la mort de Dieu est en lui une plaie béante, et devant lui comme une espèce de vaste trou au fond duquel résonne la voix de Zarathoustra, l’appel au Surhomme, et par-delà même de Surhomme l’annonce du retour éternel ; ici Nietzsche est très loin et très près de Kierkegaard. Mais avant de se séparer l’un de l’autre et de nous, et de s’abîmer dans leur inaccessible solitude, ils nous proposent comme suprême méditation le sacrifice ou le dépassement de l’existence. L’existence, réalité suprême de l’homme, est quelque chose qui doit être surmonté. Ainsi, la philosophie de Jaspers a trouvé dans Kierkegaard et dans Nietzsche son choc initial ..."
Le livre est structuré en deux grandes parties, précédées d'une introduction majeure de Ricœur, "Problématique de la Philosophie de l'Existence" : c'est la pièce maîtresse de l'ouvrage, où Ricœur situe Jaspers dans le paysage philosophique.
Définition de la "philosophie de l'existence" : Ricœur la distingue de l'"existentialisme" sartrien. Pour lui, c'est une philosophie qui part de la situation concrète de l'homme fini, aux prises avec les "situations-limites" (la mort, la souffrance, la faute). Elle ne construit pas un système, mais cherche à éveiller l'individu à sa propre liberté et à sa possibilité de transcender sa condition simplement empirique.
- Le rôle de la Transcendance : La clé de voûte de la pensée de Jaspers, selon Ricœur, est la relation de l'existence avec la Transcendance (qu'il appelle aussi l'Umgriffend, l'Enveloppant). La philosophie n'aboutit pas au néant (comme chez Sartre) mais à un au-delà du monde qui se manifeste dans l'échec, le questionnement et l'acte libre.
- Jaspers vs Heidegger : Ricœur établit un contraste fondamental : Heidegger est le philosophe de l'être-dans-le-monde et de la finitude radicale ; Jaspers est le philosophe de la sortie du monde vers la Transcendance. L'un est ontologue, l'autre est métaphysicien.
Partie I : "Les Filiations de la Philosophie de l'Existence" (par Mikel Dufrenne)
Dufrenne retrace les sources de la pensée de Jaspers pour en comprendre la genèse.
- La source psychopathologique : L'expérience de la folie et des limites de la raison scientifique est fondatrice. Elle a appris à Jaspers la fragilité de la conscience et l'existence d'un "autre" de la raison.
- La source historique : Jaspers puise dans l'histoire de la philosophie (Plotin, Spinoza, Kant, Hegel) non pour l'étudier objectivement, mais pour y trouver des alliés existentiels, des manières de penser qui font signe vers la Transcendance.
- Les maîtres spirituels : Kierkegaard et Nietzsche sont présentés comme les deux pôles incontournables. Kierkegaard pour la relation passionnée à Dieu, Nietzsche pour l'affirmation tragique de la vie sans Dieu. Jaspers tente une synthèse en les dépassant : il cherche une foi qui assume le défi nietzschéen.
Partie II : "Les Thèmes de la Philosophie de l'Existence" (par Paul Ricœur)
C'est le cœur de l'ouvrage, une analyse systématique des concepts clés de Jaspers.
- Les Situations-Limites (Grenzsituationen) : Ricœur montre comment la mort, la souffrance, la lutte et la faute ne sont pas des accidents, mais des structures de notre être-au-monde. Elles sont les "chiens de garde" de l'existence, qui la réveillent à sa vérité en brisant l'illusion du confort quotidien.
- La Communication : C'est le concept central. Pour Ricœur, la communication chez Jaspers n'est pas un échange d'informations, mais une lutte amoureuse (liebender Kampf) où les existences se provoquent et se révèlent mutuellement. C'est le contraire de la solitude de l'existentialisme sartrien. C'est aussi le critère de vérité d'une existence : une pensée qui ne peut se communiquer est une fausse pensée.
- La Liberté et la Transcendance : Ricœur explique la liberté jaspersienne non comme un pur choix arbitraire, mais comme un acte de fidélité à soi-même dans la relation à la Transcendance. Je ne me choisis moi-même qu'en me recevant d'un ailleurs qui me fonde. La Transcendance n'est pas un objet de savoir, mais se "manifeste" dans le "chiffre" du monde (les symboles, l'art, l'échec).
- La Foi Philosophique : Distincte de la foi religieuse révélée, c'est une attitude de confiance dans la raison et dans le sens du monde, malgré son obscurité. C'est la réponse de Jaspers au nihilisme.
