- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) - José Ortega y Gasset (1883-1955), "El espectator" (1916-1934), "La rebelión de las masas"
(1937) - Juan Ramón Jiménez (1881-1958), "Platero y yo" (1914-1917) - Eugenio d'Ors (1882-1954), "La Ben Plantada" (1912) - Joaquin Belda (1883-1935) - ....
Last update : 01/12/2017
"La rebelión de las masas" (1937) - Ayant montré dans "L 'Espagne ínvertébrée" ( España invertebrada, 1921) que la maladie politique de son pays tenait à la carence d`une grande aristocratie consciente de sa mission historique, Ortega applique ici ces vues à la crise de l'Europe contemporaine. Dans les sociétés les plus policées du monde, qui semblaient définitivement acquises aux vertus de libéralisme et de tolérance, notre temps a vu l'apparition d'un type d'homme tout nouveau "l`homme-masse" (hombre-masa). Jouissant de la sécurité trompeuse de l'héritier, exploitant les avantages d'une culture qu'il ne crée pas et ne comprend pas, ne se connaissant que des droits et point d'obligations, l'homme-masse ignore que la préservation des commodités et des beautés de l'existence exige un continuel effort. Il se laisse vivre. Cet homme-masse, dans l'esprit d'Ortega y Gasset, ne s'identifie d'ailleurs nullement à une classe sociale particulière. Toute société est définie par l'action réciproque d`une masse et d'une minorité sortie de la masse. jamais séparée d'elle, et constituant en quelque sorte son noyau animateur et directeur. Toute société exige le sacrifice envers une mission collective que l'élite, précisément, a pour fonction d'imposer à la masse. Mais les diverses patries européennes, prises en particulier, sont-elles encore capables dïnventer quelque grande entreprise qui tirerait l`homme-masse de sa béate torpeur? Ortega y Gasset ne le croit pas ...

1923-1930 - Dictature (dictadura) du général Primo de Rivera - Le règne d'Alphonse XIII, qui a débuté en 1902, a accéléré considérablement la dégradation politique et sociale de l'Espagne, engageant le pays, avec la France, dans une politique interventionniste, impopulaire, au Maroc et qui ne sera pas sans conséquences puisque cette guerre donna aux généraux une importance durable dans la vie publique. La Semana Trágica (Barcelona, 1909), les mouvements d'autonomie régionale (Catalogne, Galicie, Pays Basque) qui s'expriment dès 1916, l'instabilité politique et la corruption généralisée incitent le général Primo de Rivera à prendre le pouvoir : sa dictature, alliage de conservatisme et de corporatisme, va durer un peu plus six années et prendre la forme d’un Directoire militaire puis civil. S'il s’opposa tant au régionalisme catalan qu' à l’émergence du Parti communiste, s'il dut faire face à plusieurs tentatives de soulèvement, sa vie particulièrement dissolue et ses velléités journalistiques alimenteront caricaturistes, presse, théâtre et littérature, tel Valle Inclán (La hija del capitán; 1927; Tirano Banderas, 1926). Ces années voient naître quelques vagues d'émigrations mais qui concernent principalement l'élite intellectuelle, politique ou sociale : des écrivains comme Miguel de Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, des politiques comme Santiago Alba, ministre libéral d’Alphonse XIII, José Sánchez Guerra, José Manteca, des journalistes comme Eduardo Ortega y Gasset, Carlos Esplá...
1930, c'est l'année où le général Primo de Rivera quitte le pouvoir et où paraît "La rebelion de las masas" d'Ortega y Gasset...

Entre la Génération de 98 et celle de 27, entre le début du siècle et la guerre civile, la "Generación de 1914" (ou noucentisme), des écrivains nés vers 1880 qui ont atteint leur maturité dans les années environnant 1914, tels que José Ortega y Gasset (1883-1955), Eugenio d'Ors (1881-1954), Gabriel Miró (1879-1930), Pérez de Ayala (1880-1962), Eduardo Marquina (1879-1946), Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Gregorio Marañón (1887-1960),...
L'Espagne connaît un foisonnement d'idées, un nouvel essor des mouvements ouvriers, anarchistes et socialistes après la répression de la semaine tragique de Barcelone en 1909 et le développement concomitant du régionalisme catalan, nombre de personnalités émergeante telles que Gabriel Miró, Pérez de Ayala, Eduardo Marquina, Juan Ramón Jiménez, Eugenio d'Ors, Ramón Gómez de La Serna, et Ortega y Gasset...., toutes partagées entre des tendances contradictoires, désir de s'identifier à la culture européenne, sans renoncer pour autant à la tradition castillane ou méditerranéenne, toutes marquées par la résurgence interrogations relatives à l'âme nationale et à son destin, à cette lancinante problématique d'une supposée décadence espagnole qui ne cesse d'agiter les esprits depuis la fin du XIXe siècle ..

José Ortega y Gasset (1883-1955)
Né à Madrid, José Ortega y Gasset domine la vie intellectuelle de l'Espagne pendant plus d'un quart de siècle,
Après des études au collège des Jésuites de San Estanislao de Miraflores del Palo (Malaga), au cours desquelles il apprend le grec et perd la foi, entre à la
faculté de Philosophie de l’Université de Madrid (1899), complète sa formation philosophique en Allemagne (1905-1907), - "pendant dix ans, écrira-t-il, j'ai vécu dans la pensée kantienne ; je
l'ai respirée comme une atmosphère, et elle a été à la fois ma demeure et ma prison" -, et occupe en 1912 la chaire de Métaphysique de l’Université de Madrid. Il débute la publication de "El
Espectador" (8 volumes jusqu’en 1934), dans lequel il fixe ses impressions d’esthète avec ses commentaires sur Greco, Titien, Poussin, Vélasquez, Goya, Zuloaga, Cézanne, mais aussi prétend tout
voir, tout savoir, tout prévoir. A qui lui reproche son éclectisme, il répond actualité et modernité, et c'est bien en effet la réalité, toute la réalité qu'il entend embrasser. Son
autorité intellectuelle ne cesse de croître, il lance le journal El Sol (1917), fonde la célèbre Revista de Occidente (1923) - pour ouvrir l'Espagne de son temps à tous les courants d'idées
qui, dans tous les domaines, traversent alors l'Europe -, ainsi que la Biblioteca de Ias Ideas del siglo XX, où paraitront, traduits en espagnol, des textes de Spengler, Max Scheler, Husserl,
Brentano, Rudolf Otto, Bertrand Russell..
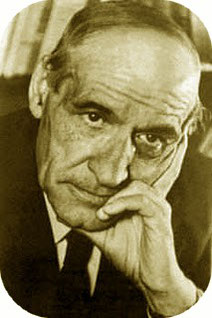
Ortega reprend la réflexion critique sur le devenir historique de l'Espagne, à laquelle s'étaient livrés Angel Ganivet et les écrivains de la « génération
de 98 » (Unamuno, A. Machado, Pío Baroja, Azorín, R. de Maeztu...), au travers de "Meditaciones del Quijote" (1914) puis d' "España invertebrada" (1921), "El Tema de nuestro
tiempo" (1923), et enfin "La deshumanización del arte" (1925). Il répond au grand problème supposé de la décadence espagnole en affirmant que l'histoire de cette nation est
entièrement hantée par l'absence de minorités choisies capables d'assurer son unité : "Le grand malheur de l'histoire espagnole a été le manque de minorités insignes et l'empire
imperturbable des masses". Le mal de l’homme moderne n’est pas la corruption mais bien la répugnance des masses à se soumettre a la direction d’une élite éclairée. Avec "La Révolte des
masses" (La Rebelión de las masas, 1930), il interprète les crises qui secouent l'Europe de son temps pour aboutir à l'idée centrale d'une confrontation entre l'homme-masse (hombre-masa)
et l'homme d' élite qui aboutit à cette "irruption verticale des Barbares" qu'il condamne. Il résout donc à sa façon "l'éternel dilemme entre la révolution et l'évolution", entre le principe
démocratique d'égalité et les principes de hiérarchie et d'autorité naturelle des élites en soutenant que: "J'ai dit, et je le crois toujours, chaque jour avec une conviction plus énergique, que
la société humaine est toujours aristocratique, bon gré, mal gré, par sa propre nature." Thèse controversée mais qui influencera toute une génération de philosophes, dans et hors d'Espagne. Et
plus encore, pour Ortega, l'existence, la réflexion, la culture, l'art et l'éthique ne doivent pas tant s'abandonner à quelque raison pure, mais à cette "raison vitale", expression de la vie qui
est par définition passagère, concrète, unique, incomparable: "Porque eso, ser imprevisble, ser un horizonte abierto a toda posibilidad, es la vida auténtica, la verdadera plenitud de la vida".
D'où le célèbre aphorisme: "Je suis moi et ma circonstance, et si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même".
Mais la "réalité" ne répond pas à ses attentes. Le coup d’État du général Primo de Rivera en 1923 est sans doute un premier tournant dans son appréhension
du monde et si, de 1931 à 1933, il est député aux Cortes constituantes, il finit par se retirer rapidement de toute vie publique, se retirant dans un certain conservatisme, sans doute mal à
l'aise face aux menaces de révolutions, aux incertitudes politiques, au communisme, à tout ce qui pourrait s'apparenter à du "rationalisme effectif" : il en vient à choisir l'exil après le
soulèvement de Franco en 1936. Il ne reviendra en Espagne qu'en 1945, pour rester à l'écart du régime franquiste.
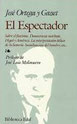
El espectador (fragmento)
" La verdad, lo real, el universo, la vida - como queráis llamarlo - se quiebra en facetas innumerables, en vertientes
sin cuento, cada una de las cuales da hacia un individuo. Si éste ha sabido ser fiel a su punto de vista, si ha resistido a la eterna seducción de cambiar su retina por otra imaginaria, lo que ve
será un aspecto real del mundo. Y viceversa: cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve otra. Somos insustituibles,
somos necesarios. Dentro de la humanidad cada raza, dentro de cada raza cada individuo es un órgano de percepción distinto de todos los demás y como un tentáculo que llega a trozos de universo
para los otros inasequibles. La realidad, pues, se ofrece en perspectivas individuales. Lo que para uno está en último plano, se halla para otro en primer término. El paisaje ordena sus tamaños y
sus distancias de acuerdo con nuestra retina, y nuestro corazón reparte los acentos. La perspectiva visual y la intelectual se complican con la perspectiva de la valoración.
"
« La vérité, le réel, l'univers, la vie — comme vous voulez l'appeler — se brise (Se quiebra)en d'innombrables facettes, en d'innombrables versants (Vertientes sin cuento), dont chacun donne sur un individu (Da hacia un individuo).
Si cet individu a su être fidèle à son point de vue, s'il a résisté à l'éternelle séduction de changer sa rétine contre une autre imaginaire, ce qu'il voit sera un aspect réel du monde. Et vice versa : chaque homme a une mission de vérité (Misión de verdad).
Là où se trouve ma pupille, il n'y en a pas une autre ; ce que ma pupille voit de la réalité, une autre ne le voit pas. Nous sommes irremplaçables, nous sommes nécessaires.
Au sein de l'humanité, chaque race, et au sein de chaque race, chaque individu, est un organe de perception distinct de tous les autres, tel un tentacule qui atteint des fragments d'univers inaccessibles aux autres.
La réalité, donc, s'offre en perspectives individuelles. Ce qui pour l'un est à l'arrière-plan se trouve pour un autre au premier plan. Le paysage ordonne ses dimensions et ses distances selon notre rétine, et notre cœur répartit les accents (Nuestro corazón reparte los acentos). La perspective visuelle et la perspective intellectuelle s'entremêlent (Se complican con) à la perspective de la valorisation. »

Meditaciones del Quijote (1914)
Première oeuvre d'Ortega y Gasset, "Méditations de Don Quichotte" contient déjà en germe les principales idées qui formèrent sa philosophie, notamment le principe, Je suis moi et l'expression de mon milieu, l'idée de la vérité en tant que découverte, une théorie du concept, le postulat de la raison vitale, le "prospectivisme", aunatnt de thèmes qui seront par suite développés dans les huit volumes de son "El espectator", 1916-1934...
"... Cuando hemos llegado hasta los barrios bajos del pesimismo y no hallamos nada en el universo que nos parezca una afirmación capaz de salvarnos, se
vuelven los ojos hacia las menudas cosas del vivir cotidiano - como los moribundos recuerdan al punto de la muerte toda suerte de nimiedades que les acaecieron -.
Vemos, entonces que no son las grandes cosas, los grandes placeres ni las grandes ambiciones que nos retienen sobre el haz de la vida, sino este minuto
de bienestar junto a un hogar en invierno, esta grata sensación de una copa de licor que bebemos, aquella manera de pisar el suelo, cuando camina, de una moza gentil, que no amamos ni conocemos,
tal ingeniosidad que el amigo ingenioso nos dice con su buena voz de costumbre..."

La rebelión de las masas (1930)
"El hombre-masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes.."
"Ce livre, – à supposer que ce soit un livre – date… Il commença à paraître en 1926 dans un quotidien madrilène et le sujet qu’il traite est trop humain pour n’être pas trop affecté par le temps. Il y a des époques surtout où la réalité humaine, toujours mobile, précipite sa marche, s’emballe à des vitesses vertigineuses. Notre époque est de celles-là. C’est une époque de descentes et de chutes. Voilà pourquoi les faits ont pris de l’avance sur le livre. Bien des choses y sont annoncées qui furent très vite un présent et sont déjà un passé..."
Publié à l'origine sous forme d'articles en 1929, puis en livre en 1930, "La Rebelión de las Masas" est une réflexion profonde sur la crise de la civilisation occidentale à l'aube des totalitarismes. Ortega y Gasset, philosophe espagnol, y diagnostique un phénomène nouveau et périlleux : la prise de pouvoir social et culturel par "l'homme-masse", un " enfant gâté " conformiste et égalitariste qui rejette le passé, la raison et l'exigence morale, corrélée à une inquiétante " étatisation de la vie " et à l'" idolâtrie du social ". Il y esquisse aussi ce qui peut l'en guérir , l'avènement d'" un libéralisme de style radicalement nouveau, moins naïf et de plus adroite belligérance ", et l'édification culturelle d'une Europe réellement unie. (Paru en 1937 dans sa traduction française, soit sept ans après sa publication en Espagne (1930), traduction Librairie Stock)
"L’avènement des masses au plein pouvoir social — qu’on y voit un bien ou un mal – est le plus important des faits qui soient survenus dans la vie publique de l’Europe actuelle. Mais comme par définition, les masses ne doivent ni ne peuvent se gouverner elles-mêmes, et encore moins régenter la société, ce fait implique que l’Europe traverse actuellement la crise la plus grave dont puissent souffrir peuples, nations et cultures. Cette sorte de crise est survenue plus d’une fois dans l’Histoire. On en connaît la physionomie et les conséquences, on en connaît aussi le nom ; c’est la Révolte des Masses.
Pour la meilleure intelligence de ce phénomène, on évitera, tout d’abord, de donner aux mots « révolte », « masses », « pouvoir social », un sens exclusivement politique, ou tirant de la politique son origine. La vie publique n’est pas seulement politique, mais à la fois, et même avant tout, intellectuelle, morale, économique et religieuse ; elle embrasse toutes les coutumes collectives, et comprend jusqu’à la façon de se vêtir, jusqu’à celle de jouir de la vie.
Le meilleur moyen de prendre contact avec ce phénomène historique serait peut-être de nous reporter à une expérience visuelle de notre époque ; soulignons un de ses traits les plus caractéristiques, les plus frappants.
Ce trait d’une analyse complexe, est bien facile à énoncer. Je le nommerai le phénomène de l’agglomération, du « plein ». Les villes sont pleines de population ; les maisons, de locataires. Les hôtels sont remplis de pensionnaires ; les trains, de voyageurs ; les cafés, de consommateurs ; les promenades, de passants. Les salles d’attente des médecins célèbres sont envahies de malades, et les spectacles – à moins qu’ils ne soient trop déconcertants, trop intempestifs – regorgent de spectateurs. Les plages fourmillent de baigneurs. Ce qui, autrefois, n’était jamais un problème, en devient un presque continuel aujourd’hui : trouver de la place.
Restons-en là. Existe-t-il dans la vie actuelle un fait plus simple, plus notoire et plus constant ? Creusons un peu cette observation, banale en apparence ; nous serons surpris d’en voir jaillir une source inattendue, où la lumière blanche du jour, de ce jour, du temps présent, se décompose en tout son riche chromatisme intérieur.
Que voyons-nous donc ? Pourquoi ce spectacle nous surprend-il ainsi ? La foule, en tant que foule, s’est tout naturellement appropriée des locaux et des machines créées par la civilisation. Mais à peine y réfléchissons-nous un instant, que nous nous surprenons de notre propre surprise. Eh bien ! quoi ! N’est-ce pas là l’idéal ? Le théâtre a des places pour qu’on les occupe, c’est-à-dire pour que la salle soit pleine ; pour la même raison, les wagons du chemin de fer ont leurs banquettes, et les hôtels leurs chambres. Sans doute, mais il est bien certain qu’autrefois, aucun de ces établissements et de ces véhicules n’était habituellement plein. Aujourd’hui, ils regorgent de monde, et, au dehors, grossit une foule impatiente d’en profiter à son tour. Bien que ce fait soit logique, naturel, il est hors de doute qu’il ne se produisait pas auparavant, et qu’il se produit aujourd’hui. Ainsi un changement est survenu, une innovation qui, tout au moins de prime abord, justifie notre surprise.
Être surpris, s’étonner, c’est déjà commencer à comprendre. L’étonnement est le sport, le luxe propre à l’intellectuel, dont l’attitude familière, la « déformation professionnelle », consiste à regarder le monde les yeux agrandis par la surprise. Tout ce qui existe au monde est étrange et merveilleux pour des pupilles bien ouvertes. Cet étonnement, jouissance interdite au footballeur, emporte l’intellectuel à travers le monde, dans une perpétuelle ivresse de visionnaire. L’étonnement est un de ses attributs. Et c’est pourquoi les anciens représentaient Minerve avec la chouette, l’oiseau dont les yeux sont toujours éblouis.
L’agglomération, le plein, ce phénomène n’était pas fréquent autrefois. Pourquoi l’est-il aujourd’hui ?
Les individus qui composent ces foules ne sont pourtant pas surgis du néant. Il y a quinze ans, il existait à peu près le même nombre d’êtres qu’aujourd’hui. Il semblerait naturel qu’après la guerre ce nombre eût diminué. Or, nous nous heurtons ici à une première remarque importante. Les individus qui composent ces foules existaient avant, mais non en tant que foule. Disséminés dans le monde, en petits groupes, ou isolés, ils menaient apparemment une vie divergente, dissociée, distante. Chacun d’eux – individu ou petits groupes – occupait une place, sa place légitime peut-être, à la compagne, au village, à la ville, dans le faubourg d’une grande cité.
Aujourd’hui, sans transition, ils apparaissent sous l’aspect de groupements et nous voyons des foules de tous côtés. De tous côtés ? Non pas. Mais précisément aux meilleures places, créations relativement raffinées de la culture humaine, aux places réservées auparavant à des groupes plus restreints, en somme à des minorités.
Brusquement, la foule est devenue visible, s’est installée aux places de choix de la société. Autrefois, si elle existait, elle passait inaperçue au fond de la scène sociale. Aujourd’hui, elle s’est avancée vers la rampe ; elle est devenue le personnage principal. Les protagonistes ont disparu ; il n’y a plus maintenant que le chœur.
La notion de foule est quantitative et visuelle. En la traduisant, sans l’altérer, dans une terminologie sociologique, nous y découvrons l’idée de masse sociale. La société est toujours l’unité dynamique de deux facteurs, les minorités et les masses. Les minorités sont des individualités ou des groupes d’individus spécialement qualifiés. La masse est l’ensemble de personnes non spécialement qualifiées.
Il faut donc se garder d’entendre simplement par masses les seules « masses ouvrières » ; la masse, c’est l’homme moyen. C’est ainsi que ce qui était une simple quantité – la foule – prend une valeur qualitative : c’est la qualité commune, ce qui est à tous et à personne, c’est l’homme en tant qu’il ne se différencie pas des autres hommes et n’est qu’une répétition du type générique. Mais qu’avons-nous gagné à cette conversion de la quantité en qualité ? C’est bien simple. La qualité nous a fait comprendre la genèse de la quantité. Il est évident, et même enfantin, que la formation normale d’une foule implique une coïncidence de désirs, d’idées, de manières d’être, chez les individus qui la composent. On objectera que ceci se produit pour tous les groupes sociaux, aussi sélectionnés qu’ils se prétendent l’être. En effet, mais il y a ici une différence essentielle.
Dans les groupes dont le caractère est justement de n’être pas des foules, ni des masses, les coïncidences affectives de leurs membres consistent en quelque désir, en quelque idée ou idéal qui, de lui-même, exclut le grand nombre. Pour former une minorité, quelle qu’elle soit, il faut que tout d’abord chaque membre se soit séparé de la foule pour des raisons spéciales, plus ou moins individuelles. La coïncidence qui l’unit aux autres membres formant la minorité est donc secondaire, postérieure au moment où chacun d’eux s’est différencié de la masse ; elle est en grande partie, par conséquent, une coïncidence « à ne pas coïncider ». Il y a des cas où ce caractère de différenciation du groupe apparaît au grand jour : les groupes anglais qui se dénomment eux-mêmes « non-conformistes » sont composés d’individus qui ne s’accordent que dans leur « non-conformité », vis-à-vis de la foule illimitée. Cet élément qui produit l’union du petit nombre, pour mieux le séparer du grand nombre, est toujours implicite dans la formation de toute minorité. Parlant du public très restreint qui écoutait un musicien raffiné, Mallarmé notait avec esprit que ce public soulignait par sa rare présence l’absence multitudinaire de la foule.
La masse peut donc, à la rigueur, se définir en tant que fait psychologique, sans même attendre que les individus apparaissent sous forme de groupements. En voyant un individu, nous pouvons affirmer s’il appartient ou non à la masse, s’il est masse ou non. Un individu fait partie de la masse, lorsque non seulement la valeur qu’il s’attribue – bonne ou mauvaise – ne repose pas sur une estimation justifiée de qualités spéciales, mais lorsque, se sentant comme tout le monde, il n’en éprouve cependant aucune angoisse, et se sent à l’aise, au contraire, de se trouver identique aux autres. Imaginez un homme modeste qui, essayant d’estimer sa propre valeur, se demande s’il ne possède pas quelque talent, dans tel ou tel domaine et constate, en fin de compte, qu’il ne possède aucune qualité saillante. Cet homme se sentira médiocre, vulgaire, peu doué, mais il ne se sentira pas « masse ».
Quand on parle de « minorités d’élite », il est courant que les gens de mauvaise foi dénaturent le sens de cette expression et feignent d’ignorer que l’homme d’élite n’est pas le prétentieux qui se croit supérieur aux autres, mais bien celui qui est plus exigeant pour lui que pour les autres, même lorsqu’il ne parvient pas à réaliser en lui ses aspirations supérieures. Il est indéniable que la division la plus radicale qui se puisse faire dans l’humanité est cette scission en deux classes d’individus : ceux qui exigent beaucoup d’eux-mêmes, et accumulent volontairement devoirs sur difficultés, et ceux qui, non seulement n’exigent rien de spécial d’eux-mêmes, mais pour lesquels la vie n’étant à chaque instant que ce qu’elle est déjà, ne s’efforcent à aucune perfection et se laissent entraîner comme des bouées à la dérive.
Ceci me rappelle que le bouddhisme orthodoxe se compose de deux religions distinctes : l’une, rigoureuse et ardue ; l’autre, plus accessible et grossière : le Mahayana, « grand véhicule » ou « grand chemin » – et l’Hinayana, « petit véhicule » ou « petit chemin ». Ce qui est décisif c’est le choix que fait l’individu de l’un ou l’autre de ces véhicules, d’un maximum ou d’un minimum d’exigences.
La division de la société en masses et en minorités d’élites, n’est donc pas une division en classes sociales, mais plutôt en classes d’hommes, et cette division ne peut coïncider avec un tableau hiérarchique en classes supérieures et inférieures. Il est évident que l’on trouvera dans les classes supérieures, lorsqu’elles sont devenues vraiment supérieures, une plus grande quantité d’hommes qui adopteront le « grand véhicule », que dans les classes inférieures, normalement constituées par des individus neutres, sans qualité. Mais on pourrait trouver à la rigueur une masse et une minorité authentiques dans chaque classe sociale. Comme nous le verrons, une des caractéristiques de notre temps est la prédominance de la masse et du médiocre, jusque dans les groupes où la sélection était traditionnelle. Dans la vie intellectuelle qui requiert et suppose, par son essence, le discernement de la qualité, on remarque le triomphe progressif des pseudo-intellectuels non qualifiés, non qualifiables, et que la contexture même de leur esprit, disqualifie. Le même phénomène se produit dans les groupes survivants de la « noblesse » masculine et féminine. En revanche, il n’est pas rare de rencontrer aujourd’hui parmi les ouvriers, qui pouvaient autrefois être pris comme l’exemple le plus précis de ce que nous appelons « masse », des esprits au plus haut point disciplinés.
Or, il existe dans la société des opérations, des activités, des fonctions d’ordres les plus divers, qui, par leur nature même sont spéciales, et par conséquent ne peuvent être bien exécutées sans dons, eux aussi spéciaux. Par exemple, certains plaisirs de caractère artistique et luxueux, certaines fonctions de gouvernement et de jugement politique dans les affaires publiques. Ces activités spéciales incombaient autrefois à des minorités qualifiées – ou qui tout au moins avaient la prétention de l’être. La masse ne prétendait pas intervenir : elle se rendait compte que si elle voulait intervenir, il lui fallait nécessairement acquérir ces dons spéciaux et cesser d’être masse. Elle connaissait parfaitement son rôle dans une salutaire dynamique sociale.
Si nous revenons maintenant aux faits que nous avons énoncés au début, ils nous apparaîtront clairement comme les signes avant-coureurs d’un changement d’attitude dans la masse. Ces symptômes paraissent tous indiquer que la masse a résolu de s’avancer au premier plan social, d’en occuper les places, d’en utiliser les instruments et de jouir des plaisirs réservés autrefois au petit nombre. Il est évident par exemple que les édifices, étant donné leurs dimensions réduites, n’étaient pas prévus pour les foules ; et pourtant la foule en déborde constamment ; nous avons là une preuve visible de ce fait nouveau : la masse, sans cesser d’être masse, supplante les minorités...."

Mais quand Ortega parle de « masse » et de « minorité » (ou élite), il ne parle pas de classes sociales au sens économique — ce ne sont pas les riches contre les pauvres, ni les ouvriers contre les bourgeois. Ce sont plutôt des types humains, c’est-à-dire des façons d’être, des attitudes face à la vie et à soi-même.
- L'homme masse
“El hombre-masa es el que se siente ‘como todo el mundo’, y sin embargo no se angustia, se siente a gusto al sentirse idéntico a los demás.” - « L’homme-masse est celui qui se sent comme tout le monde, et qui ne s’en inquiète pas, mais s’en trouve bien. »
L'Homme-masse est le type central et problématique de son époque (le XXᵉ siècle). Ce sont les individus moyens, qui ne cherchent pas à se dépasser, à développer leur personnalité ou leur esprit critique. Ils se conforment à ce que tout le monde pense, fait ou dit. Ortega dit que « l’homme-masse » est celui qui se satisfait de lui-même, qui ne reconnaît pas de supériorité ou d’excellence à admirer ou imiter. Il vit dans le confort des idées toutes faites, refuse l’effort intellectuel ou moral.
“El hombre medio ha aprendido a utilizar la civilización, pero no a comprenderla” : « L’homme moyen a appris à utiliser la civilisation, mais non à la comprendre. »
- L’homme d’élite (ou minoritaire)
“el hombre selecto” (littéralement, l’homme « choisi », c’est-à-dire celui qui s’impose des exigences) ou “la minoría selecta” (la minorité des meilleurs, l’élite spirituelle). Ce n’est pas une élite sociale, mais morale et spirituelle.
L’homme d’élite se donne des exigences qu’il s’impose à lui-même ; il reconnaît qu’il y a des choses supérieures à lui et cherche à les atteindre ; il a le sens de la responsabilité et du devoir ; il est animé par l’effort, la culture, la rigueur et le désir de se dépasser.
Il est le moteur de la civilisation : ce sont les créateurs, les inventeurs, les penseurs, les artistes véritables, les savants, les éducateurs — bref, ceux qui portent la culture et la société vers le haut.
- L’homme-barbare moderne (el bárbaro moderno)
Ortega parle de la « barbarie du spécialisme » (la barbarie del especialismo), où le spécialiste moderne, hypercompétent techniquement, devient un barbare cultivé : “El especialista ‘sabe’ muy bien su mínimo rincón del universo; pero ignora de raíz todo lo demás.” (« Le spécialiste connaît très bien son petit coin de l’univers, mais ignore radicalement tout le reste. »)
Ce “bárbaro moderno” est donc un type d’homme-masse doté de savoir technique mais sans culture ni vision morale. L’homme moderne, dominé par la technique, perd sa liberté intérieure.
- L’homme cultivé / intellectuel (el hombre culto ou el intelectual auténtico)
Ortega valorise "el hombre culto", c’est-à-dire celui qui cherche la vérité (la verdad), garde vivant l’héritage culturel, et agit par responsabilité intellectuelle. C’est l’opposé du hombre-masa et du bárbaro moderno. “Vivir es constantemente decidir lo que vamos a ser” : ivre, c’est décider constamment de ce que nous allons être.

Le Phénomène de la Rébellion des Masses
La "rébellion" n'est pas une révolution au sens classique. Elle ne consiste pas à se soulever contre un ordre oppressif, mais à un phénomène bien plus insidieux, la révolte de la médiocrité contre l’excellence, de l’« homme-masse » contre les minorités exigeantes qui portaient jusqu’alors la civilisation.
- Grâce au progrès technique et à l'organisation sociale (notamment la démocratie libérale), la vie est devenue plus confortable et sûre. La population a augmenté, et les masses, autrefois passives, occupent maintenant tout l'espace social.
- L'homme-masse, au lieu de rester à sa place, intervient dans tous les domaines (politique, culture, morale) sans en avoir la compétence, en imposant son avis non qualifié comme s'il avait la même valeur que celui de l'expert.
- Le coeur du problème, la Souveraineté de l'Incompétent. Dans la vie publique, l'opinion non fondée, le préjugé et la médiocrité deviennent souverains, étouffant la voix des minorités compétentes.
Autrement dit, il n’y a pas de victime, pas d’ennemi visible : la rébellion consiste à refuser toute supériorité, toute exigence, toute autorité légitime. L’« homme-masse » ne réclame plus seulement l’égalité politique ou sociale : il veut imposer son niveau moyen comme norme universelle. “La masa actúa directamente, sin ley ni freno, por el simple hecho de sentirse como todo el mundo” : «La masse agit directement, sans loi ni frein, simplement parce qu’elle se sent comme tout le monde». Ce n’est donc pas une rébellion contre un pouvoir, mais une invasion du pouvoir par la masse elle-même.
Ortega parle d’un processus intérieur et diffus, non d’un événement spectaculaire ...
Ce n’est pas une guerre, ni un coup d’État, mais une transformation silencieuse des mentalités. Les hommes-masses ne veulent plus suivre ni admirer ceux qui savent, qui créent, qui exigent :
ils veulent que tout soit à leur portée, sans effort, sans hiérarchie.
“El hecho más importante de nuestro tiempo es la entrada en la vida pública de las masas, y su decisión de regir la sociedad sin contar con las minorías” - « Le fait le plus important de notre temps est l’entrée des masses dans la vie publique, et leur décision de diriger la société sans tenir compte des minorités».
Pour Ortega, la « rébellion des masses » n’est pas un progrès démocratique,
mais une dégénérescence de la civilisation moderne ...
"..En résumé, le nouveau fait social que nous analysons ici est le suivant: l’histoire européenne semble, pour la première fois, livrée aux décisions de l’homme vulgaire, en tant qu’ "homme vulgaire"; ou si l’on veut, en tournant la proposition dans la voix active : l’homme moyen que l’on dirigeait autrefois, a résolu de gouverner le monde. Cette résolution d’occuper le premier plan social lui est venue automatiquement, dès que parvint à maturité le nouveau type d’homme qu’il représente. Si l’on étudie la structure psychologique de ce nouveau type d’homme-masse, en tenant compte des répercussions qu’il provoque dans la vie publique, on y relèvera les caractéristiques suivantes : en premier lieu, l'impression originaire et radicale que la vie est facile, débordante, sans aucune tragique limitation ; de la cette sensation de triomphe et de domination qu’éprouvera en lui chaque individu moyen, sensation qui, en second lieu, l’invitera à s’affirmer lui-même, tel qu’il est, à proclamer que son patrimoine moral et intellectuel lui parait satisfaisant et complet. Ce contentement de soi-même l’incite à demeurer sourd à toute instance extérieure, à ne pas écouter, à ne pas laisser discuter ses opinions et à ne pas s’occuper des autres. Cet intime sentiment de domination le pousse constamment à occuper la place prépondérante. Il agira donc comme s’il n’existait au monde que lui et ses congénères. Aussi - en dernier lieu - interviendra-t-il partout pour imposer son opinion médiocre, sans égards, sans atermoiements, sans formalités ni réserves, c’est-à-dire suivant un régime d’ "action directe".
"..L’ensemble de ces traits nous a fait penser à ceux qui caractérisent certaines attitudes humaines déficientes, celle de l’enfant gâté, ou du primitif
révolté, c’est-a-dire du barbare. (Le primitif normal étant au contraire, parmi les êtres qui aient jamais existé, le plus docile envers les instances supérieures - religion, tabous, tradition
sociale, coutumes, etc.). Il ne faut pas s’étonner si j’accumule ainsi les sarcasmes sur ce spécimen d’être humain. Le présent essai n’est qu’une première tentative d’attaque contre cet homme
triomphant ; et le signe avant-coureur de la prochaine et énergique volte-face d’un certain nombre d’Européens, décidés à s’opposer à ses prétentions à la tyrannie. Il ne s’agit maintenant que
d’un ballon d’essai, que d’une escarmouche, rien de plus. L’attaque de fond viendra ensuite; très prochainement peut-être, et sous une forme bien différente de celle que revêt cet essai. Elle se
présentera sous une forme telle que, même en la voyant se préparer sous ses propres yeux, il ne pourra se prémunir contre elle, ni même soupçonner qu’elle sera précisément la véritable attaque de
fond.
Ce personnage qui surgit maintenant de tous cotés et impose en tous lieux sa foncière barbarie est en effet, l’enfant gâté de l’histoire humaine.
L’enfant gâté, c’est l'héritier qui se comporte uniquement en tant qu’héritier. Ici l'héritage n’est autre que la civilisation - le bien-être, la sécurité, en somme les avantages de la
civilisation. Comme nous l’avons vu, c'est seulement dans l’ampleur vitale que cette civilisation a donnée au monde, que peut naître un homme constitué par cet ensemble de traits,
caractéristiques de l’enfant gâté. C'est là une des nombreuses déformations que le luxe produit dans la matière humaine. Nous aurions tendance à nous imaginer qu’une vie engendrée dans
l'abondance excessive serait meilleure, de qualité supérieure, plus "vivante" que celle qui consiste précisément à lutter contre la disette. Mais il n’en est pas ainsi. Et pour des raisons très
rigoureuses, fondamentales qu’il n’est pas le moment d’énoncer à présent. Il suffit ici, au lieu de donner ces raisons, de se souvenir du fait, cent fois cité, qui constitue la tragédie de toute
aristocratie héréditaire. L’aristocrate hérite, c’est-à-dire se voit attribuer des conditions de vie qu’il n’a pas créées lui-même, et qui, pour cette raison, ne sont pas liées organiquement à sa
propre vie. Dès sa naissance, il se trouve brusquement installé, et sans savoir comment, au milieu de sa richesse et de ses prérogatives. Il n’a intimement rien à voir avec elles puisqu’elles ne
viennent pas de lui. Elles ne sont en quelque sorte que le caparaçon gigantesque d’une autre personne, d’un être qui a vécu: son aïeul. Et il doit vivre en héritier, c’est-à-dire qu’il doit
revêtir cette carapace d’une autre vie. Dès lors, quelle va être la vie de l’ "aristocrate" héréditaire ? La sienne ou celle du preux qui instaura sa lignée ? Ni l'une ni l’autre. Il est
condamné à représenter l’autre et par conséquent à n’être ni l'autre, ni lui-même. Sa vie perd inexorablement son authenticité et devient une pure fiction, une pure représentation de la vie de
son ancêtre. La surabondance des biens dont il est tenu de se servir ne lui permet pas de vivre son propre destin, son destin personnel, et atrophie sa vie. Toute vie consiste dans la lutte et
l'effort pour être soi-même. Les difficultés auxquelles je me heurte pour réaliser ma vie éveillent et mobilisent mes activités, mes capacités. Si mon corps n’était pas pesant je ne pourrais pas
marcher. Si l'atmosphère était sans résistance, mon corps me semblerait vague, spongieux, fantomatique. Il en est de même pour l' "aristocrate" héréditaire : toute sa personnalité s’estompe par
manque d'effort et de tension vitale. Il en résulte ce gâtisme particulier, sans égal, des vieilles noblesses, dont personne n’a encore décrit le tragique mécanisme intérieur ; ce tragique
mécanisme intérieur qui amène insensiblement toute aristocratie héréditaire à une irrémédiable dégénérescence. Ce simple fait suffirait à contrecarrer notre tendance naïve à croire que l’excès de
biens favorise la vie. Bien au contraire, en effet : un monde débordant de possibilités engendre automatiquement de graves déformations et des spécimens vicieux de l'existence
humaine..."
C'est dans "La Révolte des Masses", qu'Ortega développe sa théorie de l'État-nation moderne. L'idée centrale est que l'État précède la nation, et non l'inverse...
"... Qu’est-ce qui saute aux yeux quand nous repassons l’évolution de n’importe laquelle des « nations modernes » – France, Angleterre, Allemagne ? Simplement ceci : ce qui, à une certaine date, semblait constituer la nationalité, apparaît réfuté plus tard. D’abord la nation semble la tribu et la non-nation, la tribu d’à côté. Bientôt la nation se compose des deux tribus, plus tard c’est une contrée et peu après c’est déjà un comté, ou un duché ou un « royaume ». La nation est León, et non Castille ; bientôt c’est le León et la Castille, mais non l’Aragon. La présence de deux principes est évidente : l’un, variable et toujours dépassé — tribu, contrée, duché, « royaume », avec sa langue ou son dialecte – l’autre, permanent, qui franchit librement toutes ces limites et postule comme unité ce que le premier considérait précisément comme une radicale opposition.
Les philologues – j’appelle ainsi ceux qui, aujourd’hui, prétendent au nom d’historiens – se livrent à la plus délicieuse des naïvetés lorsque, partant de ce que sont aujourd’hui, à cette date fugitive, en ces deux ou trois siècles, les nations d’Occident, ils supposent que Vercingétorix ou le Cid Campeador voulaient déjà une France s’étendant de Saint-Malo à Strasbourg – exactement – ou une Spania qui s’étendît du Finistère galicien à Gibraltar. Ces philologues – comme le dramaturge naïf – font presque toujours partir leurs héros pour la guerre de Trente ans. Pour nous expliquer comment se sont formées la France et l’Espagne, ils supposent que la France et l’Espagne préexistaient en tant qu’unités au fond des âmes françaises et espagnoles. Comme s’il avait existé dès l’origine des Français et des Espagnols avant l’existence même de la France et de l’Espagne ! Comme si le Français et l’Espagnol n’étaient pas simplement dés êtres qu’il fallut deux mille ans de travail à élaborer !
La vérité toute simple c’est que les nations actuelles ne sont que la manifestation actuelle de ce principe variable, condamné à un perpétuel progrès. Ce principe n’est maintenant ni le sang ni la langue, puisque la communauté de sang et de langue en France et en Espagne a été un effet et non une cause de l’unification de l’État ; ce principe est actuellement la « frontière naturelle ».
Il est bon que, dans son escrime subtile, un diplomate emploie ce concept des frontières naturelles, comme ultima ratio de son argumentation. Mais un historien ne peut s’abriter derrière lui comme s’il était un retranchement définitif. Il n’est pas définitif, ni même suffisamment spécifique...."

"La deshumanización del arte" (1925)
Un essai de philosophie esthétique dans lequel Ortega y Gasset analyse l'art moderne qui émerge au début du XXe siècle (comme les avant-gardes : cubisme, surréalisme, abstraction, etc.). Sa thèse centrale est que cet art nouveau opère une "déshumanisation". Cela ne signifie pas qu'il est inhumain ou cruel, mais qu'il retire les éléments purement humains, réalistes et sentimentaux qui caractérisaient l'art traditionnel.
- L'art moderne rejette la simple imitation de la réalité (le réalisme). Il ne cherche pas à représenter le monde tel que nous le voyons, mais à le réinterpréter, le déformer ou le simplifier (ex: le cubisme).
- L'œuvre d'art n'est plus un reflet de la vie, mais devient un objet autonome, qui existe pour lui-même et selon ses propres règles.
-Cet art n'est pas destiné à tout le monde. Il est difficile d'accès, intellectuel et s'adresse à une minoré capable de comprendre son langage et ses conventions. Ortega y Gasset parle de "divertissement pour l'élite".
- L'art moderne utilise abondamment l'ironie pour se distancier de l'émotion directe et la métaphore comme outil de création de nouvelles réalités.
- En se déshumanisant, l'art moderne remplit une fonction sociale de division : il sépare la masse (qui le rejette) de l'élite minoritaire (qui le comprend et l'apprécie).
, "La deshumanización del arte" est une œuvre extrêmement connue et influente. Elle est considérée comme un classique de la philosophie de l'art du XXe siècle et une clé de lecture essentielle pour comprendre la naissance et la signification de l'art moderne et des avant-gardes. Sa notoriété dépasse largement le monde hispanophone, grâce à ses nombreuses traductions. ("La déshumanisation de l'art", trad. Editions Allia, 2011)
"PARMI les nombreuses idées de génie, hélas mal développées, du génial Français Guyau, on doit citer sa tentative d'étudier l'art au point de vue sociologique. Au premier abord, on pourrait penser qu'un tel sujet est stérile. Saisir l'art par le biais de ses effets sociaux ressemble fort à comprendre de travers ou à étudier l'homme au départ de son ombre. Les effets sociaux de l'art sont, à première vue, tellement extrinsèques, tellement éloignés de l'essence esthétique, qu'on voit difficilement comment, à partir d'eux, on peut pénétrer dans l'intimité des styles. Guyau, c'est sûr, n'a pas tiré le meilleur parti de sa géniale tentative. La brièveté de sa vie et cette hâte tragique vers la mort l'empêchèrent de rasséréner ses inspirations pour pouvoir, laissant de côté tout ce qui est évident et tout nouveau, insister sur ce qui est le plus substantiel et le plus caché. On peut dire que de son livre L'Art au point de vue sociologique, seul le titre existe ; le reste doit encore être écrit.
La fécondité d'une sociologie de l'art me fut révélée de manière inattendue lorsque, il y a quelques années, j'eus un jour l'idée d'écrire quelque chose sur la nouvelle époque musicale, qui commence avec Debussy . Je me proposais de définir le plus clairement possible la différence de style entre la nouvelle musique et la musique traditionnelle. Le problème était rigoureusement esthétique et, cependant, je me suis rendu compte que le chemin le plus court pour y arriver partait d'un phénomène sociologique : l'impopularité de la nouvelle musique.
Aujourd'hui, je voudrais élargir mon propos et traiter de tous les arts qui ont encore une certaine vigueur en Europe. Outre la nouvelle musique, je parlerai de la nouvelle peinture, de la nouvelle poésie et du nouveau théâtre. Surprenante et mystérieuse est, il est vrai, la solidarité compacte qu'entretient chaque époque historique avec elle-même dans toutes ses manifestations. Une inspiration identique, un même style biologique palpitent dans les arts les plus divers. Sans s'en rendre compte, le musicien jeune aspire à réaliser avec des sons exactement les mêmes valeurs esthétiques que le peintre, le poète et le dramaturge, ses contemporains. Et cette identité de sens artistique devait aboutir, forcément, à une conséquence sociologique identique. En effet, à l'impopularité de la nouvelle musique répond une même impopularité dans les autres muses. Tout l'art jeune est impopulaire, non pas par hasard ou par accident, mais en vertu d'une destinée essentielle.
D'aucuns diront que tout style nouveau-né passe par une mise en quarantaine et évoqueront la bataille d'Hernani et les autres combats survenus lors de l'avènement du romantisme. Cependant, l'impopularité du nouvel art présente une tout autre physionomie. Il faut distinguer ce qui n'est pas populaire de ce qui est impopulaire. Le style innovateur tarde un peu à conquérir la popularité : il n'est pas populaire, mais il n'est pas non plus impopulaire. L'exemple de l'irruption romantique, que l'on invoque d'habitude, fut, comme phénomène sociologique, exactement l'inverse de celui que l'art offre aujourd'hui. Le romantisme conquit très rapidement le “peuple”, pour qui le vieil art classique n'avait jamais été une chose très intime. L'ennemi contre lequel le romantisme dut se battre fut justement une minorité choisie, ankylosée dans les formes archaïques de l'“ancien régime” poétique. Les œuvres romantiques sont les premières – depuis l'invention de l'imprimerie – à avoir bénéficié de gros tirages. Le romantisme a été le style populaire par excellence. Premier né de la démocratie, il fut dorloté par la masse.
Par contre, le nouvel art a la masse contre lui, et il en sera toujours ainsi. Il est impopulaire par essence ; plus encore, il est antipopulaire. Quelle que soit l'œuvre que l'art engendre, elle produit automatiquement auprès du public un curieux effet sociologique. Elle le divise en deux parties, l'une, minime, composée d'un nombre restreint de personnes qui lui sont favorables ; l'autre, majoritaire, innombrable, qui lui est hostile. (Laissons de côté la faune équivoque des snobs.) L'œuvre d'art agit donc comme un pouvoir social qui crée deux groupes antagoniques ; un pouvoir qui sépare et sélectionne dans le tas informe de la multitude deux castes différentes d'hommes.
Quel est le principe différenciateur de ces deux castes ? Toute œuvre d'art suscite des divergences ; elle plaît aux uns et déplaît aux autres ; elle plaît moins à certains et plus à d'autres. Cette dissociation n'est pas organique, elle n'obéit pas à un principe. Le hasard de notre nature individuelle nous placera parmi les uns ou parmi les autres. Mais dans le cas du nouvel art, la disjonction se produit sur un plan plus profond que celui sur lequel évoluent les variétés du goût individuel. Ce qui se passe, ce n'est pas que l'œuvre jeune ne plaise pas à la majorité du public et bien à la minorité, mais que la majorité, la masse, ne la comprend pas. Les vieilles perruques qui assistaient à la représentation d'Hernani comprenaient très bien le drame de Victor Hugo, c'est précisément pour cela qu'il ne leur plaisait pas. Fidèles à une sensibilité esthétique bien définie, elles éprouvaient de la répugnance envers les nouvelles valeurs artistiques que le romantique leur proposait.
À mon sens, ce qui caractérise le nouvel art, “au point de vue sociologique”, c'est qu'il divise le public en deux classes d'hommes : ceux qui le comprennent et ceux qui ne le comprennent pas. Cela implique que les uns possèdent un organe de compréhension refusé, par conséquent, aux autres ; nous avons là deux variétés distinctes de l'espèce humaine. Le nouvel art n'est visiblement pas fait pour tout le monde, comme l'était l'art romantique, mais il s'adresse naturellement à une minorité spécialement dotée. D'où l'irritation qu'il suscite au sein de la masse. Lorsque quelqu'un n'aime pas une œuvre d'art mais qu'il l'a comprise, il se sent supérieur à elle et l'irritation n'a pas lieu d'être. Mais lorsque le mécontentement que l'œuvre provoque naît de son incompréhension, l'homme se sent comme humilié, il a une obscure conscience de son infériorité qu'il doit compenser par l'affirmation indignée de soi face à l'œuvre. L'art jeune, par sa seule manifestation, oblige le bon bourgeois à se sentir tel qu'il est : un bon bourgeois, un sujet incapable de sacrements artistiques, aveugle et sourd à toute beauté pure. Or, cela ne peut se produire impunément après cent ans de flatterie en tout genre envers la masse et d'apothéose du “peuple”. Habituée à prédominer dans tous les domaines, la masse se sent offensée dans ses “droits de l'homme” par le nouvel art, qui est un art de privilège, de noblesse de nerfs, d'aristocratie instinctive. Partout où les jeunes muses se présentent, la masse regimbe.
Pendant un siècle et demi, le “peuple”, la masse a prétendu être toute la société. La musique de Stravinsky ou le drame de Pirandello ont l'efficacité sociologique de l'obliger à se reconnaître tel qu'il est, “rien que peuple”, simple ingrédient parmi d'autres de la structure sociale ; matière inerte du processus historique, facteur secondaire du cosmos spirituel. Par ailleurs, l'art jeune contribue aussi à ce que les “meilleurs” se connaissent et se reconnaissent au milieu de la grisaille de la multitude et apprennent leur mission : être peu nombreux et se battre contre le nombre.
Le temps approche où la société, de la politique à l'art, se réorganisera, comme il se doit, en deux ordres ou rangs : celui des hommes illustres et celui des hommes vulgaires. Tout le malaise de l'Europe débouchera sur cette nouvelle scission salvatrice qui le guérira. L'unité indifférenciée, chaotique, informe, sans architecture anatomique, sans discipline rectrice, dans laquelle nous avons vécu cent cinquante ans durant, ne peut perdurer. En dessous de toute la vie contemporaine sommeille une injustice profonde et irritante : la prétendue égalité réelle entre les hommes. Chaque pas fait parmi eux nous montre le contraire, de manière si évidente, que chaque pas est un douloureux trébuchement.
Si la question se pose en politique, les passions qu'elle suscite sont telles qu'il est peut-être trop tôt pour se faire comprendre. Heureusement, la solidarité de l'esprit historique à laquelle je faisais allusion plus haut permet de souligner, en toute clarté, en toute sérénité, dans l'art germinal de notre époque, les mêmes symptômes et signes annonciateurs qui, en politique, se trouvent assombris par de basses passions.
L'évangéliste disait : Nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellectus. Ne soyez pas comme le cheval et le mulet, à qui l'entendement fait défaut. La masse regimbe et ne comprend pas. Essayons, quant à nous, de faire l'inverse. Extrayons de l'art jeune son principe essentiel et nous verrons alors dans quel sens profond il est impopulaire.
ART PLASTIQUE
SI le nouvel art n'est pas intelligible à tout le monde, cela signifie que ses ressorts ne sont pas ceux du genre humain. Ce n'est pas un art pour les hommes en général, mais pour une classe très particulière d'hommes qui, même s'ils ne valent pas plus que les autres, sont de toute évidence différents.
Il convient, d'emblée, de préciser une chose. Qu'est-ce que la majorité des gens entendent par “plaisir esthétique” ? Que se passe-t-il dans leur esprit lorsqu'une œuvre d'art, par exemple, une pièce de théâtre, leur “plaît” ? La réponse ne fait aucun doute ; un drame leur plaît lorsqu'ils ont réussi à s'intéresser aux destinées humaines qui leur sont proposées. Les amours, les haines, les peines, les joies des personnages font vibrer leur cœur : ils y participent comme s'il s'agissait de cas réels de la vie. Et ils disent d'une œuvre qu'elle est “réussie” lorsqu'elle parvient à produire la quantité d'illusions nécessaire pour que les personnages imaginaires équivalent à des personnes vivantes. Dans la poésie lyrique, ils chercheront les amours et les douleurs de l'homme qui palpite sous le poète. Dans la peinture, seuls les attireront les tableaux où ils trouveront des silhouettes d'hommes et de femmes avec qui, dans un certain sens, il serait intéressant de vivre. Une peinture de paysage leur semblera “jolie” si le paysage réel qu'il représente mérite, grâce à ses charmes ou à son pathétisme, qu'ils y aillent en excursion.
Cela revient à dire que pour la majorité des gens le plaisir esthétique n'est pas une attitude spirituelle différente par essence de celle qu'ils adoptent habituellement dans leur vie. Elle ne s'en distingue que par des qualités secondaires : elle est, peut-être, moins utilitaire, plus dense et dépourvue de conséquences fâcheuses. Mais, en définitive, l'objet dont ils s'occupent en art, qui sert de terme à leur attention et en même temps aux autres facultés, est le même que celui de la vie quotidienne : des passions et des sujets humains. Ils appelleront “art” l'ensemble des moyens grâce auxquels on leur permet d'entrer en contact avec des choses humaines intéressantes. De telle sorte qu'ils ne toléreront les formes proprement artistiques, les irréalités, la fantaisie, que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à leur perception des formes et des péripéties humaines. Dès que ces éléments purement esthétiques dominent et qu'il ne peut pas bien saisir l'histoire de Jean et Marie, le public est pris au dépourvu et il ne sait que faire face à la scène, au livre ou au tableau. C'est normal, il ne connaît pas d'autre attitude face aux objets que l'attitude pratique, celle qui nous pousse à nous passionner et à intervenir sentimentalement. Une œuvre qui ne l'invite pas à cette intervention le prive de son rôle...."

"... Esquissons maintenant chacun des traits du nouvel art.
QUELQUES GOUTTES DE PHÉNOMÉNOLOGIE
UN homme célèbre agonise. Sa femme est à son chevet. Un médecin prend le pouls du moribond. Dans le fond de la chambre, il y a deux autres personnes : un journaliste, qui assiste à la scène mortuaire pour raison professionnelle, et un peintre, que le hasard a conduit là. Épouse, médecin, journaliste et peintre sont témoins d'un même événement. Cependant, ce seul et même événement – l'agonie d'un homme – s'offre à chacun d'eux sous un éclairage différent. Ces angles d'approche sont si différents qu'ils ont à peine un noyau commun. La différence entre ce qu'il signifie pour la femme transie de douleur et pour le peintre qui, impassible, regarde la scène, est si grande qu'il serait presque plus exact de dire que l'épouse et le peintre assistent à deux faits complètement différents.
Il en ressort donc qu'une même réalité se fractionne en une multitude de réalités divergentes lorsqu'elle est observée depuis différents points de vue. Et l'on en vient à se demander laquelle de ces réalités multiples est la réalité véritable, authentique ? Quelle que soit notre décision, elle sera arbitraire. Notre préférence pour l'une ou pour l'autre ne peut être fondée que sur un caprice. Toutes ces réalités sont équivalentes, chacune est authentique selon le point de vue adopté. La seule chose que nous puissions faire, c'est classer ces points de vue et choisir celui qui, en pratique, semble le plus normal ou le plus spontané. Nous arriverons ainsi à une notion en rien absolue, mais, au moins, pratique et normative de la réalité.
Le moyen le plus clair pour différencier les points de vue de ces quatre personnes qui assistent à la scène mortuaire consiste à mesurer l'une de ses dimensions : la distance spirituelle qui sépare chacun d'entre eux du fait commun, de l'agonie. Chez l'épouse du mourant, cette distance est minime, au point qu'elle n'existe presque pas. Le tragique événement tourmente à ce point son cœur, il occupe une telle place dans son âme, qu'il se fond à sa personne ou, pour le dire autrement, la femme participe à la scène, elle en est partie prenante. Pour que nous puissions voir quelque chose, pour qu'un fait devienne un objet à contempler, nous devons nous en détacher et veiller à ce qu'il cesse de faire partie intégrante de notre être. L'épouse, donc, n'assiste pas à la scène, mais y est intégrée ; elle ne la contemple pas, elle la vit.
Le médecin se trouve déjà un peu plus éloigné. Pour lui, il s'agit d'un cas professionnel. Il n'intervient pas dans la situation avec l'angoisse passionnée et aveuglante qui inonde l'âme de cette pauvre femme. Toutefois, son métier l'oblige à s'intéresser sérieusement à ce qui se passe ; sa responsabilité est en partie engagée et son prestige peut être mis à mal. Par conséquent, quoique de manière moins exclusive et intime que l'épouse, il prend part à cet événement ; la scène s'empare de lui, l'entraîne en son centre dramatique, le prenant non par les sentiments, mais par le côté professionnel de sa personne. Il vit, lui aussi, ce triste épisode, même si ses émotions ne partent pas de son centre cordial, mais de sa périphérie professionnelle.
En faisant maintenant nôtre le point de vue du journaliste, nous remarquons que nous nous sommes énormément éloignés de cette douloureuse réalité. Nous nous en sommes tellement éloignés que, ce faisant, nous avons perdu tout contact sentimental avec la situation. Le journaliste, tout comme le médecin, est là, tenu par sa profession, non sous l'effet d'un élan spontané et humain. Mais, tandis que la profession du médecin l'oblige à intervenir, celle du journaliste le contraint précisément à ne pas agir : il doit se contenter d'observer. Pour lui, le fait est pure scène, simple spectacle qu'il devra ensuite relater dans les colonnes du journal. Il ne participe pas sentimentalement à ce qui se passe là-bas, il est libre spirituellement et non impliqué dans la situation ; il ne la vit pas, mais la contemple. Il la contemple, toutefois, avec le souci de devoir la rapporter ensuite à ses lecteurs. Il voudrait les intéresser, les émouvoir et, si possible, tirer des larmes à tous les abonnés, comme s'ils étaient momentanément parents du mourant. À l'école, il avait lu le précepte d'Horace : Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi (Si tu veux me faire pleurer, souffre d'abord toi-même).
Fidèle à Horace, le journaliste essaie de feindre une émotion dont il nourrira ensuite sa prose. Ainsi, bien qu'il ne “vive” pas la scène, il “fait semblant” de la vivre.
Enfin, le peintre, indifférent, ne s'intéresse qu'à ce qui se déroule en coulisse3. Il se moque de ce qui se passe alentour ; il est, comme on dit d'habitude, à cent mille lieues de l'événement. Son attitude est purement contemplative et il faut même dire qu'il n'observe pas la situation dans son intégrité ; le douloureux sens interne de celle-ci reste en dehors de son champ de perception. Il ne s'occupe que de l'extérieur, des ombres et des lumières, des valeurs chromatiques. Avec le peintre, nous sommes arrivés à la distance maximale et à l'intervention sentimentale minimale...."

Juan Ramón Jiménez (1881-1958)
En 1936, Federico García Lorca se reconnaissait deux maîtres, Antonio Machado et Juan Ramón Jiménez, et l'influence de ce dernier sur la génération dite de
1927 fut en effet décisive: avec lui, la poésie se fait "religion immanente". Né à Moguer, dans la province andalouse de Huelva, Juan Ramón Jiménez se nourrit de poésie et se lie avec des poètes
tels que Salvador Rueda, Francisco Villaespesa, Rubén Darío, Valle-Inclán. En 1903-1904, il dirige une revue moderniste fameuse, "Helios". En 1916, il épouse à New York, Zenobia Camprubí. De 1916
à 1936, il séjourne à Madrid, où il écrit beaucoup ; il est célèbre, dirige plusieurs revues. Alliage de modernisme et de mysticisme, reconnu comme l'une des plus hautes figures du lyrisme
espagnol du XXe siècle, un poète éperdu de beauté poétique mais, écrira Lorca, "un grand poète troublé par une terrible exaltation de son moi, lacéré par la réalité qui l'entoure,
incroyablement mordu par des choses insignifiantes, l'oreille aux aguets du monde, véritablement ennemi de son âme merveilleuse et unique de poète.." Il aimera en effet régenter la vie
littéraire. En 1936, il quitte l'Espagne pour les États-Unis, s'installe en 1951 à Porto Rico, où il demeure jusqu'à son dernier jour.
Il est d'usage, reprenant ses propos, de distinguer trois périodes successives dans l'oeuvre de Juan Ramón Jiménez, la première étant décrite comme "idéaliste" (etapa sensitiva, 1898-1915), mais douloureuse et intimiste, avec "Elejías", "Las hojas verdes", "Baladas de primavera", "Pastorales", "La soledad sonora", "Poemas májicos y dolientes", "Sonetos espirituales", "Platero y yo"...

"Platero y yo" (1914-1917)
C'est le plus célèbre, tant en Espagne qu'en Amérique latine, des récits en prose du poète espagnol Juan Ramón Jiménez, sous-titré Élégie andalouse, qui
relate, en une centaine de petites poèmes en prose, la vie et la mort de l’âne Platero, compagnon du poète, prétexte à la description poétique de la vie andalouse, nature environnante, village de
Moguer, saisons et personnages.
PLATERO
"Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo
dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de
miel...
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las
últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo:
- Tien’ asero...
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo."
La deuxième étape de l'oeuvre de Juan Ramón Jiménez, dite "spiritualisme symboliste" (etapa intelectual, 1916-1936), avec "La soledad sonora", "Diario de un poeta recién casado", "Eternidades", "Piedra y cielo"...
SOLEDAD
(de Diario de un poeta recién casado)
En tí estás todo, mar, y sin embargo,
¡qué sinti estás, qué solo,
qué lejos, siempre, de ti mismo!
Abierto en mil heridas, cada instante,
cual mi frente,
tus olas van, como mis pensamientos,
y vienen, van y vienen,
besándose, apartándose,
con un eterno conocerse,
mar, y desconocerse.
Eres tú, y no lo sabes,
tu corazón te late y no lo sientes...
¡Qué plenitud de soledad, mar solo!.
Solitude
En toi tu es toute, mer, et cependant,
comme tu es sans toi, comme tu es seule,
et loin, toujours, de toi-même!
Ouverte de mille blessures, sans cesse,
tel mon front,
tes vagues vont, comme mes pensées,
et viennent, vont et viennent,
se baisant, s'écartant,
en un éternel se connaître,
mer, et ne plus se connaître éternel.
Tu es toi, et tu ne le sais pas,
ton coeur bat, et il ne le sent pas...
Quelle plénitude solitude, mer seule!
La dernière étape de l'oeuvre de Juan Ramón Jiménez, dite "métaphysique et d'exaltation de l'intelligence" (etapa verdadera, 1937-1958), correspond à la fin de son chemin, de son exil américain jusqu'à sa mort : "Españoles de tres mundos" (1942), "La estación total con canciones" (1946), "Animal de fondo" (1949)...

"Espacio", commencé lors de son exil américain en 1941, inclus dans "En el otro costado", est l'un des plus célèbres de ses textes, il y propose une esthétique nouvelle exprimée dans cette extraordinaire citation : "les arbres ne sont pas seuls, ils sont avec leurs ombres.."
"Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo.” Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo porvenir. No soy presente
solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo, a un lado y otro, en esta fuga (rosas, restos de alas, sombra y luz) es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento,
olvido.
¿Quién sabe más que yo, quién, qué hombre o qué dios puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe,
yo lo sé más que ése, y si quien lo ignora, más que ése lo ignoro. Lucha entre este ignorar y este saber es mi vida, su vida, y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores,
flores, soles y lunas, lunas soles como yo, como almas, como cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección; como dioses. Y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su
ciencia; solo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo; sí, de fuego o de luz, luz. ¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? Como yo ye nacido en el sol,
y del sol he venido aquí a la sombra, ¿soy de sol, como el sol alumbro?, y mi nostaljia, como la de la luna, es haber sido sol de un sol un día y reflejarlo solo ahora. Pasa el iris cantando como
canto yo. Adiós, iris, iris, volveremos a vernos, que el amor es uno y solo y vuelve cada día."
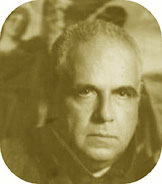
Eugenio d'Ors y Rovira (1882-1954)
Né à Barcelone, d'une mère cubaine et d'un père catalan, Eugenio d'Ors est un philosophe, critique d'art, essayiste, romancier, qui appartient à la
génération postérieure à la génération dite de 98, auprès de Marañon, de Gómez de la Serna et d'Ortega y Gasset, et qui puise sa première thématique en Catalogne, dont le célèbre "La Ben
Plantada" (1912). En 1920, il vit à Madrid et n'écrit plus qu'en castillan. A l'Espagne anecdotique et déchirée, il entend opposer une Espagne du savoir, consacre, comme Ortega y Gasset,
une grande partie de son activité à diffuser les grands courants européens, philosophiques, littéraires et artistiques, en s'attachant plus particulièrement aux problèmes esthétiques. Son œuvre
principale est constituée par ses "Glosari", série de brefs écrits commencés en 1906 et prolongés en 1920 par "El Nuevo Glosario" : il s'agit d'une sorte de journal intellectuel, d'un journal de
l' "intelligence" qui entend englober le meilleur de l'art, de la philosophie, de la littérature, le tout construit avec un alliage de rigueur logique et de fine sensibilité, très proche de
l'idéal classique de la civilisation. Ses « Gloses », ses commentaires, ses essais sont d'abord publiés dans la presse quotidienne avant d'être rassemblés en volumes : "El Valle de Josafat"
(1921), "Oceanografía del tedio" (Océanographie de l'ennui, 1921), Tres horas en el Museo del Prado (1922), De la amistad y el diálogo (1914), Aprendizaje y heroismo (1915), Grandeza y
servidumbre de la inteligencia (1919), Religio est libertas (1930), Primera lección de un curso de filosofía (1927), "La vida de Goya" (1928), "Cuando ya esté tranquilo" (Lorsqu'enfin je serai
tranquille, 1930), .. Ralllié à la Phalange en 1936, les premières années du régime franquiste lui confèrent une sorte de monopole culturel, qu'il perdra à partir de la renaissance de
l'antifranquisme dans les années 50..

Joaquin Belda (1883-1935)
Né à Cartagena, Joaquín Belda Carreras est de ces écrivains espagnols du début du siècle qui profite de la relative libéralisation de la censure sous
Alphonse XIII, pour se lancer dans le roman érotique (La Coquito (1915), Fifí Lupiañez se casa (1915), Aquellos polvos (1916), Más chulo que un ocho (1917), Las noches del Botánico (1917), Las
chicas de Terpsícore (1917), Las noches del Botánico (1917), Un riñón de menos (1918), La primera salida, (1918)...) : il alimente ainsi entre 1903 et 1935 en situations scabreuses un large
public fortement demandeur, mais a su se forger une réputation littéraire reconnue, par l'inventivité de son écriture, - pour être publié à cette époque lorsque l'intrigue est des plus obscènes,
faut-il encore employer un langage tout en périphrases et en euphémismes -, l'habileté à suggérer scènes et gestes, et en arrière-fonds, omniprésente, une satire discrète de la société hispanique
de l'époque. Insensiblement, au travers de ces "oeuvres", une époque s'achève.

La Coquito (1915)
Julio, un étudiant sans le sou, parvient aux prix de mille sacrifices à réunir la somme exigée pour vivre enfin le moment tant attendu, celui d'une nuit
passée avec la Coquito, vedette d'un cabaret madrilène, "Salon Nuevo", cabaret spécialisé dans les attractions lascives où les danseuses vendent leur corps aux plus offrants après les
représentations. La description de cette fameuse nuit occupe près d'un quart du roman : l’étudiant, cherchant ses mots, décrira son plaisir en ces mots, "mes chairs s’écartaient, comme si un
parapluie automatique venait de s’ouvrir à l’intérieur de mon corps et cherchait à en ressortir !", mais il y perdra sa fortune et son âme...
"...Il se dirigea vers le portemanteau où il avait suspendu son veston. Il en sortit un portefeuille qui n’avait visiblement pas l’habitude dc contenir
des trésors. Plusieurs billets de cent, d’autres de cinquante et de vingt-cinq. Doña Micaela ne pourrait pas lui reprocher de ne point avoir scrupuleusement suivi ses conseils. Il y avait là un
échantillonnage complet de tout le papier monnaie émis par la Banque d’Espagne et servant d’ordinaire à acheter des wagons de céréales plutôt que l’honneur de certaines dames. Sortant de son
expectative, Coquito s’approcha de sa mère, et lui dit, des flammes dans les yeux :
- Mais enfin, maman, vous ne pouvez pas faire vos comptes de mémoire sans avoir vos billets devant les yeux I
- Tu sais bien que non, ma jolie. Je me trompe et je perds le fil. Ecoutez, don Julio, vous qui étes un homme du monde, vous allez comprendre : quand je
marque cinquante pesetas, si je n’ai pas devant moi le billet ou les duros, j’ai l'impression de ne rien noter ; et quand je dis je pose vingt et je retiens deux, si je n’ai rien devant moi, je
m’évanouis et je tombe par terre.
- Tu me fais honte !
- Mais pourquoi, petite sotte ? Ta mère a raison. Tu ne comprends pas que c’est la méme
chose ?
Doña Micaela compta les billets et constata que la somme y était. Elle allait sortir, quand, tout a coup, elle s’arréta — toujours en bonne mère vigilante et jalouse du bien de sa fille
! - et dit:
- Je vous réveille à quelle heure demain ?
- A aucune ! lança La Coquito presque en pleurant.
- Bon, bon ; comme tu voudras ma fille ; comme tu voudras.
Elle sortit, souhaitant une bonne nuit à sa maisonnée, telle une matrone romaine pénétrant dans l’impluvium. Coquito était rouge. Bien que la pudeur ne fut pas son état de conscience babituel, elle était femme, et...
- Tu vois ? Une jument vendue à la foire aux bestiaux !
- Tu ne vas pas pleurer pour cela. Ca n’en vaut pas la peine, et je m’en moque moi, tu sais. Je m’attendais un peu à ce qu’elle réagisse comme ça. La premiere fois que j’ai eu le plaisir
de lui parler, elle n’était pas différente, ça ne me surprend plus. Si tu veux que je te
parle avec franchise, je la trouve plutôt haute en couleur et amusante.
- Evidemment, ce n’est pas toi qui vas dire le contraire ! Je trouve ça dégoûtant !
Cependant, Coquito et Julio se trompaient, ils n’avaient rien compris au jeu pratiqué par la mère de l’artiste. Vendre les charmes de sa fille et vanter les mérites de son corps comme s’il
s’agissait de pommes de terre nouvelles n’était en soi ni dégoûtant, ni repoussant, ni même condamnable. C’était simplement une
question de physiologie. Une personne qui est née sans odorat ou qui l’a perdu après la naissance mérite-t-elle un blâme parce
qu’en passant à coté d’une vespasienne ou d’un bureau municipal, elle ne remarque pas l’odeur fetide qui s’en exhale ? Ce que Doña Micaela faisait n’avait rien à voir avec le cynisme, la vantardise, l’immoralité ou la négligence d’une personne qui sait que le mal existe et qui décide
malgré tout de le perpétrer sous cape. Le sens moral avait chez elle un vice de fabrication, un oubli du maitre artisan qui nous
fabriqua et qui parfois lance dans le vaste monde une créature sans pied, sans main ou dotée d’une âme dépourvue de sens moral
et qui ne peut appréhender le bien.
Doña Micaela sur un trône, ce serait une nouvelle Catherine II: elle signerait les sentences de mort comme d’autres écrivent des cartes postales !
Méchantes, ces deux femmes ? Non, en les qualifiant de la sorte vous commettriez une erreur historique. Pour que des personnes comme Catherine de Russie et Doña Micaela - ô vies paralleles ! — fussent méchantes, il eut fallu qu’elles possédassent la
méchanceté du rocher qui tombe sur une véranda et la brise ou du concombre qui, une certaine nuit d’été,
nous contraint à faire le serpent dans le lit, en proie aux douleurs du miserere.
Et puis, lorsque vous plongez une personne telle que celle-ci dans une société ou les postes de députés s’achètent, ou le droit d’ouvrir une maison close se monnaie, où un sacristain de
village peut se payer le titre de chanoine, ou n’importe quelle sainte Thérèse peut devenir une Messaline, dites-moi si cette
personne ne va pas faire de l’argent son dieu et s’occuper de ses affaires avec le même respect qu’un commentateur zélé
des Evangiles...
Ô Doña Micaela ! Tu as tout notre respect et toute notre sympathie...
Après avoir payé sa "dette" et calmé les inquiétudes de Coquito, Julio se sentait de nouveau irrésistiblement attiré par cette histoire de la nuit
cubaine qui vit la naissance de la rumba, pour le plaisir et la joie de tous les publics futurs. Ce qui n’avait été jusqu'alors qu'une danse de sauvages, deviendrait, grâce à Coquito, une
salvation divinement infernale qui triompherait sur toutes les scènes du monde, en soumettant au joug de la luxure des centaines de milliers d’hommes..."
