- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest

Jean Rhys (1890-1979), "After leaving Mr. McKenzie" (1931), "Voyage in the Dark" (1934), "Good Morning Midnight" (1939), "Wide Sargasso Sea" (1966) ...
Last update: 2023/02/02
Née d'un père gallois et d'une mère dominicaine, Jean Rhys évoquera souvent dans son oeuvre le déracinement des femmes et de façon obsessionnelle sa propre existence, à peine romancée. C'est de l'intérieur qu'elle dépeint le profond sentiment de solitude et d'exil que ressentent des héroïnes, toutes malheureuses, toutes errant dans des villes hostiles et exploitées par les hommes. Et ceci avec une technique d'écriture éprouvée tant elle est tout autant capable de décrire des sentiments ambigus ou des états proches de la folie sans la moindre complaisance, elle avait, a pu dire Madox Ford, un instinct de la forme que possèdent peu d'écrivains anglais ...
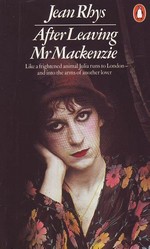
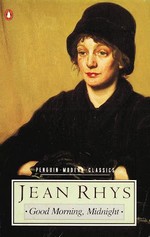
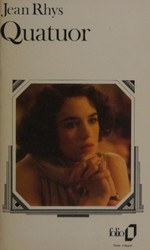





Jean Rhys a écrit pour survivre. Sa vie a été marquée par une série d'échecs sentimentaux, de deuils, de précarité et d'instabilité psychologique. L'écriture était pour elle une manière de mettre à distance ses démons, de donner un sens et une forme à son chaos intérieur. Elle disait elle-même écrire sur ce qui la terrifiait ou la hantait. Si des auteurs comme Joyce ou Woolf explorent le flux de conscience de personnages appartenant à des milieux cultivés, Rhys applique cette technique aux marginaux. Son style, apparemment simple et dépouillé, est d'une précision chirurgicale pour capturer les états de conscience flottants, l'ivresse, la dépression, la honte et la paranoïa. Ses personnages féminins sont souvent perçus comme des séductrices ou des femmes faciles. Rhys, de l'intérieur, montre qu'il s'agit d'un rôle imposé, d'une prison. Elle révèle la vulnérabilité, la peur et la détresse derrière la façade de la "mauvaise femme" ...

Jean Rhys (1890-1979)
Née en 1890 dans l'île de la Dominique aux Antilles, Ella Gwendolen Rees Williams est devenue Jean Rhys après avoir utilisé plusieurs pseudonymes, d'une mère issue d'une famille créole installée aux Antilles depuis le XVIIIe siècle, et d'un père médecin gallois. Profondément marquée par son enfance dans les îles, qu'elle considéra plus tard comme une sorte de paradis perdu, elle y souffrit pourtant de se sentir rejetée par sa famille, et en particulier par sa mère. Elle quitte la Dominique à seize ans pour faire des études rapidement abandonnées et se lancer dans une carrière théâtrale à Londres, où elle fit principalement de la figuration. Après une première liaison avec un homme plus âgé, épisode raconté de façon à peine romancée dans "Voyage dans les ténèbres", elle épouse en 1919 un journaliste, Jean Lenglet, et s'installe avec lui à Paris, faisant des voyages à Vienne et à Budapest. Elle perd son premier enfant, âgé de quelques semaines, puis donne naissance à une fille en 1922. Le thème de la mort de l'enfant hantera la plupart de ses romans. Après une période dès plus faste, son mari se retrouve en prison pour escroquerie, elle fait alors la rencontre du romancier Ford Madox Ford, qui l'encourage à écrire. Elle publie ses premières nouvelles, "Left Bank" (1927), des « esquisses et études du Paris bohème d'aujourd'hui ». Puis "Quatuor" (1928), qui raconte sa liaison avec lui, sous l'œil complaisant de sa femme, décrivant ses tendances alcooliques et suicidaires. ...
Marya, une jeune Anglaise, vient d'épouser Stephan, un Polonais. Ils sont venus vivre à Paris (elle écrira beaucoup à Paris car elle déteste Londres et l'Angleterre). Marya est heureuse et ne cherche pas trop à savoir d'où provient l'argent du ménage, jusqu'au jour où Stephan est arrêté pour vol d'oeuvres d'art. Désemparée, Marya tombe dans le piège des Heidler, un couple de mécènes anglais connus dans les milieux bohèmes de Montparnasse. Marya subit, effrayée et fascinée, la sensualité de Heidler et la domination de Loïs, sa femme, complice de leur liaison. Stephan, une fois sorti de prison, retrouve Marya. Mais elle ne peut renoncer à Heidler, et pas davantage abandonner Stephan. Elle les perdra tous les deux ...
Les années 1930 constitueront sa période littéraire la plus fructueuse, publiant trois romans, "Quai des Grands-Augustins" (1931, After Leaving Mr Mackenzie), "Voyage dans les Ténèbres" (1934, Voyage in the Dark), et "Bonjour Minuit" (1939, Good Morning, Midnight). Entre-temps, elle a divorcé de Jean Lenglet et épouse à Londres Leslie Tilden Smith, un agent littéraire, en 1932. En 1936, elle retourne avec lui à la Dominique mais en revient déçue, la réalité est moins belle que dans ses souvenirs ("The Day They Burned the Books"). Leur vie commune est une succession de difficultés se toutes sortes, financières, frustrations, alcoolisme. Après la mort de Tilden Smith en 1945, elle se remarie une troisième fois en 1947 avec Max Hamer, le cousin de son second mari, avec lequel va se poursuivre la même expérience chaotique, jusqu'à passer cinq jours dans l'hôpital de la prison de Holloway en 1949. Elle ne publie plus rien mais est "redécouverte" en 1957 à l'occasion d'une adaptation radiophonique de "Bonjour Minuit". Sa carrière littéraire reprend avec la publication d'un nouveau roman, "La Prisonnière des Sargasses" et tous ses romans précédents sont alors republiés entre 1967 et 1973, que complètent une biographie et des recueils de nouvelles ("Smile please", "Tigers are Better-looking", "Sleep it off Lady")....

"After Leaving Mr. Mackenzie" (1930)
Publié en 1930, ce roman s'inscrit directement dans la continuité thématique et stylistique de "Quartet" (1928).
Il approfondit le portrait de ce que l'on pourrait appeler "l'héroïne rhysienne" : une femme fragile, déracinée et en proie à une précarité tant économique qu'émotionnelle. Si "Quartet" montrait la chute, "After Leaving Mr. Mackenzie" explore l'état de survivance dans les bas-fonds parisiens et londoniens.
Julia Martin, une femme d'une quarantaine d'années dont la beauté commence à se faner, la rendant encore plus vulnérable dans un monde où son capital séducteur était son principal atout ...
Première Partie : La Rupture et la Précarité à Paris ..
Le roman s'ouvre sur Julia vivant dans une pension parisienne miteuse. Elle vient de rompre avec Mr. Mackenzie, un homme qui lui versait une modeste pension alimentaire après leur liaison. Ce dernier, par l'intermédiaire de son avocat, a mis fin aux versements de manière froide et définitive.
Sans ressources, Julia sombre dans une existence misérable. Elle erre dans Paris, vit de peu, boit pour oublier et observe avec une lucidité désabusée son propre naufrage. Elle est prise au piège entre le mépris des hommes qui l'ont utilisée et son incapacité à trouver une place respectable dans la société.
Deuxième Partie : Le Retour à Londres et l'Échec Familial ..
Apprenant que sa mère est mourante à Londres, Julia y retourne, espérant peut-être une aide financière ou un réconfort. Cet espoir est rapidement déçu.
Elle retrouve sa sœur, Norah, qui incarne la respectabilité étriquée et laborieuse. Norah considère Julia avec un mélange de pitié, de jalousie et de mépris moralisateur. La visite au chevet de leur mère, sénile et méconnaissable, est un échec cuisant. Aucune communication réelle n'est possible, et Julia repart sans avoir reçu l'aide ou l'absolution qu'elle cherchait inconsciemment.
Troisième Partie, les errances désespérées et la quête vaine ..
De retour à Paris, Julia tente de renouer avec d'anciennes connaissances masculines dans l'espoir de se refaire une situation. Elle revoit George Horsfield, un homme plutôt bienveillant mais faible, qui est attiré par elle mais effrayé par son désespoir. Elle tente aussi une approche désespérée et humiliante auprès de Mr. Mackenzie lui-même, qui la rejette avec une froideur définitive.
Chaque tentative se solde par un échec. Les hommes voient en elle un fardeau, un rappel encombrant de leur propre médiocrité. Julia, de son côté, est trop fière et trop brisée pour jouer correctement le jeu de la séduction ou de la soumission. Le roman se clôt sur elle alors qu'elle erre dans les rues de Paris, sans argent, sans amour et sans le moindre espoir pour l'avenir. La dernière image est celle d'une femme définitivement perdue, "after leaving" tout et tout le monde.
".. Julia had come across this hotel six months before- on the fifth of October. She had told the landlady she would want the room for a week or perhaps a fortnight. And she had told herself that it was a good sort of place to hide in. She had also told herself that she would stay there until the sore and cringing feeling, which was the legacy of Mr Mackenzie, had departed.
At first the landlady had been suspicious and inclined to be hostile because she disapproved of Julia’s habit of coming home at night accompanied by a bottle. A man, yes; a bottle, no. That was the landlady’s point of view. But Julia was quiet and very inoffensive. And she was not a bad-looking woman, either.
The landlady thought to herself that it was extraordinary a life like that, not to be believed. ‘Always alone in her bedroom. But it’s the life of a dog.’ Then she had decided that Julia was mad, slightly pricked. Then, having become accustomed to her lodger, she had ceased to speculate and had gradually forgotten all about her.
Julia was not altogether unhappy. Locked in her roomespecially when she was locked in her room- she felt safe.
She read most of the time.
But on some days her monotonous life was made confused and frightening by her thoughts. Then she could not stay still. She was obliged to walk up and down the room consumed with hatred of the world and everybody in itand especially of Mr Mackenzie. Often she would talk to herself as she walked up and down.
Then she would feel horribly fatigued and would lie on the bed for a long time without moving. The rumble of the life outside was like the sound of the sea which was rising gradually around her.
She found pleasure in memories, as an old woman might have done. Her mind was a confusion of memory and imagination. It was always places that she thought of, not people. She would lie thinking of the dark shadows of houses in a street white with sunshine; or of trees with slender black branches and young green leaves, like the trees of a London square in spring; or ofa dark-purple sea, the sea of a chromo or of some tropical country that she had never seen.
Nowadays something had happened to her; she was tired. She hardly ever thought of men, or of love...."
"Julia était tombée sur cet hôtel six mois plus tôt – le cinq octobre. Elle avait dit à la propriétaire qu'elle aurait besoin de la chambre pour une semaine ou peut-être quinze jours. Et elle s'était dit que c'était un bon endroit où se cacher. Elle s'était aussi dit qu'elle y resterait jusqu'à ce que la sensation douloureuse et humiliée, legs de Mr Mackenzie, se soit dissipée.
Au début, la propriétaire s'était montrée méfiante et plutôt hostile, car elle désapprouvait l'habitude qu'avait Julia de rentrer le soir accompagnée d'une bouteille. Un homme, passe encore ; une bouteille, non. Telle était l'opinion de la propriétaire. Mais Julia était calme et très inoffensive. Et ce n'était pas une vilaine femme, non plus.
La propriétaire pensait en elle-même que c'était une vie extraordinaire, incroyable. « Toujours seule dans sa chambre. Mais c'est la vie d'un chien. » Puis elle avait décidé que Julia était folle, un peu timbrée. Puis, s'étant habituée à sa locataire, elle avait cessé de spéculer et l'avait peu à peu totalement oubliée.
Julia n'était pas tout à fait malheureuse. Enfermée dans sa chambre – surtout lorsqu'elle était enfermée dans sa chambre – elle se sentait en sécurité.
Elle lisait la plupart du temps.
Mais certains jours, sa vie monotone était rendue confuse et effrayante par ses pensées. Alors, elle ne pouvait rester en place. Elle était obligée de marcher de long en large dans la pièce, consumée de haine envers le monde et tous ceux qui le peuplaient – et surtout envers Mr Mackenzie. Souvent, elle se parlait à elle-même en marchant de long en large.
Puis elle se sentait horriblement fatiguée et restait allongée sur le lit, longtemps, sans bouger. Le grondement de la vie au-dehors était comme le bruit de la mer qui montait peu à peu autour d'elle.
Elle trouvait du plaisir dans les souvenirs, comme aurait pu le faire une vieille femme. Son esprit était une confusion de mémoire et d'imagination. C'était toujours à des lieux qu'elle pensait, pas à des gens. Elle restait allongée à penser aux ombres sombres des maisons dans une rue blanche de soleil ; ou à des arbres aux branches minces et noires et aux jeunes feuilles vertes, comme les arbres d'une place londonienne au printemps ; ou à une mer d'un violet sombre, la mer d'un chromo ou d'un pays tropical qu'elle n'avait jamais vu.
De nos jours, quelque chose lui était arrivé ; elle était fatiguée. Elle ne pensait presque plus jamais aux hommes, ni à l'amour..."
La Condition de la Femme "Jetable", une critique féroce de la condition féminine dans une société patriarcale. Julia n'a ni mari, ni métier, ni famille solidaire. Sa valeur est indexée sur sa jeunesse et sa beauté, deux capitaux périssables. Une fois ceux-ci érodés, la société n'a plus aucune place pour elle. Rhys montre l'impitoyable logique de "consommation" puis de "mise au rebut" des femmes par les hommes. Julia est une éternelle étrangère, en exil partout. Elle ne peut communiquer ni avec sa famille (qui la juge), ni avec ses amants (qui la paient ou la fuient), ni même avec les autres femmes. Son isolement est total. La scène avec sa mère mourante est emblématique de cette rupture irrémédiable du lien.
Chaque relation est sous-tendue par un calcul économique. La pension de Mr. Mackenzie était la contrepartie financière de leur relation passée. Sans elle, Julia n'a plus aucune valeur à ses yeux. Norah, qui travaille dur, considère la vie de Julia comme immorale et oisive, sans voir que les deux sœurs sont deux faces d'une même misère féminine.
Comme toujours chez Rhys, le style est sec, précis et d'une objectivité presque clinique. Il n'y a pas de jugement moral, pas de pathos superflu. Le désespoir de Julia est rendu par de petits détails concrets : une robe froissée, un verre de vin, la sensation du froid dans une chambre d'hôtel. Cette économie de moyens rend son destin d'autant plus poignant.
"After Leaving Mr. Mackenzie" est un jalon essentiel dans l'œuvre de Jean Rhys. Il affine le portrait de l'anti-héroïne moderne et sans illusions....
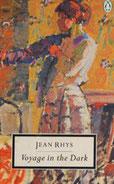
"Voyage in the Dark" (1934)
Le premier texte à l'origine de ce roman fut écrit à Londres en 1913, sous le coup d'une impulsion irrésistible, en une seule nuit. Cette sorte de journal fut ensuite transformé en œuvre de fiction ayant pour protagoniste une jeune femme de dix-neuf ans qui ressemble comme une sœur à l'auteur. Comme elle, Anna Morgan souffre de se retrouver dans une Angleterre grise et glacée après une enfance dans les Antilles; elle aussi vit d'expédients et de petits rôles dans des comédies musicales ratées, avant de rencontrer Walter Jeffries, un homme riche, plus âgé qu`elle, dont elle tombe amoureuse, mais qu'elle effraie par son caractère passionné et sa dépendance totale. Leur rupture, suivie d'un sordide avortement, la plonge dans la solitude et la dépression. Jean Rhys reprend ici les épisodes de sa liaison avec le banquier Lancelot Hugh Smith, qui lui versa longtemps une pension dont elle était désespérée de ne pouvoir se passer. Le froid, la peur, l'humiliation des difficultés financières reviennent comme des leitmotive dans ce roman qui décrit la dérive d`une femme incapable d`affronter un monde où tout lui semble étranger et hostile, pour en fin de compte se réfugier dans l'inertie, l'alcool ou le sommeil.
Ecrit à la première personne en mots courts ou monosyllabiques, "comme un chat qui miaule", dira l`auteur, avec de nombreux dialogues décousus, entrecoupés de passages de réminiscences lyriques, ce texte restitue de façon quasi hallucinatoire un état de souffrance extrême, traversé d'instants de lucidité et d'humour. (Trad. Denoël, 1974).
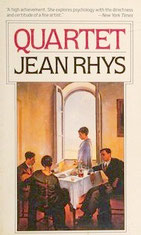
"Quartet" (1928)
Premier roman de Jean Rhys (sous le titre Postures), et bien plus qu'un simple roman autobiographique. C'est un livre cruel, élégant et d'une modernité saisissante, qui installe d'emblée Jean Rhys comme une observatrice unique et essentielle des zones d'ombre de la condition féminine au XXe siècle.
Le roman est profondément inspiré par la relation tumultueuse de Jean Rhys avec le célèbre écrivain Ford Madox Ford et son épouse, Stella Bowen. Dans les années 1920, Rhys a eu une aventure avec Ford, qui l'a prise sous son aile, lui et son mari, tout en l'introduisant dans les cercles littéraires parisiens. Cette expérience humiliante et complexe de dépendance affective et économique est la matière première du livre.
L'intrigue se déroule dans le Paris bohème et précaire de l'entre-deux-guerres.
Marya Zelli, une jeune femme anglaise un peu passive, vit une existence insouciante à Paris avec son mari polonais, Stephan, un marchand d'art aux activités troubles. Leur vie est faite de cafés, de nuits à Montmartre et d'un bonheur fragile.
Cet équilibre vole en éclats lorsque Stephan est arrêté et emprisonné pour des délifs non précisés. Marya, complètement désemparée, se retrouve seule, sans ressources et sans repères dans une ville étrangère.
C'est alors qu'intervient le couple Heidler : H.J. Heidler, un marchand d'art américain riche et dominateur, et sa femme, Lois, froide et résignée. Ils proposent à Marya de la "sauver" en l'hébergeant et en prenant soin d'elle. Très vite, cette charité se révèle être un piège. Heidler entreprend Marya avec une brutalité cynique, l'obligeant à devenir sa maîtresse. Lois, quant à elle, participe à ce chantage affectif en feignant l'indifférence, mais en exerçant une pression psychologique constante sur Marya.
Le Quartet Infernal : S'installe alors une dynamique relationnelle malsaine et étouffante, un "quartet" où chacun joue un rôle forcé. Marya est tiraillée entre sa dépendance économique envers les Heidler, son dégoût pour cette relation imposée, un reste d'affection pour son mari en prison et une fascination malsaine pour la force brutale de Heidler.
Le roman suit la lente déchéance de Marya. Elle sombre dans l'alcool, la jalousie et la dépression. À la libération de Stephan, qui devine la situation mais refuse de la comprendre, la rupture est consommée. Le roman se clôt sur Marya plus seule et perdue que jamais, piégée dans la relation destructrice avec les Heidler, son identité et sa volonté anéanties.
"... Vous ne voulez pas venir habiter chez nous, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Pourquoi faire tant d'histoires ? Si vous craignez vraiment d’être une gêne, sortez-vous cela de la tête. J’ai l’habitude. H.J. est toujours en train de sauver un jeune génie ou un autre et de l'installer dans la chambre d’amis. Nous en avons sorti d’affaire plus d’un depuis que nous sommes à Montparnasse, croyez-moi. Elle ajouta : Et invariablement, ils nous haïssent à mort ensuite. Tant pis ! Peut-être serez-vous la brillante exception.
— Oui, répondit vaguement Marya, mais pour moi la question n’est pas de durer quelques jours ou quelques semaines. Je n’ai vraiment pas d’argent du tout ; il faut vraiment que je prenne les choses en main.
— Eh bien, dit Loïs, qu’allez-vous faire ?
Elle regarda Marya d’un air de doute, mais avec intelligence, comme pour dire : « Allez-y. Expliquez-vous. J'écoute. Je fais un effort pour comprendre votre point de vue. »
Marya commença avec difficulté :
— Voyez-vous, l'ennui avec moi, je le crains, c’est que je ne suis pas assez dure. Je suis une personne douce, vulnérable et j'étais morte de peur ces derniers jours. Je ne veux pas dire que j'avais peur physiquement... » Elle s’arrêta. Mme Heidler la contemplait toujours de ses yeux bruns, raisonnables et inquisiteurs.
.— Je me suis rendu compte, voyez-vous, que la vie est horrible et cruelle aux gens sans protection. Je crois que la vie est cruelle. Je crois que les gens sont cruels. » Tout le temps qu’elle parlait, elle pensait : Quel besoin ai-je de lui dire tout ça ? Mais elle se sentait forcée de continuer : « J'ai peut-être complètement tort, bien sûr, mais c’est ce que je crois. Et puis, je me suis habituée à l’idée de faire face à cette cruauté. On peut, vous savez. Le moment vient où même la personne la plus douce s’en fiche complètement, et c’est un moment précieux. On ne devrait pas le gâcher. Vous êtes merveilleusement bonne, mais si je venais habiter chez vous, cela ne ferait que me rendre douce et timide de nouveau, et il me faudrait recommencer à m’endurcir après. Je ne suppose pas, ajouta-t-elle sans grand espoir, que vous compreniez quoi que ce soit de ce que je veux dire.
— Je ne vois pas, répliqua Loïs, pourquoi il vous faudrait recommencer à vous endurcir après.
Les gens ne sont pas de tels ogres. Les gens peuvent être très bienveillants, si on ne les prend pas à rebrousse-poil.
— Le peuvent-ils ? demanda Marya.
Loïs toussa.
— Tout cela est bien beau, mais parlons peu, parlons bien : que pensez-vous faire exactement ? Je me sens responsable de vous, en quelque sorte. Je me demande pourquoi. Vous devez être le genre de personne dont on se sent responsable. Vous faisiez du théâtre, n'est-ce pas ? Eh bien, j'espère que vous ne pensez pas à un emploi de femme nue dans un music-hall. Elles ne sont pas payées du tout, les pauvres chéries.
— Je sais, répondit Marya. Non, je n’essaierai pas d’être une femme nue. Je ne sais pas ce que je vais faire. Cela m'est égal, et ça, en tout cas, c’est un grand avantage.
Elle posa sa tête en arrière sur les coussins et ferma les yeux. Brusquement, elle se sentait horriblement fatiguée, étourdie de fatigue.
— Naturellement, remarqua Loïs d’une voix pensive, les hommes, un homme pourrait peut-être... Oui, d’une certaine façon. . Mais ces choses-là doivent être préparées avec soin, ma petite, ou cela finit par le plus effroyable fiasco. Je veux dire, même si vous décidiez que c’est le meilleur moyen de vous en sortir, il vous faudrait préparer vos plans très soigneusement. Et, aussi soigneusement qu’on les prépare, cela se termine en fiasco le plus souvent, à mon avis.
— Je ne crois pas que je pourrai jamais préparer soigneusement des plans, dit Marya, et certainement pas ce genre de plan. Si j'allais en enfer, j'irais parce que je veux y aller, ou parce que c’est une bonne drogue, ou parce que je me fiche de mon idiot de corps de bonne femme, de toute façon. Et tous les gens qui jasent. » Elle parlait très vite, le visage empourpré et elle éclata en sanglots. Maintenant, je suis fichue, pensa-t-elle. J'ai commencé à pleurer et je ne vais plus pouvoir m'arrêter. ..."
Quartet est une illustration criante de la vulnérabilité des femmes seules dans une société patriarcale. Sans mari ni argent, Marya n'a d'autre choix que de se soumettre au "marché" sexuel. Rhys montre, sans le moindre jugement moral, comment le corps féminin devient la dernière monnaie d'échange pour survivre. La "générosité" des Heidler n'est en réalité qu'une forme déguisée d'exploitation. Le roman est une dissection impitoyable des rapports de pouvoir au sein d'un triangle amoureux. Rhys démystifie l'image bohème et libre du ménage à trois pour en révéler la cruauté et les manipulations. Lois n'est pas une victime, mais une complice active qui préserve son statut d'épouse en sacrifiant Marya. Heidler utilise les deux femmes pour asseoir son pouvoir et son ego.
Marya est une héroïne typiquement rhysienne : passive, spectatrice de sa propre vie. Le titre original, Postures, est révélateur : elle est contrainte d'adopter des "postures" (la protégée reconnaissante, la maîtresse soumise) qui ne sont pas les siennes. Elle perd peu à peu le contrôle de son existence et de son identité, jusqu'à devenir l'ombre d'elle-même.
Une prose dépouillée, objective, presque clinique, qui décrit la déchéance sans pathos. Elle ne cherche ni à attendrir le lecteur ni à condamner ses personnages. Elle se contente de montrer, avec une lucidité glaçante, les mécanismes de la dépendance et de la manipulation. C'est cette absence de sentimentalisme qui rend le roman si fort et si moderne.
À contre-courant des héroïnes plus conventionnelles, Rhys donne une voix aux "perdues", aux "mauvaises femmes", et révèle la face sombre de la vie de bohème ...
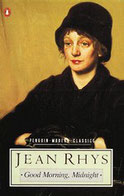
"Good Morning Midnight" (1939)
Le titre du cinquième roman de Jean Rhys fait référence à un poème d'Emily Dickinson. Après "Quatuor" ("Quartet", publié sous le titre "Posture", en 1928), "Quai des Grands-Augustins" ("After leaving Mr. McKenzie, 1931) et "Voyage dans les ténèbres" (1934), qui décrivent sous une forme à peine romancée l'enfance de Jean Rhys à la Dominique, son arrivée à Londres, ses premières liaisons, dont celle avec l'écrivain Ford Madox Ford à Paris, et ses mariages malheureux, "Bonjour Minuit" présente une nouvelle version de la femme victime de la vie, décrite de l'intérieur dans un récit décousu et à la première personne. Sasha Jansen, plus âgée que les premières héroïnes, revient à Paris en 1937 et se rappelle ses premiers séjours dans cette ville où tout a changé, et pourtant tout est semblable. C'est le Paris de Montparnasse, de la Rotonde et de la Closerie des Lilas où se pressent les écrivains ratés `et les peintres sans le sou, tout un monde cosmopolite qui cherche désespérément à s'amuser ou simplement à survivre.
Jean Rhys nous offre une image sombre et désenchantée de la "génération perdue" des années 1930, celle que l'on retrouve dans les romans plus joyeux de Hemingway et de Fitzgerald. Sasha erre à travers la ville, passant d'hôtel en hôtel et de café en café, quêtant en vain un regard ou un geste amical, ne rencontrant que des êtres aussi perdus qu'elle : un Russe qui la croit riche parce qu'elle porte encore un manteau de fourrure, un peintre qui la trouve triste, et divers gigolos. Superstitieuse, elle se fabrique un itinéraire personnel : tel café est hostile, il ne faut pas y entrer, tel autre est marqué de signes bénéfiques, mais le danger est quand même partout. Elle se sent perpétuellement scrutée par des regards hostiles, qu'elle méprise mais qu'elle cherche à se concilier par des rites propitiatoires. Si elle porte sa robe- noire, personne ne la verra. D'autres fois, elle se déguise en se teignant les cheveux, ou en s'achetant un horrible chapeau. Elle guette son image dans tous les miroirs, plus pour se prouver qu'elle existe que par coquetterie.
On sent que l'auteur a connu tout cela de très près mais maîtrise parfaitement cette matière autobiographique. Car, disait-elle, "un roman doit avoir une forme, alors que la vie n'en a pas". Proche de modernistes tels que Joyce ou Virginia Woolf, elle pratique le monologue intérieur, l'association d'idées, les ruptures d'ordre chronologique qui permettent de rendre les pensées qui se bousculent dans la conscience de sa narratrice. Procédant par bribes de phrases ou par accumulation, elle nous restitue le mélange des perceptions présentes et des souvenirs de Sasha, qui revit, par exemple, la mort traumatisante de son enfant (épisode qui évoque la mort du premier enfant de Jean Rhys). Il ne s'agit pas de procédés ni de simple technique narrative : la voix est authentique, parfois exaspérante et geignarde, mais toujours obsédée de vérité. La note finale est plutôt optimiste puisque le roman se termine sur une belle scène d'amour (- Trad. Denoël, 1969).
PART ONE
Quite like old times,' the room says.
'Yes? No?'
There are two beds, a big one for madame and a smaller one on the opposite side for monsieur. The wash-basin is shut off by a curtain. It is a large room, the smell of cheap hotels faint, almost imperceptible. The street outside is narrow, cobble-stoned, going sharply uphill and ending in a flight of steps. What they call an impasse.
I have been here five days. I have decided on a place to eat in at midday, a place to eat in at night, a place to have my drink in after dinner. I have arranged my little life.
The place to have my drink in after dinner....Wait, I must be careful about that. These things are very important.
Last night, for instance. Last night was a catastrophe....The woman at the next table started talking to me - a dark, thin woman of about forty, very well made up. She had the score of a song with her and she had been humming it under her breath, tapping the accompaniment with her fingers.
'I like that song.'
'Ah, yes, but it's a sad song. Gloomy Sunday.' She giggled. 'A little sad.'
She was waiting for her friend, she told me.
The friend arrived - an American. He stood me another brandy and soda and while I was drinking it I started to cry.
I said: 'It was something I remembered.'
The dark woman sat up very straight and threw her chest out.
'I understand,' she said, 'I understand. All the same.... Sometimes I'm just as unhappy as you are. But that's not to say that I let everybody see it.'
Unable to stop crying, I went down into the lavabo. A familiar lavabo, and luckily empty. The old dame was out ide near the telephone, talking to a girl.
I stayed there, staring at myself in the glass. What do I want to cry about?.... On the contrary, it's when l am quite sane like this, when I have had a couple of extra drinks and am quite sane, that I realize how lucky I am.
Saved, rescued, fished-up, half drowned, out of the deep, dark river, dry clothes, hair shampooed and set. Nobody would know I had ever been in it. Except, of course, that there always remains something. Yes, there always remains something....Never mind, here I am, sane and dry, with my place to hide in. What more do I want?....I'm a bit of an automaton, but sane, surely - dry, cold and sane. Now I have forgotten about dark streets, dark rivers, the pain, the struggle and the drowning....Mind you, I'm not talking about the struggle when you are strong and a good swimmer and there are willing and eager friends on the bank waiting to pull you out at the first sign of distress. I mean the real thing. You jump in with no willing and eager friends around, and when you sink you sink to the accompaniment of loud laughter.
Lavabos....What about that monograph on lavabos - toilets - ladies?....A London lavabo in black and white marble, fifteen women in a queue, each clutching her penny, not one bold spirit daring to dash out of her turn past the stern faced attendant. That's what I call discipline....The lavabo in Florence and the very pretty, fantastically dressed girl who rushed in, hugged and kissed the old dame tenderly and fed her with cakes out of a paper bag. The dancer-daughter?....That cosy little Paris lavabo, where the attendant peddled drugs - something to heal a wounded heart.
« Tout à fait comme autrefois », dit la chambre.
« Oui ? Non ? »
Il y a deux lits, un grand pour madame et un plus petit de l’autre côté pour monsieur. Le lavabo est caché par un rideau. C’est une grande chambre, avec une odeur faible, presque imperceptible d’hôtel bon marché. La rue dehors est étroite, pavée, monte raide et se termine par un escalier. Ce qu’ils appellent une impasse.
Il y a cinq jours que je suis là. J’ai choisi un endroit pour manger à midi, un endroit pour manger le soir, un endroit pour boire après le dîner. J’ai arrangé ma petite existence.
L’endroit où aller boire après le dîner… Attendez, il faut que j’y fasse bien attention. Ce sont des choses très importantes.
Hier soir par exemple. Hier soir ça a été une catastrophe… La femme de la table voisine a engagé la conversation avec moi, une brune, maigre, d’une quarantaine d’années, très bien maquillée. Elle avait apporté la musique d’une chanson qu’elle chantonnait tout bas, en tapotant l’accompagnement avec ses doigts.
— J’aime bien cette chanson.
— Ah ! Oui, mais elle est triste. Sombre dimanche – Elle a gloussé : Un peu triste.
Elle attendait un ami, m’a-t-elle dit.
L’ami est arrivé – un Américain. Il m’a payé un autre cognac-soda et en le buvant j’ai fondu en larmes.
J’ai dit :
— C’est un souvenir qui m’est revenu.
La femme brune s’est redressée sur son siège et a fait saillir sa poitrine.
— Je comprends, a-t-elle dit, je comprends. Tout de même… Il m’arrive d’être tout aussi malheureuse que vous. Mais ça ne veut pas dire que je le laisse voir à tout le monde.
Ne pouvant m’arrêter de pleurer, je suis descendue aux lavabos. Un lavabo familier, et par bonheur vide. La vieille femme était dehors près du téléphone, en train de parler à une jeune fille.
Je suis restée là, à me regarder fixement dans la glace. Quelle raison ai-je donc de pleurer ?… Pourtant, c’est quand je suis parfaitement lucide comme maintenant, quand j’ai bu un ou deux verres de trop et que je suis parfaitement lucide, que je me rends compte de ma chance. Sauvée, rescapée, repêchée, à demi noyée dans le fleuve profond et sombre, les vêtements secs, les cheveux lavés et mis en plis. Personne ne pourrait se douter que j’en sors. Sauf, évidemment, qu’il en reste toujours quelque chose. Oui, il en reste toujours quelque chose… Peu importe, me voilà, lucide et sèche, avec un endroit où me cacher. Qu’est-ce que je demande de plus ?… Je suis devenue un pur automate, mais lucide, c’est certain – sèche, froide et lucide. Maintenant j’ai oublié les rues sombres, les fleuves sombres, la souffrance, les efforts, et la noyade… Attention, je ne parle pas des efforts qu’on fait quand on est vigoureux et bon nageur et qu’il y a des amis serviables et empressés sur la rive pour vous tirer de là au premier signe de détresse. Je veux dire quand c’est pour de bon. On saute dedans sans amis serviables et empressés aux alentours et, quand on coule, c’est au son de bruyants éclats de rire.
Les lavabos… Qu’est-ce que c’était que cette monographie des lavabos… les toilettes… ladies ?… Un lavabo londonien en marbre blanc et noir, quinze femmes qui font la queue, chacune serrant son penny, pas une assez audacieuse pour resquiller et passer devant la préposée à l’air sévère. Voilà ce que j’appelle de la discipline… Le lavabo de Florence,… la très jolie fille incroyablement élégante qui est entrée en courant, a pris dans ses bras et embrassé tendrement la vieille femme et lui a offert des gâteaux tirés d’un sac en papier. Sa danseuse de fille ?… Le douillet petit lavabo parisien où la préposée vendait de la drogue – de quoi guérir un cœur blessé.
When I got upstairs the American and his friend had gone. 'It was something I remembered,' I told the waiter, and he looked at me blankly, not even bothering to laugh at me. His face was unsurprised, blank.
That was last night.
I lie awake, thinking about it, and about the money Sidonie lent me and the way she said: 'I can't bear to see you like this.' Half shutting her eyes and smiling the smile which means: 'She's getting to look old. She drinks.'
'We've known each other too long, Sasha,' she said, 'to stand on ceremony with each other.'
I had just come in from my little health stroll round Mecklenburgh Square and along the Gray's Inn Road. I had looked at this, I had looked at that, I had looked at the people passing in the street and at a shop window full of artificial limbs. I came in to somebody who said: 'I can't bear to see you looking like this.'
'Like what?' I said.
'I think you need a change. Why don't you go back to Paris for a bit?....You could get yourself some new clothes - you certainly need them....I'll lend you the money,' she said. 'I'll be over there next week and I could find a room for you if you like. 'Etcetera, etcetera.
I had not seen this woman for months and then she swooped down on me.... Well, here I am. When you've been made very cold and very sane you've also been made very passive. (Why worry, why worry?) I can't sleep. Rolling from side to side.... Was it in 1923 or 1924 that we lived round the corner, in the Rue Victor-Cousin, and Enno bought me that Cossack cap and the imitation astrakhan coat? It was then that I started calling myself Sasha. I thought it might change my luck if I changed my name. Did it bring me any luck, I wonder, calling myself Sasha?
Was it in 1926 or 1927?
I put the light on. The bottle of Evian on the bedtable, the tube of luminal, the two books, the clock ticking on the ledge, the red curtains....
I can see Sidonie carefully looking round for an hotel just like this one. She imagines that it's my atmosphere. God, it's an insult when you come to think about it! More dark rooms, more red curtains....
But one mustn't put everything on the same plane. That's her great phrase. And one mustn't put everybody on the same plane, either. Of course not. And this is my plane....Quatrieme a gauche, and mind you don't trip over the hole in the carpet. That's me.
There are some black specks on the wall. I stare at them, certain they are moving. Well, I ought to be able to ignore a few bugs by this time. 'II ne faut pas mettre tout sur le meme plan....'
I get up and look closely. Only splashes of dirt. It's not the time of year for bugs, anyway.
I take some more luminal, put the light out and sleep at once.
I am in the passage of a tube station in London. Many people are in front of me; many people are behind me. Everywhere there are placards printed in red letters: This Way to the Exhibition, This Way to the Exhibition. But I don't want the way to the exhibition -I want the way out. There are passages to the right and passages to the left, but no exit sign. Everywhere the fingers point and the placards read: This Way to the Exhibition.....I touch the shoulder of the man walking in front of me. I say: 'I want the way out.' But he points to the placards and his hand is made of steel. I walk along with my head bent, very ashamed, thinking: 'Just like me - always wanting to be different from other people.' The steel finger points along a long stone passage. This Way - This Way - This Way to the Exhibition....
Now a little man, bearded, with a snub nose, dressed in a long white nightshirt, is talking earnestly to me. 'I am your father,' he says. 'Remember that I am your father.' But blood is streaming from a wound in his forehead. 'Murder,' he shouts, 'murder, murder.' Helplessly I watch the blood streaming. At last my voice tears itself loose from my chest. I too shout: 'Murder, murder, help, help,' and the sound fills the room. I wake up and a man in the street outside is singing the waltz from Les Salim-banques. 'C'est I'amour qui flotte dans l'air a la ronde,' he sings....
Quand je suis remontée, l’Américain et son amie étaient partis.
— C’est un souvenir qui m’est revenu, ai-je dit au garçon, et il m’a regardé d’un œil atone, même pas assez intéressé pour se moquer de moi. Son visage était sans surprise, vague.
Cela c’était hier soir.
Couchée, je reste éveillée à y penser et à penser à l’argent que m’a prêté Sidonie et à la façon dont elle m’a dit : « Je ne peux pas supporter de te voir comme ça. » En fermant à demi les yeux et en souriant de ce sourire qui veut dire : elle commence à avoir l’air vieille. Elle boit.
« Nous nous connaissons depuis trop longtemps, Sasha, a-t-elle dit, pour faire des manières l’une avec l’autre. »
Je venais de rentrer de ma petite promenade hygiénique autour de Mecklenburgh Square et dans Gray’s Inn Road. J’avais regardé une chose, puis une autre, regardé les gens qui passaient dans la rue et une vitrine pleine de bras et de jambes artificiels.
En rentrant j’ai trouvé quelqu’un qui m’a dit : « Je ne peux pas supporter de te voir avec un air comme ça. »
« Comme quoi ? » ai-je dit.
« Je crois que tu as besoin de te changer les idées. Pourquoi ne retournes-tu pas un peu à Paris… Tu pourrais t’acheter de nouvelles robes – tu en as bien besoin… Je te prêterai l’argent nécessaire, disait-elle ; j’y vais la semaine prochaine et, si tu veux, je pourrai te trouver une chambre. » Etcetera, etcetera.
Cela faisait des mois que je n’avais pas vu cette femme et puis elle a fondu sur moi…
Alors, me voilà ! Quand on vous a rendue très froide et très lucide on a aussi fait de vous quelqu’un de très passif. (Pourquoi se tracasser, pourquoi se tracasser ?)
Je ne peux pas dormir. Rouler d’un côté à l’autre… Etait-ce en 1923 ou en 1924 que nous habitions à deux pas d’ici, rue Victor-Cousin, et qu’Enno m’a acheté cette toque de Cosaque et le manteau en faux astrakan ? C’est alors que j’ai commencé à me faire appeler Sasha. J’ai pensé que mon sort changerait peut-être si je changeais de nom. Cela m’a-t-il porté bonheur, je me demande, de me faire appeler Sasha ?
Etait-ce en 1926 ou en 1927 ?
J’allume la lumière. La bouteille d’Evian sur la table de nuit, le tube de gardénal, les deux livres sur le rebord, la pendulette qui tictaque, les rideaux rouges…
Je me représente Sidonie en train de chercher un hôtel exactement comme celui-ci. Elle s’imagine que c’est l’atmosphère qu’il me faut. Bon Dieu, c’est insultant quand on y pense. Encore des chambres sombres, encore des rideaux rouges…
Mais il ne faut pas tout mettre sur le même plan. C’est sa grande phrase. Et il ne faut pas mettre tout le monde sur le même plan, non plus. Bien entendu. Et voilà le mien… ‘ Quatrième à gauche ’ [Les mots placés entre guillemets (‘ ’) sont en français dans le texte (NdT.).] et gare à ne pas vous prendre le pied dans le trou, du tapis. Cela, c’est moi.
Il y a des petites taches noires sur le mur. Je les regarde fixement, certaine qu’elles remuent. Allons, je devrais pouvoir être indifférente à quelques punaises depuis le temps. ‘ Il ne faut pas mettre tout sur le même plan… ’
Je me lève pour regarder de près. De simples éclaboussures de saleté. Ce n’est pas la saison des punaises, d’ailleurs.
Je reprends du gardénal, j’éteins la lumière et je m’endors tout de suite.
Je suis dans le couloir d’une station de métro à Londres. Il y a beaucoup de gens devant moi, beaucoup de gens derrière moi. Partout des pancartes sur lesquelles on lit en lettres rouges : Par ici pour l’Exposition, Par ici pour l’Exposition. Mais ce n’est pas le chemin de l’Exposition que je cherche – je cherche la sortie. Il y a des couloirs à gauche et des couloirs à droite mais pas d’écriteau désignant la sortie. Partout des doigts se tendent et des pancartes indiquent : Par ici pour l’Exposition… Je touche l’épaule de l’homme qui marche devant moi. Je dis : « Je cherche la sortie. » Mais il montre du doigt les pancartes et sa main est en acier. Je poursuis ma route la tête baissée, pleine de honte, me disant : « C’est bien moi – il faut toujours que je ne sois pas comme les autres. » Le doigt d’acier est pointé vers un long couloir de pierre. Par ici – Par ici pour l’Exposition…
A présent un petit homme barbu, au nez retroussé, vêtu d’une longue chemise de nuit blanche me parle d’un ton convaincant : « Je suis ton père », dit-il. « Souviens-toi que je suis ton père. » Mais le sang coule à flots d’une blessure à son front. « A l’assassin », crie-t-il, « à l’assassin, à l’assassin. » Impuissante, je regarde couler le sang. Enfin ma voix s’arrache de ma poitrine. Moi aussi je crie : « A l’assassin, à l’assassin, au secours, au secours », et le son emplit la chambre. Je me réveille et dehors il y a un homme qui chante la valse des « Saltimbanques » : ‘ C’est l’amour qui flotte dans l’air à la ronde ’, chante-t-il.
J’ai l’impression qu’il fait beau, mais la chambre reçoit si peu de jour qu’on ne peut en être sûr. Dehors, sur le palier, on ne voit absolument rien quand la lumière n’est pas allumée. C’est un grand palier, encombré du matin au soir de balais, de seaux, de piles de draps sales et d’autres choses de ce genre – épaves des étages spectaculaires d’au-dessous.
L’homme qui a la chambre à côté de la mienne se pavane comme d’habitude dans sa robe de chambre blanche. Il traîne. On dirait le fantôme du palier. Je passe mon temps à tomber sur lui.
Il est maigre comme un squelette. Il a une figure d’oiseau, des yeux sombres, enfoncés, avec une drôle d’expression servile, insinuante, complice. Pourquoi faut-il qu’il me regarde comme ça ?… Il est toujours en robe de chambre – une bleue avec des pois noirs ou alors la fameuse blanche. Je ne puis l’imaginer en costume de ville.
— ‘ Bonjour. ’
Je marmonne :
— ‘ Bonjour. ’ – Je n’aime pas ce foutu type…
Quand j’arrive en bas le patron me dit qu’il veut voir mon passeport. Je n’ai pas mis le numéro du passeport sur la fiche, dit-il.
Le patron ressemble de façon frappante à un employé qu’il y avait autrefois au mont-de-piété de la rue de Rennes – celui qui vous regardait de travers et empochait vos affaires pour les faire estimer. Un poisson régnant en maître dans son bassin personnel, observant le monde extérieur d’un œil vitreux et incrédule ... (pour la traduction française, 1969, by Éditions Denoël)
"Bonjour minuit" est situé dans l'entre-deux-guerres, et son personnage principal, Sasha, la cinquantaine, retourne à Paris où elle a vécu jeune.Ce récit sombre, fragmenté et elliptique, glisse du présent au passé tout en explorant les limites paradoxales d'une femme qui a cherché à se libérer des conventions. Alors que Sasha tente de retrouver ses marques parmi les lieux célèbres dela ville, le lecteur est inondé des souvenirs doux-amers de sa jeunesse. On apprendra comment elle a échappé aux contraintes de la classe populaire londonienne en épousant Enno, jeune homme aux penchants artistiques, et en le suivant sur le continent. Le peu d'empressement que met celui-ci à la protéger de contraintes économiques et sociales dégradantes fait comprendre à cette dernière le peu de valeur que lui accorde la société. Au fil du roman, nous pénétrons plus profondément dans le passé de Sasha, pour découvrir les événements traumatisants -la mort de son enfant en bas âge et l'abandon de son mari- qui ont poussé même la société non-conventionnelle à la rejeter. Le déclin rapide et poignant de Sasha, son alcoolisme et sa dérive d'un emploi à I'autre semblent tous valoriser avant tout la jeunesse et la beauté féminine, ce qui constitue une continuité entre le passé et le présent. À la fin du roman, elle acceptera à contrecœur I'inévitable et dure réalité de la pauvreté et de l'âge qui l'ont rendue encore plus vulnérable ...
"Wide Sargasso Sea" (La Prise des Macalous) comme chef-d'œuvre absolu ...
Ce roman, publié en 1966 après des années d'oubli, a radicalement changé la perception de son œuvre. En écrivant l'histoire d'Antoinette Cosway (la "folle du grenier" de Jane Eyre de Charlotte Brontë), Rhys a accompli l'un des actes de "writing back" (réécriture) les plus célèbres de l'histoire littéraire. Elle a
- donné une voix, une histoire et une humanité à un personnage silencieux et monstrueux de la littérature canonique.
- déstructuré le point de vue colonial et patriarcal du roman victorien.
- et installé la figure de la "femme folle" non plus comme un élément de décor gothique, mais comme une victime tragique de l'oppression raciale et masculine.
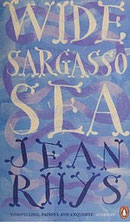
"Wide Sargasso Sea" (1966)
Antoinette Cosway, la première Mme Rochester, est la folle du grenier de Thornfield Hall qui hante Jane Eyre de Charlotte Brontë. Wide Sargasso Sea se déroule en Jamaïque dans les années 1830. Antoinette nous raconte son enfance sur l'île luxuriante, avec ses superstitions et son héritage colonial troublé et, planant sur sa famille, une expression de la décadence de la communauté blanche, la folie. Antoinette est une héritière et est mariée à Rochester dès son arrivée en Jamaïque. Fragile et mal aimée, elle n'a pas grand-chose pour le séduire, si ce n'est les sortilèges et la magie de l'île. Les mots cadencés que Rhys utilise, respirant les vents et les odeurs des îles, ont une force séduisante et langoureuse qui expose cruellement l'échec d'Antoinette. Mais la première Mrs Rochester n'est rien d'autre qu'un point de départ imaginatif permettant à Jean Rhys d'impliquer des significations plus larges.
Dans tous ses romans, elle est la grande chroniqueuse de ceux qui ne sont pas protégés. Ici, dans une prose onirique et exquise, elle recrée une expérience de la folie qui est l'une des plus touchantes de la littérature. Le destin d'Antoinette résonne, il est symbolique. Car Rochester ne pourra jamais découvrir les secrets des îles ; Rhys révèle qu'il s'agit des forces qui sommeillent dans les faibles, qui flottent, ignorées sous les tyrannies politiques, raciales et sexuelles des forts....
Part One
They say when trouble come close ranks, and so the white people did. But we were not in their ranks. The Jamaican ladies had never approved of my mother, ‘because she pretty like pretty self’ Christophine said.
She was my father’s second wife, far too young for him they thought, and, worse still, a Martinique girl. When I asked her why so few people came to see us, she told me that the road from Spanish Town to Coulibri Estate where we lived was very bad and that road repairing was now a thing of the past. (My father, visitors, horses, feeling safe in bed – all belonged to the past.)
Another day I heard her talking to Mr Luttrell, our neighbour and her only friend. ‘Of course they have their own misfortunes. Still waiting for this compensation the English promised when the Emancipation Act was passed. Some will wait for a long time.’
How could she know that Mr Luttrell would be the first who grew tired of waiting? One calm evening he shot his dog, swam out to sea and was gone for always. No agent came from England to look after his property – Nelson’s Rest it was called – and strangers from Spanish Town rode up to gossip and discuss the tragedy.
‘Live at Nelson’s Rest? Not for love or money. An unlucky place.’
Mr Luttrell’s ho was left empty, shutters banging in the wind. Soon the black people said it was haunted, they wouldn’t go near it. And no one came near us.
I got used to a solitary life, but my mother still planned and hoped – perhaps she had to hope every time she passed a looking glass.
She still rode about every morning not caring that the black people stood about in groups to jeer at her, especially after her riding clothes grew shabby (they notice clothes, they know about money).
Then, one day, very early I saw her horse lying down under the frangipani tree. I went up to him but he was not sick, he was dead and his eyes were black with flies. I ran away and did not speak of it for I thought if I told no one it might not be true. But later that day, Godfrey found him, he had been poisoned. ‘Now we are marooned,’ my mother said, ‘now what will become of us?’
Godfrey said, ‘I can’t watch the horse night and day. I too old now. When the old time go, let it go. No use to grab at it. The Lord make no distinction between black and white, black and white the same for Him. Rest yourself in peace for the righteous are not forsaken.’ But she couldn’t. She was young. How could she not try for all the things that had gone so suddenly, so without warning. ‘You’re blind when you want to be blind,’ she said ferociously, ‘and you’re deaf when you want to be deaf. The old hypocrite,’ she kept saying. ‘He knew what they were going to do.’ ‘The devil prince of this world,’ Godfrey said, ‘but this world don’t last so long for mortal man.’...
"Quand surviennent les ennuis, il faut serrer les rangs, dit-on, et c’est ce que font les Blancs. Mais nous n’étions pas dans leurs rangs. Ma mère n’avait jamais plu aux dames de la Jamaïque, « parce qu’elle, jolie, jolie personne comme tout », disait Christophine.
Ma mère était la seconde femme de mon père, bien trop jeune pour lui, pensaient-elles, et, qui pis est, Martiniquaise. Quand je lui demandais pourquoi si peu de personnes venaient nous voir, elle me répondait que la route de Spanish Town au domaine Coulibri, où nous demeurions, était très mauvaise et que le projet de la réparer était maintenant chose du passé. (Mon père, les visiteurs, les chevaux, être en sûreté dans son lit – tout cela appartenait au passé.)
Un autre jour, je l’entendis parler à M. Luttrell, notre voisin et son seul ami. « Ils ont, bien entendu, leurs propres infortunes. Ils en sont encore à attendre l’indemnité promise par les Anglais quand on a passé la loi sur l’Affranchissement. Il y en a qui attendront longtemps ! »
Comment aurait-elle pu savoir que M. Luttrell serait le premier à se lasser d’attendre ? Par une calme soirée, il tua son chien d’un coup de feu, gagna à la nage la haute mer et disparut à jamais. Aucun régisseur ne vint d’Angleterre s’occuper de sa propriété – Nelson’s Rest, elle s’appelait – et des inconnus venaient à cheval de Spanish Town en curieux pour parler de la tragédie et cancaner.
« Habiter Nelson’s Rest ? Pour rien au monde ! Une demeure qui porte malheur ! »
La maison de M. Luttrell resta vide, les volets claquant au vent. Les Noirs ne tardèrent pas à dire qu’elle était hantée, ils ne voulaient pas s’en approcher. Et personne ne vint dans notre voisinage.
Je m’habituai à une vie solitaire, mais ma mère continua à tirer des plans sur la comète et à espérer – peut-être qu’il lui fallait absolument espérer chaque fois qu’elle passait devant un miroir.
Elle continuait à monter à cheval chaque matin, sans tenir compte du fait que les Noirs restaient à la regarder et s’attroupaient pour se moquer d’elle, surtout lorsque son costume de cheval fut devenu tout râpé (ils remarquent les vêtements, ils s’y connaissent, question argent).
Puis un jour, de très bonne heure, je vis son cheval couché sous le frangipanier. Je m’avançai vers lui, mais il n’était pas malade, il était mort et ses yeux étaient noirs de mouches. Je m’enfuis en courant et n’en parlai pas, car il me sembla que si je ne le disais à personne, peut-être que ça ne serait pas vrai. Mais un peu plus tard, ce jour-là, Godfrey le découvrit ; il avait été empoisonné. « Nous voilà comme isolés sur une île déserte, dit ma mère. Qu’allons-nous devenir maintenant ? »
Godfrey lui dit : « J’peux pas surveiller le cheval nuit et jour. Moi trop vieux maintenant. Quand le bon vieux temps s’en va, laisse-le s’en va. Ça sert à rien se cramponner ! Le Seigneur faire pas différence entre Noirs et Blancs ; Noirs et Blancs, même chose pour lui. Reposez en paix, car les justes seront pas abandonnés. » Mais elle ne pouvait pas. Elle était jeune. Comment n’aurait-elle pas cherché à ravoir toutes les choses qui avaient disparu si brusquement, sans crier gare. « Tu es aveugle quand tu veux l’être », lui dit-elle d’un ton féroce, « et tu es sourd quand tu veux l’être ! » « Le vieil hypocrite ! » ne cessait-elle de dire. « Il savait ce qu’ils allaient faire ! »
« Le diable, lui prince de ce monde », dit Godfrey, « mais ce monde pas durer bien longtemps pour l’homme mortel ».
Elle décida un médecin de Spanish Town à venir voir Pierre, mon jeune frère, qui chancelait en marchant et n’arrivait pas à parler distinctement. Je ne sais pas ce que le docteur lui dit ni ce qu’elle dit au docteur, mais il ne revint jamais, et après cela elle changea. Tout d’un coup, non peu à peu. Elle maigrit et devint silencieuse, et finalement elle ne voulut plus quitter la maison du tout.
Notre jardin était grand et beau comme celui dont il est question dans la Bible – où croissait l’arbre de vie. Mais il était devenu sauvage. Les sentiers étaient envahis par l’herbe et une odeur de fleurs mortes se mêlait à la senteur vivante et fraîche. Sous les fougères arborescentes, aussi hautes que celles de la forêt, la lumière était verte. Les orchidées fleurissaient hors d’atteinte ou, pour telle ou telle raison, il ne fallait pas les toucher. L’une d’elles avait l’aspect d’un serpent, une autre ressemblait à une pieuvre, avec ses longs et minces tentacules bruns sans feuilles, pendant d’une racine torse. Deux fois par an, cette orchidée fleurissait – et alors on ne voyait plus un pouce de tentacule. C’était une masse de blanc, de mauve, de violets foncés, admirable à voir. Son parfum était très suave et très fort. Je ne m’en approchais jamais.
Le domaine Coulibri tout entier était retourné à l’état sauvage comme le jardin, était redevenu brousse. L’esclavage n’existait plus – pourquoi qui que ce soit devrait-il travailler ? Je n’en ai jamais été attristée. Je ne me souvenais pas du domaine à l’époque de sa prospérité.
Ma mère avait l’habitude de se promener de long en large sur le glacis, terrasse dallée et recouverte d’un toit, qui courait tout le long de la maison et montait en pente jusqu’à un bouquet de bambous. En se tenant debout près des bambous, elle jouissait d’une vue dégagée sur la mer, mais tout passant pouvait la dévisager. Ils la regardaient effrontément, parfois riaient. Longtemps après que le son de ce rire s’était éloigné, puis éteint, elle gardait les yeux fermés et les mains crispées. Un pli se formait entre ses sourcils noirs, un pli profond – on aurait dit qu’il était taillé au couteau. Je détestais ce pli et, une fois, j’ai touché son front pour essayer de le rendre lisse. Mais elle m’a repoussée, pas brutalement, mais calmement, froidement, sans un mot, comme si elle avait décidé une fois pour toutes que je ne lui étais bonne à rien. Elle voulait rester assise avec Pierre ou se promener où bon lui semblait sans être importunée ; elle voulait la paix et la tranquillité. J’étais assez grande pour prendre soin de moi-même. « Oh ! Laisse-moi tranquille », disait-elle, « laisse-moi tranquille ! » Et une fois que j’eus remarqué qu’elle se parlait tout haut à elle-même, j’eus un peu peur d’elle.
Aussi passais-je le plus clair de mon temps dans la cuisine qui se trouvait dans un bâtiment extérieur, à quelque distance. Christophine dormait dans la petite chambre contiguë à la cuisine.
Quand venait le soir, elle me chantait quelque chose, si elle était d’humeur à cela. Il ne m’était pas toujours possible de comprendre ses chansons en patois – elle aussi venait de la Martinique – mais elle m’apprit celle qui dit : « Les petits grandissent, les enfants nous quittent, reviendront-ils ? » et celle sur les fleurs du cèdre qui ne durent qu’un jour.
La musique en était gaie, mais les paroles tristes, et sa voix souvent chevrotait et se brisait sur la note haute. « Adieu ! » Non adieu comme nous le disons, mais à Dieu, ce qui avait davantage de sens, somme toute. L’amoureux était solitaire, la jeune fille était abandonnée, les enfants ne revenaient jamais. Adieu !
Ses chansons ne ressemblaient pas aux chansons jamaïquaines, et elle ne ressemblait pas aux autres femmes.
Elle était beaucoup plus noire – d’un noir bleu, avec un visage maigre aux traits réguliers. Elle portait une robe noire, de lourdes boucles d’oreilles en or et un mouchoir de tête jaune – noué avec soin, les deux hautes pointes sur le devant. Aucune autre négresse ne portait du noir, ni ne nouait son mouchoir à la mode martiniquaise. Elle avait une voix calme et un rire calme (quand il lui arrivait de rire), et bien qu’elle fût capable de parler en bon anglais, si elle le voulait, et en français aussi bien qu’en patois, elle avait soin de parler comme les autres négresses. Mais celles-ci ne voulaient rien avoir à faire avec elle et elle ne voyait jamais son fils qui travaillait à Spanish Town. Elle n’avait qu’une amie, une femme nommée Maillotte, et Maillotte n’était pas jamaïquaine.
Les filles des bords de la baie qui lui donnaient parfois un coup de main pour la lessive et le nettoyage avaient une peur bleue de Christophine. Je ne tardai pas à découvrir que c’était ce qui les faisait venir – car elle ne les payait jamais. Cependant, elles apportaient des fruits et des légumes en cadeau et, après la tombée de la nuit, j’entendais souvent un bruit de chuchotements qui venait de la cuisine. C’est ainsi que je fus amenée à poser des questions sur Christophine. Était-elle très âgée ? Avait-elle toujours été avec nous ?
— Elle a été le cadeau de mariage que ton père m’a fait – l’un de ses cadeaux. Il a pensé qu’une Martiniquaise me ferait plaisir ..."
(La prisonnière des Sargasses, traduit de l’anglais par Yvonne Davet, Gallimard)
Le roman, commencé en 1957, ne fut publié qu'en 1966, vingt-sept ans après ses quatre premiers romans, au bout d'un long et pénible travail de remaniement. À son origine, se trouve le désir de l'auteur de donner à son lecteur une autre image d`un personnage du roman de Charlotte Brontë, "Jane Eyre" (1847). Il s'agit de la première femme de M. Rochester que son époux garde enfermée dans une chambre secrète, et qui finit par apparaître au grand jour lorsque celui-ci, sur le point d'épouser June, est forcé d'avouer qu'il est déjà marié, mais à une démente ramenée des îles, qui n'est plus qu'un animal. À la fin du roman, elle meurt après avoir mis le feu à Thomfield Hall, ce qui permet le mariage de Jane et de Rochester. Reprenant des éléments du récit de Rochester, Jean Rhys voulait recréer l'atmosphère de sa propre jeunesse à la Dominique, et présenter la créole comme une victime fascinée et persécutée par son mari, symbolisant la condition féminine. Hésitant au départ entre un récit à la première personne par la gardienne de la folle, par Rochester, ou par la victime elle-même, Jean Rhys finit par réécrire le roman en forme de triptyque.
Dans une première partie, l'héroïne, Antoinette Cosway raconte son enfance à Roseau, dans l'île de la Dominique, l'incendie de la maison par les Noirs, la mort de son jeune frère et la folie consécutive de sa mère. Elevée alors dans un couvent, Antoinette sera finalement mariée à un Anglais venu chercher fortune aux Antilles.
Dans une deuxième partie, ce dernier - jamais nommé, mais en qui le lecteur reconnait facilement le Rochester de Jane Eyre - raconte les premiers temps de son mariage et la rapide dégradation de ses rapports avec Antoinette. Mal à l`aise dans ce pays exotique qu'íl ne comprend pas, victime lui aussi de ce mariage voulu pour des raisons financières par son père, il oscille entre l'amour et la haine pour une femme, chez qui il voit les signes d'une folie héréditaire.
La troisième et dernière partie donne la parole de nouveau à Antoinette, alors enfermée en Angleterre. et qui ne distingue plus la réalité du rêve, ou du cauchemar. Le roman se termine par l`incendie de la demeure, déjà vécu en rêve par l'héroïne, et familier aux lecteurs de "Jane Eyre".
"La Prisonnière des Sargasses" est un bel un exemple d'intertextualité, où des éléments du roman de Charlotte Brontë se fondent dans un nouveau récit ; Jean Rhys s'est intimement approprié le premier texte pour le transformer et y faire entendre sa voix personnelle, poignante et inimitable. La description de la végétation luxuriante de l'île, et l'évocation de
l'enfance d'Antoinette dans une maison créole à moitié à l'abandon, son amour pour sa gouvernante noire Christophine, et ses tentatives désespérées pour se faire une amie de la petite indigène Tia qui la méprise rappellent les souvenirs personnels de l'auteur décrits dans son "Voyage dans les ténèbres". Mais ils sont ici parfaitement transposés et s`intègrent dans l'œuvre de fiction : on le considère comme le meilleur roman de Jean Rhys.(- Trad. Denoël, 1971).
"... Sous les lauriers-roses… Je contemplais les montagnes cachées et les brumes voilant leurs pentes. Il fait frais aujourd’hui ; un temps frais, calme et nuageux comme un été anglais. Mais l’endroit est beau par n’importe quel temps ; si loin que je voyage, je n’en verrai jamais un plus beau.
Les mois des ouragans ne sont plus tellement éloignés, je crois, et je vois cet arbre, là, enfoncer ses racines plus profondément, se préparant à lutter contre le vent. En vain. Quand vient l’ouragan, s’il vient, c’en est fait de tous ces arbres. Quelques-uns des palmiers royaux tiennent bon (à ce qu’elle dit). Dépouillés de leurs branches, tels de hauts piliers bruns, mais qui tiennent bon – avec un air de défi. Ce n’est pas pour rien qu’on les appelle royaux. Les bambous adoptent une voie plus facile, ils se courbent jusqu’à terre et demeurent ainsi, craquant, gémissant, criant grâce. Le vent dédaigneux passe, sans se soucier de ces choses déchues. (Qu’elles vivent !) Hurlant, poussant des clameurs aiguës, riant, la rafale de vent passe.
Mais tout cela, ce n’est que dans quelques mois. À présent, c’est un été anglais, si frais, si gris. N’empêche que je songe à ma vengeance et aux ouragans. Des mots me traversent l’esprit à toute vitesse (des actes aussi). Des mots. Pitié est l’un d’eux. Il ne me laisse pas de repos.
La pitié, tel un nouveau-né nu à califourchon sur la rafale.
J’ai lu cela il y a longtemps, quand j’étais jeune – je déteste les poètes maintenant, et la poésie. Comme je déteste la musique que j’aimais autrefois. Tu peux chanter tes chansons, Rupert le Rhénan, je n’écouterai pas, bien qu’on me dise que tu as une voix mélodieuse…
La pitié. N’y en a-t-il donc pas pour moi ? Lié pour la vie à une folle – à une folle ivrogne et menteuse – qui a pris le même chemin que sa mère.
« Elle vous aime tant, tant ! Elle a soif de vous. Aimez-la un peu, comme elle dit. C’est comme vous êtes seulement capable d’aimer – un peu ! »
Ricane jusqu’à la fin, Démon. Crois-tu que je ne sache pas ? Elle a soif de n’importe quel homme – pas de moi…
Elle dénoue ses cheveux noirs, et elle rit et enjôle et flatte (une folle ! Peu lui importe avec qui elle fait l’amour). Elle pousse des gémissements et pleure et se donne comme aucune femme saine d’esprit ne le ferait – ni ne le pourrait. Ni ne le pourrait. Puis repose absolument immobile, immobile comme ce temps couvert. Une folle qui sait toujours quelle heure il est. Mais qui ne fait jamais rien.
Jusqu’au jour où elle se soûle à mort. Elle a fait si souvent des siennes que le pire voyou hausse les épaules et se gausse d’elle. Et je dois reconnaître ça – moi ? Non, je lui garde un chien de ma chienne !
« Elle vous aime tant, tant ! Essayez-la encore une fois. »
Je vous dis qu’elle n’aime personne en particulier, qu’elle aime le premier venu. Je ne pourrais plus la toucher. Sauf de la manière dont l’ouragan touchera cet arbre – et le brisera. Vous dites que je l’ai déjà fait ? Non. Cela, c’étaient les jeux forcenés de l’amour. Mais maintenant je le ferai.
Elle ne rira plus, baignée de soleil. Elle ne s’habillera plus en se souriant à elle-même dans ce détestable miroir. Si contente, si satisfaite !
Vaniteuse et sotte créature ! Faite pour l’amour ? Oui, mais elle n’aura plus d’amant, car je ne veux pas d’elle et elle n’en verra aucun autre.
L’arbre frémit. Frémit et rassemble toutes ses forces. Et attend.
(Il souffle maintenant un vent frais – un vent froid. Porte-t-il le bébé né pour chevaucher la rafale des ouragans ?)
Elle a dit qu’elle aimait cet endroit. Elle ne le reverra pas. Je l’épierai, dans l’attente d’une seule larme, d’une seule larme humaine. Pas ce visage fermé, haineux, hébété. J’écouterai… Si elle dit au revoir, peut-être adieu. – comme dans ces chansons d’autrefois qu’elle chantait. Toujours adieu (et toutes ces chansons le disent). Si elle aussi le dit, ou si elle pleure, je la prendrai dans mes bras, ma démente. Elle est folle, mais elle est mienne, mienne. Que m’importent les dieux ou les démons, ou le Destin lui-même ! Si elle sourit ou pleure, ou fait les deux. Pour moi.
Antoinette – je peux être doux aussi. Cache ton visage. Cache-toi, mais dans mes bras. Tu verras vite combien je suis doux. Ma démente ! Ma folle !
Pour t’aider, voici un jour nuageux. Pas de soleil d’airain.
Pas de soleil… Pas de soleil. Le temps a changé.
Baptiste attendit et les chevaux étaient sellés. Le jeune valet d’écurie se tenait debout près du giroflier, le panier qu’il devait porter posé à côté de lui. Ces paniers sont légers et imperméables. J’avais décidé d’en utiliser un pour les quelques vêtements nécessaires – la plupart de nos affaires devaient suivre dans un jour ou deux. Une voiture nous attendrait à Massacre. J’avais eu l’œil à tout, j’avais tout organisé.
Elle était là dans l’apouja ; habillée avec soin pour le voyage, remarquai-je, mais le visage vide, sans expression du tout. Des larmes ? Il n’y avait pas une seule larme en elle. Bon, nous verrons bien. Se souvenait-elle de quoi que ce fût me demandai-je, éprouvait-elle un quelconque sentiment ? (Ce nuage bleu, cette ombre, c’est la Martinique. Elle est nettement visible en ce moment… Ou des noms des montagnes. Non, pas montagne. Morne, dirait-elle. Montagne est un vilain mot – pour eux. Ou des histoires de Jean l’Espagnol. Du temps jadis. Et quand elle a dit : « Regardez ! La Chute d’Émeraude ! Ça porte bonheur ! « Oui, durant un moment, le ciel fut vert – un coucher de soleil d’un vert éclatant. Bizarre ! Mais pas moitié aussi bizarre que l’idée de dire que ça porte bonheur !)
Après tout, je m’attendais à sa totale indifférence. Je savais que mes rêves étaient des rêves. Mais la tristesse que je ressentis en regardant la maison blanche délabrée – je ne m’y attendais pas. Plus que jamais auparavant, elle paraissait faire tous ses efforts pour se tenir à distance de la noire forêt serpentine. Plus fort et plus désespérément que jamais, elle criait au secours : Sauvez-moi de la destruction, de la ruine et de la désolation ! Sauvez-moi de la longue mort lente par les termites ! – Mais que fait ici une « folie » comme vous ? Si près, de la forêt ? Ne savez-vous pas que c’est un lieu dangereux ? Et que toujours la sombre forêt l’emporte ? Toujours. Si vous ne le savez pas, vous ne tarderez pas à l’apprendre, et je ne puis rien pour vous secourir.
Baptiste paraissait très différent. Il ne restait plus trace en lui du domestique poli. Il portait un chapeau de paille à très larges bords, comme ceux des pêcheurs, mais à la calotte plate, pas haute ni pointue comme les leurs. Sa large ceinture de cuir reluisait, ainsi que le manche de son couteau de chasse engainé ; sa chemise de coton bleu et son pantalon étaient d’une propreté irréprochable. Le chapeau, je le savais, était imperméable. Baptiste était paré contre la pluie et celle-ci était certainement en route.
Je lui dis que j’aimerais dire au revoir à la fillette qui riait toujours – à Hilda. « Hilda n’est plus ici », répondit-il dans son anglais soigné. « Hilda est partie – hier. »
Il parlait avec suffisamment de politesse, mais je sentais son aversion et son dédain. Le même dédain que celui de cette diablesse quand elle m’avait dit : « Goûtez mon sang de taureau ! » Sous-entendant : Cela fera de vous un homme. Peut-être ! Mais ce que je peux m’en ficher, de ce qu’ils pensent de moi ! Quant à Antoinette, je l’avais pour le moment oubliée. Aussi je ne comprendrai jamais pourquoi, de façon soudaine, déroutante, je fus certain que tout ce que je m’étais figuré être la vérité était faux. Faux ! Seuls la magie et le rêve sont vrais – tout le reste est mensonge. Passons ! C’est ici qu’est le secret. Ici.
(Mais il est perdu, ce secret, et ceux qui le connaissent ne peuvent pas le révéler.)
Non, pas perdu. Je l’avais découvert dans un lieu caché et je l’avais gardé, je m’y étais cramponné. Comme je m’étais cramponné à Antoinette.
Je la regardai. Elle avait le regard perdu au loin, sur la mer. Elle était le silence incarné...."
(La prisonnière des Sargasses, traduit de l’anglais par Yvonne Davet, Gallimard)
"La Prisonnière des Sargasses" constitue donc la réponse littéraire de Jean Rhys au roman de Charlotte Brontë, "Jane Eyre", et l'auteur prend pour point de départ la description animale et sexualisée que fait Charlotte Brontë de Bertha Mason, la première femme d'Edward Rochester, dangereusement folle. En récrivant ce classique, Jean Rhys donne la parole à Antoinette (Bertha est le nom que lui a imposé son mari), et explore les peurs et désirs qui ont dominé les relations des Caraïbes et de l'Europe.
Le roman est divisé, nous l'avons vu, en trois parties,
- dans la première, Antoinette fait le récit de son enfance malheureuse;
- dans la deuxième, Rochester décrit son premier mariage;
- dans la troisième, on découvre les rêves et pensées d'Antoinette une fois qu'elle est emprisonnée en Angleterre.
Cette structure permet à Jean Rhys d'établir des liens explicites entre Jane Eyre et l'histoire coloniale. L'auteur place ainsi "La Prisonnière des Sargasses" dans le contexte de la fin de l'esclavage dans les Caraïbes et Antoinette - dont la mère était martiniquaise - à équidistance des communautés européennes et noires. Sa vulnérabilité sociale est utilisée par Jean Rhys afin d'explorer les relations coloniales de désir et d'identité, auxquelles Charlotte Brontë ne pouvait que faire allusion.
Le mariage arrangé d'Antoinette et Rochester est parcouru d'énergie sexuelle et pourtant instable à cause de l'incompréhension et de la méfiance dont font preuve les deux époux. Dans ce récit parallèle, Antoinette est la victime d'un moment historique complexe ...
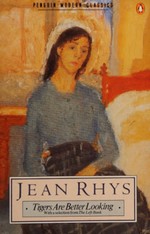
"Tigers Are Better Looking" (1968)
Publié juste après le immense succès de "Wide Sargasso Sea" (1966), ce recueil a permis aux lecteurs de redécouvrir la puissance de ses nouvelles, qui étaient jusque-là largement oubliées. Il a consolidé sa réputation. Bien qu'écrites sur plusieurs décennies, ces nouvelles forment un tout cohérent. Qu'elles se déroulent sous le soleil des Antilles ou dans les brumes de Paris, elles parlent toujours de l'exil, de la recherche d'une identité et de la lutte des femmes pour préserver leur dignité dans un monde hostile. On y retrouve la marque de fabrique de Rhys, une prose apparemment simple, dépouillée, mais d'une précision chirurgicale pour capturer les émotions complexes, la honte, la vulnérabilité et les petites cruautés de la vie quotidienne.
(traduction française, Mercure de France, 1981, "Rive gauche", L'Imaginaire, Gallimard)
« La main gauche est moins habile que la droite ; et chaque ville possède sa rive gauche. Londres, autour de Bloomsbury ; New York, autour de Greenwich Village ; Vienne, également (bien que Vienne se soit quelque peu délabrée, depuis la chute de l’Empire austro-hongrois, au détriment de la civilisation européenne !). Je ne crois pas que Jean Rhys ait vécu à Greenwich Village, mais elle a retrouvé beaucoup de cette vie sur la rive gauche de la Seine – elle peut donc affirmer qu’elle l’a connue. Arrivant des Antilles, douée d’une terrifiante intuition, et d’une passion exagérée, presque maladive, pour tous les marginaux du monde, elle a laissé courir sa plume le long de toutes les rives gauches du vieux continent. Le long de ses mansardes, de ses salons, de ses cafés, s’attardant sur ses assassins et ses midinettes – avec une sorte de prédilection admirative pour les midinettes, et une pointe évidente de tendresse pour tous ceux qui se sont mis hors-la-loi […] » (Ford Madox Ford, 1927).
1. Les Nouvelles Caribéennes : La Nostalgie et le Choc Colonial
Ces histoires, souvent considérées comme les plus fortes du recueil, plongent aux racines de l'identité de Rhys.
- « The Day They Burned the Books » (Le Jour où elles brûlèrent les livres)
Narrée par une enfant, cette nouvelle raconte l'amitié complexe entre elle et un garçon mulâtre, Eddie, fils d'un colon anglais brutal et d'une mère antillaise. À la mort du père, la mère, dans un acte de rage libératrice, brûle la bibliothèque de son mari, symbole de la culture coloniale oppressive. Eddie parvient à sauver un livre, qu'il offre à la narratrice.
Une nouvelle fondatrice sur le thème de l'identité culturelle coloniale. La bibliothèque représente le canon littéraire anglais imposé, à la fois désiré et haï. Son autodafé est un acte de révolte postcoloniale avant l'heure. La relation entre les deux enfants illustre les clivages raciaux et sociaux complexes des Antilles.
- « Again the Antilles » (Encore les Antilles)
Un monologue intérieur d'une femme blanche créole, observant la vie autour d'elle sur une île des Antilles. Elle décrit avec un mélange de cynisme et de tendresse les autres résidents blancs, les serviteurs, et l'atmosphère étouffante et belle à la fois.
Un portrait saisissant de l'aliénation de la Créole blanche. La narratrice est une observatrice détachée, qui ne se sent chez elle nulle part. Le style est impressionniste, capturant la chaleur, la lumière et l'ennui qui ronge la petite communauté coloniale.
- « Mixing Cocktails » (Préparer les cocktails)
Une évocation de l'enfance de la narratrice dans les Antilles, centrée sur son père et l'atmosphère de la maison familiale. Elle décrit les rituels sociaux, comme la préparation des cocktails, et les tensions sous-jacentes.
Comme un prélude à son autobiographie "Smile Please", cette nouvelle capture les premiers émois de la conscience et la perception des adultes comme des êtres étranges et parfois menaçants. C'est une plongée dans la mémoire sensorielle de l'enfance créole.
2. Les Nouvelles d'Exil en Europe, la précarité féminine
Ces histoires se déroulent à Paris ou à Londres et mettent en scène les héroïnes typiques de Rhys : jeunes, seules, vulnérables et en lutte pour leur survie...
- « Mannequin »
Anna, une jeune femme sans le sou, travaille comme mannequin pour une maison de couture parisienne. Elle observe le monde cruel et superficiel de la mode, les autres mannequins, les clients riches, et les hommes qui voient en elles des objets de désir.
Une critique acerbe de l'exploitation économique et sexuelle des femmes. Le titre est ironique : les mannequins sont des poupées sans vie, et le récit montre comment le système réduit ces jeunes femmes à l'état d'objets. Anna incarne la conscience qui résiste à cette déshumanisation.
- « Vienne » est une nouvelle courte, un pur joyau d'atmosphère et de désillusion. Le récit, fragmentaire et subjectif, est porté par la voix d'une jeune femme qui se trouve à Vienne dans les années d'après-guerre (probablement après la Première Guerre mondiale). Elle ne livre pas une histoire linéaire, mais une série d'impressions, de scènes observées et de sentiments éprouvés.
Elle décrit la ville comme un lieu de plaisir factice et désespéré, où l'on danse pour oublier la faim et la défaite. Elle croise des officiers élégants mais ruinés, des femmes cherchant désespérément à se marier, et une atmosphère générale de cynisme et de décadence. La narratrice elle-même est une observatrice détachée, une étrangère qui flotte en marge de cette frénésie. Elle a une relation avec un homme, mais celle-ci semble vide de sens, teintée de mélancolie et d'un profond sentiment d'aliénation. La nouvelle se clôt sur une image de la ville la nuit, belle et vaine, alors que la narratrice s'en éloigne, laissant derrière elle ce "bal masqué".
- « A Solid House » (Une Maison Solide)
Une femme, Teresa, sort d'une longue maladie et tente de se réadapter au monde. Elle se rend dans une maison amie, mais se sent déconnectée, fragile et incapable de supporter la banalité des conversations.
La convalescence psychologique et le sentiment de ne plus appartenir au monde des "gens normaux". La "maison solide" représente une normalité et une stabilité qui sont devenues étrangères et hostiles pour l'héroïne.
- « Tea With an Artist » (Thé avec un artiste)
La nouvelle est narrée par une jeune femme anglaise, sans le sou, qui vit une existence précaire à Paris. Elle est engagée comme modèle par un peintre anglais excentrique et misanthrope, Mr. Lawson, qui vit reclus dans son atelier avec sa femme, également artiste. L'histoire décrit plusieurs séances de pose, ponctuées par le rituel du thé, où les relations tendues et complexes entre le couple et le modèle se dévoilent. Mr. Lawson est cynique, brutal dans ses propos, et semble mépriser le monde entier, y compris son modèle. La narratrice, elle, observe la scène avec une distance à la fois amusée et lucide, notant la poussière, le désordre et l'atmosphère de délabrement qui règne dans l'atelier.
- « Hunger » (Faim)
Le portrait d'une jeune femme dans une chambre misérable, confrontée à la faim, au froid et à la solitude la plus absolue.
Un récit court et brutal sur la précarité matérielle et existentielle. Rhys y décrit avec une simplicité terrifiante la physicalité de la misère, un thème qu'elle maîtrise parfaitement pour l'avoir vécu.
- « The Sound of the River » (Le Bruit de la Rivière)
Une femme seule dans une chambre d'hôtel parisienne, proche de la Seine, est submergée par le bruit du fleuve et par les souvenirs d'une relation amoureuse douloureuse et d'un avortement.
Un chef-d'œuvre de la subjectivité. Le bruit de la rivière devient une métaphore du flux de la conscience, de la mémoire et du désespoir. C'est une plongée dans un état mental à vif, où le passé et le présent se confondent, illustrant le style "moderne" et intérieur de Rhys.
"Une ampoule pendait du plafond, mais comme le fil était trop court elle ne donnait pas assez de lumière pour lire. Alors, ils étaient allongés dans le lit et ils parlaient. L’air de la nuit entrait par la fenêtre ouverte – un air humide et doux, qui faisait bouger les rideaux.
— Effrayée par quoi ? Que veux-tu dire exactement par : effrayée ?
Elle répondit :
— C’est comme quand on veut avaler et qu’on ne peut pas.
— Tout le temps ?
— Presque tout le temps.
— Ma chérie, vraiment. Tu es stupide.
— Je sais, oui.
« Mais pas pour ça, pensa-t-elle, non, pas pour ça. »
— C’est une simple question d’humeur, reprit-elle, rien d’autre. Ça va passer.
— Tu es vraiment inconséquente. C’est toi qui as découvert cet endroit, qui as voulu y habiter. J’ai cru qu’il te plaisait.
— Il me plaît. J’aime la lande, et la solitude, et ce qui nous entoure, mais la solitude surtout. Je voudrais simplement que la pluie s’arrête de temps en temps.
— C’est beau, la solitude, en effet. C’est très beau. Mais ça demande du beau temps.
— Demain, peut-être, il fera beau.
« Si je pouvais trouver les mots, pensait-elle, expliquer ma peur avec de vrais mots, elle s’effacerait. On y parvient parfois. On les trouve, on les trouve presque, et la peur s’efface alors – enfin, presque. On parvient parfois à se dire : j’ai eu peur, aujourd’hui, je le reconnais. J’ai
eu peur des visages lisses et brillants, des visages de rats, de la façon dont ils riaient au cinéma. J’ai peur des ascenseurs, du regard des poupées. Mais cette peur-là, les mots manquent pour l’expliquer. On ne les a pas encore inventés. »
Elle dit :
— Il me plaira, dès que la pluie aura cessé.
— En ce moment précis, il ne te plaît pas, n’est-ce pas ? Avec cette rivière en contrebas.
— Mon Dieu…, dit-elle. Pas beaucoup, en effet.
— L’atmosphère a quelque chose d’un peu fantomatique, cette nuit.
Tu t’attendais à quoi ? On ne choisit jamais un endroit par beau temps.
(« Ni quoi que ce soit d’autre, d’ailleurs », pensa-t-il.) Ce sont ces pins, qui sont trop serrés. Qui t’étouffent.
— Oui.
« Mais ça n’a rien à voir avec l’ombre des pins, pensait-elle, ni avec ce ciel sans étoiles, ou la lune étroite et fuyante, ou ces collines à fleur de terre avec leurs sommets aplanis, ou même l’obélisque et ces énormes pierres. Non, c’est la rivière. »
— On n’entend plus le bruit de la rivière, dit-elle. Parce qu’elle est trop haute, peut-être.
— Ou qu’on a l’habitude, et qu’on finit par ne plus l’entendre. Je vais me lever pour faire du feu dans la cheminée. Et je voudrais boire quelque chose. Je donnerais n’importe quoi pour boire quelque chose. Pas toi ?
— On peut faire du café.
Pendant qu’ils descendaient l’escalier, il regardait sans cesse la rivière.
— Curieux ce reflet métallique qu’elle a pris, cette nuit. Elle n’a plus du tout l’air d’une rivière.
— Tellement lisse, aussi. Comme si elle était gelée. Et tellement plus large.
— Pas gelée du tout. Au contraire. Elle n’a jamais été plus vivante. Presque inquiétante, à ce point-là. Une sorte de chevelure liquide.
Comme s’il se parlait à lui-même. Il le sentait donc, lui aussi. Elle revint se coucher. Et elle se souvint de la façon dont le clair de lune changeait l’aspect de la rivière, cette surface aux éclats sombres, et qui roulait si violemment. Les choses ont plus d’énergie que les hommes...."

"Smile Please: An Unfinished Autobiography" (1979)
Un texte absolument essentiel pour tout lecteur de Jean Rhys, mais qui doit être abordé avec une certaine prudence et une pleine conscience de sa nature particulière.
Ce livre a été en effet publié à titre posthume et était inachevé. Rhys est décédée alors qu'elle y travaillait encore. Le livre est structuré en courts chapitres, souvent anecdotiques, qui se concentrent sur des moments précis, des sensations, des images. Il n'a pas la fluidité narrative d'une autobiographie traditionnelle. La majeure partie du texte couvre son enfance en Dominique et ses jeunes années en Angleterre et en Europe. La période de sa "disparition" littéraire (les longues décennies d'oubli) et de sa redécouverte est bien moins détaillée. On sent Rhys qui cherche ses mots, qui tente de capturer une sensation fugace ou un souvenir douloureux ...
La Clé pour Lire Toute son Œuvre : on y trouve la matière première de toute sa fiction. Presque tous les événements, personnages et sentiments de ses romans et nouvelles sont puisés ici,
- Le sentiment d'être une exclue, une "békée" (blanche créole) rejetée à la fois par les Blancs anglais et par les Noirs antillais.
- Le traumatisme fondateur du tremblement de terre, métaphore de son monde intérieur toujours prêt à s'effondrer.
- La relation complexe avec sa mère, source de beaucoup de sa détresse.
- L'importance des vêtements, du regard des autres, de la honte.
Le style est magnifique : dépouillé, précis, d'une honnêteté qui frôle la cruauté envers elle-même. Elle applique à sa propre vie la même lucidité impitoyable qu'à ses héroïnes. La célèbre première phrase est emblématique : "As I was putting this book together, I found the only thing that was any good was the moment—the moment of being there." ("En préparant ce livre, j'ai trouvé que la seule chose qui valait la peine était le moment — le moment où l'on y était.")
" ‘Smile please,’ the man said. ‘Not quite so serious.’
He’d dodged out from behind the dark cloth. He had a yellow black face and pimples on his chin.
I looked down at my white dress, the one I had got for my birthday, and my legs and the white socks coming half way up my legs, and the black shiny shoes with the strap over the instep.
‘Now,’ the man said.
‘Keep still,’ my mother said.
I tried but my arm shot up of its own accord.
‘Oh what a pity, she moved.’
‘You must keep still,’ my mother said, frowning.
The chosen photograph in a silver frame stood on a small table under the sitting-room jalousies of our house in Roseau. It pleased me that it was by itself, not lost among the other photographs in the room, of which there were many. Then I forgot it.
It was about three years afterwards that one early morning, dressed for school, I came downstairs before anyone else and for some reason looked at the photograph attentively, realising with dismay that I wasn’t like it any longer. I remembered the dress she was wearing, so much prettier than anything I had now, but the curls, the dimples surely belonged to somebody else.
The eyes were a stranger’s eyes. The forefinger of her right hand was raised as if in warning. She had moved after all. Why I didn’t know, she wasn’t me any longer. It was the first time I was aware of time, change and the longing for the past. I was nine years of age.
Catching sight of myself in the long looking-glass I felt despair. I had grown into a thin girl, tall for my age. My straight hair was pulled severely from my face and tied with a black ribbon. I was fair with a pale skin and huge staring eyes of no particular colour. My brothers and sisters all had brown eyes and hair, why was I singled out to be the only fair one, to be called Gwendolen which means ‘white’ in Welsh I was told? I was wearing an ugly brown holland dress, the convent uniform, and from my head to my black stockings which fell untidily round my ankles, I hated myself.
At the convent I had noticed that some of the girls’ stockings were smooth, tightly stretched, and at last I plucked up enough courage to ask one of them how she managed it. She answered in that impatient, unwilling, secretive voice girls sometimes use to each other: ‘Your garters are too slack.’
I borrowed a needle and strong cotton, went into the room where we left our hats and sewed a large tuck in each garter. Now, though not so smooth as some of the others, my stockings were passable. But as soon as I got home my mother noticed the change and objected so strongly to my wearing anything tight round my knees that I had to take the tucks out.
Again my black stockings drooped.
« Souris, je t'en prie », dit l'homme. « Pas si sérieuse. »
Il s'était dégagé en vitesse de derrière le drap noir. Il avait un visage jaune et noir et des boutons sur le menton.
Je baissai les yeux sur ma robe blanche, celle que j'avais eue pour mon anniversaire, sur mes jambes et les chaussettes blanches qui me remontaient à mi-mollet, et sur les chaussures noires et vernies avec la lanière sur le cou-de-pied.
« Alors, » dit l'homme.
« Reste immobile », dit ma mère.
J'essayai, mais mon bras se leva de son propre accord.
« Oh, quel dommage, elle a bougé. »
« Il faut que tu restes immobile », dit ma mère en fronçant les sourcils.
La photographie choisie, dans un cadre d'argent, trônait sur une petite table sous les jalousies du salon de notre maison à Roseau. J'étais contente qu'elle soit seule, pas perdue parmi les autres photographies de la pièce, qui étaient nombreuses. Puis je l'oubliai.
Ce fut environ trois ans plus tard, tôt un matin, habillée pour l'école, que je descendis avant tout le monde et que, pour une raison quelconque, je regardai la photographie avec attention, constatant avec consternation que je ne lui ressemblais plus. Je me souvins de la robe qu'elle portait, tellement plus jolie que tout ce que j'avais maintenant, mais les boucles, les fossettes appartenaient sûrement à quelqu'un d'autre.
Ses yeux étaient les yeux d'une inconnue. L'index de sa main droite était levé comme pour avertir. Après tout, elle avait bougé. Pourquoi, je ne savais pas, elle n'était plus moi. C'était la première fois que je prenais conscience du temps, du changement et de la nostalgie du passé. J'avais neuf ans.
En m'apercevant dans la glace longue, je fus saisie par le désespoir. J'étais devenue une fille mince, grande pour mon âge. Mes cheveux raides étaient tirés sévèrement en arrière et attachés avec un ruban noir. J'étais blonde, avec une peau pâle et d'énormes yeux grands ouverts, sans couleur particulière. Mes frères et sœurs avaient tous les yeux et les cheveux bruns ; pourquoi étais-je la seule, moi, à être blonde, à m'appeler Gwendolen – ce qui signifie « blanche » en gallois, m'avait-on dit ? Je portais une affreuse robe de toile brune, l'uniforme du couvent, et de ma tête jusqu'aux bas noirs qui me retombaient malproprement sur les chevilles, je me détestais.
Au couvent, j'avais remarqué que les bas de certaines filles étaient lisses, bien tendus, et finalement, je rassemblai assez de courage pour demander à l'une d'elles comment elle faisait. Elle me répondit de cette voix impatiente, réticente et secrète que les filles emploient parfois entre elles : « Tes jarretières sont trop lâches. »
J'empruntai une aiguille et du fil solide, j'allai dans la pièce où nous laissions nos chapeaux et je fis un large repli à chaque jarretière. Désormais, bien que moins lisses que ceux de certaines autres, mes bas étaient présentables. Mais dès mon retour à la maison, ma mère remarqua le changement et s'opposa si vivement à ce que je porte quoi que ce soit de serré autour des genoux que je dus enlever les replis.
De nouveau, mes bas noirs tombèrent...."
Une Profondeur psychologique saisissante ...
Elle explore avec une acuité douloureuse la formation de sa propre personnalité : la sensibilité, la paranoïa, le besoin d'amour et la difficulté à le recevoir, le sentiment d'illégitimité. Le chapitre où elle décrit son sentiment de honte et d'aliénation après avoir été moquée pour son accent antillais en Angleterre est déchirant et fondamental.
Mais il est capital de se rappeler que Jean Rhys était une mythomane et une réécrivaine compulsive de sa propre vie. Elle a embelli, dramatisé, réarrangé et parfois purement inventé des épisodes de son passé. Elle-même l'admettait en partie. "Smile Please" n'est pas un document historique fiable, c'est une construction littéraire de son propre mythe.
Le livre est aussi remarquable par ce qu'il ne dit pas. Il passe sous silence ou effleure à peine certains épisodes sombres, certaines de ses relations les plus destructrices, et les pires moments de son alcoolisme...
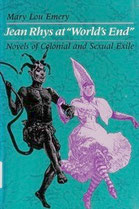
"Jean Rhys at 'World's End': Novels of Colonial and Sexual Exile" de Mary Lou Emery (1990)
Un ouvrage universitaire fondateur et très influent dans les études sur Jean Rhys. Avant les travaux d'Emery et d'autres critiques postcoloniaux, Rhys était souvent lue principalement comme une chroniqueuse de la condition féminine marginale en Europe. Emery a montré que ces deux aspects (le colonial et le sexuel) étaient indissociables et que l'œuvre de Rhys formait un tout cohérent. Son livre a grandement contribué à faire de Rhys un auteur majeur, non plus seulement pour son style, mais pour la puissance politique et théorique de sa vision.
Le titre est parfaitement explicite. La thèse centrale d'Emery est que l'exil dans l'œuvre de Jean Rhys est un exil double et inextricable : il est à la fois colonial et sexuel. Emery affirme que l'on ne peut pas comprendre la condition de marginalisation des héroïnes de Rhys sans analyser comment ces deux dimensions s'entremêlent et se renforcent mutuellement.
Pour Emery, "World's End" (le "Bout du Monde") n'est pas seulement un lieu géographique (bien que le roman Voyage dans les Ténèbres s'y déroule), mais un état d'existence. C'est la position sociale et psychologique de ceux qui sont rejetés par tous les systèmes de pouvoir (impérial, patriarcal, de classe) et qui se retrouvent littéralement et métaphoriquement "au bout du monde".
La Créole Blanche, une Figure d'Entre-Deux ...
Emery insiste sur le statut particulier de Rhys et de ses héroïnes en tant que femmes créoles blanches. Elles ne sont pas pleinement britanniques (elles sont vues comme "exotiques" et inférieures en Angleterre) et ne sont pas non plus des indigènes des Caraïbes (elles sont associées à la classe des colonisateurs). Cette position d'entre-deux les rend inclassables et profondément vulnérables. Leur identité est toujours définie par les autres, jamais par elles-mêmes.
La Critique du Modernisme et de l'Eurocentrisme ...
Emery situe Rhys par rapport aux grands modernistes (comme Joyce, Woolf, Eliot). Elle soutient que Rhys offre une version "marginale" du modernisme. Alors que les modernes européens cherchaient souvent des réponses mythiques ou historiques à la crise de la civilisation occidentale, Rhys, elle, met en scène l'effondrement de cette civilisation du point de vue de celles qu'elle a colonisées et exploitées. Son œuvre révèle les failles de l'impérialisme et du patriarcat que le modernisme traditionnel tendait à ignorer.
L'Exil Sexuel comme Conséquence de l'Exil Colonial ...
L'ouvrage démontre comment la précarité économique et sociale des héroïnes, liée à leur origine coloniale, les pousse dans une situation de dépendance sexuelle. Leur corps devient souvent leur seule monnaie d'échange. Leur "exil sexuel" – le fait d'être traitées comme des objets érotiques et jetables – est une conséquence directe de leur manque de racines et de protection sociale dans le monde européen.
Emery propose ainsi des analyses détaillées des principaux romans de Rhys pour étayer sa thèse ...
- Quartet et After Leaving Mr. Mackenzie : Elle y voit la description de l'exil sexuel et économique des femmes dans le Paris et le Londres de l'entre-deux-guerres.
- Voyage dans les Ténèbres (Good Morning, Midnight) est l'apogée de cet état de "World's End". Le personnage de Sasha Jensen incarne la dissolution complète de l'identité, un "nervous breakdown" qui est aussi une crise civilisationnelle.
- Wide Sargasso Sea (La Prise des Macalous) est présenté comme le point culminant de la pensée de Rhys, où la double problématique de l'exil colonial et sexuel est pleinement et explicitement déployée dans le contexte caribéen. Antoinette Cosway est l'archétype de la créole blanche, dont le corps et l'esprit sont littéralement "pris" et détruits par le patriarcat impérial britannique (représenté par Rochester).
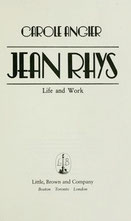
"Jean Rhys: Life and Work", Carole Angier (1990)
C'est la biographie de référence, monumentale, méticuleusement recherchée, et d'une objectivité parfois cruelle. Angier ne juge pas, mais elle ne cache rien. C'est un travail de bénédictin, essentiel pour quiconque veut comprendre les faits de la vie de Rhys dans leur contexte le plus large.
A Critical And Biographical Study Of The English Novelist. Part One: Life, 1890-1927 -- Dominica, 1890-1907 -- First Steps, 1907-1912 -- The Interval, 1913-1919 -- John, 1919-1924 -- Ford, 1924-1927 -- Quartet -- Part Two: Work, 1928-1939 -- Leslie, 1928-1930 -- After Leaving Mr Mackenzie -- Leslie, 1931-1934 -- Voyage In The Dark -- Leslie, 1935-1939 -- Good Morning, Midnight -- Part Three: The Lost Years, 1939-1966 -- War, 1939-1945 -- Max, 1945-1957 -- The Writing Of Wide Sargasso Sea, 1957-1966 -- Wide Sargasso Sea -- Part Four: The Last Years, 1966-1979 -- Life, 1966-1975 -- Death, 1976-1979
La vie de Rhys était un tissu de légendes, souvent entretenu par elle-même. Angier a passé sa vie au crible, distinguant méthodiquement la réalité des faits des mythes autobiographiques que Rhys a construits. Elle vérifie, recoupe et confronte les témoignages avec une objectivité de détective.
Avant Angier, les décennies entre 1939 (la publication de Good Morning, Midnight) et 1966 (la publication de Wide Sargasso Sea) étaient un grand mystère. Angier a été la première à retracer et documenter en détail cette longue traversée du désert – les déménagements constants, la pauvreté, l'alcoolisme, les séjours en prison et en hôpital psychiatrique. Cette partie de la biographie est aussi fascinante que tragique.
C'est la grande force du ton d'Angier. Elle éprouve une profonde compassion pour la souffrance de Rhys, son génie et sa vulnérabilité. Mais elle ne tombe jamais dans l'hagiographie. Elle maintient une lucidité impitoyable sur les aspects les plus sombres de sa personnalité ...
- Sa cruauté : Envers ses maris (notamment Leslie Tilden Smith), ses amants, et surtout sa fille.
- Sa manipulation : Sa capacité à jouer la victime pour obtenir de l'argent et de la sympathie.
- Son auto-destruction : Son alcoolisme n'était pas seulement une conséquence de sa détresse, mais aussi un choix actif qui a détruit ceux qui l'entouraient.
Angier ne juge pas, mais elle ne cache rien. Le portrait qui en ressort est d'une richesse et d'une complexité humaines bouleversantes. Le titre n'est pas anodin : "Life and Work". La grande réussite d'Angier est de montrer comment la vie alimente l'œuvre, et comment l'œuvre transforme la vie.
Enfin, Angier structure sa biographie autour d'une idée-force : il y avait "deux Jean Rhys".
- Ella Gwendolen Rees Williams : La femme réelle, vulnérable, dépendante, qui avait désespérément besoin d'amour et de sécurité et qui se sabordait constamment.
- Jean Rhys : L'écrivain, la conscience froide, lucide et impitoyable qui observait "Ella" de l'extérieur et transformait ses échecs en art.
Cette dialectique est la clé pour comprendre le "mystère Rhys". Elle explique comment une femme qui semblait si passive et sans défense dans la vie a pu produire une œuvre d'une aussi grande maîtrise stylistique et d'une aussi radicale intelligence.
