- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau

Hans Fallada (1893-1947), "Kleiner Mann, was nun?" (Et puis après, 1932), "Wolf unter Wölfen" (Loup parmi les loups, 1932), "Der eiserne Gustav" (1938), "Jeder stirbt für sich allein" (Seul dans Berlin, 1947) - Erich Kästner (1899-1974), "Fabian Die Geschichte eines Moralisten" (Fabian, histoire d'un moraliste, 1931) - ..
Last update: 11/11/2016
Fallada ne fait pas de l’arrivée à Berlin, en pleine Répblique de Weimar, de son personnage Pinnberg ("Kleiner Mann - Was nun ?", 1932), une grande occasion comme celle vécue par Emil d’Erich Kästner qui arrive en train ("Fabian", 1931) ou par Franz Biberkopf, d’Alfred Döblin (Berlin Alexanderplatz", 1929), qui sort de prison. Arriver à Berlin pour Pinneberg et sa femme signifie avant tout, après la plus brève mention d’une « mêlée de piétons et de tramways », une première rencontre avec la redoutable Mia Pinneberg, mais non pas une rencontre détaillée avec une métropole vibrante et vivante, le "mythe". Fallada ou Kästner sont des satiristes, il ne s'agit pas d'agiter pour eux quelque théorie, d'analyser des conditions politiques ou sociales, de dénoncer en argumentant, mais de simplement décrire, avec économie, parfois caricatural ou terre à terre, des faits, des faits d'existence, des êtres humains qui se sentent désormais, sans pouvoir l'expliquer, rejeter de leur vie sociale, conséquence invisible d'une prise de pouvoir par le nazisme : subitement, alors que les violences ne se sont pas encore véritablement déchaînées, la vie n'est déjà plus, pour certains, ce qu'elle aurait pu être ...


Hans Fallada (1893-1947)
Wilhelm Friedrich Rudolf Dilzen naquit en Poméranie avant de prendre pou nom de plume celui de Hans Fallada. Fils aîné d'un juge, sa timidité le fit échouer au baccalauréat. En 1911, il prit part à un duel qui était censé être un double suicide, mais, alors que l’autre duelliste, un ami de Fallada, mourut, il survécut et fut envoyé dans un établissement psychiatrique. N'ayant obtenu aucun diplôme d’études secondaires et, après sa libération en 1913, il dut alors choisir une orientation et entra à l'école d'Agronomie. ll en vint ainsi à occuper divers emplois d'expert agronome et de comptable; il fut aussi gardien de nuit, marchand de céréales et agent de publicité. S'il s’est porté volontaire pour rejoindre l’armée allemande en 1914, en raison de sa dépendance à l’alcool et à la morphine, il fut rapidement jugé inapte à servir. Il passa ainsi la majeure partie de 1917-1919 à tenter de se rétablir, sans succès. Plus tard, il a travaillé comme administrateur sur différentes successions, séjourna trois mois en prison en 1923, puis en 1925 à 1928, pour détournement de fonds.
Après la Première Guerre mondiale, il vint s`établir à Berlin et commença à écrire. Le 5 avril 1929, Fallada épouse Anna (« Suse ») Issel, ils eurent trois enfants. Travaillant comme journaliste avant de trouver un emploi chez l’éditeur Rowohlt à Berlin en 1930, - Rowohlt avait déjà publié deux de ses romans sous le nom de Hans Fallada—"Der junge Goedeschal" (1920; « The Young Goedeschal ») et "Anton und Gerda" (1923), mais tous deux sont passés inaperçus. En 1929, il assista comme correspondant d`un journal au fameux procès des paysans de Neumunster, et du compte rendu de ce procès naquit son roman "Paysans, gros bonnets et bombes" (Bauern, Bonzen und Bomben, 1930), qui lui valut une grande renommée. Il conquit ensuite une gloire mondiale en 1932 avec son roman le plus réussi, "Et puis après" (Kleiner Mann, was nun?". Avec le produit de la vente de ses livres, il put s'acheter dans le Meclembourg une petite propriété qu'il cultiva lui-même avec l'aide de sa famille, à Carwitz, un hameau de pêcheurs de la commune de Feldberg.
En 1933, lorsque Hitler accède au pouvoir, Fallada subit une courte arrestation par la S.A. (11 jours), après avoir été dénoncé pour des propos tenus à Ernst von Salomon. Il se retire ensuite dans sa ferme. N'ayant publié que des œuvres inoffensives sans faire de déclarations politiques tout en ayant décidé de ne pas émigré, firent que l'auteur fut après la guerre critiqué comme un opportuniste.
Commence alors une période prolifique, avec la rédaction de "Wer einmal aus dem Blechnapf frißt" (Le Roman du prisonnier, Who Once Eats from the Tin Cup, un roman sur un homme reconnu coupable de détournement de fonds qui est libéré de prison et qui lutte pour réintégrer la société. pour lequel Fallada s’est inspiré de son expérience personnelle), "Wir hatten mal ein Kind" (Nous avions un enfant) en 1934, "Das Märchen vom Stadtschreiber, der aufs Land flog" en 1935, "Wolf unter Wölfen" (Wolf Among Wolves, Loup parmi les loups) en 1937, "Der eiserne Gustav" (Gustave-de-Fer, Iron Gustav) en 1938, "Der ungeliebte Mann" (Mariage sans amour) en 1940, "Ein Mann will hinauf" en 1943.
Se consacrant à une littérature plus distrayante que critique, il bénéficiera donc d'une tolérance du régime nazi, avec des conditions matérielles assez précaires : il est vrai que ses ouvrages ne connurent pas le succès de celui écrit en 1932 ...
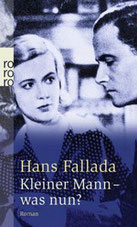
"Kleiner Mann - Was nun ?" (1932, Quoi de neuf, petit homme ?)
La renommée de "Et puis après ?" (aussi traduit en français sous le titre "Quoi de neuf, petit homme ?), ou "Little Man, What Now?", dépassera les frontières allemandes (quarante-huit mille exemplaires la première année) jusqu'à devenir immédiatement un classique mondial (publié par Simon & Schuster aux Etats-Unis).
Il sera suivi de "Wir hatten mal ein Kind" (Nous avions un enfant, 1934) et "Altes Herz geht auf die Reise" (Pauvre coeur à l'aventure, 1936), mais ceux-ci n'atteigneront pas sa valeur artistique et sa portée sociale. La réalité quotidienne et grise de la vie berlinoise, à la veille du troisième Reich et de la prise du pouvoir par Hitler, en constitue la trame : critique, il fournit une image vivante et poignante de la vie dans l'Allemagne de Weimar en se concentrant sur un jeune couple marié luttant pour survivre dans l’inflation cauchemardesque du pays. Les partis extrêmes luttaient alors entre eux, aux dépens de la petite bourgeoisie qui, désorganisée et impuissante devant l'effrayante montée de la crise économique, laissait ses propres chômeurs sombrer dans la misère prolétarienne.
Prologue — Blithe Spirits / Heitere Geister
Une façade bien optimiste avant la plongée dans les difficultés sociales Une scène d’ouverture qui met en avant toute la naïveté et l'amour sincère d'un jeune couple qui va être confrontés à la dure réalité économique. On y voit déjà la première allusion à la grande crise économique (la crise de 1929-1930 qui secoue la République de Weimar).
Part One — The Small Town / Die Kleinstadt
De la fragilité du « petit homme » face à la discipline économique et la cruauté sociale de la petite bourgeoisie provinciale ... Après leur mariage, Pinneberg et Lämmchen s’installent dans une petite ville du nord de l’Allemagne. Pinneberg travaille comme comptable dans un magasin de fournitures agricoles dirigé par Kleinholz, un patron autoritaire et suspicieux. Le couple lutte pour joindre les deux bouts.
Part Two — Berlin / Berlin
De la cruauté de la « grande ville », la déshumanisation du travail, et la mécanique écrasante du capitalisme moderne. Dans le grand magasin Mandel, Pinneberg est traité comme un numéro. Il doit « sourire » tout en vendant, sous pression constante. C’est la naissance de la société de consommation moderne : l’individu devient simple rouage, surveillé et contrôlé par des quotas. Ils emménagent dans une petite chambre meublée et découvrent une grande ville déjà saturée de chômeurs et de misère.
Epilogue — Life Goes On / Und das Leben geht weiter
Pinneberg ne trouve plus d’emploi stable. Le couple se réfugie dans une petite cabane à la campagne, prêtée par un ami. Ils survivent tant bien que mal avec un peu de jardinage et de troc. Malgré la misère, leur amour résiste et devient leur unique bouée de survie. Pinneberg est profondément abattu, humilié, incapable de se projeter dans l’avenir. Pourtant, Lämmchen, avec son optimisme discret et doux, le réconforte : elle lui rappelle qu’ils ont « Murkel », et que « tant que nous sommes ensemble, nous pouvons continuer ». Le roman se termine sur une note douce-amère : aucune solution sociale n’est proposée, mais la dignité humaine subsiste ..
Les héros du roman sont un jeune couple, Johannes Pinneberg et Emma Lämmchen. Le jeune homme représente la masse anonyme des petits-bourgeois honnêtes et victimes de l`inflation; Lämmchen est fille d`ouvriers, modeste et bonne; il l`a rencontrée un dimanche au cours d'un pique-nique. lls décident de se marier parce qu`elle attend un enfant. Mia, la mère de Pinneberg, est veuve. Son mari était cet homme intègre qui fut premier secrétaire d`un grand avocat mais elle est devenue une femme de mauvaise vie. Elle fait venir à Berlin les jeunes gens, qui étaient en province, et Pinneberg, qui méprise sa mère mais ignore ses activités équivoques, trouve un emploi de commis dans une maison de commerce grâce à Jachmann, le dernier amant de Mia, un homme facile et jovial. Mal considéré, plus mal payé encore, il fait alors l`expérience de la méchanceté humaine que la crise économique et le chômage ne font qu`exciter davantage.
Des collègues jaloux révèlent aux jeunes gens la profession de Mia, et le jeune couple va se réfugier loin d`elIe, dans une mansarde. L`amour, uni à tant de pauvreté, et la naissance de l`enfant forment un íntermède lyrique d'une très humaine poésie au milieu de cette morne chronique.
Mais voici que Pinneberg perd son emploi. Il ne peut plus payer son loyer. Un de ses anciens amis et collègue, naturiste convaincu, Heilbutt, lui cède un de ses pavillons hors de Berlin ; il y a un petit jardin ; la famille vit tant bien que mal : Lämmchen gagne quelque argent en faisant des travaux de couture; elle essaie de soutenir son époux, toujours chômeur et de plus en plus découragé. Pinneberg refuse d'aller voler du bois comme les autres; il veut rester honnête, mais leur niveau de vie baisse toujours plus; c'est sans espoir : "Et maintenant, pauvre homme ?" ...
Maintenant surgira le troisième Reich; la plupart des chômeurs, déjà abrutis, s`enrôleront dans les légions hitlériennes, tandis que les hommes comme Pinneberg se replient sur eux-même et continueront à tenter de lutter pour leur vie honnête de petit-bourgeois... (Trad. Gallimard, 1933). Après des mois de pauvreté et d’humiliation, le désespéré Pinneberg continue à survivre, aucune question n'est résolue pour autant : "On m'a dit : "Pourquoi n'avez-vous pas de réponse à la question "Et maintenant ?"? Lammchen est ma réponse, je n'en connais pas de meilleure. Le bonheur et la misère, les soucis et un enfant, les soucis d'un enfant, les hauts et les bas de la vie, ni plus ni moins...."

Allemagne, 1932,
- Pinneberg vit constamment dans la peur de "descendre" (vergesellschaften). Sa honte, quand il ne peut plus offrir un cinéma ou une sortie à Lämmchen, est immense. Cette peur de déclassement est un moteur social puissant, qui nourrit un climat d’humiliation collective, exploitée ensuite par la propagande nazie.
- Pinneberg est un "homme ordinaire" incapable de s’affirmer. Il est toujours dominé, soit par le patron, soit par la belle-mère dominatrice, soit par les normes économiques. Son désespoir silencieux prépare le terrain à la recherche d’un "sauveur fort" — ce que le nazisme va proposer.
- Lors des premières traductions anglaises (Susan Bennett, 1933 ; Eric Sutton, 1933/1952), les éditeurs anglo-saxons craignaient que le lecteur se perde dans la structure en « blocs » typique de Fallada. Pour faciliter la lecture, ils ont ajouté des titres humoristiques ou ironiques, souvent basés sur une phrase résumant la section. Ces titres reflètent le ton feuilletonnesque et journalistique que Fallada utilisait parfois dans ses articles ou ses chroniques, mais qui n’étaient pas explicitement mis en titre dans le roman...
- Quand Little Man, What Now? a été publié en anglais en 1933, les éditeurs britanniques et américains ont adouci ou supprimé plusieurs passages jugés « trop intimes » ou « indécents » (y compris certaines scènes de tendresse conjugale jugées trop physiques). L’un des passages les plus édulcorés est précisément la scène où Pinneberg voit Lämmchen nue et ressent un mélange de peur et d’étrangeté.

« Kleiner Mann – was nun? » propose un un panorama social de Berlin en 1932, non à travers les militants ou les intellectuels, mais à travers les angoisses quotidiennes d’un « petit homme » écrasé par la crise économique et morale. Les personnages secondaires (comme Jachmann ou les Heilbutt) sont des types sociaux, des figures satiriques qui rendent compte de l'impuissance collective face à la crise ...
- Johannes Pinneberg : le "petit homme"
Un employé de bureau, modeste, fragile, constamment angoissé de perdre son emploi. Il incarne la petite bourgeoisie laborieuse, dépolitisée, prise au piège des transformations brutales de la société de Weimar finissante. Face à la crise , il n'exprime que passivité et survie ; et s’enferme dans sa vie domestique et son amour pour Lämmchen (Emma).
- Lämmchen, Emma Mörschel
L'épouse aimante, soutenant son mari. Elle représente la force silencieuse, la tendresse, la capacité d’adaptation. Elle aide à maintenir un semblant de dignité.
- Mia, la belle-mère
Mia vit dans une certaine insouciance, entretenue par ses liaisons et par une attitude superficielle. Elle symbolise ceux qui se débrouillent dans le chaos sans scrupules. Elle semble flotter au-dessus des contraintes matérielles, montrant la superficialité d’une certaine petite bourgeoisie ou bohème urbaine.
- Jachmann, l'opportuniste
Ancien collègue devenu une figure de l’arrivisme, l'incarnation du pragmatisme cynique. Il exploite la crise pour avancer, manipulant Pinneberg au passage. Il représente ceux qui s’adaptent au capitalisme sauvage, prêts à tout pour survivre ou prospérer.
- Les Heilbutt, la petite bourgeoisie naturiste
Naturistes, végétariens, idéaux pseudo-réformistes, ils incarnent une utopie petite-bourgeoise, croyant pouvoir se purifier par le retour à la nature. Leur naïveté et leur déconnexion du réel les rendent inoffensifs politiquement ; ils sont incapables d’affronter la crise de manière structurelle ("Die wissen ja gar nicht, was Hunger ist", ils ne savent pas ce que c’est, la faim... )
- Kleinholz & Lohse et la direction de Mandel
Collègues subalternes et agressifs, obsédés par la concurrence interne, un patronat brutal et inhumain, prêt à licencier sans scrupule. Ils illustrent la brutalité des rapports de travail, la déshumanisation de l’économie en crise. Fallada nous livre la hiérarchie comme un microcosme du capitalisme allemand : chacun écrase celui d’en dessous.

Fallada ose montrer le corps comme une réalité sociale, pas comme simple objet esthétique ou sentimental, Pinneberg semble n'exister que par son couple ...
Tout au long du roman, Lämmchen est "le dernier refuge" de Pinneberg contre l’humiliation sociale, refuge, mais aussi un rappel constant de la réalité. Dès le début, Lämmchen est le seul espace d'humanité et de consolation pour Pinneberg. Alors que tout autour d’eux (famille, employeurs, société) les écrase ou les humilie, Lämmchen incarne une bulle de tendresse et de loyauté absolue. Elle est à la fois mère, compagne, amie, mais aussi un miroir dans lequel Pinneberg voit sa propre dignité.
Contrairement à d’autres romans contemporains qui idéalisent l'amour conjugal (ou le taisent), Fallada montre la vie corporelle du couple, leur sexualité, bien qu'évoquée avec pudeur, est réaliste, directe, jamais détachée du quotidien matériel.
Ces moments sont "crus" non au sens pornographique, mais parce qu'ils sont dépeints sans filtre sentimental bourgeois. Lämmchen se moque gentiment de Pinneberg quand il est maladroit, les discussions sur l'argent pendant qu'ils sont au lit, les contacts physiques rassurants (elle caresse son front, ils s’enlacent sous la couverture pour "oublier le froid" ou "chasser la peur")...
- Première intimité après le mariage, "Und wenn sie dann abends beieinanderlagen, ganz dicht, und sie rutschte mit ihrem Fuß an seinem Bein hinauf, dann war alles wieder gut. Dann war die Welt draußen weit weg, dann war nur sie, nur sie beide, nur sie zwei gegen alle." (t quand ils étaient allongés l’un contre l’autre le soir, tout proches, et qu’elle faisait glisser son pied le long de sa jambe, alors tout allait bien de nouveau. Alors le monde dehors était très loin, il n’y avait qu’eux, seulement eux deux, contre tous).
- Les caresses silencieuses après les humiliations : "Er wollte sprechen, sie hielt ihm die Hand auf den Mund. ‚Nein, nichts mehr, Johannes, schlaf. Morgen ist auch noch ein Tag.‘ Und sie streichelte sein Haar, bis er einschlief" (Il voulait parler, elle posa sa main sur sa bouche. 'Non, plus rien maintenant, Johannes, dors. Demain est un autre jour.' Et elle caressait ses cheveux jusqu’à ce qu’il s’endorme"). Lämmchen protège Pinneberg même de ses propres pensées.
- Moment d’humour tendre dans la pauvreté, "Und sie lachten leise, obwohl es nichts zu lachen gab. Sie lachten über ihre alten Socken, über das durchgelegene Bett, über den Lärm draußen. Und ihr Lachen war wie ein warmer Mantel, der sie umhüllte" (Et ils riaient doucement, bien qu’il n’y eût rien à rire. Ils riaient de leurs vieilles chaussettes, du lit creusé, du bruit dehors. Et leur rire était comme un manteau chaud qui les enveloppait). La complicité remplace les possessions matérielles.
- "wie sie nackt standen vor allem, was da kommen konnte" (comme ils se tenaient nus face à tout ce qui pouvait arriver) - La scène de la nudité et du malaise qu'elle provoque : après une journée difficile chez Mandel, Pinneberg rentre à la petite chambre.Lämmchen est en train de se changer ou se laver, dans leur espace exigu. Pinneberg voit son corps nu dans une lumière crue, il est soudain pris de vertige, il détourne le regard. Il éprouve un malaise qu'il ne comprend pas lui-même immédiatement : un mélange de honte, de fatigue psychique, de fragilité. Pour la première fois, Pinneberg doute de leur fusion, de leur invincibilité. Il comprend que même ce corps qu’il aime est exposé, fragile, soumis aux mêmes menaces que lui (froid, faim, pauvreté). Un basculement psychologique ...
"Er trat ein, sie stand vor dem Spiegel, nackt, ganz nackt. Er blieb stehen, er konnte nicht weitergehen, er starrte auf sie. Sie war so fremd, so fremd und schutzlos. Er sah die kleinen, weichen Brüste, den runden Bauch, die schlanken Hüften, die weißen, glatten Schenkel, und er fühlte eine unendliche Angst. Es war nicht Scham, es war keine Peinlichkeit; es war Angst, große, namenlose Angst. Warum hatte er Angst? Er wußte es nicht. Er sah sie so nackt, so ganz nackt, wie er sie noch nie gesehen hatte. Sie war kein Lämmchen, kein Weibchen, kein Kamerad mehr, sie war ein Mensch, ein ganz nackter, fremder Mensch. Und sie war so schutzlos, so ausgeliefert. Er konnte sie nicht mehr schützen, nicht gegen den Hunger, nicht gegen das Elend, nicht gegen das Leben. Er empfand plötzlich, wie elend und verloren sie beide waren, wie sie nackt standen vor allem, was da kommen konnte. Er machte kehrt und ging hinaus, ganz leise"
(Il entra, elle se tenait devant le miroir, nue, entièrement nue. Il s'arrêta, il ne pouvait pas aller plus loin, il la fixait. Elle était si étrange, si étrangère et sans défense. Il voyait les petits seins souples, le ventre rond, les hanches fines, les cuisses blanches et lisses, et il ressentait une peur infinie. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas de la gêne ; c'était de la peur, une grande peur sans nom. Pourquoi avait-il peur ? Il ne le savait pas. Il la voyait si nue, si entièrement nue, comme il ne l'avait jamais vue. Ce n'était plus un agneau, une femelle, un camarade, c'était un homme, un homme tout nu, étranger. Et elle était si vulnérable, si exposée. Il ne pouvait plus la protéger, ni contre la faim, ni contre la misère, ni contre la vie. Il sentit soudain à quel point ils étaient tous deux misérables et perdus, à quel point ils étaient nus face à tout ce qui pouvait arriver. Il fit demi-tour et sortit, tout doucement).
Le moment le plus brut, plus existentiel que sensuel, leur vulnérabilité absolue...
Un passage de la version allemande de "Kleiner Mann - was nun?" de l'édition Rowohlt (1932), reprise, contrairement aux éditeurs anglo-saxons qui l'ignorèrent, par la première traduction française parue en 1933 chez Gallimard , « Il la vit, toute nue, avec ses petits seins mous, son ventre arrondi, ses hanches fines, ses cuisses blanches et lisses. Une peur infinie s’empara de lui. Ce n’était pas de la honte, ni un embarras ; c’était une peur immense, sans nom. Elle n’était plus Lämmchen, ni une compagne, elle était un être humain, un être tout nu, étranger » ...
- La réconciliation silencieuse après le licenciement, "Sie legte sich an ihn, ganz fest, und sie sagten kein Wort. Aber er fühlte, dass sie verstand, dass sie bei ihm war. Und er weinte leise in ihr Haar" (Elle se serra contre lui, très fort, et ils ne dirent pas un mot. Mais il sentait qu’elle comprenait, qu’elle était avec lui. Et il pleura doucement dans ses cheveux).

"Diebesbande. Geschichten aus dem Leben jugendlicher Verbrecher" (1932)
"Voyous, truands et autres voleurs", traduction Gallimard (2015) d'un recueil de récits centrés sur la petite criminalité, la marginalité et la vie de jeunes délinquants à Berlin. Il a été écrit à partir d’enquêtes et d’observations faites par Fallada, qui s’intéressait déjà beaucoup aux « laissés-pour-compte » et aux marginaux, ce qui traverse toute son œuvre (comme dans "Seul dans Berlin" ou "Quoi de neuf, petit homme ?").
Au début des années 1930, Fallada s’intéresse de près aux marges de la société allemande, particulièrement à la pauvreté urbaine et aux jeunes délinquants. Dans Diebesbande, il compile plusieurs récits inspirés de faits réels, recueillis en partie par le biais d’entretiens, de documents judiciaires et d’observations directes. Il adopte un style très proche du reportage social, influencé par le courant de la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité), qui privilégiait une écriture factuelle, sobre et engagée.
Le livre est composé d’environ six récits principaux, plus quelques vignettes courtes. Voici un aperçu ...
- "Diebesbande" (La bande de voleurs), une bande d’adolescents livrés à eux-mêmes à Berlin, vivant de petits larcins, cambriolages et vols à l’étalage. Montre la solidarité et la brutalité à l’intérieur du groupe, ainsi que l’échec des institutions à proposer une véritable alternative ...
- "Der kleine Dieter' (Le petit Dieter), portrait d’un garçon extrêmement jeune, déjà entraîné dans la délinquance. Met en avant l’absence totale de structure familiale et la violence précoce.
- "Der dritte Einbruch" (Le troisième cambriolage), récit sur la répétition des délits, l’escalade et la manière dont la justice finit par rattraper les jeunes. Souligne la spirale sans issue : punition, libération, rechute.
- "Der Taschenmesser-Diebstahl" (Le vol du couteau de poche), une histoire courte et symbolique, presque anecdotique, sur un jeune qui vole un simple couteau, mais pour lequel la société réagit avec une dureté disproportionnée.
- "Die Muttergeschichte" (L’histoire de la mère), décrit le rôle (ou l’absence) de la figure maternelle, montrant souvent des mères dépassées ou absentes, ce qui explique en partie la dérive des enfants.
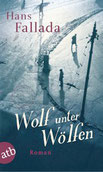
"Wolf unter Wölfen" (1937, Wolf among Wolves, Loup parmi les Loups)
Le grand roman social de la République de Weimar, plus ample et plus ambitieux encore que "Kleiner Mann – was nun?" ...
Dans ce roman, Fallada a voulu donner un tableau de l`Allemagne avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Le premier volume se passe à Berlin et son héros, Wolfgang Pagel. qui vit avec une prostituée, est le symbole de toute cette époque désaxée. Après avoir décrit la vie citadine, Fallada se tourne, dans le second volume, vers la vie à la campagne. ll montre la révolte des paysans (nous sommes en Prusse orientale), la décadence des hobereaux, tout le désordre politique. économique et sentimental des années 1920-1925. C`est le tableau magistral qu'il a tracé dans ce second volume qui a définitivement établi sa renommée : il se dégage de ce roman l`impression d'un total désarroi total. (Trad. Albin Michel. 1941).
Fallada, qui écrivait sous le régime nazi (1937), se garde bien de toute critique directe, mais le roman résonne comme un immense avertissement sur la brutalité sociale et la fragilité humaine. Un grand succès à l"poque lors de sa publication, admiré pour son souffle narratif et sa peinture sociale . Aujourd’hui ce livre est considéré comme l’un des grands romans allemands sur la République de Weimar (au même titre que "Berlin Alexanderplatz" de Döblin) ...
Le roman est très long (environ 900 pages en allemand). Il suit plusieurs intrigues entremêlées et un grand nombre de personnages. Fallada saisit capte l’argot, les tournures quotidiennes, la langue parlée, ce qui donne à son oeuvre une authenticité brutale. Et malgré la misère, un esprit ironique traverse ces échanges, comme un réflexe de survie psychique.
Dans l’original allemand, "Wolf unter Wölfen" n’est pas explicitement divisé en deux grandes parties mais en 38 chapitres, publiés en un seul volume. Cependant, la traduction anglaise (notamment celle par Philip Owens, 1938) a choisi de diviser le livre en deux sections pour faciliter la lecture et souligner l’évolution du cadre et du ton, "The Unquiet City", qui couvre surtout les événements à Berlin, et "The Land of Fire", qui se déroule principalement à Neulohe (la campagne, la propriété du comte). Ces deux grandes divisions correspondent à un déplacement géographique et psychologique majeur du protagoniste. Contrairement à la version anglaise, les traducteurs français (1938, Gallimard) n’ont pas divisé le roman en deux grandes parties avec des titres distincts

Le roman s’ouvre sur Berlin en 1923, pendant l’hyperinflation. Tout est chaos, débordements et perte de repères moraux. On suit Wolfgang Pagel, un jeune homme charmant, joueur compulsif, impulsif et un peu rêveur. Il est accompagné de Petra Ledig, une jeune femme qui l’aime sincèrement et tente en vain de le sauver de ses addictions. Wolfgang est perpétuellement à la recherche d’argent pour financer ses dettes de jeu. Petra, malgré sa misère, reste loyale, vend même ses maigres possessions pour l’aider. Dans Berlin, tout le monde cherche à survivre : fonctionnaires ruinés, anciens officiers humiliés, femmes contraintes à la prostitution, banquiers cyniques, profiteurs. La ville est décrite comme une métaphore du désespoir social, chaque personnage symbolisant une facette de la décadence morale ou du désespoir économique. Wolfgang finit par fuir Berlin après une série de mésaventures humiliantes, notamment une descente de police et un scandale au casino clandestin.
Le climat est globalement anxiogène, chaque individu se sent traqué, écrasé par l’effondrement monétaire. - "Jeder ist in Angst. Angst vor dem Morgen, Angst vor dem Verlust, Angst vor der nächsten Stunde. Berlin ist ein brodelnder Kessel, aus dem kein Entkommen ist" (Chacun est dans la peur. Peur du lendemain, peur de perdre, peur de l'heure suivante. Berlin est un chaudron bouillonnant, d’où il n’y a pas d’échappatoire)/
Une hyperinflation vécue au quotidien - "Die Menschen zählten nicht mehr in Mark, sondern in Milliarden. Geld wurde zu Papier, Papier zu Dreck. Jeder versuchte, heute noch zu kaufen, bevor es morgen nichts mehr wert war" (Les gens ne comptaient plus en marks, mais en milliards. L’argent était devenu du papier, et le papier de la saleté. Chacun essayait d’acheter encore aujourd’hui avant que cela ne vaille plus rien demain).
Ce dialogue satirique et presque absurde rend palpable l’hyperinflation. Il montre la rapidité grotesque de la dévaluation et le cynisme résigné des Berlinois...
- Gast: "Was kostet der Kaffee heute?"
( Combien coûte le café aujourd’hui ? )
- Kellner: "Heute? Heute fünf Millionen. Morgen vielleicht zehn."
(Aujourd’hui ? Cinq millions. Demain peut-être dix)
- Gast: "Dann trinke ich ihn lieber sofort, bevor ich ihn mir nicht mehr leisten kann."
(Alors je le bois tout de suite, avant de ne plus pouvoir me le payer).
Wolfgang Pagel passe beaucoup de temps dans les cafés, tripots et casinos clandestins. Le jeu devient une métaphore de la société entière, tout est pari, risque, et perte. Le jeu symbolise le délire collectif : une fuite en avant, le déni de réalité. - "Er setzte alles, was er hatte, auch das, was er nicht hatte. Im Spiel glaubte er, ein Gott zu sein — der einzige Ort, wo er noch Macht spürte" (Il misait tout ce qu’il avait, même ce qu’il n’avait pas. Dans le jeu, il se croyait un dieu — le seul endroit où il ressentait encore une forme de pouvoir).
La relation Wolfgang - Petra renforce le sentiment de tragédie humaine,- la loyauté et la douleur silencieuse de Petra contraste avec la déshumanisation générale de Berlin - "Sie liebte ihn, mit einer Geduld, die wehtat. Aber ihre Augen waren leerer geworden, wie das Gesicht einer Puppe" (Elle l’aimait, avec une patience qui faisait mal. Mais ses yeux étaient devenus plus vides, comme le visage d’une poupée).
Un dialogue qui révèle à la fois le délire mégalomaniaque de Wolfgang (le fantasme d’une victoire totale) et la pureté désespérée de Petra. Toute leur relation tragique se résume ici :
- Petra: "Warum spielst du immer wieder? Du weißt doch, dass wir nichts haben!"
(Pourquoi joues-tu sans cesse ? Tu sais bien que nous n’avons plus rien ! )
- Wolfgang: "Weil ich vielleicht eines Tages alles gewinne. Und dann gehört dir die ganze Welt."
(Parce que peut-être qu’un jour je gagnerai tout. Et alors, le monde entier t’appartiendra)
- Petra: "Ich will nicht die Welt. Ich will nur dich - gesund, bei mir, ohne Angst."
(Je ne veux pas le monde. Je veux seulement toi - sain, près de moi, sans peur).
L’atmosphère nocturne de Berlin est transformée par une musicalité très "Falladienne", - "Berlin schrie in der Nacht. Hupen, Lachen, das Röhren der Autos - eine Stadt, die nicht schlafen wollte, die ihren eigenen Untergang verschlafen musste" (Berlin hurlait la nuit. Klaxons, rires, rugissements des voitures - une ville qui ne voulait pas dormir, qui devait dormir sur sa propre destruction) ...
Fallada dresse un tableau sociologique acéré de Berlin, ville devenue jungle. La narration mêle un regard ironique (quasi journalistique) et une compassion tragique pour ceux qui sont broyés. L’ambivalence morale du héros (charmant mais égoïste) préfigure l’idée du "loup parmi les loups" : tous sont contraints à des comportements de survie extrêmes. Certains critiques voient cette première partie comme un témoignage quasi documentaire, sans manichéisme.

Après Berlin, Wolfgang et Petra se réfugient dans le domaine agricole du comte von Prackwitz, à Neulohe.
Après le chaos urbain de Berlin, Neulohe apparaît d’abord comme une promesse d’ordre, presque une tentative de retour à la "pureté" rurale. Wolfgang espère y se réhabiliter, travailler honnêtement, rompre avec ses vices. La terre et les rythmes agricoles semblent offrir une stabilité que la ville refuse. Mais très vite, Fallada montre que cette apparente stabilité est illusoire. La campagne est minée par la crise économique : dettes, faim, mécontentement ouvrier. La "nature" n’est pas un refuge pur : elle est aussi le lieu d’un nouveau combat social, d’un autre "loupisme" latent. On découvre un microcosme rural plein de tensions : le comte, autoritaire mais dépassé ; sa femme, distante ; sa fille, fragile ; les travailleurs agricoles, affamés et révoltés ...
L’arrivée à Neulohe - Wolfgang rêve d’une "renaissance" morale, Fallada joue ici sur une esthétique pastorale trompeuse. "Die Luft war klar, die Felder weit, und Wolfgang atmete, als ob er nach langer Haft zum ersten Mal Freiheit schmeckte" (L’air était pur, les champs s’étendaient au loin, et Wolfgang respirait comme s’il goûtait à la liberté pour la première fois après un long emprisonnement). Wolfgang s’attache à cette vie simple et éprouve enfin un début de transformation morale. Il tente de réorganiser les comptes, pacifier les ouvriers, et sauver Petra qui sombre dans la maladie et la mélancolie.
Mais la situation dégénère : les troubles sociaux s’intensifient, Petra meurt tragiquement (selon certaines lectures, elle symbolise la pureté sacrifiée). Wolfgang reste vivant, transformé intérieurement, prêt à assumer une vie plus honnête et responsable.
- La noblesse se cramponne à ses valeurs abstraites, tandis que la base meurt de faim. La métaphore des yeux "comme des pierres" suggère une humanité en voie d’extinction morale : "Der Graf sprach von Pflicht, von Ehre, von altem Adel - aber die Knechte hatten Hunger, und ihre Augen waren wie Steine" (Le comte parlait de devoir, d’honneur, de vieille noblesse - mais les ouvriers agricoles avaient faim, et leurs yeux étaient comme des pierres).
- La transformation tragique de Petra. Sa mort symbolique précède la mort réelle. Neulohe, loin de la sauver, l’achève : "Petra schlich wie ein Schatten durchs Haus. Ihre Schritte waren so leise, als wolle sie nicht stören, nicht leben" (Petra errait comme une ombre dans la maison. Ses pas étaient si silencieux qu’on aurait dit qu’elle ne voulait ni déranger, ni vivre).
- La campagne devient un baril de poudre. On passe d’un décor pastoral à une zone quasi révolutionnaire. Fallada montre la contagion du chaos social de Berlin à la campagne : "Die Knechte tuschelten nachts in den Ställen. Worte wie 'Revolte', 'Brot', 'Feuer' flogen durch die Luft wie Funken" (Les ouvriers chuchotaient la nuit dans les étables. Des mots comme "révolte", "pain", "feu" volaient dans l’air comme des étincelles).
Cette seconde partie incarne une utopie inachevée : la campagne, supposée être le lieu de purification morale, s’avère elle aussi pleine de "loups". Fallada abandonne le ton ironique et devient plus lyrique, parfois plus sentimental. La crise rurale apparaît comme un reflet plus large de l’échec du système weimarien : même la terre ne sauve plus.
Le roman passe ainsi d’une peinture de la ville comme "enfer moderne" à une allégorie de la fin d’un ordre social aristocratique. Beaucoup de critiques considèrent que cette deuxième partie est plus faible artistiquement, mais elle porte la "réconciliation" morale de Wolfgang, essentielle pour la cohérence du roman.
La "rédemption" ambiguë de Wolfgang - un moment qui suggère sa transformation morale. Mais elle n’est pas triomphale : il s’agit d’une résignation presque mélancolique, une "paix lourde", non d’un salut radieux : "Zum ersten Mal dachte Wolfgang an andere. An die, die kein Essen hatten, an die, die krank waren. Und plötzlich fühlte er eine fremde, schwere Ruhe" (Pour la première fois, Wolfgang pensa aux autres. À ceux qui n’avaient pas de nourriture, à ceux qui étaient malades. Et soudain, il sentit une étrange et lourde paix). Wolfgang trouve un embryon de conscience sociale. C’est le seul rayon fragile d’espoir.

"Der eiserne Gustav" (1938, Gustave-de-Fer)
Un roman dur, puissant dans une époque atroce, comportant deux épisodes, "Inferno" et "Le Voyage à Paris". Vaste fresque de la vie de Berlin au cours des années 1914-1924, ce roman-fleuve va dépeindre l'agonie des classes moyennes allemandes. Au centre de l'action se dresse le personnage haut en couleur du vieux Hackendahl, propriétaire d`une écurie de fiacres. Dur envers lui-même comme envers les siens, il est fier de son surnom de Gustave-de-Fer, qu`il s'efforce de mériter en dépit de toutes les catastrophes. De ses trois fils et deux filles, seul le cadet lui donne un semblant de satisfaction. L`ainé. Otto, brave garçon terrorisé par la tyrannie paternelle, épouse en secret, juste avant de partir au front, une couturière bossue. A sa première permission, il trouve le courage d'avouer cette union à son père : qui le maudit. Au moment de rejoindre son unité, Otto est tué. Le second fils, Eric, le préféré de son père, possède ce mélange d'intelligence et de paresse. de cupidité et d'absence de scrupules qui est propre aux grands profiteurs des époques troubles. Brillant officier à l'arrière, meneur de soldats révoltés, jouisseur cynique, seigneur du marché noir et du trafic de devises, Eric a forcément honte de ses origines, de ce père vulgaire qui s`entête à rester un simple cocher de fiacre. Pendant des années, il évite soigneusement tout contact avec sa famille. Mais. un jour, ruiné par une spéculation malheureuse sur le mark, il est bien obligé de retourner chez ses parents. Or, Gustave n`est plus propriétaire d'écurie; ruiné par la guerre et l`inflation d'abord. par l'apparition des taxis ensuite, il gagne péniblement sa subsistance avec le dernier cheval qui lui reste. Mais il trouve encore dans son porte-monnaie quelques pièces qu'il glisse dans la poche de son fils.
Puis, il le chasse. La fille aînée, devenue une dame respectable, s`est complètement détachée de sa famille. Par contre la cadette, Eva, est tombée sous la coupe d'un louche personnage, souteneur et voleur, prêt à tout. Un dernier sursaut de dignité la pousse à tirer sur son protecteur qui veut la livrer à une bande de soldats démobilisés. Elle le défigure, le rend aveugle, mais, quelques semaines plus tard, revient docilement vers cet homme qui a fait d'elle sa chose. Seul Gustave-de-Fer, roc solide au milieu de la tourmente. est resté fidèle aux vieilles traditions. Certes, il a dû accepter bien des humiliations, mais personne ne pourra l'accuser de la moindre action malhonnête. Il a même trouvé, presque au terme de son existence. le moyen de devenir célèbre : un voyage en fiacre, de Berlin à Paris. Sa compagne est morte. En revanche. Gustave retrouve Heinz, son fils cadet, garçon sobre, courageux et qui, peut-être, méritera un jour de porter le surnom du père ...
En dépit de l'enchevêtrement des situations, Fallada, grâce au don qu'il a de peindre les caractères, donne à son oeuvre une parfaite unité et l'intrigue suit une implacable évolution. L'ouvrage vaut également par la description saisissante des mille aspects de cette ville inquiétante, sordide, agitée qu'était le Berlin de l`inflation ...
"Der eiserne Gustav" de Fallada vaut par la description saisissante des mille aspects de cette ville inquiétante, sordide, agitée qu'était le Berlin de l`inflation ...
- La misère urbaine, la saleté omniprésente, et la figure des enfants laissés à eux-mêmes (motif qu’il reprend aussi dans "Diebesbande") - "Die Straßen Berlins sind voll von Dreck und Papier, als ob ein Sturm Papierkörbe umgestoßen hätte, und überall lungern Bettler und Kinder herum" (Les rues de Berlin sont pleines de saleté et de papiers, comme si un orage avait renversé toutes les poubelles, et partout traînent des mendiants et des enfants).
- Une ville qui ne dort jamais, toujours en ébullition. Cela traduit la frénésie économique et sociale, mais aussi l’instabilité psychologique des habitants -"Die Stadt summte und brummte wie ein gewaltiger Bienenstock, voll rastloser Geschäftigkeit und gieriger Hast" (La ville bourdonnait et vrombissait comme une immense ruche, pleine d’une activité fiévreuse).
- Une ville vivante, menaçante, presque animée d’une volonté propre - "Man spürte hinter jedem Haus, in jeder Ecke, in jedem Flüstern eine drohende Gefahr, als ob die Stadt selbst atmete und lauerte" (On sentait derrière chaque maison, dans chaque recoin, dans chaque murmure, un danger latent, comme si la ville elle-même respirait et guettait).
- Toute la fascination et le dégoût que ressent Fallada pour la ville nocturne, entre attirance et répulsion - "Nachts gehörte die Stadt den Dirnen, den Trunkenbolden, den Taschendieben - Berlin in seinem wahren Gesicht, schmutzig, lärmend, unersättlich" (La nuit, la ville appartenait aux prostituées, aux ivrognes, aux pickpockets - Berlin sous son vrai visage, sale, bruyant, insatiable).
On peut rapprocher la description de Berlin chez Hans Fallada (Der eiserne Gustav) de celle d’Alfred Döblin ("Berlin Alexanderplatz", 1929) ...
- Fallada voit Berlin comme un organisme presque monstrueux, un espace hostile, plein de pièges pour les petites gens. Son regard est plutôt moral, imprégné d’un sentiment de déclin social. Le symbole d’un monde en train de disparaître (celui des cochers, des petites gens honnêtes)...
- Pour Döblin, Berlin est certes un flux, une immense entité organique, mais décrite de manière plus impersonnelle, presque documentaire. Il ne la juge pas moralement. Il décrit un kaléidoscope d’images, de voix, de bruits - un « montage » littéraire inspiré du cinéma. La ville devient un personnage, mais aussi une sorte de mosaïque de fragments modernes, reflet du chaos psychique de Franz Biberkopf. Berlin devient l’expression de la modernité absolue, un collage urbain qui dépasse l’individu...
Les bouleversements causés par la défaite nazie ramèneront à Berlin Fallada.
En juillet 1944, il divorce d'Anna Issel, mais un nouvel épisode violent en août contre son ex-épouse entraîne son incarcération. C'est alors qu'il entreprend la rédaction du roman "Der Trinker", publié seulement en 1950, qui évoque le parcours de l’auteur lui-même, alcoolique et morphinomane depuis sa jeunesse. Il fait ensuite la connaissance d'Ursula Losch, qu'il épouse début 1945. Un membre important du SED, le poète expressionniste Johannes R. Becher, l’incite à venir à Berlin-Est ; Fallada travaille au journal Tägliche Rundschau (de), tout en continuant son travail de romancier. En 1946, il écrit "Der Alpdruck" (Le Cauchemar) et "Jeder stirbt für sich allein" (Seul dans Berlin), « l'un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie », selon Primo Levi...
Hospitalisé en raison de ses problèmes d'addiction à Berlin-Niederschönhausen, Hans Fallada meurt d'un arrêt cardiaque le 5 février 1947....

"Der Alpdruck" (Le Cauchemar, 1947)
La paix régnait enfin, aucune bombe ne déchirait plus l'air, et bien qu'il n'entendit jai un seul bruit, Doll savait que se trouvait ici toute sa famille, tout le peuple allemand, et même aussi tous les peuples d'Europe, "tous aussi démunis et sans défense que lui, tous tourmentés par les mêmes angoisses que lui..." - Alors que la Seconde Guerre mondiale s'achève dans ce bout de campagne allemande, Herr Doll, un écrivain d'âge mûr, est désigné par les Russes maire par intérim de on village. Il y découvre, entre autres, l'égoïsme éhonté de certains Allemands qui ont, pendant la guerre et après, tiré profit de tout, et quoiqu'il tente de faire, tout effort se révèle vain. Le couple qu'il forme avec sa jeune épouse, riche veuve d'une précédente union, ne manquait pas de susciter les médisances. Et son nouveau statut d'homme de pouvoir, au lendemain de la chute des nazis, n'arrange rien...
Le couple, persécuté, doit fuir pour Berlin où tout n'est que ruine et désolation. "Les ruines ne sont pas importantes, mais la vie est importante (...) Et peut-être que les gens apprendront même quelque chose. Apprendront de leurs souffrances, de leurs larmes, de leur sang. Apprendront à contrecoeur, en hésitant ou avec enthousiasme. Apprendront que cela ne peut continuer qu'autrement, qu'il faut apprendre à penser autrement". Doll est aussi décidé à apprendre, "derrière ces premiers pas recommence déjà la pénombre qui assombrit l'avenir de chaque Allemand, mais il ne veut pas y penser ..." ((trad. Denöel).
Fallada pensait pouvoir décrire, à côté de tous les effets secondaires, inévitables, que cette terrible avait apportés à chaque Allemand, des moments de sursaut, des actes nobles et courageux, mais il n'en fut rien. Un "document humain", comme il l'indique dans sa préface ...
"L’auteur de ce roman n’est aucunement satisfait de ce qu’il a écrit dans les pages suivantes, de ce que le lecteur a maintenant imprimé sous les yeux. Lorsqu’il rédigea le plan de ce livre, il s’imaginait décrire, à côté des défaites, des maladies, du découragement – à côté de tous ces effets secondaires inévitables que la fin de cette terrible guerre a apportés à chaque Allemand –, il s’imaginait qu’il pourrait aussi décrire des moments de sursaut. Des actes nobles et courageux, des heures pleines d’espoir – cela ne lui fut pas donné. Ce livre est resté pour l’essentiel un rapport médical, l’histoire de cette apathie qui s’est emparée de la majeure partie, et surtout de la plus décente partie du peuple allemand en avril 1945, et dont beaucoup de gens ne se sont pas encore libérés aujourd’hui.
Le fait que l’auteur n’ait rien pu y changer, qu’il n’ait pas pu apporter plus de légèreté et de gaieté à ce roman, ne tient pas qu’à sa manière de voir, cela tient surtout à l’état général du peuple allemand, qui aujourd’hui encore, plus d’un an et trois mois après la fin des hostilités, est toujours sombre.
Si le roman est, malgré ces défauts, proposé au public, c’est parce qu’il est peut-être un document humain, un rapport le plus fidèle possible de ce que les Allemands et les Allemandes ressentirent, souffrirent, accomplirent, d’avril 1945 jusqu’à l’été suivant. Peut-être que dans les prochains temps, déjà, on ne comprendra plus cette paralysie qui influença de façon si funeste cette première année après la guerre. Une histoire médicale donc, pas une œuvre – mes excuses ! (L’auteur lui non plus ne pouvait pas sortir de sa peau, l’auteur lui aussi était « paralysé ».)
Il a été question à l’instant de « rapport fidèle ». Mais rien de ce qui est raconté dans les pages qui suivent ne s’est passé comme on l’a écrit ici. Un livre comme celui-ci ne peut pas, déjà pour des raisons de place, dire tout ce qui est arrivé ; il a fallu constamment faire des choix, il a fallu inventer, les faits rapportés ne pouvaient être utilisés sous leur première forme et durent être modifiés. Cela ne change rien au fait que tout ceci est pourtant « vrai » : tout ce qui est raconté ici pourrait s’être déroulé ainsi et est aussi un roman, donc une création de l’imaginaire.
La même chose vaut pour les personnages présentés : tels qu’ils ont été décrits ici, aucun n’existe en dehors de ce livre. Ces événements ont suivi les lois de la narration, et il en fut de même pour les personnages. Certains sont inventés, d’autres sont composés à partir de plusieurs.
Ce ne fut pas réjouissant d’écrire ce roman, mais il semblait important à l’auteur. Il garda toujours à l’esprit, entre les sursauts et les défaites, ce qui fut vécu intérieurement et extérieurement après la fin de la guerre. Presque tous avaient perdu la foi et finirent pourtant par retrouver un peu de courage et d’espoir – voilà de quoi il est question ici."
Berlin, août 1946

"Jeder stirbt für sich allein" (Seul dans Berlin, 1947)
"Jeder stirbt für sich allein", tout le monde meurt pour soi-même - Les évènements de ce livre, écrit Hans Fallada, reprennent à grands traits des dossiers de la Gestapo concernant l'activité illégale d'un couple d'ouvriers de Berlin pendant les années 1940 à 1942, et dans ce livre, qui reste un roman, il est presque uniquement question de gens qui ont lutté contre le régime d'Hitler et de leurs persécuteurs. Un tiers de ce livre se déroule dans des prisons et des asiles de fous : c'est que derrière la façade triomphale du Reich qui, en mai 1940, fête sa campagne de France, se cache un monde de misère et de terreur. Fallada nous raconte le quotidien d'un modeste immeuble de la rue Jablonski à Berlin : persécuteurs et persécutés y cohabitent. On rencontre Frau Rosenthal, Juive, dénoncée et pillée par ses voisins, mais aussi Baldur Persicke, jeune recrue des SS qui terrorise sa famille. La première partie s'ouvre avec les Quangel : désespérés d'avoir perdus leur fils au front, ils inondent la ville de tracts contre Hitler et déjouent la Gestapo avant de connaître une terrifiante descente aux enfers ... (trad. Plon, 1967, Denoël, Laurence Courtois, 2014). Fiévreusement, Fallada écrivit son dernier roman en moins de quatre semaines à l’automne 1946 ...
Erster Teil - Die Quangels
1. Die Post bringt eine schlimme Nachricht
Die Briefträgerin Eva Kluge steigt langsam die Stufen im Treppenhaus Jablonskistraße 55 hoch. Sie ist nicht nur deshalb so langsam, weil ihr Bestellgang sie ermüdet hat, auch weil einer jener Briefe in ihrer Tasche steckt, die abzugeben sie haßt, und jetzt gleich, zwei Treppen höher, muß sie ihn bei Quangels abgeben. Vorher hat sie den Persickes in der Etage darunter den Schulungsbrief auszuhändigen. Persicke ist Amtswalter oder Politischer Leiter oder sonst was in der Partei – Eva Kluge bringt alle diese Ämter noch immer durcheinander. Jedenfalls muß man bei Persickes »Heil Hitler!« grüßen und sich gut vorsehen mit dem, was man sagt. Das muß man freilich überall, selten mal ein Mensch, dem Eva Kluge sagen kann, was sie wirklich denkt. Sie ist politisch gar nicht interessiert, sie ist einfach eine Frau, und als Frau findet sie, daß man Kinder nicht darum in die Welt gesetzt hat, daß sie totgeschossen werden. Auch ein Haushalt ohne Mann ist nichts wert, vorläufig hat sie gar nichts mehr, weder die beiden Jungen noch den Mann, noch den Haushalt. Statt dessen hat sie den Mund zu halten, sehr vorsichtig zu sein und ekelhafte Feldpostbriefe auszutragen, die nicht mit der Hand, sondern mit der Maschine geschrieben sind und als Absender den Regimentsadjutanten nennen.
La poste apporte une mauvaise nouvelle
La factrice Eva Kluge monte lentement les marches du numéro 55 de la rue Jablonski. Lentement parce que sa tournée l'a beaucoup fatiguée, mais surtout parce qu'elle a dans sa sacoche une de ces lettres qu'elle déteste apporter, et là, bientôt, deux étages plus haut, elle va devoir la donner aux Quangel. La femme la guette sans doute déjà, cela fait plus de deux semaines qu'elle guette la factrice pour savoir s'il n'y aurait pas une lettre du front pour elle. Avant que la factrice Kluge remette cette lettre militaire tapée à la machine à son destinataire, elle doit d'abord donner aux Persicke, à l'étage, le Völkischer Beobachter. Persicke est cadre au parti, ou bien dirigeant politique, ou autre chose encore - bien qu'Eva Kluge, depuis qu'elle travaille à la poste, soit aussi membre du parti, elle confond encore toutes ces fonctions. Quoi qu'il en soit, il faut donner du "Heil Hitler!" aux Persicke, et faire bien attention à tout ce qu'on leur dit. Même si, bien sûr, c'est partout qu'il faut faire attention, rares sont les gens à qui Eva Kluge peut dire ce qu'elle pense vraiment. La politique ne l'intéresse pas du tout, elle est une femme, voilà tout, et en tant que femme, elle pense qu'on ne met pas des enfants au monde pour qu'ils aillent se faire tuer. Et aussi qu'un foyer sans mari ne vaut rien, et pour l'instant elle n'a plus rien de tout cela, ni les deux garçons, ni le mari, ni le foyer. Au lieu de quoi, elle doit juste garder sa bouche fermée, être très prudente et apporter d'horribles lettres de la poste militaire qui ne sont pas écrites à la main mais tapées à la machine, et qui donnent l'aide de camp du régiment comme expéditeur.
Sie klingelt bei Persickes, sagt »Heil Hitler!« und gibt dem alten Saufkopp seinen Schulungsbrief. Er hat auf dem Rockaufschlag das Partei- und das Hoheitszeichen sitzen und fragt: »Wat jibt's denn Neues?«
Sie antwortet: »Haben Sie denn die Sondermeldung nicht gehört? Frankreich hat kapituliert.«
Persicke ist durchaus nicht mit ihr zufrieden. »Mensch, Frollein, det weeß ick natürlich; aber Se saren det so, als ob Sie Schrippen vakoofen täten! Det müssen Se zackig rausbringen! Det müssen Se jedem saren, der keenen Radio hat, det überzeugt noch die letzten Meckerköppe! Der zweite Blitzkrieg, hätten wa ooch geschafft, und nu ab Trumeau nach England! In 'nem Vierteljahr sind die Tommys erledigt, und denn sollste mal sehen, wie unser Führer uns leben läßt! Denn können die andern bluten, und wir sind die Herren der Welt! Komm rin, Mächen, trink 'nen Schnaps mit! Amalie, Erna, August, Adolf, Baldur – alle ran! Heute wird blaujemacht, heute wird keene Arbeet anjefaßt! Heute begießen wir uns mal die Neese, und am Nachmittag gehen wa bei de olle Jüdische in de vierte Etage, und det Aas muß uns Kaffee und Kuchen jeben! Ick sare euch, die Olle muß, jetzt kenne ick keen Abarmen mehr!«
Elle sonne chez les Persicke, dit "Heil Hitler!" et tend son Völkischer au vieil ivrogne. Il a déjà son insigne du parti et les emblèmes nationaux épinglés sur le revers de sa veste - elle oublie tout le temps de mettre son insigne du parti - et il demande : "Quoi d'neuf? "
Elle répond prudemment : "Oh, je sais pas. Je crois bien que la France a capitulé." Et elle ajoute rapidement : "Est-ce qu'il y a quelqu'un chez les Quangel ?" - Persicke ne prête aucune attention à sa question. Il ouvre le journal. "Mais oui, c'est écrit là : la France a capitulé. Mais enfin, Fräulein, et vous dites ça comme ça, comme si vous refourguiez des petits pains! Un peu d'jus faut que ça claque! Faut le dire à tout le monde chez qui vous allez, et emporter le morceau chez les derniers rouspéteurs! La deuxième guerre éclair, serait déjà ça de fait et maintenant vas-y, Totor, direction l'Angleterre! Dans trois mois les Tommies seront à plat, alors tu verras bien comment qu'y nous laisse vivre, not' Führer! C'est qu'les autres y vont saigner, et nous on sera les rois du monde! Rent, ma fille, viens boire un schnaps! Amalie, Erna, August, Adolf, Baldur, venez tous là! Aujourd'hui on sèche, aujourd'hui on va pas au turbin! Aujourd'hui on s'en met plein la lampe, aujourd'hui la France a capitulé, et cet après-midi on ira peut-être chez la vieille youpine au quatrième, et tu vas voir que la vieille garce va nous servir soncafé et ses gâteaux! Je vous dis que ça, moi, la vioque elle va cracher, maintenant que la France est à nos pieds y a plus de pitié qui tienne! Maintenant on est les rois du monde, et y vont tous faire coucouche panier devant nous!"
Während Herr Persicke, von seiner Familie umstanden, sich in immer aufgeregteren Ausführungen ergeht und die ersten Schnäpse schon hinter die Binde zu gießen beginnt, ist die Briefträgerin in die Etage darüber hinaufgestiegen und hat bei den Quangels geklingelt. Sie hält den Brief schon in der Hand, ist bereit, sofort weiterzulaufen. Aber sie hat Glück, nicht die Frau, die meist ein paar freundliche Worte mit ihr wechselt, sondern der Mann mit dem scharfen, vogelähnlichen Gesicht, dem dünnlippigen Mund und den kalten Augen öffnet ihr. Er nimmt wortlos den Brief aus ihrer Hand und zieht ihr die Tür vor der Nase zu, als sei sie eine Diebin, vor der man sich vorzusehen hat.
Eva Kluge zuckt nur die Achseln und geht wieder die Treppen hinunter. Manche Menschen sind eben so; solange sie die Post in der Jablonskistraße austrägt, hat der Mann noch nie ein einziges Wort zu ihr gesagt. Nun, laß ihn, sie kann ihn nicht ändern, hat sie doch nicht einmal den eigenen Mann ändern können, der mit Kneipensitzen und mit Rennwetten sein Geld vertut, und der zu Haus nur dann auftaucht, wenn er ganz abgebrannt ist.
Bei den Persickes haben sie die Flurtür offengelassen, aus der Wohnung klingt Gläsergeklirr und das Lärmen der Siegesfeier. Die Briefträgerin zieht die Flurtür sachte ins Schloß und steigt weiter hinab. Dabei denkt sie, daß dies eigentlich eine gute Nachricht ist, denn durch den raschen Sieg über Frankreich wird der Friede nähergerückt. Dann kommen die beiden Jungen wieder.
Bei diesen Hoffnungen aber stört sie das ungemütliche Gefühl, daß dann solche Leute wie die Persickes ganz obenauf sein werden. Solche zu Herren haben und immer den Mund halten müssen und nie sagen dürfen, wie einem ums Herz ist, das scheint ihr auch nicht das Richtige.
Pendant que Herr Persicke, entouré de sa famille, se répand en discours de plus en plus enflammés et qu'il s'en jette déjà plus d'un dans le gosier, la factrice a depuis longtemps atteint l'étage du dessus, et elle a sonné chez les Quangel. Elle tient déjà la lettre à la main, elle est prête à repartir aussitôt. Mais elle a de la chance; ce n'est pas la femme, qui la plupart du temps échange quelques mots sympathiques avec elle, c'est son mari qui lui ouvre, cet homme au visage acéré, au profil d`oiseau, avec une bouche étroite, des lèvres fines et des yeux froids. Il lui prend sans un mot la lettre des mains et il lui claque la porte au nez comme si elle était une voleuse dont il faut prendre garde.
Eva Kluge hausse seulement des épaules et elle redescend l'escalier. Certaines personnes sont comme ça, voilà tout; depuis qu'elle distribue le courrier dans la rue Jablonski, l'homme ne lui a encore jamais adressé un seul mot, pas même «Heil Hitlerl» ou «Bonjour», bien que, elle le sait, il ait aussi un poste à l'Arbeitsfront. Bah, laisse donc, elle ne peut pas le changer, elle n'a déjà pas réussi à changer son propre mari qui dilapide tout son argent dans les cafés et dans les courses de chevaux, et qui ne refait surface que quand il est fauché.
Les Persicke dans l'excitation ont laissé leur porte ouverte, on entend dans l'appartement le tintement des verres et le chahut de la victoire. La factrice referme doucement la porte et continue à descendre. Et elle se dit que finalement c`est une bonne nouvelle car, avec cette victoire rapide sur la France, la paix s'est rapprochée. Alors ses deux garçons vont revenir, et elle pourra à nouveau leur offrir un toit. Mais ses espoirs sont troublés par le sentiment inconfortable qu'alors ce sont des gens comme les Persicke qui seront en haut de l'échelle. Que ce soient des gens comme eux qui soient les maîtres, et qu'il faille toujours garder la bouche fermée, et ne jamais pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur, ça ne lui semble pas non plus très juste.
Elle pense aussi furtivement à l'homme au visage froid, au visage de rapace à qui elle a remis la lettre de la poste militaire, et qui grimpera sûrement, lui aussi, sur l'échelle du parti, et elle pense à la vieille ]uive Rosenthal, là-haut, au quatrième étage, dont la Gestapo est venue chercher le mari il y a deux semaines. Elle fait pitié, cette femme. Les Rosenthal avaient autrefois une boutique de linge dans la Prenzlauer Allee. Puis elle a été aryanisée, et maintenant ils sont venus chercher le mari qui ne doit pas avoir loin de soixante-dix ans. Ces deux vieux n'ont sûrement jamais fait de mal àpersonne de toute leur vie, et ils ont toujours fait crédit, aussi à Eva Kluge quand il n'y avait plus d'argent pour la layette, et chez les Rosenthal la marchandise n'était ni plus mauvaise ni plus chère que dans les autres boutiques. Non, ça ne veut pas rentrer dans la tête d'Eva Kluge qu'un homme comme Rosenthal soit plus mauvais qu'un Persicke, seulement parce qu'il est juif. Et maintenant la vieille femme est là-haut dans son appartement, seule au monde, et elle n'ose même plus sortir dans la rue. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'elle part faire ses courses avec son étoile jaune, elle a sûrement faim. Non, pense Eva Kluge, et même si nous gagnons dix fois sur la France, on peut pas dire que les choses soient vraiment justes chez nous...."

Un roman de près de 900 pages, divisé en quatre parties et 76 chapitres. Alors que la première partie tourne principalement autour de la population berlinoise, avant que l'ombre de la Gestapo ne vienne à s'imposer dramatiquement à partir de la deuxième partie : encore n'est-ce pas un combat épique opposant brutalité et innocence héroïque, mais un enchaînement de petits fait de la vie en temps de guerre, où le comportement des uns va provoquer la chute des autres : au début, tout semblait aller bien, au fond peu d'opposition au national-socialisme, et soudain, c'est la mort du fils, la guerre qui frappe, tout s'enchaîne et tout va mal, soudain, on ne verra bientôt plus qu’oppression, haine, coercition et souffrance, beaucoup de souffrance, "so viel Leid" ..
Nous sommes en 1940: la factrice Eva Kluge apporte au couple Quangel une lettre de campagne annonçant la mort de leur fils unique Otto. C'est le cœur lourd qu'Otto Quangel annonce la nouvelle à Gertrud ("Trudel") Baumann, qui était quasiment fiancée à son fils. La jeune femme lui révèle alors qu'elle fait partie d'une cellule communiste dans l'usine d'uniformes où elle est employée comme couturière. À l'étage au-dessus des Quangel vit Lore Rosenthal, de confession juive, son mari Siegfried a été emmené par la Gestapo deux semaines plus tôt. Alors qu'elle passe la nuit chez les Quangel, tout comme Trudel, deux hommes forcent leur porte pour vider leur appartement, Enno Kluge et Emil Barkhausen ...
Enno Kluge a été mis à la porte par sa femme Eva, la factrice : les deux fils qui lui restent (trois sont morts prématurément), Karlemann et Max, sont partis à la guerre. Emil Barkhausen vit avec sa femme Otti et son fils Kuno-Dieter, âgé de treize ans, dans le voisinage des Quangel et de Lore Rosenthal, mais dans la cave de l'arrière-boutique. Le fait qu'Otti, qui s'était prostituée dans la rue avant son mariage, reçoive des clients dans l'appartement convient parfaitement à Barkhausen, car le petit criminel ne pourrait sinon pas nourrir sa famille.
Kluge et Barkhausen, au cours de leur cambriolage, font main basse sur les alcools et sont ivres lorsque Baldur Persicke, un lycéen de seize ans, les assomme et récupère les objets volés. Après le cambriolage, Lore Rosenthal est accueillie par l'ancien conseiller à la cour d'appel Fromm, qui habite également dans la maison : il met à sa disposition la chambre de sa fille, décédée en 1933, et lui de ne pas la quitter ni de se montrer à la fenêtre. Au bout de quelques jours, Lore Rosenthal ne supporte plus d'être enfermée, avale le reste des somnifères que Fromm lui a donnés et quitte les lieux en titubant : mais elle passe devant Baldur Persicke dans la cage d'escalier, celui-ci alerte la police, et quelques minutes plus tard, le commissaire Rusch et son collaborateur Friedrich arrivent sur place. L'enquête établit qu'elle s'est cachée dans la maison, Friedrich interroge la vieille femme, celle-ci grimpe sur le rebord de la fenêtre, se jette en bas dans la cour et meurt sur le coup.
Otto et Anna Quangel n'étaient pas opposés à Hitler dès le début. Au contraire, ils ont réagi avec reconnaissance à la réduction du chômage, qui a permis à Otto de trouver plus facilement un emploi. Il occupe une fonction au sein du Front du travail, et Anna s'engage dans l'association des femmes. Tous deux perdent cependant leurs fonctions, et cela leur convient parfaitement, car ils ont depuis pris leurs distances : la mort de leur fils au front les voit réagir contre le régime, Otto Quangel se procure de l'encre, un porte-plume et des cartes postales et, un dimanche, au prix d'un travail laborieux, écrit en lettres d'imprimerie maladroites sur l'une des cartes selon laquelle le Führer a assassiné son fils et assassinera tous les fils. L'une de ces cartes est trouvée par l'acteur Max Harteisen, un homme de trente-six ans qui ne se voit plus proposer d'engagements parce qu'il a joué dans des films pacifistes et critiqué Joseph Goebbels. Il sort tout juste de chez Erwin Toll, son ami avocat, qui a son cabinet dans cette maison. Comme Max Harteisen doit craindre que quelqu'un l'ait observé pendant qu'il prenait la carte, il se précipite chez Toll, désemparé. Dès qu'il se remet de sa frayeur, celui-ci appelle le responsable politique de l'immeuble et remet la carte au fonctionnaire.
Un commissaire de la Gestapo du nom d'Escherich dirige l'enquête et entre en scène. Au bout de six mois, quarante-quatre petits drapeaux marquent sur une carte routière de Berlin les endroits où des cartes contenant des appels à la critique du régime ont déjà été trouvées. C'est avec Enno Kluge, suspecté un temps, que se poursuit le récit : dénoncé par l'assistance d'un médecin peu regardant sur les arrêts de travail, Mademoiselle Kiesow, arrêté puis libéré par la Gestapo, faute de preuve, quittant sa maîtresse Lotte pour s'installer chez la veuve Hedwig ("Hete") Häberle sous le faux nom de Hans Enno en racontant qu'il est poursuivi par la Gestapo (le mari de celle-ci a été arrêté par la Gestapo en 1934 et est mort dans un camp de concentration soi-disant d'une pneumonie). Hete Häberle s'aperçoit rapidement que Kluge n'est qu'un petit escroc, des chantages financiers à son propos opposent tant la veuve, qui s'interpose malgré tout, qu'Emil Barkhausen, qui entend vendre son ancien compagnon, et le commissaire Escherich. Ce dernier abattra Kluge et la police conclura qu'il s'agit d'un suicide...
Eva Kluge est suspendue du service postal en raison de sa demande de démissionner du NSDAP. Au lieu d'attendre de nouvelles instructions dans son appartement, elle se rend à Ruppin chez sa sœur. C'est là qu'elle apprend la mort d'Enno. Son fils Max est tué en Russie. Quelque temps plus tard, elle se rend au tribunal du parti à Berlin. Après avoir passé cinq jours en prison, elle dissout son ménage dans la capitale, retourne dans le village près de Ruppin où vit sa sœur et loue une chambre meublée dans laquelle s'installe finalement son nouvel ami, l'instituteur suppléant Kienschäper. Eva Kluge ne travaille pas seulement dans l'agriculture, mais aussi comme infirmière, couturière et jardinière. Alors qu'elle travaille dans les champs, un garçon affamé lui vole le pain qu'elle a apporté. Il s'appelle Kuno-Dieter. Au lieu de le dénoncer, elle l'accueille chez elle et persuade Kienschäper de l'instruire. Quelque temps plus tard, Eva et Kienschäper se marient.
Trudel Baumann, jadis belle soeur de Quangel, tombe amoureuse de Karl Hergesell, un électricien qui travaille dans la même usine d'uniformes. Ils se mettent en couple et se marient. Ils déménagent à Erkner, une petite ville au sud-est de Berlin. En 1942, Trudel, enceinte de cinq mois, observe par hasard Otto Quangel déposer une carte dans une cage d'escalier de Berlin. Elle prend peur en lisant ce qui y est écrit, mais partage son avis selon lequel il faut faire quelque chose contre le régime criminel nazi, mais le met en garde ...
Pendant ce temps, le supérieur d'Escherich, l'Obergruppenführer Prall, perd patience et confie l'affaire de l'enquête relative aux cartes au Kriminalrat Zott. Quelque temps plus tard, Quangel est vu par le secrétaire général de la poste Millek en train de déposer une carte dans une cage d'escalier. Celui-ci le poursuit dans la rue et appelle la police. Anna, qui attendait son mari devant la maison, a la présence d'esprit de jeter l'autre carte qu'elle a dans sa poche dans la boîte aux lettres la plus proche avant de se rendre chez Otto. Les policiers ne trouvent rien de suspect chez le couple, Quangel est lui-même libéré, les autorités sont persuadées que car le cartographe qu'il recherche est un solitaire. Klebs est alors chargé d'enquêter sur ce profil et arrive ainsi chez le vieux Persicke : son fils Baldur est étudiant, ses autres fils sont à la guerre, sa femme s'est enfuie chez des parents pour échapper à cet alcoolique irascible et l'a laissé à sa fille, qui a toutefois immédiatement commencé à travailler comme surveillante au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, afin de ne plus devoir vivre avec son père.
Klebs en profite pour voler l'ivrogne, mais il est surpris par Emil Barkhausen : celui-ci est arrêté par deux policiers que l'ancien conseiller à la Cour suprême Fromm avait fait venir entre-temps. Un tribunal condamne Klebs et Barkhausen à des peines de prison. Les enfants de Barkhausen sont placés dans un foyer. Le commissaire Escherich, qui a entre-temps a repris l'enquête après que le Kriminalrat Zott soit tombé en disgrâce auprès de l'Obergruppenführer Prall, aboutit à Otto Quangel, l'arrête, effectue une perquisition au domicile du couple et saisit une carte inachevée. Anna est alors arrêtée à son tour. Au quartier général de la Gestapo, on célèbre le succès. Un succès qui révèle à Escherich que la justice est un leurre, le voici qui se suicide. Prall se déchaîne, crie à la désertion et fait venir Quangel ...
Lors de l'interrogatoire mené par Laub, le successeur d'Escherich, Anna Quangel mentionne à qui son fils était quasiment fiancé. Trudel Hergesell, qui vient de faire une fausse couche, et son mari reçoivent ainsi la visite de la Gestapo. Pendant que Trudel est interrogée, Karl tente de brûler dans la cuisine le ticket de consigne d'une valise que Grigoleit - l'un des membres de la cellule communiste de l'entreprise, dissoute entre-temps - lui a confiée. Un policier empêche la destruction de la pièce à conviction. La valise contient une machine à imprimer. Les époux sont menottés, Karl mourra en prison et sa femme se jettera dans le vide. Le frère d'Anna, Ulrich Heffke, et son épouse sont également emprisonnés. Heffke tente de se pendre à deux reprises pour être finalement conduit à l'hôpital psychiatrique de Berlin-Wittenau, où il sera assassiné quelque temps plus tard dans le cadre du programme d'euthanasie des nazis. Le vieux Persicke est lui aussi conduit à l'hôpital psychiatrique après un delirium tremens. Le docteur Martens, le médecin traitant, tente de donner à son fils Baldur Persicke l'espoir d'une guérison prochaine, mais le national-socialiste fanatique précise que son père doit rester enfermé à long terme.
Sous la présidence de Feisler, le tribunal populaire de Berlin condamne le couple Quangel à la peine de mort pour trahison. Fromm, ancien conseiller à la Cour suprême, fournit discrètement une ampoule de cyanure au couple, Otto Quangel, fort de pouvoir mettre fin à sa vie à tout moment, se sent ainsi libre. Toutefois, il attendra que le couperet lui tranche la tête pour mordre l'ampoule. Anna, qui ignore l'exécution de son mari, vit encore pendant des mois dans l'espoir d'être menée avec lui à l'échafaud. Au début de l'été 1946, Kuno Kienschäper rencontre par hasard son père Emil Barkhausen dans la rue. Le garçon, qui a été adopté par le couple Kienschäper, ne veut plus entendre parler de lui. Il le menace d'appeler la police pour le faire partir du quartier....

Erich Kästner (1899-1974)
Ennemi de la fausse profondeur, romancier, moraliste, poète et journaliste, Erich Kästner avait trois exigences : la sincérité du sentiment, la précision de la pensée, la simplicité de la langue, que nous retrouvons particulièrement dans son œuvre poétique, "Dr. Käsmer lyrische Hausapotheke" (1949, Pharmacie poétique du docteur Erich Kästner), où l'auteur se sert tout à la fois de la satire mordante, du rire, du persiflage, de l'ironie et de la critique. Il avait écrit son roman intitulé "Fabian" en une dizaine de mois, d’octobre 1930 jusqu’en juillet 1931 : c’est son seul roman conçu pour un lectorat adulte. Kästner est surtout devenu célèbre pour sa poésie et ses nombreux livres pour enfants, dès 1929, avec « Emil und die Detektive », puis en 1934, «Emil und die drei Zwillinge», histoire d'un jeune garçon qui se fait voler tout son argent. Emile va passer à Berlin quelques jours chez sa grand-mère, et tandis qu'il dort allongé sur la banquette, son compagnon de voyage, Grundeis, lui prend l'enveloppe attachée par une épingle à la doublure de sa veste, et contenant un billet de cent marks et deux de vingt. Commence alors une poursuite animée à travers la ville. Ses souvenirs de jeunesse racontés dans "Als ich ein kleiner Junge war" (1957) possèdent le même ton où se mêlent naïveté et maturité ...
Après les années relativement stables de la République de Weimar à la fin des années 1920, l’Allemagne est entrée de plus en plus dans une crise économique profonde, dont profitent principalement les forces nationalistes d'extrême droite. S'inspirant du célèbre "Berlin Alexanderplatz" (1929) d'Alfred Döblin, le livre de Kästner s'en démarque toutefois avec ses scènes érotiques permissives et ses descriptions parfois très détaillées de sujets politiques hautement sensibles : le livre parut finalement le 15 octobre 1931 à la Deutsche Verlags-Anstalt à Stuttgart sous un titre inoffensif "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" alors que trois propositions de titre avaient été rejetées par l'éditeur, "Sodom und Gomorrha", "Saustall", "Der Gang vor die Hunde". Mais le roman n'en fut pas moins jugé « dégénéré » (entartet), et fut brûlélors de l’autodafé organisé par le NSDAP le 10 mai 1935 sur la Bebelplatz à Berlin ...
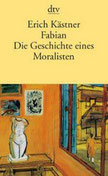
"Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" (Fabian, histoire d'un moraliste, 1931)
Fabian s'inscrit dans un courant satirique typiquement berlinois qui aborde non sans
complaisance exhibitionniste le problème de l'émancipation sexuelle de la femme. Dans la
satire de l`époque, le spectacle du dévergondage occupe une place prépondérante, et le comique de situation qu`il produit est accentué par le rôle de héros passif dévolu à Jacob Fabian. Erich Kästner voulait mettre en garde, écrira-t-il, contre l'abîme dans lequel l'Allemagne se précipitait, le chômage massif, la dépression psychique qui suit la crise économique, l'addiction à l'alcool, l'activité des partis sans scrupules comme des signes avant-coureurs de la crise imminente, et surtout le silence inquiétant qui précède la tempête, la paresse des cœurs, semblable à une paralysie épidémique. "Certains ont été poussés à s'opposer à la tempête et au silence. Ils ont été mis de côté. On préférait écouter les crieurs de foire et les joueurs de tambour qui vantaient leurs pansements à la moutarde et leurs solutions miracles toxiques. On courait après les joueurs de flûte, dans l'abîme où nous sommes maintenant arrivés, plus morts que vifs, et où nous essayons de nous installer comme si de rien n'était." (Es trieb manche, sich dem Sturm und der Stille entgegenzustellen. Sie wurden beiseite geschoben. Lieber hörte man den Jahrmarktschreiern und Trommlern zu, die ihre Senfpflaster und giftigen Patentlösungen anpriesen. Man lief den Rattenfängern nach, hinein in den Abgrund, in dem wir nun, mehr tot als lebendig, angekommen sind und uns einzurichten versuchen, als sei nichts geschehen).
L`action se déroule à Berlin au début des années 1930 alors que sombre la république de Weimar, en pleine catastrophe économique et politique. Jacob Fabian, jeune intellectuel issu de la petite bourgeoisie. est obligé de végéter dans un emploi de rédacteur publicitaire. Théoriquement démocrate, par décence plus que par conviction, il promène sur l`événement le regard froid du "moraliste" qui enregistre avec l'imperturbabilité apparente caractérisant le courant littéraire de la "Nouvelle objectivité" (Neue Sachlichkeit) les effets destructeurs exercés sur le tissu social et la moralité ambiante par le chômage, la montée des extrémismes, l`impuissance du pouvoir et la dissolution des valeurs. Dans ce monde qui assiste à sa propre déchéance, Fabian et son ami Labude veulent préserver leur intégrité ..
Fabian est un moraliste parce qu'au lieu d'orienter sa vie vers le profit et le gain, il l'oriente selon des principes éthiques et moraux et croit en la bonté de l'être humain. L'argent, le pouvoir et l'ascension professionnelle ne signifient rien pour lui : "Je peux faire beaucoup de choses et je ne veux rien. Pourquoi devrais-je avancer ? Pour quoi et contre quoi ? Supposons que je sois le porteur d'une fonction. Où est le système dans lequel je peux fonctionner ? Il n'est pas là, et rien n'a de sens (Ich kann vieles und will nichts. Wozu soll ich vorwärtskommen? Wofür und wogegen? Nehmen wir einmal an, ich sei der Träger einer Funktion. Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da, und nichts hat Sinn). [...] Pourquoi devrais-je gagner de l'argent ? Qu'est-ce que je vais faire de cet argent ? [...] Je ne suis pas un capitaliste, je te le répète ! Je ne veux pas d'intérêts, je ne veux pas de plus-value. [...] Mais qu'est-ce que je fais du pouvoir, puisque je ne souhaite pas être puissant ? La soif de pouvoir et la soif d'argent sont des frères et sœurs, mais ils n'ont aucun lien de parenté avec moi". (Aber was fange ich mit der Macht an, da ich nicht mächtig zu sein wünsche? Machthunger und Geldgier sind Geschwister, aber mit mir sind sie nicht verwandt). Allors que Fabian cultive l`abstention politique, Labude, quant à lui, milite pour un libéralisme solidariste inspiré des théories de Walther Rathenau. Tous deux mourront en pleine jeunesse, dans des circonstances que l`auteur s`est ingénié à rendre absurdes : morts symboliques du déclin de la république de Weimar. où ce genre d'hommes n'a plus sa place.
L`aveuglement et la brutalité incorrigibles du petit-bourgeois allemand donnent lieu à une série de vignettes ironiques, qui ont fait le succès du livre. L'envahissement de l`histoire par l`absurde, la vanité des efforts déployés par ceux qui veulent rester des purs forment la thématique de ce roman, qui n'est pas exempt par ailleurs de provocations délibérées. Dans ce roman qui se veut libéral, mais qui est plutôt nihiliste, on assiste à un déferlement de misogynie. Les débuts de la révolution sexuelle sont décrits comme un symptôme supplémentaire du processus de dégradation de l`être humain dans un monde rongé par la logique du capitalisme monopolisateur (Trad. Balland.1983).
