- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman

Carlo Emilio Gadda (1893-1973), "Il castello di Udine" (1934), "La cognizione del dolore" (1963, La Connaissance de la Douleur, publié partiellement dans les années 1938–1941), "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" (1957, L'Affreux pastis de la rue des Merles), "Accoppiamenti giudiziosi" (1963, Des accouplements bien réglés) - ...
Last update : 12/12/2017

Carlo Emilio Gadda est célèbre en Italie pour avoir pulvérisé l'italien standard : son écriture fusionne dialectes (milanais, romain), langues savantes (latin, grec), jargon technique (ingénierie, philosophie), argot et néologismes. Personne en Italie n'a poussé le baroque linguistique aussi loin. Contre le bel canto de la prose italienne, il impose un chaos organisé, miroir d'un monde fragmenté, comme on aime à le dire. Son œuvre est souvent comparée à celle de Joyce ou de Céline pour cette inventivité linguistique.
Une écriture au service d'un projet de Critique Totale par ce qu'on a pu appelé la "pluriperspective". Ainsi, dans "La Connaissance de la Douleur" ou "L'Affreux Pastis de la rue des Merles", il dépeint la société italienne (bourgeoisie, bureaucratie, fascisme) non par un récit linéaire, mais par une accumulation de points de vue contradictoires, plus à même, semble-t-il, de révéler hypocrisies et absurdités.
C’est une satire totale, sans complaisance. L'Italie avait une tradition baroque (Marino, le maniérisme), mais Gadda la radicalise : son baroque est systémique, structurant la pensée même. Un détail infime devient obsessif, le réel est un réseau de connexions à déchiffrer – comme un ingénieur fou analysant un moteur social en surchauffe.
Comme Joyce et Proust, il explore la conscience et la mémoire, mais ce qu'il traque, ce sont les systèmes (physiques, sociaux, psychiques) qui régissent le chaos. Son réalisme n'est pas psychologique, mais encyclopédique et parodique. Ici, le vulgaire côtoie le sublime ...
On l'a dit "ingénieur-écrivain", et sa formation d'ingénieur (tout comme sa maniaquerie scientifique) est fondatrice. Il va décrire le monde comme une machine détraquée, un circuit de causes/effets pervertis (Le Château d'Udine). Aucun écrivain dans le monde n'a sans doute autant fusionné technique et tragique grotesque.
Dans son Œuvre-Phare, "L'Affreux Pastis de la rue des Merles" (1957), un policier à la polyphonie délirante, une enquête sur un meurtre devient prétexte à disséquer la Rome fasciste. Et chaque personnage parlera dans son idiome (du juge pédant au voyou romain), créant une cacophonie géniale. Et si le crime reste insoluble c'est que le monde est un gâchis (Garbuglio, pasticciaccio, un gâchis épouvantable) qu'on ne peut espérer déchiffrer ni connaître ...

Carlo Emilio Gadda se distingue d'autres écrivains anti-fascistes italiens tels que Elio Vittorini (1908–1966), Alberto Moravia (1907–1990) ou Italo Calvino (1923–1985) en s'attaquant non pas directement au fascisme mais aux éléments qui le rende possible, ainsi l’obsession italienne de la façade et du masque : la maladie n’est pas seulement politique, mais psychique et linguistique.
De là son obsession du détail, sa syntaxe sinueuse et éclatée, ses digressions — tout cela fonctionne comme une résistance littéraire à la rigidité idéologique. Il déconstruit le langage officiel et exhibe la vérité chaotique du monde...
Elio Vittorini, dans "Conversazione in Sicilia" (1941), décrit un retour initiatique dans la Sicile natale, sous une forme allégorique, pour dénoncer la passivité du peuple italien sous le fascisme, et croit encore à la possibilité d’un sursaut collectif. Contrairement à Vittorini, Gadda ne dénonce pas seulement l’inaction du peuple, mais sa participation intime et active au désastre collectif, la complicité du peuple italien est autant psychologique que morale ..
Pour Gadda, la société italienne sous le fascisme ne se contente pas de subir - elle coopère, entretient et alimente le système, car celui-ci répond à un désir profond d’évasion devant la douleur et la complexité ...
- la « cognition de la douleur » (cognizione del dolore) désigne l’effort douloureux de lucidité que la société refuse.
- ce n’est donc pas une passivité qu’il fustige, mais plutôt une fuite active dans la comédie collective et la superficialité, qui permet d’éviter la vérité tragique de la condition humaine.
Dans "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", par exemple, chaque personnage participe à la confusion générale, chacun collabore au « pasticciaccio » (le sale gâchis) par intérêt, lâcheté ou simple indifférence morale. Il n’y a pas de figure d’innocence ou d’espoir collectif...

Gadda n'a jamais cru, contrairement à Vittorini (et même à Moravia), à une idée d’émancipation possible et à une fonction « éthique » de la littérature.
Et s'il méprisait le fascisme et ses slogans nationalistes, il n’était pas non plus un « démocrate » militant au sens classique, et critiquait aussi violemment la démocratie bourgeoise, la corruption parlementaire : et se montrait sceptique sur toute idée de « salut collectif ». Son pessimisme foncier et sa misanthropie le placèrent ainsi à l’écart de tout combat structuré ...

Gadda est perçu comme un des auteurs les plus difficiles du XXᵉ siècle? Gadda est un auteur sans doute difficile à lire en italien (plus que dans ses traductions, quoique ses jeux entre dialecte lombard, italien standard, romanesco ou jargon technique soient quasiment impossibles à rendre en français) : Gadda cultive ce qu’il appelle lui-même le "groviglio" (l’emmêlement, le nœud), sa syntaxe est longue, sinueuse, pleine de parenthèses, d’incises, de ruptures, accumulant des digressions à l’infini, pour imiter la complexité psychique et la fragmentation du réel...

(PIC by) Tullio Pericoli (1936) - "Carlo Emilio Gadda a Milano, 1988" n’est pas seulement un simple portrait mais ben une réflexion visuelle sur l’univers littéraire et intellectuel de Gadda, et sur l’essence même du projet littéraire de l’écrivain. Gadda, connu pour son chef-d’œuvre "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" (1957), incarne dans la culture italienne le thème du chaos, de la complexité et du désordre de l’existence urbaine. Sa littérature reflète une pensée complexe, tortueuse, et baroque, marquée par une langue expérimentale et un regard critique sur la société milanaise et romaine ....
Carlo Emilio Gadda (1893-1973)
Carlo Emilio Gadda est né à Milan le 14 novembre 1893, dans une famille de la petite bourgeoisie milanaise. Son père, Francesco, était un industriel passionné d’art, et sa mère, Adele Lehr, cultivait une éducation sévère et autoritaire, ce qui marquera fortement la sensibilité de l’écrivain. Après un parcours scolaire brillant, Gadda s’inscrit à l’École polytechnique de Milan en 1913 pour étudier le génie électrique. Mais la Première Guerre mondiale éclate, et il interrompt ses études pour s’engager volontairement.
Mobilisé comme officier dans un régiment d’infanterie, Gadda vit l’expérience tragique de Caporetto en 1917. Son frère Enrico, également officier, meurt sur le front, événement qui marquera Gadda d’un sentiment de culpabilité et d’angoisse existentielle, thème récurrent de son œuvre.
Après la guerre, il termine son diplôme d’ingénieur en 1920. Mais Gadda se sent toujours étranger au monde technique : il éprouve un malaise profond face à la rationalité et la logique de l’ingénierie, préférant s’abandonner à l’écriture, à la philosophie et à la psychanalyse.
Pendant les années 1920, l’Italie vit la montée du fascisme sous Mussolini. Gadda, d’abord distant de la politique, développe rapidement une aversion profonde pour le régime fasciste, qu’il juge brutal, vulgaire et irrationnel. Bien qu’il ne soit pas un opposant actif, il vit en retrait, préférant observer et critiquer la société italienne de l’intérieur. Sa méfiance envers toute forme de dogme et son horreur du simplisme idéologique transparaîtront plus tard dans son écriture fragmentaire, chaotique, marquée par la multiplicité des registres linguistiques.
Gadda commence à publier dans les années 1930. Ses premiers textes, réunis plus tard dans "La Madonna dei filosofi" (1931) et "Il Castello di Udine" (1934), témoignent déjà de sa prose dense, labyrinthique et analytique. Il y développe un style fait de digressions, d’ironie mordante et d’un mélange audacieux de dialectes régionaux, latinismes et néologismes.
Son style se veut une « scomposizione » (décomposition) de la réalité, en opposition à l’idéologie fasciste qui vise à imposer une unité factice et autoritaire. Là où le régime cherche la simplification et l’ordre, Gadda expose la complexité chaotique du réel.
En 1934, Gadda part pour l’Argentine, où il travaille comme ingénieur. De retour en Italie en 1936, il vit à Florence et collabore avec la revue Solaria — un cercle anti-fasciste modéré, où il fréquente Montale et Vittorini. Durant ces années, le fascisme s’intensifie (lois raciales de 1938, intervention en Éthiopie, alliance avec l’Allemagne nazie), et Gadda ressent de plus en plus violemment l’étouffement culturel. Bien qu’il continue à écrire, il se tient à distance de toute compromission publique.
Après la Seconde Guerre mondiale et la chute du fascisme, Gadda publie ses œuvres les plus célèbres :
- "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" (1946–1947, publié en volume en 1957)
Roman inachevé et monumental, c’est une satire tragique de l’Italie fasciste, dissimulée sous l’apparence d’un roman policier. L’enquête policière sert à démonter les dysfonctionnements sociaux et moraux du pays. À travers son style baroque et polyphonique, Gadda y donne corps à l’idée d’un « chaos » social et linguistique.
- "La cognizione del dolore" (La Connaissance de la douleur, publié entre 1938 et 1941, version complète en 1963)
Roman fortement autobiographique, inspiré par la mort de sa mère et la relation trouble avec elle. Situé dans un pays fictif, le « Maradagàl », il sert à figurer une dictature sud-américaine, mais qui transparaît comme une métaphore du fascisme italien.
Ces œuvres mettent en scène une Italie dominée par l’absurdité, la corruption et la violence larvée, symboles d’un malaise moral collectif.
Gadda se retire à Rome dans les années 1950 et 1960, se consacrant à des essais, à des textes plus introspectifs (notamment I viaggi la morte). Il devient une figure culte, admiré par Italo Calvino et Pier Paolo Pasolini, qui le considèrent comme un des grands innovateurs de la prose italienne du XXᵉ siècle. Il meurt à Rome le 21 mai 1973, laissant derrière lui une œuvre fragmentaire mais décisive, qui a profondément renouvelé la langue littéraire italienne.

Dans son œuvre, Gadda voit le fascisme comme un phénomène qui impose une fausse cohérence au réel et veut réduire celle-ci à des slogans simplistes et à un ordre factice ...
- Le fascisme prône l’idée d’un ordre nouveau, clair, « pur », fondé sur des valeurs simples : patrie, discipline, force, unité nationale.
- Cette simplification est en réalité un refus de la complexité humaine, psychologique et sociale.
- Pour Gadda, la vie est chaotique, fragmentée, pleine de contradictions, de douleurs intimes et de tensions irrésolues.
- Le fascisme, lui, propose une « narration officielle » qui efface tout cela au profit d’un mythe héroïque (l’Empire romain, la grandeur italienne, l’homme nouveau viril).
Pour Gadda, la société italienne a accepté cette réduction car elle refuse d’affronter sa propre complexité et sa propre douleur (la fameuse "cognizione del dolore"). Une grande part des Italiens refuse d’admettre leur propre douleur collective (échecs historiques, divisions internes, pauvreté, humiliations coloniales, retard économique).

Le fascisme historique (1922–1943) est certes né en Italie avec Mussolini, et est issu d’un contexte très italien bien connu,
- la « vittoria mutilata » après la Première Guerre mondiale (l’Italie s’est sentie lésée par les traités de paix).
- un tissu social fragilisé, marqué par de grandes inégalités régionales et une faible industrialisation du Sud.
- un État jeune (l’unité italienne date de 1861) et des institutions fragiles.
- une tradition d’obéissance hiérarchique, liée au catholicisme et au clientélisme local.
Mais Gadda considère que ce besoin d’« ordre factice » n’est pas uniquement italien. La tentation de réduire la complexité par des idéologies totalisantes est une réalité que l'on trouve tant dans le nazisme que dans le stalinisme. Ce qui serait spécifiquement italien, selon lui, c’est l’ironie tragique : une capacité à se moquer de tout tout en restant prisonnier de l’illusion collective (cf. son regard sur les bureaucrates et policiers dans Pasticciaccio).
Pour Gadda, l’Italie ne vit pas seulement sous une dictature extérieure, mais sous une dictature intérieure ...
- Une incapacité historique à regarder la réalité en face (qu’il appelle parfois il male oscuro, le mal obscur).
- Une tendance à préférer les slogans ou les masques (le folklore, la commedia, la rhétorique) à une introspection douloureuse.
Sa satire ne vise pas seulement le régime fasciste en tant que système politique, mais la mentalité collective italienne qui accepte la supercherie et la corruption morale.

"La Madonna dei Filosofi" (1931)
"La Madone des philosophes", traduit partiellement en anglais par William Weaver, - certains textes sont inclus dans The Novels and Stories of Carlo Emilio Gadda (1965), et publié en français en 1981 (dans "La Madone des philosophes et autres textes", Gallimard), contient plusieurs nouvelles ou essais narratifs, marqués par une réflexion philosophique, souvent sombre, sur la condition humaine, la science, et la religion. "La Madonna dei Filosofi" est souvent considérée comme l’une des premières expressions de sa prose mature, avec "Il castello di Udine" (1934). Elle marque la transition entre son écriture d’ingénieur rationnel et son style plus foisonnant, critique et ironique.
Dans ce recueil, qui est sa première œuvre, Gadda met en place les éléments de sa vision satirique de la bourgeoisie milanaise, qui culminera plus tard dans "L'Adalgisa". En même temps qu'il décrit le milieu milanais, il se met en scène lui-même et s'attache à prendre une distance ironique vis-à-vis de son métier d`ingénieur et du jargon qu`il implique.
Dans la première nouvelle, "Théâtre", il dépeint, dans un style héroïcomique, plein de réminiscences littéraires. une soirée d`opéra à laquelle assiste la bonne société milanaise. Mais le sujet n`est ici qu'un prétexte à des rapprochements inattendus, à des descriptions savoureuses de la salle et de la scène, jusqu`au moment où le narrateur s`endort au milieu de la représentation.
" ... Tout à coup, le noir cessa pour moi aussi.
L’étincellement des lustres, enveloppant de lumière les plus jeunes dames de la ville, proféra haut l’éloge de très douces rondeurs ou de la « maigreur élégante de l’épaule, au contour heurté »I. Quelques-unes avaient un rubis, telle une goutte de sang, sur leur très blanche gorge.
Les coussins aux desseins ignorés les attendent ; pour le moment, le génie du mélodrame désaltère leurs âmes à la sève de la beauté éternelle. J’étais dépourvu de lorgnette nacrée : aussi les regardai-je à l’œil nu, car, même ainsi, j’y vois assez bien.
Le spectacle fut indescriptible : ce soir-là, la société babylonienne la plus cultivée s’était donné rendez-vous au Théâtre Ponchielli. Le fond du fer à cheval était parcouru par des messieurs très sérieux. Dans les loges les plus chères, les plastrons parfaits, les bandes moulantes des fracs, les manchettes immaculées, un quant-à-soi distrait disaient : « Nous connaissons les dessous de la vie ! Les navettes secrètes du monde, c’est nous qui les introduisons dans la trame de la grossièreté plébéienne. Notre science, notre intelligence, notre pouvoir, notre argent permettent au génie de nous distraire, comme eût fait un jongleur. C’est bien d’un authentique génie qu’il s’agit. » Et, en effet, les gourmets, les connaisseurs, les critiques s’entrecongratulaient. Tout en haut, on entendait crier « limonade ! ». Baies de perles sur les seins crémeux de la deuxième jeunesse : gouttes de brillants. On n’avait jamais vu chose pareille.
Un parfum diffus de gâteaux et de tablettes de chocolat me faisait songer à un gynécée fabuleux, où il est malheureusement interdit d’entrer, sauf à des personnages spéciaux, un peu grassouillets.
Dans les "Manœuvres d`artillerie en campagne", Gadda se livre à une charge féroce contre l`armée et les militaires. en s'inspirant de sa propre expérience de la première guerre mondiale.
La nouvelle "Cinéma" est remplie de souvenirs de la propre existence de Gadda à Milan : on voit l`auteur donner des leçons particulières de mathématiques aux jeunes filles de la bonne société, errer ensuite à travers Milan en cherchant désespérément un visage connu ou un but de promenade. En désespoir de cause. le narrateur se réfugie dans un cinéma, et la suite de la nouvelle prend l`aspect d`une épopée grotesque dont le moindre quiproquo n`est pas celui qui fait prendre l`auteur pour un amateur de femmes seules parce qu`il dérange sa voisine en cherchant ses clés dans sa poche.
"... Elle me regardait elle aussi, à son tour, et d’un air plutôt mauvais : depuis les contours d’un nez aquilesque et pâle, très effilé, elle me lançait des coups d’œil saturés d’une perfidie vipérine : puis, contractant ses lèvres pour aspirer lentement un long souffle sifflant qui lui était propre, elle rentrait le cou dans les épaules avec une suffisance solennelle pleine de sous-entendus tragiques.
« Oh, qu’a-t-elle, cette dame ? » pensai-je, en rougissant sans le vouloir. Nous étions entassés. Et comme j’étais un peu impressionnable, mes amis me suggéraient, dans de semblables occurrences, de toucher avec deux ou trois doigts une pincée de quelque sulfure ou oxyde ou carbonate ou silicate métallique comme la pyrite, la blende, la cala mine, la bauxite, la sidérite, la galène, la leucite, la dolomite, ou même du laiton, ou, mieux encore, du fer homogène. J’allai donc à la recherche de la clé de chez moi que je gardais d’habitude dans la poche postérieure de mes pantalons : en la palpant ensuite avec acharnement, la retournant en tous sens, je la fis entrer en collision contre toute intention avec quelque chose de dur qui ressortait de l’échafaudage externe de la dame très distinguée.
Le souffle qu’elle était en train d’aspirer siffla alors entre sa langue et ses molaires...."
La dernière nouvelle du recueil, qui lui a donné son titre, prend le prétexte d'un drame mondain parfaitement banal pour évoquer avec humour la figure d'une jeune fille de l`aristocratie milanaise, Maria, inconsolable de la mort à la guerre de son fiancé, et le personnage d`un ingénieur humaniste, fou de littérature ancienne. l'ingénieur Baronfo.
Entre la jeune fille et l`ingénieur va se nouer une intrigue sentimentale, qui finira le plus bourgeoisement du monde par un mariage. Entre-temps une ancienne maîtresse aura grièvement blessé Baronfo et estropié le jeune homme qui lui servait de chauffeur.
Dans ce récit grinçant, où l`ingénieur Baronfo apparaît comme une projection possible de l'auteur, Gadda donne libre cours à son plaisir de raconter et à son amour des rappels historiques et culturels. Le personnage de Maria permet d`évoquer le destin des familles aristocratiques de Milan, les marottes de l`ingénieur philosophe permettent à l`écrivain de faire étalage d'une culture encyclopédique. à la fois réelle et farfelue; et au-dessus de toute l`hístoire plane la figure de la Madone peinte sur la demeure seigneuriale de la famille de Maria.
"...Maria Ripamonti, la fille, était parvenue à ses vingt-cinq ans et les avait même un peu dépassés sans que ni ses proches ni les gens de sa connaissance s’en fussent aperçus : mais son papa et sa maman avaient fixé leur idée sur l’avocat Pertusella, un conseiller commercial lombard très distingué, qui avait déjà milité non sine gloria dans le parti clérical et auquel, maintenant, à l’approche de ses trente-huit ans, était venu un nez un peu rouge ; raison pour laquelle, au premier reverdissement des collines, il honorait régulièrement de sa présence les Thermes Royaux de Salsomaggiore.
C’était un personnage très distingué, par ailleurs : comme il était un peu myope, il portait des lunettes : il continuait à entretenir des contacts salutaires avec des associations culturelles catholiques, avec de très solides banques catholiques et avec des institutions de bienfaisance également catholiques et également solides. Conseiller et membre et administrateur par-ci, expert et fondé de pouvoir et président par-là.
Elle, Maria, en revanche, ne pensait jamais, pas même par inadvertance, à l’avocat Pertusella, dont elle arrivait à se rappeler, avec peine, uniquement le nez, chaque fois que les siens laissaient tomber la conversation sur lui, tout en feignant que ce fût l’effet du hasard ou d’une coïncidence. Tout au plus, elle comprenait instinctivement que sa propre vie finirait, si par hasard ils continuaient de la sorte, par devenir une farce atroce, une farce grotesque et essoufflée ; sans queue ni tête. D’accord pour la religion, d’accord pour Dom Zaccaria, d’accord pour La Perseveranza et L’Italia1, d’accord pour le patronage de saint Alexandre, mais l’idée de devenir Mme Pertusella lui procurait des crises d’hystérie : les réclames* de Salsomaggiore lui donnaient des palpitations.
Maria, et cela constitue en quelque sorte l’honneur et le mérite des créatures, ne voulait pas encore en être réduite à croire que vraiment le monde et les chevaux et les maisons et les cygnes des jardins, et les petites filles ; que les gardes, les généraux, les paralytiques, les prêtres, les billets de cent, les écrivains célèbres, les poires et les chefs de gare et la prose des écrivains célèbres, et tout le reste, que vraiment tout n’était qu’un mauvais rêve : non : elle sentait bien du plus profond de son âme, comme peut-être toutes les nobles et très gentes dames de sa vieille famille, qu’il devait quand même exister quelque chose d’autre que la crétinerie, qu’il devait exister quelque chose de vrai dans le monde quitte à l’inventer, à se le fabriquer avec l’imagination, ou avec une volonté désespérée.
Et puis, ce n’était même pas cela : elle comprenait et sentait qu’elle avait vécu deux vies. L’une s’était achevée à l’âge de dix-neuf ans, l’autre venait après. Celle qui avait abouti à ses dix-neuf ans s’était achevée en un souvenir déchirant, en un néant horrible et désolé, en un atroce on ne sait quoi. Maria, à dix-sept ans, avait eu le tort de trouver extrêmement « sympathique » le fils d’un commerçant ruiné, ou peut-être d’un industriel...."

"Il castello di Udine" (1934)
"The Castle of Udine" (publié dans The Novels and Stories of Carlo Emilio Gadda, trad. William Weaver, 1965) - "Le Château d'Udine et autres nouvelles" (trad. Grasset, 1986) - Recueil de nouvelles explorant des thèmes existentiels et psychologiques. Gadda y développe déjà son style complexe et analytique.
Le texte tire son nom du château qui surplombe la ville d’Udine, évoqué comme une figure presque mythologique, un point de convergence visuel et psychologique. Le narrateur (souvent identifié à Gadda lui-même) se trouve à Udine en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, peu avant la débâcle de Caporetto. Udine s'impose comme un « observatoire » où le narrateur contemple la ville, la campagne frioulane, les mouvements de troupes et la tension de la guerre. Le narrateur projette sur le château ses propres états d’âme ; la guerre est perçue comme un miroir du chaos intérieur. Gadda y introduit déjà ce qui deviendra sa marque de fabrique, une langue hybride, riche en archaïsmes, dialectes, registres techniques et poétiques : ce qu’il nommera plus tard le pastiche linguistique et la « molteplicità della realtà » (multiplicité de la réalité). Dans "Il castello di Udine", la perception du narrateur n’est jamais stable : elle est fragmentée, morcelée, traversée par des oscillations émotionnelles violentes...
À sa publication, "Il castello di Udine" surprendra la critique italienne par son audace stylistique et sa profondeur psychologique.
"Il castello di Udine"
Écrit après la Première Guerre mondiale, basé sur l’expérience de Gadda comme officier dans le Frioul en 1917. Le narrateur, en poste à Udine, contemple le château, symbole puissant et silencieux dominant la ville. Il décrit les rues, l’atmosphère inquiète, le mouvement de la guerre imminente (la retraite de Caporetto se profile). La contemplation se transforme en introspection douloureuse. Le château, immobile et serein, devient la métaphore d’un ordre supérieur inatteignable. La prose est lyrique, parfois elliptique, annonçant le style baroque et fragmenté futur de Gadda.
"La Madonna dei Filosofi" - Personnage central, une statue de la Vierge Marie. Le narrateur s’arrête devant une Madone, mais au lieu de se recueillir religieusement, il engage une réflexion critique sur la philosophie, la rationalité, la foi. Il évoque la piété populaire, la tradition iconographique, et l’opposition entre spiritualité simple et intellectualisme. La Madone devient un « prétexte » pour démonter les illusions rationnelles, dénoncer les pseudo-certitudes.
"La casa" - Description minutieuse d’une maison familiale, observée comme un organisme vivant. Gadda analyse chaque pièce, les objets, les souvenirs, la fonction de chaque espace. La maison devient le reflet du moi intérieur et de la mémoire collective.
"Il colloquio di notte" - Dialogue nocturne, intérieur ou avec un interlocuteur imaginaire. Le narrateur médite sur la mort, la guerre, la futilité de la gloire. L’atmosphère est crépusculaire et hallucinée, marquée par une syntaxe tordue et un sentiment de solitude radicale.
"La sera del Turbine" - Une soirée d’orage, décrite comme un événement quasi mythique. La violence du vent et de la pluie renvoie à l’agitation psychologique du narrateur. Les objets, les paysages deviennent animés, presque doués d’une âme (animisme poétique). De l’instabilité fondamentale du monde et de l’être humain.
"L’Adalgisa" (abbozzo) - Ébauche d’un personnage féminin, Adalgisa, figure milanaise, ironique et grotesque. Elle incarne la petite bourgeoisie urbaine, préoccupée de mode, d’apparences et de statut social. Gadda introduit ici une veine satirique, qui sera pleinement développée plus tard dans L’Adalgisa (1944).
"L’inizio della cognizione del dolore" - Ébauche de ce qui deviendra "La cognizione del dolore". Scènes de la maison familiale en Brianza, la mère du narrateur (figure inspirée de la mère de Gadda), et son obsession de la souffrance. Exploration du deuil, de la fragilité humaine, de la culpabilité. Un texte inachevé, dense et labyrinthique.
"Sogni e ironie del signor di Noris" - Portrait ironique d’un personnage rêveur et solitaire, M. di Noris. Ses rêveries se mêlent à des considérations burlesques sur la société milanaise. On trouve déjà les jeux de langage, la fracture entre rêve et réalité, et la critique sociale.
"Il bestione e la madonnina" - Récit d’une confrontation entre un « bestione » (animal énorme, symbole de la force brute) et une « madonnina » (figure fragile, protectrice). Un conte symbolique, à la limite de l’allégorie, qui juxtapose innocence et violence. Peut se lire comme une fable morale sur l’Italie contemporaine.
"Il canto della macchina" - Réflexion poétique sur la technique et la mécanique. L’auteur décrit une machine (ou le moteur) comme un organisme doué de vie. Gadda, ingénieur, y projette son ambiguïté face au progrès technique, à la fois fasciné et inquiet.
"Il viaggio di alcuni amici" - Un groupe d’amis voyageant ensemble ; le récit décrit minutieusement leurs interactions, les détails de la route, les arrêts. Une apparence banale, mais saturée de micro-observations psychologiques et d’ironie.
"Il ritratto dell’ingegnere" - Portrait moral et intellectuel d’un ingénieur (écho autobiographique direct). L’ingénieur est montré comme rationnel, méthodique, mais aussi vulnérable, hanté par l’échec. Gadda y exprime sa méfiance envers la foi aveugle dans la science et la technique.
"Il fuoco e l’amico" - Le narrateur évoque un ami disparu, autour d’un feu. La flamme sert de métaphore de la mémoire et de la présence fugitive. Poème en prose mélancolique, où le passé redevient douloureusement vivant.

"La cognizione del dolore" (1963, publié partiellement dans les années 1938–1941)
"Acquainted with Grief" (trad. William Weaver, 1969), "La Connaissance de la douleur" (trad. Louis Bonalumi, 1975) - Publié de 1938 à 1941 dans Letteratum, puis en volume en 1963, un roman profondément autobiographique et sombre, se déroulant dans une province imaginaire sud-américaine (Maradagàl), il évoque la relation douloureuse entre un fils et sa mère, inspirée de la propre relation de Gadda avec sa mère après la mort de son frère. Le style est fragmenté, avec un mélange de registres linguistiques.
Ici, par exemple, un texte qui présente plusieurs défis, un vocabulaire technique agricole ("banzavóis", "Peronospera"), des termes administratifs spécifiques ("Nistitùos provinciales de vigilancia"), et un ton ironique typique de la littérature du XXe siècle. La syntaxe est parfois alambiquée avec des incises fréquentes....
"In quegli anni, tra il 1925 e il 1933, le leggi del Maradagàl, che è paese di non molte risorse, davano facoltà ai proprietari di campagna d’aderire o di non aderire alle associazioni provinciali di vigilanza per la notte - (Nistitùos provinciales de vigilancia para la noche); e ciò in considerazione del fatto che essi già sottostavano a balzelli ed erano obbligati a contributi molteplici, il cui globale ammontare, in alcuni casi, raggiungeva e financo superava il valsente del poco banzavóis che la proprietà rustica arriva a fruttare, Cerere e Pale assenziendo, ogni anno bisestile: cioè nell’anno su quattro in cui non si sia verificata siccità, non pioggia persistente alle semine ed ai raccolti, e non abbi avuto passo tutta la carovana delle malattie. Paventata, più che ogni altra, la ineluttabile «Peronospera banzavoisi» del Cattaneo: essa opera, nella misera pianta, a un disseccamento e sfarinamento delle radicine e del fusto, proprio nei mesi dello sviluppo: e lascia ai disperati e agli affamati, invece del granone, un tritume simile a quello che lascia dietro di sé il tarlo, o il succhiello, in un trave di rovere. In talune plaghe bisogna poi fare i conti anche con la grandine. A quest’altro flagello, in verità, non è particolarmente esposta la involuta pannocchia del banzavóis, ch’è una specie di granoturco dolciastro proprio a quel clima. Clima o cielo, in certe regioni, altrettanto grandinifero che il cielo incombente su alcune mezze pertiche della nostra indimenticabile Brianza: terra, se mai altra, meticolosamente perticata.
Il Maradagàl, come è noto, uscì nel 1924 da un’aspra guerra col Parapagàl, stato limitrofo con popolazione della medesima origine etnica, immigratavi via via dall’Europa, a far tempo dai primi decenni del secolo decimosettimo. Anche ciò è noto. I pochi Indios superstiti alla Reconquista e pervenuti fino al secolo e ai clamori della radio, vivono a tribù e quasi a branchi nei lontani «Territorios», felicitati da una loro speciale tubercolosi e da una loro speciale sifilide, oltreché dalla lontananza della gendarmeria: tratti, alcuni, e a gran fatica, dalla caparbietà d’un qualche missionario piemontese, nell’orto della Fede di Cristo; donde purtuttavia si assentano ancora, poi, di tanto in tanto, per una di quelle loro così deplorevoli bevute di caña, che li lasciano un paio di giorni a terra, lungo un sentiero, come sassi. Ognuno dei due paesi sostiene di aver vinto la guerra ene addossa all’altro la terribile responsabilità. Negli anni seguenti al 1924 vi erano perciò, tanto nel Maradagàl quanto nel Parapagàl, dei reduci di guerra, alcuni dei quali appartenevano e appartengono tutt’ora alla benemerente categoria dei mutilati: e zoppicavano, o avevano sul volto cicatrici, o un arto irrigidito, o erano privi di un piede, o di un occhio. Non è infrequente, nei più ciaccolosi caffè del Maradagàl o del Parapagàl, venir fissati da un occhio di vetro. Di taluni reduci si sapeva che erano stati feriti, per quanto non apparisse; le cicatrici, nascoste dai panni, venivano così defraudate della quota di ammirazione a cui avevano diritto. Vi erano poi anche dei sordi di guerra.
La preposizione di (de, in maradagalese) esprimente causa od origine, seguita dal sostantivo «guerra» e preceduta da un aggettivo sostantivale come «invalido», «mutilato», «cieco», «sordo», «minorato», e simili, aveva anzi dato luogo a certa facezia, di discutibile gusto, è vero: e non proibita tuttavia dalla legge, perché innocente. Accade alla loquace vita, purtroppo, di esorbitare talora dalle sacre leggi della deferenza e della compostezza. Così a Terepàttola, sulle prime pendici della Cordillera, le ragazze terepattolesi apostrofàvano «scemo di guerra!» qualche zerbinotto un po’ troppo ardito di mano, a cui però, dopo un dieci minuti di broncio, finivano col perdonare e col farci la pace, come i plenipotenziari del Maradagàl l’avevano fatta coi plenipotenziari del Parapagàl.
«Scemo» si dice «mocoso» con un c solo, in maradagalese, e la locuzione pretta è perciò: «¡Mocoso de guerra!».
Ora appunto, trattandosi di arruolare i vigili dei Nistitùos de vigilancia para la noche, si deliberò venisse data la prelazione ai reduci di guerra, senza escluder dal novero i gloriosi feriti, quandoché beninteso apparissero idonei all’ufficio: il che torna a dire fisicamente ancor validi: e tanto prestanti, anzi, da poter assolvere a un incarico del genere, il quale può richiedere interventi manu armata e presume comunque, nel vigile, un certo grado di robustezza e di conseguente autorevolezza, affinché il vigile possa efficacemente persuadere al fuorilegge ch’egli deve senz’altro seguirlo al più vicino posto di guardia. Seguirlo, o per dir meglio precederlo, visto che certi tipi è meglio metterseli davanti, che dietro.
(...)
« En ces années-là, entre 1925 et 1933, les lois du Maradagàl – pays aux ressources limitées – autorisaient les propriétaires terriens à adhérer ou non aux Nistitùos provinciales de vigilancia para la noche (Instituts provinciaux de veille nocturne). Cette liberté s’expliquait par le fait qu’ils étaient déjà soumis à de multiples taxes et contributions obligatoires, dont le montant total pouvait, dans certains cas, atteindre voire dépasser la valeur du peu de banzavoine que rapportait annuellement une propriété agricole – Cérès et Pales en témoignent – durant les années bissextiles : c’est-à-dire une année sur quatre où ne sévissaient ni sécheresse, ni pluies persistantes aux semailles et aux récoltes, ni toute la kyrielle de maladies. La plus redoutée était l’inéluctable Peronospera banzavoisi de Cattaneo : elle provoque, sur la misérable plante, un dessèchement et un effritement des radicelles et de la tige, précisément pendant les mois de croissance, laissant aux désespérés et aux affamés, au lieu de gros grains, une mouture semblable à celle laissée par le ver ou la vrille dans une poutre de chêne. Dans certaines régions, il faut aussi compter avec la grêle. Ce fléau, en vérité, n’épargne pas particulièrement l’involuque épi de banzavoine – une sorte de maïs doux adapté à ce climat. Un climat ou ciel, dans certaines zones, aussi grêligène que celui qui pèse sur quelques arpents de notre inoubliable Brianza : terre, s’il en fut, méticuleusement arpentée.
Le Maradagàl, comme on sait, sortit en 1924 d’une guerre acharnée avec le Parapagàl, État voisin peuplé d’une ethnie d’origine européenne commune, immigrée progressivement depuis le début du XVIIᵉ siècle. Ceci est également connu. Les rares Indios survivants de la Reconquista, parvenus jusqu’au siècle des ondes radiophoniques, vivent en tribus, quasi en hordes, dans lointains Territorios, bénis par une tuberculose et une syphilis qui leur sont propres, outre l’éloignement de la gendarmerie. Quelques-uns, tirés à grand-peine de leur caprice par l’obstination de missionnaires piémontais, furent introduits dans le jardin de la Foi du Christ ; d’où ils s’absentent néanmoins encore, de temps à autre, pour ces déplorables beuveries de caña qui les laissent deux jours à terre, le long d’un sentier, comme des pierres. Chacun des deux pays soutient avoir gagné la guerre et en rejette la terrible responsabilité sur l’autre. Dans les années suivant 1924, il y avait donc, tant au Maradagàl qu’au Parapagàl, des anciens combattants, dont certains appartenaient – et appartiennent encore – à la méritante catégorie des mutilés : ils boitaient, portaient des cicatrices au visage, avaient un membre raidi, ou manquaient d’un pied, d’un œil. Il n’est pas rare, dans les cafés les plus bavards du Maradagàl ou du Parapagàl, d’être fixé par un œil de verre. Certains blessés de guerre l’étaient sans que cela se voie ; leurs cicatrices, cachées sous les vêtements, se voyaient ainsi frustrées de la part d’admiration qui leur était due. Il y avait aussi des sourds de guerre.
La préposition de (maradagalais pour de), exprimant la cause ou l’origine, suivie du substantif « guerre » et précédée d’un adjectif substantivé comme « invalide », « mutilé », « aveugle », « sourd », « handicapé » et autres, avait d’ailleurs donné lieu à une plaisanterie d’un goût discutable, il est vrai – mais non interdite par la loi, car innocente. Il arrive malheureusement à la loquace vie de sortir parfois des saintes lois de la déférence et de la bienséance. Ainsi, à Terepàttola, sur les premiers contreforts de la Cordillère, les filles du cru apostrophaient « crétin de guerre ! » quelque galant un peu trop entreprenant, à qui elles finissaient néanmoins par pardonner après dix minutes de bouderie, et par faire la paix, comme les plénipotentiaires du Maradagàl l’avaient faite avec ceux du Parapagàl.
« Scemo » (crétin) se dit « mocoso » avec un seul *c* en maradagalais, et l’expression authentique est donc : « ¡Mocoso de guerra! ».
Or, justement, pour le recrutement des veilleurs des Nistitùos de vigilancia para la noche, il fut décidé qu’on donnerait la priorité aux anciens combattants – sans exclure les glorieux blessés, pourvu qu’ils fussent manifestement aptes à la fonction : ce qui signifie encore physiquement valides, et même assez vigoureux pour assumer une telle charge, pouvant exiger des interventions manu armata et supposant de toute façon chez le veilleur un certain degré de robustesse et d’autorité qui en découle, afin qu’il puisse persuader efficacement le hors-la-loi qu’il doit impérativement le suivre au poste de garde le plus proche. Le suivre, ou plutôt le précéder – vu qu’avec certains individus, il vaut mieux les avoir devant soi que derrière. »
(...)
Dans un pays imaginaire de l`Amérique du Sud, qui émerge à peine d'une longue guerre contre un pays voisin, l'ingénieur hidalgo Gonzalo Pirobutirro exhale ses rancœurs. Cloîtré dans la vieille demeure ancestrale dont les murs se lézardent (la maison est décrite presque comme un tableau maniériste ou une nature morte. Chaque objet est isolé, décrit minutieusement) et dont les champs ont cessé de produire, il s'abandonne à des accès de fureur contre le monde qui l'entoure : les "péons" voleurs et ivrognes, les petits-bourgeois qui exploitent l'ignorance du peuple pour en servir les vices, les profiteurs de guerre, les militaires bellicistes, les hommes d'affaires qui guettent la ruine des nobles pour les dépouiller. Sa colère n'excepte pas même sa mère, qu'il bat, insulte, humilie, en l'accusant de se laisser berner par son bon cœur, son orgueil de mère et de noble, son souci de garder la Villa Pirobutirro, même au prix de la ruine de la famille.
Dernier des individualistes et dernier des Pirobutirro, Gonzalo a refusé la protection de l' "Institut de vigilance nocturne", chargé de veiller sur les domaines des grands propriétaires terriens du pays, tout comme il repousse les conseils de sagesse du docteur qui voit en lui une proie facile pour une de ses nombreuses filles.
Le conflit mère-fils est le centre symbolique et émotionnel du roman (l’auteur ayant eu une relation très complexe et douloureuse avec sa propre mère). Dans le chapitre V (ou I de la IIe partie), le plus emblématique, le protagoniste Don Gonzalo Pirobutirro d’Eltino vit seul avec sa mère dans la « villa di campagna » (maison de campagne) isolée. Gadda décrit longuement le décor, les sensations physiques, le climat étouffant de la région imaginaire de Maradagàl (transposition semi-allégorique de l’Argentine). Le chapitre se concentre sur le rapprochement conflictuel entre Gonzalo et sa mère. Leur relation est saturée d’hostilité latente, de non-dits, de culpabilité et d’accusations voilées. On voit Gonzalo s’enfermer dans ses obsessions, rongé par le ressentiment, la douleur et une misanthropie quasi pathologique.
"Elle errait, solitaire, à travers la maison. C’était, ces murs, ces cuivres, ce qui lui restait, de toute une vie ? On l’avait informée du nom, noir et brutal, de la montagne : contre laquelle il était mort : on avait précisé celui, apaisé jusqu’à la désolation, de la terre où on l’avait porté, et déposé, le visage rendu à la paix, à l’oubli : à jamais sans réponse. Le fils qui lui avait souri, trop brefs printemps, qui, quand il l’embrassait, savait étreindre avec tant d’élan, tant de douceur. Un an plus tard, à Pastrufazio, un sous-officier de gendarmerie s’était présenté chez elle, porteur d’un diplôme, lui avait remis un méchant livret, et l’avait priée de bien vouloir apposer sa signature sur un autre brouillard : il tendait, ce disant, un crayon-encre. D’abord, il avait demandé :
– Madame Elisabetta François, c’est bien vous ?
Pâlissant à l’entendre prononcer ce nom : celui du malheur : elle avait répondu :
– Oui, c’est moi.
En tremblant, comme au retour d’un verdict que la bouche d’ombre de l’éternité, après l’horreur d’un premier cri, se fût acharnée à lui remettre en mémoire.
Avant que l’autre ne s’en aille, lorsqu’il eut ramené vers lui, dans un tintement de chaînette, après son registre, son sabre qui luisait, elle avait dit, comme pour le retenir :
« Puis-je vous offrir un verre de Nevado ?
Serrant l’une dans l’autre ses mains décharnées.
Mais lui, n’avait pas voulu accepter. Elle avait songé alors qu’il ressemblait, d’étrange manière, à celui qui avait occupé une si brève fulguration du temps : d’un temps consumé. Les battements de son cœur l’en avertissaient : et elle avait senti devoir une fois encore l’aimer, avec un tremblement des lèvres, cette présence reparue : tout en sachant que nul, jamais, nul ne revient.
Elle errait à travers la maison : et quelquefois entrebâillait les jalousies d’une fenêtre, pour que le soleil pénètre dans la grand-chambre. La lumière rencontrait alors ses vêtements modestes, presque pauvres : les expédients dont elle avait usé pour soigner, en refoulant des larmes, une robe humiliée par la vieillesse. Mais qu’était le soleil ? Quel jour apportait-il – sur les abois de l’ombre ? Elle en savait les dimensions et les propriétés, la distance qui le séparait de la terre comme des restantes planètes : et leur cours et leurs révolutions ; elle avait appris, appris et enseigné, bien des choses : dont les calculs et quadratures de Kepler, qui poursuivent, dans la vacuité des espaces dénués de sens*1, la désespérante ellipse de la douleur.
Elle errait, à travers la maison, comme en quête d’un mystérieux sentier qui l’eût conduite à la rencontre de quelqu’un : ou d’une solitude nue, peut-être, privée enfin d’images et de compassion. De la cuisine désormais sans feu, aux chambres désormais sans voix : qu’habitaient seulement quelques mouches. Ou bien, autour de la maison, elle voyait les champs, et le soleil.
Vaste par-dessus le temps dissous, le ciel s’assombrissait parfois de noirs nuages ; ils s’étaient levés ronds et blancs sur la montagne, puis accumulés, puis rembrunis, ils semblaient la menacer tout à coup, restée dans la maison déserte, ses fils au loin, terriblement.
Ainsi arriva-t-il sur le déclin du même été, un après-midi de début septembre, après une longue canicule dont tous disaient qu’elle serait sans fin : dix jours après celui où elle avait fait venir la gardienne, avec les clés, et voulu descendre, en sa compagnie, jusqu’au cimetière.
La menace l’atteignait au vif. C’étaient les coups, c’était le sarcasme, de forces ou d’êtres inconnus mais implacables à la persécuter : le mal qui resurgit, par un retour interminable, après des éclaircies au matin d’espoir. Ce qui la désolait le plus, depuis toujours, c’était la malveillance imprévue de qui n’avait nulle raison de la vouloir blesser ou de la haïr : de ceux-là mêmes auxquels sa confiance désarmée était allée avec élan, escomptant une société des âmes égale et fraternelle. Tout ce qui eût pu lui porter secours – expérience et souvenir, vertu, travail, réconfort collectif ou personnel –, tout s’effaçait alors d’un coup, dans la désolation d’un instinct mortifié ; l’intime force de la conscience s’égarait : comme ferait une enfant bousculée traînée par la foule. La foule barbare des âges oubliés, l’opacité des choses et des esprits : trouble énigme, devant laquelle, avec angoisse, elle se demandait – dans ce désarroi d’enfant égarée – : mais pourquoi ?
L’ouragan, ce jour-là comme bien d’autres, parcourait avec de longs hurlements les gorges hostiles des montagnes, pour se jeter en ressortant contre logements et fabriques. Après un cumul funèbre de ses rancœurs, il déchaînait ses foudres au travers du ciel, à la façon d’un capitan de lanciers qui fait bombance un soir de sacs et de rapines, parmi les lueurs sinistres et les détonations. Ce vent qui lui avait enlevé son fils vers des cyprès d’oubli, semblait la pourchasser, elle aussi, dans chaque embrasure : à son tour. Sous la lucarne de l’escalier, une rafale, en faisant irruption, l’avait attrapée aux cheveux : planchers et solives de bois craquaient comme près de se rompre : comme membrures, c’était cela, de navires en détresse : avec les huis barricadés, verrouillés, gonflés par cette fureur du dehors.
Elle, semblable à l’animal blessé, lorsque encore au-dessus de lui il entend les sonneries en fièvre répétées de la chasse, s’était vue réduite à trouver, comme elle pourrait, ainsi exténuée, refuge tout en bas, sous l’escalier : descendant jusqu’en bas : jusqu’en une encoignure. Surmontant avec épouvante le vide à chaque marche, en les tâtant du pied, l’une après l’autre, en s’accrochant à la rampe, de ces mains qui ne savaient plus bien saisir : descendant, jusqu’en bas, jusqu’en bas, vers le noir et l’humidité du fond. Où se trouvait une console.
L’obscurité ne lui interdit pas d’y reconnaître à tâtons une chandelle, ramollie, et une soucoupe avec des allumettes, déposées là en prévision des rentrées tardives aux heures de nuit. Où nul ne rentrait plus. Elle essaya coup sur coup une allumette, puis une autre, contre le papier de verre : et ce fut, dans la lueur, enfin, jaunâtre d’une tremblotante aperception des dalles, ce fut pour découvrir, et voir fuir, une écharde de ces ténèbres : avec épouvante : qui se refigea aussitôt dans une immobilité d’embûche : le noir d’un scorpion.
Elle, fermant les yeux, se replia en une ultime solitude : la tête droite à l’instar de ceux qui savent vain tout appel à une quelconque bonté. En elle s’amenuisait, tout près de se réduire en cendres, une flammèche du temps, douloureuse : ce temps au long duquel elle avait été femme, épouse : et mère. Elle restait là, atterrée, devant cette arme sans bravoure, dont les ténèbres elles-mêmes faisaient usage pour la repousser. Tandis que la poursuivaient jusqu’en ce fond où elle était descendue, au fond obscur de toute mémoire, tandis que s’acharnaient sur elle les éclats, la violence, et la gloire vandale de l’ouragan. Répugnante embûche de l’ombre : issue, tache plus noire, de l’humidité et du mal.
Sa pensée ne connaissait plus de : pourquoi : d’avoir oublié, à l’extrême de l’offense, qu’implorer demeure possible, ou l’amour : qu’il y a la charité, autrui : elle n’avait plus de souvenir : l’antique secours des siens s’était perdu, au loin. C’est en vain qu’elle avait donné le jour, et nourri de son lait : nul ne le reconnaîtrait, dans la gloire sulfureuse de la tempête et le chaos, nul n’était là pour y songer : sur les années reculées des entrailles, sur les souffrances et sur la douceur abolie, d’autres temps étaient échus : puis les clameurs de la victoire, la pompe des oraisons : et, pour elle, la vieillesse : dernière solitude, venue clore les ultimes horizons de l’esprit.
Une mouchure, en gouttant, tomba sur sa main qui tremblait, et la brûla ; le souffle glacial de l’orage, depuis la lucarne de l’escalier, faisait vaciller et laminait la flamme, la couchant sur la flaque et les grumeaux de cire, réduisant le papillotis de la mèche à une mortuaire prise de congé.
Elle ne vit plus rien. L’horreur de tout : la haine. Le tonnerre planait sur les choses, et les fulgurations de l’éclair croulaient en colère, à grésiller par à-coups réitérés dans les lames des persiennes closes, là-haut. Et le scorpion, voici, réveillé, avait bougé, comme de flanc, comme pour la tourner, et elle, en frissonnant, avait reculé au fond d’elle-même, en tendant une main froide et lasse, comme pour l’arrêter. Ses cheveux retombaient sur son front, elle n’osait souffler mot, les lèvres sèches, exsangues : personne, personne n’aurait pu l’entendre, dans ce vacarme. Et vers qui se tourner, en un temps si changé, maintenant qu’après tant d’années, la haine seule était sa part ? Quand la maternité elle-même, au cours des ans, n’avait été que douleur vaine, et la chair de ses fils fleur pour les charniers : perdue : dans cette terre de vanité.
Pourquoi ?
Du fond d’ombre de l’escalier, elle levait parfois le visage, afin de retrouver, jusqu’en ce moment, au-dessus de sa tête, les interludes muets de la tourmente, la nullité stupide de l’espace : et du soir qui descendait : aux chéneaux, dehors, les gouttes, telles des larmes, ou un silence miséricordieux. Elle imaginait que les lames brusques des rafales, après avoir parcouru la maison, étaient ressorties comme une bande retardataire, pour regagner la plaine, et la nuit, où s’agréger à leur errant troupeau. Un contrevent battait, en le giflant, sur le mur de façade. Les arbres, dehors, elle les entendait, ils s’égouttaient par à-coups vers le soir, comme lavés de pleurs ..."
Le roman, resté inachevé, devait se continuer par la fuite de Gonzalo et le siège de la propriété par les hommes de l' "Institut de vigilance nocturne". La mère mourait pendant l'assaut avec le soupçon que Gonzalo avait été l'instigateur de l'agression. Dans cette satire transparente, Gadda a voulu donner libre cours à sa colère d'écrivain antifasciste et antibourgeois. Le roman dénonce la collusion de la bourgeoisie italienne avec le régime fasciste. L' "Institut de vigilance nocturne" cache à peine l'organisation du régime fasciste, soutenu par les grands propriétaires terriens. Les "péons" figurent le peuple italien muselé par son ignorance et les tabous politiques et religieux. La DOULEUR de Gonzalo est celle de l'intellectuel lucide, dont le refus du monde où il vit peut aller jusqu'au désir d'auto-destruction et d'anéantissement général. En même temps, la souffrance de Gonzalo se rattache à un antique fonds de souffrance humaine, peut-être lié à l'enfance et au caractère passionnel, exclusif, de la "mère" italienne.
À la fois violent et grotesque, satirique et exaspéré, le livre est écrit dans ce style baroque propre à Gadda qui utilise toutes les ressources de la parodie, de la lexicologie et de l'invention verbale. À travers le grossissement parodique de l'écriture, le livre se transforme en une sorte d'épopée du désespoir et de la colère humaine. Né du mépris et d`un besoin de délivrance au moins verbale, le roman est resté inachevé, les événements politiques postérieurs à 1940 ayant ôté à l'écrivain le goût de le continuer. (Trad. Ed. du Seuil, 1987).

"Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" (1957)
"That Awful Mess on Via Merulana (trad. William Weaver, 1965) - "L'Affreux pastis de la rue des Merles (trad. Louis Bonalumi, 1976) - Roman policier inachevé, mélangeant intrigue criminelle, satire sociale et observation psychologique. Situé à Rome, le livre est célèbre pour sa langue baroque, mélange d'italien, de dialectes romains et d'inventions personnelles.
Son deuxième grand roman, celui qui fit sa renommée, fut conçu à partir de 1945 et publié en 1957. ll fut immédiatement adapté au cinéma par Pietro Germi. Là encore, la trame de fond est policière. Dans un environnement très provincial, en 1927 (la satire de Mussolini est évidente), on assiste à une intrigue volontairement désordonnée, qui détruit l'essence même du roman. Le commissaire Francesco Don Ciccio lngravallo est un élément perturbateur et chaotique, qui casse le récit traditionnel. Certains détails insignifiants prennent des proportions invraisemblables et se démultiplient. La langue est un mélange de dialecte de Rome, de Naples et du Molise. La lecture de l'œuvre de Gadda est agréable, mais pas toujours des plus faciles ...
"Tous l’appelaient désormais don Ciccio. C’était le dottor Francesco Ingravallo détaché à la garde mobile : l’un des fonctionnaires les plus jeunes et, on ne sait pourquoi, jalousés du bureau des enquêtes : doué d’ubiquité, omniprésent dans les affaires ténébreuses. De taille moyenne, plutôt replet de sa personne, ou peut-être un peu trapu, les cheveux noirs, touffus et crépus qui semblaient sortir à mi-hauteur de son front, comme pour abriter du beau soleil d’Italie ses deux bosses métaphysiques, il avait un air un peu somnolent, une allure lourde et indolente, la façon d’agir un peu niaise de quelqu’un qui lutte avec une digestion laborieuse : habillé comme le maigre traitement de l’État le lui permettait, et avec une ou deux petites taches d’huile sur le col, presque imperceptibles cependant, comme un souvenir des collines de son Molise.
À coup sûr, bien que jeune encore (trente-cinq ans), il avait une certaine pratique routinière du monde, de notre monde dit « latin » : une certaine connaissance des hommes : et aussi des femmes.
Sa propriétaire le vénérait, pour ne pas dire qu’elle l’adorait : en raison et en dépit de l’étrange embrouillamini de tintements de sonnette et de livraisons imprévues d’enveloppes jaunes, d’appels de nuit et d’heures sans répit qui formaient le contexte tourmenté de son emploi du temps. « Il n’a pas d’heure, il n’a pas d’heure ! Hier, y m’est revenu qu’il faisait jour ! » Il était, pour elle, le « fonctionnaire d’État de la plus grande distinction » longuement rêvé, précédé de cinq A dans les petites annonces du Messaggero, évoqué, extirpé de l’assortiment infini des fonctionnaires avec l’appât de la « belle chambre ensoleillée à louer » et malgré l’intimation péremptoire en clôture : « Femmes exclues », qui, dans le jargon des annonces du Messaggero offre, comme on sait, une double possibilité d’interprétation.
Et puis il avait fait en sorte que la police ferme les yeux sur cette histoire ridicule d’amende… oui, la contravention pour n’avoir pas sollicité le permis de location… amende qu’ils se partageaient moitié-moitié, entre municipalité et commissariat. « Une dame comme moi ! Veuve du commendator Antonini ! Qu’on peut bien dire que tout Rome l’connaissait : et ceux qui l’connaissaient l’portaient tous comm’ qu’aux nues, j’dis pas ça pacequ’ c’était mon mari, pauvr’âme ! Et là, moi, qu’on m’prend pour ‘ne logeuse ! Moi, logeuse ? Sainte Vierge Marie, j’m’jette plutôt à l’eau. »
Dans sa sagesse et pauvreté molisanes, le dottor Ingravallo, qui semblait vivre de silence et de sommeil sous la jungle noire de cette tignasse, luisante comme la poix et frisée comme un agneau d’Astrakhan, dans sa sagesse il interrompait parfois sommeil et silence pour énoncer quelques idées d’ordre théorique (idées générales, bien entendu) sur les affaires des hommes : et des femmes. À première vue, c’est-à-dire à première ouïe, on aurait dit des banalités. Ce n’étaient pas des banalités. Aussi, ces énoncés rapides, qui produisaient sur sa bouche le crépitement soudain d’une allumette illuminatrice, revivaient ensuite dans les tympans des gens, à des heures ou des mois de distance de leur énonciation : comme après un temps mystérieux d’incubation. « Eh oui ! reconnaissait l’intéressé, le dottor Ingravallo me l’avait pourtant dit. »
Il soutenait, entre autres choses, que les catastrophes inopinées ne sont jamais la conséquence ou l’effet, si l’on préfère, d’un motif unique, d’une cause au singulier : mais elles sont comme un tourbillon, un point de dépression cyclonique dans la conscience du monde, vers lequel ont conspiré toute une multiplicité de mobiles convergents. Il disait aussi nœud ou enchevêtrement, ou grabuge, ou gnommero, embrouille, qui en dialecte veut dire pelote.
Mais le terme juridique « les mobiles, le mobile » s’échappait de préférence de sa bouche : presque contre son gré, semblait-il. La conviction qu’il fallait « réformer en nous le sens de la catégorie de cause » tel que nous le tenions des philosophes, d’Aristote ou d’Emmanuel Kant, et remplacer la cause par les causes, était chez lui une conviction centrale et persistante : une fixation, quasiment : qui s’évaporait de ses lèvres charnues, mais plutôt blanches, au coin desquelles flageolait un mégot éteint qui semblait accompagner la somnolence du regard et le quasi-rictus, entre l’amer et le sceptique, qu’il avait coutume de laisser exprimer selon une « vieille » habitude à la partie inférieure de son visage, sous le sommeil du front et des paupières et le noir de poix de la tignasse. C’est ainsi, vraiment ainsi, qu’il en était de « ses » délits. « Quand qu’on m’appelle !… Oui. Si qu’on m’appelle moi… tu peux qu’être sûr et certain que st’est l’un malheur : quelqu’embrouille… à débroussailler… » disait-il, mélangeant napolitain, molisan, et italien.
Le mobile apparent, le premier mobile, était bien, oui, un seul. Mais la sale affaire était l’effet de toute une rosace de mobiles qui avaient soufflé sur lui en tournoyant (comme les seize vents de la rose des vents quand ils s’entortillent en trombe dans une dépression cyclonique) et avaient fini par enserrer dans le tourbillon du délit la « raison débilitée du monde ». Comme on tord le cou à un poulet. Et il avait coutume de dire, mais cela avec quelque lassitude, « qu’é femmes on s’les retrouve l’où qu’on veut pas s’les trouver ». Une réédition italique tardive du désuet cherchez la femme.
Puis il paraissait se repentir, comme d’avoir calomnié « é femmes », et vouloir changer d’idée. Mais alors on serait allé loin. Si bien qu’il se taisait, pensif, de crainte d’avoir trop parlé. Il voulait signifier qu’un certain mobile affectif, un tantinet ou, dirions-nous aujourd’hui, un certain « quantum d’érotie », se mêlait aussi aux « affaires d’intérêt », aux délits apparemment les plus éloignés des tempêtes d’amour.
Certains collègues quelque peu jaloux de ses trouvailles, certains prêtres mieux instruits des nombreux dégâts du siècle, quelques subalternes, certains huissiers, ses supérieurs, soutenaient qu’il lisait des livres étranges : dont il tirait tous ces mots qui ne veulent rien dire, ou presque rien, mais servent mieux que d’autres à allécher les démunis, les ignares. Des questions qui sentaient un peu l’asile psychiatrique : une terminologie de médecin des fous.
Pour la pratique, faut autre chose. Les enfumages et les philosophailles faut les laisser aux auteurs de traités : la pratique des commissariats et de la gendarmerie mobile est une tout autre affaire : il y faut beaucoup de patience, beaucoup de charité : un estomac bien en place aussi : et, à condition que toute la baraque des ‘Taliens ne chancelle pas, le sens des responsabilités et de la décision sûre, de la modération civile ; oui : et oui : et une poigne ferme. À propos de ces objections si justes lui, don Ciccio, faisait semblant de rien : il continuait à dormir debout, à philosopher l’estomac vide, et à feindre de fumer sa demi-cigarette, régulièrement éteinte...."
L'intrigue de L'AFFREUX PASTIS DE LA RUE DES MERLES se déroule à Rome au temps du fascisme ...
Le commissaire de police don Ciccio lngravallo est chargé d'enquêter à propos d'un vol de bijoux, survenu au 219 de la Via Merulana, une rue populaire au cœur d'un des plus vieux quartiers de Rome. Dans l'immeuble du vol habitent deux amis du commissaire, les époux Balducci, chez qui il va déjeuner les jours de fête. Liliane Balducci est, pour le célibataire don Ciccio, l'incarnation de la pureté et de la douceur féminine.
Un matin, don Ciccio apprend que Liliane a été sauvagement égorgée dans son appartement du 219 : le vol des bijoux et l'assassinat de Liliane Balducci sont-ils l'œuvre d'une même personne? La scène du crime est décrite comme un tableau baroque. Les drapés, les objets, la lumière créent une composition dramatique proche du clair-obscur de Caravaggio. Les indices sont maigres, les témoignages contradictoires.
Le roman prend forme d'odyssée, celle de don Ciccio et de ses hommes à travers Rome et la campagne romaine pour essayer de démêler la vérité. En même temps c'est toute une société, du haut fonctionnaire aux prostituées, de l'aristocratie au petit peuple de Rome, qui va se révéler aux enquêteurs, et par-delà au lecteur.
Les soupçons se portent successivement sur un vieux fonctionnaire à la retraite, sur le jeune et beau neveu de Liliane, sur un "maquereau" chargé de faire visiter Rome aux étrangères esseulées. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, un nouveau visage de Liliane se révèle : incapable d`avoir l'enfant qu'elle désirait, elle reportait son trop-plein d'affection sur son bellâtre de neveu et sur des orphelines qu`elle faisait venir de la campagne, qu'elle "adoptait" provisoirement pour les combler de faveurs et les marier à son gré. Déçue et grugée à chaque fois, elle puisait dans la religion la force de recommencer l'expérience, avec l'accord tacite de son mari, simple "objet domestique", habitué à partager son existence entre les voyages pour affaires et la chasse.
Les aveux d`une prostituée, lnès, mettent enfin les enquêteurs sur la trace d'une soi-disant blanchisseuse des environs de Rome, Zamira Pàcori, ancienne prostituée des bataillons d'Afrique, et plus proprement maquerelle, sorcière et guérisseuse. Au doigt d'une de ses employées, le carabinier Pestaloui découvre une des topazes volées Via Merulana. La piste est bonne : elle conduit finalement Pestalozzi chez un garde-barrière de la campagne romaine, où l'on découvre le reste des bijoux cachés dans le vase de nuit de la grand-mère. Entre-temps, les hommes de don Ciccio ont arrêté, au marché de Piazza Vittorio, un jeune vendeur de cochon rôti, le propre frère de l'assassin présumé de Liliane.
Le filet se resserre : don Ciccio part dans une vieille guimbarde interroger Assunta, une des anciennes protégées de Liliane. Il la trouve au chevet de son père mourant. Assunta nie toute complicité dans ce crime : les fils pourtant vont se dénouer, mais don Ciccio, devant la vitalité splendide d'Assunta, hésite un instant, comme saisi de remords.
Le livre se clôt ainsi sur l'hésitation de don Ciccio, sans que l'intrigue ait abouti à un véritable dénouement : une incertitude subsiste sur l'enchaînement des faits - l'histoire s'efface devant les personnages.

Le chapitre le plus emblématique du Pasticciaccio est sans conteste le Chapitre 7, l'interrogatoire de la domestique Ines, un tourbillon linguistique et narratif qui incarne le génie de Gadda (si vous survivez à son chaos linguistique, vous domptez Gadda) ...
Après le meurtre de Liliana Banducci et le vol de ses bijoux, le commissaire Ingravallo interroge les habitants du 219 via Merulana, et l'interrogatoire de la domestique devient le centre d'un chaos verbal dans lequel pas moins de sept témoins parlent en même temps : voisins, policiers, la victime fantasmée. Le récit explose en fragments : scènes de ménage, ragots, souvenirs déformés, autant de reflets d'un réel insaisissable. Et tandis que les policiers notent des détails insignifiants (des spaghettis brûlés), Ines hurle sa misère. Derrière le comique de la scène, perce la pauvreté de l'Italie fasciste. La vérité ? Une aiguille dans une botte de mensonges, commissaire. Et la botte, c’est Rome, cette fichue ville où tous parlent et personne n’écoute (La verità? Un ago in un pagliaio di menzogne, commissario. E il pagliaio è Roma, questa dannata città dove tutti parlano e nessuno ascolta). Ines va livrer un monologue décousu de 17 pages sur les amants supposés de Liliana, les vols des anciennes domestiques et ses propres problèmes de santé : une véritable scène culte de la littérature européenne... mais que la traduction ne peut rendre intégralement ....
«LA INES CIONINL…»
«Comandi, signor commissario capo» fece Paolillo.
«Tenersi a disposizione!...» Povera figliola, avrebbe atteso l'alba sul tavolaccio della camera di sicurezza, rinvoltata dentro una copertuccia bigia da caserma all'insegna der pidocchietto: in compagnia d'altre nereidi pescate ad oceano dal pattuglione, involtate in vigogna doppia del pari, e similmente intrigate dalla parentèla, e a volta a volta sospirose o addirittura eloquenti nel sonno: e in presenza d'un càntaro muto, incoperchiato, in un angolo: er commendató: un tipo autorevole difatti, tesoriere d'escrementi. Riportava l'animo a certa romanesca lautezza e scioltezza del vivere e del fungere, a certo pre-qùarantottardo (o pre-quarantanovesco) e alquanto gregoriano «loisir de siéger».
Povera figliola; dato, invece, quell'ordine, bah, er sor Paolillo la venne a ridomandare alle dieci.
Quanto al Pestalozzi, a un certo punto aveva chiesto compermesso al dottor Fumi, pregandolo dargli agio a potersi rifocillare un tantino, dopo la lunga e non perfetta giornata: idea che Fumi trovò eccellente lui pure.
Piovuto dai colli saluberrimi, il superbrigadiere-centauro aveva interpretato il desiderio di tutti. Si diedero convegno per le nove e un quarto nove emmezza. Prima di riscappar via, logicamente, Pestalozzi voleva concordare il séguito: a conclusione del già fatto. In uno scalpiccio per i corridoi e controscalucce, la radunata si sciolse.
Nel frattempo, salito a palazzo Simonetti a via Lanza, Ingravallo maturò de premura quelle che il Truce in cattedra, a palazzo der Mappamonno, avrebbe chiamato le direttive da impartire... alle sottostanti gerarchie: cioè a li vasi de coccio l'uno de sotto all'artro che se le bevevano a garganella in cascata, le sue traculente fessaggini: l'uno dal sedere dell'altro. Era tardi. Piovigginava. Tutto era ancora sossopra nella notte. Don Ciccio si cucchiarò in bocca la magra minestrucola, ma non tanto magra poi, enfatizzando in uno strascico brodoso la povertà delle proteine e peptoncelli ingredienti: poi, stufo, masticò e mandò giù qualche boccone alla meno peggio, senza far parola, cor capoccione sur piatto, de queli spezzatini de muscolo de caucciù, povero don Ciccio!, amoroso bersaglio d'alcuni «ma che cos'ha stasera dottore?» della impareggiabile padrona tutta in ansie, in premure: che non la finiva più di roteargli attorno, a lui e al servito. «Un po' de stracchino? De quello de Corticelli che je piace tanto, dottó?» E, al grugno che mise: «Un pochetto solo, dottó! Cioo provi: è tanto bono! Mica je po fa male…» Sotto al riflettore di vetro, orlato di crespe e di riccioli bianchi e verdini come l'insalata, er cucuzzone pareva più tenebroso, più riccioluto del solito. Niente automobile! Nessuna comodità di trasferta. Le automobili c'erano, bah! «Ma solo pe chelli scocciatori daa politica», cioè della squadra politica. La gita mancata, l'orribile giovedì: «giuorno dici-assette! 'o peggio nummero», sospirò: «o cchiù fetente 'e tutti!..». grugnì a denti stretti.
Tutto il merito, ora, ai carabinieri di Marino. «Sti lanternoni d' 'o tteate 'e Pulcinella». Pestalozzi cenò di buon appetito a 'o tavolino de marmo: a via der Gesù: dal Maccheronaro: dove ce l'aveva accompagnato Pompè: lo Sgranfia, come lo chiamavano; che fungeva pure da maestro de cerimonie, a Santo Stefano, l'opportunità richiedendo.
Pompeo, da parte sua, non vide quale controindicazione potesse ostare all'introito d'una replica dello sfilatino-scarpa delle sette: con embricature, questa volta, di rosbiffe e di mortadella cotta a fette alterne, mollemente adagiata in quel divano a opera dei diti peritissimi e paffutelli del Maccheronaro: che le tegumentò alfine, un colpo d'occhio a collaudo, a congedo, del pre-resecato e pre-accantonato tetto o coperchio (er mezzo sfilatino de sopra): sporgendo lui er labbro sotto, ma un millimetro appena: intanto che la pappagorgia compressa e per così dire appiattita contro il colletto, se ad un colletto si poteva credere, finì di nascondergli tutta la cravattina di primavera, a farfalla, con piselloni sul verde.
Allibirono, invidi, gli astanti avventori. Una torpediniera d'alto mare, una cosa d'eccezione. A vedella de fòri... decorosissima: ma podentemenie imbottita, dentro. Er Maccheronaro levò le palpebre serio serio, cor labbro tuttavia sporto un millimetro, affisando senza dir parola il cliente diletto, nel momento e nell'atto stesso che gli porgeva quel trofeo. «Semo o nun semo?» parve significare lo sguardo. Pompeo si lasciò guardare. Mise il dente indove gli meritava di metterlo. Doppo un par de mozzichi da cavajere la sua bocca somigliava a una molazza, a un eccentrico. Nun ce la faceva a risponne, si quarcuno je domandava quarche cosa. Girava l'occhi verso quello, du occhioni tonni tonni, coll'aria d'avé capito.
(Le texte alterne entre italien standard, dialecte romain (romanesco), termes techniques et créations lexicales.)
« LA INES CIONINL… »
« À vos ordres, monsieur le commissaire principal » fit Paolillo.
« Tenez-vous à disposition !... » Pauvre fille, elle attendrait l’aube sur la paillasse de la chambre de sûreté, enroulée dans une couverture grisâtre de caserne aux couleurs de la puce (er pidocchietto) : en compagnie d’autres naïades pêchées en haute mer par la patrouille, emmitouflées dans du vigogne double de même, et pareillement empêtrées dans leur parentèle, tour à tour soupirantes ou carrément éloquentes dans leur sommeil : sous l’œil d’un pot de chambre (er commendató) muet, couvert, dans un coin : le commendatore : un gaillard autoritaire en effet, trésorier d’excréments (tesoriere d'escrementi). Cela rappelait une certaine opulence romaine et désinvolture de vivre et de fonctionner, ce pré-quarante-huitard (ou pré-quarante-neuf) et quelque peu grégorien « loisir de siéger » (jeu de mots sur "loisir" et siège de WC).
Pauvre fille ; au lieu de cela, cet ordre donné, bah, Monsieur Paolillo vint la réclamer à dix heures.
Quant à Pestalozzi, à un moment il avait demandé congé au docteur Fumi, le priant de lui permettre de se réconforter un brin, après la longue et imparfaite journée : idée que Fumi trouva excellente lui aussi.
Débarqué des collines salubres, le super-brigadier-centaure (surnom hyperbolique) avait interprété le désir de tous. Ils se donnèrent rendez-vous pour neuf heures et quart, neuf heures et demie. Avant de filer, logiquement, Pestalozzi voulait convenir de la suite : pour conclure ce qui était déjà fait. Dans un piétinement le long des couloirs et escaliers dérobés, le rassemblement se dispersa.
Entre-temps, monté au palais Simonetti via Lanza, Ingravallo mûrit à la hâte ce que le « Truc » en chaire, au palais de la Mappemonde, aurait appelé les directives à donner... aux hiérarchies inférieures : c’est-à-dire aux vases de terre cuite empilés ("vasi de coccio", expression italienne pour désigner des subordonnés fragiles)qui s’en gorgeaient à la régalade en cascade (se le bevevano a garganella, image de cascades d'inepties), ses inepties traculentes : chacun pompant au derrière de l’autre. Il était tard. Il bruinait. Tout restait sens dessus dessous dans la nuit.
Don Ciccio enfourna dans sa bouche la maigrichonne soupite, pourtant pas si maigre, exagérant dans un traînage bouillonneux la pauvreté des protéines et peptoncelles (néologisme peptones)ingrédients : puis, excédé, mâcha et avala tant bien que mal quelques bouchées, sans mot dire, la grosse tête sur l’assiette, de ces ragoûts de muscle de caoutchouc (muscolo de caucciù), pauvre don Ciccio ! cible aimante de quelques « mais qu’a-t-il donc ce soir docteur ? » de l’incomparable maîtresse de maison toute en angoisses, en empressements : qui n’en finissait plus de tourner autour de lui et du service. « Un peu de stracchino ? De celui de Corticelli que vous aimez tant, docteur ? » Et, devant son grognement : « Un p’tit rien, docteur ! Allons goûtez : il est si bon ! Ça ne peut vous faire de mal… »
Sous l’abat-jour de verre, ourlé de frisettes blanches et verdâtres comme salade, la grosse tête semblait plus ténébreuse, plus crépue qu’à l’accoutumée. Pas de voiture ! Aucun confort pour la route. Les voitures y en avait, bah ! « Mais rien que pour ces emmerdeurs de la politique », c’est-à-dire de l’équipe politique. L’excursion avortée, l’horrible jeudi : « jour dix-sept ! le pire numéro », soupira-t-il : « ou le plus fétide de tous !.. » gronda-t-il les dents serrées.
Tout le mérite, à présent, aux carabiniers de Marino. « Ces lanternes du théâtre de Polichinelle ».
Pestalozzi dîna de bon appétit à la petite table de marbre : via del Gesù : chez le Macaronnier : où Pompè l’avait accompagné ; l’Écorcheur, comme on le nommait ; qui officiait aussi comme maître de cérémonie à Saint-Étienne, quand l’occasion se présentait.
Pompée, quant à lui, ne vit nulle contre-indication à ingurgiter une réplique du petit pain-chaussure de sept heures : avec cette fois des imbrications de rosbif et de mortadelle cuite en tranches alternées, mollement déposées dans ce divan par les doigts experts et potelés du Macaronnier : qui les coiffa enfin, jetant un coup d’œil d’essai et d’adieu au toit pré-découpé et pré-positionné (le demi-pain supérieur) : sa lèvre inférieure avançant d’un millimètre à peine : tandis que son double menton compressé et comme aplati contre le col – si l’on peut dire – finissait de dissimuler sa cravate printanière à nœud papillon, pois verts sur fond vert.
Les clients alentour demeurèrent sidérés, envieux. Un torpilleur de haute mer (torpediniera d'alto mare), une chose d’exception. À l’extérieur... fort présentable : mais puissamment blindé, à l’intérieur. Le Macaronnier leva les paupières très sérieusement, la lèvre toujours saillante d’un millimètre, fixant sans mot dire le client chéri, à l’instant même où il lui tendait ce trophée. « On l’est ou on l’est pas ? » semblait dire son regard. Pompée se laissa dévisager. Il planta la dent où il se devait de la planter. Après deux bouchées de chevalier, sa bouche ressemblait à une meule, à un excentrique. Il ne pouvait répondre si quiconque l’interrogeait. Il roulait des yeux vers l’interlocuteur, deux gros yeux ronds comme billes, l’air d’avoir compris."
(...)

"... « À dix heures et demie, ils étaient tous réunis dans le bureau du docteur Fumi. Paolillo avait ramené Ines. Qui était – et où était – le jeune homme ? Et cette amie de son amie ? Mais, quelle amie ? Celle… celle dont elle avait parlé, Mattonari, Camilla : « celle, si je ne me trompe, » dit le docteur Fumi, « l’amie qui travaillait avec toi chez Zamira », chez I Due Santi.
Camilla Mattonari, admit Ines, lui avait parlé d’une amie, qui avait été domestique à Rome, mais pas à la journée complète.
« À mi-temps, tu veux dire.
— Eh bien, je ne sais pas si c’était mi-temps : elle travaillait pour des gens qui lui avaient donné une dot, et maintenant, elle devait se marier.
— Se marier avec qui ?
— Avec un monsieur, un homme d’affaires dans le commerce : le genre qui vit à Turin et fabrique des voitures : qui lui avait offert deux perles. Et à la Chandeleur, d’ailleurs, elle les portait aux oreilles, ces perles. Tout le monde les a vues. » Et elle l’avait aussi rencontrée un soir… quels yeux !
« Quels yeux ! » : et Fumi était agacé ; il haussa les épaules.
« Eh bien, oui, ses yeux… » rétorqua Ines, « étaient… différents. Différents des yeux que nous avons, nous autres. Comme si c’était une sorcière, ou une gitane. Deux étoiles noires, tout droit sorties de l’enfer. À l’Ave Maria, quand il commençait à faire nuit, elle ressemblait à un diable déguisé en femme. Ces yeux faisaient peur. C’était comme s’ils contenaient l’idée de se venger de quelqu’un.
— Donc tu la connais.
— Non, je ne l’ai vue qu’une fois… après la tombée de la nuit.
— Où ?
— Eh bien… c’était sur une route, à la campagne.
— À la campagne où ?… Écoute ici, la fille, ne crois pas que tu puisses me berner… Tu essaies de me rouler dans la farine.
— C’était un chemin de terre : où il y avait un champ… et une église, mais sans prêtres, elle a un nom long avec tondo dedans. »
Une menteuse, qui s’empêtrait dans ses propres mensonges. Fumi se demanda si elle était folle, ou quelque chose dans le genre. Les idées tortueuses et alambiquées d’une paysanne stupide qui ment. Après l’avoir harcelée, tous les quatre, comme quatre chiens après une biche, la tirant et la poussant dans tous les sens sous la torture d’objections faciles et pourtant répétées, ils réussirent finalement à lui arracher des lèvres le mensonge apaisant, le mensonge plausible : celui qui, contredisant ou résolvant tous les précédents, semblait enfin être la vérité. On découvrit que la « route de campagne » devait être une rue (à cette époque encore campagnarde et solitaire) sur la colline du Cælius, parmi des pins parasols silencieux, des champs d’artichauts et quelques écuries, des murs en ruine et un ou deux arcs, foulée, au crépuscule, par les pas merveilleux de la solitude, si chers aux amoureux : c’était peut-être la Via di San Paolo della Croce, ou plus probablement la Via della Navicella ou Santo Stefano Rotondo. L’arc était celui de San Paolo, sinon l’arcade de la Villa Celimontana à côté de Santa Maria in Domnica. Le « tondo »… « sans prêtres », ce n’était pas, ne pouvait pas être, le Temple d’Agrippa, où les limiers avaient voyagé en pensée, le rejetant immédiatement car il ne se trouve pas « à la campagne ». C’était plutôt Santo Stefano Rotondo, désacralisée, ces années-là, pour permettre certains travaux de restauration.
Avec toute cette logistique, le docteur Fumi avait plutôt perdu de vue la gitane, la fiancée de l’industriel turinois. Les limiers semblaient s’enfoncer plus profondément dans la boue.
« Parle-nous de ces boucles d’oreilles.
— Je ne les ai pas vues. Mais tout le monde est au courant : deux longues boucles d’oreilles, comme celles d’une vraie dame. » Et elle répéta, d’un ton entêté et chantant : « son fiancé les lui a offertes, un homme d’affaires de Turin : il achète et vend des voitures : comment puis-je être plus claire que ça ?
— Laisse tomber le clair et l’obscur… la clarté est notre affaire, » la réprimanda le docteur Fumi, ses yeux maintenant lourds de colère. Qui était-elle ? Oui, cette sorcière, cette gitane… Où habitait-elle ? Quelle était son adresse ? « Son adresse… » Ines hésita de nouveau.
Eh bien, elle devait habiter quelque part vers Pavona : c’est ce que lui avait dit la Mattonari. Et c’est ce que tout le monde disait, chez I Due Santi. « Cette fille a de la chance : Rome, c’est là que les filles se perdent : et au lieu de ça, elle s’est même fait offrir une dot, voilà. Et maintenant, quand elle en a envie, elle peut se marier avec un vrai monsieur. »
Les officiers, le docteur Fumi, Ingravallo, le sergent Di Pietrantonio, le caporal échangèrent des regards. Grabber, jeune homme perspicace qu’il était, lut dans ces regards une pensée : « Cette fille essaie de nous baiser. Elle croit qu’elle vole des bonbons à un bébé. »
Ingravallo semblait fatigué, contrarié, agacé : puis absorbé dans une chaîne de pensées. Grabber soupçonnait que d’étranges analogies, inconnues des autres, étaient à l’œuvre dans ce cerveau. Il n’y avait aucun lien apparent, mais qui sait s’il n’en existait pas un, qui sait si Ingravallo ne l’avait pas deviné, noir et silencieux dans sa réflexion ; il n’y avait aucune piste menant du livreur en tablier au voleur en salopette, au meurtrier inconnu, jusqu’aux grands yeux de la gitane.
« Et le garçon ?
— Quel garçon ?
— Ton petit ami, ce guappo, ce petit escroc : comment veux-tu que je l’appelle ? » Le docteur Fumi semblait l’encourager, l’inviter à raisonner, à parler. Puis Ines prit peur : elle semblait soudain fatiguée, dans son attraction sordide : elle semblait se replier de honte, envelopper sa souffrance : les yeux enfoncés, creux, son front blanc enveloppé de tristesse sous cette chevelure blonde, si dure, durcie par un peu de pluie séchée et de crasse desséchée dans la poussière (cette chevelure, pensèrent-ils tous, d’où un peigne en celluloïd vert aurait extrait de l’or au soleil), ses lèvres un peu gonflées et comme encore gercées par chaque rafale du vent de mars.
« Il s’appelle Diomede, mon petit ami. Mais je ne sais pas où il habite. Il déménage tout le temps.
— Déménage comment ? » Il se déplaçait dans les deux meilleurs sens du terme : changeant souvent de chambre ou plutôt de tanière ou de lit de camp : et flânant oisivement dans Rome du matin au soir : à la recherche de je ne sais quoi. La dernière fois, elle l’avait croisé au Tunnel de la Via Nazionale. Il vivait ici un moment, puis là. Mais il ne voulait pas lui dire où il logeait. Sur un canapé chez un parent : dans une chambre louée à une couturière. Dans le lit vide d’un oncle mort, il y a deux semaines… c’est-à-dire l’oncle d’un ami à lui, qui avait perdu son oncle. Et quand il ne s’en sortait plus, ne pouvait plus payer, alors il devait changer d’air, tu vois ?
« Évidemment, » approuva le docteur Fumi à voix basse. Et il errait dans la ville sans but particulier, ou bien avec des itinéraires lents et peut-être médités : il passait doucement d’un quartier à l’autre : Monti à dix heures, Trastevere à quatre heures, Piazza Colonna ou Piazza Esedra avec les lumières et les enseignes lumineuses rouges et vertes du soir, de la nuit. Les quartiers résidentiels ? Oui.
« Il faisait aussi parfois la Via Veneto, la Via Ludovisi, où c’est un peu plus sombre, à cause des femmes. »
« La fille rougit, leva la tête, et sa voix devint pleine de rancœur, agacée. « Il sortait marcher, marcher : il devait faire ressemeler ses chaussures tous les mois : il marchait, et disparaissait, et on ne savait jamais où il était allé. »
Soit pour cultiver ses belles, soit pour échapper à ses belles : certaines belles, du moins c’est ce qu’il semblait à Ingravallo, qui le cherchaient, désireuses de le trouver, de l’attraper, avec de longs regards scrutateurs par-dessus le flot des voitures, d’un trottoir à l’autre, ou le long du trottoir encombré de tables et de chaises, où des dames et des messieurs buvaient ou étaient en train de sucer, à petites gorgées prudentes et désintéressées, de pâles fistules.
« Elles iraient au bout du monde pour le traquer », déclara-t-elle, les yeux fermes, calmes.
« Lui aussi ! Lui, aussi ! » Les sentiments d’Ingravallo s’en trouvèrent blessés. « Dans le registre des fortunés et des heureux, même lui ! » Son visage s’assombrit. « Lui aussi, persécuté par les femmes ! »
« Alors il erre un peu, vous voyez ce que je veux dire… » et, après une hésitation et avec une certaine émotion dans le ton : « comme ça, toutes ces femmes qui le cherchent ne le trouveront pas chez lui, comme ça il n’a pas à buter sur une fille à chaque pas. »
D’une main, elle rejeta en arrière sa méchante tignasse : elle se tut.
« Je comprends, » reprit le docteur Fumi. « Maintenant, dis-moi : à quoi il ressemble, quel genre de visage il a, ce Diomède ? Au fait, Diomède, c’est son prénom ou son nom ? »
« Son nom ? » Ines baissa les yeux : elle rougit, pour gagner du temps, pour fabriquer son soixante-treizième mensonge.
« Son nom, » enchaîna Ingravallo. « Oui, nous pourrions avoir besoin de lui. »
« Pour apprendre aussi quelques petites choses de sa part, » ajouta le docteur Fumi.
« Eh bien, il ne voulait pas me dire son nom. »
« Mais il te l’a finalement dit, quand même, » insista Ingravallo. « Sors-nous son nom. »
« Écoute-moi, ma petite. Nous tous, ici… c’est mieux pour toi… nous avons besoin de son aide. »
« Mais Monsieur l’officier, comment pouvez-vous avoir besoin d’un garçon comme lui ? Il n’a jamais fait de mal à personne. »
« Il t’en a fait, à toi !… Vu que la brigade des mœurs t’a ramassée. »
« Eh bien, je veux dire, ça c’est entre lui et moi : la police n’a rien à voir là-dedans : c’est notre affaire. »
« Ah ah, alors la police n’a rien à voir, hein ? Ma petite, tu ne parles pas raison. C’est nous qui savons de quoi la police doit ou ne doit pas s’occuper. »
« Il n’a rien fait. »
Bon, alors dis-nous son nom. »
« Et moi non plus, je ne sens pas que j’ai fait quelque chose de mal » : ses yeux s’humidifièrent : « Lâchez-moi, moi aussi. »
« Diomède, hein… » et le regard du docteur Fumi avait l’inflexibilité d’une demande de papiers d’identité, urgente.
« Eh bien, on m’a dit qu’il s’appelait Diomède… Lanciani, Diomède. » Et elle éclata en une sorte de sanglot étouffé, doux.
« Ne te fais pas de souci. Nous voulons mettre la main sur lui parce qu’il doit nous dire… quelque chose : quelque chose d’intéressant. C’est pour ça qu’il faut qu’on le trouve. »
« Dépêche-toi maintenant. Quel genre de binette a ce Lanciani ? » insista Ingravallo, dur. « Il est grand ? petit ? blond ? il a les cheveux foncés ? »
Tiraillée entre la méfiance et la fierté, Ines s’essuya les yeux du revers de la main. « Ce Lanciani est électricien, » dit-elle fièrement : et se mit à esquisser son portrait. Sa voix, après des pauses de peur et de suspicion et des aveux empreints d’une prudence tardive, s’anima jusqu’à une gaieté insouciante, presque joyeuse. Elle avait mal pris le choix des mots d’Ingravallo. « Si vous voulez savoir pour cette binette, » reprit-elle, se tournant vers Fumi comme vers le plus bienveillant de ses deux principaux inquisiteurs, « il y a plus d’un garçon qui serait content de l’avoir, cette binette ; croyez-moi, Monsieur, chef, que vous ne la refuseriez pas vous-même, un visage comme ça. » « Bien sûr, bien sûr. » « Un garçon de cette taille » : et elle fit le geste habituel, levant et étendant horizontalement sa main. Elle pencha la tête sur le côté, pour mieux regarder sa paume, pour évaluer, d’en bas, la précision de cette indication de taille. « Un beau garçon. Oui, il est beau. Et alors ? C’est contre la loi ? Il est malin, en plus. Oui, blond. C’est pas sa faute si sa Maman l’a fait blond. Hein ? Elle devait le faire brun, alors qu’elle avait envie de le faire blond ? » Dans son sac, elle avait même sa photo. Paolillo partit aussitôt au débarras pour dénicher, dans ces guenilles, ce misérable petit porte-monnaie : la carte d’identité de la pauvre fille, qu’elle avait refusée à la patrouille lors de son interpellation, était déjà sur le bureau du docteur Fumi et sous la lampe, ouverte, froissée. Paolillo revint, avec le porte-monnaie du vagabond et, dans l’autre main, la photographie d’un jeune homme douloureusement signée en travers d’une griffonnade : « Lumiai Dio… » épela-t-il en marchant, et il était sur le point de la tendre. « Donne-la. » Le docteur Fumi la lui arracha des mains. « Lunci-a-ci Di-o… Dieu seul sait ce qu’il a écrit ici. Diomède ! » s’exclama-t-il, victorieux. Un sacré numéro ! Un visage du genre que le bimensuel « La Difesa della Razza » (« La Défense de la Race »), quinze ans plus tard, aurait publié comme exemple de splendide aryanisme : l’aryanisme des peuples latins et sabelliens. Comme une copie exacte, oui. Il était blond, certainement : la photo l’affirmait : un visage viril, une tignasse. La bouche, une ligne droite. Au-dessus de la vie des joues et du cou, deux yeux fermes, moqueurs : qui promettaient le meilleur, aux filles, aux bonnes, et le pire à leurs économies délaissées. Un audacieux, fait pour être entouré et disputé, suivi et rattrapé, puis gratifié de cadeaux par toutes les filles, plus ou moins, selon les possibilités de chacune. Un type à représenter le Latium et sa beauté au Foro Italico.
Cette photo, expliqua Ines, lui avait coûté un nombre incroyable de gifles : parce que lui, un jour, l’avait réclamée. Oui, il la voulait à tout prix. C’était la nuit, presque. Il était devenu méchant, alors qu’elle refusait : il semblait hors de lui. Il lui avait crié au visage, l’avait traitée de tous les noms, il avait même eu le cœur de la gifler : et, comme si ça ne suffisait pas, des menaces. Ils étaient seuls, entre deux murs, sous un réverbère cassé du Clivo de’ Publicii à Rocca Savella, où sont les chevaliers : la nuit tombait. Mais elle avait encaissé les gifles, sans ciller. Elle avait tenu bon. Au moins ce souvenir de lui ! de tout l’amour qu’ils s’étaient portés ! et elle l’aimait toujours, de son côté : même si maintenant… ils la forçaient à le dénoncer. « Mais il n’y a rien à dénoncer ! » cria-t-elle. « Alors il m’a donné une paire de gifles, et alors ? C’est notre affaire : vous ne pouvez pas le mettre en prison pour ça. »
« Une paire de gifles ! » et le docteur Fumi, hochant la tête, la regarda. « Avant, tu nous as raconté une autre histoire : mais peu importe ! » et il rentra la tête dans les épaules. Il était sur le point de lui répéter qu’elle n’avait rien à craindre : ils voulaient seulement l’interroger, pas l’arrêter, encore moins l’enfermer. « Enfin bref, je suis sûre que vous n’y arriverez jamais : vous ne le trouverez pas, pas lui. » Elle parlait la tête baissée, pensive. « Et puis, si vous le trouvez, j’en serai contente. Ça mettra fin aux choses entre lui et… cette Américaine. » Elle semblait se justifier, en tant que femme, devant elle-même. »
(...)
On le voit, la traduction est bien malaisée, il faut choisir et bien choisir la stratégie...

Dans "L'Affreux Pastis de la rue des Merles", Gadda abandonne la critique de la société milanaise, qui avait été la base de ses livres précédents. Les riches bourgeois de Milan cèdent la place aux petits-bourgeois et au menu peuple de Rome. L'intrigue policière n'est ici qu'un prétexte à une exploration, tout intérieure, de l'univers populaire romain. Don Ciccio, avec sa patience obstinée, ses colères brusques, son scepticisme et son humanité profonde, est un peu le double de l'écrivain : c'est lui qui est au centre de l'histoire et qui donne son sens à une réalité multiforme et contradictoire et ne parvient pas à dissimuler la participation intime de l'auteur au destin du peuple italien sous le fascisme. Pour raconter cette histoire aux mille rebondissements, aux personnages les plus inattendus, Gadda a inventé un langage qui résulte de la fusion intime de l'italien couramment parlé avec le dialecte de Rome. Grâce à la distance créée par le langage, grâce à un humour permanent et à une intention stylistique continuelle, l'écrivain a pu raconter une histoire qui se situe à chaque instant sur deux plans : celui du réalisme et celui du symbole. (Trad. Editions du Seuil, 1983).

Une adaptation cinématographique du roman de Gadda a été réalisée sous le titre de "Quel maledetto imbroglio" (1959) par Pietro Germi (célèbre pour "Sedotta e abbandonata"), avec Pietro Germi (le Commissaire Francesco Ingravallo) et Claudia Cardinale (Liliana Banducci, la victime). Un film qui, en simplifiant l'intrigue, restitue l'atmosphère d'une Rome fasciste des années 1920, la dimension policière et la satire sociale, mais ne parvient pas, on peut le comprendre, à traduire la langue de Gadda : le mélange de dialectes romains, d'italien littéraire et de néologismes est quasi intraduisible à l'écran ...

"La meccanica" (1950)
Non traduit intégralement en anglais (extraits disponibles dans The Novels and Stories of Carlo Emilio Gadda), ni en français - "La meccanica" est un texte court (un racconto ou « racconto saggio ») que Gadda écrit en 1950, publié dans la revue Letteratura. Il s'agit d'un texte hybride, entre récit autobiographique et essai philosophique. Il s’inscrit dans la veine de la réflexion technique et scientifique de Gadda, qui, rappelons-le, était ingénieur de formation.
Le texte ne raconte pas une histoire linéaire au sens traditionnel. Il s'agit plutôt d'une méditation sur le monde mécanique, entendu à la fois comme univers technique et comme métaphore de la condition humaine.
Gadda commence par évoquer les machines et les moteurs, les ateliers, les gestes précis de l'ingénieur ou du mécanicien. Il décrit la beauté d'une machine en mouvement, la « poésie » de la transmission mécanique, des forces, des engrenages. Il introduit des souvenirs personnels : par exemple, son expérience d’ingénieur, ses études, son rapport intime à la technique. Il souligne la discipline rigoureuse de la mécanique, où chaque pièce doit s'ajuster parfaitement, et chaque écart peut conduire à l'échec.
Mais cette description technique glisse progressivement vers une métaphore existentielle :
La mécanique devient le modèle d'une vision du monde où tout est déterminé, régi par des lois implacables, où l'homme est aussi un « engrenage » pris dans un système.
Gadda évoque l'idée que la mécanique, comme la vie, est faite de tensions, d'efforts, de forces contrariées. Il insiste sur l’angoisse de l’imperfection, sur la souffrance causée par la friction et la résistance (image du destin, du conflit intérieur). Enfin, il critique implicitement une vision trop rationaliste ou simplificatrice du monde (il s’oppose à une mécanique « pure » qui oublierait la complexité humaine).
La mécanique n’est pas seulement une science froide et extérieure, mais aussi une métaphore de l’existence humaine : nous sommes nous-mêmes des structures complexes, soumises à des forces, des chocs, des ajustements. Les défauts, les frottements, les jeux dans les machines traduisent la tragédie de l’homme moderne, toujours en tension entre aspiration à la perfection et réalité chaotique.
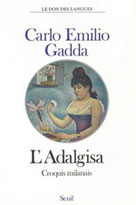
"L’Adalgisa: Disegni milanesi" (1944)
"The Milanese Sketches" (dans The Novels and Stories of Carlo Emilio Gadda) ou en français, "L'Adalgisa" (trad. Seuil), une série de vignettes satiriques et affectueuses sur la bourgeoisie milanaise, pleine de jeux de langue et de dérision. Mais la traduction française ne contient pas exactement tous les "disegni" du recueil italien original, et certains ont été écartés ou recomposés...
Le recueil, qui porte le sous-titre de "Croquis milanais", met en scène la riche bourgeoisie et l'aristocratie de Milan, à laquelle l'auteur est lié par sa naissance et par ses fonctions d`ingénieur. Les mêmes personnages, les mêmes familles se retrouvent de nouvelle en nouvelle, et l'ensemble finit par constituer une sorte de comédie humaine à l'échelle de la "bonne société" milanaise. En même temps qu'il fait œuvre de conteur, Gadda s'abandonne au plaisir nostalgique d'évoquer le vieux Milan du début du XXe siècle et se met parfois en scène lui-même parmi ses personnages. Au fil des nouvelles, le lecteur se familiarise peu à peu avec ce monde clos des bourgeois de Milan que l`écrivain lui présente tantôt de l'intérieur, en évoquant les problèmes intimes des personnages, tantôt de l'extérieur, en les observant impitoyablement, comme une faune ou une flore sous l'œil du naturaliste, leur obsession de la respectabilité, leur provincialisme caché sous un vernis mondain, leur conformisme moral et esthétique ...
Parmi les sept textes de la traduction française, un petit récit satirique (Quand le Girolamo a fini…) centré sur le personnage de Girolamo, un musicien (ou un chef d’orchestre amateur) qui anime les fêtes familiales ou les petites réunions musicales bourgeoises : dès la fin du morceau, tout le monde soupire de soulagement, s'agite et reprend ses conversations mondaines. "Nuit de lune" décrit Milan, les lumières, les façades, les gens qui s’agitent encore la nuit, et surtout l’atmosphère ambiguë de la métropole moderne."Claudio désapprend à vivre" (Claudio va a imparare a vivere), un jeune homme milanais de la bonne bourgeoisie envoyé par ses parents pour se dégourdir dans la "vraie" vie dans différents milieux, finit par échouer systématiquement, « le monde » n'enseigne ni la force et ni la virilité. Dans « Il eut quatre filles et chacune fut reine », chacune des quatre filles d'un bourgeois milanais épouse un « bon parti » et devient, à sa manière, une petite reine dans son cercle mondain. Les mariages sont perçus comme des opérations de prestige, de conquête sociale, jamais comme des unions affectives. Dans « I momenti perduti » (Les Moments perdus), Gadda évoque ces « moments perdus » de la vie, ces instants d’oisiveté, d’ennui ou de contemplation stérile, que l’on croit souvent insignifiants ou « inutiles ». À Milan, ces moments sont remplis par des activités futiles : bavardages, visites mondaines, lectures inutiles, promenades sans but, petites manies.
Dans "Au parc, un soir de mai", lieu mondain où la bourgeoisie milanaise vient se promener, discuter, se montrer, chacun joue un rôle, où tout est réglé par des conventions sociales. Ce ne sont pas des personnages individuels très développés (comme Adalgisa) : ici, Gadda présente plutôt une fresque collective, une peinture satirique...
"La dame, très bien mise en carrosse, et pomponnée selon certains tons de carême, entre le violet et le noir, se livrait aux regards en grâce un peu fanée : toute abandonnée à son siège et à son dossier, à la majesté et au charme avec lesquels elle soutenait son parasol violet, enguirlandé d’une laitue violette de crêpe. Quoique ridé, et jaune, son visage cependant étincelait à présent et souriait, plein d’une bienveillance inattendue, que le peuple peut-être ne méritait pas. L’ataraxie habituelle de son esprit, et de son nez imperturbable, semblait s’attiédir, et fondre, sous l’haleine germinale du printemps, dont la tendresse et le sourire apparemment l’ensorcelaient : ce même sourire que Luini avait identifié et reflété entre les peupliers de ces terres, pour la joie un peu fermée, si bien astiquée, du musée Poldi-Pezzoli7. Puis cette manière impétueuse, par trop facile, insipide donc et banale, de bourgeonner des marronniers, leur furie muratto-plébéienne, et d’ailleurs excusable, de vouloir d’un coup verdir le Parc tout entier, avant tous les buissons du Parc. Une lumière bienveillante et bonne descendait de ses yeux haut placés et de son « esprit dominateur » (ainsi le célébraient les Perego) sur l’infanterie pantouflarde de l’humanité. Ses dernières lectures et méditations l’avaient conduite à soupçonner d’abord, et puis à admettre… que même les laitiers, après tout… Si bien qu’elle semblait à présent, avec cet éclair mou dans le blanc de l’œil deux fois hyperbrillant, elle semblait vraiment dire : « Mes frères, mon cœur est à vous… »
Dans « Un concert de cent vingt professeurs" on voit le ban et l'arrière-ban des grandes familles milanaises se ruer à un concert de musique moderne parce que le décorum l'exige et qu'il leur faut affirmer leur primauté artistique et culturelle. Parmi cette foule, il s'attarde notamment sur les jeunes femmes des grandes familles, des figures décoratives, plus préoccupées par leurs toilettes et leurs allures que par l'expérience esthétique ou intellectuelle du concert. Fidèle à son style « baroque » et analytique, Gadda observe la société comme un ingénieur observe une machine ou un système.
"Dans le théâtre bruyant, jeune homme et jeune fille arrivaient à leur place, ôtaient la marque de son occupation, mettaient en mouvement, en le levant, puis le rabaissant, le siège mobile, y pinçaient un bout de la jupe ou du pardessus de l’occupant de derrière, s’asseyaient : jeune homme et jeune fille à l’âme sereine et pure, à l’œil limpide : et au cerveau sain, comme, par certains matins bleutés, le granit éminent des Alpes". La description des jeunes femmes est presque clinique, comme s'il disséquait un phénomène social. Leur gestuelle, leurs regards, leurs déplacements deviennent pour lui des symptômes d’un malaise collectif ou d’une décadence morale....
".. Et partout des filles, qu’on appelait alors, chez nous, « demoiselles ». Quatre-vingts filles environ à marier, dont quarante, au minimum, infirmières diplômées ou en train de l’être à la Croix-Rouge italienne : et quarante munies du diplôme de cuisinières ou d’éleveuses de chapons, délivré par l’École ménagère de via Quadronno. Ces quatre-vingts-là avaient à leurs trousses cent vingt mères joueuses de bridge : disséminées un peu partout sur les sièges les plus « acoustiques » de la salle tant giuseppienne que verdienne : munies, pour les mères les plus redoutables, de lunettes, certaines même de jumelles. Bien entendu, de petites jumelles en nacre, ou que sais-je, cerclées d’or, non pas une véritable longue-vue de marine : qui aurait par trop grogné dans le marsupium du sac, tout maternel et spacieux qu’il fût.
De ces quatre-vingts filles, c’est-à-dire, je m’embrouille, de ces cent vingt mères, quatre-vingts étaient leurs mères proprement dites, aux filles : les quarante autres étaient les mères de leurs amies les plus chères : leur fille s’étant sauvée en auto vers lacs et pervenches, elles, sur le coup, n’avaient point eu pendant tout l’après-midi une fille aux trousses de qui rester : à « lancer », en somme, au concert de Stangermann.
Il y avait des épouses, connues en ville pour leur grâce avenante, comme on disait bien des années plus tôt : c’est-à-dire pour leur beauté fraîche et comme assouvie. Ces dernières, à l’observateur le moins agressif, ou le plus enclin vers l’histoire des mœurs, faisaient penser aux dragées : avec le diadème de fleurs d’oranger, l’écharpe tricolore, la plume en or, le discours du curé, l’allocution de l’oncle Gnecchi au champagne, et le champagne lui-même, et les fracs : et tout le flot de la correspondance, imprimée ou à la main, qui avait précédé, accompagné, suivi des noces si bien méritées : épithalame sans précédent dans l’histoire de notre ville. Leur sublime visage disait la certitude et la validité d’un amour quotidien, légitime, exempt de tempêtes et d’impôts, présents sinon futurs : pour qu’elles puissent l’exercer sans menace, sur une terre sereine, après les rubis, un cadeau, dont avaient subitement pâli les héros. De chaque élu, dans le caillot de son sang, la chasteté lacérée s’égarait à travers la pierraille, les mouches vertes retenaient, ivres, la putréfaction de la doline46. Et elles, dans leurs lins candides. Pas encore violée par d’impudentes restaurations, la divine attitude de leur visage semblait auréolée d’un halo de télégrammes de vœux. Chaleureux et bourrés de fautes, comme d’habitude. Le meilleur télégramme, quoi qu’il en soit, c’est celui qui sait germer, auguste et tacite, du sentiment intime de l’aimé.
Il y avait les mères et les épouses, les maris et les fils, et les vieux qui ont beaucoup souffert : Té polù tletòi té geròntes. Les fils qui partiront peut-être un lendemain : ils iront où les appellera le destin : ou peut-être ils resteront immobiles, à se balancer, là où le destin les aura oubliés.
Il y avait quarante-deux belles-mères encore potables (à leur avis) : quelques veuves pudiques (sans compter la veuve Borella), auxquelles Stangermann ne paraissait pas sans quelque convenance, puisqu’il s’agissait de musique, et la musique, parfois, fait pleurer comme les oignons. Il y avait, non pas là, mais bien chez elles, existantes, persistantes — là, elles se manifestaient par leurs ramures, les pinacles infinis des arrière-petits-fils —, dix-neuf arrière-grand-mères de quatre-vingt-quatre ans, encore alertes pour une quinzaine d’années de plus. Sorte de collégiale de Dolomites d’Ampezzo, ou de Castrozza, elles étaient encore parées de toutes leurs terrestres visées : et même aux termes de la loi, d’ailleurs, il fallait leur donner tous les soins nécessaires, prendre les plus amoureuses précautions de manière à les conserver en vie et efficacité dolomitique le plus longtemps possible, éventuellement au-delà de leur centième année. Elles tiraient encore, impérieusement, la sonnette, se faisaient appeler « comtesse » ou « donna Carla » par la préposée au clystère, avaient encore dans leur tête tout un assortiment d’ordres, de commandements, de contrordres, à donner l’un après l’autre à la servante, à la cuisinière, à leur bru : de la diane au couchant. Mâchouillant entre des gencives édentées une bouillie de biscuits défaits, écrabouillée en simple amidon, en eau et gluten, elles poursuivaient de caravanes de malédictions motorisées les hanches en fuite de la servante ; pour le lait, pour la peau du lait, parce que le lait s’était refroidi, parce qu’elles avaient barbouillé du trop-plein de lait leurs pantalons. Leur châle. Parce que le café, que Palmira avait mis dans le lait, était trop long ou trop court, ou trop chaud, ou trop couleur clystère. Parce qu’elles avaient bien compris qu’on voulait les empoisonner. Du fond de leur fauteuil millénaire, la tremblote dans leurs genoux, dans leurs longues mains squelettiques, veinées de bleu, impuissantes à frapper, à faire justice, elles aboyaient à travers des yeux safranés leur tenace malédiction contre les survivants : en train, ces derniers, de vider la chaussette de quelques petits louis d’or oubliés là depuis le temps du Prina, pour arriver à payer, payer, payer : tout ce qu’il y avait à payer...."
"L’Adalgisa" - Au terme de son itinéraire milanais, Gaddda évoque le personnage qui donne son nom au recueil, la veuve Adalgisa Borella-Biandronni, ancienne chanteuse lyrique des salles populaires, douée d'un « talentino », un petit talent qui, bien qu’authentique, demanderait un long travail pour s’affirmer. Le contraste entre sa naïveté provinciale et Milan, ville impitoyable, mondaine, superficielle, est montrée non sans tendresse. Après ses débuts pleins d’espoir, vite embourgeoisée par son mariage avec un ingénieur de la bonne société milanaise, un frêle personnage lunaire passionné par l'entomologie, elle représente la femme du peuple milanaise prête à tous les sacrifices pour une place dans la société. Elle finira par trouver une forme de succès limité, mais qui reste provincial et modeste. Elle se produira dans des théâtres secondaires et participera à des concerts ou des soirées de société, sans jamais atteindre la consécration espérée. Ni tragédie, ni apothéose. Adalgisa, qui voulait être une étoile, s’est transformée en « petite planète » qui gravite autour des salons milanais.
" .... Il restait, pour elle, « son art » : la question de la voix. Mais au cours de ces deux mois, l’art, c’est-à-dire la voix, se remit en place tout à fait. Elle devint une voix normale, plus que normale : qui donne des ordres à la femme de chambre, à la cuisinière, comme il convient aux dames, à une vraie dame. Elle faisait des gargarismes. Elle employait des collutoires très efficaces, où elle dissolvait deux ou trois substances à la fois.
Pourtant, parfois, elle s’éprouvait réticente et fâchée à l’idée que « son » Carlo, « si sensible en tout », n’était jamais parvenu à sentir « tout le mal qu’il lui avait fait » en riant, à certains moments, de l’art : et d’elle : ou du moins en négligeant, ou sous-évaluant, chez elle, justement « ce que Dieu lui avait donné de plus précieux » (par quoi elle entendait précisément la voix). Mais petit à petit elle se calma : s’apaisa.
Elle regardait, rêvant les yeux ouverts, vers de lointains rivages. Une palpitation soudaine, montée du nœud vivant et profond des viscères, comme un surgissement obscur, comme de quelqu’un au loin qui demandât la vie, et la maternelle caresse. « Ce n’était pas la voix, se disait-elle, ce n’était pas négligence !… Mais non, mêm’ pas gh’un songe ! » Elle haussait légèrement les épaules, souriante, les yeux pointés vers l’infini, ben foeurs le voir, au point de ressembler à une jeune mariée de Novello.
« C’était la jalousie !… » Voilà ce que c’était. « L’était jaloux de tous ces mirliflores… avet leurs bouquets à fleurs… L’ pauv’ gosse ! » sourit-elle : et elle regardait encore au loin, rêvant, loin, bien loin : « Près tütt, l’est ’n homme, lü aussi, avet sa pâr’ de mustak… » Un homme. Oh ! de cela, elle était certaine. Elle s’apaisa sur cette idée de la jalousie : et peut-être aussi en cette autre, contiguë, qu’il était un homme : celle-ci, d’ailleurs, plus profonde et valable : quoique moins convenablement exprimable. Elle s’apaisa, et fut sauvée. Elle resta toujours vive et lucide, exigeante (aux casseroles, avec les domestiques) et docile (aux rythmes). Saine et chaude, elle l’était déjà pour son compte...."
Dans ce recueil, qui contient les meilleurs récits de Gadda, l'écrivain règle ses comptes avec la société milanaise, dont il dénonce la vanité, le vide et l'hypocrisie. Mais en même temps Gadda demeure encore trop lié à cet univers qui est le sien pour ne pas donner à sa critique un aspect autobiographique et restituer la fascination qu`un tel milieu peut exercer sur un observateur extérieur. La société milanaise apparaît comme un monde extravagant, au-delà de toute appréciation d'ordre moral et de tout jugement critique, un monde non terrestre dont Gadda saisit sur le vif l'aspect grotesque et insensé.
Pour traduire cette intuition du caractère des bourgeois milanais, l'auteur a eu recours à un style héroïcomique, un style baroque qui unit, dans un syncrétisme original, les composantes populaires du dialecte milanais, le langage technique des ingénieurs et les connaissances humanistes propres à Gadda. (trad. Seuil, 1987).

"Meditazione milanese" (1931)
Une méditation épistémologique sur la méthode. "Meditazione milanese" est un texte rédigé en 1931, publié d'abord dans la revue Solaria en 1932, puis inclus plus tard dans le recueil I sogni e la folgore (1955). Il s’agit d’un texte théorique, à la fois confession et méditation stylistique, dans lequel Gadda élabore ses idées sur le langage, la connaissance et la structure de la réalité. "Meditazione milanese" anticipe la poétique du "roman inachevé" de Gadda, qu’on retrouve dans La cognizione del dolore ou Quer pasticciaccio brutto de via Merulana. Pas de traduction complète en anglais ni en français.
1 - IL DATO E L’INIZIO DELLA ATTIVITÀ RELATRICE
Chiediamo a noi medesimi 'Donde comincerò?'. Ci chiediamo inoltre se è possibile che un metodo preceda l’analisi: se è doverosa una conoscenza, avanti la determinazione del metodo. Questa perplessità si e palesata nelle manifestazioni del pensiero: si adduce, a ragione dell'incompiutezza del «Tractatus de intellectus emendatione» di Benedetto Spinoza, ch'egli intuisse come il fondamento della correzione non fosse se non l'idea centrale della prima parte dell’«Etica»: l'unità.
La conoscenza centrale era essa il metodo. In realtà la questione, posta così schematicamente in termini, è falsa: un metodo è già una conoscenza ed elezione, presume nozioni; se non le nozioni centrali di un aggruppamento conoscitivo, al contrario di ciò che potrebbe mostrare l’esempio citato, certo alcuni dati. Certamente, da un punto di vista psicologico-storico, ognuno di noi e la collettività stessa de' nostri uomini, e l'intero genere umano, instituiscono e devono instituire l'analisi (mediante un processo di afairesis: molto dopo verrà, se verrà, l’apodeixis) ne' modi e con i mezzi onde il topografo eseguisce la triangolazione d’un territorio. Da una base nota comprendente termini sufficienti (cioè angoli e distanze noti), si procede alla determinazione di punti ignoti. Questi servono alla loro volta come stazione per l’ulteriore sviluppo.
Se non che il terreno su cui il geodeta fonda il suo teodolite e, rispetto ai fini che si propone, una salda, una univoca realità. Inoltre, lo sviluppo della ricerca è per lui uniforme e consente l’uso costante di strumenti costanti. Il terreno del filosofo e la mobile duna o la savana deglutitrice: o meglio la tolda di una nave trascinata dalla tempesta: e il ‘bateau ivre’ delle dissonanze umane, sul cui ponte, non che osservare e riferire, è difficile reggersi. Questa nave viaggia mari strani e diversi: ed ora la stella è termine di riferimento, ed ora, nella buia notte, il 'metodo’ non potrà riferirsi alla stella.
Mobile è il riferimento conoscitivo iniziale: diverso, continuamente diverso, il processo.
Insisto su questi due temi: primo: la nostra analisi ha inizio da un dato psicologico-storico (cioè personale-ambientale) che possiede un suo flusso, una sua velocità: che e labile, mobile. In quanto labile in sé noi lo intuiamo per prima approssimazione come un sistema in sé, cioè come qualcosa di non semplice. In quanto mobile noi lo intuiamo per prima approssimazione come appartenente ancora a un sistema che diciamo esterno.
Esiste dunque un qualcosa con velocità diversa, con forma intrinseca diversa da quelle in noi attualmente vigenti: e noi desideriamo appunto misurare il divario fra il nostro dato e questo inconosciuto che è oggetto di ricerco, d'amore.
(...)
1 – LA DONNÉE ET LE COMMENCEMENT DE L’ACTIVITÉ RELATRICE
Nous nous demandons à nous-mêmes : « Par où commencerai-je ? ». Nous nous demandons en outre s’il est possible qu’une méthode précède l’analyse : si une connaissance est requise avant même la détermination de la méthode. Cette perplexité s’est manifestée dans les expressions de la pensée : on allègue, à juste titre pour expliquer l’inachèvement du « Tractatus de intellectus emendatione » de Baruch Spinoza, qu’il pressentait que le fondement de la correction n’était autre que l’idée centrale de la première partie de l’« Éthique » : l’unité.
La connaissance centrale était-elle la méthode ? En réalité, la question, posée de façon si schématique, est fallacieuse : une méthode est déjà une connaissance et un choix, elle présuppose des notions ; sinon les notions centrales d’un agencement cognitif — contrairement à ce que pourrait suggérer l’exemple cité — du moins certaines données. Certes, d’un point de vue psycho-historique, chacun de nous et la collectivité même de nos semblables, et l’humanité entière, instituent et doivent instituer l’analyse (au moyen d’un processus d’afairesis : l’apodeixis viendra bien plus tard, si elle vient) à la manière et avec les moyens dont le topographe exécute la triangulation d’un territoire. À partir d’une base connue comprenant des termes suffisants (c’est-à-dire des angles et des distances connus), on procède à la détermination de points inconnus. Ceux-ci servent à leur tour de station pour le développement ultérieur.
Toutefois, le terrain sur lequel le géomètre fonde son théodolite est, relativement aux fins qu’il se propose, une réalité stable, univoque. De plus, le déroulement de la recherche est pour lui uniforme et permet l’usage constant d’instruments constants. Le terrain du philosophe est la dune mouvante ou la savane dévoratrice : ou plutôt le pont d’un navire emporté par la tempête : et le « bateau ivre » des dissonances humaines, sur le pont duquel, loin d’observer et de relater, il est difficile de se tenir debout. Ce navire vogue sur des mers étranges et diverses : tantôt l’étoile est terme de référence, tantôt, dans la nuit obscure, la « méthode » ne pourra se référer à l’étoile.
Mouvant est le référentiel cognitif initial : différent, continuellement différent, le processus.
J’insiste sur ces deux thèmes :
Premièrement : notre analyse commence par une donnée psycho-historique (c’est-à-dire personnelle-environnementale) qui possède son propre flux, sa propre vitesse : chose labile, mouvante. En tant que labile en soi, nous l’intuitions en première approximation comme un système en soi, c’est-à-dire comme quelque chose de non simple. En tant que mouvante, nous l’intuitions en première approximation comme appartenant encore à un système que nous disons externe.
Il existe donc un quelque chose dont la vitesse diffère, dont la forme intrinsèque diffère de celles actuellement en vigueur en nous : et nous désirons justement mesurer l’écart entre notre donnée et cet inconnu qui est objet de recherche, d’amour.
(...)
Le texte est écrit à la première personne, sous la forme d’un flux de conscience méditatif. Gadda y expose sa réflexion sur son incapacité à atteindre la "connaissance" complète et cohérente du monde, qu'il appelle "il pensiero unitario" (la pensée unitaire). Gadda constate l’échec de toute tentative de synthèse unificatrice du réel.Il se moque implicitement de la philosophie idéaliste et de la rationalité pure (il vise notamment l’hégélianisme et le néo-idéalisme italiens, Croce en tête). Il exprime l’idée que la réalité est intrinsèquement complexe, faite d’innombrables fils (il parle souvent de gnommero, une pelote embrouillée).
Selon Gadda, le réel est "un système de systèmes" : tout est relation, tout est entrelacé. Il évoque la "complessità" (complexité) comme seule approche honnête du monde. Il critique l’idée d’un roman ou d’une œuvre littéraire cherchant une unité harmonieuse. Gadda affirme la nécessité d’un style qui reflète cette complexité. Son écriture doit être "polymorphe", multilingue, multiréférentielle (ce qu’il appelle plus tard le "pastiche linguistique"). Il expérimente des mélanges de registres, dialectes et styles pour approcher la multiplicité du réel.
Sa méditation s’enracine aussi dans sa propre expérience milanaise. Il évoque un sentiment d’échec personnel, une incapacité à agir efficacement dans la vie, un malaise existentiel (écho de la crise post–Première Guerre mondiale).
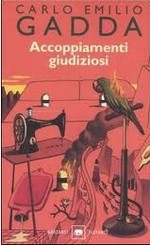
"Accoppiamenti giudiziosi" (1963)
Gadda poursuit sa démolition ironique des mythes bourgeois (famille, ordre social, pureté morale), l’incommunicabilité fondamentale et la « disarmonia prestabilita » (disharmonie préétablie) qui obsède Gadda ...
"Judicious Couplings", certains récits ont été traduits en anglais par William Weaver et inclus dans The Novels and Stories of Carlo Emilio, et sous le titre "Des accouplements bien réglés" publié chez Gallimard en 1982.
Ce recueil rassemble plusieurs nouvelles et fragments écrits entre les années 1920 et 1950. Le ton est plus léger, souvent ironique et satirique, mais toujours marqué par la langue foisonnante et inventive de Gadda. Les textes évoquent les petites manies et contradictions de la bourgeoisie italienne, les thèmes de l’amour, des faux-semblants, de l’hypocrisie sociale, et nous proposent des descriptions minutieuses de milieux urbains ou familiaux, comme dans "L'oro e la mela" ou "Il tempo e la morte".
"Dopo il veglione" (Après l’extinction des feux) - Un petit récit centré sur l’atmosphère d’un bal costumé qui se termine. Le narrateur décrit la sortie des invités, la fatigue, la décrépitude des masques, et la solitude latente qui perce après l’excitation collective. - "San Giorgio nei Brocchi" (Saint Georges chez les Brocchi) - Le récit se concentre sur une famille bourgeoise milanaise, les Brocchi, et sur une statue de Saint Georges qui domine la demeure. Le saint chevalier, symbole de pureté et de courage, est réduit ici à un bibelot ridicule, signe de la dégénérescence bourgeoise. - "Socer generque" (Socer generque) - Histoire d’un beau-père (socer) et d’un gendre (generque) dans un quotidien saturé de malentendus et d’animosités feutrées. De la déconstruction ironique du stéréotype familial italien. - "Un saluto cordiale" (Un salut respectueux) - Un récit court sur l’échange de salutations entre voisins ou connaissances, apparemment banal, qui révèle une tension latente. Ironie fine, presque théâtrale : ce « saluto » est en fait une scène de guerre larvée. - "Benito" (Bien nourri) - Portrait d’un homme nommé Benito, figure grotesque, centré sur sa relation compulsive avec la nourriture et son corps « bien nourri ». Allégorie du consumérisme et de la gloutonnerie, Gadda y fustige l'Italie petite-bourgeoise obsédée par la satiété matérielle. - "La gazza ladra" (La pie voleuse)
Récit d’un vol domestique par une pie, qui devient prétexte à une réflexion sur la propriété, l’obsession du contrôle, et le désordre. Fable animalière qui se transforme en satire sociale. - "Il club delle ombre" (Le club des ombres) - Une société secrète imaginaire où se réunissent des « ombres », entités mystérieuses discutant des passions humaines et des erreurs répétées. Vision quasi fantasmagorique : la société est vue comme un théâtre d’ombres. - "Il bar" (Le bar) - Scène de vie dans un bar populaire, galerie de personnages abîmés, discutant de politique, de sport ou de banalités. Microsociologie de la vie urbaine, satire des discours vides, du « bla-bla » populaire. - "La cenere delle battaglie" (La cendre des batailles) - Réflexion sur les souvenirs de guerre et la « cendre » qu’ils laissent dans la psyché collective et individuelle. Un texte méditatif et grave, plus sombre que les autres. - "Prima divisione nella notte" (Première division dans la nuit) - Texte d’ambiance nocturne, centré sur un bataillon en mouvement, mélange de descriptions poétiques et de micro-drames. Révèle le chaos latent dans toute structure collective. - "La sposina di provincia" (La mariée de village) - Portrait d’une jeune mariée de province, pleine d’illusions et d’attentes, confrontée au désenchantement conjugal et social. Thème classique chez Gadda : la destruction des illusions féminines.
"L'incendio di via Keplero" (L’incendie de la via Keplero)
Un incendie se déclare dans une rue de Milan ; Gadda en fait un prétexte pour peindre la foule, les réactions paniquées ou indifférentes, et les dysfonctionnements des services publics.
"On en racontait de toutes les couleurs sur l’incendie du numéro 14. Mais à la vérité, même Son Excellence Filippo Tommaso Marinetti aurait été incapable de rendre compte simultanément ce qui advint, en trois minutes, au fond de ce trou à rats gueulard, et que le feu, lui, sut en un tournemain réussir : débondant d’un coup toutes les femmes qui y vivaient à moitié nues, en ce quinze août, avec leur progéniture globale, loin de la puanteur et de la soudaine panique de la maison, puis divers mâles, puis quelques dames pauvres et au dire d’un chacun plutôt traîneuses de gambette, qui firent une apparition osseuse, blanche et dépeignée, en combinaisons de dentelle blanche, et non pas noires et compassées comme elles l’étaient d’ordinaire du côté de l’église, puis des messieurs un peu rapetassés eux aussi, puis Anacarsi Rotunno, le poète italo-américain, puis la domestique du garibaldien agonisant du cinquième étage, puis l’Achille avec la gamine et le perroquet, puis Balossi en caleçon et la Carpioni sur les bras, que dis-je, la Maldifassi, qui avait l’air d’avoir le diable au train à lui tirer les plumes, tant elle était bramante elle aussi. Puis enfin, parmi les hurlements persistants, les angoisses, les larmes, les enfants, les cris, les appels déchirants, les atterrissages de fortune et les ballots de vêtements jetés, pour les sauver, depuis les fenêtres, alors que déjà on entendait les pompiers arriver à toute allure et que deux cars de police déjà transvidaient trois douzaines de sergents de ville en tenue blanche, qu’arrivait de surcroît l’ambulance de la Croix-Verte, à la fin des fins, des deux fenêtres de droite du troisième étage, et peu après du quatrième, le feu ne put faire autrement que de libérer ses propres étincelles, terrifiantes autant qu’attendues ! et, par soudains à-coups, des langues serpentines et rouges, aussi promptes à se manifester qu’à disparaître en tortillons de fumée noire, poisseuse, pâteuse, comme issue d’une rôtisserie d’enfer, et désireuse seulement de se segmenter en sphères et resphères, ou de s’entrefouiller elle-même comme un python noir surgi des profondeurs des sous-terres parmi de sinistres clartés ; et des papillons ardents, c’est exactement ce dont ils avaient l’air, en papier peut-être mais plus probablement en tissu ou en « péramoïd » calciné, qui s’en allaient voleter partout dans le ciel souillé de suie, terrorisant de nouveau les ébouriffées, certaines pieds nus dans la poussière de la rue inachevée, d’autres en savates, indifférentes à la pisse et au crottin de cheval, parmi les cris et les pleurs de leurs mille marmots. Elles sentaient déjà leurs têtes et leurs cheveux, bien vainement ondulés, s’embraser en un horrible et vivant brandon...."
"La domenica" (Le dimanche) ...
" ... À la gare, dans sa fatigue, il voulut laisser choir, pour une fois, le pesant fardeau de sa parcimonie : il demanda un billet de première classe (le chemin de fer n’avait que des premières et des troisièmes). La voiture lui apparut bondée. Sur les velours écarlates, noblement munis de candides dentelles contre le gras des caboches, il n’y avait plus qu’une seule place. Il s’y arrêta : tomba à côté de Mme Batraci. Elle était en train de se peindre les lèvres et, inversement, de se blanchir la pointe du nez : par dispositions alternatives : par bâton et houppette qu’elle avait extraits, après toute une cohorte d’autres machins dorés et argentés, d’une petite boîte en fausse écaille de tortue : celle-ci à son tour tirée du marsupial universel d’un sac à main, « en crocodile » (de fait bouvillon de Lomellina) : « Oh ! comme je suis contente de vous revoir, mon cher ingénieur !… », ne se lassa-t-elle pas de répéter, tout en s’appliquant à parfaire de quelques touches magistrales son chef-d’œuvre d’optimisme. « Que faites-vous de beau ? » Il revenait en ville comme tout le monde.
« Mais vous avez grossi ! », s’exclama-t-elle sans sourciller (car les sourcils étaient rivés au miroir), et sans même le regarder. « Mais vous avez l’air vraiment bien !… On voit que les affaires marchent à merveille… et de quoi vous occupez-vous maintenant ?… » : sa grande spécialité était de déverser sur le dos des pauvres diables la grêle de ses interrogations, se passant régulièrement de toute réponse. « Où est-ce que vous travaillez ?… » (L’ingénieur avait la réputation d’avoir travaillé dans plusieurs domaines.)
« On m’a dit… attendez !… qui est-ce qui me l’a dit ?… oh, ce que les gens racontent !…allez savoir si c’est vrai !… que vous étiez dans les engrais chimiques, c’est vrai ?… que vous en aviez jusque-là… D’ailleurs M. Donda aussi, on peut dire qu’il a commencé sa fortune dans le fumier… Mais enfin qu’est-ce que c’est que ce fumier artificiel ?
Avec quoi le fabrique-t-on ? Je serais bien curieuse de savoir d’où on le tire ! Mon Dieu !… ce doit être une grande chose que la science, cette science moderne ! On peut dire qu’elle va se nicher un peu partout !… Là où nous autres, pauvres femmes, n’arrivons même pas à l’imaginer… Moi, de toute façon, je n’y entends rien…
Mais vous, qui êtes si intelligent, c’est autre chose. Vous avez toujours été un garçon instruit. Garçon… garçon… avec quelques petites années sur les épaules, si l’on veut… Vous vous souvenez, monsieur l’ingénieur, quand on jouait à s’attraper, dans le jardin des Garbagnati ?… Mon Dieu !… Comme le temps passe ! Mais tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir… Surtout pour vous, les hommes !… Le pire c’est pour nous, pauvres petites femmes… » Elle changea de ton : le grésil parut se transformer en une pluie de lait et de miel. « Maintenant c’est au tour de ma Luisa, ma petite chérie !… Vous le savez déjà, peut-être ? dites la vérité…
Que voulez-vous, c’est leur destin, pauvres petites !… Et son heure est arrivée, à elle aussi… » Elle sourit, amadouée, émue, de ses yeux vitreux et mous, gélatineux, de ses paupières plutôt lourdes, boursouflées, languissamment assises sur ses joues, qui la faisaient ressembler à une bonne chienne en paix avec le monde. « Désormais je peux bien vous le dire… parce que la chose est officielle… et puis… vous êtes un ami, un véritable ami… quelqu’un de sérieux… dommage que vous n’y ayez pas songé vous aussi !…
Mais si vous le vouliez, il serait encore temps… il suffit de vouloir… Allons, un peu de courage vous aussi… » L’ingénieur ne répondait pas. De la fenêtre il voyait en un adieu d’or la maison très lointaine qui fuyait, fuyait. « Avec le fils Mananti, vous savez, Mimmo, ce beau garçon… arrivé troisième, mais pensez donc ! dans la descente d’obstacles, à la coupe de Madonna di Campiglio !… Ils sont si distingués ! Ce sont eux qui m’ont accompagnée à la gare. Et comme il conduit !… à faire peur quand on est à côté.
Mais oui, mais oui, les petits enfants du grand-père Mananti… celui-là… celui-là même ! Eh, c’est que le temps passe, mon cher ingénieur !… Qu’est-ce que vous croyez ?… que les enfants doivent toujours rester des enfants ?… »
Une intervention miraculeuse des Célestes Essences, auxquelles était venue l’idée de faire acquérir à Mme Batraci la revue Grazia, permit à l’ingénieur de retrouver dans le rythme caressant du teuf-teuf un vague espoir de somnolence. Mais un sursaut de sa compagne de velours le secoua : « Dites la vérité… feront-ils un beau couple, oui ou non ?… », et l’œil de la mère se perdait aux lointains horizons : à son retour, avec un sourire, il atterrit sur une page de petites culottes, soutien-gorge, broderies et dentelles, à en rêver la bouche ouverte.
Le train courait, l’ingénieur s’endormit. Bientôt cependant ses narines commencèrent à être stimulées par cette odeur « industrielle » mêlée de sulfure de carbone, de gaz, de benzol, de colles, de vidanges de gazogènes et de fumée de fours, qui annonce la proximité, voire l’imminence des faubourgs de la métropole.
À la gare suburbaine il se leva, salua avec son habituelle courtoisie, descendit, bombardé par les « au revoir ! » et les « donnez de vos nouvelles ! ». Mme Batraci le vit remettre son billet, se perdre dans la foule ouvrière. Le lendemain, lundi, on recommencerait à tirer de chaque os toute la colle qui s’en pouvait retirer, en vertu des plus modernes procédés."
(1945)
"Accoppiamenti giudiziosi" (Des accouplements bien réglés)
Méditation ironique sur les « unions » humaines, leurs illusions et leurs ratés. De l’impossibilité d’une harmonie, qu’elle soit sentimentale ou sociale.
"... Les faits nouveaux, qui devaient jouer à l’encontre de toute tentation de révision du dispositif de base (soit l’idée de tout laisser, une moitié pour chacun, au couple Giuseppe Adelaide, désormais uni par le double lien d’un mariage à double tour : mariage civil, 1910, et religieux par là-dessus), les faits nouveaux avaient mûri et fini par tomber dans la réalité de la connaissance commune, cette connaissance, ou si l’on veut cette conscience que certains philosophes appellent justement « le réel » pour mieux le distinguer de l’interminable traîne de leurs divagations personnelles : comme s’ils lui concédaient au moins un droit de pâle citoyenneté « dans le domaine de l’esprit » : ils avaient fini, en fait, par tomber, tomber par détachement, poirillons surs, de l’arbre de Noël d’un précédent sursis dénommé « le possible ». Tout comme la goutte d’eau se gonfle en s’irisant, et petit à petit se sphéricise, sous l’augmentation constante de son propre poids, au bord extrême de la gouttière : jusqu’à l’instant où, tac, elle s’en décolle tout soudain : et dans le court moment de sa chute, acquiert son identité particulière et prend le nom de goutte d’eau, Berkeley lui-même ne l’appellerait pas autrement ; elle appartient pendant deux secondes, le temps d’atterrir sur le cou de qui, au passage, en frissonne, à une vaste certitude : la certitude du « réel » historique orchestré par Dieu, historicisé par Hegel, exalté par Carlyle. Elle, la goutte, à peine captée par la dialectique de l’histoire ou la vertèbre cervicale du passant, s’évapore aussitôt : comme la Substance du marquis de Château Flambé dans le creuset dialectique de l’an 1792.
Avec la signifiante certitude d’une prophétie, ces faits déjà advenus et désormais portés au registre de la connaissance commune mirent avant tout en lumière, sous le regard bonificateur de Beniamino, un nouveau « possible » : une possibilité nouvelle de sauver le magot, un nouveau manteau de sauvegarde à jeter sur les épaules du magot, dans le but, toujours, d’en garantir, à la postérité, l’unité posthume. Cette postérité, disposée dans le temps en une régulière succession strophique dite encore descendance biologique, était devenue une pièce indispensable du système cognitif de Beniamino : je veux dire ce système qui lui permettait de penser un avenir pour la Substance, d’offrir un avenir aux millions : étant acquis que les bipèdes du futur, le futur des millions lui-même n’était pas concevable.
Si on ne conçoit pas l’échalas, comment concevrait-on la vigne ? Si le concept de moi biologique héritant venait à lui manquer, le concept même de Substance héritable et héritée se trouverait raréfié et dissous comme neige au premier soleil dans l’alpe. Avec un même et pourtant antinomique crève-cœur, le cultivateur ployant sous le travail déplore, ou pleure, sa descendance absente, ou tombée pour rien à la Moskova : car par-delà les labours et les brumes, il n’entrevoit personne pour labourer sa terre dans les lendemains sans espoir.
Après l’exclusive absolue du notaire et commandeur Barlingozzi, Beniamino avait perdu toute envie d’insérer dans le « réel » l’holographe dichotomie qu’il avait crue possible, quand une nouvelle « solution » se présenta à lui sous l’apparence, d’abord, d’une fantaisie aux contours incertains. Elle lui apparut en rêve, comme l’Amour arrachant le cœur au poète ; et de forme ou image nébuleuse qu’elle était d’abord, se raffermit petit à petit en idée, et idée claire : non plus celle d’une disjonction mal posée, mais celle d’une conjonction matrimoniale : d’un second accouplement à ruminer ..."

"Eros e Priapo" (1945, publié en 1967)
Rédigé entre 1944 et 1945 mais publié seulement en 1967 (une publication révélatrice des résistances culturelles et politiques à une critique aussi directe et provocatrice du fascisme dans l’Italie d’après-guerre). Sous-titré « Da furore a cenere » (« De la fureur à la cendre »), le livre constitue une réflexion pamphlétaire, profondément satirique et psychanalytique, sur l'Italie fasciste et la figure de Mussolini. Gadda dénonce la psychologie collective de l'Italie pendant la dictature, en révélant une complicité à la fois tragique et grotesque. - Traduction anglaise : Eros and Priapus (partielle, dans That Awful Mess on Via Merulana and Other Stories) - Traduction française : Non disponible intégralement.
"Eros e Priapo" est l'une des analyses les plus incisives et originales jamais produites sur le fascisme italien. Le texte est à la fois une satire féroce et une réflexion philosophique profonde sur les racines psychologiques et sociales des régimes autoritaires. Gadda offre ainsi un angle inédit, combinant psychanalyse freudienne, critique culturelle, et satire politique.
Le texte de Gadda est un pamphlet analytique et mordant qui utilise le langage dense, riche en néologismes, caractéristique du style baroque de Gadda. Le livre repose sur la thèse selon laquelle le fascisme mussolinien tire ses racines profondes d'un érotisme perverti et refoulé, illustré symboliquement par les figures mythologiques d'Éros et de Priape. Éros incarne ici l'amour, le désir et la pulsion de vie, tandis que Priape représente la luxure obscène, la virilité grotesque, et une sexualité hypertrophiée, symptomatique de l'obsession fasciste du pouvoir, de l'ordre et de l’autorité masculine exacerbée.
- Influencé par Freud, Gadda interprète le fascisme comme l’expression d’une libido collective frustrée. Mussolini apparaît comme une incarnation grotesque de Priape, une figure phallique et obscène exploitant les pulsions refoulées des Italiens. Selon Gadda, Mussolini capte les frustrations collectives liées à la pauvreté morale, intellectuelle, mais surtout à une sexualité sublimée, déviée par une propagande de la virilité guerrière.
- Dénonciation de la rhétorique fasciste : Gadda décortique impitoyablement la rhétorique fasciste, la transformant en un catalogue d’obsessions phalliques et guerrières, soulignant son caractère infantile, régressif et grotesque. Mussolini est ridiculisé en tant que « duce » de papier, figure creuse dont le pouvoir provient davantage d'une mise en scène théâtrale que d'une réelle autorité morale ou intellectuelle. Le culte de la personnalité est décrit comme une pathologie collective, une hystérie érotisée qui amène la société entière vers l’abîme.
- Gadda étend sa critique à toute la société italienne, qu’il juge responsable d'avoir adhéré avec enthousiasme ou passivité à une idéologie dégradante et absurde. Cette complicité est vue comme une régression collective dans l’infantilisme politique et moral. Le fascisme, loin d’être une simple anomalie historique, est ainsi révélé comme la manifestation profonde d’un mal-être social et culturel italien, marqué par l’absence d’esprit critique, le culte de l'apparence et la soumission servile.
Le texte est remarquable par son originalité stylistique. Gadda y pratique une satire linguistique extrêmement sophistiquée, combinant un vocabulaire érudit à un langage populaire et trivial. Cette virtuosité linguistique est utilisée non pas pour impressionner gratuitement, mais pour démonter avec force l’idéologie fasciste de l’intérieur, en révélant l’incohérence morale et intellectuelle de ses prétentions grandioses.
"... Li associati cui per più d’un ventennio è venuto fatto di poter taglieggiare a lor posta e coprir d’onta la Italia, e precipitarla finalmente a quella ruina e in quell’abisso ove Dio medesimo ha paura guatare, pervennero a dipingere come attività politica la distruzione e la cancellazione della vita, la obliterazione totale dei segni della vita. Ogni fatto o atto della vita e della conoscenza è reato per chi fonda il suo imperio sul proibire tutto a tutti, coltello alla cintola.
Si direbbe che la coscienza collettiva, e la singula, oltraggiate dal coltello, dal bastone, dall’olio, dall’incendio, e di poi messe in bavaglio da disperati tramutatisi per scaltrita suasione in soci nel grido e nell’armi, dalle carceri, dalle estorsioni, dal veto imposto per legge, se legge fu quella, a ogni forma del libero conferire e prima che tutto alle stampe, dalla sempiterna frode ond’era spesa la parola e l’intendimento e poi l’atto, dalla concussione sistematica esaltata al valore e direi al decoro formale di un’etica nicomachèa, dalla tonitruante logorrea d’uno o d’altro poffarbacco, dalla folle corsa verso l’abisso e, ad ultimo, dalla strage, dalla rovina del paese, si direbbe codesta coscienza l’abbî trovato ricetto, quasi oltre lor lagune i Veneti, così ella in una zona munita dall’acque, contro la storia spaurata. Si direbbe riparasse, codesta coscienza, di là dall’odio e dalla bestiaggine: tra profughi, perseguitati, carcerati, oltraggiati e congiunti e figli di deportati e di fucilati: e la risorga alfine come dal nero fondo della miniera alla luce, chiedendo a Dio di poter proferire le parole della vita.
'Un texte bourré de néologismes ("poffarbacco", "sventoli"), d'archaïsmes ("issofatto"), d'insultes créatives ("animalini a cavatappo") et de références culturelles très italiennes (comme la "Nicomachea"). Gadda utilise un style baroque excessif avec des phrases qui s'étendent sur des paragraphes entiers...
« Les associés à qui, pendant plus de vingt ans, il est arrivé de pouvoir rançonner à leur guise et couvrir d'opprobre l'Italie, pour finalement la précipiter dans cette ruine et cet abîme où Dieu Lui-même a peur de regarder, en sont venus à présenter comme activité politique la destruction et l'annihilation de la vie, l'oblitération totale des signes de la vie. Tout fait ou acte de la vie et de la connaissance est un crime pour qui fonde son empire sur l'interdiction de tout à tous, le couteau à la ceinture.
On dirait que la conscience collective, et la conscience individuelle, outragées par le couteau, le gourdin, l'huile [de ricin], l'incendie, puis bâillonnées par des désespérés transformés par une rusée persuasion en complices du cri et des armes, par les prisons, les extorsions, par le veto imposé par la loi – si loi il y eut – à toute forme de libre échange et avant tout à la presse, par la sempiternelle fraude grâce à laquelle étaient dépensés la parole, l'intention puis l'acte, par la concussion systématique élevée au rang de valeur et je dirais de décence formelle d'une éthique nicomachéenne, par la tonitruante logorrhée de l'un ou l'autre bon Dieu de bois, par la course folle vers l'abîme et, en dernier lieu, par le massacre, par la ruine du pays, on dirait que cette conscience ait trouvé refuge, comme les Vénètes au-delà de leurs lagunes, ainsi elle dans une zone fortifiée par les eaux, contre l'histoire effrayée. On dirait qu'elle se soit mise à l'abri, cette conscience, au-delà de la haine et de la bestialité : parmi les réfugiés, les persécutés, les emprisonnés, les outragés, les proches et les enfants des déportés et des fusillés : et qu'elle ressuscite enfin comme du fond noir de la mine à la lumière, demandant à Dieu de pouvoir prononcer les paroles de la vie.
En interdisant tout à tous, la brigade criminelle s'est garanti à elle-même tout confort et toute sécurité supérieurs, de l'illicite contre d'éventuelles bandes concurrentes ; semblable à qui crée une réserve de chasse pour chasser et ramasser à sa guise, sans crainte et sans danger, et ses adeptes à simuler férocité et grogner, à dormir paisiblement ou à rester assis à jouer sans rien faire autant qu'il leur plaisait et semblait bon ; et à donner des coups de matraque ou d'épée, fusiller, déporter, baver et coasser dans les harangues et délirer dans la presse ; le Vigile des destins prince à braire de ses balcons pendant vingt-trois ans, à palatifier la campagne nue de vains marbres et ciments, et à retourner les arcs de triomphe, anticipés à l'aveugle à chaque triomphe espéré et catastrophe assurée. Ayant semé le vent machiavélique d'une de ses alliances tâtonnantes, il récolta sur-le-champ la tempête de l'ignoble coup de poignard porté à un peuple mourant.
Rugissant lion de toute faïence botté et médaillé, la "clairvoyance" militaire de ce tremblant le traîna de force à la fanfaronnade africaine, à répandre dans les déserts le fléau mortel en tendant l'outre à la soif des héros et des martyrs, n'ayant pas encore subi la volonté du compère de fer dont, vase de toute faïence, il s'était si aveuglément fait prisonnier. Sûr comme la foudre de ce fameux "sûr", il livra de valeureux Alpins piémontais à la mort sans chaussures, quelques mitrailleuses suffirent dans la tempête et en juillet sans chaussures, les trois mille mètres aidant. Fin stratège et aruspice des plus doués par beau temps, voici maintenant le beau moment. Non, non, non, Pologne, Danemark, Norvège, France, Scrotoslavie [Croatie], Luxembourg, Turquie, Suisse, toute la Grèce et l'Espagne, et j'oubliais le Portugal, et même Andorre et Saint-Marin, qui sont de minuscules républiquettes dans les montagnes, non, non, elles ne se sont pas alliées aux bêtes, elles n'ont pas glissé sphinctériquement dans les guerres meurtrières du badigeonneur. Lui, je veux dire notre Sombre, il voulut d'abord pour sa gloire, gloire menaçante, la criminelle expédition en Affrique : où il y avait un tout petit peu de café et du pétrole inexistant et trompetté : et de l'or et du platine, grattez! : et du karkadé : craignant que la chiourme ne reste pas tranquille, mobile et tumultueuse comme elle l'a toujours été et divertie par les fanfares et les drapeaux, si ce n'est pour lui jeter ce morceau dans les gueules stupides, (1935), de cette puérile scipionerie : où disparurent entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix milliards de lires, à asphaltiser les bas-fonds chlorurés du Danakil, après avoir payé, pour chaque sac de ciment, de l'or, le passage au canal.
Bon, les crimes de la triste mafia et de tous les "enthousiasmés" à délinquance ayant atteint ou, dirai-je, pénétré toute forme pensable de praxis, c'est-à-dire toute recoin du système italien (avec une "pénétration capillaire", oh! oui, vraiment), il est évident que toutes nos activités de connaissance et les fonctions universelles de l'âme doivent intervenir dans le jugement du mal, subi et commis. Tous les modes, les méthodes, les techniques, les opérations singulières et les disciplines de l'esprit sont appelés à nous secourir. L'acte de connaissance par lequel nous devons nous racheter prélude à la résurrection si une résurrection est tentable à partir de décombres aussi effroyables. Cet acte sacral s'applique à toutes les subdivisions du savoir, à tous les sujets du discours. Tous les experts, et médecins de toutes sortes, ont eu et auront à dissertater sur l'ignominie. Le juriste au premier chef, comme cela se produit déjà dans les tribunaux et les procès : et ces autres experts, ou expertes, qui pour expédier la procédure voudraient faire passer les assassins de leurs fils à l'Achéron, par des potences plantées au marché, ou les précipiter dans un fleuve plus vrai et plus familier. L'historien des religions nous éclairera, avec une lampe sacrée et antique, pour scruter dans son intensité et son étendue l'indifférence athéiste (a-gnôsis) de la bande bottée : qui se vêtit pour la Messe des imbéciles, et alla ainsi parée et vêtue fanfaronner dans le bordel de la Terre universelle, couteau à la ceinture. L'économiste, pour enquêter, connaître et certifier le préjudice et les dommages irréparables et les mauvaises années infligés par de tels Solons et Lycurgues à l'économie publique et aux biens privés, les présents et les lointains et oubliés, avec la ruine et la destruction de celle-là. L'expert en science des finances, pour mesurer au mètre de la terreur la chute des budgets de l'État, qui étaient excellents ou du moins honnêtes, et en général l'importance et la nature comptable des concussions : et le discrédit, ou plutôt l'abrogation totale du crédit : et le mensonge de l'autosuffisance ou autarkheia, et le papier gonflé et le gaspillage, et les autres innombrables méfaits : combinés et comportés par la gestion fanfaronne.
Elle hypothéquait l'avenir pour rapiécer les poches, les trouées poches du présent : elle extorquait emprunts et subventions aux fonds mathématiques des compagnies d'assurance pour creuser des piscines dans les montagnes où aucun peuple ne barbotait, comme j'ai pu le constater de mes propres yeux, un dimanche à midi, et au tepidarium de tout marbre tiédissait l'eau et se baignait elle-même : elle les extorquait aux banques populaires, et aux caisses dites d'épargne, pour payer les médicaments des adeptes. Et ensuite l'ingénieur nous dira son mot, le militaire son mot, le marin son mot, l'agriculteur son mot : et avec tous ceux-là viendront aussi bavarder les médecins, surtout le psychiatre ou phrénologue et le dermatopathe. L'Italie était polluée despotiquement par le possédé : le possédé était impérialement gratté et excité au prurit par les applaudissements d'un peuple de quarante-quatre millions de milliards de bestioles à tire-bouchon.
C'était mille fois mieux... vous me comprenez sans paroles.
Ergo : pendant vingt-trois ans, l'Italie a envoyé cette bestiole. Et que le juge me coupe la main, si ceci qui n'est pas ici un syllogisme droit, de mesure étroite. Le souffleur, c'était lui le Ministre, Premier Ministre des fanfaronnades, lui le Premier Maréchal (Maréchal de mes fesses), lui le premier Glaneur, Fabulateur et Éjecteur des imbécillités et des emphatiques conneries, qui dégoulinaient du balcon pendant vingt-trois ans : sur les pauvres et maigres épaules d'un peuple en sueur, convoqué à la bière sur les parvis maudits, aux rostres des futures défaites, incité aux acclamations obligatoires : comprimé au rassemblement comme le peuple des anchois dans le baril, perdu, en fait, parmi les signes de démence : à voir s'éloigner l'avenir, la nourriture de la chair, de l'esprit futur. Une trompettée de paroles sans substance, qui étaient les rots majestueux de ce furieux abruti, la dédommageait des cotisations syndicales "en développement continu et prometteur", c'est-à-dire au fur et à mesure magnifiées en douce "par la loi", ou "par décret-loi", c'est-à-dire à l'arbitraire d'un trait de plume de ces despotes. La Gazette Officielle du Royaume d'Italie esquissait : elle engloutissait et déféquait la loi.
Une sorte ignoble de mensonge, une menterie sans issue et sans rédemption se tissait et se piquait dans ces rassemblements. Il tendait à la multitude la chaîne de son incontinence buccale, et elle y lançait la navette des clameurs, et des cris fous, selon des rythmes précipités et très ignobles. Kù-cè, Kù-cè, Kù-cè, Kù-cè. La multitude, qui selon le dire de messire Nicolò Machiavel est femelle, et femelle à certains moments noctambule, simulait à ces hurlements l'amour et le délire amoureux, comme le ment d'habitude n'importe laquelle d'entre elles, pour "accélérer les temps" : et pour expédier le client : se tordant dans ses fureurs et sueurs d'enthousiaste, mammillonnant en sanglots pour de l'argent. Sur sa tribune, le mâchoire, gonflé à en éclater, à ces premiers cris de la marmaille, il était déjà ivre d'un égarrement fou, semblable à un alcoolique, à qui il suffit de renifler le verre pour se sentir pris et livré à la merci du destin. Puis la pantomime d'une évulvescence scénique, par laquelle la louche racaille se laissait exciter, se précipiter, assister, éteindre cette ardeur incontrôlable. Le bombetté [Mussolini] seul avait la force, dans la convention de la pantomime, de combler (à la mesure de cette frénésie feinte) la trompe vaginale de la bassaride. Un sale mensonge, remontant des ténèbres des âmes. Des bouches, une bave incontrôlable. Kù-cè, Kù-cè, Kù-cè, Kù-cè. Un fier-à-bras coud le sac de ses vantardises : un chef de camorra qui distribue des couteaux aux gamins, toujours prêt de sa tribune à démentir chaque chose, à remâcher chaque fois.
Cela, vingt et un ans ! Vingt et un ans de voix et de cris seuls du forcené, comme les hurlements d'un loup sinistre dans un piège : ou de ces sinistres braillards de ses complaisants, sur chaque place, et de ses braves acclamants. Et le reste... muet et effacé de la vie. Vingt et un ans : le meilleur temps d'une génération, qui est parvenue à la vieillesse à travers le silence. Per silentium ad senectutem (Par le silence vers la vieillesse)...."
