- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman

Emmanuel Mounier (1905-1950), "Révolution personnaliste et communautaire" (1935), "Traité du caractère" (1946), "Introduction aux existentialismes" (1946), "Le Personnalisme" (1950) - Jacques Maritain (1882-1973), "Humanisme intégral" (1936) - Gabriel Marcel (1889-1973), "Journal métaphysique" (1927), "Être et avoir" (1935), "Le Mystère de l’être" (1951) - Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), "Le Phénomène humain" 1938-1940) - ...
Last update: 12/11/2016
La France est probablement la seule grande nation moderne à avoir revendiqué deux fois une mission universelle, d’abord "rationnelle" (XVIIIᵉ), puis "spirituelle" (XXᵉ), tout en restant un État laïc. Elle le fit avec une conviction exceptionnelle, ancrée dans une culture qui valorise l’engagement intellectuel et moral.
Mais cette revendication de "mission spirituelle", qui s'affirme dans les années 1930-1920, - dans la continuité de cet âge d'or qui caractérise le catholicisme intellectuel en France -, s’effondre rapidement après 1950, entraîné dans la modernité consumériste et le recul du religieux ...
Elle aura porté au devant de la scène une génération "spirituelle" confrontée à une même crise de civilisation (les deux guerres, la montée des idéologies, la déshumanisation technique), dont Emmanuel Mounier (1905-1950), Jacques Maritain (1882–1973), et Gabriel Marcel (1889–1973), trois personnalités qui, après la Seconde Guerre mondiale,
- et alors que la communauté internationale entend trouver le langage et les institutions qui permettraient de fonder une paix durable (la création de l’ONU en 1945 s'accompagne de la rédaction d'une déclaration proclamant les droits fondamentaux de l’homme en 1948) -, ..
expriment la même soif d’humaniser le monde et de réconcilier la spiritualité avec le vécu concret ...
En synthèse,
- Jacques Maritain cherchera à adapter le thomisme au monde moderne,
- Emmanuel Mounier proposera un personnalisme engagé socialement,
- Gabriel Marcel refusera toute réduction matérialiste et technique de notre existence,
- et Teilhard de Chardin proposera d' intégrer l’évolution scientifique dans une lecture spirituelle de la création.
On peut noter que dans l’entre-deux-guerres et après 1945, plusieurs pays connaissent un "retour du religieux" ou un renouveau spirituel. Le cas français apparaît dans ce contexte assez singulier par sa richesse intellectuelle et sa diversité : que l'on évoque Jacques Maritain (néothomisme modernisé), Gabriel Marcel (existentialisme chrétien), Étienne Gilson (histoire de la philosophie médiévale), Maurice Blondel (philosophie de l’action), le personnalisme d’Emmanuel Mounier (revue Esprit, 1932), la revue Temps présent, le mouvement ouvrier chrétien (Jeunesse ouvrière chrétienne — JOC), l’Action catholique, les influences de Paul Claudel, Charles Péguy, Georges Bernanos, François Mauriac ...
Le XVIIIe siècle avait la France propulsé comme foyer des Lumières (rationalisme, esprit critique, universalisme, droits naturels), une vocation universelle exportée ensuite par la Révolution française (1789), puis par l’Empire napoléonien. Au XXe siècle, entre 1930 et 1950, des intellectuels catholiques (Maritain, Mounier, Bernanos, Marcel) affirment que la France a une "vocation spirituelle universelle", comparable à celle qu’elle revendiquait pour la raison au XVIIIᵉ siècle.
Une situation d'autant plus paradoxale que depuis 1905 (séparation de l’Église et de l’État), la France est désormais un espace intellectuel laïque : et c’est dans cette atmosphère qu’un renouveau catholique très vigoureux émerge, pour un temps, que tente d'être repensée une présence chrétienne dans la société républicaine ...
On ne se rend peut-être pas compte à quel point cette idéologie de la "société républicaine", en France, unique au monde, tant assénée par des "politiques" sans inspiration, peut entraîner la culture politique d'un pays dans une impasse de paradoxes difficiles à surmonter ...
Emmanuel Mounier, Jacques Maritain et Gabriel Marcel cherchaient tous trois à rompre avec un christianisme purement « clérical », rituel ou dogmatique, rejetant une spiritualité qui serait purement intériorisée, coupée du monde, et proposant une voie chrétienne engagée, capable de répondre à la crise moderne (totalitarismes, individualisme, perte de sens).
L'idée centrale : la personne humaine ne se réalise qu’en s’ouvrant aux autres et en transformant le monde, sans renoncer à sa profondeur spirituelle.
Ils entendaient ainsi tenter d'ouvrir un « troisième chemin », spirituel et chrétien, entre capitalisme libéral et communisme autoritaire.
Mais aujourd'hui que reste-t-il réellement de leur tentative?
Leur vision globale d’une société spiritualisée, communautaire, solidaire, n’a pas été réalisée. Après la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales ont privilégié la reconstruction économique, la consommation, le confort matériel. Le personnalisme ou l’humanisme intégral apparurent trop exigeants, trop spirituels et la figure de la personne engagée s’est heurtée au triomphe de « l’individu autonome » consumériste.
Plus encore, l’essor d'une sécularisation radicale a tout emporté. Dès les années 1960 (Concile Vatican II, Mai 68), la religion, même humaniste, apparaît à beaucoup comme un obstacle à la liberté. Les nouvelles générations ont préféré l’athéisme existentialiste (Sartre) ou le marxisme révolutionnaire. Et les idéaux spirituels, même incarnés, ont semblé « démodés » ou réactionnaires.
Reste que le personnalisme a influencé certains mouvements (Esprit, non-violence chrétienne, activisme social chrétien), et que leur insistance sur la dignité de la personne a inspiré la Déclaration universelle des droits de l’homme (Maritain y a contribué)...
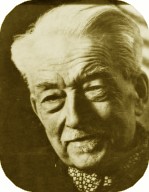
Jacques Maritain (1882–1973)
"Art et scolastique", publié en 1920, marque le début de la notoriété de Jacques Maritain, philosophe, diplomate et professeur : il y développe sa conception esthétique inspirée de la philosophie thomiste (Thomas d’Aquin). Il y défend la subordination de l’art à la vérité et au bien, en s’opposant à une conception purement formaliste ou subjective de l’art. Mais c'est avec "Primauté du spirituel" (1927), qui défend la primauté des valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles ou économiques, rejette la politisation excessive des débats religieux et appelle à une société plus respectueuse de la dignité de la personne humaine, que Maritain devient une figure centrale du renouveau catholique français. Et c'est dès la fin des années 1920 que Mounier découvre Maritain : il lui doit sa lecture de Thomas d’Aquin et sa critique du libéralisme. Il inspirera dans ses premiers écrits (notamment "Révolution personnaliste et communautaire" (1934), la défense de la personne humaine contre la masse.

"Humanisme intégral" (1936) sera sans doute son livre le plus influent à long terme : il y développe un projet de société fondé sur la dignité humaine et la liberté, tout en restant ancré dans le christianisme, un "nouvel humanisme" qui dépasse à la fois le matérialisme marxiste et l’individualisme libéral. L'ouvrage eut une énorme influence sur la pensée sociale chrétienne : il inspirera non seulement le personnalisme, mais aussi la doctrine sociale de l’Église et certains partis démocrates-chrétiens (le livre fut en effet lu et discuté bien au-delà du monde catholique, y compris à l’international, aux Etats-Unis et au Canada).
"... à considérer l'humanisme occidental dans ses formes contemporaines apparemment les plus émancipées de toute métaphysique de la transcendance, il est aisé de voir que si un reste de conception commune y subsiste encore de la dignité humaine, de la liberté, des valeurs désintéressées, c’est la un héritage d’idées jadis chrétiennes et de sentiments jadis chrétiens aujourd’hui désaffectes. Et j’entends bien que l'humanisme libéral-bourgeois n’est plus guère que du froment dégermé, du pain d’amidon. Et contre ce spiritualisme matérialisé, le matérialisme actif de l'athéisme ou du paganisme a beau jeu. Mais, désunies de leurs attaches naturelles et portées dans un climat de violence, ce sont encore pour une part des énergies chrétiennes désaffectées qui, de fait, existentiellement, quoi qu’il en soit des théories, émeuvent le coeur des hommes et les entraînent à l'action. N’est-ce-pas un des signes de la confusion des idées qui s’étend aujourd’hui sur le monde, de voir de telles énergies jadis chrétiennes servir à exalter précisément la propagande de conceptions culturelles opposées de front au christianisme? L’occasion serait belle pour des chrétiens de ramener les choses à la vérité, en réintégrant dans la plénitude de leur source originelle ces espérances de justice et ces nostalgies de communion dont la douleur du monde fait sa pâture et dont I’élan est désorienté, et en suscitant ainsi une force culturelle et temporelle d’inspiration chrétienne capable d’agir sur l'histoire et d’aider les hommes.
Une saine philosophie sociale et une saine philosophie de I’histoire moderne leur seraient nécessaires pour cela. Ils travailleraient alors à substituer au régime inhumain qui agonise sous nos yeux un nouveau régime de civilisation qui se caractériserait par un "humanisme intégral", et qui représenterait à leurs yeux une nouvelle chrétienté non plus sacrale, mais profane, ainsi que nous essayons de le montrer dans les études ici réunies.
Ce nouvel humanisme, sans commune mesure avec I’humanisme bourgeois, et d’autant plus humain qu’il n’adore pas l'homme, mais respecte réellement et effectivement la dignité humaine et fait droit aux exigences intégrales de la personne, nous le concevons comme orienté vers une réalisation sociale-temporelle de cette attention évangelique à I’humain qui ne doit pas exister seulement dans I’ordre spirituel, mais s’incarner, et vers I’idéal d’une communauté fraternelle. Ce n’est pas au dynamisme ou à I’impérialisme de la race, de la classe ou de la nation qu’il demande aux hommes de se sacrifier, c’est à une meilleure vie pour leurs frères, et au bien concret de la communauté des personnes humaines; c’est à I’humble vérité de I’amitié fraternelle à faire passer - au prix d’un effort constamment difficile, et de la pauvreté, - dans I’ordre du social et des structures de la vie commune; c’est par là qu’un tel humanisme est capable de grandir I’homme dans la communion, et c’est par là qu’il ne saurait être qu’un humanisme héroïque...."

Si Jacques Maritain n’a pas rédigé directement le texte final de la Déclaration universelle, ni participé comme membre officiel de la Commission de rédaction (où siégeaient René Cassin, Eleanor Roosevelt, Charles Malik, etc.), il a eu une influence déterminante sur l’esprit du texte, en particulier à travers son rôle dans le projet UNESCO ...
Après la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale veut fonder une paix durable. La création de l’ONU (1945) prévoit une déclaration proclamant les droits fondamentaux de l’homme. Dès 1946, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (présidée par Eleanor Roosevelt) commence à rédiger la DUDH. Maritain, philosophe catholique et néothomiste, était alors ambassadeur de France au Vatican (1945–1948), mais il avait aussi une aura internationale très forte grâce à ses nombreux séjours aux États-Unis et au Canada. Il participe ainsi, en tant qu’intellectuel et conseiller moral, aux discussions préparatoires, notamment via l’UNESCO.
Avant l’adoption officielle de la DUDH, l’UNESCO lance un projet visant à savoir si des penseurs du monde entier peuvent s’entendre sur une liste commune de droits humains, malgré des philosophies différentes. Maritain dirige, à la demande de Julian Huxley (directeur général de l’UNESCO), un questionnaire international auprès de philosophes, religieux, juristes (projet "Les bases philosophiques des droits de l’homme"). Il publie en 1947 le rapport intitulé "Human Rights: Comments and Interpretations", montrant qu’on peut parvenir à un consensus pratique sur les droits, même si les fondements philosophiques divergent ("On s’accorde sur les droits, à condition de ne pas demander pourquoi").
Maritain critique la vision purement individualiste des droits (héritée des Lumières) et défend l'idée que ces droits ne doivent pas seulement être "naturels" ou purement "juridiques" mais reposent sur la dignité de la personne humaine, notion centrale chez Maritain; et que l’homme est un être spirituel et social, et pas seulement un individu isolé (la thèse de l'humanisme intégral).
La déclaration proclamant les droits fondamentaux de l’homme sera adoptée et proclamée le 10 décembre 1948, 48 États membres la soutiendront, 8 s'abstiendront (URSS, République socialiste soviétique d'Ukraine, République socialiste soviétique de Biélorussie, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Afrique du Sud, Arabie saoudite) : le clivage Est-Ouest commençait déjà à se cristalliser (début de la Guerre froide), les autorités sud-africaines voulaient préserver la séparation raciale et leur politique interne sans ingérence extérieure, et l’Arabie saoudite craignait que l’universalité proclamée par la Déclaration ne heurte la souveraineté des traditions islamiques...
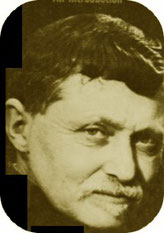
Gabriel Marcel (1889–1973)
Son "Journal métaphysique", publié en 1927, marque véritablement l'entrée sur la scène philosophique de Gabriel Marcel et qui attire l’attention sur son approche très personnelle, à la fois existentielle et spirituelle.
Un recueil de réflexions personnelles, notées sur plusieurs années, explorant des questions existentielles, spirituelles et métaphysiques, abordant des thèmes tels que le mystère de l’être, la présence, le corps, la liberté, la relation à autrui, la transcendance, qui va l'imposé comme une figure originale du courant existentialiste, même s’il refusera plus tard cette étiquette en se définissant plutôt comme un "philosophe de l’existence". Après le "Journal métaphysique", il publiera d’autres œuvres marquantes, notamment "Être et avoir" (1935) et "Le Mystère de l’être" (1951), qui approfondissent sa réflexion, et des pièces de théâtre (Le Monde cassé, La Chapelle ardente) qui incarnent ses idées philosophiques.
Philosophe et dramaturge, profondément marqué par la perte de sa mère, son expérience d’orphelin et sa sensibilité au tragique de la condition humaine, inspiré par Kierkegaard (l’existence avant l’essence) et Jaspers (le "saut" existentiel), animé par une spiritualité chrétienne (sa conversion au catholicisme date de 1929), c'est un itinéraire existentiel et spirituel, à l'encontre d'une philosophie qu’il jugeait trop abstraite et "objectivante" (notamment le rationalisme et certains systèmes idéalistes), que Gabriel Marcel proposera ...
- Réhabiliter l'expérience vécue : plutôt que d’expliquer l’homme par des concepts abstraits, il part des situations concrètes (l’amour, la fidélité, la mort, la souffrance).
- Mettre l’accent sur la relation : il défend une philosophie du "je-tu" (inspirée aussi de Martin Buber), centrée sur la présence et la disponibilité à autrui.
- Refuser la réduction technique de l’homme : Marcel critique la société moderne qui traite la personne comme un objet ou un "cas".
- Explorer le mystère plutôt que le problème : pour lui, un problème est extérieur et peut se résoudre, alors qu’un mystère engage le sujet tout entier et ne se "résout" pas mais se vit.
Contrairement à Sartre, qui défend un existentialisme athée, Marcel voit l’existence comme ouverte à la transcendance et à Dieu. La distinction problème / mystère reste l’une de ses contributions majeures : il montre que certaines réalités (comme la mort, la liberté, la foi) ne sont pas des "problèmes à résoudre", mais des mystères dans lesquels nous sommes impliqués. Et par sa notion de "présence", en tant que disponibilité intérieure et accueil de l’autre, il s'élève contre contre la dispersion et la superficialité modernes.
Emmanuel Mounier, universitaire qui abandonna l'enseignement pour fonder la revue Esprit et le mouvement personnaliste, définit la personne par opposition à l'individu ...
"Auto-défense de l'individu. Personnalisme contre individualisme. - Pour qui regarde le spectacle des hommes et n'est pas aveugle à ses propres réactions, cette vérité n'est pas évidente. Depuis le début de l'histoire, les jours consacrés à la guerre sont plus nombreux que les jours consacrés à la paix. La vie de société est une guérilla permanente. Là où l'hostilité s'apaise, l'indifférence s'étale. Les cheminements de la camaraderie, de l'amitié ou de l'amour semblent perdus dans cet immense échec de la fraternité humaine. Heidegger, Sartre l'ont mis en philosophie. La communication reste pour eux bloquée par le besoin de posséder et de soumettre. Chaque partenaire y est nécessairement, ou tyran, ou esclave. Le regard d'autrui me vole mon univers, la présence d'autrui fige ma liberté, son élection m'entrave. L`amour est une infection mutuelle, un enfer.
Contre ce tableau, l'indignation est vaine. Il est difficile de nier qu'il n`évoque un important aspect des rapports humains. Le monde des autres n'est pas un jardin de délices. Il est une provocation permanente à la lutte, à l'adaptation et au dépassement. Il réintroduit constamment le risque et la souffrance là où nous touchions à la paix.
Aussi, l'instinct d'auto-défense réagit-il en le refusant. Les uns l'oublient, suppriment toute surface de contact. Les autres s'y font, avec des personnes, des objets maniables et utilisables, les pauvres du philanthrope, les électeurs du politicien, les enfants de celui-ci, les ouvriers de celui-là; l'égocentrisme s'étourdit d'illusions altruistes. Un autre réduit son entourage à être pour lui un simple miroir. Une sorte d'instinct travaille ainsi à perpétuellement nier et appauvrir l'humanité autour de nous.
Même dans les meilleures dispositions, l'individu obscurcit la communication par sa seule présence. Il développe une sorte d'opacité partout où il s'installe. Mon corps me donne l'image la plus évidente de cette opacité, ainsi dans la gêne qu'il apporte au milieu d'une confidence. Mais elle naît plus profond que le corps. Une vertu trop appuyée dégoute de la vertu, l'intention de séduire désenchante l'amour, de convertir, hérisse l'infidèle. La plus légère présence parfois semble secréter un poison mortel pour la relation de l'homme à l'homme.
Sur ce séparatisme profond, la culture développe des jeux de masques peu à peu incrustés jusqu'à ne plus se distinguer du visage de l'individu. Ils lui sont un double et seul moyen de ruser avec autrui et de ruser avec soi-même, de s'installer dans les refuges de l'imposture pour éviter cette zone de vérité qui naît à la rencontre du regard d'autrui et du regard intérieur.
L'individualisme est un système de mœurs, de sentiments, d'idées et d'institutions qui organise l'individu sur ces attitudes d'isolement et de défense. Il fut l'idéologie et la structure dominante de la société bourgeoise occidentale entre le XVIIe et le XIXe siècle. Un homme abstrait, sans attaches ni communautés naturelles, dieu souverain au cœur d'une liberté sans direction ni mesure, tournant d'abord vers autrui, la méfiance, le calcul et la revendication; des institutions réduites à assurer le non empiètement de ces égoïsmes, ou leur meilleur rendement par l'association réduite au profit : tel est le régime de civilisation qui agonise sous nos yeux, un des plus pauvres que l'histoire ait connus. Il est l'antithèse même du personnalisme, et son plus prochain adversaire.
Pour les distinguer, on oppose parfois personne à individu. On risque ainsi de couper la personne de ses attaches concrètes. Le mouvement de repli qui constitue "l'individu" contribue à assurer notre forme. Cependant, la personne ne croît qu'en se purifiant incessamment de l'individu qui est en elle. Elle n'y parvient pas à force d'attention sur soi, mais au contraire en se faisant disponible (G. Marcel), et par là, plus transparente à elle-même et à autrui. Tout se passe alors comme si n'étant plus "occupée de soi", "pleine de soi", elle devenait et alors seulement, capable d'autrui, entrait en grâce..." (Le Personnalisme. P.U.F., éd.)

Emmanuel Mounier (1905-1950)
Agrégé de philosophie en 1928, Emmanuel Mounier consacre son premier livre à la pensée de Péguy (1931) et entre en rupture avec un monde bourgeois qui lui répugne et qui fait courir le monde occidental à la catastrophe : il fonde alors la revue Esprit (1932) qui va devenir l'organe d'un mouvement de pensée visant à une rénovation totale de la civilisation, un nouvel humanisme qui prend nom de "personnalisme" : à l'individu devenu pure abstraction et élément d'une masse, Mounier oppose la "personne", ouverte à la transcendance et confluence du thomisme, de l'existentialisme allemand et de l'idéalisme russe. La personne est "la seule réalité que nous connaissions et que nous fassions en même temps du dedans ; elle se conquiert sur l'impersonnel par un mouvement de personnalisation." Et ce "personnalisme communautaire" dessine tant une nouvelle figure de la civilisation, qu'une transformation de l'humain qui pousse à l' engagement, l'action est en effet aussi un "moyen de connaissance".

Théorie de l'engagement (Qu'est-ce que le personnalisme ?, 1947)
"Une philosophie pour qui existent des valeurs absolues est tentée d'attendre, pour agir, des causes parfaites et des moyens irréprochables. Autant renoncer à agir. L'Absolu n'est pas de ce monde et n'est pas commensurable à ce monde. Nous ne nous engageons jamais que dans des combats discutables sur des causes imparfaites. Refuser pour autant l'engagement c'est refuser la condition humaine. On aspire à la pureté : trop souvent on appelle pureté l'étalement de l'idée générale, du principe abstrait, de la situation rêvée, des bons sentiments, comme le traduit le goût intempérant des majuscules : le contraire même d'une héroïcité personnelle. Ce souci inquiet de pureté exprime souvent aussi un narcissisme supérieur, une préoccupation égocentrique d'intégrité individuelle, retranchée du drame collectif. Plus banalement, il lui arrive de couvrir d'un manteau royal l'impuissance, la pusillanimité, voire la puérilité. Le sens de l'absolu se commet ici avec une cristallisation psychologique ambiguë. Non seulement nous ne connaissons jamais de situations idéales, mais le plus souvent nous ne choisissons pas les situations de départ où notre action est sollicitée. Elles, nous attaquent autrement que nos schémas ne le prévoyaient, et de court. Il nous faut répondre impromptu, en pariant et inventant, là où notre paresse s'apprêtait à « appliquer ››. On parle toujours de s'engager comme s'il dépendait de nous : mais nous sommes engagés, embarqués, préoccupés. C'est pourquoi l'abstention est illusoire. Le scepticisme est encore une philosophie; la non-intervention, entre 1936 et 1939, a engendré la guerre d'Hitler, et qui ne «fait pas de politique›› fait passivement la. politique du pouvoir établi. Cependant, s'il est consentement au détour, à l'impureté («se salir les mains››) et à la limite, l'engagement ne peut consacrer l'abdication de la personne et des valeurs qu'elle sert. Sa force créatrice naît de la tension féconde qu'il suscite entre l'imperfection de la cause et sa fidélité absolue aux valeurs impliquées. La conscience inquiète et parfois déchirée que nous y prenons des impuretés de notre cause nous maintient loin du fanatisme, en état de vigilance critique..."
POSITION DU PERSONNALISME - Emmanuel Mounier, (Equivoques du personnalisme, Esprit n°2, 1947)
Ce qui rend à certains le personnalisme insaisissable, c'est qu'ils y cherchent un système, alors qu'il est perspective, méthode, exigence. `
Comme perspective, à |'idéalisme et au matérialisme abstraits, il oppose un réalisme spirituel, effort continu pour rejoindre l'unité que ces deux perspectives disloquent; le destin de l'homme y est pris sous toutes ses dimensions, matérielle, intérieure, transcendante ; l'appel à la plénitude personnelle, pointe et instrument de l'histoire universelle, n'y est pas séparé de l'appel de l'humanité comme tout, aucun problème n'y est pensé sans cette double référence; l'histoire de l'homme y apparaît comme une concurrence dramatique entre ces divers points de vue, la crise perpétuelle d'une dialectique montante d'unification et de perfection. Cet optimisme tragique s'oppose également à |'optimisme ingénu de la bourgeoisie ascendante et à l'irrationalisme sceptique de la bourgeoisie décadente.
Comme méthode, le personnalisme refuse à la fois la méthode déductive des dogmatiques et I'empirisme brut des "réalistes".
Notre destin immédiat, c'est d'avancer dans l'histoire et de faire de l'histoire, même dans une perspective éternelle où tout ce labeur humain aurait sa fin suprême au-delà de lui-même. Aussi bien, les constantes de la condition humaine ne peuvent-elles être décrites sous la forme d'un schème définitif qu'il n'y aurait plus ensuite qu'à appliquer sur l'action. Elles sont largement engagées dans la situation de chaque moment historique; elles ne peuvent être regardées qu'à travers cette situation, maintenues qu'en les réinventant chaque fois avec la substance de l'actuel. Le personnaliste chrétien lui-même, si sa visée dépasse l'histoire, ne peut avancer vers elle que dans l'histoire, et, pour déterminer ses moyens, il doit interroger les possibilités de l'histoire. Quelle que soit donc notre philosophie dernière, l'intelligence de l'action ne s'éveille qu'à partir d'un engagement dans la chaîne de l'événement, la règle de l'action se compose à la rencontre d'une philosophie de l'homme et d'une analyse directe des conjonctures historiques, qui commandent en dernière instance le possible et le réel.
Comme exigence enfin, le personnalisme est exigence d'engagement à la fois total et conditionnel. Engagement total, car il n'y a de lucidité valide que celle qui réalise et ne souffre pas de se laisser résoudre en simple critique; nous avons, en effet, la passion de l'homme, mais c'est pour nous une passion efficace, nous cherchons à le comprendre pour le mieux transformer. Engagement conditionnel, car le désaccord interne de l'homme, si nous ne gardons pas fermement en mains le gouvernail, fait périodiquement basculer l'équilibre de ses civilisations, tantôt vers la complaisance solitaire, tantôt vers l'étourdissement collectif, tantôt vers l'évasion idéaliste.
Ce n'est pas une image de l'homme ou un rêve de l'humanité que nous proposons comme mythe, mais un travail, le travail humain à proprement parler, pris dans toute son extension, le perpétuel rassemblement des données fondamentales de la civilisation, l'invention perpétuelle d'une synthèse qu'aucun âge ne réalisera jamais. La permanence de l'homme c'est l'aventure. La nature de l'homme, c'est l'artifice. Assumer cette aventure, diriger cet artifice afin que l'homme, sous des visages chaque fois inattendus, soit toujours plus homme, telle est la tâche où pour nous tradition et révolution dialoguent et se poussent l'une l'autre.
Il n'est pas une zone de la pensée ou de l'action que cette exigence ne doive renouveler.
L'éducation doit en préparer le terrain. Trop souvent réduite aujourd'hui à la distribution superficielle du savoir et à la consolidation des divisions sociales ou des valeurs d'un monde agonisant, elle doit briser avec ses cadres morts pour élaborer une formation de l'homme total, également offerte à tous, laissant chacun libre de ses perspectives dernières, mais préparant à la cité commune des hommes équilibrés, fraternellement préparés les uns avec les autres au métier d'homme.
La culture occidentale est devenue un héritage inerte entre les mains d'une classe sociale qui n'en garde que la jouissance sans en renouveler les sources. Elle doit être revivifiée par de nouvelles élites de souche populaire, qui lui rendront l'authenticité et la fécondité.
Vie personnelle, vie privée, vie publique, sans se confondre dans une vulgarisation générale de toute existence, doivent à la fois offrir à tous leurs diverses possibilités d'enrichissement, et, cessant de s'empoisonner chacune, à l'intérieur de leurs cloisons, avec leurs propres venins, se fortifier mutuellement par leur communication.
Ainsi la vie individuelle n'apparaîtra plus comme le refuge de l'égocentrisme et comme le luxe d'une classe, la vie privée, et notamment la famille, s'ouvriront sur l'air du large en restant la zone d'épreuve de l'humanité de chacun, la vie publique se gonflera des sucs qui lui viendront d'êtres plus achevés en plénitude. A la longue, l'unité du genre humain doit, tout en se diversifiant à l'infini, résorber toutes ses cassures mortelles : intellectuel-manuel, ville-campagne, privé-public, action-contemplation.
Nous n'avons pu exprimer toutes ces exigences de ce qu'on appelle parfois la "révolution spirituelle" sans les appuyer à des considérations de structure qui relèvent d'une révolution proprement politique et économique. Le personnalisme, en effet, considère que les structures du capitalisme se dressent aujourd'hui en travers du mouvement de libération de l'homme, et qu'elles doivent être détruites au profit d'une organisation socialiste de la production et de la consommation. Ce socialisme, nous ne l'avons pas inventé. ll est né de la peine des hommes et de leur réflexion sur les désordres qui les oppriment. Personne ne le réalisera sans ceux mêmes qui l'ont tiré de leur propre destin. ll comporte, sous l'angle humain, deux exigences capitales. ll ne doit pas remplacer l'impériaIisme des intérêts privés par la tyrannie des pouvoirs collectifs : il faut donc lui trouver une structure démocratique, sans affaiblir la rigueur des mesures qu'il devra prendre pour installer et défendre ses premières conquêtes.
Par ailleurs, il est nécessairement conduit, dans nos civilisations industrielles, par l'élite organisée des travailleurs ; mais nos sociétés étant des sociétés de structure complexe, il doit chercher, autour de ce noyau directeur, à grouper un aussi large consentement que possible. Aussi bien le personnalisme, qui eût sans doute été libéral en 1789, nous commande aujourd'hui de dénoncer et de combattre toutes les mystifications que la peur sociale pourrait combiner sous son étiquette, et de nous attacher résolument au combat de cette démocratie populaire dont l'Europe cherche aujourd'hui les voies. Dans ce combat, il a sa note à donner. Ses exigences sont de celles que la violence des tumultes révolutionnaires compromettent à coup sûr, car ce sont des exigences complexes, et des révolutions sont des poussées brutales des grandes forces élémentaires. Mais vingt siècles d'expérience historique ne doivent pas être tout de même perdus. Comme les autres, la technique des révolutions s'affine de jour en jour. ll doit être possible d'opérer l'Europe du XXe siècle sans la défigurer. C'est pour cette réussite que nous parlons, pour elle que nous combattons : ne pas compromettre les nécessités révolutionnaires par les exigences révolutionnaires, ni les exigences révolutionnaires par les nécessités révolutionnaires. Quelle que soit la manière dont un personnaliste estime devoir engager aujourd'hui ce combat, cette liberté relative d'insertion ne doit laisser aucun doute sur le sens et sur le point d'application du combat. Et si nos idéaux venaient par malheur à divorcer de nos frères de lutte, c'est avec nos frères de lutte que nous marcherions à leur réconciliation, car les idées ne sont rien sans les hommes qui seuls peuvent les nourrir..."

Introduction aux existentialismes, 1946.
Mounier définit l'existentialisme "comme une réaction de la philosophie de l'homme contre l'excès de la philosophie des idées et de la philosophie des choses", mais distingue plusieurs existentialismes : c'est à partir de Kierkegaard que le tronc de l'existentialisme se scinde en deux branches, l'une athée, amorcée par la phénoménologie, et qui aboutit à l'athéisme de Sartre, l'autre, chrétienne, plus riche, où se côtoient Bergson, Gabriel Marcel, Jaspers, Chestov. A la lumière de cette distinction, Mounier passe en revue les thèmes fondamentaux de ce mouvement (contingence, aliénation, fragilité, solitude de l'existence) et les notions clés (néant, engagement, autrui, etc).
"..Nous touchons ici un des paradoxes les plus méconnus de l'existentialisme. Cette philosophie de l'homme blessé, parfois de l'homme désespéré, n'est pas un quiétisme du malheur, tout au contraire. Partant d'une vision aussi désolée, l'épicurisme proposait à l'homme une retraite heureuse en marge de la vie, une sorte d'assoupissement de l'élan vital. L'existentialisme, à l'opposé, jette l'homme au devant de son malheur. Chasseur fiévreux de divertissements ou de vérité chez Pascal, chez Nietzsche créateur de valeurs et de puissance, l'homme est encore, pour Heidegger et pour Jaspers un pouvoir être, un essor, un bondissement (Aufsprung, Absprung), un être-en-avant-de-soi. C'est ce mouvement qu'ils appellent sa transcendance. Mais, pour Jaspers, l'être humain tend vers un au-delà de l'existence humaine; pour Heidegger, n'existe que le monde de l'homme, et il y est projeté en dehors et en avant de soi, sans changer de monde. Il faudrait parler, dans le premier cas, comme le suggère Jean Wahl, de "transascendance". Nous proposerons de désigner le second processus, pour éviter une ambiguïté fréquente, sous le nom de "transproscendance". En ce sens, l'existant humain est toujours plus que ce qu'il est (sur le champ), quoiqu'il ne soit pas encore ce qu'il sera. Il est, dira Sartre, 1' « être qui n'est pas ce qu'il est et qui est ce qu'il n'est pas ››. Cette conception prospective de l'existence, Heidegger l'oppose à l'inertie, à la détermination totale de l'existentia classique, de la substance, tout au moins de l'image dégradée qu'on en a souvent proposé. L'être humain n'est pas ce que le décret éternel et inamovible d'une essence lui a imposé d'être, il est ce qu`il a résolu d'être, "autodétermination". Il ne saurait donc être pourvu d'une définition abstraite, d'une nature antérieure à son existence, il est son existence, il est ce qu'il se fait. Ses modes ne sont pas des propriétés permanentes qu'il possède, mais des manières d'exister concrètement qui, chaque fois, l'engagent tout entier et l'emportent en avant dans l'aventure de lui-même.
On ne peut se dissimuler, toutefois que l'existant n'est pas constamment ni tout entier ce bondissement créateur. Il y a de l'inertie dans l'être. Elle amène Heidegger à distinguer un existant brut (le Seinde), réduit au « il y a ››, obscurité chaotique sans détermination - pour autant que la simple désignation ne détermine pas déjà - et un projet qui prend perpétuellement de la distance par rapport à cet existant brut...."
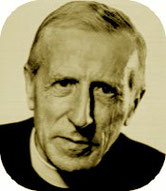
Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955)
Le livre incontournable de Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, paléontologue, philosophe et théologien, longtemps censuré ou marginalisé par l’Église, celui qui incarne vraiment sa pensée et qui est considéré comme son œuvre majeure, est "Le Phénomène humain".
Écrit entre 1938 et 1940 (pendant son séjour en Chine), il sera publié en 1955, à titre posthume (Éditions du Seuil). C’est le texte dans lequel Teilhard développe sa vision globale de l’évolution, de la matière inanimée à la vie, à l’homme, à la conscience, à la "noosphère", puis au "Point Oméga" (Christ cosmique). Il y intègre la science (géologie, paléontologie) dans une perspective totalement spirituelle. La "Noosphère" correspond à la sphère de la pensée humaine, stade supérieur de l’évolution collective de l’humanité, et le "Point Oméga", finalité ultime, pôle d’attraction spirituel qui attire toute la création vers une unification en Dieu.
"L’Avenir de l’homme" (The Future of Man), un recueil publié en 1959, qui rassemble des essais écrits entre 1930 et 1955, complète et développe les intuitions du "Phénomène humain", en se focalisant encore plus sur le devenir collectif et spirituel de l’humanité. Il y décrit la Terre comme un immense organisme en croissance, où l’homme est le pivot d’une prise de conscience planétaire.
Pour Teilhard, l’évolution biologique a conduit à l’homme, mais elle ne s’arrête pas là : elle se poursuit au niveau psychique et collectif. L’homme n’est plus un simple individu isolé ; il participe à un processus global d’hominisation et de complexification. Il évoque un « englobement » ou « socialisation » progressive de l’humanité, préparant une unité spirituelle future.

"Le Phénomène Humain" (1940)
Teilhard commence par critiquer la séparation entre science et spiritualité et affirme qu’il faut développer une conscience cosmique pour saisir l’unité du réel. La science, la philosophie et la foi doivent s’unir pour « voir » l’évolution de l’univers. Contrairement à la vision strictement darwinienne, Teilhard valorise la montée de la conscience et l’intériorisation, ce qui donne une dimension spirituelle à l’évolution. Si sa téléologie (l’idée que l’évolution aurait un but) est incompatible avec l’évolution biologique telle qu’acceptée aujourd’hui et si la notion de Point Oméga n’a aucun fondement empirique, son langage poétique et sa pensée téléologique ont inspiré non seulement des croyants, mais aussi des chercheurs sensibles à une vision « holistique » du cosmos. Aujourd’hui, sa noosphère est rediscutée dans les études sur la conscience collective et l’Anthropocène...
Teilhard décrit l’évolution cosmique depuis le Big Bang (qu’il nomme « cosmogenèse ») jusqu’à l’apparition de la vie. Il distingue trois étapes, 1) la Pré-vie (matière inorganique) : organisation progressive de la matière (atomes, molécules, puis structures complexes). 2) la Vie (biogenèse) : émergence de la vie comme saut qualitatif, première manifestation d’une complexité organisée. 3) la Pensée (noogenèse) : préparation de l’émergence de la conscience.
La vie - Teilhard insiste sur la montée progressive de la complexité biologique. La vie se développe à travers la différenciation des espèces et la montée vers une conscience plus élaborée. Il y introduit la notion d’« énergie radiale » (tendant vers la conscience) et d’« énergie tangentielle » (tendant vers la matérialité). Il voit l’évolution comme une montée vers l’intériorité et non simplement comme une diversification morphologique.
La pensée - Avec l’apparition de l’homme, la nature connaît selon Teilhard un nouveau saut évolutif : la conscience réfléchie. Il nomme ce phénomène noosphère, c’est-à-dire une couche « pensante » enveloppant la Terre, après la géosphère et la biosphère. Dans cette étape, l’homme prend conscience de lui-même, le langage, la culture et les sociétés se développent, apparaît la conscience collective. C'est le début d’un « englobement » planétaire (mondialisation vue comme étape d’unification spirituelle).
La survie spirituelle (le Point Oméga)
Teilhard aboutit à la notion centrale de Point Oméga : un pôle d’attraction spirituelle ultime vers lequel converge toute l’évolution. Il s’agit d’un point de synthèse totale où matière et esprit s’unissent, identifié à la figure du Christ cosmique. Il voit la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une union plus intime au divin. La convergence des consciences individuelles se fait dans une unité plus grande, sans annihilation des individualités.
"... A un double titre, qui le fait deux fois centre du Monde, l’Homme s’impose à notre effort pour voir, comme la clef de l’Univers. Subjectivement, d’abord, nous sommes inévitablement centre de perspective, par rapport à nous-mêmes. Ç’aura été une candeur, probablement nécessaire, de la Science naissante, de s’imaginer qu’elle pouvait observer les phénomènes en soi, tels qu’ils se dérouleraient à part de nous-mêmes. Instinctivement, physiciens et naturalistes ont d’abord opéré comme si leur regard plongeait de haut sur un Monde que leur conscience pouvait pénétrer sans le subir ni le modifier. Ils commencent maintenant à se rendre compte que leurs observations les plus objectives sont toutes imprégnées de conventions choisies à l’origine, et aussi des formes ou habitudes de pensée développées au cours du développement historique de la Recherche. Parvenus à l’extrême de leurs analyses, ils ne savent plus trop si la structure qu’ils atteignent est l’essence de la Matière qu’ils étudient, ou bien le reflet de leur propre pensée. Et simultanément ils s’avisent que, par choc en retour de leurs découvertes, eux-mêmes se trouvent engagés, corps et âme, dans le réseau des relations qu’ils pensaient jeter du dehors sur les choses : pris dans leur propre filet. Métamorphisme et endomorphisme, dirait un géologue. Objet et sujet s’épousent et se transforment mutuellement dans l’acte de connaissance. Bon gré mal gré, dès lors, l’Homme se retrouve et se regarde lui-même dans tout ce qu’il voit.
Voilà bien une servitude, mais que compense immédiatement une certaine et unique grandeur.
Il est simplement banal, et même assujettissant, pour un observateur, de transporter avec soi, où qu’il aille, le centre du paysage qu’il traverse. Mais qu’arrive-t-il au promeneur si les hasards de sa course le portent en un point naturellement avantageux (croisement de routes ou de vallées) à partir duquel non seulement le regard, mais les choses mêmes rayonnent ? Alors, le point de voie subjectif se trouvant coïncider avec une distribution objective des choses, la perception s’établit dans sa plénitude. Le paysage se déchiffre et s’illumine. On voit.
Tel paraît bien être le privilège de la connaissance humaine.
Il n’est pas besoin d’être un homme pour apercevoir les objets et les forces « en rond » autour de soi. Tous les animaux en sont là aussi bien que nous-mêmes. Mais il est particulier à l’Homme d’occuper une position telle dans la Nature que cette convergence des lignes ne soit pas seulement visuelle mais structurelle. Les pages qui suivent ne feront que vérifier et analyser ce phénomène. En vertu de la qualité et des propriétés biologiques de la Pensée, nous nous trouvons placés en un point singulier, sur un nœud, qui commande la fraction entière du Cosmos actuellement ouvert à notre expérience. Centre de perspective, l’Homme est en même temps centre de construction de l’Univers. Par avantage, autant que par nécessité, c’est donc à lui qu’il faut finalement ramener toute Science. — Si, vraiment, voir c’est être plus, regardons l’Homme et nous vivrons davantage.
Et pour cela accommodons correctement nos yeux.
Depuis qu’il existe, l’Homme est offert en spectacle à lui-même. En fait, depuis des dizaines de siècles, il ne regarde que lui. Et pourtant c’est à peine s’il commence à prendre une vue scientifique de sa signification dans la Physique du Monde. Ne nous étonnons pas de cette lenteur dans l’éveil. Rien n’est aussi difficile à apercevoir, souvent, que ce qui devrait « nous crever les yeux ». Ne faut-il pas une éducation à l’enfant pour séparer les images qui assiègent sa rétine nouvellement ouverte ? A l’Homme, pour découvrir l’Homme jusqu’au bout, toute une série de « sens » étaient nécessaires, dont l’acquisition graduelle, nous aurons à le dire, couvre et scande l’histoire même des luttes de l’Esprit.
Sens de l’immensité spatiale, dans la grandeur et la petitesse, désarticulant et espaçant, à l’intérieur d’une sphère de rayon indéfini, les cercles des objets pressés autour de nous.
Sens de la profondeur, repoussant laborieusement, le long de séries illimitées, sur des distances temporelles démesurées, des événements qu’une sorte de pesanteur tend continuellement à resserrer pour nous dans une mince feuille de Passé.
Sens du nombre, découvrant et appréciant sans sourciller la multitude affolante d’éléments matériels ou vivants engagés dans la moindre transformation de l’Univers.
Sens de la proportion, réalisant tant bien que mal la différence d’échelle physique qui sépare, dans les dimensions et les rythmes, l’atome de la nébuleuse, l’infime de l’immense.
Sens de la qualité, ou de la nouveauté, parvenant, sans briser l’unité physique du Monde, à distinguer dans la Nature des paliers absolus de perfection et de croissance.
Sens du mouvement, capable de percevoir les développements irrésistibles cachés dans les très grandes lenteurs, — l’extrême agitation dissimulée sous un voile de repos, — le tout nouveau se glissant au cœur de la répétition monotone des mêmes choses.
Sens de l’organique, enfin, découvrant les liaisons physiques et l’unité structurelle sous la juxtaposition superficielle des successions et des collectivités.
Faute de ces qualités dans notre regard, l’Homme restera indéfiniment pour nous, quoi qu’on fasse pour nous faire voir, ce qu’il est encore pour tant d’intelligences : objet erratique dans un Monde disjoint. — Que s’évanouisse, par contre, de notre optique, la triple illusion de la petitesse, du plural et de l’immobile, et l’Homme vient prendre sans effort la place centrale que nous annoncions : sommet momentané d’une Anthropogénèse couronnant elle-même une Cosmogénèse.
L’Homme ne saurait se voir complètement en dehors de l’Humanité ; ni l’Humanité en dehors de la Vie, ni la Vie en dehors de l’Univers.
D’où le plan essentiel de ce travail : la Prévie, la Vie, la Pensée, — ces trois événements dessinant dans le Passé, et commandant pour l’avenir (la Survie !), une seule et même trajectoire : la courbe du Phénomène humain.
Phénomène humain, — dis-je bien.
Ce mot n’est pas pris au hasard. Mais pour trois raisons je l’ai choisi.
D’abord pour affirmer que l’Homme, dans la Nature, est véritablement un fait, relevant (au moins partiellement) des exigences et des méthodes de la Science.
Ensuite, pour faire entendre que, parmi les faits présentés à notre connaissance, nul n’est plus extraordinaire, ni plus illuminant.
Enfin pour bien insister sur le caractère particulier de l’Essai que je présente.
Mon seul but, et ma vraie force, au cours de ces pages, est simplement, je le répète, de chercher à voir, c’est-à-dire à développer une perspective homogène et cohérente de notre expérience générale étendue à l’Homme. Un ensemble qui se déroule.
Qu’on ne cherche donc pas ici une explication dernière des choses, — une métaphysique. Et qu’on ne se méprenne pas non plus sur le degré de réalité que j’accorde aux différentes parties du film que je présente. Quand j’essaierai de me figurer le Monde avant les origines de la Vie, ou la Vie au Paléozoïque, je n’oublierai pas qu’il y aurait contradiction cosmique à imaginer un Homme spectateur de ces phases antérieures à l’apparition de toute Pensée sur Terre. je ne prétendrai donc pas les décrire comme elles ont été réellement, mais comme nous devons nous les représenter afin que le Monde soit vrai en ce moment pour nous : le Passé, non en soi, mais tel qu’il apparaît à un observateur placé sur le sommet avancé où nous a placés l’Évolution. Méthode sûre p.30 et modeste, mais qui suffit, nous le verrons, pour faire surgir par symétrie, en avant, de surprenantes visions d’avenir.
Bien entendu, même réduites à ces humbles proportions, les vues que je tâche d’exprimer ici sont largement tentatives et personnelles. Reste que, appuyées sur un effort d’investigation considérable et sur une réflexion prolongée, elles donnent une idée, sur un exemple, de la manière dont se pose aujourd’hui en Science le problème humain.
Étudié étroitement en lui-même par les anthropologistes et les juristes, l’Homme est une chose minime, et même rapetissante. Son individualité trop marquée masquant à nos regards la Totalité, notre esprit se trouve incliné, en le considérant, à morceler la Nature, et à oublier de celle-ci les liaisons profondes et les horizons démesurés : tout le mauvais anthropocentrisme. D’où la répugnance, encore sensible chez les savants, à accepter l’Homme autrement que par son corps, comme objet de Science.
Le moment est venu de se rendre compte qu’une interprétation, même positiviste, de l’Univers doit, pour être satisfaisante, couvrir le dedans, aussi bien que le dehors des choses, — l’Esprit autant que la Matière. La vraie Physique est celle qui parviendra, quelque jour, à intégrer l’Homme total dans une représentation cohérente du monde.
Puissé-je faire sentir ici que cette tentative est possible, et que d’elle dépend, pour qui veut et sait aller au fond des choses, la conservation en nous du courage et de la joie d’agir.
En vérité, je doute qu’il y ait pour l’être pensant de minute plus décisive que celle où, les écailles tombant de ses yeux, il découvre qu’il n’est pas un élément perdu dans les solitudes cosmiques, mais que c’est une volonté de vivre universelle qui converge et s’hominise en lui.
L’Homme, non pas centre statique du Monde, — comme il s’est cru longtemps ; mais axe et flèche de l’Évolution, — ce qui est bien plus beau." (Edition du Seuil)
