- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman

Pierre Véry (1900-1960), "L'Assassinat du père Noël" (1934) - Boileau-Narcejac, "Les diaboliques (Celle qui n'était plus)" (1952) - Stanislas André Steeman
(1908-1970), "L'assassin habite au 21" (1939), "Quai des Orfèvres (Légitime défense)" (1942) - Henri-Georges Clouzot (1907-1977) - Boileau-Narcejac - Léo Mallet (1909-1996), "120, rue de la Gare"
(1943) - Auguste Le Breton (1913-1999) - Albert Simonin (1905-1980), "Touchez pas au grisbi" (1954) - Charles Exbrayat (1906-1989) - ...
Last update : 2019/12/12 -

Le roman policier, en France comme outre-Atlantique ou outre-Manche, vaut déjà pour ses titres ("A toi de faire, mignonne! J'ai bien l'honneur! La Maison qui tue...) mais plus encore pour sa singularité de style, une atmosphère, des regards, des gestes, des silences, la mécanique intellectuelle ou émotionnelle qui tisse sa toile dans quelque coin obscur de l'existence. Ce qui lui vaut d'emblée une extraordinaire connivence avec le cinéma : le narrateur/réalisateur doit capter le plus rapidement possible l'attention du lecteur/spectateur, et maintenir cet intérêt sans faiblir, l'intrigue doit être solidement structurée. Et ce roman policier conjugue de plus deux dimensions qui semblent portant bien irréconciliables, roman de la profondeur la plus sombre de notre humanité, il peut être critique sociale et parfaitement ludique. Tout est dans le degré de noirceur que l'on privilégie. Simenon, le "peseur d'âme", est en ce sens la grande révélation des années 1930-1950, résoudre l'énigme pour Maigret, écriront Boileau-Narcejac, ce n'est pas découvrir l'assassin, mais ressentir la crise psychologique qui a conduit au drame"...



"Brelan d'as", réalisé par Henri Verneuil en 1952, met en scène autour de trois sketches (La Mort dans l'ascenseur, Je suis un tendre, Les Témoignages d'un enfant de chœur) trois fameux personnages de roman policier des années 1930-1940, qui vont nourrir le cinéma français pendant deux décennies, le subtil inspecteur Wens, oeuvre de Stanislas-André Steeman (Six Hommes morts, 1931, Les Atouts de M. Wens, 1932, L'Ennemi sans visage, 1934), Lemmy Caution, le séduisant et grand cogneur agent du FBI, créature du britannique Peter Cheyney (Cet homme est dangereux, 1936, La Môme vert-de-gris, 1937, Les femmes ne sont pas des anges, 1938, À toi de faire, ma mignonne, 1941), et le commissaire Maigret, le fumeur de pipe invétéré imaginé par Georges Simenon (Le Pendu de Saint-Pholien, 1931, Le Chien jaune, 1931, Le Fou de Bergerac, 1932).
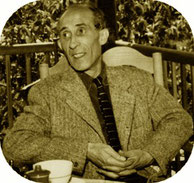
Pierre Véry (1900-1960)
Stanislas-André Steeman, Pierre Véry et Georges Simenon sont les auteurs de romans policiers de langue française les plus importants d'avant-guerre. Pierre
Véry remporte le premier prix du roman d'aventures créé par Albert Pigasse avec "le Testament de Basil Crookes" (1930), un premier roman d'énigme qui préfigure l'inspiration dominante de
l'auteur, des oeuvres policières marquées par le fantastique et la poésie ("Je voudrais que mes romans soient des contes de fées pour grandes personnes") : Clavier universel (1933), Monsieur
Marcel des pompes funèbres (1934), L'Assassinat du père Noël (1934), Les Disparus de Saint-Agil (1935), Goupi-Mains rouges (1937), L'Inspecteur Max (1937), Mort depuis 100 000 ans (1941),
L'assassin a peur la nuit (1942), Les Anciens de Saint-Loup (1944). Le réalisateur Christian-Jaque adapta très rapidement deux romans de Pierre Véry, "Les Disparus de Saint-Agil" (1938), avec
Erich von Stroheim (Walter, professeur d'anglais), Michel Simon (Lemel, professeur de dessin), - trois élèves du pensionnat de Saint-Agil ont fondé un groupe secret dans le but de partir en
Amérique, mais une nuit, l'un d'entre eux surprend un mystérieux visiteur et disparaît, a-t-il réussi à gagner l'Amérique? -, et "L'Assassinat du Père Noël" (1941), avec Harry Baur, Raymond
Rouleau et Renée Faure, - dans un village savoyard, le père Cornusse s'apprête à jouer comme chaque année le rôle du père Noël mais tandis que sa fille rêve au prince charmant et que le baron du
château voisin revient au pays, un homme en costume de père Noël est retrouvé mort....

Les crimes sont-ils commis par des êtres hors série, plus complexes à comprendre que l'homme de la rue? - Simenon mène une double vie littéraire, il trouve ainsi quelque espace pour s'affranchir de la structure du polar et du commissaire Maigret dans ses quelques 117 romans parus entre 1931 et 1972 et qualifiés de "romans durs". C'est dans ces romans qu'il va marquer profondément son sillon dans la littérature francophone, de minuscules tragédies qui posent la question du crime et du châtiment. Bon nombre seront adaptés au cinéma : "Le relais d'Alsace" (1931), "Les Fiançailles de M. Hire" (1933), "Les Gens d'en face" (1933), "Le Bourgmestre de Furnes" (1939), "Les Inconnus dans la maison" (1940), "Cour d'Assise" (1941), "La Vérité sur Bébé Donge" (1942), "La Veuve Couderc" (1942), "L'Aîné des Ferchaux" (1943), "Lettre à mon juge" (1947), "La neige était sale" (1948), "Le Fond de la bouteille" (1949), "Les Fantômes du chapelier" (1949),"Tante Jeanne" (1951), "La Mort de Belle" (1952), "Le Petit Homme d'Arkhangelsk" (1956), "En cas de malheur" (1956), "Le Président" (1958), "Dimanche" (1959), "La Chambre bleue" (1964), "Le Chat" (1967), "La Disparition d'Odile" (1971), "Les Innocents" (1972)...







Stanislas André Steeman (1908-1970)
Né à Liège, Steeman est à l'origine de deux célèbres films de H.G.Clouzot, "L'Assassin habite au 21" (1942) et "Quai des Orfèvres" (1947, Légitime défense),
et connut un temps dans les années 1950 un certain succès, reprenant la tradition du roman-jeu qui incitait les lecteurs à découvrir le coupable avec subtilité et humour, n'hésitant pas à
brouiller les pistes. Il écrira quelque 37 romans qui se prolongeront en une douzaine d'adaptations cinématographiques : dans la série M. Wens, détective impertinent et mystérieux, "Le Dernier
des six" (1931, avec Pierre Fresnay), "Les Atouts de M. Wens" (1932), "Un dans trois" (1932), "L'Ennemi sans visage" (1934), "Crimes à vendre" (1951), "Six hommes à tuer" (1956), auxquels peuvent
s'ajouter "Feu Lady Anne" (1935), "Le condamné meurt à cinq heures " (1959)...
C'est en 1931 que vint en fait la consécration avec le prix du roman d'aventures qui couronne "Six Hommes morts", et les débuts de l'élégant Wenceslas
Vorobeitchik, un ancien policier plus connu sous le nom de M.Wens. On a souvent vu dans un autre personnage de Steeman, le commissaire Malaise, une préfiguration de Maigret: Le Doigt volé, Le
Mannequin assassiné. Après "la Maison des veilles" (1936), "l'Infaillible Silas Lord" (1937), Steeman doit s'adapter aux évolutions du genre, ce sera Poker d'enfer, Six hommes à tuer, Impasse des
boiteux, Une veuve dort seule. Il s'inspirera au début des années 1950 du détective dur-à-cuire américain avec le personnage de Désire Marco dans Madame la mort, 18 Fantômes, Faisons les
fous...

"Le Mort dans l'ascenseur" (1930), nouvelle de Steeman publiée dans le recueil "Six hommes morts", et qui sera adapté pour le film à sketches "Brelan d'as" (1952), un film réalisé par Henri Verneuil et qui réunissait les trois grands policiers du moment, Lemmy Caution (John Van Dreelen), le commissaire Maigret (Michel Simon) et l'inspecteur Wens (Raymond Rouleau).
"Le Mort dans l'ascenseur", alors que celui-ci s'ouvre à l'étage, un homme, Nestor Gribbe, git, poignardé à l'aide d'un stylet à manche d'argent, et nul trace de son assassin...
"- C'est impossible, monsieur. Les portes fermées, le tableau est hors de portée.
- Naturellement, dit Wens, vous n`avez vu entrer personne d'autre que M. Thiénot? Ni un peu avant, ni un peu après?
- Non, monsieur. Mais quelqu`un aurait pu s'introduire dans la maison par la porte de derrière.
- Évidemment, dit Wens.
Que l`assassin de Thiénot se fût introduit par cette porte et se fût caché dans l'escalier de pierre, c'était plus que probable. Mais ensuite?...
L'inspecteur s'adressa au portier :
- Vous dites que, en regagnant votre loge, vous avez entendu le bruit de la porte intérieure de l`ascenseur qui se fermait? Mais est-ce que cela ne pouvait pas être la parte extérieure que l'on ouvrait?
Le portier se gratta la nuque et réfléchit un instant avant de répondre :
- Oh! bien si, monsieur. Cela aurait fait le même bruit, ou à peu près...
- Bon, dit Wens.
Il tira un étui d'argent de sa poche, alluma une cigarette et se mit à fumer, absorbé dans ses réflexions. Heldinge et le portier, immobiles à ses côtés, respectaient sa méditation. Il y eut encore une fois des pas dans l'escalier, des pas rapides, et plusieurs hommes surgirent sur le palier. Il y avait la le juge d'instruction, le substitut du procureur du roi , un médecin, un photographe, et un cinquième personnage insignifiant, le greffier sans doute. L'inspecteur mit rapidement les nouveaux venus au courant de la situation et conclut :
- Cela n'a vraiment pu se passer que de cette façon... Le meurtrier est entré par la porte de derrière; il s'est alors tenu coi dans le petit escalier de pierre jusqu'à ce que Thiénot eût pénétré dans l'ascenseur, jusqu`à ce que le portier eût refermé la porte extérieure et se fût éloigné de quelques pas. Il est alors sorti de sa cachette...
- Croyez-vous? fit le juge d'instruction. Quelle audace n'aurait-il pas fallu à cet homme pour...
- Tout nous prouve, interrompit Wens, que c'est un homme d'audace. Surpris par le portier, le meurtrier en eût été quitte pour décliner une quelconque identité, déclarer être entré par la porte de derrière et témoigner de son désir de rendre visite à un locataire d'un des étages supérieurs. Il ne fut pas obligé d'en arriver là et réussit à se faire ouvrir la porte extérieure par Thiénot, en usant de quelque prétexte, à moins qu'il ne l'ouvrît lui-même tout naturellement, sans que Thiénot pensât à s'étonner qu'une autre personne voulût monter également... Voici donc notre homme â l'intérieur. Il a sans doute son stylet dans sa manche. Détourner une seconde l'attention de la victime, la frapper d'un coup foudroyant, jeu d'enfant.,.
Les yeux dans le vide, sa cigarette au coin de la lèvre, Wens ne parlait plus pour ses interlocuteurs. Il se parlait à lui-même, pensant tout haut. Il dit "jeu d'enfant" et releva la tête. Il semblait sortir d'un rêve.
- Et puis... ?, fit-il. L'assassin n'a pas pu tuer autrement, mais comment ce mort est-il monté jusqu'ici?,..
- Oui, comment? s'écria Heldinge. Lorsque l'ascenseur a atteint le palier, Thiénot était assis sur la banquette du fond, la tête appuyé à la paroi, le chapeau enfoncé sur les yeux..."

"L'assassin habite au 21" (1939)
Le chef d'oeuvre de Steeman. Un tueur en série terrorise Londres, - sept victimes en deux mois crânes fracassés -, en signant ses d’une carte de visite au
nom de «Monsieur Smith». L'enquête du superintendant Strickland le conduit dans une pension de famille, au 21 Russell Square, une pension dirigée par Mrs Valérie Hobson, et où cohabitent le Dr.
Hyde, un ancien médecin, le Major Fairchild, un ancien officier des Indes, Miss Pawter, une publiciste, le couple Crabtree, Mr. Collins, un poseur d’antennes radio, Mr. Andreyew, un doubleur
russe, le professeur Lalla-Poor, un prestidigitateur et Miss Holland, une écrivaine timide passionnée de la race féline. À ce petit groupe, vient rapidement s’ajouter un nouveau locataire, Mr.
Julie, un français venu étudier les monuments égyptiens au British Museum. Scotland Yard pense pouvoir utiliser ce dernier comme indicateur mais il est assassiné le soir. Et chaque fois que le
superintendant Strickland arrête un des locataires, un nouveau meurtre est commis...
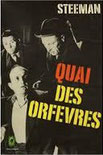
"Quai des Orfèvres (Légitime défense)" (1942)
Noël avait beau se raisonner, il ne parvenait pas à faire taire sa jalousie. Il savait bien que Belle aimait se sentir entourée, cajolée, courtisée.
Pourtant le doute le rongeait. D'où venaient ces fleurs ? A qui écrivait-elle ? Pourquoi s'absentait-elle ? Judas Weyl? Noël avait tenu bon jusqu'ici. Mais cette fois, il sentait que c'était
sérieux. Belle lui avait menti. Sa vieille mère malade la demandait ? Allons donc ! L'excuse était grossière ! Belle voulait s'échapper pour retrouver l'autre, tout simplement. Noël en tremblait
de rage. Sa décision était prise. Il allait les surprendre, il allait le tuer. Le point de vue de l'intrigue adopté est celui de Noël, qui croit avoir tué celui qu’il pensait être l’amant de sa
femme...






En 1947, Henri-Georges Clouzot adapte très librement "Quai des Orfèvres", avec Suzy Delair (Jenny Lamour), Bernard Blier (Maurice Martineau), Louis Jouvet (l'inspecteur Antoine), Simone Renant (Dora Monier). Jenny Lamour est une petite chanteuse de music-hall qui a grand peine à trouver des engagements. Malgré l'opposition de son mari pianiste, Maurice, elle accepte un rendez-vous à souper avec Brignon, un vieil homme d'affaires ambigu qui doit lui procurer un rôle. Maurice, apprenant ce rendez-vous, se rend chez Brignon, mais il ne trouve plus qu'un cadavre. Affolé, il se réfugie chez une amie de Jenny, Dora, qui photographiait par ailleurs des jeunes filles nues pour le compte de Brignon, et lui raconte son histoire. Mais Dora a déjà reçu la visite de Jenny, venue lui avouer qu'elle avait assommé Brignon, devenu trop entreprenant. Brignon a été en fait tué par une balle de revolver et c'est l'inspecteur Antoine, un ancien de la coloniale dont il a ramené un fils qu'il a placé en pension et qui est le seul être qu'il aime, qui entreprend l'enquête dans un milieu qui ne peut que le troubler, celui des cabarets : le meurtrier n'est confondu qu'à la fin du film, on croit que l'on va être sur une grande affaire de passion et tout se termine dans une misérable petite affaire, comme d'habitude, concluera Louis Jouvet...













"Un dans trois" (1932)
Soit deux points a et b de la trajectoire d'une balle. Sachant que le point a se trouve dans le mur de la chambre à 60 centimètres du plancher et le point b
dans le dossier du fauteuil à 1 mètre 20, tracez une oblique jusqu'à la verticale d'explosion. Cette dernière étant située à 5 mètres de la victime, qu'en concluez-vous ? Et quelle est la taille
de l'assassin? Ah, évidemment, ce casse-tête laisse ces messieurs du Parquet babas. D'autant que la solution en est troublante. Jugez plutôt : il est mathématiquement démontré que l'assassin
mesure 2 mètres 40. Un peu grand, non ? A moins de dénicher dans le secteur un géant. Ou un monstre qui aurait eu une excellente raison de tuer le Dr Nepper...
"L'homme en noir referma son livre d'un coup sec et se renversa sur les coussins de la voiture. Aujourd'hui, le château de Loverval, classé monument
historique, avait un propriétaire sans particule : Hugo Schlim. Sur le compte de celui-ci, les gens du pays ne savaient rien, ou presque rien... Seulement qu'il était fabuleusement riche - il
faut l'être pour acheter un monument historique à l'État - et qu'il avait couru le monde toute sa vie. Il s'était marié il y a un an et, après avoir fait faire à sa femme un voyage de noces long
de six mois, il s'était installé au château avec elle, un ami, une nièce de dix-neuf ans et de nombreux domestiques. C'était un homme qui avait passé la quarantaine et qui avait l'aspect d'un
officier enretraite. Chaque matin, on le voyait monter à cheval, accompagné tantôt de sa nièce, tantôt de son ami. Droit comme un i sur sa selle, il ne regardait rien, ni personne. Il ne répondait
pas aux coups de chapeau, poussant sa monture sans souci de ceux qu'il croisait et les forçant parfois à descendre dans le fossé pour éviter d'être heurtés par le poitrail de César. Son dédain
avait découragé les plus entreprenants et M. le curé, lui-même, après avoir vainement essayé plusieurs fois d”être reçu par "Sa Seigneurie" qu'il espérait intéresser au sort de ses ouailles,
avait pris le parti de l'ignorer. On voyait rarement sa femme, qui sortait d'habitude en auto. Elle était pâle et blonde, d°une beauté qui ne se livrait pas tout de suite. Les commères, à la
veillée, se plaisaient à la prendre en compassion, convaincues, malgré leur ignorance de la vie intime du château, que leur pitié n'était pas sans objet. Le docteur Nepper, l'ami du châtelain et
son hôte depuis six mois, n'avait pas davantage éveillé les sympathies. C'était un gaillard trapu, nerveux, et sec comme un sarment, qui se comportait, dans chaque circonstance de la vie, comme
s'il était le centre de l'intérêt universel. Se trouvait-il seul dans sa chambre, le moindre de ses gestes était réglé de façon à ne pouvoir donner prise aux critiques d'un invisible public.
Chaque jour, le temps fût-il beau ou mauvais, il s'en allait le long des routes ou des sentiers, les dents serrées sur une courte pipe de bruyère, le plus souvent vide ou éteinte. Après un mois
de séjour au château, ses bandes molletières et son petit chapeau de feutre vert étaient connus à plusieurs lieues à la ronde et il n'était pas un paysan qui, à l'approche du docteur, manquât
d'interrompre un instant son travail pour le regarder passer avec mépris., Un jour, en effet, un fermier avait eu recours à l'hôte du châtelain et l'avait sollicité de se rendre en hâte au chevet
de son enfant qui, terrassé par un mal subit, gémissait et délirait. Le docteur avait éconduit l'homme, faisant valoir qu°il ne professait plus depuis longtemps et que, au surplus, la médecine
générale ne l'intéressait pas. Fou de colère, le fermier avait esquissé un geste de menace, jurant ses grands dieux que, si son enfant mourait, il ne mourrait pas seul. Puis il avait attelé sa
carriole et, à une allure d'enfer, avait couru jusqu'à Charleroi d'où il avait ramené un honnête praticien qui, heureusement pour Nepper, avait réussi à sauver le petit malade. Depuis cette
date, le docteur ne rencontrait sur sa route que visages fermés ou hostiles et il était arrivé que des gamins courussent après lui en l'accablant, d'insultes. et en lui jetant des pierres - ce
dont il ne paraissait pas, à la vérité, se
soucier le moins du monde...
Tiré de sa songerie, l'homme en noir releva la tête. L'auto venait de s'arrêter au beau milieu de la route.
- Eh bien? grogna-t-il. Qu'est-ce que c'est?...
- Je ne sais pas, monsieur, répondit le chauffeur en descendant de son siège. Je vais voir...
- Ce n'est pas une panne, j'espère?...
N'obtenant pas de réponse, le voyageur se carra sur les coussins de la voiture, tira de sa poche un petit miroir en métal et se mit à vérifier
l'ordonnance de sa toilette. Il était vêtu de noir des pieds à la tête et son visage en paraissait plus pâle. Il portait une courte barbe noire, taillée en collier, et son front, haut et bombé,
était couronné d'une chevelure léonine. Quoique celle-ci fût aussi noire que la barbe, un bref examen permettait de se rendre compte qu'il ne s'agissait là que d'un artifice destiné à dissimuler
une calvitie sans doute définitive. Tel quel, l'homme avait un aspect peu propre à engendrer la gaieté et, faisant fi de toute coquetterie, bien loin de chercher à l'atténuer, il semblait, au
contraire, vouloir l'accentuer en portant des gants de fil noirs. Le voyageur poussa un soupir, remit son miroir dans sa poche et sortit à son tour de l'auto. Le chauffeur, qui avait soulevé le
capot, se tourna vers lui en ôtant sa casquette et en se grattant le crâne.
- Eh bien? , interrogea, pour la seconde fois, l'homme en noir.
Il s'exprimait avec une froideur peut-être voulue et son visage était impassible.
- Elle ne veut plus avancer, fit le chauffeur d'un tom embarrassé...."

Dans la seconde moitié des années 1930, le "polar" se teinte d'un "romantisme des bas-fonds", d'un "désespoir naturaliste" (ou "réalisme poétique", comme l'on voudra) qui sied à merveille à un acteur comme Jean Gabin. C'est l'époque où Julien Duvivier réalise "Pépé le Moko" (1936), tandis que Marcel Carné, avec la collaboration de Jacques Prévert, adapte un roman de Pierre MacOrlan (1927), "Quai des Brumes" (1938), puis tourne "Le Jour se lève" (1939). Ici s'exprime tout le talent d'écrivains et scénaristes comme Jacques Viot (1898-1973), Eugène Dabit (1898-1936), Pierre MacOrlan (1882-1970), Jacques Prévert (1900-1977)...

"Pépé le Moko" (1936), de Julien Duvivier, avec Jean Gabin, Mireille Balin, Line Noro, évoque les péripéties d'un chef d'une bande de malfaiteurs, Pépé le Moko, qui s'est réfugié dans la Casbah d'Alger avec les membres de sa bande et sa maîtresse Inès et que la police cherche à capturer.

"Quai des Brumes" (1938), de Marcel Carné, avec Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan et Pierre Brasseur, nous conte l'histoire, dramatique, à souhait, d'un déserteur de la Coloniale hanté par ses souvenirs de guerre, Jean, qui arrive dans la ville portuaire du Havre et qui, en quête d’un bateau, fait la rencontre de la belle Nelly (Michelle Morgan) dont il tombe amoureux, mais elle est sous la coupe d'un tuteur qui la terrorise et lui-même assailli par un groupe de petits voyous...

"Hôtel du nord" (1938), de Marcel Carné, d'après un roman d'Eugène Dabit, avec Annabella, Jean-Pierre Aumont, Louis Jouvet, Arletty, relate l'histoire d'un couple, Pierre et Renée, qui ont décidé d'en finir avec la vie dans une chambre de l'Hôtel du Nord. Mais Pierre, après avoir tiré sur sa compagne, hésite à se tuer, l'arrivée d'un voisin l'empêche de mettre son projet à exécution. Il fuit puis se constitue prisonnier alors que Renée n'est que blessée. Elle va tenter de sauver et d'innocenter Pierre...

"Le Jour se lève" (1939), de Marcel Carné, sur un scénario de Jacques Viot, avec Jean Gabin, Jules Berry, Jacqueline Laurent, Arletty, apogée du film travaillé au millimètre en studio et premier film parlant utilisant le flash-back au cours duquel un homme (Jean Gabin), un ouvrier sableur, perdu et barricadé dans sa chambre (François, François, y a plus de François … laissez-moi seul, tout seul, j’veux qu’on m’foute la paix") après avoir tué le très ambigu Valentin (Jules Berry), le saltimbanque, se remémore sans illusion les circonstances de son crime, un drame de la fatalité amoureuse et sociale dans lequel interviennent Clara (Arletty), la maîtresse de Valentin ("des souvenirs, des souvenirs, est-ce que j’ai une gueule à faire l’amour avec des souvenirs"), et Françoise, la douce fleuriste (Jacqueline Laurent)...

Les décennies de l'Occupation nazie voient paradoxalement le film du mystère connaître son âge d'or en France. Adapté de romans écrits dans les années 1930, le fantastique contrebalance la noirceur de la Collaboration. On pense aux "Inconnus dans la maison" (1941), de Henri Decoin, "L'Assassinat du Père Noël" (1941), de Christian-Jaque, "Goupi Mains rouges" (1943) de Becker, "Le Corbeau" (1943) de Clouzot. Les années 1950 voient s'étoffer la fiction policière avec les premières adaptations françaises de Peter Cheyney ("Cet Homme est dangereux" (1952), de Jean Sacha, "La Môme Vert-de-Gris" (1951), de Bernard Borderie), les adaptations argotiques des romans noirs écrits au début des années 1950 ("Touchez pas au grisbi" (1953), de Jacques Becker, "Razzia sur la chnouf" (1954), de Henri Decoin, "Du rififi chez les hommes" (1954), de Jules Dassin), l'exploitation de sujets à caractère criminel ou réflexion sur la justice ("Justice est faite" (1951), "Nous sommes tous des assassins" (1952), d'André Cayatte) : "l'abondance de films de gangsters ou policiers, émaillés de détails techniques sur le maniement du revolver ou la préparation du guet-apens, aboutit, publiera le Conseil de la magistrature en 1948, à l'institution d'une véritable école du meurtre..." Mais la truculence d'un Michel Audiard viendra contrebalancer entre 1949 et 1951 les dramatiques péripéties de notre appétit criminel, "Méfiez-vous des blondes", réalisé par André Hunebelle, avec Martine Carol, en est un bon exemple. "Classe tous risques" (1960) de Claude Sautet inaugurera un nouveau style de film...
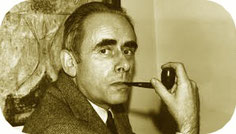
Henri-Georges Clouzot (1907-1977) est un réalisateur qui fut fortement influencé par l'expressionnisme et à qui on reprocha d'avoir bénéficié, pendant l'Occupation nazie en France, de l'exil aux États-Unis des grands réalisateurs comme Jean Renoir, Julien Duvivier, René Clair. Il fit ses premiers pas aux studios de la Babelsberg à Berlin comme assistant d'Anatole Litvak. Il n'aura de cesse de traquer dans ses films la noirceur de ce monde. Le mal est tapi en chacun de nous, la caméra de Clouzot explore sans concession tant l'âme de ses personnages que leur environnement, tout est ici le signe d'une obscure ambiguïté morale de l'âme humaine. C'est ainsi qu'il adapte successivement "Les inconnus dans la maison" (1941, réalisé par Henri Decoin) avec Raimu, d'après un roman de Georges Simenon, "Le dernier des six" (1941, réalisé par Georges Lacombe) avec Pierre Fresnay et Suzy Delair, d'après Stanislas-André Steeman, puis réalise "L'assassin habite au 21", (1942), avec Pierre Fresnay-Suzy Delair, "Le corbeau" (1943), avec toujours Pierre Fresnay et selon un scénario inspiré d'un fait divers qui s'était passé à Tulle dans les années 1920, puis "Quai des Orfèvres" (1947). "Le salaire de la peur" (1953), adapté d'un roman de Georges Arnaud, avec Yves Montand et Charles Vanel, lui vaudra le Lion d'or à Venise et le Grand Prix au Festival de Cannes, mais c'est avec " Les diaboliques" (1955) qu'il atteint la notoriété...

Henri Decoin (1890-1969) a réalisé nombre d'adaptations de roman de Georges Simenon, "Les Inconnus dans la maison" (1942), "L'Homme de Londres" (1943), "La Vérité sur Bébé Donge" (1951), avec Danielle Darrieux et Jean Gabin, mais aussi "La fille du diable" (1946), "Les amoureux sont seuls au monde" (1948), "Razzia sur la chnouf" (1955). Il met en scène dans "Entre onze heures et minuit" (1948), d'après le roman de Claude Luxel, "Le sosie de la morgue", un extraordinaire inspecteur joué par Louis Jouvet, qui se découvre le sosie d'un homme assassiné et prend sa place pour mener l'enquête...

Jacques Becker (1906-1960), le célèbre réalisateur de "Casque d'or" (1952), a conjugué poésie du quotidien et sujets criminels : "Dernier Atout" (1942) est l'un des premiers policiers noirs français. Il adapte un roman de Pierre Véry, "Goupi Mains Rouges" (1943), avec Fernand Ledoux, Georges Rollin, Blanchette Brunoy, entremêlant suspense, étude de mœurs et fantastique : dans un petit village de Charente, vit en reclus le clan des Goupi, l'un de ses membres sera assassiné en plein coeur de la forêt. En 1954, Becker réalisera le premier chef d'oeuvre du film noir français, "Touchez pas au grisbi", d'après Albert Simonin, avec Jean Gabin et Jeanne Moreau...
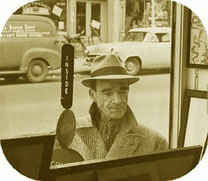
Auguste Le Breton (1913-1999)
"Je ne peux pas inventer mes héros, c'est de la chair et du sang. Ils existent. Ils prennent des coups. Ils souffrent. Et pour décrire des gens, il faut
que je les pige." - La vie d'Auguste Montfort, dit Le Breton, l'inventeur du "rififi", est à elle seule un véritable roman, orphelin qui connut les centres d'éducation surveillée, exerça
nombre de petits métiers et fréquenta la petite pègre de Saint-Ouen, bookmaker clandestin, il sort de la 2e Guerre mondiale avec la Croix de guerre, se met à l'écriture la
trentaine passée (La Loi des rues, Les Hauts murs) et parcourra le monde, dont l'Amérique du Sud. C'est avec la publication de "Du Rififi chez les hommes" (1953), édité dans la Série noire et
adapté au cinéma par Jules Dassin, en 1955, que débute sa renommée dans le polar à la française : l'argot côtoie ici le verlan. Suivent plus de 80 livres, dont certains seront portés à l'écran,
les mythiques "Razzia sur la chnouf" (1954), "Du rififi chez les femmes" (1957), "Le Rouge Est Mis" (1957) , "Du rififi à Paname" (1965) et le célèbre "Clan des Siciliens"...



"Razzia sur la chnouf" (1954), de Henri Decoin, avec Jean Gabin, un Jean Gabin qui gagne en épaisseur, Magali Noël, Lino Ventura : Henri Ferré, alias Le Nantais, revient de New York à Paris pour restructurer un réseau de drogue sous la couverture de patron d'un bar, et se révèle en fait un inspecteur de police infiltré pour la bonne cause ...






"Le Rouge Est Mis" (1957), réalisé par Gilles Grangier, avec Jean Gabin, Paul Frankeur, Marcel Bozzuffi, Lino Ventura, Annie Girardot, conte les péripéties d'un gang de cambrioleurs chevronnés, Louis Le Blond, qui a pris l'identité d'un respectable garagiste Louis Bertain, Pépito Le Gitan, Raymond Le Matelot et le vieux rabatteur Frédo, qui, perdant subitement la tête, plonge le groupe dans la tourmente...







Albert Simonin (1905-1980)
La trilogie de "Max le Menteur", de 1953 à 1955, avec "Touchez pas au grisbi !", "Le cave se rebiffe", "Grisbi or not grisbi", fit la renommée d'Albert
Simonin, son langage argotique (son dictionnaire d'argot date de 1957) et ses personnages de truands haut en couleur se prêtèrent aisément à des films très rapidement populaires. Il fut ainsi
associé à nombre de grands classiques du polar français aux extraordinaires réparties et qui bénéficièrent d'une génération de réalisateurs et d'acteurs particulièrement remarquables : Touchez
pas au grisbi, de Jacques Becker (1953), Le Feu aux poudres, d'Henri Decoin (1957), Le cave se rebiffe, de Gilles Grangier (1961), Du mouron pour les petits oiseaux, de Marcel Carné (1962),
Mélodie en sous-sol, de Henri Verneuil (1962), Le Gentleman d'Epsom, de Gilles Grangier (1962), "Les Tontons flingueurs", de Georges Lautner (1963), "Les Barbouzes", de Georges Lautner (1963),
"Quand passent les faisans", d'Édouard Molinaro (1965), "La Métamorphose des cloportes", de Pierre Granier-Deferre (1965), "Le Pacha", de Georges Lautner (1967)...



"Touchez pas au grisbi" (1954), un film de Jacques Becker, avec Jean Gabin, Jeanne Moreau, Lino Ventura, règlement de compte entre truands qui lancera Lino Ventura dans le cinéma... Max, parrain charismatique de la pègre parisienne, et Riton, son vieux camarade de route, aspirent à prendre sa retraite au lendemain de son dernier grand coup d’éclat, le vol de 50 millions de francs en lingots d’or à l’aéroport d’Orly. Mais Riton se permet, dans les gras de sa maîtresse Josy, quelques indiscrétions, ce qui va susciter l'intérêt d'Angelo, un grisbi éveille toujours bien des convoitises...






"Le Cave Se Rebiffe" (1961), un film de de Gilles Grangier et dialogues de Michel Audiard, avec Jean Gabin, Maurice Biraud, Bernard Blier, Martine Carol, trois apprentis gangsters se lancent dans la fausse monnaie en espérant manipuler un talentueux graveur, mais se retrouvent dans l'obligation de faire appel à un expert du Milieu...



"Grisbi or not grisbi", adapté sous le titre "Les Tontons flingueurs" (1963), de Georges Lautner, dialogues de Michel Audiard, avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre, Francis Blanche, un chef d'oeuvre d'humour pastichant les films noirs américains, voit la singulière reconversion d'un ex-truand qui doit malgré lui faire quelque peu de ménage...



Boileau-Narcejac
"Pierre Boileau bâtit l'intrigue, Thomas Narcejac rédige, étoffe, met au propre le texte définitif" - Boileau-Narcejac est la signature commune de
Pierre Louis Boileau (1906-1989) et Pierre Ayraud, dit Thomas Narcejac (1908-1998 ), écrivains français de romans policiers, dont certains ont donné lieu à des adaptations ... Né à Paris,
sensible, dit-il, dès son enfance à la moindre menace de dérèglement que pourrait connaître son quotidien, Pierre Boileau a fait ses études dans une école de commerce. Tout en exerçant les
métiers les plus divers pour gagner sa vie, il écrit des contes et des nouvelles. En 1938, il remporte le Prix du Roman d'aventures avec "Le Repos de Bacchus" et se consacre alors à la
littérature policière (La Pierre qui tremble, La Promenade de minuit, Six Crimes sans assassin, Les Trois Clochards, Les Rendez-vous de Passy, etc. Il collabore depuis 1950 avec Thomas Narcejac.
Né à Rochefort-sur-Mer, petite ville où "le moindre changement, le moindre détail compte", Thomas Narcejac, après des études universitaires, est professeur de lettres et de philosophie. Il vient
à la littérature policière en pastichant les maîtres du genre (Chesterton, Agatha Christie, Conan Doyle, Maurice Leblanc). Il publie plusieurs romans maritimes (Une Seule Chair, 'Le Grand Métier,
etc.) et divers ouvrages de critique. Il obtient le Prix du Roman d'aventures en 1948 avec "La Mort est du voyage". Il collabore depuis 1950 avec Pierre Boileau. Boileau et Narcejac ont publié
sous leur double signature une vingtaine de romans dont la plupart ont été portés à l'écran : "Les Diaboliques" (Clouzot), "Sueurs froides" (Hitchcock), "Maldonne" (S. Gobbi), etc. Ils ont reçu
en 1965 le Prix de l'Humour noir avec "Et Mon Tout est un homme". Boileau-Narcejac écrivent concurremment pour le cinéma, la radio et la télévision. Fans depuis toujours d'Arsène Lupin, ils ont
résolu de donner suite aux aventures du légendaire détective aristocrate de Maurice Leblanc., et "Le Secret d'Eunerville", premier ouvrage de la série, a obtenu en 1973 le Prix Mystère de la
critique. Thomas Narcejac a jadis rappelé le commun dénominateur qui l'unissait à Pierre Boileau, écrire "un roman carnivore, un roman semblable à ces fleurs tropicales qui se referment sur les
papillons qu'elles ont séduits"..
Boileau-Narcejac entendent inaugurer un nouveau style de roman policier dont "L'Ombre et la proie" constitue la première expérience, bientôt pleinement affirmé avec "Celle qui n'était plus" (Les Diaboliques) : la matière qui constitue le suspense est celle d'une réalité qui très rapidement prend des allures de piège, dérègle le quotidien et conduit inexorablement les personnages au drame. Ce sera "Les Visages de l'ombre" (1953), "D'entre les morts" (1954), "Les Louves" (1955), "Le Mauvais Oeil", "Au bois dormant" (1956), "Les Magiciennes" (1957), "L'ingénieur aimait trop les chiffres" (1958), "A coeur perdu" (1959), "Maléfices" (1961), "Maldonne" (1962)...
"Il nous fallait, d'une part, sauver l'enquête et, grâce à elle, le problème, mais, d'autre part, conserver, comme personnage central, la victime. En
d'autres termes, nous sentions qu'il était possible de renouveler le roman-problème, à condition d'en chasser les policiers, les suspects, les indices, tout le contenu traditionnel. Le suspense
était à ce prix. A partir de là, nous comprenions mieux que, pour unir indissolublement mystère et explication, pour faire du roman policier un roman envoûtant, il fallait écrire le roman de la
victime..." (...)
Pour faire du roman policier un roman vraiment envoûtant, il fallait écrire le roman de la victime. Mais on n'est pas une victime parce qu'on est
poursuivi et directement menacé. On est une victime dès qu'on assiste à des évènements dont on ne réussit pas à épuiser le sens définitif, dès que le réel devient un piège, dès que le
quotidien se dérègle. On est une victime parce qu'on cherche en vain la vérité, et que celle que l'on atteint n'est pas la bonne et ainsi de suite, et plus on raisonne, plus on s'égare. Le
roman policier, au lieu de marquer le triomphe de la logique, doit dès lors consacrer la faillite du raisonnement... Mais la logique n'est pas absente d'un tel récit, elle sert à construire le
drame; elle fait du roman une machine à mourir. La logique inefficace de la victime est impuissante devant la logique souterraine et implacable de l'intrigue" (Boileau-Narcejac, Le Roman
policier, essai théorique et historique sur le genre policier)

"Les diaboliques (Celle qui n'était plus)" (1952)
Le roman, qui a inspiré le célèbre film de H.-G.Clouzot, est le récit d'une machination qui conduit au crime, entièrement écrit du point de vue de la
victime, et l'angoisse naît en effet de la solitude d'un être qui se sait condamné, le monde y est ici corrompu par le mensonge, un mal qui s'étend, invisible, jusqu'aux aspects les plus
familiers de la vie. Terrorisant sa femme, Christina, et martyrisant sa maîtresse, Nicole, par ailleurs professeur, Michel Delasalle dirige à Saint-Cloud une institution pour jeunes gens. Un
pacte diabolique va réunir les deux femmes qui décident de le tuer. Mais le corps disparaît, d'étranges évènements hantent l'institution, la véritable machination conçue par Michel et Nicole à
l'encontre la fragile Christina va progressivement se révéler...
"- Fernand, je t'en supplie, cesse de marcher!
Ravinel s'arrêta devant la fenêtre, écarta le rideau. Le brouillard s'épaississait. Il était jaune autour des lampadaires qui éclairaient le quai,
verdâtre sous les becs de gaz de la rue. Parfois, il se gonflait en volutes, en fumées lourdes et, parfois, il se changeait en poussière d'eau, en pluie très fine dont les gouttes brillaient,
suspendues. Le château avant du Smoelen apparaissait confusément, dans des trous de brume, avec ses hublots éclairés. Quand Ravinel restait immobile, on entendait, par bouffées, la musique d'un
phonographe.
On savait que c'était un phonographe, car chaque morceau durait trois minutes environ. Il y avait un silence très bref. Le temps de retourner le disque.
Et la musique recommençait. Elle venait du cargo.
- Dangereux! observa Ravinel. Suppose que quelqu'un du bateau voie Mireille entrer ici!
- Penses-tu! fit Lucienne. Elle va s'entourer de tant de précautions... Et puis, des étrangers! Qu'est-ce qu'ils pourraient
raconter?
D'un revers de manche, il essuya la vitre que sa respiration couvrait de buée. Son regard, passant au-dessus de la grille du minuscule jardinet,
découvrait, à gauche, un pointillé de lumières pâles et d'étranges constellations de feux rouges et verts, les uns, semblables à de petites roues dentelées, comme des flammes de cierges au fond
d'une église, les autres, presque phosphorescents comme des lucioles. Ravinel reconnaissait sans peine la courbe du quai de la Fosse, le sémaphore de l'ancienne gare de la Bourse et le fanal du
passage à niveau, la lanterne suspendue aux chaînes qui interdisent, la nuit, l'accès au pont transbordeur, et les feux de position- du Cantal, du Cassard et du Smoelen. A droite, commençait le
quai Ernest-Renaud. La lueur d'un bec de gaz tombait en reflets blêmes sur des rails, découvrait du pavé mouillé. A bord du Smoelen, le phono jouait des valses
viennoises.
- Elle prendra peut-être un taxi, tout au moins jusqu'au coin de la rue, dit Lucienne.
Ravinel lâcha le rideau, se retourna.
- Elle est trop économe, murmura-t-il.
De nouveau, le silence. Ravinel recommença de déambuler. Onze pas de la fenêtre à la porte. Lucienne se limait les ongles et, de temps en temps, levait
sa main vers le plafonnier, la faisant tourner lentement comme un objet de prix. Elle avait gardé son manteau, mais avait insisté pour qu'il prît, lui, sa robe de chambre, enlevât son col et sa
cravate, enfilât ses pantoufles. "Tu viens de rentrer. Tu es fatigué. Tu te mets à, l'aise avant de manger... Tu comprends?". Il comprenait parfaitement. Et même, il comprenait trop bien, avec une
espèce de lucidité désespérée. Lucienne avait tout prévu. Comme il s'apprêtait à sortir une nappe du buffet, elle l'avait rabroué, de sa voix rauque, habituée à
commander.
- Non, pas de nappe. Tu arrives. Tu es seul. Tu manges sur la toile cirée, rapidement.
Elle avait elle-même disposé son couvert : la tranche de jambon, dans son papier, était jetée négligemment entre la bouteille de vin et la carafe.
L'orange était posée sur la boîte de camembert. "Une jolie nature morte", avait-il pensé. Et il était resté, un long moment, glacé, incapable de faire un mouvement, les mains pleines de
sueur.
- Il manque quelque chose, avait remarqué Lucienne. Voyons! Tu te déshabilles... Tu vas manger... tout seul... Tu n'as pas la radio... J'y suis! Tu
jettes un coup d'œil sur tes commandes de la journée. C'est normal!
- Mais je t'assure...
- Passe-moi ta serviette!
Elle avait éparpillé, sur un coin de la table, les feuilles dactylographiées dont l'en-tête représentait une ligne à lancer et une épuisette, croisées
comme des fleurets. Maison Blache et Lehuédé - 45, boulevard de Magenta - Paris. Il était à ce moment-là neuf heures vingt. Ravinel aurait pu dire minute par minute tout ce qu'ils avaient fait
depuis huit heures. D'abord, ils avaient inspecté la salle de bains, s'étaient assurés que tout fonctionnait bien, que rien ne risquait de clocher au dernier moment. Fernand aurait même voulu
remplir tout de suite la baignoire. Mais Lucienne s'y était opposée;
- Réfléchis donc. Elle va vouloir tout visiter. Elle se demandera pourquoi cette eau...
Ils avaient failli se disputer. Lucienne était de mauvaise humeur. En dépit de tout son sang-froid, on la sentait tendue,
inquiète.
- On dirait que tu ne la connais pas... Depuis cinq ans, mon pauvre Fernand.
Mais, justement, il n'était pas si sûr que cela de la connaître. Une femme! On la rencontre à l'heure des repas. On couche avec elle. On l'emmène au
cinéma., le dimanche. On économise pour acheter un petit pavillon, en banlieue. Bonjour Fernand! Bonsoir Mireille! Elle a des lèvres fraîches et de minuscules taches de rousseur, au coin du nez.
On ne les voit qu'en l'embrassant. Elle ne pèse pas bien lourd dans les bras, Mireille. Maigrichonne, mais robuste, nerveuse. Une
gentille petite femme, insignifiante. Pourquoi l'a-t-il épousée? Est-ce qu'on sait pourquoi on se marie? L'âge qui vient. On a trente-trois ans. On est las des hôtels, des gargotes et des prix
fixes. Ce n'est pas drôle d'être représentant de commerce. Quatre jours sur la route. On est content de retrouver, le samedi, la
petite maison d'Enghien, et Mireille, souriante, qui fait de la couture dans la cuisine. Onze pas de la porte à la fenêtre. Les hublots du Smoelen, trois disques dorés, qui descendaient peu à
peu, parce que la marée baissait. Venant de Chantenay, un train de marchandises défila lentement. Les roues grinçaient sur un contre-raíl, les toits des wagons glissaient d'un mouvement doux,
passaient sous le sémaphore, dans un halo de pluie. Un vieux wagon allemand, à vigie, s'éloigna le dernier, un feu rouge accroché au-dessus des tampons. La musique du phonographe redevint
perceptible. A neuf heures moins le quart, ils avaient bu
un petit verre de cognac, pour se redonner du courage. Ravinel, ensuite, s'était déchaussé, avait endossé sa vieille robe de
chambre...."






"Les Diaboliques", un film de Henri-Georges Clouzot (1955), avec Simone Signoret, Paul Meurisse, Vera Clouzot. Dans un pensionnat tenu par le despotique et cruel Paul Meurisse (Michel Delasalle), sa femme cardiaque, Christina Delasalle (Véra Clouzot,) et sa superbe maîtresse, Nicole Horner (Simone Signoret) s'allient pour l'assassiner... L'apparition de son "fantôme" aura raison de la vie de sa femme. Mais le commissaire (Charles Vanel) élucidera la terrible machination. Michel Serrault, Noël Roquevert et Pierre Larquey complètent la distribution d'un suspense parfaitement maîtrisé par Henri-Georges Clouzot...

















"Sueurs froides" (1954)
Connu sous les titres de 'Sueurs froides" ou 'D'entre les morts", le roman inspira l'un des chefs d'oeuvres d'Alfred Hitchcock sorti en 1958, avec James
Stewart et Kim Novak. Ancien inspecteur de police, Flavières ne peut que confirmer toutes les craintes de son ami Gévigne au sujet de sa jeune épouse Madeleine qui se comporte de façon étrange.
Flavières va progressivement s'attacher à chacun de ses pas jusqu'à l'obsession, jusqu'à la tragédie,..
