- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite

Afrique & décolonisation - Chinua Achébé (1930-2013), "Le Monde s'effondre" (1958), "La Flèche de Dieu" (Arrow of God, 1964), "Les Termitières de la savane" (1987, Anthills of the Savannah) - Ngũgĩ wa Thiong'o (1938), "La Rivière de la vie" (The River Between, 1965), "Et le blé jaillira" (A Grain of Wheat, 1967) - Ahmadou Kourouma (1927-2003), "Les Soleils des indépendances" (1968) - Wole Soyinka (1934), "A Dance of the Forests" (1963), "The Interpreters" (1965), "Chroniques du pays des gens les plus heureux du monde" (2021) - Amos Tutuola (1920-1997), "The Palm-Wine Drinkard and his dead Palm-Wine Tapster in the Deads’ Town" (1953) - ....
Last update: 2023/02/02

L'Afrique moderne est née entre 1955 et 1965, - en fait elle existait déjà dans nombre d'africains qui avait su se frayer un chemin à l'ombre de cette culture occidentale qu'il leur était demandé d'intégrer avant d'être écouté - plus de 23 Etats connaissent alors l'indépendance, mais ces nouvelles nations n'étaient pas définies par leurs ethnies (il est vrai plus de 3000 pour la totalité de l'Afrique), mais par le hasard de l'occupation coloniale, d'où les nombreuses et tragiques tensions internes qui suivront l'indépendance. Et l'unité africaine souhaitée par presque tous les Etats du continent se révèle en pratique, difficile à réaliser....
Les idéologies occidentales dominantes avaient relégué les Africains au statut de forces rebelles au pouvoir colonial, lui-même souvent considéré de droit divin. Pendant la période des luttes pour l'indépendance, et notamment une fois celle-ci acquise, les écrivains africains commencèrent à rééquilibrer les choses en présentant leurs peuples comme les victimes de l'agression colonialiste et en (re)découvrant leurs histoires et cultures locales comme moyen de revendiquer une identité propre prévalant sur celle imposée par l'autorité coloniale. Une grande partie a pu être ainsi visiblement préservée - notamment via l'anglais et le français en tant que langues dominantes du discours post-colonial - et le mélange, proche de la synthèse positive, des institutions et des cultures a donné naissance à certains des plus beaux exemples de littérature non européenne.
Nombre de théories et de polémiques, qui ont servi de justification et de motivation à des écrivains, ont alimenté les écrits post-coloniaux; ce domaine sembla en effet parfois crouler sous les théories.
Certains d'entre eux se sont avérés extrêmement influents, en tout premier lieu les écrivains français de la "négritude", Frantz Fanon (1925-1961) et Edward Said (1935-2003). La "négritude" est le fruit des idées et des écrits d'un groupe d'intellectuels franco-africains, dont notamment le Martiniquais Aimé Césaire (1913-2008), Léopold Sédar Senghor (1906-2001), qui fut président de la République indépendante du Sénégal, et Léon Damas (19l2-1978), de Guinée française.
Leur vision d'une culture "pan-noire" (panafricaine) coupée de la culture occidentale fut instrumentalisée dans les milieux racistes hostiles et fournit une base théorique aux prémices des troubles anticoloniaux. Les écrits de Fanon en font une exploration encore plus poussée, avec notamment "Peau noire, masques blancs" (1952) et "Les Damnés de la terre" (1961), deux ouvrages qui exercèrent une très grande influence sur le mouvement anticolonial en Afrique, Dans sa célèbre œuvre, "Orientalism" (1978), l'écrivain palestinien Edward Saïd fait un examen minutieux de la théorie postcoloniale sur la relation de l'Occident avec le Moyen-Orient et l'Asie du Sud.
Fortement influencés par le mouvement de la négritude, les écrivains africains noirs commencèrent à émerger dans les années 1950 et, avec la publication de "Things Fall Apart" (Le Monde s'effondre, 1958), de l'écrivain nigérien Chinua Achebe, leur littérature perça sur la scène internationale.
Son compatriote poète et dramaturge Wole Soyinka (1934) fut, en 1986, le premier Africain à obtenir le prix Nobel de Littérature. Achebe et Soyinka écrivaient tous deux en anglais, mais des voix se firent bientôt pressantes pour demander l'abandon de la langue des puissances coloniales au profit des langues locales, Le plus éminent écrivain à adopter cette attitude fut le Kénian Ngugi wa Thiong'o (1938) qui écrivit uniquement en kikuvu (Weep Not, Child, 1964, Petals of Blood, 1977, Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, 1986) ....

Chinua Achebe (1930-2013)
Né à Ogidi, au Nigeria, Achebe a étudié à Londres avant de travailler, dès 1954, à la radio nigériane comme producteur puis directeur régional. Directeur des éditions Citadel Books à Enugu, il a fondé et dirigé de 1962 à 1972 la célèbre collection Écrivains africains aux éditions Heinemann. Il fut particulièrement actif pendant la guerre civile et se rendra aux États-Unis en 1969 pour recueillir des appuis pour le Biafra, tout en poursuivant une carrière universitaire commencée à Nsukka (Nigeria) en 1967. Il devient avec "Things Fall Apart" (1958 ; Le monde s'effondre, 1966) l'un des plus grands romanciers africains : il y relate la tragique histoire d'Okwonkwo, chef tribal biafrais qui, en dépit d'un code de conduite plus souple que les préceptes des missionnaires britanniques, ne sait pas leur résister et s'adapte aux valeurs qu'ils introduisent dans la société traditionnelle. Il reprendra le même thème avec "No Longer at Ease" (1960 ; Le Malaise, 1978) dans lequel, pendant les années 1950, le personnage principal, Obi, ne parvient pas à concilier son éducation morale traditionnelle et les leçons apprises en Europe : il sombrera dans la corruption. "Arrow of God" (1964 ; La Flèche de Dieu, 1978) conte sur un mode plus tragique le dilemme du grand-prêtre Ezeulu face aux désordres engendrés par l'administration coloniale du capitaine Winterbottom. Son quatrième et cinquième romans s'attacheront à peindre les effets de la corruption : "A Man of the People" (1966 ; Le Démagogue, 1977), "Anthils of the Savanah (1987, Les Termitières de la savane). Achebe excelle d'autre part dans le genre de la nouvelle: "The Sacrificial Egg and Other Stories" (1962 ; « L'Œuf du sacrifice et autres nouvelles »), "Girls at War" (1972 ; Femmes en guerre, 1981) et "African Short Stories" (1984). Ses poèmes sont réunis dans "Christmas in Biafra" (1973 ; « Noël au Biafra »)....

LE MONDE S'EFFONDRE (1958, Things Fall Apart)
Oeuvre célèbre qui a été tiré à plus de deux millions d'exemplaires et traduit en trente langues, conçue dans une intention nettement militante. Il s'agit d' "Aider mes compatriotes à retrouver foi en eux-mêmes et à se débarrasser des complexes accumulés pendant des années de dénigrement et d`humiliation". Les cent premières pages de ce court récit (qui se situe dans un village ibo à la fin du siècle dernier) présentent la société traditionnelle sous un éclairage avantageux et dressent un inventaire chaleureux de la vie rurale avec son cycle de fêtes, de labeurs et de cérémonies rituelles. Et pour répondre à l`accusation d`anarchie proférée par les colonisateurs, Achebe examine la société de ses ancêtres en ses structures profondes et en souligne le caractère à la fois agricole et religieux. On objectera que le romancier sc complaît à décrire cet univers fait de gravité joyeuse, de disponibilité émouvante et de rigueur raisonneuse, mais il n`en demeure pas moins conscient de la fragilité de ces microcosmes clos. Nombre de personnages du roman se sentent dangereusement coupés du monde extérieur et commencent à s'insurger contre certaines coutumes cruelles comme l'abandon des jumeaux dans la forêt. Lorsque le colonisateur arrive dans cette communauté figée dans ses certitudes, il lui suffit d`exploiter les faiblesses du système. En une série d`épisodes ironiquement tragiques, Achebe montre alors comment les missionnaires vont voir venir vers eux les exclus de l`organisation sociale ancestrale ou comment les administrateurs vont aisément convaincre chacun de l`importance de l`éducation et du commerce. La victoire de l`homme blanc sera donc quasi totale au terme de cette confrontation inégale que l`auteur décrit le plus équitablement possible, démontrant, en particulier. que l'hypocrisie des Européens n'avait d'égale que la naïveté des Africains.
Le héros du livre est ainsi un jeune homme valeureux qui tente de s`opposer au changement mais finit par se suicider, désavoué par tous. Le choix de ce protagoniste permet à Achebe de donner à son récit une ambiguïté particulièrement intéressante. D`un côté, en soulignant l'excessive intransigeance de cet homme qui "lutte et échoue seul", le romancier s`interdit d'en faire un porte-parole crédible de sa communauté (et de l`auteur); mais, d`autre part, en organisant le début de son récit autour de la réussite de ce fermier prospère, l'écrivain se permet d`utiliser pleinement son protagoniste pour célébrer la symbiose de l`individu traditionnel avec son environnement. Africanisant son texte anglais par une utilisation fervente mais contrôlée des modes d`expression vernaculaires (comme les proverbes ou les contes), Achebe fait alors la démonstration des effets heureux de sa double appartenance culturelle et, avec ce texte très maîtrisé. prouve que le recours à une langue d'emprunt, loin d'être sclérosant, peut, au contraire, permettre de remonter aux sources de l`expression ancestrale (Trad. Présence africaine, 1973).
"L'arrivée des missionnaires avait causé une émotion considérable au village de Mbanta. Ils étaient six, dont un Blanc. Hommes et femmes, tout le monde sortit pour voir le Blanc. Il courait toutes sortes d'histoires sur ces hommes étranges depuis que l'un dieux avait été tué et son cheval de fer attaché au kapokier sacré à Abame. Tout le monde était donc dehors pour voir le Blanc. C'était l'époque de l'année où on restait chez soi. La récolte était passée.
Quand les gens furent tous rassemblés, le Blanc leur parla. Il avait un interprète, un Ibo, bien que son dialecte soit différent et désagréable aux oreilles de Mbanta. Beaucoup se moquaient de ce dialecte et de l'usage bizarre que cet homme faisait des mots. Au lieu, par exemple, de dire “moi-même” il disait toujours “mes fesses”. Mais l'homme en imposait par sa présence, et les membres du clan l'écoutaient. Il leur déclara qu'ii était l'un d'entre eux, comme ils pouvaient le voir à sa couleur et à son langage. Les autres Noirs étaient aussi leurs frères, bien que l'un d'eux ne parle pas l'ibo. Le Blanc aussi était leur frère puisqu'ils étaient tous les fils de Dieu. Et de leur parler de ce nouveau Dieu, le Créateur du monde et de tous les hommes et de toutes les femmes. Il leur dit qu'ils avaient jusqu'ici adoré de faux dieux, des dieux de bois et de pierre. Un profond murmure parcourut la foule à ces mots. Il leur dit que le vrai Dieu vivait au ciel et que tous les hommes, quand ils mouraient, se présentaient devant Lui pour être jugés. Ceux qui étaient mauvais et tous les païens qui, dans leur aveuglement, se prosternaient devant du bois ou de la pierre étaient précipités dans un feu qui brûlait comme de l'huile de palme. Mais les bons qui adoraient le vrai Dieu entraient pour toujours dans Son royaume.
- Ce grand Dieu nous a envoyés vous demander de renoncer à vos erreurs et à vos faux dieux pour vous tourner vers Lui afin d'être sauvés quand vous mourrez!
- Tes fesses comprennent notre langue! lança gaiement quelqu'un, provoquant l'éclat de rire de la foule.
- Qu'est-ce qu'il dit? demanda le Blanc à son interprète.
Mais, sans lui laisser le temps de répondre, un autre homme demanda :
- Où est passé le cheval du Blanc?
Les évangélisateurs ibos se concertèrent et conclurent que cet homme parlait sans doute d'une bicyclette. Ils en firent part au Blanc, qui sourit avec bienveillance :
- Dites-leur que j'apporterai beaucoup d'autres chevaux de fer quand je serai installé parmi eux. Certains pourront même les monter.
Ces paroles furent aussitôt traduites, mais très peu les entendirent. Ils discutaient entre eux avec animation car le Blanc avait parlé de s'installer parmi eux. Ils n'avaient pas pensé à ça.
Un vieil homme avait une question à poser :
- C'est qui, au juste, ton dieu? La déesse de la Terre, le dieu du Ciel, Amadiora, le tonnerre, ou quoi?
L'interprète dit quelques mots au Blanc et la réponse fut immédiate :
- Tous les dieux que tu viens de nommer ne sont absolument pas des dieux. Ce sont des dieux trompeurs qui vous poussent à tuer vos semblables et des enfants innocents. Il n'y a qu'un vrai Dieu et Il règne sur la terre comme au ciel, sur vous, sur moi et sur nous tous.
- Si nous abandonnons nos dieux pour suivre le tien, demanda un autre homme, qui nous protégera de la colère de ceux que nous aurons abandonnés, et de nos ancêtres?
- Vos dieux ne sont pas vivants et ne peuvent pas vous faire de mal, répondit le Blanc. Ce ne sont que des pierres et des morceaux de bois.
En entendant l'interprète traduire ces paroles, les gens de Mbanta éclatèrent d'un rire moqueur. Ces hommes devaient être fous, se dirent-ils. Comment, sinon, pouvaient-ils dire qu'Ani et Amadiora étaient inoffensifs? Et Idemili et Ogwugwu aussi?
Quelques-uns commencèrent à partir.
Les missionnaires, alors, se mirent à chanter. C'était l'un de ces chants joyeux et bien rythmés des évangélistes, qui avaient le pouvoir de faire vibrer à nouveau certaines cordes silencieuses engourdies dans le cœur de l'Ibo. L'interprète expliquait chaque verset à l'auditoire. Une partie de celui-ci restait saisie et ne s'agitait plus. C'était l'histoire de frères qui vivaient dans les ténèbres, la crainte et l'ignorance de l'amour de Dieu. Il était question d'une brebis égarée dans la montagne, loin des portes du paradis et du berger qui lui prodiguait ses soins et son amour.
Après le chant, l'interprète parla du Fils de Dieu qui avait pour nom Jesu Kristi. Okonkwo, qui n'était resté là que dans l'espoir qu'on finirait par chasser ces hommes hors du village ou par les exterminer, prit la parole :
-- Tu nous as dit toi-même qu'il n'y avait qu'un seul dieu. Maintenant tu nous parles de son fils. Il doit donc avoir une épouse?
Murmures d'approbation dans la foule.
- Je n›ai pas dit qu'Il avait une femme, répliqua l'interprète, un peu gêné.
- Tes fesses ont dit qu'il avait un fils, lança un plaisantin. Il doit donc avoir une femme et ils doivent tous avoir des fesses!
Ignorant la remarque, le missionnaire se lança dans un discours sur la Sainte-Trinité. À la fin, Okonkwo était pleinement convaincu que l'homme était fou. Il haussa les épaules et s'en alla tirer son vin de palme pour l'après-midi.
Mais un garçon avait été captivé. Il s'appelait Nwoye et c'était le fils aîné d'OkonkWo. Ce qui le captivait n'était pas la logique délirante de la Sainte-Trinité, à laquelle il ne comprenait rien. Mais la dimension poétique de la nouvelle religion le touchait au plus profond de lui-même. L'hymne sur les frères qui vivaient dans les ténèbres et la crainte semblait répondre aux interrogations confuses qui hantaient sa jeune âme - la question des jumeaux pleurant dans la forêt et celle du meurtre d'Ikemefuna. Il avait éprouvé une sorte de soulagement en
entendant cet hymne qui avait apaisé son âme blessée. Les mots étaient comme des gouttes de pluie gelée fondant sur le palais desséché de la terre assoiffée. L'esprit simple de Nwoye n'en revenait pas.
"XVII - Les missionnaires passèrent leurs quatre ou cinq premières nuits sur la place du marché, en se rendant chaque matin au village pour prêcher l'Evangile. Ils demandèrent qui était le roi de ce village, mais les villageois leur répondirent qu'il n'avait as de roi. Nous avons des hommes hautement titrés et les chefs prêtres et les anciens, dirent-ils.
Il ne fut pas facile, après l'excitation du premier jour, de rassembler les hommes hautement titrés et les anciens. Mais les missionnaires ne se découragèrent pas et furent finalement reçus par ceux qui dirigeaient Mbanta. Ils demandèrent un terrain pour y bâtir leur église.
Tout clan, et tout village, avait sa "forêt maudite". On enterrait ceux qui mouraient de maladies vraiment mauvaises comme la lèpre ou la petite vérole. C'était aussi le dépotoir des puissants fétiches des grands hommes-médecine à la mort de ces derniers. Une “forêt maudite” était donc animée de puissances funestes et d'obscurs pouvoirs. C'est ce genre de forêt que les notables de Mbanta attribuèrent aux missionnaires. Comme ils ne tenaient pas vraiment à les avoir dans leur clan, ils leur firent cette offre, qu'aucun individu doué de bon sens n'aurait acceptée.
- Ils veulent un terrain pour leur sanctuaire, dit Uchendu à ses pairs quand ils se réunirent pour en discuter. Nous allons leur donner un terrain.
Il fit une pause et il y eut un murmure désapprobateur dans le groupe.
- Donnons-leur une partie de la Forêt Maudite. Ils se vantent d'être plus forts que la mort. Offrons-leur un champ de bataille pour le prouver.
Ils rirent et se déclarèrent d'accord, puis firent venir les missionnaires auxquels ils avaient demandé de les laisser un moment afin de pouvoir "chuchoter ensemble”. Ils leur offrirent de prendre une aussi grande portion de la Forêt Maudite qu'il leur plairait.
Et, à leur stupéfaction, les missionnaires les remercièrent et se mirent à chanter.
- Ils ne comprennent pas, dit l'un des anciens. Mais ils comprendront demain matin, une fois sur leur terrain.
Et le groupe se dispersa.
Le lendemain matin, ces fous commençaient bel et bien à défricher une partie de la forêt et entamaient la construction. Les habitants cle Mbanta s'attendaient à ce qu'ils soient tous morts en quatre jours.
Le premier jour passa, puis le deuxième, le troisième, le quatrième, et aucun ne mourut. Tout le monde était sidéré. On sut alors que les fétiches du Blanc avaient un pouvoir incroyable. On raconta qu'il avait sur les yeux des verres grâce auxquels il pouvait voir les esprits malfaisants et leur parler. C'est peu après qu'il conquit ses trois premiers convertis.
Bien qu'il ait ressenti dès le premier jour une attirance pour la nouvelle foi, Nwoye en garda le secret. Il n'osait pas s'approcher des missionnaires par crainte de son père. Mais chaque fois qu'ils venaient prêcher au village ou sur le terrain de jeu, Nwoye était là. Et il commençait déjà à connaître une partie des histoires simples qu'ils racontaient.
- Nous avons maintenant une véritable église, déclara M. Kiaga, l'interprète, qui était désormais chargé de la jeune congrégation.
Le Blanc était reparti à Umuofia, où il allait bâtir son quartier général et d'où il venait rendre de fréquentes visites à la congrégation de M. Kiaga à Mbanta.
- Nous avons maintenant une véritable église, déclara M. Kiaga, et je veux que vous veniez tous chaque septième jour pour célébrer le culte du vrai Dieu.
Le dimanche suivant, Nwoye passa et repassa devant le petit édifice de chaume et de terre rouge sans trouver le courage d'entrer. Il entendit chanter les voix, et bien qu'elles n'émanent que d'un petit groupe d'hommes, elles étaient fortes et confiantes.
L'église se trouvait dans une clairière circulaire qui semblait être la gueule ouverte de la Forêt Maudite. Attendait-elle le moment de refermer sa mâchoire?
Après être passé et repassé devant l'église, Nwoye rentra chez lui.
Les gens de Mbanta savaient bien que leurs dieux faisaient parfois preuve d'une grande patience et laissaient délibérément un homme les défier. Mais même dans ce cas, ces dieux fixaient leur limite à sept semaines de marché ou vingt-huit jours. Au-delà, ils ne souffraient d'aucun homme qu'il continue. C'est pourquoi l'excitation allait croissant au village à l'approche de la septième semaine après que les missionnaires eurent imprudemment bâti leur église en pleine Forêt Maudite. Les villageois étaient tellement certains de la malédiction qui allait s'abattre sur ces hommes qu'un ou deux convertis jugèrent plus sage de suspendre leur allégeance à la nouvelle foi.
Le jour arriva enfin où tous les missionnaires auraient dû être morts. Mais ils étaient toujours vivants, et s'activaient pour construire un nouveau bâtiment de terre rouge et de chaume où loger leur instructeur, M. Kiaga. Ils gagnèrent cette semaine-là une poignée de convertis. Et, pour la première fois, une femme. Elle se nommait Nneka et était l'épouse d'un fermier prospère, Amadi. Sa grossesse était bien avancée.
Nneka avait déjà eu quatre grossesses, toutes menées à terme, mais elle avait chaque fois accouché de jumeaux qui avaient tout de suite été abandonnés. Son mari et la famille de celui-ci multipliaient déjà les critiques à l'égard d'une telle femme et ne furent pas perturbés outre mesure en apprenant qu`elle était partie rejoindre les chrétiens. C'était un bon débarras. ..." (trad. Actes Sud).

"La Flèche de Dieu" (Arrow of God, 1964)
Chinua Achebe raconte comment, au Nigeria en 1921, Ezeulu, grand prêtre ibo âgé et polygame, s'évertue à s'adapter aux autorités coloniales blanches. Dans une amère comédie des méprises, la tentative d'un fonctionnaire anglais bien intentionné d'en faire un chef de village accrédité entraîne son humiliation aux mains d'un adjoint blanc et de son émissaire noir qui le traite de "sorcier". Ezeulu cherche par la suite à rabaisser son village en repoussant une moisson; les villageois se tournent alors vers la mission chrétienne qui les encourage à moissonner comme prévu, et Ezeulu se retire dans "la splendeur hautaine d'un grand prêtre dément". L'intrigue est subtile et à son portrait des complexités d'une société indigène en train d'évoluer, montrant combien les réactions aux difficultés du colonialisme sont très diverses. Si les colons anglais perturbent la culture indigène, ils mettent aussi fin aux guerres tribales, construisent écoles, routes et hôpitaux. L'auteur nous rappelle que l'impérialisme anglais, tout coupable qu'il fut, s'est montré plus constructif que la dynastie béninoise du XIXe siècle. Achebe écrit avec esprit et humour, avec un réalisme acéré et une compassion imaginative....
"... Arrow of God has ardent admirers as well as ardent detractors. To the latter nothing more need be said. To the others I can only express the hope that the changes I have made will meet with their approval. But in the nature of things there may well be some so steadfast in their original affection that they will see these changes as uncalled for or even unjustified. Perhaps changes are rarely called for or justified, and yet we keep making them. We should be ready at the very least to salute those who stand fast, the spiritual descendants of that magnificent man, Ezeulu, in the hope that they will forgive us. For had he been spared Ezeulu might have come to see his fate as perfectly consistent with his high historic destiny as victim, consecrating by his agony – thus raising to the stature of a ritual passage – the defection of his people. And he would gladly have forgiven them." (Chinua Achebe)
La Flèche de Dieu a des admirateurs ardents tout comme des détracteurs tout aussi ardents. Aux derniers, rien de plus ne doit être dit. Aux autres, je ne peux qu'exprimer l'espoir que les modifications que j'ai apportées recevront leur approbation. Mais, de par la nature des choses, il se peut bien que certains, si fermes dans leur affection originelle, considèrent ces changements comme superflus, voire injustifiés. Peut-être que les changements sont rarement nécessaires ou justifiés, et pourtant nous continuons à les faire. Nous devrions être prêts, à tout le moins, à saluer ceux qui tiennent bon, les descendants spirituels de cet homme magnifique, Ezeulu, dans l'espoir qu'ils nous pardonneront. Car s'il avait été épargné, Ezeulu aurait pu finir par voir son destin comme parfaitement cohérent avec sa haute destinée historique de victime, consacrant par son agonie – élevant ainsi au statut d'un passage rituel – la défection de son peuple. Et il les aurait volontiers pardonné.
Chapter One
"This was the third nightfall since he began to look for signs of the new moon. He knew it would come today but he always began his watch three days early because he must not take a risk. In this season of the year his task was not too difficult; he did not have to peer and search the sky as he might do when the rains came. Then the new moon sometimes hid itself for days behind rain clouds so that when it finally came out it was already halfgrown. And while it played its game the Chief Priest sat up every evening waiting.
His obi was built differently from other men’s huts. There was the usual, long threshold in front but also a shorter one on the right as you entered. The eaves on this additional entrance were cut back so that sitting on the floor Ezeulu could watch that part of the sky where the moon had its door. It was getting darker and he constantly blinked to clear his eyes of the water that formed from gazing so intently.
Ezeulu did not like to think that his sight was no longer as good as it used to be and that some day he would have to rely on someone else’s eyes as his grandfather had done when his sight failed. Of course he had lived to such a great age that his blindness became like an ornament on him. If Ezeulu lived to be so old he too would accept such a loss. But for the present he was as good as any young man, or better because young men were no longer what they used to be. There was one game Ezeulu never tired of playing on them. Whenever they shook hands with him he tensed his arm and put all his power into the grip, and being unprepared for it they winced and recoiled with pain.
The moon he saw that day was as thin as an orphan fed grudgingly by a cruel foster-mother. He peered more closely to make sure he was not deceived by a feather of cloud. At the same time he reached nervously for his ogene. It was the same at every new moon. He was now an old man but the fear of the new moon which he felt as a little boy still hovered round him. It was true that when he became Chief Priest of Ulu the fear was often overpowered by the joy of his high office; but it was not killed. It lay on the ground in the grip of the joy.
He beat his ogene GOME GOME GOME GOME… and immediately children’s voices took up the news on all sides. Onwa atuo!… onwa atuo!… onwa atuo!… He put the stick back into the iron gong and leaned it on the wall.
The little children in his compound joined the rest in welcoming the moon. Obiageli’s tiny voice stood out like a small ogene among drums and flutes. He could also make out the voice of his youngest son, Nwafo. The women too were in the open, talking.
‘Moon,’ said the senior wife, Matefi, ‘may your face meeting mine bring good fortune.’
‘Where is it?’ asked Ugoye, the younger wife. ‘I don’t see it. Or am I blind?’
‘Don’t you see beyond the top of the ukwa tree? Not there. Follow my finger.’
‘Oho, I see it. Moon, may your face meeting mine bring good fortune. But how is it sitting? I don’t like its posture.’
‘Why?’ asked Matefi.
‘I think it sits awkwardly – like an evil moon.’
‘No,’ said Matefi. ‘A bad moon does not leave anyone in doubt. Like the one under which Okuata died. Its legs were up in the air.’
‘Does the moon kill people?’ asked Obiageli, tugging at her mother’s cloth.
‘What have I done to this child? Do you want to strip me naked?’
‘I said does the moon kill people?’
‘It kills little girls,’ said Nwafo, her brother.
‘I did not ask you, ant-hill nose.’
‘You will soon cry, long throat.’
The moon kills little boys
The moon kills ant-hill nose
The moon kills little boys… Obiageli turned everything into a song."
C’était le troisième crépuscule depuis qu’il avait commencé à guetter les signes de la nouvelle lune. Il savait qu’elle apparaîtrait aujourd’hui, mais il commençait toujours sa veille trois jours à l’avance, car il ne devait prendre aucun risque. En cette saison, sa tâche n’était pas trop difficile ; il n’avait pas à scruter et fouiller le ciel comme il était parfois obligé de le faire quand venaient les pluies. Alors, la nouvelle lune se cachait parfois pendant des jours derrière les nuages de pluie, de sorte que lorsqu’elle finissait par apparaître, elle était déjà à demi-formée. Et pendant qu’elle jouait à ce jeu, le Chef Prêtre restait assis chaque soir à l’attendre.
Son obi était construit différemment des autres huttes. Il y avait le seuil long et habituel à l’avant, mais aussi un plus court sur la droite en entrant. Les avant-toits de cette entrée supplémentaire étaient taillés de telle sorte qu’assis sur le sol, Ezeulu pouvait observer la partie du ciel où la lune avait sa porte. L’obscurité gagnait, et il clignait constamment des yeux pour les débarrasser de l’eau qui s’y formait à force de fixer si intensément.
Ezeulu n’aimait pas penser que sa vue n’était plus aussi perçante qu’autrefois et qu’un jour, il devrait s’en remettre aux yeux d’un autre, comme son grand-père l’avait fait lorsque sa vue avait faibli. Bien sûr, celui-ci avait vécu jusqu’à un âge si avancé que sa cécité était devenue comme un ornement pour lui. Si Ezeulle vivait aussi vieux, il accepterait lui aussi une telle perte. Mais pour l’heure, il valait n’importe quel jeune homme, voire mieux, car les jeunes hommes n’étaient plus ce qu’ils étaient. Il y avait un jeu qu’Ezeulu ne se lassait pas de leur jouer. Chaque fois qu’ils lui serraient la main, il tendait son bras et mettait toute sa force dans l’étreinte, et, n’y étant pas préparés, ils grimçaient et se retiraient avec douleur.
La lune qu’il vit ce jour-là était aussi mince qu’un orphelin nourri à contrecoeur par une marâtre cruelle. Il plissa les yeux pour s’assurer qu’il n’était pas trompé par une plume de nuage. En même temps, il attrapa nerveusement son ogene. C’était la même chose à chaque nouvelle lune. Il était maintenant un vieil homme, mais la crainte de la nouvelle lune qu’il éprouvait petit garçon planait encore autour de lui. Il était vrai que lorsqu’il était devenu le Grand Prêtre d’Ulu, cette crainte était souvent dominée par la joie de sa haute fonction ; mais elle n’était pas morte. Elle gisait à terre, tenue en respect par la joie.
Il battit son ogene : GOME GOME GOME GOME… et immédiatement, des voix d’enfants reprirent la nouvelle de tous les côtés. Onwa atuo !… onwa atuo !… onwa atuo !… Il remit le bâton dans le gong de fer et l’appuya contre le mur.
Les petits enfants de sa concession se joignirent aux autres pour souhaiter la bienvenue à la lune. La petite voix d’Obiageli se détachait comme un petit ogene parmi les tambours et les flûtes. Il pouvait aussi distinguer la voix de son plus jeune fils, Nwafo. Les femmes aussi étaient dehors, à bavarder.
« Lune, dit l’épouse senior, Matefi, puisse ta face rencontrant la mienne apporter bonne fortune. »
« Où est-elle ? demanda Ugoye, la femme plus jeune. Je ne la vois pas. Suis-je aveugle ? »
« Ne vois-tu pas au-delà de la cime de l’arbre ukwa ? Pas là. Suis mon doigt. »
« Oho, je la vois. Lune, puisse ta face rencontrant la mienne apporter bonne fortune. Mais comment est-elle assise ? Je n’aime pas sa posture. »
« Pourquoi ? » demanda Matefi.
« Je trouve qu’elle est assise bizarrement – comme une lune maléfique. »
« Non, dit Matefi. Une mauvaise lune ne laisse planer aucun doute. Comme celle sous laquelle Okuata est morte. Ses jambes étaient en l’air. »
« Est-ce que la lune tue les gens ? » demanda Obiageli, tirant sur le pagne de sa mère.
« Qu’est-ce que j’ai fait à cet enfant ? Veux-tu me mettre toute nue ? »
« J’ai dit : est-ce que la lune tue les gens ? »
« Elle tue les petites filles », dit Nwafo, son frère.
« Je ne t’ai pas parlé, nez de termitière. »
« Tu vas bientôt pleurer, grande goinfre. »
La lune tue les petits garçons
La lune tue le nez de termitière
La lune tue les petits garçons… Obiageli mettait tout en chanson.
"Ezeulu went into his barn and took down one yam from the bamboo platform built specially for the twelve sacred yams. There were eight left. He knew there would be eight; nevertheless he counted them carefully. He had already eaten three and had the fourth in his hand. He checked the remaining ones again and went back to his obi, shutting the door of the barn carefully after him.
His log fire was smouldering. He reached for a few sticks of firewood stacked in the corner, set them carefully on the fire and placed the yam, like a sacrifice, on top.
As he waited for it to roast he planned the coming event in his mind. It was Oye. Tomorrow would be Afo and the next day Nkwo, the day of the great market. The festival of the Pumpkin Leaves would fall on the third Nkwo from that day. Tomorrow he would send for his assistants and tell them to announce the day to the six villages of Umuaro.
Whenever Ezeulu considered the immensity of his power over the year and the crops and, therefore, over the people he wondered if it was real. It was true he named the day for the feast of the Pumpkin Leaves and for the New Yam feast; but he did not choose it. He was merely a watchman. His power was no more than the power of a child over a goat that was said to be his. As long as the goat was alive it could be his; he would find it food and take care of it. But the day it was slaughtered he would know soon enough who the real owner was. No! the Chief Priest of Ulu was more than that, must be more than that. If he should refuse to name the day there would be no festival – no planting and no reaping. But could he refuse? No Chief Priest had ever refused. So it could not be done. He would not dare.
Ezeulu was stung to anger by this as though his enemy had spoken it.
‘Take away that word dare,’ he replied to this enemy. ‘Yes I say take it away. No man in all Umuaro can stand up and say that I dare not. The woman who will bear the man who will say it has not been born yet.’
But this rebuke brought only momentary satisfaction. His mind never content with shallow satisfactions crept again to the brink of knowing. What kind of power was it if it would never be used? ..."
Ezeulu entra dans son grenier et descendit un igname de la plate-forme en bambou construite spécialement pour les douze ignames sacrés. Il en restait huit. Il savait qu’il y en aurait huit ; néanmoins, il les compta soigneusement. Il en avait déjà mangé trois et tenait le quatrième dans sa main. Il vérifia une nouvelle fois ceux qui restaient et retourna dans son obi, en refermant soigneusement la porte du grenier derrière lui.
Son feu de bûches couvait. Il attrapa quelques bûches empilées dans le coin, les disposa soigneusement sur le feu et plaça l’igname, tel un sacrifice, au sommet.
Tandis qu’il attendait qu’il rôtisse, il planifia l’événement à venir dans son esprit. On était Oye. Demain serait Afo et le jour suivant Nkwo, le jour du grand marché. Le festival des Feuilles de Citrouille tomberait le troisième Nkwo à partir de ce jour. Demain, il enverrait chercher ses assistants et leur dirait d'annoncer la date aux six villages d'Umuaro.
Chaque fois qu’Ezeulu considérait l’immensité de son pouvoir sur l’année et les récoltes, et donc sur le peuple, il se demandait s’il était réel. Il était vrai qu’il nommait le jour de la fête des Feuilles de Citrouille et celui de la fête de l’Igneuveau ; mais il ne le choisissait pas. Il n’était qu’un gardien. Son pouvoir n’était guère plus que celui d’un enfant sur une chèvre que l’on disait sienne. Tant que la chèvre était en vie, elle pouvait être à lui ; il lui trouverait de la nourriture et prendrait soin d’elle. Mais le jour où elle serait abattue, il saurait bien assez tôt qui en était le véritable propriétaire. Non ! Le Grand Prêtre d’Ulu était plus que cela, devait être plus que cela. S’il refusait de nommer le jour, il n’y aurait pas de festival – pas de plantation et pas de récolte. Mais pouvait-il refuser ? Aucun Grand Prêtre n’avait jamais refusé. Donc, cela ne pouvait pas se faire. Il n’oserait pas.
Ezeulu fut piqué au vif par cette pensée, comme si son ennemi l'avait prononcée.
« Retire ce mot oser », répondit-il à cet ennemi. « Oui, je te dis de le retirer. Aucun homme dans tout Umuaro ne peut se lever et dire que je n’ose pas. La femme qui mettra au monde l’homme qui le dira n’est pas encore née. »
Mais cette réprimande n’apporta qu’une satisfaction momentanée. Son esprit, jamais content des satisfactions superficielles, rampa à nouveau au bord de la connaissance. Quel genre de pouvoir était-ce s’il ne devait jamais être utilisé ? ..."
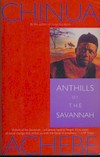
LES TERMITIÈRES DE LA SAVANE (1987, Anthills of the Savannah)
Après plus de vingt ans de silence. l'auteur du "Monde s 'effondre" complète avec ce dernier récit, la fresque historique du Nigéria qu`il brosse depuis plus de trente ans. Fidèle à son thème premier, le POUVOIR, le romancier en, étudie le dernier avatar africain : le coup d`Etat militaire.
Dans ce livre qui se déroule dans un "Etat africain arriéré". un jeune commandant en chef de l`armée se retrouve soudain à la tête de la nation : il n`a reçu aucune préparation pour ce rôle de chef politique et l`exercice des fonctions suprêmes le terrifie d`abord, puis l`amuse et enfin le dévore. Cet homme "pas très intelligent mais pas méchant" s`entoure d`un cirque de flagorneurs qui font mine de croire à ses rodomontades et cette atmosphère de paranoïa soupçonneuse ne serait que ridicule si elle n`était pas dangereuse et si elle n`engendrait pas, en fait, un regime de terreur que le despote dirige avec une "jubilation tranquille". A la fin du livre, le tyran tombe sous les remarques goguenardes du peuple : "On va faire un autre président : ça, c'est pas difficile" mais un autre colonel apparaît et le cycle infernal des corruptions, des manipulations et des répressions reprend, semble-t-il, à jamais.
Au-delà de cette description classique de la vie brève et sanglante d'un de ces innombrables "guides providentiels" qui surgissent périodiquement en Afrique, Achebe s`attache à décrire les effets pervers de ces prises de pouvoir illégitimes. Les premières victimes en sont les deux amis d'enfance du dictateur : lorsque celui-ci s'est vu offrir le pouvoir, il leur a, en effet, demandé de "tout faire pour que son entreprise soit un succès" et a nommé l'un rédacteur en chef du plus grand quotidien national et l`autre ministre de l'lnformation. Pour avoir ainsi facilité cette ascension imméritée, ces deux jeunes hommes, pourtant jeunes et brillants, sont lentement mais sûrement condamnés par Achebe. Tous les efforts généreux qu`ils feront pour se démarquer du régime de plus en plus totalitaire seront réduits à néant : l`un, après avoir prononcé un discours courageux devant les étudiants, se fera abattre d`une rafale dans le dos; l`autre. passé dans la clandestinité, mourra sous les balles d'un policier ivre. Avec la mort de ces opposants, la parole aurait pu rester au peuple mais celui-ci n'est pas épargné par la vindicte de l`écrivain.
Au yeux du romancier, ces "damnés de la terre" qui ne savent que quémander servilement ou rire de leurs humiliations méritent pleinement le mépris des puissants dans la mesure ou ils adhèrent, eux aussi, à la dialectique faussée qui s'est instaurée entre oppresseurs et opprimés : "Le coupable est celui qui souffre; celui qui souffre est le coupable".
La lueur d`espoir de ce livre sombre reste l'apanage de quelques individus fragiles ou obscurs qui sont investis d'un rôle essentiel : celui d'être la "mémoire meurtrie" de l`Afrique. La fin du récit est consacrée aux compagnes des deux amis disparus : l'une est une intellectuelle, l`autre est une illettrée mais toutes les deux tentent, à leur façon, de témoigner de l' " histoire aigrie" de leur pays. Eplorées mais fortes, elles jouent le même rôle que ces termitières qui donnent au roman son titre et qui. selon le message du livre, "survivent pour raconter à l`herbe nouvelle de la savane les feux de brousse de la dernière saison" (Trad. Belfond, 1987).
I - PREMIER TÉMOIN : CHRISTOPHER ORIKO
- Vous nous faites perdre notre temps, monsieur le Commissaire à l'Information. Je n'irai pas en Abazon. N'en parlons plus ! Kabisa! Autre chose ?
- Comme Votre Excellence voudra. Mais...
- Il n'y a pas de mais, monsieur Oriko ! L'affaire est entendue. Grand Dieu, combien de fois devrai-je le répéter ? Pourquoi faut-il que vous trouviez si difficile d'avaler mes ordres ?
- Je suis désolé, Excellence, mais je n'éprouve aucune difficulté à les avaler, ni même à les digérer.
Ses yeux furieux restèrent braqués sur moi pendant une bonne minute. Nos regards s'étaient brièvement affrontés, puis j'avais baissé le mien, et fixé la table étincelante en un geste de capitulation solennelle. Mais il n'était pas apaisé. Au contraire. Il laissait le silence s'épaissir comme pour un autre combat, un peu à la façon des enfants qui jouent à celui qui restera le plus longtemps sans ciller. De nouveau, je m'avouai vaincu et, sans lever les yeux, répétai : "Je suis vraiment désolé, Votre Excellence." Un an plus tôt, je n'y serais pas parvenu sans me faire violence. Maintenant ce n'était qu'une simple faveur de ma part. Cela ne me coûtait rien, ne me gênait en rien; mais pour lui, c'était infiniment important.
En y réfléchissant, cela m'a semblé un jeu commencé en toute innocence mais qui, brusquement, s'était changé en quelque chose d'étrange, d'empoisonné. Peut-être mon jugement était-il encore trop optimiste. Car, si je ne me trompe, à revoir les événements des deux dernières années, il devrait être possible de désigner un fait précis, décisif, et de dire: c'est à tel endroit que tout a changé, que les règles ont été suspendues. J 'ai eu beau chercher longtemps, obstinément, je n'ai rien trouvé de tel. Il me vient donc à l'esprit que jamais, en fait, il ne s'est agi d'un jeu, que la situation actuelle existait dès le départ, mais que j'étais alors trop aveugle, ou trop occupé, pour m'en apercevoir. La véritable question, cependant, que je me suis souvent posée, est de savoir pourquoi je continue maintenant que j'y vois clair. Je ne sais pas. Peut-être suis-je emporté par mon élan, à moins que ce ne soit simple curiosité : le désir de savoir comment tout... disons, finira. Ce n'est pas tellement à lui que je pense, mais à mes collègues, onze hommes intelligents, instruits, qui ont laissé faire, qui se sont même donné du mal pour que cela arrive et qui, jusqu'à présent, n'ont rien vu, rien appris, eux, l'élite de notre société, l'espoir de la race noire. Je suppose que c'est à cause d'eux que je reste ainsi stupidement à ce aposte d'observation, à noter des détails grotesques dans le délirant livre de bord du navire de l'État. Mon désenchantement à leur égard s'est depuis longtemps changé en intérêt clinique et détaché.
Je trouve leurs actes non seulement supportables mais vraiment intéressants, voire fascinants. C'est à n'y pas croire la Quand je pense que c'est moi qui ai recommandé près de la moitié d'entre eux et qui les ai fait nommer!
Et bien sûr, pour être très honnête, je dois mentionner une dernière raison, dont j'éprouve d'ailleurs quelque honte : je ne pourrais écrire tout cela si je ne restais pas ici pour observer. Et personne d'autre non plus.
Nous demeurions assis, raides, autour de la table d'acajou, et je pouvais lire dans leur esprit frappé de mutisme des paroles du genre: Ça y est, nous allons encore avoir une de ces journées... Mauvaise, à l'évidence. Elles sont bonnes ou mauvaises pour nous, selon que Son Excellence s'est levée, du pied droit ou du pied gauche. Lorsqu'elles sont mauvaises, et celle-ci l'était brusquement devenue, après de nombreux présages favorables, il n'y a plus qu'à gagner les abords de son trou, tout prêt à s'y jeter. Il n'y, a plus qu'à fermer la bouche, surtout, car rien n'est plus sans danger, pas même les flatteries que nous savons, avec tant d'adresse, faire passer pour des discussions.
A ma droite était assis l'Honorable Commissaire à l'Éducation. C'est de loin le plus terrorisé de la bande. Dès qu'il avait flairé le danger, il avait commencé à se glisser dans son trou, à reculons, comme font certains animaux et certains insectes. Instinctivement, il avait rassemblé ses papiers, et sa main soulevait la couverture de son classeur pour le refermer avant de le tirer vers lui. Mais il se pétrifia soudain. Peut-être une alarme plus forte, surgie des profondeurs de son instinct, l'avait-elle averti que ce qu'il se préparait à accomplir revenait à claquer la porte au nez de Son Excellence. Il se produisit alors une chose invraisemblable. Voilà qu'il laisse retomber la couverture avec tant. de panique que tous se tournent vers lui pour le voir exécuter un geste des plus étranges : épouvanté, il éparpille de nouveau les documents du Conseil, en un acte d'expiation et de réparation pour le sacrilège qu'il a failli commettre. Par inadvertance. Puis il jette un coup d' œil circulaire et son regard, rencontrant celui de Son Excellence, s'abaisse brutalement sur l'acajou. Le silence n'avait pas été rompu depuis mes nouvelles excuses. J'étais sûr que ce pauvre type, qui n'avait jamais été très fort sur le chapitre de l'originalité, se préparait à répéter mes propres paroles, exactement dans le même ordre. Je l'aurais juré. Il avait serré les bras contre son corps comme pour paraître plus maigre, et joint les mains devant lui tel un suppliant.
Mais ,c'est Son Excellence qui parle. Sans s'adresser à lui, d'ailleurs, mais à moi. Et, chose stupéfiante, sur un ton presque amical, conciliant. En cet instant, la journée change. Le soleil ardent se retire provisoirement derrière un nuage. C'est le sursis, et nous nous sentions déjà prêts à le fêter. J'entends déjà les nombreux compliments que nous lui ferons dès qu'elle aura le dos tourné, disant que l'ennui, avec Son Excellence, c'est qu'elle ne peut jamais blesser quelqu'un sans s'en excuser aussitôt. C'est un raffinement, soit dit en passant, que nous n'avons pas encore perdu: nous attendons qu'il ait effectivement le dos tourné. Et certains vont ajouter: "C'est dommage, car ce dont notre pays a vraiment besoin, c'est d'un dictateur impitoyable. Pendant cinq bonnes années au moins". Et nous allons tous rire, un peu trop bruyamment, sachant bien, dans notre innocence, que nous ne jouirons jamais d'un bonheur aussi immérité...."

Ngũgĩ wa Thiong'o (1938)
Né à Kamarithu (Kenya), fils d'un métayer dans le Kenya rural occupé par les Britanniques, ayant atteint sa majorité pendant la rébellion des Mau Mau, James Ngugi wa Thiong'o est un romancier majeur de l'Afrique de l'Est. Il fit ses études à Makerere University College, à Kampala. 1963 voit l'indépendance du Kenya : Daniel arap Moi est alors vice-président de Jomo Kenyatta. Ngũgĩ wa Thiongʼo publie en 1964 son premier roman, "Weep not Child" (Enfant, ne pleure pas, 1983), qui traite des conflits entre la tradition (ou Mau Mau) et l'école européenne et chrétienne aux débuts de la révolte des Mau-Mau. En 1965, "The River Between" présente l'histoire kikouyou aux prises avec le colonialisme à travers la rivalité de deux factions d'un même clan. "A Grain of Wheat", en 1967, explore, dans une perspective plus humaniste que politique, les sentiments et les intrigues amoureuses des héros et des traîtres pendant la guerre de libération. Nommé à l'université de Nairobi, il démissionne en 1969 pour protester contre les restrictions imposées aux libertés universitaires. Kenyatta pratique alors une politique autoritaire et clientéliste pour assurer l'unité nationale, et en 1978 Moi lui succède et durcit le régime. Lorsqu'il s' intéressera à la trahison du peuple kenyan par la nouvelle élite dirigeante, Ngũgĩ sera emprisonné sans procès et écrira le premier roman moderne en kikouyou, "Devil on the Cross", sur du papier toilette fourni par la prison. Après un recueil de nouvelles, "Secret Lives" (1975), la production romanesque de Ngugi wa Thiong'o culmine avec "Petals of Blood" (1977 ; Pétales de sang, 1985), une vaste fresque qui dénonce avec puissance la collusion des nouveaux dirigeants et du néo-colonialisme. Obligé de s'exiler, Ngũgĩ wa Thiongʼo vivra à partir de 1982 entre l'Angleterre et les États-Unis, publiant désormais romans et essais dans sa langue maternelle, le kikouyou. En 2004, Ngugi et sa femme choisissent de revenir au Kenya,le combat continue ..
Dans "Wizard of the Crow" (2006), qui se déroule dans la République libre fictive d'Aburĩria et qui met en scène un dictateur mégalomane connu uniquement sous le nom de Ruler, Ngũgĩ montre à quel point l'écrivain a su, bien qu'ayant été exilé de son pays natal pendant 22 ans, être totalement dépourvu de toute amertume, compatissant à l'égard des gens ordinaires et satirique à l'égard du souverain et de ses sbires. Il saisit toute l'évolution depuis le pillage et la violence du colonialisme jusqu'à la corruption des élites nationales du tiers-monde par les forces prédatrices du capitalisme mondial. Depuis la publication de "Wizard of the Crow", Ngugi a écrit trois volumes de mémoires, revenant sur les périodes qu'il a couvertes dans ses romans. Le premier, "Dreams in a Time of War", commence avec ses grands-parents à l'époque de la conférence de Berlin de 1885, lorsque les pays européens se sont partagé l'Afrique, puis raconte sa propre enfance de travailleur sans terre. Le deuxième volume, "In the House of the Interpreter", raconte ses années passées dans un pensionnat britannique près de Nairobi lorsque, pendant la rébellion des Mau Mau, la maison familiale a été rasée et son frère emprisonné dans un camp de concentration britannique. Le troisième volume, "Birth of a Dream", raconte ses quatre années passées à l'université de Makerere, en Ouganda, alors que le Kenya approchait de l'indépendance et que Ngugi commençait à écrire ses premières œuvres littéraires...
Ses essais critiques et littéraires, "Homecoming" (1972), ont été suivis de son journal de prison, "Detained" (1980). "Barrel of a Pen" (1983), et surtout "Decolonising the Mind"(1986) le voient affirmer que les Africains doivent écrire dans leur langue maternelle pour se libérer des chaînes mentales du colonialisme, position qui n'est pas sans risque et aurait pu avoir comme conséquence de le faire immédiatement disparaître de la scène du monde : "We of the elder generation are so bound up by our anti-colonial nationalism, which is important for us but the younger generation - they are free. You find they don’t confine their characters necessarily to Africa. They are quite happy to bring in characters from other races, and so on … that’s good because they are growing up in a multicultural world" (Nous, la génération des anciens sommes tellement liés par notre nationalisme anticolonial, qui est important pour nous, mais la jeune génération est libre. On constate qu'ils ne limitent pas nécessairement leurs personnages à l'Afrique. Ils sont tout à fait heureux d'introduire des personnages d'autres races, etc... c'est bien parce qu'ils grandissent dans un monde multiculturel, New African, 2013)
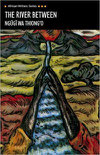
"La Rivière de la vie" (The River Between, 1965)
Deuxième roman de Ngugi qui lui apporta la reconnaissance comme l'un des grands écrivains africains. Une simple histoire d'amour située en période coloniale, un Roméo et Juliette africain où deux jeunes originaires de villages opposés tombent amoureux et tentent de transcender le fossé qui sépare leurs communautés, mais qui traite aussi de l'histoire précoloniale et coloniale du Kenya. Il montre l'infiltration lente mais continue du pays par les Britanniques, la façon dont les indigènes sont chassés de leurs terres, les effets négatifs de la mission chrétienne sur les structures de pouvoir locales, les rituels et les relations, mais aussi les rivalités profondes qui opposent les diverses factions africaines et précèdent la lutte anticolonialiste des années 1950. Au centre du livre, le débat sur l'excision qui en vient à symboliser la pureté culturelle et la résistance au colonialisme des Kikuyu à un point tel que l' "impureté" de la jeune héroïne, Nyambura, décide du sort du couple. Malgré ses conséquences si tragiques, l'excision est montrée comme un élément important de l'identité kenyane, un rituel essentiel face aux avancées du colonialisme, ce qui révèle bien toute la puissance dévastatrice du colonialisme ...
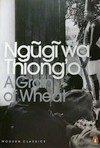
"ET LE BLÉ JAILLIRA" (A Grain of Wheat, 1967)
Roman de l`écrivain kenyan Ngugi wa Thiong`o (né en 1948), écrit en anglais, un roman ambitieux qui confronte les espoirs et les doutes du Kenya indépendant aux dix années douloureuses de la rébellion "Mau Mau" (1952) et de l`état d`urgence, telles que les vécurent les villageois ordinaires en pays kikuyu.
Les Kikuyus et les Kambas sont les principales populations bantoues qui habitent le Kenya, qui après avoir lutté contre les Massaï est devenu en 1895 protectorat britannique lorsque le sultan d’Oman a concédé les droits de la zone côtière à la British East Africa Company en 1887. Des milliers de colons européens vont alors s’installer, expulsant au passage les agriculteurs kikouyous, une époque qui inspirera la Danoise Karen Blixen en 1937 (Out of Africa). Le Kenya devient une colonie de la Couronne en 1920. Alors que la la Kikuyu Central Association, ébauche d'une organisation politique nationale à l'initiative d'intellectuels éduqués par les missionnaires protestants, débute un combat pour abolir les barrières raciales, ses membres réclament plus de terres cultivables et vont adhérer à une société secrète (Mau-Mau), ancrée sur le fonds culturel traditionnel et sur des pratiques de sorcellerie. En mai 1952, les Mau-Mau commencent à assassiner les Kikouyous qui ne les ont pas rejoint, puis des Européens, le 20 octobre 1952, l’État d’urgence est proclamé et des renforts militaires envoyés, fin 1955, la révolte est définitivement écrasée, la guerre s’achève officiellement en octobre 1956 avec la capture et la pendaison de Dedan Kimathi, le principal chef Mau-Mau. Le Kenya accède à une pleine indépendance le 12 décembre 1963, le leader kikouyou Jomo Kenyatta devient le chef du nouvel État...
S'interroger sur l'enchaînement des circonstances et des choix culturels qui entraînèrent tout un peuple dans un conflit qui prit parfois la forme d'une guerre civile pour tenter de faire ressortir les traces durables de cette période qui pèsent encore sur les choix du nouvel Etat kenyan. S'exprime la crainte que les groupes jadis privés de leurs terres par la colonisation ne soient dépossédés une seconde fois, et il trouve les germes de cette nouvelle forme d`exploitation dans le passé récent. La structure complexe du récit présente de façon symétrique les groupes de paysans et les colons européens, les rebelles et les loyalistes, met en parallèle les actions présentes et passées, contraste le statut héroïque et menaçant des guérilleros de la forêt et l`impuissance des villageois soumis au couvre-feu ou internés dans des camps de réhabilitation.
Le roman se construit autour de quatre personnages tour à tour lâches et héroïques, dont Karanja, fasciné par le pouvoir blanc, et qui fait régner l`ordre colonial dans les rangs des loyalistes et séduit Mumbi, la femme de son ami Gikonyo alors que celui-ci est détenu.
Gikonyo sera libéré de son camp au prix d`une lâcheté. Mugo, enfin. choisi par les villageois comme leur porte-parole à cause d`un acte héroïque, confesse publiquement, l`indépendance venue. que c'est lui qui a livré le général rebelle Kihaki. Le prophète se fait bouc émissaire et assume les fautes commises. mais aussi la responsabilité qui seule permettra de créer un pays neuf. Les héros, accablés de culpabilité et en quelque sorte fascinés par leur propre angoisse, sont proches de ceux de Conrad, - que Ngugi a beaucoup étudié. La vision pessimiste paraît en contradiction avec la dernière page d`un optimisme militant délibéré : la parole passe à nouveau dans le couple formé par Gikonyo et Mumbi, couple éponyme du couple fondateur kikuyu et la fertilité sera enfin possible, "le blé jaillira" après les souffrances...
"One - Mugo felt nervous. He was lying on his back and looking at the roof. Sooty locks hung from the fern and grass thatch and all pointed at his heart. A clear drop of water was delicately suspended above him. The drop fattened and grew dirtier as it absorbed grains of soot. Then it started drawing towards him. He tried to shut his eyes. They would not close. He tried to move his head: it was firmly chained to the bed-frame. The drop grew larger and larger as it drew closer and closer to his eyes. He wanted to cover his eyes with his palms; but his hands, his feet, everything refused to obey his will. In despair, Mugo gathered himself for a final heave and woke up. Now he lay under the blanket and remained unsettled fearing, as in the dream, that a drop of cold water would suddenly pierce his eyes. The blanket was hard and worn out; its bristles pricked his face, his neck, in fact all the unclothed parts of his body. He did not know whether to jump out or not; the bed was warm and the sun had not yet appeared. Dawn diffused through cracks in the wall into the hut. Mugo tried a game he always played whenever he had lost sleep in the middle of the night or early morning. In total, or hazy darkness most objects lose their edges, one shape merging with another. The game consisted in trying to make out the various objects in the room. This morning, however, Mugo found it difficult to concentrate. He knew that it was only a dream: yet he kept on chilling at the thought of a cold drop falling into his eyes. One, two, three; he pulled the blanket away from his body. He washed his face and lit the fire. In a corner, he discovered a small amount of maize-flour in a bag among the utensils. He put this in a sufuria on the fire, added water and stirred it with a wooden spoon. He liked porridge in the morning. But whenever he took it, he remembered the half-cooked porridge he ate in detention. How time drags, everything repeats itself, Mugo thought; the day ahead would be just like yesterday and the day before.
He took a jembe and a panga to repeat the daily pattern his life had now fallen into since he left Maguita, his last detention camp. To reach his new strip of shamba which lay the other side of Thabai, Mugo had to walk through the dusty village streets. And as usual Mugo found that some women had risen before him, that some were already returning from the river, their frail backs arched double with water-barrels, in time to prepare tea or porridge for their husbands and children. The sun was now up: shadows of trees and huts and men were thin and long on the ground.
‘How is it with you, this morning?’ Warui called out to him, emerging from one of the huts.
‘It is well.’ And as usual Mugo would have gone on, but Warui seemed anxious to talk.
‘Attacking the ground early?’
‘Yes.’
‘That’s what I always say. Go to it when the ground is soft. Let the sun find you already there and it’ll not be a match for you. But if it reaches the shamba before you – hm.’
Warui, a village elder, wore a new blanket which sharply relieved his wrinkled face and the grey tufts of hair on his head and on his pointed chin. It was he who had given Mugo the present strip of land on which to grow a little food. His own piece had been confiscated by the government while he was in detention. Though Warui liked talking, he had come to respect Mugo’s reticence. But today he looked at Mugo with new interest, curiosity even.
‘Like Kenyatta is telling us,’ he went on, ‘these are days of Uhuru na Kazi.’ He paused and ejected a jet of saliva on to the hedge. Mugo stood embarrassed by this encounter. ‘And how is your hut, ready for Uhuru?’ continued Warui.
‘Oh, it’s all right,’ Mugo said and excused himself. As he moved on through the village, he tried to puzzle out Warui’s last question.
Thabai was a big village. When built, it had combined a number of ridges: Thabai, Kamandura, Kihingo, and parts of Weru. And even in 1963, it had not changed much from the day in 1955 when the grass-thatched roofs and mud walls were hastily collected together, while the whiteman’s sword hung dangerously above people’s necks to protect them from their brethren in the forest. Some huts had crumbled; a few had been pulled down. Yet the village maintained an unbroken orderliness; from a distance it appeared a huge mass of grass from which smoke rose to the sky as from a burnt sacrifice.
Mugo walked, his head slightly bowed, staring at the ground as if ashamed of looking about him. He was re-living the encounter with Warui when suddenly he heard someone shout his name. He started, stopped, and stared at Githua, who was hobbling towards him on crutches. When he reached Mugo he stood to attention, lifted his torn hat, and cried out:
‘In the name of blackman’s freedom, I salute you.’ Then he bowed several times in comic deference."
"Mugo se sentit nerveux. Il était allongé sur le dos et regardait le toit. Des mèches de suie pendaient du chaume de fougères et d'herbe et toutes pointaient vers son cœur. Une goutte d'eau claire était délicatement suspendue au-dessus de lui. La goutte grossit et devint plus sale à mesure qu'elle absorbait des grains de suie. Puis elle se mit à avancer vers lui. Il essaya de fermer les yeux. Ils refusèrent de se fermer. Il essaya de bouger la tête : elle était solidement enchaînée au cadre du lit. La goutte grossissait de plus en plus à mesure qu'elle se rapprochait de ses yeux. Il voulut se couvrir les yeux avec ses paumes ; mais ses mains, ses pieds, tout refusait d'obéir à sa volonté. Désespéré, Mugo rassembla ses forces pour un dernier soubresaut et se réveilla. Maintenant, il gisait sous la couverture et restait perturbé, craignant, comme dans le rêve, qu'une goutte d'eau froide ne transperce soudainement ses yeux. La couverture était dure et usée ; ses poils piquaient son visage, son cou, en fait toutes les parties non couvertes de son corps. Il ne savait pas s'il devait sauter du lit ou non ; le lit était chaud et le soleil n'était pas encore apparu. L'aube filtrait à travers les fissures du mur dans la hutte. Mugo essaya un jeu qu'il jouait toujours lorsqu'il avait perdu le sommeil au milieu de la nuit ou tôt le matin. Dans l'obscurité totale ou floue, la plupart des objets perdent leurs contours, une forme fusionnant avec une autre. Le jeu consistait à essayer de distinguer les différents objets dans la pièce. Ce matin, cependant, Mugo eut du mal à se concentrer. Il savait que ce n'était qu'un rêve : pourtant, il ne cessait de frissonner à l'idée d'une goutte froide tombant dans ses yeux. Un, deux, trois ; il retira la couverture de son corps. Il se lava le visage et alluma le feu. Dans un coin, il découvrit une petite quantité de farine de maïs dans un sac parmi les ustensiles. Il la mit dans une sufuria sur le feu, ajouta de l'eau et la remua avec une cuillère en bois. Il aimait le porridge le matin. Mais chaque fois qu'il en prenait, il se souvenait du porridge à moitié cuit qu'il mangeait en détention. Comme le temps traîne, tout se répète, pensa Mugo ; la journée à venir serait exactement comme hier et avant-hier.
Il prit une jembe et une panga pour répéter le schéma quotidien dans lequel sa vie était tombée depuis qu'il avait quitté Maguita, son dernier camp de détention. Pour atteindre sa nouvelle parcelle de shamba qui se trouvait de l'autre côté de Thabai, Mugo devait marcher à travers les rues poussiéreuses du village. Et comme d'habitude, Mugo constata que certaines femmes s'étaient levées avant lui, que certaines revenaient déjà de la rivière, leurs frêles dos arqués sous le poids des barils d'eau, à temps pour préparer le thé ou le porridge pour leurs maris et enfants. Le soleil était maintenant levé : les ombres des arbres, des huttes et des hommes étaient fines et longues sur le sol.
« Comment vas-tu, ce matin ? » lui lança Warui, émergeant de l'une des huttes.
« Tout va bien. » Et comme d'habitude, Mugo serait passé son chemin, mais Warui sembla anxieux de parler.
« Tu attaques la terre de bonne heure ?
Oui.
C'est ce que je dis toujours. Vas-y quand la terre est molle. Que le soleil te trouve déjà là et il ne sera pas de taille pour toi. Mais s'il atteint le shamba avant toi – hm. »
Warui, un ancien du village, portait une nouvelle couverture qui contrastait vivement avec son visage ridé et les touffes de cheveux gris sur sa tête et son menton pointu. C'était lui qui avait donné à Mugo la parcelle de terre actuelle pour y faire pousser un peu de nourriture. Sa propre parcelle avait été confisquée par le gouvernement pendant qu'il était en détention. Bien que Warui aimât parler, il en était venu à respecter la réticence de Mugo. Mais aujourd'hui, il regarda Mugo avec un intérêt nouveau, de la curiosité même.
« Comme nous le dit Kenyatta, poursuivit-il, ce sont les jours d'Uhuru na Kazi (Indépendance et Travail). » Il fit une pause et ejecta un jet de salive sur la haie. Mugo, gêné par cette rencontre, resta planté là. « Et comment va ta hutte, prête pour l'Uhuru ? » continua Warui.
« Oh, ça va », dit Mugo et s'excusa. Alors qu'il poursuivait son chemin à travers le village, il essaya de comprendre la dernière question de Warui.
Thabai était un grand village. Lors de sa construction, il avait regroupé un certain nombre de collines : Thabai, Kamandura, Kihingo et des parties de Weru. Et même en 1963, il n'avait pas beaucoup changé depuis le jour de 1955 où les toits de chaume et les murs de boue avaient été hâtivement rassemblés, tandis que l'épée de l'homme blanc pendait dangereusement au-dessus du cou des gens pour les protéger de leurs frères dans la forêt. Certaines huttes s'étaient écroulées ; quelques-unes avaient été démolies. Pourtant, le village conservait un ordre intact ; de loin, il apparaissait comme une immense masse d'herbe d'où la fumée s'élevait vers le ciel comme lors d'un sacrifice brûlé.
Mugo marchait, la tête légèrement penchée, fixant le sol comme s'il avait honte de regarder autour de lui. Il revivait la rencontre avec Warui quand soudain il entendit quelqu'un crier son nom. Il sursauta, s'arrêta et dévisagea Githua, qui se rapprochait de lui en boitillant sur des béquilles. Lorsqu'il atteignit Mugo, il se mit au garde-à-vous, souleva son chapeau déchiré et s'écria :
« Au nom de la liberté de l'homme noir, je vous salue. » Puis il s'inclina plusieurs fois avec une déférence comique.
‘Is it – is it well with you?’ Mugo asked, not knowing how to react. By this time two or three children had collected and were laughing at Githua’s antics. Githua did not answer at once. His shirt was torn, its collar gleamed black with dirt. His left trouser leg was folded and fixed with a pin to cover the stump. Rather unexpectedly he gripped Mugo by the hand:
‘How are you man! How are you man! Glad to see you going to the shamba early. Uhuru na Kazi. Ha! Ha! Ha! Even on Sundays. I tell you before the Emergency, I was like you; before the whiteman did this to me with bullets, I could work with both hands, man. It makes my heart dance with delight to see your spirit. Uhuru na Kazi. Chief, I salute you.’
Mugo tried to pull out his hand. His heart beat and he could not find the words. The laughter from the children increased his agitation. Githua’s voice suddenly changed:
‘The Emergency destroyed us,’ he said in a tearful voice and abruptly went away. Mugo hurried on, conscious of the man’s eyes behind him. Three women coming from the river stopped when they saw him. One of them shouted something, but Mugo did not answer or look at them. He raised dust like a man on the run. Yet he only walked asking himself questions: What’s wrong with me today? Why are people suddenly looking at me with curiosity? Is there shit on my legs?
Soon he was near the end of the main street where the old woman lived. Nobody knew her age: she had always been there, a familiar part of the old and the new village. In the old village she lived with an only son who was deaf and dumb. Gitogo, for that was the son’s name, spoke with his hands often accompanied with animal guttural noises. He was handsome, strongly built, a favourite at the Old Rung’ei centre where young men spent their time talking the day away. Occasionally the men went on errands for the shop-owners and earned a few coins ‘for the pockets only, just to keep the trousers warm’, as some carelessly remarked. They laughed and said the coins would call others (man! their relatives) in due time ..."
"« Est-ce que… est-ce que tout va bien pour toi ? » demanda Mugo, ne sachant comment réagir. À ce moment-là, deux ou trois enfants s'étaient rassemblés et riaient des singeries de Githua. Githua ne répondit pas tout de suite. Sa chemise était déchirée, son col brillait noir de crasse. Sa jambe de pantalon gauche était repliée et fixée avec une épingle pour couvrir le moignon. Assez inopinément, il attrapa la main de Mugo :
« Comment vas-tu, mon vieux ! Comment vas-tu, mon vieux ! Content de te voir aller au shamba de bonne heure. Uhuru na Kazi. Ha ! Ha ! Ha ! Même le dimanche. Je te dis qu'avant l'État d'urgence, j'étais comme toi ; avant que l'homme blanc ne me fasse ça avec des balles, je pouvais travailler des deux mains, mon vieux. Cela fait danser mon cœur de joie de voir ton état d'esprit. Uhuru na Kazi. Chef, je vous salue. »
Mugo essaya de retirer sa main. Son cœur battait et il ne trouvait pas ses mots. Les rires des enfants augmentaient son agitation. La voix de Githua changea soudainement :
« L'État d'urgence nous a détruits », dit-il d'une voix larmoyante et s'en alla abruptement. Mugo se dépêcha de poursuivre son chemin, conscient du regard de l'homme derrière lui. Trois femmes revenant de la rivière s'arrêtèrent en le voyant. L'une d'elles cria quelque chose, mais Mugo ne répondit pas et ne les regarda pas. Il souleva de la poussière comme un homme en fuite. Pourtant, il ne faisait que marcher, se posant des questions : Qu'est-ce qui ne va pas chez moi aujourd'hui ? Pourquoi les gens me regardent-ils soudain avec curiosité ? Est-ce qu'il y a de la merde sur mes jambes ?
Bientôt, il fut près du bout de la rue principale où vivait la vieille femme. Personne ne connaissait son âge : elle avait toujours été là, une partie familière de l'ancien et du nouveau village. Dans l'ancien village, elle vivait avec un fils unique qui était sourd et muet. Gitogo, car c'était le nom du fils, parlait avec ses mains, souvent accompagnées de bruits gutturaux animaux. Il était beau, solidement bâti, un favori du centre de l'ancien Rung'ei où les jeunes hommes passaient leur temps à discuter toute la journée. Occasionnellement, les hommes faisaient des courses pour les propriétaires de magasins et gagnaient quelques pièces « pour les poches seulement, juste pour garder le pantalon au chaud », comme certains disaient avec désinvolture. Ils riaient et disaient que les pièces en appelleraient d'autres (mon vieux ! leurs parents) en temps voulu..."

Ahmadou Kourouma (1927-2003)
"LES SOLEILS DES INDÉPENDANCES" (1968)
Premier roman du romancier ivoirien Ahmadou Kourouma, publié par les Presses de l`université de Montréal et réédité à Paris en 1970. Né de parents guinéens d’ethnie malinké. On sait, au passage, que ce qui singularise la Côte d’Ivoire en Afrique, est cette particularité de parvenir à faire cohabiter pacifiquement près de 70 ethnies différentes. Par ordre d'importance démographique, on peut noter au centre du pays les Baoulés (le président Houphouët Boigny était Baoulé); à l'Ouest, les Bétés, (18%); originaires du Nord musulman, les Sénoufos; enfin les Malinkés, traditionnellement commerçants et qui surent sans peine intégrer les structures économiques imposées par le colonisateur. Enfin faut-il rappeler que de 1950 à 1954, Ahmadou Kourouma sera envoyé comme tirailleur sénégalais en Indochine... On lui doit "Monnè, outrages et défis" (1988), - un siècle d'outrages et de défis de la colonisation -, "En attendant le vote des bêtes sauvages" (1998), qui décrit l’ascension du maître-chasseur Koyaga,et son exercice du pouvoir comme Président de la République du Golfe, contant en malinké ironique la démesure tyrannique des chefs d’États africains, et l’hypocrisie des Occidentaux -, "Allah n'est pas obligé" (2000) ...
"Les Soleils des Indépendances" un roman dont la réputation est d'occuper une place singulière dans l`histoire du roman africain d'expression française, non seulement parce qu'il en renouvelle la thématique, - en s`attachant à la critique de la société post-coloniale -, mais aussi parce qu'il innove sur le plan de l`écriture. A travers les destins croisés d`un prince malinké déchu, Fama, et de son épouse, stérile, Salimata, Kourouma évoque en les bouleversements politiques, économiques et idéologiques qui ont affecté la république des Ebènes - la Côte-d`Ivoire - au lendemain de son accession à la souveraineté nationale, le 7 août 1960 (le premier président du nouvel État sera un médecin de 55 ans devenu planteur de cacao et militant syndical, Félix Houphouët-Boigny : prenant le contrepied de ses homologues africains qui dénonce le «néo-colonialisme» des Occidentaux, il fera d'emblée le choix d'une coopération sans réserve avec l'ancienne puissance coloniale).
Les "Soleils", dont il est ici question, renvoient donc, métaphoriquement, à cette période de turbulence au cours de laquelle les anciennes colonies de l`Afrique occidentale française acquièrent le statut d`Etats souverains. Une mutation profonde, marquée par la rupture des équilibres d`antan au sein de la société africaine et qui, avec l'instauration du parti unique, entraîne la confiscation du pouvoir par la nouvelle caste des politiciens et des bureaucrates, dont le romancier dénonce à la fois la cupidité et l`absolutisme. Kourouma se montre tout aussi critique à l'égard des nostalgiques d`une tradition incarnée par son héros, encouragé par les griots et les féticheurs, et qui apparaît le plus souvent désuète et sclérosée, voire factice. L`originalité et la nouveauté du livre résident dans une écriture qui, tant sur le plan métaphorique que syntaxique, traduit la volonté de son auteur de briser le carcan du discours romanesque occidental, et d'ancrer son récit, à la manière d`un conteur de village, dans le vieux fonds culturel de l'imaginaire malinké....
"1. Le molosse et sa déhontée façon de s’asseoir
Il y avait une semaine qu’avait fini dans la capitale Koné Ibrahima, de race malinké, ou disons-le en malinké : il n’avait pas soutenu un petit rhume…
Comme tout Malinké, quand la vie s’échappa de ses restes, son ombre se releva, graillonna, s’habilla et partit par le long chemin pour le lointain pays malinké natal pour y faire éclater la funeste nouvelle des obsèques. Sur des pistes perdues au plein de la brousse inhabitée, deux colporteurs malinké ont rencontré l’ombre et l’ont reconnue. L’ombre marchait vite et n’a pas salué. Les colporteurs ne s’étaient pas mépris : « Ibrahima a fini », s’étaient-ils dit. Au village natal l’ombre a déplacé et arrangé ses biens. De derrière la case on a entendu les cantines du défunt claquer, ses calebasses se frotter ; même ses bêtes s’agitaient et bêlaient bizarrement. Personne ne s’était mépris. « Ibrahima Koné a fini, c’est son ombre », s’était-on dit. L’ombre était retournée dans la capitale près des restes pour suivre les obsèques : aller et retour, plus de deux mille kilomètres. Dans le temps de ciller l’œil !
Vous paraissez sceptique ! Eh bien, moi, je vous le jure, et j’ajoute : si le défunt était de caste forgeron, si l’on n’était pas dans l’ère des Indépendances (les soleils des Indépendances, disent les Malinkés), je vous le jure, on n’aurait jamais osé l’inhumer dans une terre lointaine et étrangère. Un ancien de la caste forgeron serait descendu du pays avec une petite canne, il aurait tapé le corps avec la canne, l’ombre aurait réintégré les restes, le défunt se serait levé. On aurait remis la canne au défunt qui aurait emboîté le pas à l’ancien, et ensemble ils auraient marché des jours et des nuits. Mais attention ! sans que le défunt revive ! La vie est au pouvoir d’Allah seul ! Et sans manger, ni boire, ni parler, ni même dormir, le défunt aurait suivi, aurait marché jusqu’au village où le vieux forgeron aurait repris la canne et aurait tapé une deuxième fois. Restes et ombre se seraient à nouveau séparés et c’eût été au village natal même qu’auraient été entreprises les multiples obsèques trop compliquées d’un Malinké de caste forgeron.
Donc c’est possible, d’ailleurs sûr, que l’ombre a bien marché jusqu’au village natal ; elle est revenue aussi vite dans la capitale pour conduire les obsèques et un sorcier du cortège funèbre l’a vue, mélancolique, assise sur le cercueil. Des jours suivirent le jour des obsèques jusqu’au septième jour et les funérailles du septième jour se déroulèrent devant l’ombre, puis se succédèrent des semaines et arriva le quarantième jour, et les funérailles du quarantième jour ont été fêtées au pied de l’ombre accroupie, toujours invisible pour le Malinké commun. Puis l’ombre est repartie définitivement. Elle a marché jusqu’au terroir malinké où elle ferait le bonheur d’une mère en se réincarnant dans un bébé malinké.
Parce que l’ombre veillait, comptait, remerciait, l’enterrement a été conduit pieusement, les funérailles sanctifiées avec prodigalité. Les amis, les parents et même de simples passants déposèrent des offrandes et sacrifices qui furent repartagés et attribués aux venus et aux grandes familles malinké de la capitale
Comme toute cérémonie funéraire rapporte, on comprend que les griots malinké, les vieux Malinkés, ceux qui ne vendent plus parce que ruinés par les Indépendances (et Allah seul peut compter le nombre de vieux marchands ruinés par les Indépendances dans la capitale !) « travaillent » tous dans les obsèques et les funérailles. De véritables professionnels ! Matins et soirs ils marchent de quartier en quartier pour assister à toutes les cérémonies. On les dénomme entre Malinkés, et très méchamment, « les vautours » ou « bande d’hyènes ».
Fama Doumbouya ! Vrai Doumbouya, père Doumbouya, mère Doumbouya, dernier et légitime descendant des princes Doumbouya du Horodougou, totem panthère, était un « vautour ». Un prince Doumbouya ! Totem panthère faisait bande avec les hyènes. Ah ! les soleils des Indépendances !
Aux funérailles du septième jour de feu Koné Ibrahima, Fama allait en retard. Il se dépêchait encore, marchait au pas redoublé d’un diarrhéique. Il était à l’autre bout du pont reliant la ville blanche au quartier nègre à l’heure de la deuxième prière ; la cérémonie avait débuté.
Fama se récriait : « Bâtard de bâtardise ! Gnamokodé ! » Et tout manigançait à l’exaspérer. Le soleil ! le soleil ! le soleil des Indépendances maléfiques remplissait tout un côté du ciel, grillait, assoiffait l’univers pour justifier les malsains orages des fins d’après-midi. Et puis les badauds ! les bâtards de badauds plantés en plein trottoir comme dans la case de leur papa. Il fallait bousculer, menacer, injurier pour marcher. Tout cela dans un vacarme à arracher les oreilles : klaxons, pétarades des moteurs, battements des pneus, cris et appels des passants et des conducteurs. Des garde-fous gauches du pont, la lagune aveuglait de multiples miroirs qui se cassaient et s’assemblaient jusqu’à la berge lointaine où des îlots et lisières de forêts s’encastraient dans l’horizon cendré. L’aire du pont était encombrée de véhicules multicolores montant et descendant ; et après les garde-fous droits, la lagune toujours miroitante en quelques points, latérite en d’autres ; le port chargé de bateaux et d’entrepôts, et plus loin encore la lagune maintenant latérite, la lisière de la forêt et enfin un petit bleu : la mer commençant le bleu de l’horizon. Heureusement ! qu’Allah en soit loué ! Fama n’avait plus long à marcher, l’on apercevait la fin du port, là-bas, où la route se perdait dans une descente, dans un trou où s’accumulaient les toits de tôles miroitants ou gris d’autres entrepôts, les palmiers, les touffes de feuillages et d’où émergeaient deux ou trois maisons à étages avec des fenêtres persiennes. C’étaient les immenses déchéance et honte, aussi grosses que la vieille panthère surprise disputant des charognes aux hyènes, que de connaître Fama courir ainsi pour des funérailles.
Lui, Fama, né dans l’or, le manger, l’honneur et les femmes ! Éduqué pour préférer l’or à l’or, pour choisir le manger parmi d’autres, et coucher sa favorite parmi cent épouses ! Qu’était-il devenu ? Un charognard…
C’était une hyène qui se pressait. Le ciel demeurait haut et lointain sauf du côté de la mer, où de solitaires et impertinents nuages commençaient à s’agiter et à se rechercher pour former l’orage. Bâtardes ! déroutantes, dégoûtantes, les entre-saisons de ce pays mélangeant soleils et pluies.
Il tourna après un parterre, monta l’allée centrale du quartier des fonctionnaires. Allah en soit loué ! C’était bien là. Fama arrivait quand même tard. C’était fâcheux, car il allait en résulter pour lui de recevoir en plein visage et très publiquement les affronts et colères qui jettent le serpent dans le bouffant du pantalon. impossibilité de s’asseoir, de tenir, de marcher, de se coucher.
Donc il arriva. Les dioulas couvraient une partie du dessous de l’immeuble à pilotis ; les boubous blancs, bleus, verts, jaunes, disons de toutes les couleurs, moutonnaient, les bras s’agitaient et le palabre battait. Du monde pour le septième jour de cet enterré Ibrahima ! Un regard rapide.
On comptait et reconnaissait nez et oreilles de tous les quartiers, de toutes les professions. Fama salua, et avec quels larges sourires ! planta sa grande taille parmi les pilotis, assembla son boubou et ensuite se cassa et s’assit sur un bout de natte. Le griot, un très vieux et malingre, qui criait et commentait, répondit :
— Le prince du Horodougou, le dernier légitime Doumbouya, s’ajoute à nous… quelque peu tard.
Yeux et sourires narquois se levèrent. Que voulez-vous ; un prince presque mendiant, c’est grotesque sous tous les soleils. Mais Fama n’usa pas sa colère à injurier tous ces moqueurs de bâtards de fils de chiens. Le griot continua à dire, et du autrement désagréable :
— Un retard sans inconvénient ; les coutumes et les droits des grandes familles avaient été respectés ; les Doumbouya n’avaient pas été oubliés. Les princes du Horodougou avaient été associés avec les Keita.
Fama demanda au griot de se répéter. Celui-ci hésita. Qui n’est pas Malinké peut l’ignorer : en la circonstance c’était un affront, un affront à faire éclater les pupilles. Qui donc avait associé Doumbouya et Keita ? Ceux-ci sont rois du Ouassoulou et ont pour totem l’hippopotame et non la panthère.
D’un ton ferme, coléreux et indigné, Fama redemanda au griot de se répéter. Celui-ci se lança dans d’interminables justifications ..." (Editions du Seuil, janvier 1970)

Amos Tutuola (1920-1997),
"The Palm-Wine Drinkard and his dead Palm-Wine Tapster in the Deads’ Town" (1953)
Amos Tutuola est né au Nigeria et a travaillé à Lagos et à Ibadan dans l’ouest du Nigeria la majeure partie de sa vie. Parmi ses romans, citons "My Life in the Bush of Ghosts" (1954) et "Pauper, Brawler and Slanderer" (1987), il avait trente-trois ans lorsqu'il écrivit "The Palm-Wine Drinkard" ...
"L'Ivrogne dans la brousse" commence ainsi : "J'étais un buveur de vin de palme depuis l'âge de dix ans". Mais à la mort de son robinetier, notre narrateur, qui n'est pas satisfait, dit que "tous les gens qui étaient morts dans ce monde n'allaient pas directement au paradis, mais vivaient dans un endroit quelque part dans le monde", décide de partir à la recherche de son palmier dans le monde entre le ciel et la terre. Le roman est le récit de ses aventures fantastiques. Il se lit comme un conte populaire, faisant partie d'une tradition orale (yoruba); il est raconté simplement, le style est sans artifice et percutant. À chaque paragraphe, un nouveau monstre ou une nouvelle menace apparaît, ou un nouveau voyage, ou une nouvelle vision étrange ; la métamorphose est constante. Il trouve une femme en cours de route ; le ton est large, innocent, impartial. La plupart de ses escapades se déroulent dans un monde de cauchemars et d'effroi inconscient ; Jung et Freud se seraient bien amusés avec ce livre. Ce qui le distingue, c'est la qualité de son énergie imaginative, son refus de se contenter d'une seule histoire ou d'un seul sens. Le sentiment que les morts, les vivants et les demi-morts partagent ce monde étrange est très puissant et l'utilisation de l'art du conteur ainsi que la verve de la narration font de ce livre l'un des meilleurs romans africains parus au cours des cinquante dernières années....
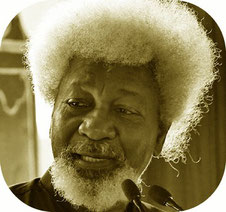
Wole Soyinka (1934)
Akinwande Oluwole Soyinka, natif d'Abeokuta (Nigeria), dramaturge et militant politique nigérian, fut le premier écrivain africain à se voir attribuer le prix Nobel de littérature (1986). L'académie suédoise justifia son choix en le décrivant comme "un écrivain qui met en scène, dans une vaste perspective culturelle enrichie de résonances poétiques, une représentation dramatique de l'existence". Une formule bien alambiquée qui montre à quel point il semble difficile d'évoquer un écrivain qui, pour prouver la capacité du continent noir à s'exprimer de façons multiples tout en demeurant fondamentalement fidèle à des racines culturelles particulièrement riches. Chaque écrit de Soyonka est en effet un hommage au folklore yoruba dont il est issu et qui dit le commerce millénaire des êtres humains, des esprits et des dieux. Des Yorubas bien connus pour la civilisation urbaine qu'ils développèrent très tôt (royaume d'Oyo, fondé au xve siècle), à la différence de nombre de peuples d'Afrique noire, mais qui dramatiquement aussi payèrent un lourd tribut aux traites négrières. Mais l'héritage dans la continuité duquel se construit l'oeuvre de Soyinka est bien celui de projeter sur cette "matrice esthétique ancestrale" - la célébration vibrante des cycles éternels de la vie, de la semence et de la récolte à la souffrance et à la rébellion - ses interrogations sur le monde présent, sa croyance dans les maux inhérents à l'exercice du pouvoir, sur la liberté bafouée, sur le "viol des nations"..
Soyinka a publié une vingtaine d'ouvrages, théâtre, romans et poésie. Il écrit en anglais. Dramaturge, il se rattache au théâtre traditionnel africain populaire avec sa combinaison de danse, de musique et d'action et fonde son écriture sur la mythologie de sa propre tribu, les Yoruba, dont Ogun, le dieu du fer et de la guerre, est le centre...
Alors enfant, sa patrie était encore une dépendance britannique. Son père était directeur d'une école primaire anglicane et sa mère, qu'il surnommait "Wild Christian", était commerçante. En 1981, Soyinka a publié "Aké", un mémoire sur sa jeunesse. Très tôt, il s'est impliqué dans la lutte pour l'indépendance du Nigeria et a été inspiré par celle-ci, ainsi que par la révolte à laquelle sa mère a participé, une taxe frappant les femmes et une " tax revolt" as “the earliest event I remember in which I was really caught up in a wave of activism and understood the principles involved. Young as I was, it all took place around me, discussions took place around me, and I knew what forces were involved. But even before? I’d listened to elders talking, and I used to read the newspapers on my father’s desk. This was a period of anticolonial fervor, so the entire anticolonial training was something I imbibed quite early, even before the women’s movement" (avec cette taxe sur les femmes, "j'ai vraiment été pris dans une vague d'activisme et où j'ai compris les principes en jeu. Aussi jeune que je sois, tout se passait autour de moi, les discussions avaient lieu autour de moi, et je savais quelles forces étaient impliquées. C'était une période de ferveur anticoloniale, donc toute la formation anticoloniale était quelque chose que j'ai assimilé assez tôt). Soyinka a fréquenté le Government College et le University College d'Ibadan avant d'obtenir en 1958 un diplôme d'anglais de l'université de Leeds en Angleterre. Il écrit ses premières pièces pendant son séjour à Londres, "The Swamp Dwellers" et "The Lion and the Jewel" (une comédie légère), qui sont jouées à Ibadan en 1958 et 1959 et sont publiées en 1963.
À son retour au Nigeria, il a fondé une troupe de théâtre et a écrit sa première pièce importante, "A Dance of the Forests" (produite en 1960 ; publiée en 1963), pour les célébrations de l'indépendance du Nigeria. La pièce fait la satire de la nation naissante en la dépouillant de sa légende romantique et en montrant que le présent n'est pas plus un âge d'or que le passé. Il a écrit plusieurs pièces dans une veine plus légère, se moquant des enseignants pompeux et occidentalisés dans "The Lion and the Jewel" (première représentation à Ibadan, 1959 ; publication en 1963) et des prédicateurs astucieux des églises de prière parvenues qui s'enrichissent de la crédulité de leurs paroissiens dans "The Trials of Brother Jero" (représentation en 1960 ; publication en 1963) et Jero's Metamorphosis (1973). Tout son théâtre est bâti sur un schéma de lutte, confrontations drôlatiques (un vieillard rusé face à une jeune fille émancipée) puis combats de plus en plus inégaux et de plus en plus inquiétants, avec leurs victimes, boucs émissaires innocents, voyageurs égarés, bourreaux et intellectuels pervers. Ses pièces plus sérieuses, comme "The Strong Breed" (1963), "Kongi's Harvest" (ouverture du premier Festival des arts nègres à Dakar, 1966 ; publié en 1967), "The Road" (1965), "The Bacchae of Euripides" (1973), "From Zia, with Love" (1992), et même la parodie "King Baabu" (jouée en 2001 ; publiée en 2002), révèlent son mépris pour le leadership autoritaire africain et sa désillusion vis-à-vis de la société nigériane dans son ensemble. Une "danse macabre", dira-t-il ...
Pendant la guerre civile nigériane, Soyinka a lancé un appel au cessez-le-feu dans un article et pour cela, a été arrêté en 1967, accusé de conspirer avec les rebelles du Biafra, et détenu comme prisonnier politique pendant 22 mois, jusqu'en 1969....
En octobre 1969, Soyinka est libéré de prison et devient président du département des arts du théâtre de l'université d'Ibadan, mais l'année suivante, il s'exile volontairement en Europe pendant cinq ans. Pendant cette période, il a été rédacteur en chef de "Transition", la principale revue intellectuelle d'Afrique, et a enseigné à l'université du Ghana, à Accra, et au Churchill College, à Cambridge.
En 1975, Soyinka est retourné au Nigeria et l'année suivante, est devenu professeur d'anglais à l'université d'Ife. Au cours des années 1970 et 1980, il a joué un rôle important dans la politique locale et nationale du Nigeria et a également été professeur invité dans de nombreuses universités, dont Harvard, Yale, Cornell et Cambridge.
Soyinka a écrit par ailleurs deux romans, "The Interpreters" (1965), une œuvre complexe sur le plan narratif qui a été comparée à celles de Joyce et de Faulkner, dans laquelle six intellectuels nigérians discutent et interprètent leurs expériences africaines, et "Season of Anomy" (1973) qui est basé sur les pensées de l'écrivain pendant son emprisonnement et confronte le mythe d'Orphée et Euridice à la mythologie des Yoruba. Purement autobiographiques, "The Man Died : Prison Notes" (1972) et le récit de son enfance, "Aké" ( 1981), dans lequel la chaleur et l'intérêt des parents pour leur fils sont prépondérants. Ses essais littéraires sont rassemblés, entre autres, dans "Myth, Literature and the African World" (1975).
Enfin, les poèmes de Soyinka sont étroitement liés à ses pièces de théâtre, et rassemblés dans "Idanre, and Other Poems" (1967), "Poems from Prison" (1969), "A Shuttle in the Crypt" (1972), le long poème "Ogun Abibiman" (1976) et "Mandela's Earth and Other Poems" (1988). Si la plupart de ses poèmes décrivent la mutilation des corps et des esprits ou des paysages de carnage, se dressent toujours au sein de cette désolation, quelques figures qui sont autant de levains d`espoir, la femme, le fou, le prophète ou le militant, qui parviennent à entrevoir l'espoir, cette "pâle incision dans la peau de la nuit" ....
Entre 1993 et 1998, Soyinka a de nouveau été contraint à l'exil en raison de son opposition à la dictature militaire et à ses brutalités. Il a été jugé par contumace pour trahison capitale, les charges ayant été retirées après la chute du gouvernement en 1998. Soyinka a depuis pris le poste de professeur émérite à l'université Obafemi Awolowo, au Nigeria, mais enseigne toujours dans des universités en Europe et aux États-Unis....

"The Interpreters" (1965)
Il s'agit, dans une certaine mesure, d'une comédie de mœurs sombre et complexe qui se déroule au Nigeria dans les années qui ont suivi l'indépendance. Une comédie centrée sur la vie d'un certain nombre de jeunes intellectuels ambitieux et mal à l'aise dans la nouvelle société, qui se rencontrent régulièrement, boivent beaucoup et parlent tout le temps. Une grande partie du roman est constituée de leurs dialogues. Scène après scène - le cadre et le ton changent à chaque chapitre - ils se voient confronter à leur propre idéalisme, à leur préoccupation (ou absence de préoccupation) tant éthique que par rapport à la société qui les entoure. La religion, le vaudou, l'art, le gouvernement, le journalisme, le sexe, la négritude, la blancheur, l'étiquette (le port de gants par les femmes lors de certaines fêtes, par exemple), les Américains et les Allemands font tous l'objet de discussions et d'examens. (ici L'Américain et l'Allemand sont traités avec beaucoup de mépris). Soyinka n'héroïse aucun de ses personnages : ils ont tous leurs faiblesses, mais aussi une sorte d'innocence qui les rend vulnérables. Sa capacité à ciseler les dialogues - en particulier dans les scènes de fête, où nos intellectuels sont les plus cyniques et les plus observateurs - est étonnante. Par moments, le roman exige une attention soutenue, car Soyinka refuse le réalisme facile ; il ne porte pas de jugement ni d'évaluation psychologique ; il tire beaucoup d'émotion de détails superficiels et de moments d'observation minutieuse dépeint, et parvient - et c'est l'un des aspects les plus intéressants de son livre - à suggérer que les personnes dont il parle sont condamnées et n'auront pas la force de résister à la pression de la société qui les entoure...

"Climate of Fear, The Quest for Dignity in a Dehumanized World" (2004)
Recueil de cinq conférences intitulées "A changing mask of fear", - initialement écrites pour des lectures publiques à Londres, Bristol, Leeds et Atlanta et diffusées par BBC Radio 4 entre le 10 mars et le 8 mai 2004 -, dans lesquels Soyinka explique, à partir d'exemples commentés, qu'au fond tout pouvoir est devenu paradoxalement le début de la peur : ce climat de peur est connu de tous ceux qui ont vécu sous des régimes totalitaires, - ce qu'ont connu une grande partie de la population mondiale -, mais de nos jours, il semble que que ce sentiment puisse gagner un nombre de plus en plus importants de peuples de par le monde sous des pressions diverses, du terrorisme au pouvoir invisible du "quasi-État". Peut-être l'un des premiers signes est-il l'emprisonnement et la pendaison de Ken Saro-Wiwa, à Port Harcourt, par le gouvernement nigérian du général Sani Abacha, le 10 novembre 1995 : condamné pour avoir été le porte-parole du Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni et lutter contre les abus commis par certaines compagnies dans le delta du Niger....
Ce qui s'est passé sur le continent africain dans ces violentes années 70 et 80 a trouvé un écho, peut-être plus féroce encore, dans les Amériques, où on surgit par exemple les terribles escadrons de la mort d'extrême droite, justiciers parrainés par le gouvernement, Nicaragua, Chili, Argentine, Panama, mais aussi Iran sous la SAVAK, Afrique du Sud sous l'apartheid. La peur est alors presque uniformément une chaîne de production gérée par l'État. Entre les gouvernements de droite et l'efficace machine communiste gérée par l'État, il n'y avait guère de différence. Hongrie, Albanie, Allemagne de l'Est, Bulgarie, etc. Les émigrés de ces utopies en devenir, tout comme les survivants de l'apartheid en Afrique du Sud - aussi bien les vaincus que les conspirateurs - ont parcouru le monde à la recherche d'aide et de solidarité. Comment survivre dans un climat de peur ? ...
"What was happening on the African continent in those violent seventies and eighties was echoed, perhaps with even greater ferocity, in the Americas, where those danger words desaparecidos, right-wing murder squads, government-sponsored vigilantes, etc. gained international notoriety. Nicaragua, Chile, Argentina, Panama. Iran under the SAVAK. Apartheid South Africa under BOSS. Fear was almost uniformly a state-run production line, except of course where right-wing volunteer agents of repression lent a hand, as in Latin America. Between right-wing governments and the efficient state-run communist machinery there was, however, hardly any difference. Hungary, Albania, East Germany, Bulgaria, and so on. Emigrés from these would-be utopias, no different from survivors of apartheid South Africa—both the defeated and the yet combative and conspiratorial—crisscrossed the world seeking help and solidarity. Again and again, our paths— those of creative people—would meet, leading to that immediate question: How did creativity survive under such arbitrary exercise of power? How did Art survive in a climate of fear? Today, the constituency of fear has become much broader, far less selective."
Nous sommes tous d'accord, j'aime à le croire, sur ce qui constitue la peur. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons au moins nous entendre sur les symptômes de la peur, reconnaître quand le conditionnement de la peur s'est imposé tant à un individu qu'à une communauté. Nous avons certainement appris à associer l'émotion de la peur à la mesure vérifiable d'une contraction de nos possibilités d'expression et de volonté. Le sentiment de liberté dont nous jouissons ou, plus exactement, que nous tenions pour acquis dans la vie normale, s'est fortement réduit. La prudence et le calcul remplacent toute spontanéité. Souvent, la parole normale est réduite à un chuchotement, même dans l'intimité du foyer....
"We are all agreed, I like to believe, on what constitutes fear. If not, we can at least agree on the symptoms of fear, recognize when the conditioning of fear has afflicted or been imposed on an individual or a community. Certainly we have learned to associate the emotion of fear with the ascertainable measure of a loss in accustomed volition. The sense of freedom that is enjoyed or, more accurately, taken for granted in normal life becomes acutely contracted. Caution and calculation replace a norm of spontaneity or or routine. Often, normal speech is reduced to a whisper, even within the intimacy of the home. Choices become limited. One is more guarded, less impulsive. A rapist is on the loose in society. A serial killer terrorizes an entire community—as happened recently in the state of Maryland in the United States, where two men, an adult and his protégé, placed an entire state under siege as they picked off victims at random..."
Il y a des degrés dans le sentiment de peur, il existe en effet un type de peur avec lequel on peut vivre, dont on peut s'affranchir, une peur qui peut en fait être absorbée à l'aide par exemple d'une thérapie, - que l'on pense à la peur que peut générer un dérèglement de la nature, un incendie, comme celui qui ravagea le sud de la Californie. Mais il est une autre peur, différente, sourde, celle d'une humanité menacée par l'exercice du pouvoir d'un individu, ou de celui d'un État totalitaire sur sa population. Il existe un vaste abîme de sensibilités entre la force brute qu'est la nature, d'une part, et l'exercice de la force par un être humain sur un autre. Cela est lié à cet attribut de l'humaine nature déjà suggéré par les philosophes de l'Antiquité et de l'Extrême-Orient, la dignité (dignity).
"The Quest for Dignity.” For now, let us simply observe that the assault on human dignity is one of the prime goals of the visitation of fear, a prelude to the domination of the mind and the triumph of power..."
Il y a quelques décennies, l'existence de la peur collective avait un visage immédiatement identifiable : la bombe atomique. Si cette source n'est pas totalement absente aujourd'hui, on peut affirmer que nous avons dépassé la peur de la bombe. La menace nucléaire est également impliquée dans le climat de peur actuel, mais la bombe atomique n'est qu'une arme de plus dans son arsenal, le kit théorique à monter soi-même qui tient dans une valise et peut être assemblé dans la salle de bains la plus proche. Ce qui terrifie le monde, cependant, ce n'est plus la possibilité que des États trop musclés déchaînent sur le monde le scénario ultime - la destruction mutuelle assurée (MAD) qui, paradoxalement, servait autrefois de mécanisme de restriction mutuelle. AUJOURD'HUI, ON CRAINT UN POUVOIR FURTIF ET INVISIBLE, le pouvoir du quasi-État, cette entité qui ne revendique aucune frontière physique, qui n'arbore aucun drapeau national, qui n'est inscrite dans aucune association internationale et qui est tout aussi folle que l'évangile de l'annihilation MAD si calmement annoncé par les superpuissances...
"A few decades ago, the existence of collective fear had an immediately identifiable face—the atomic bomb. While that source is not totally absent today, one can claim that we have moved beyond the fear of the bomb. A nuclear menace is also implicated in the current climate of fear, but the atom bomb is only another weapon in its arsenal, the theoretical do-it-yourself kit that fits into a suitcase and can be assembled in the nearest bathroom.What terrifies the world, however, is no longer the possibility of over-muscled states unleashing on the world the ultimate scenario—the Mutual Assured Destruction (MAD) that once, paradoxically, also served as its own mutually restraining mechanism. Today the fear is one of furtive, invisible power, the power of the quasi-state, that entity that lays no claim to any physical boundaries, flies no national flag, is unlisted in any international associations, and is every bit as mad as the MAD gospel of annihilation that was so calmly annunciated by the superpowers...."

"Season of Anomy" (Soyinka, Wole)
Knopf Doubleday Publishing Group, Penguin Random House LLC, New York, 2021
Une œuvre tragique et profonde, bien moins satirique que Chronicles. C'est une méditation douloureuse sur les conséquences de la guerre civile, la nature du mal politique et la quête presque impossible de l'idéal dans un monde brisé. C'est un roman sombre, mais porté par une lueur d'espoir ténue, celle que représente la communauté persistante d'Aiyéró et la quête inébranlable d'Ofeyi. Il est essentiel pour comprendre la réponse de Soyinka à la tragédie nationale du Nigeria ...
Publié en 1973, "Season of Anomy" est le deuxième roman de Wole Soyinka. Il est considérablement différent dans le ton et le style de son premier, "The Interpreters", et de son dernier, "Chronicles". C'est une œuvre allégorique et dense, écrite dans une prose souvent lyrique et mythique, qui s'inspire fortement des traumatismes de la guerre civile nigériane (1967-1970) et de l'expérience de l'auteur qui fut emprisonné par le gouvernement pendant ce conflit.
Le titre lui-même annonce le sujet : une "saison d'anomie", c'est-à-dire une période de rupture des lois et normes sociales, de désintégration de l'ordre moral. Le roman est une exploration profonde de la confrontation entre un idéal humaniste et la réalité brutale de la violence politique, de la corruption et de la folie collective.
Intrigue Principale : l'histoire oppose deux visions du monde et deux "univers" symboliques ...
- L'Idylle d'Aiyéró : C'est une communauté agricole isolée, organisée de manière quasi-utopique, harmonieuse et traditionnelle. Elle fonctionne sur des principes de partage, de respect des ancêtres et de cycle naturel de la vie. Elle représente un idéal d'ordre, de culture et d'harmonie préservée. Le protagoniste, Ofeyi, en est originaire.
- La République du Cartel : C'est le reste du pays, un État anonyme et corrompu, dirigé par une junte militaro-capitaliste oppressive (le "Cartel"). C'est un monde de violence gratuite, de consommation effrénée, de manipulation médiatique et de désintégration morale. C'est le règne de l'anomie.
Le protagoniste, Ofeyi, travaille comme publicitaire pour la "Cocoa Corporation" dans la République du Cartel. Initialement, il utilise son talent pour promouvoir les produits de l'entreprise, mais il devient progressivement conscient de l'exploitation et de la corruption du système. Il se met alors à détourner ses campagnes publicitaires pour envoyer des messages subversifs et réveiller les consciences. Ses actions attirent l'attention du Cartel. La crise éclate lorsque sa compagne, Iriyise (la "Dent de Crème", symbole de beauté et de pureté), est kidnappée par les sbires du régime pour le punir et briser sa résistance. Le reste du roman suit la quête désespérée d'Ofeyi, aidé par son ami loyal Zaccheus (ou "le Pilote"), pour sauver Iriyise et se confronter à la machine de violence du Cartel. Ce voyage à travers le pays en guerre civile est une descente aux enfers, une odyssée cauchemardesque à travers un paysage ravagé par la brutalité et la folie.
Thèmes Clés ...
- L'Idéalisme contre la Corruption : C'est le cœur du roman. La pureté utopique d'Aiyéró est confrontée à la corruption absolue du Cartel. La question est de savoir si un tel idéal peut survivre, ou même simplement influencer, un monde si radicalement corrompu.
- La Violence et la Folie Collective : Soyinka dépeint avec une intensité glaçante la mécanique de la violence politique, comment elle déshumanise à la fois les bourreaux et les victimes.
- Le Sacrifice et la Rédemption : Le parcours d'Ofeyi est un sacrifice, une descente ritualiste dans les ténèbres pour tenter de sauver ce qui reste de lumière (Iriyise). Le personnage de Zaccheus, qui se sacrifie littéralement, incarne la loyauté et le sacrifice ultime.
- Le Mythe et le Rituel : Le roman est structuré comme un mythe ou une quête épique. Soyinka s'inspire du mythe d'Orphée descendant aux enfers (Hadès) pour sauver Eurydice. Ofeyi est Orphée, Iriyise est Eurydice, et la République du Cartel est les Enfers.
- Le Rôle de l'Artiste : Ofeyi, le publicitaire-artiste, pose la question du engagement de l'artiste. Peut-il utiliser les outils du système (la publicité) pour le combattre de l'intérieur ? Quel est le pouvoir réel de la parole face à la force brute ?
Bien plus que "Chronicles", ce roman fonctionne sur un mode symbolique. Les lieux et les personnages représentent des concepts (le Bien, le Mal, la Corruption, l'Idéal). La prose de Soyinka est souvent poétique et belle, même quand elle décrit l'horreur la plus absolue, créant un contraste saisissant. La narration n'est pas linéaire, incorporant des flashbacks, des monologues intérieurs et des séquences oniriques. Ce peut être d'une lecture exigeante ...

"Chronicles From the Land of the Happiest People on Earth : A Novel" (Soyinka, Wole)
Knopf Doubleday Publishing Group, Penguin Random House LLC, New York, 2021
Un verdict sévère et un cri d'alarme d'un des plus grands intellectuels africains. C'est une œuvre exigeante, souvent dérangeante, qui ne offre pas de solutions faciles mais qui oblige le lecteur à confronter les contradictions et les pathologies profondes d'une société en crise. Il est considéré comme le testament littéraire de Soyinka, une synthèse de toutes les luttes et les thèmes qui ont traversé son œuvre et sa vie : la quête de justice, la dénonciation de la tyrannie et la défense de la dignité humaine.
Publié en 2021, ce roman est la première œuvre de fiction en près de 50 ans du lauréat du prix Nobel de littérature Wole Soyinka. C'est une satire sombre, complexe et féroce qui dépeint le Nigeria contemporain à travers le prisme d'une intrigue grotesque et macabre.
Le titre lui-même fait référence à un classement international qui aurait désigné le Nigeria comme "le pays où les gens sont les plus heureux du monde". Soyinka utilise cette prémisse pour construire une critique approfondie de la corruption, de l'imposture religieuse, de la déliquescence morale et de la complicité des élites dans la faillite d'une nation.
L'histoire tourne autour d'une découverte horrible et surréaliste : un trafic de parties humaines prospère au sein même des plus hautes sphères du pouvoir. Les corps sont volés dans les morgues des hôpitaux et disséqués pour être revendus.
"1 - Oke Konran-Imoran
Papa Davina, également connu sous le nom de Teribogo, aimait à forger ses propres formules de sagesse. Tel, par exemple, son fameux :
– Tout est perspective.
La Chercheuse matinale, sa première et unique cliente de la journée, qui avait droit à une session absolument spéciale et on ne peut plus dédiée, leva la tête et acquiesça d’un hochement. Papa D pointa du doigt :
– Approchez-vous de cette fenêtre. Ouvrez les rideaux et regardez dehors.
La salle d’audience était plongée dans la pénombre, et il fallut un moment à la Chercheuse pour se diriger à tâtons le long des larges plis et trouver la jointure des deux pans. Elle empoigna à deux mains les lourds rideaux, et attendit. Papa Davina lui fit signe d’achever le geste, en poursuivant de son ton apaisant, méditatif presque :
– À l’heure de pénétrer dans cette enceinte, il est essentiel d’oublier qui vous êtes, qui vous avez été. Ne soyez plus que la Chercheuse. Je vous servirai de guide. Je ne fais pas partie de ces hommes vulgaires qui font commerce de la mission prophétique. Le temps des grands prophètes est révolu. Je ne suis ici avec vous qu’en qualité de Prescience. Seul le Dieu Tout-Puissant, l’Insondable Allah, est la Présence Même, et qui oserait se glisser dans la Présence du Seul et Unique ? Impossible ! Mais certains, dont je fais partie, peuvent entrer dans Sa Prescience. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes les élus. Nous œuvrons à déchiffrer ses plans. Vous êtes la Chercheuse. Je suis le Guide. Nos pensées ne peuvent mener qu’à la Révélation. Je vous en prie : ouvrez les rideaux. En grand.
La Chercheuse s’exécuta. La lumière du jour inonda la pièce. La voix de Papa D poursuivait la Chercheuse :
– Oui, regardez dehors et dites-moi ce que vous voyez.
La Chercheuse était montée par l’autre versant de la colline, qui n’était que misère totale et sans trêve. Mais sur ce flanc-là, ce qui lui sauta immédiatement aux yeux fut un fouillis autrement plus éclectique. Au bas du mont, on apercevait des corniches désordonnées de toits de tôles rouillées, de tuiles en terre cuite et de plaques d’acier, entrecoupées néanmoins çà et là de rangées de tours modernes, aussi isolées qu’immaculées. Des lignes grondantes de véhicules motorisés de toutes fabrications se faufilaient entre ces zones de contrastes. La ville commençait à peine à adopter son rythme du matin, de sorte qu’il y avait de vibrantes ruches d’humanité, des travailleurs perchés à l’arrière des mototaxis serpentant entre les mares laissées par les pluies de la nuit et le débordement des caniveaux. Un pan du lagon scintillait au loin. La Chercheuse se retourna et décrivit ses trouvailles à l’apôtre.
– À présent, j’aimerais que votre regard se resserre davantage sur le niveau où nous nous trouvons, ici, dans cette pièce. Laissez-le s’élever au-dessus de cette ville où il suppure, et se rapprocher de notre niveau. Entre l’endroit où vous êtes et ce spectacle de frénésie, qu’y a-t-il d’autre ?
La Chercheuse n’hésita pas un seul instant.
– Des ordures. Des monticules de déchets. Comme sur l’autre versant – me frayer un chemin jusqu’ici a été un vrai parcours d’obstacles. Les immondices de la ville, entassées partout.
Davina parut satisfait.
– Oui, un tas d’ordures. Vous l’avez bel et bien traversé en venant. Mais vous êtes ici maintenant : diriez-vous que vous vous trouvez au milieu d’un tas d’ordures ?
La femme fit non de la tête.
– Pas le moins du monde, Papa D.
L’apôtre hocha la tête, tout aussi satisfait.
– Refermez les rideaux, s’il vous plaît.
La Chercheuse obéit. L’intérieur de la pièce aurait dû se retrouver plongé dans la pénombre de tout à l’heure, et la femme s’attendait à devoir rebrousser chemin à tâtons, mais non. Des flèches multicolores, qui ressemblaient assez aux signaux lumineux indiquant les issues de secours sur le plancher des avions, guidèrent ses pas vers une autre section de la salle. Nul besoin du récital de sécurité d’une hôtesse de l’air pour l’informer de leur fonction – elle suivit les lumières. Celles-ci s’arrêtaient devant un tabouret délicatement ciselé. Il lui rappela ce tabouret royal ashanti dont elle avait vu des photos.
– Asseyez-vous. Je vais vous emmener en voyage, mettez-vous donc à l’aise.
Ce fut au tour du prédicateur de se lever.
– Ils sont nombreux, y compris chez nos propres concitoyens, à décrire ainsi cette nation : comme un vaste tas d’immondices. Mais voyez-vous, ceux qui l’affirment le font pour dénigrer. Moi, en revanche, j’y trouve du bonheur. À partir du moment où le monde produit des immondices, il faut bien qu’elles aillent s’entasser quelque part. Donc si notre nation est le tas d’immondices du monde, cela signifie que nous rendons service à l’humanité. Ça, c’est… une perspective. Puis-je en pointer une autre encore ?
La Chercheure acquiesça.
– Je suis tout ouïe, Papa D.
– Bien. Dès l’instant où vous m’avez parlé au téléphone, j’ai su que vous n’étiez pas une Chercheuse comme les autres. Votre voix m’a frappé comme étant celle d’une personne avide d’apprendre. J’offre mes conseils à toutes sortes de gens. Tous les brins de l’humanité franchissent cette porte. Vous seriez surprise d’apprendre quelles âmes contrastées sont venues s’asseoir sur ce même tabouret, si je décidais de vous le dire.
La Chercheuse eut un sourire entendu, repoussant d’un geste la proposition.
– Papa Davina, c’est cette raison qui m’amène. Votre réputation dépasse les frontières, non seulement de la nation, mais du continent tout entier.
– Oui, peut-être.
– Et même au-delà.
– Ah ? Dites-moi donc ce que vous avez entendu. Ceux qui ont guidé vos pas jusqu’ici, que disent-ils de Papa Davina ?
– Par où commencer ? soupira la femme. Eh bien, prenons le dernier en date, le candidat des Seychelles… Vous avez prié pour lui et le monde sait avec quel résultat.
Davina minimisa d’un geste l’importance de sa personne, faisant de ses mains deux vaisseaux flasques qui achevèrent leur course paumes vers le ciel, comme qui attribuerait ailleurs le crédit – et la gloire.
– Pour vous, j’ai élaboré… une perspective spéciale.
Comme il prononçait ces mots, Papa D parut se dissoudre dans la pénombre périphérique, mais la pièce, où la femme avait eu de la peine tout à l’heure à localiser la jointure des rideaux, s’emplit peu à peu de lumière, comme en remplacement de celle du jour, qu’elle venait d’éclipser. Ce n’était que le début. Sous les yeux de la Chercheuse, l’austère salle d’audience se changea peu à peu en un monde enchanté. Elle en eut le souffle coupé. Son hôte, bras tendu, semblait tournoyer lentement. Il tenait dans sa main un petit objet argenté entraîné lui aussi dans ce mouvement circulaire de plus en plus large. À l’évidence, l’apôtre avait pris place sur un plateau tournant ménagé dans le sol. Papa D pointa sa télécommande sur le plafond et… la lumière fut. Nouveau cliquetis à peine audible et un gargouillis d’eau vint rompre le silence, son origine se dévoilant peu à peu – une fissure dans un rocher qui s’était élevé par magie, source dont les eaux scintillantes tombaient en cascade comme une apaisante caresse, puis serpentaient jusqu’à une grotte où elles disparaissaient à tout jamais. Un paysage ondulé de collines et de vallées, de plaines et de plateaux, se déployait vers l’horizon lointain, tandis que des tubes jaillis du sol, irradiant une douce lumière, fusaient en direction du plafond, baignant la pièce d’un éclat psychédélique. Progressivement, une alcôve se dessina, tremblante, puis une autre juste en face, puis une troisième à la perpendiculaire et, enfin, une quatrième qui vint parachever cette installation en trois dimensions. Équidistantes les unes des autres, les alcôves hébergeaient symboliquement les quatre points cardinaux. Incrustée dans les dalles de bois poli du plancher, une vaste carte du Zodiaque entama sa propre illumination graduelle. Un pot-pourri d’encens enveloppa la Chercheuse..." (Éditions du Seuil, août 2023, pour la traduction française)
La trame narrative suit principalement quatre amis d'université, autrefois idéalistes, dont les chemins ont divergé ...
- Dr. Kighare Menka : Un chirurgien réputé et intègre qui découvre le scandale macabre lorsque des corps de ses patients sont mutilés. Il est le conscience morale de l'histoire.
- Sir Godfrey Danfere : Une figure puissante et énigmatique, "Père fondateur" de la nation et patriarche cynique. Il est au cœur d'un complexe réseau religieux et politique appelé "The Gong" et incarne la corruption absolue.
- Duyole Pitan-Payne : Un ingénieur brillant et prospère, nommé pour un prestigieux poste international. Son succès et son intégrité en font une cible pour ceux qui veulent maintenir le statu quo corrompu.
- Papa Davina : Un "hommesaint" (play on words entre "holy man" et "saint homme"), leader d'une mégéglise prospère et frauduleuse. Il représente la perversion de la religion à des fins de pouvoir et d'argent.
L'intrigue débute lorsque Menka, horrifié par sa découverte, tente d'avertir ses anciens amis, notamment Duyole. Cette tentative de révélation déclenche une série de manipulations, de conspirations et de menaces qui visent à le faire taire et à éliminer quiconque menace l'entreprise lucrative.
Soyinka montre une société où chaque institution – gouvernement, religion, affaires – est rongée par un vice profond et où l'apparence prime sur la réalité. La satire des télé-évangélistes et des "hommesaints" est impitoyable. Papa Davina et son église "The Gong" sont montrés comme des entreprises criminelles manipulant la foi des masses. Les "Pères fondateurs" de la nation, comme Sir Godfrey, sont dépeints non comme des héros, mais comme les architectes d'un système corrompu qu'ils entretiennent pour leur profit. Le roman questionne ce qui définit une nation lorsque ses fondements moraux se sont effondrés. Le titre ironique interroge : comment peut-on être "heureux" dans un tel contexte ?
"L’Évangile selon le bonheur - Nul n’ignorait plus que cette nation qu’on surnommait le Géant de l’Afrique avait été désignée comme abritant les Gens les plus heureux du monde. Ce qui n’était pas clair, en revanche, c’est comment elle s’était vu attribuer une telle reconnaissance et comment, par consensus universel, elle avait pu la mériter. Il fallait aider les autres nations ambitionnant ce titre à sortir de la jalousie qui les étreignait, malaise qui entraînait de leur part des efforts voués à l’échec pour lui arracher sa couronne. La sagesse des anciens souffle qu’il est plus digne de reconnaître un champion dès lors qu’il est indiscutable, et de marcher dans les pas de ce leader, plutôt que de se lamenter en se tortillant de colère. Comme les Yoruba ont coutume de le sermonner : Ti a ba ri erin igbo k’a gba wipe a ri ajanaku, ka ye so wipe a ri nka nto lo firi. Quand tu croises un éléphant, admets que tu as vu le seigneur de la forêt, au lieu de prétendre avec désinvolture que quelque chose a vaguement traversé ton champ de vision.
Peu de nations, par exemple, pouvaient se targuer de posséder un ministère du Bonheur. Cette innovation émanait pourtant d’un des États les plus démunis de cette nation fédérale. Sa ministre pionnière, ou plutôt sa commissaire, était l’épouse de l’imaginatif gouverneur de cet État, tandis que d’autres membres de la famille et proches occupaient les divers postes créés par l’instauration de ce ministère unique en son genre. Mais pour ne pas qu’on s’imagine que cette Première famille était seule responsable du prodige d’une telle décision unanime à l’échelle du monde entier, il convient de préciser qu’entre autres références à faire valoir, l’amour des titres et leur généreuse distribution dans le pays avaient joué leur rôle. Les gens avaient tendance à oublier que la célébration d’un seul de ces titres par le peuple aurait souvent suffi à financer les plans budgétaires annuels d’autres nations. Il y avait d’autres fondements, négligés quoique monumentaux. Est-il besoin de citer, par exemple, la multiplication constante et exponentielle des lignées de chefs traditionnels, d’un simple trait de plume tiré sur des histoires et des cultures entières par les gouverneurs des différentes provinces ?
Une ancienne cité yoruba connue sous le nom d’Ibadan, qui avait jadis formé un domaine monarchique autosuffisant, et ne présentait pourtant aucun signe évident de grossesse, avait accouché un beau jour de vingt-quatre nouveaux royaumes, en pleine époque d’affirmation forcenée de la démocratie. Cet exploit ne resta pas incontesté. Il fut bientôt égalé – ou peu s’en faut – à l’autre extrémité de l’axe national avec l’enfantement de quatorze émirats par une autre entité historique baptisée Kano. Les nouveaux rois/émirs furent présentés, avec force bâtons de commandement et autres parchemins de nomination royale, par leurs gouverneurs en exercice, ce qui généra des cérémonies de masse flamboyantes, dans une immense liesse populaire. Des couronnes/turbans individuels, évidemment confectionnés sur mesure pour convenir à chacun des crânes royaux, furent posés et enroulés autour des têtes et des bajoues des nouveaux monarques – qui n’avaient été jusqu’ici que de simples chefs de village, de petits seigneurs sans importance. Et ainsi de suite : les rabat-joie professionnels de ce monde avaient l’imagination trop courte pour visualiser les immenses festivités qui submergeraient naturellement l’ensemble d’un pays si prodigue en élévations, la garantie de carnavals quasiment quotidiens, favorisant la croissance du tourisme et l’essor de cette industrie associée qu’était le kidnapping avec demande de rançon.
Nombre de facteurs essentiels étaient généralement sous-estimés par les nations concurrentes, ce qui était en grande partie dû au souci de leurs intérêts propres et à leur désir obsessionnel d’arracher la couronne du bonheur du crâne de la nation qui la méritait amplement. Malheureusement, ce genre d’attitudes partisanes et intéressées ne faisait que semer la confusion, même au sujet des fêtes annuelles les plus habituelles – religieuses, séculaires, commémoratives, etc. – auxquelles avait droit toute nation souveraine ayant le minimum de respect traditionnel pour le monde des vivants, celui des ancêtres et le monde de ceux qui viendraient après.
La tendance à confondre réjouissances politiques et fiestas populaires était typique de ces malentendus dont se rendaient coupables les touristes en quête de divertissement – mais également, d’ailleurs, certains citoyens négligents. Le fardeau de cette confusion sur la nature des célébrations pesait au plus haut point sur la fête du Choix du Peuple. Certes, fêtes politiques et fêtes culturelles présentaient quelques similitudes, dont la plus notable était leur tendance commune à s’étendre indéfiniment, année après année, bien que des dates spécifiques leur eussent été allouées, clairement indiquées sur le calendrier national. Pourtant, il s’agissait de deux entités bien distinctes. Surnommée la Bringue de l’Année, la Concorde du Peuple, la Nuit des Nuits, etc., la fête du Choix du Peuple, cette célébration populaire unique en son genre, aurait dû, dans le strict respect des règles, se dérouler le week-end suivant la fête de l’Indépendance. Laquelle était, sans la moindre ambiguïté, un événement politique. Cette proximité était source d’une autre confusion, mineure celle-ci et sans grande conséquence, car quasiment plus personne ne se souvenait de ce que signifiait l’indépendance. Un défilé militaire, un apathique discours adressé à la nation, des appels au patriotisme, la récitation d’une insipide liste de décorations, et la vie de la nation reprenait aussitôt son cours, dans l’attente de ce qui était le véritable événement de l’année, en termes de popularité : la fête du Choix du Peuple et sa grande remise de prix.
Certains cyniques et autres révisionnistes insinuaient volontiers que cette célébration était une invention du People on the Move Party – le parti du Peuple en mouvement. Là encore, c’était très éloigné de la réalité. Bien sûr, ce parti se targuait lui aussi d’être un modèle de pratique démocratique, mais l’analogie des concepts n’allait pas plus loin. L’unique mérite que s’attribuait le POMP – acronyme évident du parti – était son libéralisme, qui permettait à un tel événement festif, œcuménique, non partisan non seulement de s’enraciner et de prospérer, mais de s’étendre progressivement de part et d’autre de ses dates officielles au point de couvrir toute l’année et de même déborder parfois sur celle d’après, ses célébrations se prolongeant jusqu’au commencement de l’édition suivante. Nulle autre réjouissance au monde ne pouvait se vanter d’une expansion aussi constante. C’était devenu une fête sans fin, qui accumulait en outre les arriérés de cérémonies – les résidus étant reportés à l’année suivante.
Le Choix du Peuple faisait bien davantage que polir l’image du gouvernement ou du parti au pouvoir : il améliorait grandement la représentation cabossée que le reste du monde se faisait des citoyens de la nation. La fête, riche déjà de nombreuses éditions, prouvait, contrairement à ce que semblaient suggérer les élections dans ce pays, que les Nigérians, quand on leur en donnait l’occasion, avaient deux ou trois choses à enseigner au monde sur cette culture politique si injustement attribuée aux Athéniens. Si le gouvernement se rendait coupable d’une quelconque intervention, celle-ci s’était jusqu’ici limitée à déclarer patrimoine national la Fiesta de la Nuit des Nuits, point d’orgue des célébrations, dont l’intensité culminait avec la remise des Yeomen of the Year, qui faisaient désormais partie du patrimoine national. Le gouvernement avait pris l’initiative sans précédent de transmettre officiellement à l’UNESCO cette résolution – avec pas moins de vingt-cinq millions de signatures vérifiées, prouesse que trois éditions successives du Recensement national n’avaient su accomplir ! Si nous avions échoué à le faire, nous aurions failli à notre devoir, et bien évidemment aurions été accusés d’indifférence à l’égard du patriotisme, de l’art et de la créativité. Et maintenant que nous avons accompli notre devoir, voilà qu’on nous cloue au pilori en nous reprochant de promouvoir je ne sais quel sinistre agenda gouvernemental. Notre peuple est tout bonnement impossible à satisfaire !
La fête du Choix du Peuple était systématiquement programmée le week-end qui suivait celle de l’Indépendance, célébrant ce jour historique où les anciens maîtres impériaux avaient été paisiblement destitués par les électeurs, sans qu’une goutte de sang soit versée – l’indépendance sur un plateau d’or, comme l’avait alors claironné un nationaliste très en vue, qui allait plus tard devenir le président de la nation. Le fait que celle-ci ait ensuite amplement rattrapé cet écart de conduite en plongeant dans une guerre civile qui avait duré plus de deux années ne pouvait être imputé au POMP, qui n’existait pas encore à l’époque de l’indépendance, et encore moins au moment de ce conflit qu’on appelait communément la guerre de sécession du Biafra. Ce qui comptait aux yeux du peuple, c’était le phénix de la splendeur, renaissant des cendres de la colonisation.
Cette fête était décidément unique. Elle s’achevait par une pléthore de récompenses, qui catapultaient au firmament de la reconnaissance publique une nouvelle classe de citoyens connus sous le nom de Yeomen of the Year – « serviteurs de l’année », ou YoY –, honneur qui exprimait la reconnaissance d’un peuple envers ceux qui œuvraient pour l’intérêt public bien au-delà de ce que leur dictaient leur devoir, l’appât du gain ou de la gloire ..." (Éditions du Seuil, août 2023, pour la traduction française)
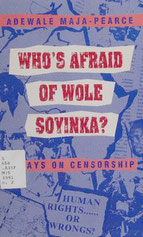
"Whoʼs afraid of Wole Soyinka? : essays on censorship"( Adewale Maja-Pearce)
Heinemann International ; Heinemann Educational Books, Oxford, Portsmouth, N.H., USA, England, 1991
Adewale Maja-Pearce est un écrivain et critique nigérian renommé, connu pour ses positions intellectuelles intransigeantes et ses analyses sans complaisance de la société nigériane et africaine. Dans "Who's Afraid of Wole Soyinka?" (publié en 1991), il utilise la figure titanesque de Wole Soyinka – dramaturge, poète, romancier, essayiste, militant et premier Africain lauréat du prix Nobel de littérature (1986) – comme point d'entrée pour mener une enquête plus large et plus profonde sur la censure, la responsabilité de l'intellectuel et les pathologies du pouvoir en Afrique postcoloniale.
L'ouvrage est bien plus qu'une simple étude sur la censure gouvernementale. Il explore ses mécanismes multiples et insidieux. Voici ses révélations principales :
- La Censure comme Symptôme d'un Mal Plus Profond
Maja-Pearce argue que la censure directe (emprisonnement, interdiction de livres, fermeture de journaux) n'est que la manifestation la plus visible d'un problème plus profond : l'échec de l'État postcolonial africain et son rejet de toute forme de critique. La volonté de contrôler la narrative et de museler les voix dissidentes est inhérente à la nature souvent autocratique et kleptocratique des régimes en place.
- La Figure de Soyinka comme Archétype de l'Intellectuel Contestataire
Le titre est provocateur. "Qui a peur de Wole Soyinka?" sous-entend que son immense stature intellectuelle et morale représente une menace existentielle pour les pouvoirs en place.
- L'Engagement comme Principe : Maja-Pearce présente Soyinka non pas comme un artiste isolé dans sa tour d'ivoire, mais comme le modèle de l'intellectuel engagé qui utilise sa plume et sa notoriété comme des armes contre l'injustice, la tyrannie et l'absurdité du pouvoir. Son emprisonnement pendant la guerre civile du Nigeria (décrit dans Cet homme est mort) est l'exemple ultime du prix à payer pour la dissidence.
- Un Standard Moral : Le livre révèle comment la simple existence d'une voix aussi libre et aussi critique que celle de Soyinka sert de repoussoir et de miroir pour les régimes autoritaires, les obligeant à se révéler dans leur brutalité lorsqu'ils tentent de le réduire au silence.
L'une des analyses les plus percutantes de Maja-Pearce va au-delà de la censure étatique active. Il révèle une forme de censure peut-être plus dangereuse et insidieuse,
- la Négligence Institutionnelle : Le manque criant de bibliothèques, de maisons d'édition vigoureuses, de librairies et de soutien aux auteurs dans de nombreux pays africains constitue une forme de censure passive. Il s'agit d'un étouffement par indifférence, qui prive les populations d'accès à la connaissance et à la littérature.
- Maja-Pearce critique le système éducatif hérité de la colonisation, qui continue de privilégier les canons et les auteurs occidentaux au détriment des auteurs africains. Cette déconnexion entre le public africain et ses propres intellectuels est une censure structurelle qui empêche l'émergence d'un espace public littéraire et critique dynamique et local.
La Complicité et l'Auto-Censure des Élites Intellectuelles ...
C'est peut-être la révélation la plus amère du livre. Maja-Pearce ne épargne pas les collègues de Soyinka :
- La Trahison des Clercs : Il accuse de nombreux intellectuels et artistes africains de complaisance et de complicité avec les régimes corrompus, par lâcheté, par opportunisme ou par cynisme. Leur silence ou leurs louanges opportunistes constituent une forme de trahison envers leur mission.
- L'Auto-Censure : La peur des représailles (perte de privilèges, emploi, sécurité) conduit à une auto-censure généralisée, où les artistes et penseurs évitent eux-mêmes les sujets sensibles. Cela crée un climat intellectuel appauvri et timoré.
La Lutte pour la Liberté d'Expression comme Combat Fondamental ...
À travers la lentille de Soyinka, Maja-Pearce affirme que la liberté d'expression n'est pas un luxe mais la condition sine qua non pour toute société saine, juste et démocratique. Sans la capacité de critiquer, de remettre en question et de débattre, aucune nation ne peut véritablement se construire ou se corriger.
"Who's Afraid of Wole Soyinka?" est bien plus qu'un recueil d'essais sur un seul homme. C'est un véritable réquisitoire contre la lâcheté des intellectuels et la brutalité des dictatures, et une défense passionnée du rôle de l'écrivain comme conscience de sa nation.
De nombreux maux qu'il pointait du doigt dans les années 90 (corruption, délitement de l'éducation, montée de l'intolérance) continuent de hanter le Nigeria et une grande partie de l'Afrique aujourd'hui...
La peur de Soyinka est, en réalité, la peur de la vérité, de la liberté et de la reddition des comptes ...
