- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bogart
- Bataille - Michaux
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Bloch
- Algren - Irish
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Lewin - Mayo - Maslow
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Pollock
- Achébé - Soyinka
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Capote - Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- Onetti - Sábato
- Sillitoe
- McCarthy - Minsky
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Cortázar
- Warhol
- Dolls
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- Ellis
- HarperLee
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Calvino
- Kôno
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Carpentier
- Pollock
- Achébé - Soyinka
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor

Miguel Angel Asturias (1899-1974), "Leyendas de Guatemala" (1930), "El señor Presidente" ( Monsieur le Président, 1946), "Hombres de maíz" (1949), "Trilogía bananera" (1950-1960), "Epopeya de los Andes verdes" (1969-1971), "Tres de cuatro soles" (1971) - ...
Last update : 03/03/2017
Miguel Ángel Asturias occupe une place centrale dans la littérature latino-américaine du XXe siècle. Son œuvre se distingue par l'intégration de la culture indigène, la dénonciation des dictatures, la critique de l'impérialisme économique et l'innovation stylistique, ce qui lui a valu le prix Nobel de littérature en 1967. Il a en effet profondément enraciné sa littérature dans les traditions et les mythes des peuples mayas du Guatemala. Son roman "Hombres de maíz" (1949) en est un exemple marquant, mettant en lumière les croyances et les luttes des communautés indigènes face à la modernisation et à l'exploitation. Cette approche a contribué à faire connaître et respecter les cultures autochtones dans la littérature mondiale.
Bien que le réalisme magique soit souvent associé à des auteurs comme Gabriel García Márquez, Asturias est reconnu comme l'un de ses pionniers. Dans "Leyendas de Guatemala" (1930), il mêle mythes, rêves et réalité pour créer une narration unique. Cette fusion du réel et du fantastique a ouvert la voie à une nouvelle forme d'expression littéraire en Amérique latine.
Asturias a expérimenté des techniques narratives audacieuses, influencées par le surréalisme et les avant-gardes européennes. Dans "El Señor Presidente" (1946), il utilise des images oniriques, des jeux de langage et une structure fragmentée pour dépeindre la réalité oppressante d'une dictature. Cette œuvre est considérée comme un jalon dans la littérature politique et a influencé de nombreux écrivains du "Boom" latino-américain...

Miguel Angel Asturias (1899-1974)
Né en 1899 à Guatemala City,dans une famille de classe moyenne, son père était juge, sa mère, institutrice d’ascendance maya-quiché, deux univers baignant son enfance, l'univers juridique et libéral de son père et la tradition orale maya transmise par sa mère et sa nourrice indígène.
Depuis 1899, le Guatemala vit sous la dictature de Manuel Estrada Cabrera, avocat et juge, qui avait gravi les échelons et était devenu président par intérim en 1898 après l’assassinat de Reina Barrios : "El Salvador de la Patria" (Le Sauveur de la Patrie) imposera des statues de la déesse Minerve (symbole de "progrès") dans tout le pays et se maintiendra au pouvoir jusqu’en 1920 (22 ans de régime). Il éliminera bien des opposants via sa Police secrète (La Mano Dura). A la même époque s'impose la fameuse United Fruit Company (1899-1970), l’empire du fruit qui façonnera l’Amérique latine (1899-1970), surnommée "El Pulpo", la pieuvre, pour son emprise tentaculaire, ou "Mamita Yunai" (en Amérique centrale) et qui contrôlera le Guatemala, Honduras ("République bananière"), Costa Rica, Colombie, Cuba selon des pratiques particulièrement controversées.
L'exil salvadorien (1904-1908) marque la première étape de la vie d'Asturias : son père, menacé pour son indépendance judiciaire (il refuse de condamner des opposants politiques), entraîne sa famille à San Salvador, capitale du Salvador voisin. Asturias découvre ainsi l’arbitraire dictatorial (même en exil, son père reste surveillé) et les inégalités sociales au Salvador (opposition entre oligarchie caféière et paysans pauvres). Mais les difficultés économiques au Salvador (le père peine à exercer comme avocat) et l'atténuation temporaire de la répression au Guatemala (Estrada Cabrera cherche à améliorer son image internationale), marque le retour en 1908 de la famille d'Asturias ; son père évitera toute fonction publique pour ne pas attirer l’attention et la famille vivra discrètement à Guatemala Ciudad, sous surveillance.
Asturias entre à la Faculté de Droit de l'Université San Carlos (Guatemala) en 1917, à 18 ans. L'université est alors un foyer de résistance intellectuelle contre la dictature d'Estrada Cabrera (À San Carlos, j'ai appris que les lois ne servent à rien sans la révolte) et soutiendra en 1923 une thèse remarquée, "El problema social del indio" (Le problème social de l'Indien), dénonçant l'exploitation des Mayas par le système des haciendas...
L'épisode peu connu (1917-1918) mais déterminant du séjour d'Asturias à Salamá (Baja Verapaz) s'inscrit dans une période cruciale de sa formation intellectuelle et politique (mes vraies études furent dans les prisons où j'accompagnais mon père, et dans les champs où mouraient les Indiens).
Jeune étudiant en droit (environ 18 ans), Asturias passe près d'un an à Salamá, son père, Ernesto Asturias, y est juge de première instance et l'y invite pour qu'il découvre le système judiciaire rural. Il découvre la réalité indigène (Salamá est située dans une région à forte population maya achí), les conditions de vie des paysans exploités par les grands propriétaires (ladinos), la persistance des traditions orales mayas (mythes, rites agricoles), y recueille des récits qui inspireront "Hombres de maíz" (1949), et y acquiert une expérience concrète de l'injustice sociale : la partialité des tribunaux en faveur des puissants, le sort des indigènes accusés sans défense (thème central dans "El Señor Presidente"). Il y rencontrera le prêtre Carlos Federico Mora, défenseur des indigènes, qui l'initie à la théologie de la libération avant l'heure, et des guérisseurs traditionnels qui lui enseignent la cosmovision maya.
Manuel Estrada Cabrera est renversé en 1920 par un mouvement mené par des étudiants et des libéraux, déclenché après qu’il ait tenté de prolonger son mandat (il meurt en prison en 1924). L'élection de José María Orellana (1921) ne change rien quant à la corruption du régime et à la mainmise des compagnies bananières sur le processus démocratique.
Parallèlement, Asturias fait ses débuts journalistiques en collaborant sous pseudonyme à "El Imparcial" (1919-1922), découvre Darío (modernisme) et les surréalistes français (via des revues importées) et commence ses recherches sur le "Popol Vuh", le texte sacré des Mayas-Quichés, racontant la création du monde, les mythes des dieux-jumeaux et l'origine de l'humanité (Asturias le traduira et s'en inspirera pour ses œuvres) ...
Grâce au soutien de son professeur Antonio Batres Jáuregui, il obtient une bourse pour étudier l'économie politique à Londres, mais bifurquera vers l'ethnologie à Paris...
L'expérience parisienne (1924-1933), la maturation artistique ...
Après avoir obtenu son diplôme en droit en 1923, Asturias s'est installé à Paris, où il a étudié l'ethnologie à la Sorbonne. Sous la direction de l'anthropologue Georges Raynaud, spécialiste des cultures mésoaméricaines, il a approfondi ses connaissances sur la civilisation maya. En 1925, il a entrepris la traduction du "Popol Vuh", le texte sacré des Mayas, en espagnol, un projet qui a duré plusieurs décennies.
Durant son séjour à Paris, Asturias a été influencé par le mouvement surréaliste, notamment par André Breton. Cette influence se manifeste dans son style d'écriture, qui mêle rêve, mythe et réalité. Asturias a utilisé ces techniques pour explorer et exprimer l'identité hybride du Guatemala, fusionnant les héritages indigène et européen.
Il commence à écrire dans les années 1930 et entre en politique au Guatemala aux côtés de Jacobo Árbenz Guzmán, premier président du Guatemala à être élu au suffrage universel en 1951, après une transition démocratique initiée par la Révolution de 1944. Pourfendeur de l'explotation du pays par la United Fruit Company (El Papa Verde, 1954), il devient diplomate au Mexique, en Argentine, au Salvador, mais connaît l'exil en Argentine de 1954 à 1961, suite à l'invasion du Guatemala par les marines nord-américains, qui renverse le régime (un coup d'État soutenu par la CIA le 27 juin 1954 et un tournant dans l'histoire guatémaltèque et latino-américaine) ...
Il faudra attendre les années 1980 pour qu'un semblant de stabilisation s'impose enfin dans un pays déchiré pendant plusieurs décennies ...
Asturias est expulsé d'Argentine en 1962 pour ses positions en faveur de Castro, et trouve en Europe et en France la terre d'accueil qu'il recherche. Il reçoit le Prix Lénine pour la paix en 1966 et le Prix Nobel de littérature en 1967, puis est nommé ambassadeur par le gouvernement Méndez Montenegro de 1966 à 1970.
Miguel Angel Asturias a écrit une trentaine d'ouvrages dont "El Señor Presidente", "Leyendas de Guatemala" (1930), publié en Espagne avec une lettre de Paul Valery en prologue, "Hombres de maíz" (1949, réputé pour sa complexité, "Mulata de tal" (1963), la "Trilogía bananera" (Viento Fuerte, El Papa Verde, Los ojos de los enterrados, 1950-1960), un récit-document engagé sur l’exploitation capitaliste, et l' "Epopeya de los Andes verdes", 1969-1971,une épopée mythologique sur la survie culturelle, comportant "Maladrón" (1969) et "Tres de cuatro soles" (1971) ...

"Leyendas de Guatemala" (1930)
Ce recueil comporte un préambule composé de deux contes où la légende et l`histoire se confondent pour évoquer tour à tour le passé colonial de la capitale du Guatemala ("Guatemala") et les premiers temps du peuple maya quiché : "Maintenant je me souviens" (Ahora que me acuerdo), selon le procédé alors cher à Asturias, qui consiste à remonter la chronologie au lieu de la descendre. Dans ce préambule, Asturias se sert de l'histoire en la débarrassant du poids mort de l'èrudition et en ne l'utilisant que sous l'angle de ses possibilités dans le domaine de l'art.
A ces deux contes font suite les légendes proprement dites. Là, l'invention d`Asturias joue avec les mythes et les traditions en respectant leur inspiration populaire, sans renier toutefois le modernisme dont il subit l'influence, cependant que grandit en lui celle du surréalisme. C'est ainsi que son goût marqué pour l'exotisme, les matières précieuses, l'esthétisme pur cède peu à peu le pas dans certaines de ces légendes à l'automatisme presque incontrôlé.
Dans celle du "Volcan" (Volcán), Asturias conte au lecteur le, premier peuplement, en partie mythique, du Guatemala. Puis c'est la légende du Cadejo "qui enlève les filles aux longues tresses et fait des nœuds aux crinières des chevaux" ; de la Tatuana, qui se rend invisible quand elle est en danger grâce au tatouage du Maître-Amandier ; du Sombrerón, chapeau du diable, dernière métamorphose d`une balle en caoutchouc venue tenter un prêtre dans son couvent ; du "Trésor du pays fleuri" (Tesoro del lugar florido), que protège le volcan dressé contre les hommes du conquérant Pedro de Alvarado.
Leyenda del Cadejo
"Madre Elvira de San Francisco, prelada del monasterio de Santa Catalina, sería con el tiempo la novicia que recortaba las hostias en el convento de la Concepción, doncella de loada hermosura y habla tan candorosa que la palabra parecía en sus labios flor de suavidad y de cariño.
Desde una ventana amplia y sin cristales miraba la novicia volar las hojas secas por el abraso del verano, vestirse los árboles de flores y caer las frutas maduras en las huertas vecinas al convento, por la parte derruida, donde los follajes, ocultando las paredes heridas y los abiertos techos, transformaban las celdas y los claustros en paraísos olorosos a búcaro y a rosal silvestre; enramadas de fiesta, al decir de los cronistas, donde a las monjas sustituían las palomas de patas de color de rosa, y a sus cánticos los trinos del cenzontle cimarrón.
Fuera de su ventana, en los hundidos aposentos, se unía la penumbra calientita, en la que las mariposas asedaban el polvo de sus alas, al silencio del patio turbado por el ir y venir de las lagartijas y al blando perfume de las hojas que multiplicaban el cariño de los troncos enraizados en las vetustas paredes.
Y dentro, en la dulce compañía de Dios, quitando la corteza a la fruta de los Ángeles para descubrir la pulpa y la semilla que es el Cuerpo de Cristo, largo como la medula de la naranja —¡vere tu es Deus absconditus!—, Elvira de San Francisco unía su espíritu y su carne a la casa de su infancia, de pesadas aldabas y levísimas rosas, de puertas que partían sollozos en el hilván del viento, de muros reflejados en el agua de las pilas a manera de huelgo en vidrio limpio.
Las voces de la ciudad turbaban la paz de su ventana, melancolía de viajera que oye moverse el puerto antes de levar anclas; la risa de un hombre al concluir la carrera de un caballo o el rodar de un carro, o el llorar de un niño.
Por sus ojos pasaban el caballo, el carro, el hombre, el niño, evocados en paisajes aldeanos, bajo cielos que con su semblante plácido hechizaban la sabia mirada de las pilas sentadas al redor del agua con el aire sufrido de las sirvientas viejas.
Y el olor acompañaba a las imágenes. El cielo olía a cielo, el niño a niño, el campo a campo, el carro a heno, el caballo a rosal viejo, el hombre a santo, las pilas a sombras, las sombras a reposo dominical y el reposo del Señor a ropa limpia…
Oscurecía. Las sombras borraban su pensamiento, relación luminosa de partículas de polvo que nadan en un rayo de sol. Las campanas acercaban a la copa vesperal los labios sin murmullo. ¿Quién habla de besos? El viento sacudía los heliotropos. ¿Heliotropos o hipocampos? Y en los chorros de flores mitigaban su deseo de Dios los colibríes. ¿Quién habla de besos? … "
Mère Elvira de San Francisco, supérieure du monastère de Santa Catalina, fut autrefois la novice qui découpait les hosties dans le couvent de la Conception, une jeune fille d’une beauté louée et d’un langage si candide que la parole semblait, sur ses lèvres, une fleur de douceur et de tendresse.
Depuis une large fenêtre sans vitres, la novice contemplait les feuilles sèches emportées par les ardeurs de l’été, les arbres se parer de fleurs et les fruits mûrs tomber dans les jardins voisins du couvent, du côté délabré, où les feuillages, cachant les murs blessés et les toits ouverts, transformaient les cellules et les cloîtres en paradis embaumés de terre cuite et d’églantiers ; des tonnelles de fête, selon les chroniqueurs, où les colombes aux pattes roses remplaçaient les nonnes, et leurs chants, les trilles du moqueur sauvage.
Au-dehors, sous sa fenêtre, dans les appartements enfouis, la pénombre tiède se mêlait au silence de la cour, troublé par les allées et venues des lézards, et au doux parfum des feuilles qui multipliaient l’affection des troncs enracinés dans les vieux murs.
Et à l’intérieur, dans la douce compagnie de Dieu, épluchant le fruit des Anges pour en découvrir la pulpe et la graine, qui est le Corps du Christ — long comme la moelle de l’orange (vere tu es Deus absconditus !) —, Elvira de San Francisco unissait son esprit et sa chair à la maison de son enfance, aux lourds heurtoirs et aux roses légères, aux portes qui déchiraient des sanglots dans les coutures du vent, aux murs reflétés dans l’eau des bassins comme une buée sur un verre propre.
Les voix de la ville troublaient la paix de sa fenêtre, une mélancolie de voyageuse entendant s’agiter le port avant le lever de l’ancre ; le rire d’un homme après une course de cheval, le roulement d’une charrette ou les pleurs d’un enfant.
Devant ses yeux défilaient le cheval, la charrette, l’homme, l’enfant, évoqués dans des paysages villageois, sous des cieux dont le visage placide ensorcelait le regard sage des bassins assis autour de l’eau, avec l’air résigné des vieilles servantes.
Et l’odeur accompagnait les images. Le ciel sentait le ciel, l’enfant sentait l’enfant, la campagne sentait la campagne, la charrette sentait le foin, le cheval sentait le vieil églantier, l’homme sentait le saint, les bassins sentaient l’ombre, les ombres sentaient le repos dominical, et le repos du Seigneur sentait le linge propre…
La nuit tombait. Les ombres effaçaient sa pensée, ce lien lumineux de particules de poussière nageant dans un rayon de soleil. Les cloches approchaient de la coupe vespérale des lèvres sans murmure. Qui parle de baisers ? Le vent secouait les héliotropes. Héliotropes ou hippocampes ? Et dans les jets de fleurs, les colibris apaisaient leur désir de Dieu. Qui parle de baisers ?…
La seconde partie du volume est consacrée à un récit intitulé "Les Sorciers de l'orage du printemps" (Los Brujos de la Tormenta Primaveral), très fortement inspiré du "Popol Vuh", bible du peuple maya quiché dont Asturias avait traduit l'adaptation française faite par Georges Raynaud, et où il puise d'ailleurs de nombreux éléments de son ouvrage tout entier. Il est très difficile de comprendre "Les Sorciers de Forage du printemps" sans avoir recours au Popol Vuh, malgré les nombreuses notes explicatives d'Asturias. Il n'est pas inutile non plus de connaître ses autres sources : "Les Annales des Xahiles" et le "Chilam Balam". En effet, la plupart des personnages, directement ou allusivement, les événements, faits, épisodes, les thèmes (rôle du Nahual ou double qui accompagne chaque homme, rôle de la magie) sont directement empruntés à ces divers monuments du passé littéraire de tradition orale maya quiché. Par ailleurs, l'influence du surréalisme est nettement plus présente ici que dans les autres chapitres, en particulier dans les images, extrêmement abondantes, qui visent souvent à l'expressivité ou bien qui se substituent à l'idée, devenant de véritables symboles, ou bien encore, et le plus fréquemment, sont gratuites, arbitraires et recréent la réalité ou plutôt en créent une nouvelle, surprenante, choquante, dépaysante si possible.
L'ouvrage se termine par une pièce de théâtre, dont les éléments sont tirés en partie de l'une des rares évocations scéniques conservées des Mayas : le "Rabinal-Achí". Parmi les personnages. Kukulkan, incarnation maya de Quetzalcoatl, dieu du soleil aztèque, aujourd'hui oublié ; Guacamayo, personnification du faux dieu, et presque de l'anti-dieu, rival de Quetzalcoatl, parfaitement ridicule et tourné en dérision tout au long des différentes scènes.
La technique d`Asturias dans cet ouvrage soigneusement travaillé, - il a été composé en quatre ans -, est éblouissante. Outre l'habile maniement de la chronologie et le rôle important de l'image, auxquels on a fait allusion, Asturias joue avec les sons à l'état pur, invente des mots, en décomposant des mots composés, en accouplant des mots isolés, en créant des néologismes, etc. "Les Légendes" plongent le lecteur dans un monde ensorcelant où, comme le dit Paul Valéry, "le volcan, les moines, l'homme-pavot, le marchand de bijoux sans prix, les "bandes d'ivrognesses dominicales", les "maîtres-mages qui vont dans les villes enseigner la fabrication des tissus et la valeur duzéro", composent les plus délirants des songes" ... - Trad. Gallimard, 1953.

"El señor Presidente" ( Monsieur le Président, 1946)
Ce roman, dont l`action se déroule dans une république latino-américaine sans nom, est tout entier tissé autour du personnage qui lui donne son titre, Monsieur le Président, énorme araignée venimeuse tapie au centre de sa toile. Anonyme comme I'Etat qu'il dirige, et lugubre, c'est une sorte de croque-mort caricatural : il n'apparaît vraiment que dans deux scènes où, faussement bonhomme et pris de boisson, il ne livre à son entourage que l`image qu`il lui plaît alors d`offrir. Pourtant, il envahit l`œuvre du premier au dernier chapitre, plus terrible encore absent que présent, menace continuelle, réfléchie dans chaque individu. lequel, espion aujourd`hui, sera demain torturé et condamné. à moins que ce ne soit l`adversaire qui devienne complice, les uns et les autres restant toujours prisonniers de l'angoisse insurmontable, monstrueuse, que fait régner Monsieur le Président.
"En el portal del Señor
... ¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre! Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, maldoblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. ¡Alumbra, lumbre de alumbre, Luzbel de piedralumbre, sobre la podredumbre! ¡Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, Luzbel de piedralumbre!
¡Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbre..., alumbra..., alumbra, lumbre de alumbre..., alumbra, alumbre...!
Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la Catedral helada, de paso hacia la Plaza de Armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás íngrima y sola.
La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el Portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes con tirria de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse, rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones, con la cabeza en el costal de sus riquezas: desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados.
En las gradas del Portal se les veía, vueltos a la pared, contar el dinero, morder las monedas de níquel para saber si eran falsas, hablar a solas, pasar revista a las provisiones de boca y de guerra, que de guerra andaban en la calle armados de piedras y escapularios, y engullirse a escondidas cachos de pan en seco. Nunca se supo que se socorrieran entre ellos; avaros de sus desperdicios, como todo mendigo, preferían darlos a los perros antes que a sus compañeros de infortunio.
Comidos y con el dinero bajo siete nudos en un pañuelo atado al ombligo, se tiraban al suelo y caían en sueños agitados, tristes; pesadillas por las que veían desfilar cerca de sus ojos cerdos con hambre, mujeres flacas, perros quebrados, ruedas de carruajes y fantasmas de Padres que entraban a la Catedral en orden de sepultura, precedidos por una tenia de luna crucificada en tibias heladas. A veces, en lo mejor del sueño, les despertaban los gritos de un idiota que se sentía perdido en la Plaza de Armas. A veces, el sollozar de una ciega que se soñaba cubierta de moscas, colgando de un clavo, como la carne en las carnicerías. A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto. A veces, los ronquidos de un valetudinario tiñoso o la respiración de una sordomuda en cinta que lloraba de miedo porque sentía un hijo en las entrañas. Pero el grito del idiota era el más triste. Partía el cielo. Era un grito largo, sonsacado, sin acento humano.
Los domingos caía en medio de aquella sociedad extraña un borracho que, dormido, reclamaba a su madre llorando como un niño. Al oír el idiota la palabra madre, que en boca del borracho era imprecación a la vez que lamento, se incorporaba, volvía a mirar a todos lados de punta a punta del Portal, enfrente, y tras despertarse bien y despertar a los compañeros con sus gritos, lloraba de miedo juntando su llanto al del borracho...."
Au Portail du Seigneur
... Brille, lumière d'alun, Lucifer de pierre-lumière ! Comme un bourdonnement d’oreilles persistait le murmure des cloches à l’heure de la prière, malaise de la lumière dans l’ombre, de l’ombre dans la lumière. Brille, lumière d'alun, Lucifer de pierre-lumière, sur la pourriture ! Brille, lumière d'alun, sur la pourriture, Lucifer de pierre-lumière !
Brille, brille, lumière d'alun... alun... brille... brille, lumière d'alun... alun... brille... brille, lumière d'alun... brille, alun... !
Les mendiants se traînaient dans les cuisines du marché, perdus dans l’ombre de la Cathédrale glacée, en route vers la Place d’Armes, le long de rues larges comme des mers, dans la ville qui restait derrière eux, désolée et seule.
La nuit les rassemblait en même temps que les étoiles. Ils se réunissaient pour dormir sous le Portail du Seigneur, sans autre lien que la misère, se maudissant les uns les autres, s’insultant avec l’aigreur d’ennemis cherchant querelle, se battant souvent à coups de coude, parfois même à coups de terre, des bagarres où, après s’être craché dessus avec rage, ils s’entre-mordaient. Ni oreiller ni confiance ne trouva jamais cette famille de parents de la décharge. Ils se couchaient séparés, sans se déshabiller, et dormaient comme des voleurs, la tête posée sur le sac de leurs richesses : restes de viande, chaussures trouées, bouts de bougie, poignées de riz cuit enveloppées dans de vieux journaux, oranges et bananes avariées.
Sur les marches du Portail, on les voyait, tournés vers le mur, compter leur argent, mordre les pièces de nickel pour vérifier si elles étaient fausses, parler seuls, passer en revue leurs provisions de bouche et de guerre – car ils faisaient la guerre dans la rue, armés de pierres et de scapulaires –, et avaler en cachette des morceaux de pain sec. On ne les vit jamais s’entraider ; avares de leurs déchets, comme tout mendiant, ils préféraient les donner aux chiens plutôt qu’à leurs compagnons d’infortune.
Une fois repus, avec leur argent serré dans un mouchoir noué sept fois autour du nombril, ils se jetaient à terre et tombaient dans des songes agités, tristes ; des cauchemars où défileraient près de leurs yeux des porcs affamés, des femmes maigres, des chiens estropiés, des roues de carrioles et des fantômes de Pères entrant dans la Cathédrale en ordre de sépulture, précédés d’un ténia de lune crucifié sur des tibias glacés. Parfois, au plus profond du sommeil, les réveillaient les cris d’un idiot qui se sentait perdu sur la Place d’Armes. Parfois, les sanglots d’une aveugle qui rêvait être couverte de mouches, pendue à un clou, comme la viande chez les bouchers. Parfois, les pas d’une patrouille qui traînait à coups un prisonnier politique, suivi de femmes essuyant les traces de sang avec des mouchoirs trempés de larmes. Parfois, les ronflements d’un valétudinaire teigneux ou la respiration d’une sourde-muette enceinte qui pleurait de peur car elle sentait un enfant dans ses entrailles. Mais le cri de l’idiot était le plus triste. Il fendait le ciel. Un cri long, arraché, sans accent humain.
Les dimanches, tombait au milieu de cette étrange société un ivrogne qui, dans son sommeil, réclamait sa mère en pleurant comme un enfant. En entendant le mot mère, qui dans la bouche de l’ivrogne était autant imprécation que lamentation, l’idiot se redressait, regardait de nouveau partout, d’un bout à l’autre du Portail, devant lui, et après s’être bien réveillé – et avoir réveillé les autres avec ses cris –, il pleurait de peur, mêlant ses larmes à celles de l’ivrogne...
La mort fortuite du colonel Parrales Sonrientes, qui (provisoirement appuie le régime, tué par un mendiant idiot, met en branle la machine judiciaire d'un procés inique et kaíkaïen, où cent témoins qui n'ont rien vu ou qui ont tout vu jurent sous serment que la victime a été abattue par le général Canales et le licencié Abel Carvajal, ennemis jurés du Président. Le sentiment de l`absurde, de l'absurde cruel, aveugle. effroyable, s`empare alors du lecteur au fur et à mesure que se déroulent les événements liés à cette mort et à ce procès : une jeune femme qui avait cherché à prévenir Canales et était arrivée après que celui-ci eut réussi à s'échapper - Monsieur le Président, pour des raisons connues de lui seul, ayant facilité sa fuite - est immédiatement arrêtée, accusée, torturée, de la façon la plus sordide, physiquement et moralement; on l'empêche d`allaiter son tout jeune enfant, qui en meurt; puis elle est dégradée, avilie, souillée : on la vend à un bordel, et elle devient folle, cependant que son mari, arrêté lui aussi, ne rentre en grâce qu`en devenant mouchard.
Face d'Ange, "beau et mauvais comme Satan", le second lumineux du sinistre Président, ombre éclatante, glace. diamant, tombe amoureux. lors de l`évasion de Canales dont il est chargé, de la fille de ce dernier, qu`il épouse pour la sauver de la mort, sur les conseils d'un sorcier. Ce moment de sa vie privée qu'il n`intègre pourtant pas à son activité, qui laisse intacte sa fidélité, lui attire la haine définitive du Président. Haine qu`il ne devinera pas, qu'il pressentira, cherchera à éviter et qui le conduira à la mort la plus ignominieuse. au fond d`un cachot, loin de celle qu'il aime et dont on lui fait savoir - suprême raffinement du supplice qui lui est imposé - qu`elle est devenue la maîtresse de Monsieur le Président. ce qui est faux, bien sûr, puisque en réalité elle dépérit lentement, sans nouvelles de son mari. L'amitié, l`amour n`entraînent donc avec eux que le malheur, l`horreur. la mort : ils sont impuissants.
Ce thème de l'impuissance face au monde impitoyablement destructeur du Président est constant dans cette œuvre d'Asturias, leitmotiv insidieux et accablant qui obsède le lecteur tout autant que les personnages. Il n'y a rien à faire, et même la révolte morale finit par disparaître et par faire place à la résignation. Ce n'est pas là l`aspect le moins désespérant du roman - l'asservissement entraîné par la tyrannie n'est pas seulement physique, il est aussi, surtout même, moral. L'individu devient une chose. Si, comme Face d'Ange. il essaie de résister, il en meurt.
"XXXI
Centinelas de hielo
En el zaguán de la Penitenciaría brillaban las bayonetas de la guardia sentada en dos filas, soldado contra soldado, como de viaje en un vagón oscuro. Entre los vehículos que pasaban, bruscamente se detuvo un carruaje. El cochero, con el cuerpo echado hacia atrás para tirar de las riendas con más fuerza, se bamboleó de lado y lado, muñeco de trapos sucios, escupimordiendo una blasfemia. ¡Por poco más se cae! Por las murallas lisas y altísimas del edificio patibulario resbalaron los chillidos de las ruedas castigadas por las rozaderas, y un hombre barrigón que apenas alcanzaba el suelo con las piernas apeóse poco a poco. El cochero, sintiendo aligerarse el carruaje del peso del Auditor de Guerra, apretó el cigarrillo apagado en los labios resecos —¡qué alegre quedarse solo con los caballos!— y dio rienda para ir a esperar enfrente, al costado de un jardín yerto como la culpa traidora, en el momento en que una dama se arrodillaba a los pies del Auditor implorando a gritos que la atendiera.
—¡Levántese, señora! Así no la puedo atender; no, no, levántese, hágame favor... Sin tener el honor de conocerla...
—Soy la esposa del licenciado Carvajal...
—Levántese...
Ella le cortó la palabra.
—De día, de noche, a todas horas, por todas partes, en su casa, en la casa de su mamá, en su despacho le he buscado, señor, sin lograr encontrarlo. Sólo usted sabe qué es de mi marido, sólo usted lo sabe, sólo usted me lo puede decir. ¿Dónde está? ¿Qué es de él? ¡Dígame, señor, si está vivo! ¡Dígame, señor, que está vivo!
Se había puesto de pie; pero no levantaba la cabeza, rota la nuca de pena, ni dejaba de llorar.
—¡Dígame, señor, que está vivo!
—Cabalmente, señora, el Consejo de Guerra que conocerá del proceso del colega ha sido citado con urgencia para esta noche.
—¡Aaaaah!
Cosquilleo de cicatriz en los labios, que no pudo juntar del gusto. ¡Vivo! A la noticia unió la esperanza. ¡Vivo!... Y, como era inocente, libre...
Pero el Auditor, sin mudar el gesto frío, añadió:
—La situación política del país no permite al Gobierno piedad de ninguna especie con sus enemigos, señora. Es lo único que le digo. Vea al Señor Presidente y pídale la vida de su marido, que puede ser sentenciado a muerte y fusilado, conforme a la ley, antes de veinticuatro horas...
—¡... le, le, le!
—La Ley es superior a los hombres, señora, y salvo que el Señor Presidente lo indulte...
—¡... le, le, le!
No pudo hablar. Blanca, como el pañuelo que rasgaba con los dientes, se quedó quieta, inerte, ausente, gesticulando con las manos perdidas en los dedos.
El Auditor se marchó por la puerta erizada de bayonetas. La calle, momentáneamente animada por el trajín de los coches que volvían del paseo principal a la ciudad, ocupados por damas y caballeros elegantes, quedó fatigada y sola. Un minúsculo tren asomó por un callejón entre chispas y pitazos, y se fue cojeando por los rieles...
—¡... le, le, le!
Sentinelles de glace
(Centinelas de hielo, référence à la froideur des soldats et du pouvoir).
Dans le vestibule de la Pénitencerie brillaient les baïonnettes de la garde, assise en deux rangées, soldat contre soldat, comme en voyage dans un wagon obscur. Parmi les véhicules qui passaient, une voiture s’arrêta brusquement. Le cocher, le corps rejeté en arrière pour tirer plus fort sur les rênes, se balança d’un côté à l’autre, pantin de chiffons sales, crachant un blasphème entre ses dents. Un peu plus, il tombait ! Le long des murs lisses et vertigineux du bâtiment sinistre glissèrent les crissements des roues freinées à mort, et un homme bedonnant, dont les jambes touchaient à peine le sol, descendit lentement.
Le cocher, sentant la voiture s’alléger du poids de l’Auditeur de guerre, serra entre ses lèvres crevassées la cigarette éteinte (quelle joie de rester seul avec les chevaux !) et lâcha les rênes pour aller attendre de l’autre côté, près d’un jardin aussi aride qu’une trahison coupable, au moment où une dame s’agenouillait aux pieds de l’Auditeur, implorant à grands cris qu’il l’écoute.
— « Relevez-vous, madame ! Je ne peux vous recevoir ainsi ; non, non, relevez-vous, je vous en prie… Sans même avoir l’honneur de vous connaître… »
— « Je suis l’épouse de maître Carvajal… »
— « Relevez-vous… »
Elle lui coupa la parole.
— « Jour et nuit, à toute heure, partout, chez vous, chez votre mère, à votre bureau, je vous ai cherché, monsieur, sans jamais vous trouver. Vous seul savez ce qu’est devenu mon mari, vous seul pouvez me le dire. Où est-il ? Qu’a-t-on fait de lui ? Dites-moi, monsieur, s’il est vivant ! Dites-le-moi ! »
Elle s’était relevée, mais ne redressait pas la tête, la nuque brisée de chagrin, et ne cessait de pleurer.
— « Dites-moi, monsieur, qu’il est vivant ! »
— « Justement, madame, le Conseil de guerre chargé du procès de votre époux a été convoqué d’urgence pour ce soir. »
— « Aaaaah ! »
Une démangeaison de cicatrice (cicatriz en los labios) lui traversa les lèvres, qu’elle ne put refermer tant la nouvelle la saisit. Vivant ! À cette annonce s’ajouta l’espoir. Vivant !… Et, puisqu’il était innocent, libre…
Mais l’Auditeur, sans changer de visage glacé, ajouta :
— « La situation politique du pays ne permet pas au Gouvernement la moindre pitié envers ses ennemis, madame. C’est tout ce que je peux vous dire. Allez voir Monsieur le Président et demandez-lui la vie de votre mari, qui pourrait être condamné à mort et fusillé, conformément à la loi, dans moins de vingt-quatre heures… »
— « … le, le, le ! »
— « La Loi est au-dessus des hommes, madame, et à moins que Monsieur le Président ne lui accorde la grâce… »
— « … le, le, le ! »
Elle ne put parler. Blanche comme le mouchoir qu’elle déchirait des dents, elle resta immobile, inerte, absente, les mains perdues dans des gestes désespérés.
L’Auditeur s’éloigna vers la porte hérissée de baïonnettes. La rue, un moment animée par le va-et-vient des voitures revenant de la promenade principale, remplies de dames et de messieurs élégants, retomba dans l’épuisement et la solitude. Un minuscule train apparut au fond d’une ruelle, crachant des étincelles et des coups de sifflet, puis disparut en boitant le long des rails…
— « … le, le, le ! »
No pudo hablar. Dos tenazas de hielo imposible de romper le apretaban el cuello y el cuerpo se le fue resbalando de los hombros para abajo. Había quedado el vestido vacío con su cabeza, sus manos y sus pies. En sus oídos iba un carruaje que encontró en la calle. Lo detuvo. Los caballos engordaron como lágrimas al encarnar la cabeza y apelotonarse para
hacer alto. Y ordenó al cochero que la llevara a la casa de campo del Presidente lo más pronto posible; mas su prisa era tal, su desesperada prisa, que a pesar de ir los caballos a todo escape, no cesaba de reclamar y reclamar al cochero que diera más rienda... Ya debía estar allí... Más rienda... Necesitaba salvar a su marido... Más rienda..., más rienda..., más rienda... Se apropió del látigo... Necesitaba salvar a su marido... Los caballos, fustigados con crueldad, apretaron la carrera... El látigo les quemaba las ancas... Salvar a su marido... Ya debía estar allí... Pero el vehículo no rodaba, ella sentía que no rodaba, ella sentía que no rodaba, que las ruedas giraban alrededor de los ejes dormidos, sin avanzar, que siempre estaban en el mismo punto...
Y necesitaba salvar a su marido... Sí, sí, sí, sí, sí... —se le desató el pelo—, salvarlo... —la blusa se le zafó—, salvarlo... Pero el vehículo no rodaba, ella sentía que no rodaba, rodaban sólo las ruedas de adelante, ella sentía que lo de atrás se iba quedando atrás, que el carruaje se iba alargando como el acordeón de una máquina de retratar y veía los caballos cada vez más pequeñitos... El cochero le había arrebatado el látigo. No podía seguir así... Sí, sí, sí, sí... Que sí..., que no..., que sí..., que no..., que sí..., que no... Pero ¿por qué no?... ¿Cómo no?... Que sí..., que no..., que sí..., que no... Se arrancó los anillos, el prendedor, los aritos, la pulsera y se los echó al cochero en el bolsillo de la chaqueta, con tal que no detuviera el coche. Necesitaba salvar a su marido. Pero no llegaban... Llegar, llegar, llegar, pero no llegaban... Llegar, pedir y salvarlo, pero no llegaban... Estaban fijos como los alambres del telégrafo, como los cercos de chilca y chichicaste, como los campos sin sembrar, como los celajes dorados del crepúsculo, las encrucijadas solas y los bueyes inmóviles.
Elle ne put parler. Deux tenailles de glace, impossibles à briser, lui serraient le cou, et son corps glissa peu à peu des épaules vers le bas. Il ne resta plus que sa robe, vide, avec sa tête, ses mains et ses pieds. À ses oreilles résonna le bruit d’une voiture qu’elle aperçut dans la rue. Elle l’arrêta. Les chevaux semblaient gonfler comme des larmes tandis qu’elle incarnait sa tête en eux et les rassemblait pour les faire stopper.
Elle ordonna au cocher de la conduire à la résidence campagnarde du Président au plus vite – mais sa hâte était telle, son désespoir si violent, que malgré les chevaux lancés au galop, elle ne cessait de crier, encore et encore, pour qu’il leur lâche plus de rênes… Elle aurait déjà dû être là… Plus vite… Il fallait sauver son mari… Plus de rênes… plus de rênes… plus de rênes…
Elle s’empara du fouet… Il fallait sauver son mari… Les chevaux, cinglés avec cruauté, redoublèrent d’efforts… Le fouet leur brûlait les hanches… Sauver son mari… Elle aurait déjà dû être là… Mais la voiture n’avançait pas – elle sentait qu’elle n’avançait pas, que les roues tournaient sur leurs essieux endormis, sans progresser, qu’elles étaient toujours au même point…
Et il fallait sauver son mari… Oui, oui, oui, oui, oui… — ses cheveux se défirent — …le sauver… — son corsage se dégrafa — …le sauver… Mais la voiture n’avançait pas, elle sentait qu’elle n’avançait pas, seules les roues avant tournaient, elle sentait l’arrière rester en arrière, le carrosse s’étirer comme l’accordéon d’une chambre photographique, et les chevaux lui semblaient de plus en plus petits… Le cocher lui avait arraché le fouet. On ne pouvait continuer ainsi… Oui, oui, oui… Oui ?… Non ?… Oui ?… Non ?… Mais pourquoi pas ?… Comment ça, non ?… Oui… non… oui… non…
Elle arracha ses bagues, sa broche, ses boucles d’oreilles, son bracelet, et les jeta dans la poche du cocher – pourvu qu’il n’arrête pas la voiture. Il fallait sauver son mari. Mais ils n’arrivaient pas… Arriver, arriver, arriver… mais ils n’arrivaient pas… Arriver, supplier, et le sauver… mais ils n’arrivaient pas… Tout était figé : les fils télégraphiques, les clôtures de chilca et de chichicaste, les champs en friche, les nuages dorés du crépuscule, les carrefours déserts et les bœufs immobiles.
... le pouvoir se mêle au sacré pour mieux le profaner...
" Por fin desviaron hacia la residencia presidencial por una franja de carretera que se perdía entre árboles y cañadas. El corazón le ahogaba. La ruta se abría paso entre las casitas de una población limpia y desierta. Por aquí empezaron a cruzar los coches que volvían de los dominios presidenciales —landós, sulkys, calesas—, ocupados por personas de caras y trajes muy parecidos. El ruido se adelantaba, el ruido de las ruedas en los empedrados, el ruido de los cascos de los caballos... Pero no llegaban, pero no llegaban... Entre los que volvían en carruaje, burócratas cesantes y militares de baja, gordura bien vestida, regresaban a pie los finqueros llamados por el Presidente meses y meses hacía con urgencia, los poblanos con zapatos como bolsas de cuero, las maestras de escuela que a cada poco se paraban a tomar aliento —los ojos ciegos de polvo, rotos los zapatos de polvillo, arremangadas las enaguas— y las comitivas de indios que, aunque municipales, tenían la felicidad de no entender nada de todo aquello. ¡Salvarlo, sí, sí, sí, pero no llegaban! Llegar era lo primero, llegar antes que se acabara la audiencia, llegar, pedir, salvarlo... ¡Pero no llegaban! Y no faltaba mucho; salir del pueblo. Ya debían estar allí, pero el pueblo no se acababa. Por este camino fueron las imágenes de Jesús y la Virgen de Dolores un jueves santo. Las jaurías, entristecidas por la música de las trompetas, aullaron al pasar la procesión delante del Presidente, asomado a un balcón bajo toldo de tapices mashentos y flores de buganvilla. Jesús pasó vencido bajo el peso del madero frente al César y al César se volvieron admirados hombres y mujeres. No fue mucho el sufrir, no fue mucho el llorar hora tras hora, no fue mucho el que familias y ciudades envejecieran de pena; para aumentar el escarnio era preciso que a los ojos del Señor Presidente cruzara la imagen de Cristo en agonía, y pasó con los ojos nublados bajo un palio de oro que era infamia, entre filas de monigotes, al redoble de músicas paganas...."
Enfin, ils s’engagèrent vers la résidence présidentielle par une bande de route se perdant entre les arbres et les ravins. Son cœur l’étouffait. La voie se frayait un passage parmi les maisonnettes d’un village propre et désert.
C’est là qu’ils commencèrent à croiser les voitures revenant des domaines présidentiels — landaus, sulkys, calèches —, occupées par des gens aux visages et habits étrangement semblables. Le bruit les précédait, le bruit des roues sur les pavés, le bruit des sabots des chevaux… Mais ils n’arrivaient pas, mais ils n’arrivaient pas…
Parmi ceux qui rentraient en voiture — bureaucrates limogés et militaires en retraite, bedonnants et bien habillés — revenaient à pied les hacendados convoqués par le Président des mois plus tôt dans l’urgence, les villageois aux chaussures semblables à des sacs de cuir, les institutrices qui s’arrêtaient à chaque instant pour reprendre leur souffle — les yeux aveuglés par la poussière, les souliers éventrés par la terre, les jupons retroussés — et les délégations d’Indiens qui, bien qu’officiels, avaient la chance de ne rien comprendre à tout cela.
Le sauver, oui, oui, oui, mais ils n’arrivaient pas ! Arriver était l’essentiel, arriver avant la fin de l’audience, arriver, supplier, le sauver… Mais ils n’arrivaient pas ! Il ne restait pourtant plus grand-chose : sortir du village. Ils auraient déjà dû être là, mais le village ne finissait plus.
C’est par cette route que passèrent, un Jeudi saint, les statues de Jésus et de la Vierge des Douleurs. Les meutes, attristées par les trompettes, hurlèrent quand le cortège défila devant le Président, apparu à un balcon sous un dais de tapisseries massives et de bougainvilliers.
Jésus passa, vaincu sous le poids de la croix, devant le César — et vers le César se tournèrent, admiratives, les foules.
La souffrance ne fut pas assez,
les larmes versées heure après heure ne furent pas assez,
les familles et les villes vieillies par le chagrin ne furent pas assez :
il fallait, pour parfaire l’outrage,
que sous les yeux du Seigneur Président
passât l’image du Christ agonisant.
Et il passa, les yeux voilés, sous un dais d’or qui était infamie, entre des rangées de pantins, au roulement de musiques païennes…
... l’agonie d’une femme confrontée à la machine implacable du pouvoir, où chaque refus est une porte qui se referme ....
"El carruaje se detuvo a la puerta de la augusta residencia. La esposa de Carvajal corrió hacia adentro por una avenida de árboles copudos. Un oficial le salió a cerrar el paso.
—Señora, señora...
—Vengo a ver al Presidente...
—El Señor Presidente no recibe, señora; regrese...
—Sí, sí, sí recibe, sí me recibe a mí, que soy la esposa del licenciado Carvajal... —Y siguió adelante, se le fue de las manos al militar que la perseguía llamándola al orden, y logró llegar a una casita débilmente iluminada en el desaliento del atardecer—. ¡Van a fusilar a mi marido, general!...
Con las manos a la espalda se paseaba por el corredor de aquella casa que parecía de juguete un hombre alto, trigueño, todo tatuado de entorchados, y hacia él se dirigió animosa:
—¡Van a fusilar a mi marido, general!
El militar que la seguía desde la puerta no se cansaba de repetir que era imposible ver al Presidente.
No obstante sus buenas maneras, el general le respondió golpeado:
—El Señor Presidente no recibe, señora, y háganos el favor de retirarse, tenga la bondad...
—¡Ay, general! ¡Ay, general! ¿Qué hago yo sin mi marido, qué hago yo sin mi marido?
¡No, no, general! ¡Sí recibe! ¡Paso, paso! ¡Anúncieme! ¡Vea que van a fusilar a mi marido!
El corazón se le oía bajo el vestido. No la dejaron arrodillarse. Sus tímpanos flotaban agujereados por el silencio con que respondían a sus ruegos.
Las hojas secas tronaban en el anochecer como con miedo del viento que las iba arrastrando. Se dejó caer en un banco. Hombres de hielo negro. Arterias estelares. Los sollozos sonaban en sus labios como flecos almidonados, casi como cuchillos. La saliva le chorreaba por las comisuras con hervor de gemido. Se dejó caer en un banco que empapó de llanto como si fuera piedra de afilar. A troche y moche la habían arrancado de donde tal vez estaba el Presidente. El paso de una patrulla le sacudió frío. Olía a butifarra, a trapiche, a pino despenicado. El banco desapareció en la oscuridad como una tabla en el mar. Anduvo de un punto a otro por no naufragar con el banco en la oscuridad, por quedar viva. Dos, tres, muchas veces detuviéronla los centinelas apostados entre los árboles. Le negaban el paso con voz áspera, amenazándola cuando insistía con la culata o el cañón del arma. Exasperada de implorar a la derecha, corría a la izquierda. Tropezaba con las piedras, se lastimaba en los zarzales. Otros centinelas de hielo le cortaban el paso. Suplicaba, luchaba, tendía la mano como menesterosa y cuando ya nadie le oía, echaba a correr en dirección opuesta...
La voiture s’arrêta devant l’auguste résidence. L’épouse de Carvajal se précipita à l’intérieur, courant sous une allée d’arbres touffus. Un officier lui barra le chemin.
— Madame, madame…
— Je dois voir le Président…
— Monsieur le Président ne reçoit personne, madame. Repartez…
— Si, si, il me recevra, moi ! Je suis l’épouse de maître Carvajal !
Elle continua d’avancer, échappant au militaire qui la poursuivait en lui ordonnant de s’arrêter, et parvint jusqu’à une petite maison faiblement éclairée dans la mélancolie du crépuscule.
— Ils vont fusiller mon mari, général !
Un homme grand, basané, tout chamarré de galons, se promenait les mains dans le dos sous le couloir de cette maison qui semblait un jouet. Vers lui elle se dirigea, haletante :
— Ils vont fusiller mon mari, général !
Le militaire qui la suivait depuis l’entrée ne cessait de répéter qu’il était impossible de voir le Président.
Malgré ses bonnes manières, le général lui répondit d’un ton sec :
— Monsieur le Président ne reçoit pas, madame. Faites-nous le plaisir de partir, je vous prie…
— Ah, général ! Ah, général ! Que vais-je faire sans mon mari ? Que vais-je faire sans mon mari ?
— Non, non, général ! Il me recevra ! Laissez-moi passer ! Annoncez-moi ! Voyez, ils vont fusiller mon mari !
Son cœur battait si fort qu’on l’entendait sous sa robe. On l’empêcha de se jeter à genoux. Ses tympans semblaient percés par le silence qui accueillait ses suppliques.
Les feuilles sèches craquaient dans la nuit comme effrayées par le vent qui les emportait. Elle s’effondra sur un banc. Des hommes de glace noire. Des artères stellaires. Ses sanglots claquaient sur ses lèvres comme des franges amidonnées, presque comme des couteaux. La bave coulait aux coins de sa bouche, brûlante de gémissements.
Elle s’affaissa sur un banc qu’elle inonda de larmes comme s’il eût été une pierre à aiguiser. On l’avait arrachée de force à l’endroit où se trouvait peut-être le Président. Le passage d’une patrouille la glaça. L’air sentait la saucisse, la mélasse, le pin scié. Le banc disparut dans l’obscurité comme une planche en mer.
Elle erra d’un point à un autre pour ne pas sombrer avec le banc dans les ténèbres, pour rester en vie. Deux, trois, maintes fois, les sentinelles postées entre les arbres l’arrêtèrent. Elles lui refusaient le passage d’une voix rude, la menaçant de la crosse ou du canon de leur fusil quand elle insistait.
Épuisée d’avoir imploré à droite, elle courait à gauche. Elle trébuchait sur les pierres, s’écorchait aux ronces. D’autres sentinelles de glace lui bloquaient le chemin. Elle suppliait, luttait, tendait la main comme une mendiante, et quand plus personne ne l’écoutait, elle repartait en courant dans la direction opposée…
"Monsieur le Président", roman de la dictature, non du dictateur. Critique de la misère - l`Etat est peuplé de mendiants. de la trahison - chaque citoyen reniera sa famille - de la dépravation - les consciences sont basses, vulgaires qu'entraîne ce régime improductif, qui ne peut se glorifier d'aucune réalisation positive en faveur de quiconque. Aussi le lecteur a-t-il l`impression d`étouffer dès le début, et cette oppression ne fait-elle que croître, voisine de l`asphyxie lorsque le roman culmine avec le dernier chapitre intitulé : "Enterré vivant" (La tumba viva).
Asturias semble avoir voulu resserrer petit à petit un monstrueux étau et avoir savamment construit cette œuvre en un crescendo lent et inéluctable, dépassant l'horreur concevable à chaque page. Le lecteur en sort anéanti, épouvanté ou plutôt il reste longtemps enfermé dans ce labyrinthe, patiemment élaboré, et qui, vraiment, est sans issue. Les trois quarts du roman couvrent quatre jours, et ceci suffit à dire avec quelle habileté l`auteur fait ressentir précisément cette brièveté comme une éternité. - Trad. Albin Michel, 1977.
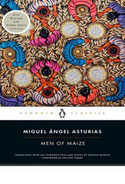
"Hombres de maíz" (1949, Men of Maize, Hommes de maïs)
C'est une des œuvres les plus complexes d'Asturias et on ne saurait l'aborder sans connaître certains aspects du peuple maya et de son histoire, en particulier le "Popol Vuh".
La lecture des "Légendes du Guatemala", du même auteur, éclaire ce très gros ouvrage dans lequel s'entrelacent, de façon plus ou moins artificielle, voire arbitraire, des thèmes où s'unissent le fantastique, la légende, et une certaine réalité, le tout visant à offrir un tableau de la vie des Indiens, faite encore de mille superstitions, mythes, pratiques de sorcellerie.
Divisé en six parties qui ne sont que très vaguement liées en apparence, mais finalement s'imbríquent étroitement l'une dans l'autre par la réapparition constante de personnages, - allant même jusqu`à changer d`identité -, le récit est dominé tantôt par un héros, tantôt par des événements.
"—El Gaspar Ilóm deja que a la tierra de llora le roben el sueño de los ojos. —El Gaspar Ilóm deja que a la tierra de Ilóm le boten los párpados con hacha… —El Gaspar Ilóm deja que a la tierra de Ilóm le chamusquen la ramazón de las pestañas con las quemas que ponen la luna color de hormiga vieja… El Gaspar Ilóm movía la cabeza de un lado a otro. Negar, moler la acusación del suelo que estaba dormido con su petate, su sombra y su mujer y enterrado con sus muertos y su ombligo, sin poder deshacerse de una culebra de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, pájaros y retumbos que sentía alrededor del cuerpo. —La tierra cae soñando de las estrellas, pero despierta en las que fueron montañas, hoy cerros pelados de Ilóm, donde el guarda canta con lloro de barranco, vuela de cabeza el gavilán, anda el zompopo, gime la espumuy y duerme con su petate, su sombra y su mujer el que debía trozar los párpados a los que hachan los árboles, quemar las pestañas a los que chamuscan el monte y enfriar el cuerpo a los que atajan el agua de los ríos que corriendo duerme y no ve nada pero atajada en las pozas abre los ojos y lo ve todo con mirada honda… El Gaspar se estiró, se encogió, volvió a mover la cabeza de un lado a otro para moler la acusación del suelo, atado de sueño y muerte por la culebra de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos que le martajaba los huesos hasta convertilo en una masa de frijol negro; goteaba noche de profundidades. Y oyó, con los hoyos de sus orejas oyó: —Conejos amarillos en el cielo, conejos amarillos en el monte, conejos amarillos en el agua guerrearán con el Gaspar. Empezará la guerra mel Gaspar Ilóm arrastrado por su sangre, por su río, por su habla de ñudos ciegos… La palabra del suelo hecha llama solar estuvo a punto de quemarles las orejas de tuza a los conejos amarillos en el cielo, a los conejos amarillos en el monte, a los conejos amarillos en el agua; pero el Gaspar se fue volviendo tierra que cae de donde cae la tierra, es decir, sueño que no encuentra sombra para soñar en el suelo de Ilóm y nada pudo la llama solar de la voz burlada por los conejos amarillos que se pegaron a mamar en un papayal, convertidos en papayas del monte, que se pegaron al cielo, convertidos en estrellas, y se disiparon en el agua como reflejos con orejas.
... la résistance de Gaspar Ilóm, une lutte cosmique entre la terre vivante et les forces de destruction...
"Gaspar Ilóm laisse la terre en pleurs se voler le sommeil de ses yeux."
"Gaspar Ilóm laisse la terre d'Ilóm se faire arracher les paupières à coups de hache..."
"Gaspar Ilóm laisse la terre d'Ilóm se faire roussir les cils des branchages sous les brûlis qui teignent la lune en vieille fourmi..."
Gaspar Ilóm secouait la tête de droite à gauche. Nier, broyer l'accusation de cette terre endormie avec sa natte, son ombre et sa femme, enterrée avec ses morts et son nombril, incapable de se défaire d'un serpent de six cent mille anneaux de boue, lune, forêts, averses, montagnes, oiseaux et grondements qui lui enserrait le corps.
"La terre tombe en rêvant depuis les étoiles, mais se réveille sur ce qui fut montagnes - aujourd'hui collines pelées d'Ilóm, où le gardien chante avec un pleur de ravin, où le faucon vole la tête en bas, où marche la fourmi géante, où gémit le colibri, et dort avec sa natte, son ombre et sa femme celui qui devrait trancher les paupières des bûcherons, brûler les cils des incendiaires et glacer le corps de ceux qui barrent l'eau des rivières - qui coulant dort et ne voit rien, mais retenue dans les mares ouvre les yeux et voit tout d'un regard profond..."
Gaspar s'étira, se recroquevilla, secoua à nouveau la tête pour pulvériser l'accusation du sol, ligoté de sommeil et de mort par le serpent aux six cent mille anneaux de boue, lune, forêts, averses, montagnes, lacs, oiseaux et tonnerres qui lui broyait les os jusqu'à le réduire en une pâte de haricots noirs ; la nuit suintait d'abîmes.
Et il entendit, par les trous de ses oreilles il entendit :
"Des lapins jaunes au ciel, des lapins jaunes dans la forêt, des lapins jaunes dans l'eau feront la guerre à Gaspar. La guerre commencera quand Gaspar Ilóm sera entraîné par son sang, par son fleuve, par sa parole de nœuds aveugles..."
La parole du sol changée en flamme solaire faillit brûler les oreilles de rats-taupes aux lapins jaunes du ciel, aux lapins jaunes de la forêt, aux lapins jaunes des eaux ; mais Gaspar se changeait en terre qui tombe d'où tombe la terre, c'est-à-dire rêve qui ne trouve plus d'ombre pour rêver sur le sol d'Ilóm, et rien ne put la flamme solaire de la voix bafouée par les lapins jaunes qui se collèrent à téter un papayer, changés en papayes sauvages, qui s'accrochèrent au ciel changés en étoiles, et se dissipèrent dans l'eau comme reflets à oreilles.
"Tierra desnuda, tierra despierta, tierra maicera con sueño, el Gaspar que caía de donde cae la tierra, tierra maicera bañada por ríos de agua hedionda de tanto estar despierta, de agua verde en el desvelo de las selvas sacrificadas por el maíz hecho hombre sembrador de maíz. De entrada se llevaron los maiceros por delante con sus quemas y sus hachas en selvas abuelas de la sombra, doscientas mil jóvenes ceibas de mil años. En el pasto había un mulo, sobre el mulo había un hombre y en el hombre había un muerto. Sus ojos eran sus ojos, sus manos eran sus manos, su voz era su voz, sus piernas eran sus piernas y sus pies eran sus pies para la guerra en cuanto escapara a la culebra de seiscientas mil vueltas de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos que se le había enroscado en el cuerpo. Pero cómo soltarse, cómo desatarse de la siembra, de la mujer, de los hijos, del rancho; cómo romper con el gentío alegre de los campos; cómo arrancarse para la guerra con los frijolares a media flor en los brazos, las puntas de güisquil calientitas alrededor del cuello y los pies enredados en el lazo de la faina. El aire de Ilóm olía a tronco de árbol recién cortado con hacha, a ceniza de árbol recién quemado por la roza. Un remolino de lodo, luna, bosques, aguaceros, montañas, lagos, pájaros y retumbos dio vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en torno al cacique de Ilóm y mientras le pegaba el viento en las carnes y la cara y mientras la tierra que levantaba el viento le pegaba se lo tragó una media luna sin dientes, sin morderlo, sorbido del aire, como un pez pequeño. La tierra de Ilóm olía a tronco de árbol recién cortado con hacha, a ceniza de árbol recién quemado por la roza...."
... la tension entre l'enracinement paysan et l'appel de la révolte, où la terre elle-même participe au combat ...
Terre nue, terre éveillée, terre de maïs ensommeillée, le Gaspar qui tombait d'où tombe la terre, terre de maïs baignée par des rivières d'eau puante d'avoir trop veillé, d'eau verte dans l'insomnie des forêts sacrifiées pour le maïs devenu homme semeur de maïs.
D'entrée, les maïsiculteurs emportèrent tout sur leur passage avec leurs brûlis et leurs haches dans les forêts-aïeules de l'ombre, deux cent mille jeunes ceibas millénaires. Dans l'herbe gisait une mule, sur la mule un homme, et dans l'homme un mort.
Ses yeux étaient ses yeux, ses mains étaient ses mains, sa voix était sa voix, ses jambes étaient ses jambes et ses pieds étaient ses pieds pour la guerre –
dès qu'il échapperait au serpent aux six cent mille anneaux de boue, lune, forêts, averses, montagnes, lacs, oiseaux et tonnerres qui s'était enroulé autour de son corps.
Mais comment se libérer ? Comment se détacher des semailles, de la femme, des enfants, de la ferme ? Comment rompre avec la foule joyeuse des champs ? Comment s'arracher à la guerre avec les plants de haricots en fleur aux bras, les pointes de chayotes tièdes autour du cou et les pieds empêtrés dans le lasso des tâches ?
L'air d'Ilóm sentait le tronc fraîchement coupé à la hache, la cendre d'arbre récemment brûlé pour l'écobuage (roza).
Un tourbillon de boue, lune, forêts, averses, montagnes, lacs, oiseaux et tonnerres tournoya, tournoya, tournoya autour du cacique d'Ilóm – et tandis que le vent lui cinglait la chair et le visage, tandis que la terre soulevée par le vent le fouettait, une demi-lune sans dents l'engloutit sans le mordre, aspiré de l'air comme un petit poisson.
La terre d'Ilóm sentait le tronc fraîchement coupé à la hache, la cendre d'arbre récemment brûlé pour l'écobuage....
L'ouvrage s`ouvre sur ce la geste de Gaspar Ilom, chef indien qui lutte contre les exploitants du mais parce que les sorciers le lui ont ordonné, fatigués de voir la terre personnifiée souffrir des coups qu'on lui porte. Il est empoisonné, puis se noie, après que les soldats ont tué toute sa famille. Le style de cette première partie est emprunté au "Popol Vuh", avec les répétitions lancinantes, et les phrases tripartites caractéristiques de cet ouvrage. Les sorciers ont décrété l`extinction de la race de ceux qui avaient tué des Indiens. Ainsi Tomas Machojon, qui avait empoisonné Ilom, est-il à son tour frappé par le sort. Quant à son fils, il disparaît alors qu`il allait retrouver sa fiancée, Candelana Reinosa, après avoir rencontré le diable.
La troisième partie met en scène un sorcier, le Cerf des sept "Rozas" dont le double, ou nahual - esprit qui accompagne l'homme et le suit dans la mort -, est, bien entendu, un cerf. Précisément, l`un des frères Tecún tue un cerf, ce qui cause la mort du sorcier, lequel a guéri la mère des Tecún, en obligeant ces derniers à égorger toute la tribu Zacaton. Ceci donne lieu à une scène d'horreur d'une violence extrême.
Puis le lecteur est entraîné à la suite du colonel Chalo Godoy qui se promène dans la montagne avec le sous-lieutenant Musus. Après avoir successivement rencontré le Serpent des villes (un des pseudonymes du diable) et un cercueil où se tenait un Indien vivant, ils sont attaqués par les Tecún - ce qui avait été prédit au début par une sorcière, la Vaca Mannela.
La cinquième partie conte les pérégrinations de Goyo Yic, un aveugle que sa femme MariaTecún-a abandonné, et qui la cherche malgré sa cécité. Il est opéré de la cataracte - ce qu'on expose dans des pages dignes de n'importe quel ouvrage de médecine - et achève sa vieau bagne, devenu légendaire. Une autre fin lui fait retrouver sa femme, et tous deux retournent à Pisigüilito (l'exploitation de maïs).
Le dernier et le plus long des épisodes du roman relate le voyage du facteur Nicho-Aquino, de San Miguel Acatan à la capitale. Transformé en coyote après que sa femme l`a laissé, il devient un être surnaturel.
Un résumé qui donne une idée à la fois de l`ampleur, de la richesse et du manque d'unité d' "Hommes de maïs". On ne peut parler vraiment de protagonistes ou d`action ; pourtant personnages et événements abondent, se perdent, se retrouvent, deviennent plus intelligibles au long des chapitres, ce qui permet souvent à Asturias de décrire, outre l'Indien, comme il se propose de le faire, le reste de la société guatémaltèque : bureaucrates, militaires, Nord-Américains, métis, sans pourtant qu`ils s`intègrent à une hiérarchie sociale. Le lecteur s`égare dans ce labyrinthe mais il en sort fasciné Trad. Albin Michel, 1967.

Avec "Hombres de maíz" commence l’élégie et l’hymne à un monde heureux perdu. Dans une atmosphère d’animisme intense, où la nature palpite et s’agite, et où l’homme semble vivre deux vies simultanément — la sienne propre et celle de son nahual (animal-guide spirituel) —, s’ouvre devant les lecteurs un monde insoupçonné, mystérieux, où la lutte quotidienne pour survivre s’appuie sur une reconquête continuelle et secrète de l’esprit. La méchanceté des hommes, qui incarnent la perversion du pouvoir, ne parvient pas à détruire cette région intérieure où s’opère une telle renaissance. Le thème de l’injustice y est traité de manière engagée ; dans le martyre d’un peuple s’enracinent des catégories spirituelles qui garantissent un avenir différent. L’intention politique est à la source de la dénonciation, mais dans le roman domine une note de chaleureuse humanité. La considération pour l’homme, si riche spirituellement mais accablé par l’arbitraire, conduit à de profondes réflexions sur le sens de la vie et de la mort dans un monde de cette nature. La mort finit par jouer le rôle de libératrice face au malheur.
Dans les romans suivants, l’engagement d’Asturias s’accentue et prend une tonalité clairement politique.
La « trilogie bananière » — composée de "Viento fuerte" (Vent violent, 1949), "El Papa Verde" (Le Pape vert, 1950) et "Los ojos de los enterrados" (Les Yeux des ensevelis, 1960), avec l’interlude d’une amertume extrême dans "Week-end en Guatemala" (1956), qui évoque l’invasion du pays par des mercenaires sous le gouvernement d’Árbenz — a surtout pour signification l’adhésion de l’écrivain aux espoirs et aux cruelles désillusions de son peuple...

"Viento fuerte" (1950, Strong Wind, Vent fort)
Le héros du premier volet de la trilogie consacrée par Asturias à la lutte contre l'impérialisme jouait déjà un rôle dans "Hommes de mais": il y vendait également des machines à coudre. mais sous le nom d`O'Neill, alors que dans ce nouveau roman, il a trois identités : Cosi, Lester Mead, Lester Stoner (l'authentique). Le procédé de la réminiscence est cher à Asturias et n`est pas fait pour surprendre le lecteur. Mais ici le personnage épisodique d` "Hommes du maïs" est au centre du récit. Lester Stoner, actionnaire richissime de la compagnie bananière Tropicaltanera - que l`on retrouve sous des noms différents dans les autres parties de la trilogie et qui est une allusion directe à une grosse compagnie américaine - Lester Stoner, donc, prend le nom de Lester Mead, pour plaider la cause des petits exploitants contre "le Pape vert".
Après des péripéties variées comme la destruction des camions privés apportant des bananes à la ville par la compagnie, ou le procès inique des associés de Mead, un ouragan effroyable se déchaîne sur les plantations et tue Lester Mead et sa femme Leland Foster. Mais entre-temps, ses clients ont eu gain de cause. En somme la lutte entre Mead et la compagnie constitue la trame du récit; le roman veut être avant tout une sorte de grande fresque "bananière".
Comme l`a dit Asturias lui-même, il s`agit d'un "opéra sous les tropiques". La grandeur du paysage : la plaine côtière du Pacifique, le climat lourd, suffocant, poisseux de la région, la condition misérable des petits planteurs exploités, c`est là ce qu`a capté Asturias à la fois de façon réaliste et de façon poétique. Lyrisme soutenu par des dialogues d'une extraordinaire vitalité, qui laissent le champ libre à l`analyse psychologique lucide : dans "L'Ouragan" apparaissent sous un jour cruel les Américains, whisky et poker pour les hommes, aventures amoureuses sordides et pitoyables pour les femmes. Les Indiens vivent comme de vraies bêtes, travaillant pour dépenser leur maigre salaire avec des prostituées ou pour s`enivrer de tequila, et sont souvent atteints de paludisme. Le couple Mead éclaire l`œuvre de son amour rayonnant et de sa pureté, comme Mayari dans "Le Pape vert", comme Tabio San et Malena Tabay dans "Les Yeux des enterrés", tous mus par des sentiments purement humanitaires. La chronologie n`est pas exagérément bouleversée, aussi l'unité de ce premier volet est-elle nettement plus marquée que dans les deux autres.
Oeuvre forte et courageuse, "L`Ouragan" marque chez Asturias la prise de conscience définitive des problèmes sociaux du Guatemala. - Trad. Gallimard, 1955.

"El papa verde" (1954, The Green Pope, Le Pape vert)
C`est l'avant-dernier volet de la trilogie qu'Asturias a consacrée à la vie des plantations. Le personnage principal de ce dernier roman est celui d'un self-made-man. Geo Maker Thompson, sorte de trafiquant de petite envergure qui deviendra propriétaire de l'un des plus gros trusts de plantations : "la Tropicale bananière", et sera connu jusqu`aux Etats-Unis sous le nom de "Green Pope", titre qui lui confère toute son importance. Orang-outan jovial et sans scrupules, beau garçon par surcroît, il ne commet qu'une erreur tactique dans sa vie, celle de tomber amoureux d'une jeune Indienne, Mayari, qui se suicide, car elle ne peut admettre l`exploitation de son peuple et préfère renoncer à l`homme dont elle s`est réellement éprise. Rectifiant ses visées, Geo Maker épouse alors la mère de Mayari, doña Flora, femme de tête qui lui convient davantage. et ne cesse de gravir les échelons de la puissance et de la richesse en étouffant les sursauts de sa conscience. De méfait en méfait, il en arrive au meurtre, n'hésitant pas à maquiller un accident soigneusement prémédité pour faire disparaître un enquêteur. Cela ne lui portera pas chance, car la victime n'était qu`un bouc émissaire, et celui qui l'envoyait, Richard Wotton, se vengera de Geo Maker
en se présentant à lui sous le faux nom de Ray Salcedo. et en séduisant sa fille. Aurelia, qu'il abandonnera enceinte.
Dans la dernière partie du roman, le lecteur pénètre dans le monde où évolue Maker Thompson vieillissant, assoiffé d`ambition et hanté par la vie brisée de sa fille dont il élève l`enfant. Est-ce à dire que "Le Pape vert" est un portrait psychologique ? Certes la figure de Geo Maker revêt une grandeur épique : elle est inoubliable mais il n`est qu'un symbole. celui du planteur face aux possibilités tant humaines qu`économiques de la terre qu`il exploite. Certes l'amour de Geo pour Mayari est l`occasion pour Asturias d'écrire l'un de ses plus beaux poèmes en prose, l`un des plus lyriques, se laissant en outre fasciner par le personnage même de Mayari. et à travers elle, par toute la poésie et la pureté qu'il attribue à la race indienne.
Le thème lancinant de la souillure par l'argent revient sans cesse ici : souillure acceptée, ou refusée et dans ce dernier cas c`est la révolte vite écrasée. ou la mort librement consentie.
Exploitation de l'homme par l'homme ? Exploitation de l'homme véritable par l'homme-machine, l'homme-rendement, l`homme-capitaux, en un mot l`homme-négation de l'homme selon Asturias. Le problème exposé par le grand écrivain guatémaltèque n'est d'ailleurs nullement matériel. mais moral. C'est toute une conception éthique qui s'élabore au long de cette fresque haute en couleur qu'est "Le Pape vert". L'auteur met pour une fois son style entièrement au service de ses idées, le dépouille de son éblouissante variété, mais n'en obtient que plus de force dans la sobriété.
Abordant avec plus de lucidité que de violence le problème agraire indien. Asturias en décrit magistralement le féodalisme et accuse sans fard la civilisation sans âme qui est celle du monde moderne. - Trad. Albin Michel. 1956.

"Week-end en Guatemala" (1956)
"Week-end en Guatemala", œuvre de réalisme social et de dénonciation, est une chronique fictive de la terrible guerre-éclair qui renversa le gouvernement d'Arbenz et imposa la dictature de Castillo Armas, avec l'intervention des trusts nord-américains de l'exploitation fruitière. "Vous ne voyez pas ce qui se passe ? Mieux vaut appeler cela des romans !" ("¿No ve las cosas que pasan? ¡Mejor llamarlas novelas!"). Cette sentence désespérée, en guise d'épigraphe, définit la relation mouvante entre chronique et fiction dans ces récits déchirants...

"Los ojos de los enterrados (1960, The Eyes of the Interred, Les Yeux des enterrés)
ll s`agit du troisième volet de la trilogie qu'Asturias a consacrée à l`anti-impérialisme. Faisant suite à "L'Ouragan" et au "Pape vert", "Les Yeux des enterrés" est l'histoire de la grande grève générale qui aboutit à la destitution du dictateur du Guatemala et porta un coup sérieux au monopole bananier.
Dans la première partie et par l'intermédiaire d`un des personnages, don Nepo, les débuts de la "Compagnie" sont évoqués. ainsi que la façon impitoyable dont les Nord-Américains dépouillèrent les indigènes. Puis apparaît celui que l`on peut considérer comme le personnage central du roman, l`agitateur révolutionnaire Tabio San, ou Octavio Sansur ou Juan Mondagón, car ce sont là ses trois identités, qui concilie son amour du peuple avec celui qu'il porte à la jeune institutrice Malena Tabay. ll y a là de très beaux passages. d`une intense poésie.
Toute la fin est consacrée aux préparatifs du jour J ; le succès des grévistes permettra aux morts indiens de refermer leurs yeux qu'ils gardent ouverts dans leur tombe, selon la légende maya, jusqu'à ce que justice leur soit rendue. "Les Yeux des enterrés" constitue donc un roman à thèse dont les personnages retiennent d`emblée l`attention du lecteur, même s`ils sont épisodiques comme les capitaines Carcamo et Salomé qui rejoignent les rangs révolutionnaires par amour ou conviction : Anastasia et Juambo que leur condition d'lndiens pousse à être en accord avec la révolution sans pouvoir y prendre part; Cayetano Duende et Popoluca. reflets du folklore maya, êtres mythiques au comportement fantastique. - Trad. Albin Michel, 1962.

"Mulata de tal" (1963, Mulata)
Un livre de pure imagination, dans lequel le délire verbal va de pair avec le débordement de la fantaisie. Mais le ton, proche de celui des contes et légendes populaires, les nombreux éléments appartenant aux mythologies de l'Amérique préhispanique, le langage profondément enraciné dans le monde linguistique des paysans guatémaltèques lui confèrent une place toute naturelle dans une tradition vivante. Le titre (dont la saveur populaire serait peut-être mieux rendue par "Cette sacrée mulâtresse") fait allusion à un personnage important mais quelque peu épisodique.
Les héros de cette histoire, qui n'est pas tout à fait un roman au sens habituel, sont en réalité un couple de paysans indiens : Celestino Yumi, dit aussi Grand Sorcier Braguette, et sa femme Catalina Zabala ou Niniloj. Envieux de la richesse de son compère Timoteo Teo Timoteo, Yumi conclut un pacte avec Tazol, le diable des feuilles de maïs, qui lui révèle que Catalina le trompe avec son compère. Yumi accepte de se promener dans le pays la braguette ouverte et de livrer sa femme à Tazol. Celui-ci l'enlève en prenant la forme de l'ouragan, mais Yumi ayant voulu se pendre, il la lui rend avec les richesses promises, transformée en poupée, dans une boîte à jouets qui contient en réduction tout ce qui doit lui appartenir. C'est alors que Yumi, enrichi et ivre, fait la connaissance de la Mulâtresse, espèce de prostituée sauvage et superbe qui danse en pleine rue. Elle exige d'être épousée par lui.
Cependant Catalina est rendue à la vie, mais elle reste naine et, sous le nom de Juana Puj, se fait emmener par son mari comme domestique de la Mulâtresse qu'elle réussit à enfermer par ruse dans la grotte où dort la lune, en profitant de l'ivresse qu`a provoquée la fumée de la marihuana. Tazol, fâché, transforme tout l'argent de Yumi en feuilles de maïs. La Mulâtresse se délivre finalement et les deux époux s'enfuient tandis que la terre tremble à l'approche de la terrible femme-démon.
De nouveau réunis, Yumi (Jayumijajá dans la langue des "salvajos") et Catalina apprennent d'un inconnu l'histoire de Piedrasanta ("Pierresainte") qui, fatigué de souffrir, a demandé au diable de le transformer en pierre; mais, une fois lassé de sa condition, il peut de ce fait obliger le diable à le re-transformer en homme, jusqu'à ce que de nouveau il en ait assez d'être homme et demande à redevenir pierre, ceci indéfiniment. L`inconnu n'est autre que Piedrasanta, et le soir, lorsqu'ils se reposent autour du feu, il colle son dos à celui de Catalina pour l'enlever. Comme Yumi avait été prévenu de cette ruse par les hommes-
sangliers, il retient si bien Catalina qu'il la décolle après l'avoir étirée jusqu'à sa grandeur naturelle.
Désirant devenir sorciers, ils se dirigent alors vers Tierrapaulita, le pays dominé par Cashtoc, le Grand, l'Immense, emportant avec eux un crucifix en feuilles de maïs qui renferme magiquement Tazol, et que Catalina porte dans un sac sur son ventre.
Tazol féconde la femme par le nombril, et après une gestation ultra-rapide, il en naît un petit diable espiègle, Tazolín, qui aidera souvent sa mère dans des situations difficiles.
Pour l'instant, cette maternité confère à Catalina des pouvoirs magiques, dont elle profite immédiatement pour se venger de son mari, qu'elle transforme en nain. Yumi, sous le nom maintenant de Chiltic, est convoité par une naine lascive qui se fait marier avec lui par le curé. Jalouse, Catalina, sous le nom maintenant de Grande Sorcière Giroma, transforme Yumi en géant, ce qui ne fait qu'exciter davantage le désir de la naine.
Ayant repris leur forme normale, Yumi et Catalina reviennent au village maudit, où Candanga mène une campagne de vociférations nocturnes pour pousser les villageois à engendrer. Le curé le défie en jetant son gant, et c'est Yumi qui le rapporte par gentillesse. Une étrange et obscène conversation s'engage alors entre lui et le sacristain. La conversation devient de plus en plus provocante, car le sacristain est possédé par la Mulâtresse, envoyée de Cashtoc. Après l'avoir terrassé, Yumi engage la lutte contre le curé, qui, depuis le début, guettait, transformé en araignée de pluie noire aux onze mille pattes. La Mulâtresse arrête la bataille au moyen d'un brouillard pétrifiant. Elle est condamnée par les diables (avertis par Catalina) à perdre la moitié de tous ses organes. S`amalgamant avec une vieille femme, elle redevient complète, mais ne peut retrouver le sexe qu'elle venait de gagner, malgré le balai magique dont elle se sert. De façon inattendue est présenté à ce moment l`entretien qui a lieu entre le directeur d'une compagnie d'assurances et le diable Candanga, qui veut assurer la paix et le feu de l'Enfer.
Tout se termine par un tremblement de "terre" dans la lune, qui se répercute à Tierrapaulita. Au cours du cataclysme, le sacristain rencontre la Mulâtresse rajeunie et meurt debout dans la nuit en lui parlant, tandis que Catalina retrouve Yumi la tête fracassée et le corps dépecé par la Mulâtresse, qui a voulu s'emparer de ses os, trompée par une légende qui les disait en or pur.
Ce ne sont là que les épisodes les plus marquants de ce long récit rempli d'aventures invraisemblables. Mille autres, et beaucoup de personnages secondaires, compliquent à l`infini le tissu de cette histoire fantastique et magique, qui laisse surtout l'impression du déchaînement d'une imagination vigoureuse et inquiétante, férocement joyeuse aussi, et nourrie de contes, légendes et mythes ancestraux. (Trad. Albin Michel, 1965).

"El alhajadito" (1961, The Bejeweled Boy, Le Bijou)
C'est l’un des récits d'Asturias les plus mystérieux et fascinants, une histoire où la nature est habitée par des dieux et des démons infatigables, où la superstition et la religion catholique brouillent les souvenirs des croyances et de leurs rites, un récit où les rêves sont les portes principales par lesquelles le passé peut resurgir pour entrevoir un futur probable et fabuleux : un enfant y entreprend une aventure fantastique, peuplée de formes menaçantes ou bienveillantes issues de la nature tropicale violente, des symboles, des présages et des enchantements qui constituent la base primordiale de la mémoire latente et indomptée de sa nature. Cette histoire attend aussi un lecteur en quête d’aventure. Comme les œuvres majeures de Miguel Ángel Asturias, ce récit énigmatique est une expérience linguistique et narrative dont la place dans la littérature contemporaine est indiscutable ...

"El espejo de Lida Sal" (1967)
Ce récit, tiré du recueil *Mulata de tal (1963) ou publié séparément selon les éditions, est un exemple typique du réalisme magique d'Asturias, mêlant folklore guatémaltèque, critique sociale et éléments surnaturels.
Le Miroir de Lida Sal raconte l'histoire de Lida Sal, une métisse "plus bien tournée qu'une toupie" (“más torneada que un trompo”) qui lavait la vaisselle dans la cantine d'un village et tomba amoureuse d'un jeune propriétaire terrien. Consciente de l’impossibilité d’une relation naturelle avec lui, Lida Sal décide d’utiliser un sortilège traditionnel. Selon la croyance populaire, si une femme revêt le costume d’un "perfectante" (personnage grotesque et coloré des processions religieuses) et se regarde en entier dans un miroir, elle peut ensorceler l’homme qu’elle convoite. Mais le drame de Lida Sal est qu'elle ne possède pas un tel miroir chez elle, objet pourtant banal pour les classes aisées. Cette absence devient une métaphore de son invisibilité sociale – privée de reflet, elle est privée d’identité et de pouvoir d’action. Sans miroir, le rituel ne peut qu'échouer. Lida Sal reste prisonnière de sa condition, tandis que le jeune haciendero, inconscient du désir qu'il suscite, incarne l’indifférence des puissants.

"Maladrón" (Epopeya de los Andes verdes, 1969)
L'un des derniers romans de Miguel Ángel Asturias, s'inscrit dans un cycle de romans épiques centrés sur les mythes et les réalités sociales de l'Amérique latine, notamment des peuples indigènes. Le roman fait en effet partie de l' "Épopée des Andes vertes" (Epopeya de los Andes verdes), mêlant réalisme magique et critique sociale.
L'histoire se déroule dans un univers à la fois historique et légendaire, où se croisent conquistadors, indigènes et figures mythiques. Le personnage central, Maladrón, est une figure ambiguë, à la fois bandit et justicier, qui incarne la résistance des opprimés face à la colonisation et à l'exploitation. Le roman plonge dans les paysages mystiques des Andes, où la nature est vivante et sacrée. Les montagnes, les forêts et les esprits ancestraux jouent un rôle actif dans l'intrigue.
À travers des récits fragmentés et des visions poétiques, Asturias dépeint la souffrance des communautés indigènes face à l'oppression coloniale et moderne. Maladrón devient un symbole de rébellion, défiant les pouvoirs en place. Des épisodes fantastiques (comme des apparitions de dieux précolombiens) se mêlent à des scènes de violence réaliste. Asturias utilise une prose lyrique, riche en métaphores et en symboles, inspirée des Popol Vuh. Maladrón est à la fois une épopée héroïque et une dénonciation des injustices historiques.

"Tres de cuatro soles" (1971)
Le testament littéraire de Miguel Ángel Asturias, une œuvre poétique en prose qui explore la cosmogonie maya à travers le prisme de la création littéraire. Dans ce texte, Asturias ne se contente pas de raconter sa propre évolution, mais celle des éléments du monde, cherchant à retrouver la manière magique par laquelle sa création s'unit à la création permanente du monde, comment le chaos s'ordonne pour donner naissance à la vie.
Le livre s'inspire des mythes mayas des "quatre soleils", chaque soleil représentant une ère cosmique. Le premier soleil voit la séparation du ciel et de la mer de la terre. Le deuxième marque l'apparition de l'homme, fait de maïs selon la tradition maya. Le troisième soleil a disparu, peut-être en référence à l'Atlantide. Le quatrième est celui de la conquête, symbolisant l'esclavage et la domination coloniale.
En intégrant ainsi la mythologie maya à la réalité guatémaltèque, Asturias propose une identité nationale qui embrasse à la fois les héritages indigènes et européens. Cette approche reflète sa vision d'une âme nationale hybride, où le langage ladino coexiste avec la mythologie maya, soulignant la richesse culturelle du Guatemala.
Première Partie : Le Soleil de Terre (Homme de Maïs)
Le "Soleil de Terre" chez Asturias renvoie au maïs (élément central dans la spiritualité maya),
La Création et la Chute - Le récit s'ouvre sur une vision mythique de la création de l'homme par les dieux mayas, modelé à partir du maïs. Les premiers hommes, liés à la terre, vivent en harmonie jusqu'à ce que l'avidité et la violence corrompent cet équilibre. La destruction vient non pas des conquistadors, mais de la corruption interne (guerres entre tribus, arrogance humaine). Asturias reprend ici le mythe du Popol Vuh où les premiers hommes de bois échouent à respecter les dieux.
Une première catastrophe (symbolisée par un tremblement de terre) marque la fin de ce "soleil". Asturias décrit la fin du Soleil de Terre par des signes naturels (sécheresse, tremblements) plutôt que par une invasion. Les conquistadors n'apparaissent explicitement qu'ensuite, sous les traits de "démons à barbe rousse" (allusion à Alvarado), marquant le début du Soleil de Feu.
Asturias brouille les temporalités pour montrer que la violence coloniale était inscrite dans les cycles du destin maya. Des échos de la conquête apparaissent dès le Soleil de Terre sous forme de symboles (cris d’oiseaux annonciateurs, rêves de sang), et certains chamanes ou personnages (comme le Nain-Prophète, figure récurrente chez Asturias) pressentent une menace future, mais les Espagnols ne sont pas encore là. Asturias utilise des images prophétiques ("des hommes-barbares viendront du ciel"), mais c’est une anticipation poétique, pas encore une confrontation directe....
Deuxième Partie : Le Soleil de Feu (Conquête et Destruction)
La colonisation est placée dans le deuxième soleil (Feu), non dans le premier, pour souligner que la violence espagnole a interrompu un cycle déjà fragile. Arrivée des conquistadors : Ils sont clairement décrits comme des "démons à cheval" (allusion au Q'eqchi', langue maya où "cheval" et "démon" se confondent).
L'Invasion Espagnole - Les Espagnols, associés au feu destructeur, ravagent les villes mayas. La figure de Pedro de Alvarado (conquistador) incarne la cruauté coloniale. Les dieux mayas semblent se retirer, laissant place au chaos.
La Résistance et la Prophétie - La "prophétie" vient souvent de figures comme le Nain de Tikal ou des ancêtres transformés en esprits, qui parlent par énigmes. Un prêtre maya prophétise le retour des anciens dieux et la chute des oppresseurs. Des révoltes éclatent, mais elles sont écrasées dans le sang.
Révolte des Zendales : Allusion historique à une rébellion maya contre les Espagnols, décrite de manière hallucinée (hommes se changeant en jaguars, arbres qui saignent).
Destruction des idoles : Les conquistadors brûlent les codex, mais des prêtres mayas cachent des prophéties dans des grottes (thème récurrent chez Asturias).
La résistance est spirituelle (malédictions, sortilèges) plutôt que physique. Le feu purificateur annonce la fin de ce deuxième soleil.
Troisième Partie : Le Soleil de Vent (Colonialisme et Dégradation)
le Soleil de Vent est décrite comme une ère de épossession matérielle (exploitation économique postcoloniale) et de résistance spirituelle (la culture maya survit par les esprits et la mémoire invisible), des thèmes qui s'imbriquent sans transition marquée.
Asturias utilise un réalisme halluciné pour montrer comment ce vent (symbolisant le capitalisme) érode les corps et les cultures. Des paysans mayas réduits au servage dans les haciendas, décrits comme "des ombres sans visage sous le fouet du vent". Los Hombres de Plomo" (hommes transformés en métal par le travail forcé). L'arrivée des compagnies étrangères (américaines) exploitant les mines, symbolisées par des "machines vomissant la terre noire". L'époque coloniale laisse place à une oppression économique (travail forcé dans les mines, haciendas). Les métis et les créoles reproduisent les violences des conquérants. Le "vent" symbolise l'érosion des cultures indigènes.
Ou le texte bascule dans le mythe, avec des incantations en langue maya (ex. "Xecotcovach !", esprit du vent vengeur). Les morts mayas reviennent sous forme de souffles ou de voix dans le vent : "Les ancêtres ont ouvert leurs lèvres de poussière pour chanter dans les ravins". Des objets sacrés (stèles, masques) s'animent pour maudire les oppresseurs. Les morts mayas reviennent hanter les oppresseurs sous forme de fantômes ou de forces naturelles. Une tempête (symbolisant le vent) balaie le pays, annonçant un nouveau cycle.
Quatrième Partie : Le Quatrième Soleil (Avenir Incertain)
Un soleil "aveugle", "le quatrième œil du ciel reste clos, il ne voit pas encore sa propre lumière", contrairement aux trois premiers soleils (Terre, Feu, Vent), celui-ci est inachevé, comme si le temps cosmique hésitait. Apparition de figures messianiques comme autant de rêves collectifs où les villageois voient tantôt un avenir radieux, tantôt des champs de ruines : le Porteur d’Eau, un mystique qui prétend incarner le nouveau soleil, mais disparaît dans une tempête (Parodie des sauveurs politiques), la Femme-Cheval, allégorie de la Nature violée, elle accouche d’un enfant-jaguar, symbole d’une possible révolte future. Le quatrième soleil est un miroir brisé : chacun y voit sa propre fin ou son commencement..
Asturias semble laisser le lecteur juge : l’histoire guatémaltèque est-elle condamnée à la répétition, ou capable de renaître ?

"Viernes de Dolores"(1972, Friday of Sorrows, Vendredi de douleurs)
Ce fut le dernier roman de Miguel Ángel Asturias. L'œuvre évoque les luttes politiques auxquelles l'auteur a pris part durant ses années étudiantes. Mais le livre s'ouvre sur une vaste fresque de la cité des morts, dont la portée symbolique dépasse largement les simples références à Quevedo. Il décrit l'organisation de l'Honorable Comité de Grève de Dolores de l'Université nationale du Guatemala. Asturias fut l'un des premiers à employer une technique littéraire aujourd'hui connue sous le nom de réalisme magique.
Les origines de la Huelga de Dolores (Grève de Douleurs) remontent à l'année 1898 dans la ville de Guatemala. À cette époque, le président de la République, Manuel Estrada Cabrera, accorda à la population certaines libertés d'expression. Profitant de cette ouverture, les étudiants des facultés de Médecine et de Droit de l'Université nationale déclenchèrent une grève pour exiger du gouvernement l'ouverture et l'amélioration des écoles primaires. Ce mouvement servit de catalyseur : un mois plus tard, les étudiants organisèrent une manifestation satirique pour critiquer les fonctionnaires et les notables de la société guatémaltèque. Cette protestation, qui eut lieu le 1er avril 1898, deviendra célèbre sous le nom de « Huelga de Dolores »...
Un chef d'oeuvre ...
I El muro del cementerio.
"Cal y llanto. Cal y llanto. Fuera la ciudad. Dentro las tumbas. Cal y llanto. Cal y llanto. Fuera las calles del suburbio. Dentro las cruces, la grama, el crucigrama que llenan nombres, apellidos, fechas. Vertical y horizontalmente, números y letras. Si se borrara, si desapareciera el muro del cementerio, pero no, allí estará siempre, siempre. Cal y llanto. Cal y llanto. Si se borrara, si desapareciera el muro del cementerio, pero no, allí estará siempre, siempre. Cal y llanto. Cal y llanto. Fuera, los pasos, las voces, la vida. Dentro, el silencio sin silencio, la tierra con historia, los pinos verticales, el gorigori del viento en los cipreses, los sauces despeinados, los álamos temblones, el damero de calles y avenidas entre nombres, apellidos, fechas. Números y letras grabados en el bronce y el mármol para la eterna brevedad del tiempo. Y más lejos, rodeada de barrancos, la isla de los pobres, cubierta de cruces blancas como hechas de palitos de fósforos. Si se borrara, si desapareciera el muro del cementerio, como se borra y desaparece la noche con el alba, cuando levanta los dedos del teclado esférico en que ha ejecutado, no a cuatro manos, sino a millones de manos, otro movimiento del eterno desaparecer. Si se borrara, si desapareciera esta última frontera sin aduanas, pero no, allí estará siempre, muro que uñé tantas cosas separando tanto, siempre, alto, plomizo, interminable, a perderse de vista entre las cocheras del servicio fúnebre y el hospital de enfermos contagiosos, momias de algodón y vendas que se retuercen, los ojos de fuera como desatornillados al oír los telonazos de las descargas de fusilamiento, sin importarles sus lepras, sus pústulas, sus llagas, la carne viva, la carcoma terebrante de sus huesos. Si se borrara, si desapareciera este paredón de ejecuciones capitales, pero no, allí estará siempre, siempre, muro que une tantas cosas separando tanto, alto, plomizo, interminable, cortado por las columnas y el arco de la puerta principal, y dos pequeñas puertas, laterales, sin más adorno que una cruz y dos enormes farolas de electricidad de arco, carbones que riegan luz de luto. Por la puerta principal entran los que ya no regresan. Se abren de par en par las gigantescas rejas, pasa el entierro y se oye un golpe de campana rota, seguido de la voz de Tenazón, el guardián del cementerio que repite, cada vez que recibe un nuevo huésped: “¡Más combustible… adelante… aquí la muerte es natural como la vida…!” Y por las puertas laterales, entran y salen las visitas.
Le mur devient à la fois frontière physique et métaphore de la condition humaine...
I. Le mur du cimetière
Chaux et larmes. Chaux et larmes. Dehors, la ville. Dedans, les tombes.
Chaux et larmes. Chaux et larmes. Dehors, les rues de la banlieue.
Dedans, les croix, l'herbe, les mots croisés que remplissent noms, prénoms, dates. Verticalement et horizontalement, chiffres et lettres.
Si l'on effaçait, si disparaissait le mur du cimetière...
Mais non, il sera toujours là, toujours. Chaux et larmes. Chaux et larmes.
Si l'on effaçait, si disparaissait le mur du cimetière...
Mais non, il sera toujours là, toujours. Chaux et larmes. Chaux et larmes.
Dehors, les pas, les voix, la vie.
Dedans, le silence sans silence, la terre chargée d'histoire, les pins dressés, le gémissement du vent dans les cyprès, les saules échevelés, les peupliers tremblants, le damier d'allées entre noms, prénoms, dates. Chiffres et lettres gravés dans le bronze et le marbre pour l'éternelle brièveté du temps.
Et plus loin, cernée de ravins, l'île des pauvres, couverte de croix blanches comme faites d'allumettes.
Si l'on effaçait, si disparaissait le mur du cimetière, comme s'efface et disparaît la nuit à l'aube, quand elle lève les doigts du clavier sphérique où elle a joué - non pas à quatre mains, mais à des millions de mains - un autre mouvement de l'éternel disparaître.
Si l'on effaçait, si disparaissait cette ultime frontière sans douane...
Mais non, il sera toujours là, mur qui unit tant de choses en séparant tant, toujours, haut, plombé, interminable, se perdant de vue entre les remises des corbillards et l'hôpital des contagieux, momies de coton et de bandages qui se tordent, les yeux exorbités comme dévissés en entendant les salves d'exécution, indifférents à leurs lèpres, leurs pustules, leurs plaies, la chair vive, la vermine perforant leurs os.
Si l'on effaçait, si disparaissait ce mur des exécutions capitales...
Mais non, il sera toujours là, toujours, mur qui unit tant de choses en séparant tant, haut, plombé, interminable, coupé par les colonnes et l'arche du portail principal, et deux petites portes latérales sans autre ornement qu'une croix et deux énormes lanternes à arc électrique, charbons qui répandent une lumière de deuil.
Par le portail principal entrent ceux qui ne reviendront plus. Les grilles géantes s'ouvrent à deux battants, passe le cortège funèbre, et l'on entend un coup de cloche fêlée, suivi de la voix de Tenazón, le gardien du cimetière, qui répète à chaque nouvel hôte :
"Du combustible... encore... ici la mort est naturelle comme la vie !"
Et par les portes latérales entrent et sortent les visiteurs.
"Entran. Salen. Entran. Salen. Entrada por salida. Calzados y descalzos, bien y mal vestidos, de luto riguroso algunos, otros con aguaceros en los ojos y otros abrazados a ramos de azucenas, embuditos blancos de pasta de hostia. Como si lo fueran. Todas estas flores mortuorias parecen de pasta de hostia, perfumada y penetrante la de los nardos, de párpado sobre párpado la de las rosas, de orejitas de nieve la de los jazmines, de pluma blanca la de los claveles, espumilla alfeñicada la de los crisantemos, porcelana la de las orquídeas. Abrazar, abarcar en las flores al ser idolatrado. Sus edades fragantes. Su recuerdo. Su vida. Dalias, lilas, gladiolos, diamelas, hortensias, magnolias, acantos, violetas, margaritas, nome-olvides. Pero no sólo flores acarrean estas filas de hormigas negras que entran y salen del cementerio, también llevan cristos, cruces, retratos, lápidas, agua bendita, floreros, coronas de ciprés, de papel, de hojalata, gente que al salir del cementerio, no se vuelve igual de entre los muertos, parece desorientada, sin saber qué hacer, sin rumbo, sin saber si marcharse a la ciudad en seguida —tranvías, carruajes, automóviles de alquiler—, o quedarse por allí, donde al sólo cruzar la calle espaciosa y arbolada, empieza el suburbio de casas apeñuscadas bajo las polvaredas que levantan los ventarrones que barren aquellos campos solos. Algunos atraviesan la gran avenida, maquinalmente, tristes, mestizos hechos de soledad cansada. La cruzan para alejarse lo antes posible de la necrópolis solemne, suntuosa, funeral, y se pierden por el barrio de calles de tierra, cercas de alambre como frenos de hilos de púas para el viento y los caballos viejos, esqueletones sin dueño, somnolentes e inmóviles de día, y de noche deambulando, sedientos, en busca de charcos de agua con estrellas...."
La danse macabre des vivants autour des morts ...
"Ils entrent. Ils sortent. Ils entrent. Ils sortent.
Entrée pour sortie.
Chaussés et déchaux, bien ou mal vêtus, certains en deuil rigoureux, d'autres avec des averses dans les yeux, d'autres encore serrant contre eux des gerbes de lys, petits entonnoirs blancs en pâte d'hostie. Comme s'ils l'étaient.
Toutes ces fleurs mortuaires semblent faites de pâte d'hostie : les tubéreuses, parfumées et pénétrantes, les roses, paupière sur paupière, les jasmins, oreillettes de neige, les œillets, plumes blanches, les chrysanthèmes, meringue filante, les orchidées, porcelaine
Étreindre, embrasser dans les fleurs l'être idolâtré. Leurs âges parfumés. Leur souvenir. Leur vie. Dahlias, lilas, glaïeuls, camélias, hortensias, magnolias, acanthes, violettes, marguerites, myosotis...
Mais ces colonnes de fourmis noires qui entrent et sortent du cimetière ne transportent pas que des fleurs. Elles portent aussi : des crucifix, des croix, des portraits, des stèles, de l'eau bénite, des vases, des couronnes de cyprès, de papier, de fer-blanc
Les gens qui sortent du cimetière n'en reviennent pas semblables. Ils semblent désorientés, ne sachant que faire, sans but, incertains : rentrer immédiatement en ville (tramways, calèches, taxis) ou rester aux alentours
Là où, dès qu'on traverse la large avenue bordée d'arbres, commence le faubourg aux maisons entassées sous les tourbillons de poussière soulevés par les bourrasques qui balayent ces champs désolés.
Certains traversent la grande avenue mécaniquement, tristes, métis faits de solitude lasse. Ils la franchissent pour s'éloigner au plus vite de la nécropole solennelle, fastueuse, funèbre, et se perdent dans le quartier aux rues de terre, aux clôtures de fil de fer pareilles à des freins de fils barbelés pour le vent et les vieux chevaux - squelettes sans maître, somnolents et immobiles le jour, qui errent la nuit, assoiffés, à la recherche de flaques d'eau étoilées.
(..)
