- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer

African-American literature & The Civil Rights Movement - James Baldwin (1924-1987), "Go Tell It on the Mountain" (1953), "Notes of a Native Son" (1955), 'Giovanni Room" (1956), "Another Country" (1962), "The Fire Next Time" (1963), "No Name in the Street" (1972), "I Am Not Your Negro" (2017) - ......
Last update: 12/12/2020
1950s - Dans les années 1950, alors que les États-Unis entrent dans la guerre froide, les "colored people", qu'ils aient ou non combattu pour défendre les intérêts américains, ne supportent plus le déni de citoyenneté et les préjugés raciaux que maintiennent les structures juridiques mises en place pour limiter leur liberté (la ségrégation institutionnelle). Mais le monde a basculé aussi pour des Blancs américains qui semblent alors considérer que le triomphe de la Seconde Guerre mondiale justifie amplement leur manière américaine de vivre en entretenant un front racial intérieur systématique...

Et dans cette toute nouvelle Amérique bourdonnante qui jaillit de l'après-dépression et de l'après-guerre, l'arme de la protestation univoque ou manichéenne ne saurait suffire devant "an humanity instead as a web of ambiguity, paradox...", c'est du moins ce que pense en 1949 le jeune essayiste new-yorkais James Baldwin (1924-1987), un protégé de Wright en avance sur son temps. "The failure of the protest novel lies in its rejection of life, the human being, the denial of his beauty, dread, power, in its insistence that it is categorization alone which is real." - entendre une autre voix en publiant "Everybody's Protest Novel", une critique de la fiction dite de la protestation (protest fiction) qui prend appui sur deux romans, "Uncle Tom's Cabin" de Harriet Beecher Stowe (1852) et "Native Son" de Richard Wright (1940). Le roman de protestation a pour objectif de faire passer un message (pour Stowe, il s'agit de montrer que l'esclavage est une erreur). Et donc, pour se faire, va simplifier à l'excès la complexité des êtres humains (ainsi le sentimentalisme de La Case de l'oncle Tom), et privilégier des personnages qui ne sont que des arguments; et réduire le monde des idées et des passions à un manichéisme réducteur, le bien et le mal, le noir et le blanc. Cette simplification n'explique pas la violence de ce qu'elle dénonce, mais la reproduit sans la moindre explication qui puisse permettre aux lecteurs de comprendre le problème. Quant à "Native Son", avec son protagoniste Bigger Thomas : "La tragédie de Bigger n'est pas qu'il ait froid, qu'il soit noir ou qu'il ait faim, ni même qu'il soit américain, noir ; mais qu'il ait accepté une théologie qui lui refuse la vie, qui admet la possibilité qu'il soit sous-humain". L'histoire de Bigger reproduit l'idée que la seule relation entre les noirs et les blancs est celle du conflit, de la haine et de la méfiance. Baldwin affirme que ce dont nous avons vraiment besoin dans la littérature, c'est d'approfondir la complexité et la vérité de notre humanité. La littérature doit résister à la catégorisation par "le dévouement à l'être humain, à sa liberté et à son épanouissement".
James Baldwin se rappellera toute sa vie de cette jeune institutrice blanche, Bill Miller, qui lui a donné des livres, qui lui a parlé des livres et du monde, qui l'a emmené des films, il avait dix ans, "c'est certainement grâce à Bill Miller, arrivé si tôt dans ma vie terrifiante, que je ne suis jamais vraiment parvenu à détester les Blancs..."

On a pu dire que James Baldwin avait transformé la colère en art et l’intime en politique, prouvant que la littérature peut être à la fois un miroir brûlant de la société et une espérance pour notre âme humaine. C'est une voix transgressive, noir, gay, exilé (Paris), Baldwin refuse les étiquettes simplistes (Je ne suis pas un nègre, je suis un homme), il fusionne race, sexualité et classe (Giovanni’s Room, 1956 ; Another Country, 1962) pour montrer que l’oppression est multidimensionnelle. Il a su mêler la précision du pamphlet (The Fire Next Time, 1963) et la poésie romanesque (Go Tell It on the Mountain, 1953), a internalisé autant la haine de soi (Les Blancs ont inventé le Nègre, et les Noirs ont fini par le croire) que l'amour comme résistance (L’amour est un combat, un chant, un cri). Penseur de la complexité morale, il refuse les manichéismes, critique les libéraux blancs (ils aiment les Noirs, mais pas leurs voisins noirs) et dénonce les limites du nationalisme noir (débat avec Malcolm X) : on ne peut pas changer tout ce à quoi on fait face, mais on ne peut rien changer tant qu’on ne lui a pas fait face...
Que lire, si l'on devait prioriser ...
- "The Fire Next Time" (1963), un essai, deux lettres percutantes sur le racisme, la religion et l’Amérique. Nous, les Noirs, nous ne sommes pas les seuls prisonniers de ce système. Les Blancs le sont aussi, et peut-être plus gravement ..
- "Go Tell It on the Mountain" (1953), un roman semi-autobiographique, son enfance à Harlem sous l’emprise d’une Église pentecôtiste abusive. Baldwin y déploie sa prose musicale, inspirée par les sermons noirs. Une scène clé, la crise mystique du jeune John, tiraillé entre foi et désir homosexuel.
- "Giovanni’s Room" (1956), c'est oser être gay en 1956, l'histoire d’un amour interdit à Paris, écrite alors que l’homosexualité était criminalisée. Le drame de David, un Américain blanc, montre que la honte de soi dépasse les questions raciales. Un texte fondateur de la littérature queer.
- "Notes of a Native Son" (1955), une autofiction critique qui mêle souvenirs personnels (dont la mort de son père) et analyse du racisme. Baldwin y refuse tant la victimisation que la haine. "Stranger in the Village", être un Noir dans un village suisse ..
- "If Beale Street Could Talk" (1974), un couple noir séparé par une fausse accusation, un roman dont le film de Barry Jenkins (2018) relancera l’intérêt.
- "Another Country" (1962), le New York années 1950, les désirs entremêlés de personnages noirs, blancs, gay et hétéros, des scènes de sexe et de violence qui firent scandale, seul l’amour brut semble en mesure de briser les solitudes.
- "The Devil Finds Work" (1976), un essai, cinéma et racisme, les Blancs croient que les films sont des divertissements. Les Noirs savent qu’ils sont des armes ..

James Baldwin, "Go Tell on the Mountain" (1953, La Conversion)
"John ne s'intéressait guère au peuple de Dieu et il était encore moins intéressé par la perspective de le guider où que ce soit, mais cette éventualité si souvent répétée se déployait dans son esprit comme un grand portail en cuivre s'ouvrant pour lui sur un monde où les gens ne vivaient pas dans la noirceur de la maison de son père..." - Ce roman d'apprentissage semi-autobiographique explore les liens complexes et souvent fragiles qui unissent son héros, John, au monde...
Le livre est divisé en trois parties :
- "Premier Jour" ("The Seventh Day") : Présente le quotidien de John Grimes à Harlem.
- "Les Prières des Saints" ("The Prayers of the Saints") : Cœur du roman – les prières et flashbacks des personnages pendant la veillée religieuse, culminant avec la transe de John.
- "La Croix" ("The Threshing Floor") : Dénouement après la conversion.
La nuit de son quatorzième anniversaire, il subit un rite d'initiation décisif dans l'église de Harlem où prêche Gabriel, qui, contrairement à ce que croit John, n'est pas son père biologique. De caractère volatile, Gabriel représente une force dominante. Après une jeunesse agitée, il a eu la révélation de la foi, qui le pousse à prêcher l'ire de Dieu. Et s'il a épousé la mère de John pour lui épargner les souffrances d'une vie de mère célibataire, il ne cesse de condamner l'amour qu'elle porte à son fils, un sentiment pour lui impudique en raison de l'illégitimité de John et de la relation qu'elle eut avec le père du garçon, son premier amour. Gabriel a lui aussi conçu un enfant illégitime au cours de son premier mariage - fait qu'il a toujours caché sous prétexte de repentir. ll passe sous silence l'existence de son fils orphelin, qui eut une enfance malheureuse et fut victime, jeune, d'une mort violente.
Bien que John ignore la plupart de ces faits, C'est un garçon intuitif qui comprend exactement les dangers que pose Harlem aux adolescents noirs, particulièrement à ceux qui ne sont protégés par aucune institution, notamment par l'Église. Le soutien aimant que lui offre Elisha, l'un des jeunes leaders religieux résonne d'un homo-érotisme jubilatoire qui permet à John d'imaginer un futur au sein de l'Église. Cependant son beau-père, responsable de l'exégèse et de l'instruction doctrinale, y impose un caractère vindicatif et cruel qui force les croyants à une obéissance aveugle. L'épuisement affectif et physique né de la conversion hallucinatoire de John lui offre au petit matin un moment de répit triomphant, tout bref qu'il soit. En 2017, le réalisateur haïtien Raoul Peck s'inspirera de ce texte pour produire un documentaire, "I Am Not Your Negro"...
"... On Sunday mornings the women all seemed patient, all the men seemed mighty. While John watched, the Power struck someone, a man or woman; they cried out, a long, wordless crying, and, arms outstretched like wings, they began the Shout. Someone moved a chair a little to give them room, the rhythm paused, the singing stopped, only the pounding feet and the clapping hands were heard; then another cry, another dancer; then the tambourines began again, and the voices rose again, and the music swept on again, like fire, or flood, or Judgment.
Then the church seemed to swell with the Power it held, and, like a planet rocking in space, the temple rocked with the Power of God. John watched, watched the faces, and the weightless bodies, and listened to the timeless cries. One day, so everyone said, this Power would possess him; he would sing and cry as they did now, and dance before his King. He watched young Ella Mae Washington, the seventeen-year-old granddaughter of Praying Mother Washington, as she began to dance. And then Elisha danced..."
"Le dimanche matin, toutes les femmes paraissaient patientes, tous les hommes impressionnants. Sous le regard attentif de John, la Puissance frappait quelqu’un, homme ou femme, lequel poussait un cri, un long cri inarticulé et, les bras déployés comme des ailes, commençait le shout, sorte de danse religieuse accompagnée d’une psalmodie exaltée. Quelqu’un tirait une chaise pour faire un peu de place, le rythme s’interrompait, les chants s’arrêtaient, on n’entendait plus que les pieds en action et les mains en train de taper ; puis c’était un nouveau cri, un nouveau danseur ; puis les tambourins reprenaient et les voix recommençaient à s’élever et la musique à tout effacer, comme le feu, les eaux ou le jugement. Puis l’église donnait l’impression de se dilater sous l’effet de la Puissance qu’elle abritait et, telle une planète dans l’espace, se voyait ébranlée par la Puissance de Dieu. John regardait attentivement ces visages et ces corps immatériels et il écoutait ces cris intemporels. Un jour, s’il fallait en croire ce que tous lui disaient, cette Puissance le posséderait ; il chanterait et crierait comme eux à présent, et danserait devant son Roi. Il observait la jeune Ella Mae Washington, la petite-fille tout juste âgée de dix-sept ans de mère Washington – la responsable des prières – qui se mettait à danser. Et ensuite Elisha se mettait à danser.
Jusque-là, il était resté assis au piano, la tête rejetée en arrière, les yeux fermés, le front emperlé de sueur, à jouer et à chanter ; puis, tout à coup, pareil à un grand chat noir en difficulté dans la jungle, il se raidissait, commençait à trembler et poussait un cri. Jésus, Oh Seigneur Jésus ! Il plaquait sur le piano une dernière note exaltée, puis tournait ses paumes vers le ciel, les doigts bien écartés. Les tambourins s’empressaient de combler le vide créé par le silence de son piano, et son cri attirait d’autres cris en réponse. Puis il sautait sur ses pieds et pirouettait sur lui-même, sans plus rien voir, le visage congestionné, déformé par cette fièvre intérieure, tandis que les muscles de son long cou noir tressautaient et se dilataient. On aurait juré qu’il ne pouvait plus respirer, que son corps ne pouvait plus contenir cette ferveur et qu’il allait, sous leurs yeux, se disséminer dans l’atmosphère figée dans l’expectative. Ses mains, raides jusqu’au bout de ses doigts, s’agitaient contre ses hanches, ses yeux éteints se levaient vers le ciel et il se mettait à danser. Ensuite, il serrait les poings, sa tête basculait en avant dans un mouvement sec et la sueur diluait la brillantine qui dégoulinait le long de ses cheveux ; le rythme des autres fidèles s’accélérait pour s’accorder sur celui d’Elisha dont les cuisses vibraient terriblement derrière le tissu de son pantalon tandis que ses talons frappaient le sol et que ses poings martelaient son corps comme un tambour. L’espace d’un moment, il évoluait ainsi au milieu des danseurs, la tête baissée et les poings en action, à un rythme intenable, jusqu’à ce que les murs de l’église paraissent prêts à céder sous le bruit. Puis il poussait un cri, relevait la tête et tendait les bras vers le ciel, le front ruisselant de sueur, tout le corps en mouvement, comme s’il devait ne jamais s’arrêter de danser. Parfois, il continuait jusqu’au moment où il tombait – où il s’effondrait comme un animal victime d’un coup de massue – en gémissant, face contre terre. Un grand gémissement emplissait alors l’église.
Le péché était parmi eux. Un dimanche, une fois l’office terminé, le père James avait dénoncé le péché parmi les justes. Il avait dénoncé Elisha et Ella Mae. Ils s’étaient engagés sur « un mauvais chemin » ; ils risquaient de s’écarter de la vérité. Et tandis que le père James évoquait ce péché qu’il les savait ne pas avoir encore commis, la figue verte trop tôt cueillie sur l’arbre – pour agacer les dents des enfants –, John sentit un vertige le prendre sur sa chaise et se vit dans l’incapacité de regarder Elisha, debout à côté d’Ella Mae, devant l’autel. Elisha baissait la tête pendant que le père James parlait, et un murmure courait dans la congrégation. Quant à Ella Mae, elle n’était plus aussi belle que lorsqu’elle chantait et qu’elle proclamait sa foi, mais ressemblait à n’importe quelle jeune fille maussade. Ses grosses lèvres pendouillaient et ses yeux étaient tout noirs – de honte ou de colère, ou les deux. Sa grand-mère, qui l’avait élevée, suivait la scène sans rien dire, les mains jointes. C’était un des piliers de l’église, une évangéliste qui en imposait et très connue. Elle n’intervint pas pour défendre Ella Mae, car elle devait avoir senti, comme tous les fidèles présents, que le père James ne faisait que son devoir, lequel était clair et douloureux ; il était responsable d’Elisha, après tout, de même que mère Washington était responsable d’Ella Mae. Ce n’était pas facile, poursuivit le père James, d’être le berger d’un troupeau. Peut-être que cela paraissait facile de monter en chaire, tous les soirs pendant des années, mais il ne fallait pas oublier l’effroyable responsabilité que le Seigneur tout-puissant avait placée sur ses épaules – nul ne devait oublier qu’il lui faudrait un jour rendre compte à Dieu de toutes les âmes de son troupeau. Il ne fallait pas l’oublier quand on le trouvait dur, il ne fallait pas oublier que le Verbe était dur, que le chemin de la sainteté l’était aussi. Dans l’armée céleste, il n’y avait pas de place pour les cœurs lâches, ni de couronne pour celui qui faisait passer mère, père, sœur, frère, bien-aimé ou ami avant la volonté de Dieu. Que la congrégation dise amen à cela ! Et ils dirent : « Amen ! Amen ! »
Le seigneur l’avait amené, reprit le père James en baissant les yeux vers le garçon et la fille qui se tenaient devant lui, à leur donner un avertissement devant tout le monde avant qu’il ne soit trop tard ... "
Dans une église pentecôtiste de Harlem, années 1930, John Grimes, 14 ans, fils d’un pasteur tyrannique (Gabriel), va vivre sa nuit de "conversion" sous pression familiale et communautaire...
"J’ai écrit Go Tell It on the Mountain pour exorciser cette nuit où j’ai cru que Dieu me parlait – et où je n’ai entendu que ma propre peur", écrira Baldwin (Notes of a Native Son), "Les Blancs croient que les églises noires sont des lieux de joie. Mais la joie y est mêlée à une terreur noire." (Interview, 1961) : l tomba à genoux, sentant soudain que c’était là sa seule chance de vivre, John étouffe sous le poids du puritanisme noir, où le salut exige le reniement de soi, mais sa crise mystique est aussi une révolte contre son père, symbole de l’autorité hypocrite, et les visions de John mêlent images bibliques (Jésus, les pécheurs) et fantasmes racistes (peur de devenir "le Nègre" méprisé des Blancs). Pendant sa transe, des chapitres révèlent le passé de son père (Gabriel, ancien débauché) et de sa tante (Florence), montrant que la sainteté cache souvent le péché. Toni Morrison s’inspire de ce récit dans "Song of Solomon" pour la scène de transe de Milkman.
".. Alors, les eaux du désespoir se mirent à submerger l’âme de John. L’amour est aussi fort que la mort, aussi profond que la tombe. Mais l’amour qui, tel un monarque bienveillant, avait peut-être grossi les rangs de la population du royaume voisin, la mort, ne s’était pas manifesté : ici, nul ne lui devait fidélité ou obéissance. Ici, il n’y avait ni discours ni langage et il n’y avait pas d’amour ; personne pour dire : « Tu es beau, John » ; personne pour lui pardonner son péché, quel qu’il fût ; personne pour le guérir et le relever. Personne : son père et sa mère regardaient derrière eux, Roy était couvert de sang, Elisha n’était pas là.
Puis les ténèbres se mirent à murmurer – terrible bruit – et les oreilles de John à vibrer. Dans ce murmure qui emplissait la tombe, comme si un millier d’ailes frappaient l’air, il reconnut un bruit qu’il entendait depuis toujours. Sous l’effet de la terreur, il se mit à pleurer et à geindre – et ce bruit se vit absorbé et pourtant amplifié par les échos qui emplissaient les ténèbres.
Ce bruit avait marqué la vie de John, du moins en avait-il l’impression maintenant, dès l’instant qu’il avait poussé son premier cri. Il l’avait entendu partout, dans les prières et les échanges quotidiens, partout où les saints se rassemblaient comme dans les rues des incroyants. Il résonnait dans la colère de son père, dans la calme insistance de sa mère, dans la véhémence moqueuse de sa tante ; il avait retenti, de manière très curieuse, cet après-midi même dans la voix de Roy, et quand Elisha avait joué du piano ; il se remarquait dans les sonorités du tambourin de sœur McCandless, dans le rythme aussi de son témoignage, et donnait à ce témoignage une autorité sans égale, irrécusable. Oui, il l’entendait depuis toujours, mais c’était aujourd’hui seulement que ses oreilles s’étaient ouvertes à ce bruit qui venait des ténèbres, qui ne pouvait venir que des ténèbres et qui pourtant témoignait assurément de la gloire de la lumière. Et, maintenant, dans ses gémissements, alors qu’il était tellement loin de toute aide possible, il l’entendait en lui-même – il montait de son cœur fendu, brisé. C’était le bruit de la fureur et des pleurs qui emplissaient la tombe, de la fureur et des pleurs émanant du temps libéré, mais désormais enfermés dans l’éternité ; d’une fureur sans paroles, de pleurs sans voix – et qui pourtant parlaient à présent à l’âme étonnée de John d’une mélancolie infinie, d’une patience suprêmement pénible et de la nuit la plus longue ; de l’eau la plus profonde, des chaînes les plus solides, du fouet le plus cruel ; de l’humilité la plus pitoyable, du cachot le plus sûr, du lit d’amour souillé, de naissance dans le déshonneur et, plus sanglant, inqualifiable, de mort soudaine. Oui, les ténèbres bruissaient de meurtres : tel cadavre dans l’eau, tel autre dans le feu, tel autre après l’arbre. John baissa les yeux vers les rangs de ces armées des ténèbres, qui défilaient les unes après les autres, et son âme murmura : Qu’est-ce que c’est que ça ? Qui sont ces gens ? Et se demanda : Où vais-je aller ?
Il n’y avait pas de réponse. Il n’y avait dans la tombe ni aide ni guérison, ni réponse dans les ténèbres, ni paroles de tous ces gens qui se trouvaient là. Ils regardaient derrière eux. Et John regarda derrière lui, ne vit aucune délivrance.
Moi, John, j’ai vu l’avenir se déployer sur le ciel.
Le fouet, le cachot et la nuit lui étaient-ils destinés ? Et la mer ? Et la tombe ?
Moi, John, j’ai vu un chiffre se déployer sur le ciel.
Il s’efforça de fuir – ces ténèbres, ces gens – pour gagner la terre des vivants, là-haut, si loin. La peur était sur lui, une peur plus dévastatrice que tout ce qu’il avait connu jusque-là, tandis qu’il se tournait et se retournait dans les ténèbres, tandis qu’il se lamentait, chancelait et rampait à travers les ténèbres sans trouver la moindre main, la moindre voix, la moindre porte. Qu’est-ce que c’est que ça ? Qui sont ces gens ? C’étaient les méprisés, les réprouvés, les misérables, les pestiférés, les parias de la Terre ; et il était des leurs, ils allaient absorber son âme. Les coups de fouet qu’ils avaient reçus allaient lui zébrer le dos, leurs punitions seraient les siennes, leur sort le sien, siennes leurs humiliations, leurs angoisses, leurs chaînes, leur cachot serait le sien, leur mort la sienne..."
Mais plus encore, Baldwin, en réinventant la langue anglaise avec la puissance du spirituel afro-américain, nous fait comprendre ici comment la religion a façonné la résistance noire (et ses contradictions) : Dieu m’a donné la langue pour dire ma souffrance ...

Giovanni 's Room" (1956)
"I STAND AT THE window of this great house in the south of France as night falls, the night which is leading me to the most terrible morning of my life. I have a drink in my hand, there is a bottle at my elbow. I watch my re ection in the darkening gleam of the window pane. My re ection is tall, perhaps rather like an arrow, my blond hair gleams. My face is like a face you have seen many times. My ancestors conquered a continent, pushing across death-laden plains, until they came to an ocean which faced away from Europe into a darker past..."
Je savais que Giovanni’s Room me ferait perdre des lecteurs, peut-être ma carrière. Mais je devais l’écrire – pour survivre (Entretien avec The Paris Review, 1984). Son éditeur lui demandera de "brûler" le manuscrit. Il refusa, le confiant à un petit éditeur britannique (Michael Joseph) avant que Knopf n’accepte enfin... "David est blanc parce que la terreur de l’homosexualité ne connaît pas de couleur. Je voulais montrer que l’enfer, c’est d’être coincé dans son propre corps, peu importe sa race." (Discours à Berkeley, 1979)....
"GIOVANNI, MON AMI", deuxième roman de James Baldwin et, selon une tradition fermement établie dans le roman américain comme dans le roman européen, un roman d`apprentissage à dominante largement sexuelle, dans lequel, le fait est à noter surtout lorsqu'on pense à I`importance prise plus tard par le problème dans son œuvre même, la question raciale ne
joue aucun rôle - pas plus, d'ailleurs, que celle de savoir quelle est l'occupation professionnelle du protagoniste. La scène initiale nous le montre en train d'attendre l`autocar dans une petite ville du Midi où vient de le quitter définitivement Hella, la jeune Américaine qu'il était censé devoir épouser. Tout le roman ensuite n'est qu'un retour en arrière.
La première partie, après un bref rappel de l'initiation homosexuelle à New York, résume la vie de l'Américain David à Paris et de sa rencontre, dans un bar à homosexuels, d`un jeune Italien très beau dont on va apprendre qu'il a mal tourné et que l'attend... la guillotine.
La deuxième partie explique comment on est arrivé là, elle se situe là où David est venu vivre en l'absence de Hella - dans la chambre de Giovanni, laquelle symbolise un peu trop manifestement le piège sordide où il est tombé, lui qui ne sait pas encore de quel côté l'attire sa sexualité, en venant vivre avec quelqu'un qui ne le sait pas non plus, et qui a quitté une jeune femme dans le sud de l'ltalie le jour où elle lui a donné un enfant mort. Lorsque Hella rentre d'Espagne, David retourne vivre avec elle, abandonnant Giovanni qui a été humilié et chassé, devant tous ses clients, par Guillaume, le patron de l'établissement où il était barman. Et c'est celui-ci que Giovanni est revenu assassiner - ce qui lui vaut la peine de mort. (Trad. La Table ronde, 1958).
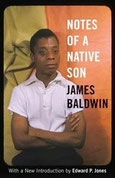
"Notes of a Native Son" (1955)
Un recueil, fondateur, de 15 essais écrits entre 1948 et 1955, organisés en trois parties, Expériences personnelles (dont le célèbre Notes of a Native Son), Critiques culturelles (cinéma, littérature, théâtre), et Réflexions sur l'exil (notamment Stranger in the Village) : une vision de la vie et de la pensée afro-américaines à l’aube du mouvement des droits civiques et alors que le mouvement gagnait lentement en force.
Récit autobiographique sur la mort de son père (pasteur tyrannique) et les émeutes raciales de Harlem en 1943 - La haine détruit toujours celui qui hait - Baldwin décrit sa lutte pour ne pas reproduire la rage paternelle, et ce malgré le racisme que l'on peut subir quotidiennement. - L’Amérique comme paradoxe (Many Thousands Gone), des Blancs américains qui aiment l'idée des Noirs, mais pas leur réalité. - L’exil et le regard de l’autre (Stranger in the Village), l'expérience d’être le premier Noir dans un village suisse, en Amérique, je suis un problème; ici, je suis une anomalie ..
"... Une des difficultés à être un écrivain noir (et n’y voyez pas une déploration particulière, car je ne prétends pas que c’est plus dur pour lui que pour n’importe qui d’autre) c’est qu’on a tant et tant écrit sur le problème noir. Les rayonnages gémissent sous le poids de l’information, et tout le monde, par conséquent, se considère informé. En outre cette information agit habituellement (généralement, populairement) pour renforcer les attitudes traditionnelles. Des attitudes traditionnelles, il y en a seulement deux — Pour ou Contre — et moi, personnellement, je trouve difficile de dire quelle attitude m’a causé le plus de souffrance. Je parle en tant qu’écrivain ; d’un point de vue social, je suis parfaitement conscient que le changement de la malveillance vers la bienveillance, quelle que soit sa motivation, quelle que soit son imperfection, quelle que soit son expression, est mieux que pas de changement du tout.
Mais c’est en partie le travail de l’écrivain — tel que je le vois — d’examiner les attitudes, d’aller sous la surface, de capter la source. De ce point de vue, le problème noir est presque inaccessible. Ce n’est pas seulement qu’on a tellement écrit dessus ; c’est qu’on a écrit tellement mal. On peut dire que le prix que paie un Noir pour accéder à la parole est de se retrouver, à la fin, sans rien à dire. (« Tu m’as appris le langage », dit Caliban à Prospero, « et tout ce que j’y gagne est que je sais maudire. ») Voyez en effet combien la terrible activité sociale que ce problème génère impose aux Blancs et aux Noirs la même nécessité de regarder vers l’avenir et de travailler à un monde meilleur. C’est bien, ainsi l’eau reste troublée ; en fait, c’est tout ce qui a rendu possible le progrès des Noirs. Et pourtant, les questions sociales ne sont pas, pour parler de façon générale, la préoccupation première de l’écrivain, qu’elles dussent l’être ou pas ; il est absolument nécessaire qu’il établisse entre ces questions et lui une distance qui rende au moins possible la clarté, pour qu’avant de jeter quelque regard sensé vers l’avenir, il ait d’abord la latitude de regarder longuement en arrière. Or dans le contexte du problème noir, ni les Blancs ni les Noirs, chacun pour d’excellentes raisons, n’ont le moindre désir de regarder en arrière ; mais je pense que le passé est la seule chose qui rende le présent cohérent et, en outre, que le passé restera horrible exactement aussi longtemps que nous refuserons de le prendre honnêtement en compte.
Je sais, en tout cas, que le moment le plus crucial de mon propre développement vint quand je fus obligé de reconnaître que j’étais une sorte de bâtard de l’Occident ; quand j’ai suivi le fil de mon passé, je ne me suis pas retrouvé en Europe mais en Afrique. Cela voulait dire que d’une façon subtile, d’une façon vraiment profonde, j’abordais Shakespeare, Bach, Rembrandt, les pierres de Paris, la cathédrale de Chartres et l’Empire State Building avec une attitude particulière. Ils n’étaient pas vraiment mes créations, ils ne contenaient pas mon histoire ; chercher un reflet de moi-même en eux serait toujours vain. J’étais un intrus, ce n’était pas mon héritage. En même temps, je n’avais pas d’autre héritage dont je pouvais espérer disposer — j’étais certainement inapte à la jungle ou à la tribu. Il allait falloir que je m’approprie ces siècles blancs, il allait falloir que je les fasse miens — il allait falloir que j’accepte mon attitude particulière, ma place spéciale dans ce cadre — sinon, je n’aurais de place dans aucun cadre. Le plus difficile était le fait d’être obligé d’admettre quelque chose que je m’étais toujours caché à moi-même, que le Noir américain avait été obligé de se cacher à lui-même, car son progrès dans la vie publique était à ce prix : je haïssais et je craignais les Blancs. Cela ne voulait pas dire que j’aimais les Noirs ; au contraire, je les méprisais, peut-être parce qu’ils avaient échoué à produire Rembrandt. Dans les faits, c’était le monde entier que je haïssais et craignais. Et cela voulait dire non seulement que je donnais ainsi au monde un pouvoir totalement meurtrier sur moi, mais aussi que dans de tels limbes, à ce point autodestructeurs, je ne pourrais jamais espérer écrire.
On écrit à partir d’une seule chose seulement — sa propre expérience. Tout dépend de l’ardeur avec laquelle on extirpe de cette expérience la dernière goutte qu’elle puisse rendre, douce ou amère. C’est là le seul vrai souci de l’artiste, de recréer, hors du désordre de sa vie, cet ordre qu’est l’art. La difficulté alors, pour moi, dans le fait d’être un écrivain noir, c’était que les terribles exigences et les très réels dangers de ma situation sociale m’interdisaient, dans les faits, d’examiner ma propre expérience de trop près.
Je ne pense pas que le dilemme que je viens de souligner soit rare. Je pense en revanche, puisque les écrivains travaillent avec le médium désastreusement explicite du langage, que cela aide un tout petit peu à expliquer pourquoi, malgré les énormes ressources du discours et de la vie noirs, et malgré l’exemple de la musique noire, la prose écrite par des Noirs a été, de façon générale, aussi pâle et aussi brutale. Si j’ai écrit si longuement sur le fait d’être un Noir, ce n’est pas parce que j’y voyais mon unique sujet, mais seulement parce que c’était la grille que je devais déverrouiller avant de pouvoir espérer écrire sur autre chose. Je ne crois pas que le problème noir en Amérique puisse même être discuté avec cohérence sans avoir en tête son contexte ; son contexte étant l’histoire, les traditions, les coutumes, les postulats moraux et les préoccupations du pays ; en bref, le tissu social général. Malgré les apparences, personne en Amérique n’échappe à ses effets et tout le monde en Amérique en porte quelque responsabilité..." (Traduit de l’anglais par Marie Darrieussecq, Gallimard)
Publié au début du mouvement des droits civiques, Baldwin répond ici à "Native Son" de Richard Wright (1940), rejetant son déterminisme social. Dans ce livre, le protagoniste Bigger Thomas, jeune Noir pauvre de Chicago, commet un meurtre accidentel puis un meurtre volontaire. Wright explique ces actes par l'oppression systémique (le racisme et la pauvreté déterminent le destin de Bigger, le réduisant à un animal acculé), une vision naturaliste (proche de Zola, Wright montre que la violence de Bigger est une réaction inévitable à la violence sociale) et une absence d'intériorité (Bigger n'a pas de conscience complexe ; il est avant tout un produit de la société). Baldwinva reprocher à Wright de sacrifier la complexité littéraire pour un message politique simpliste, et lui oppose dans "Everybody’s Protest Novel" (1949) et "Notes of a Native Son" (1955), Baldwin oppose à Wright une vision existentielle : Bigger n'est pas un personnage, mais un symbole. Même dans l’oppression, l’homme reste libre de ses actes (influence de Sartre et de la philosophie existentielle) : aucun système ne peut m’enlever ma capacité à haïr ou à aimer. C’est là ma malédiction et ma grandeur ..
"Emportés par milliers
C’est seulement par sa musique que le Noir en Amérique a pu raconter son histoire : et les Américains sont capables de l’admirer parce que leur sentimentalité les protège de vraiment la comprendre. Autrement, cette histoire reste encore à raconter ; et aucun Américain n’est préparé à l’entendre. Le résultat des choses non dites est toujours ce dangereux silence résonnant qui nous oppresse encore aujourd’hui ; et l’histoire est racontée, compulsivement, par signes et par symboles, par hiéroglyphes ; elle est révélée dans le discours du Noir et dans celui de la majorité blanche et dans leurs différents cadres de référence. Notre culture populaire et notre moralité trahissent les façons par lesquelles le Noir a affecté la psychologie américaine ; l’éloignement où nous le tenons a la profondeur de notre éloignement à nous-mêmes. La question : que ressentons-nous vraiment pour lui — nous ne pouvons pas la poser, car une telle question ouvre simplement la porte au chaos. Ce que nous ressentons vraiment pour lui engage tout ce que nous ressentons pour tout, pour tous, pour nous-mêmes.
L’histoire du Noir en Amérique est l’histoire de l’Amérique — ou plus précisément, est l’histoire des Américains. Ce n’est pas une très jolie histoire ; l’histoire d’un peuple n’est jamais très jolie. Le Noir en Amérique, lugubrement évoqué comme cette ombre couchée en travers de notre vie nationale, est bien plus que cela. Il est une série d’ombres, autocréées, entrelacées, contre lesquelles nous luttons maintenant avec impuissance. On pourrait dire que le Noir en Amérique n’a d’autre réalité que dans la noirceur de nos esprits.
Voilà pourquoi son histoire et son progrès, sa relation à tous les autres Américains, ont été cantonnés à l’arène sociale. Le Noir est un problème social, il n’est ni un problème personnel ni un problème humain ; penser à lui c’est penser statistiques, taudis, viols, injustices, violence lointaine ; c’est être confronté à un catalogue sans fin de pertes, de gains, d’échauffourées ; c’est se sentir vertueux, outragé, impuissant, comme si son statut permanent parmi nous était quelque peu analogue à une maladie — le cancer, peut-être, ou la tuberculose — qui doit être régulièrement contrôlée à défaut d’être guérie. Dans cette arène l’homme noir acquiert un tout autre aspect que celui qu’il a dans la vie. Nous ne savons pas quoi faire avec lui dans la vie ; s’il casse l’image sociologique et sentimentale que nous avons de lui, nous sommes frappés de panique et nous nous sentons trahis. C’est donc quand il enfreint cette image qu’il est confronté au plus grand danger (nous en avons l’intuition, et nous soupçonnons avec malaise qu’il joue donc très souvent un rôle pour notre bénéfice) ; et, ce qui n’est pas moins vrai à défaut d’être toujours aussi apparent, nous sommes alors nous-mêmes dans un certain danger — d’où notre repli, ou notre vengeance aveugle et immédiate.
Notre déshumanisation du Noir est ainsi indissociable de notre déshumanisation de nous-mêmes ; la perte de notre propre identité est le prix que nous payons quand nous anéantissons la sienne. Le temps et nos propres forces jouent comme nos alliés, créant une impossible et stérile tension dans le traditionnel duo maître et esclave. Impossible et stérile parce que, aussi littérale et visible que cette tension soit devenue, elle n’a rien à voir avec la réalité.
Le temps a produit quelques changements dans le visage du Noir. Rien n’a réussi à le rendre exactement comme le nôtre, bien que le désir général semble être de le rendre neutre si on ne peut pas le rendre blanc. Quand il sera neutralisé, le passé aussi soigneusement lavé du visage noir que du nôtre, nous en aurons fini avec notre culpabilité — elle aura du moins cessé d’être visible, ce que nous imaginons revenir à peu près au même. Mais, paradoxalement, c’est nous qui empêchons que cela n’advienne ; puisque c’est nous qui, à chaque heure de notre vie, réinvestissons de notre culpabilité le visage noir ; et nous le faisons — par un paradoxe encore plus grand, et tout aussi féroce — avec impuissance et passion : par un besoin inconscient de recevoir l’absolution.
Aujourd’hui, c’est sûr, nous savons que le Noir n’est pas biologiquement ou mentalement inférieur ; il n’y a pas de vérité dans ces rumeurs concernant son odeur corporelle ou son incorrigible sexualité ; ou pas davantage de vérité que celle qui peut aisément être expliquée voire défendue par les sciences sociales. Pourtant, dans notre guerre la plus récente, son sang a subi la ségrégation comme, d’une façon générale, sa personne. Nous nous tenons encore aujourd’hui à une séparation, pour qu’il ne puisse pas épouser nos filles ou nos sœurs, ni ne puisse — d’une façon générale — manger à notre table ou vivre dans nos maisons. De plus, ceux qui le font le font au grave préjudice d’une double aliénation : de leur propre peuple, dont ils doivent nier ou pire, brader et monnayer les légendaires attributs ; de nous, car nous leur demandons, quand nous les acceptons, de cesser illico d’être des Noirs et cependant de se rappeler sans cesse ce qu’être un Noir veut dire — c’est-à-dire de se rappeler ce que cela veut dire pour nous. Le seuil de l’insulte varie selon les gens impliqués, du cireur d’Atlanta à la célébrité de New York. Il faut voyager très loin, parmi des saints n’ayant rien à gagner ou des marginaux n’ayant rien à perdre, pour trouver un endroit où ça n’a pas d’importance — et peut-être un mot ou un geste ou simplement un silence témoignera que ça en a, même là-bas.
Car cela veut dire quelque chose, d’être un Noir, après tout, comme cela veut dire quelque chose d’être né en Irlande ou en Chine, de vivre où on voit de l’espace et du ciel ou de vivre où on ne voit rien d’autre que des ruines ou rien d’autre que de hautes constructions. Nous ne pouvons pas échapper à nos origines, aussi fort que nous essayions, ces origines qui contiennent la clef — à supposer qu’on puisse la trouver — de tout ce que nous devenons par la suite. Ce que cela veut dire, d’être un Noir, c’est beaucoup plus que ce que cet essai peut découvrir ; ce que cela veut dire d’être un Noir en Amérique pourrait peut-être être suggéré par un examen des mythes que nous perpétuons à son propos.
La tante Jemima et l’oncle Tom sont morts, leur place a été prise par un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes incroyablement bien adaptés, presque aussi noirs qu’eux mais férocement cultivés, bien mis et bien récurés, dont on ne se moque jamais, qui ne sont en aucun cas susceptibles de mettre un pied dans un champ de coton ou de tabac ou dans quelque cuisine que ce soit, sauf la plus moderne. D’autres demeurent, selon notre étrange idiome, « défavorisés » ; certains sont douloureusement amers ; certains sont malheureux mais, constamment confrontés à l’évidente imminence d’un jour meilleur, ils le deviennent vite moins. La plupart d’entre eux n’en ont rien à faire du tout, de la race. Ils veulent seulement leur propre place au soleil et le droit d’être laissé en paix, comme n’importe quel autre citoyen de la république. Nous pourrions tous respirer plus facilement. Mais avant que notre joie de la disparition de la tante Jemima et de l’oncle Tom ne confine à l’indécence, nous ferions mieux de nous demander d’où ils ont surgi, comment ils ont vécu ; dans quels limbes ils se sont évanouis...." (Traduit de l’anglais par Marie Darrieussecq, Gallimard)

"Another Country" (1962)
Baldwin a commencé à rédiger ce roman en 1948 à Greenwich Village, poursuivant son travail à Paris, puis à New York, et l'a finalement terminé à Istanbul en 1961. L'homosexualité, la bisexualité, les relations interraciales et les infidélités conjugales, et le New York années 1950: les désirs entremêlés de personnages noirs, blancs, gay et hétéros, des scènes de sexe et de violence qui firent scandale lors de sa parution, mais un Best-seller qui divisa la critique ...
Six personnages liés par l'amour, la trahison et la mort, Rufus Scott (musicien noir suicidaire, amant d'un Blanc, Eric), Vivaldo (écrivain italo-américain, amant de Rufus puis d'Ida), Ida (la sœur de Rufus), Eric (un acteur blanc, ex-amant de Rufus puis de Yves), Yves (un Français, dernier amour d'Eric), Cass (une épouse blanche trompée par son mari Richard), et Leona, une femme blanche du Sud, originaire de l'Alabama, mère d'un enfant : elle a fui son mari pour New York, où elle a rencontré Rufus Scott. Elle devient sa maîtresse, mais leur amour se transforme en un cycle de violence mutuelle. Leona incarne l'Amérique blanche que Rufus désire et méprise. Après son internement psychiatrique, elle quittera le récit assez rapidement, mais son spectre hantera les autres personnages, les autres femmes (Ida, Cass)...
Mais c'est le suicide de Rufus Scott qui structurera toute l'intrigue et la réalité des personnages. Il n'en pouvait plus de vivre dans le monde cruel et implacable des Blancs, humilié, abandonné de tous, écrasé par le poids d'une cité inhumaine. Par une nuit froide de novembre, il est allé s'engloutir à jamais dans l'eau glacée du fleuve. Ce drame est le point de départ d'une œuvre émouvante, violente et passionnée dont les personnages, à la recherche d'eux-mêmes et du bonheur, tentent désespérément de renverser les barrières de la ségrégation raciale et des conventions bourgeoises ... (traduction française, Gallimard)

"The Fire Next Time" (1963)
Un essai autobiographique et politique publié en pleine lutte pour les droits civiques aux États-Unis, composé de deux lettres – "My Dungeon Shook" (adressée à son neveu) et "Down at the Cross" (une réflexion sur la race, la religion et l’identité) : la condition noire américaine, le poids du racisme systémique et les illusions des solutions religieuses ou politiques. (« La Prochaine Fois, le Feu », première édition française peu après la parution originale par les éditions Gallimard)
"My Dungeon Shook" (Lettre à mon neveu) est une courte lettre adressée à son neveu James, à l’occasion du centenaire de l’émancipation des esclaves (1863). Baldwin y explique l’héritage de la haine (les Blancs ont déshumanisé les Noirs pour se rassurer sur leur propre valeur) et exhorte son neveu à ne pas mépriser les Blancs, mais à les comprendre pour les transformer. Accepter leur histoire sans se laisser définir par le regard blanc ..
"Mon cher James, Voilà cinq fois que je commence cette lettre et cinq fois que je la déchire. Constamment je vois ton visage, qui est aussi le visage de ton père, mon frère. Comme lui tu es coriace, sombre, vulnérable, ombrageux, avec ce qui pourrait très bien passer pour un côté querelleur parce que pour rien au monde tu ne voudrais pouvoir être pris pour un lâche. Peut-être en ceci ressembles-tu à ton grand-père, je n’en sais rien, mais une chose est certaine : c’est que ton père et toi-même lui ressemblez beaucoup physiquement. Quoi qu’il en soit… il est mort, ne vous a jamais connus, et sa vie a été misérable. Il avait perdu la partie, longtemps avant de mourir, parce que, au fond de son cœur, il croyait vraiment ce que les Blancs disaient de lui. C’est en partie à cause de cela qu’il devint un tel saint. Ton père t’a certainement parlé de tout cela. Ni toi ni ton père ne manifestez de fortes tendances à la sainteté. Vous appartenez véritablement à une autre époque, êtes un produit de cette migration des Noirs vers ce que feu E. Franklin Frazier appelait les « cités de destruction ». Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un « nigger ». Cela je te le dis parce que je t’aime et, s’il te plaît, ne l’oublie jamais...."
"Down at the Cross" (Réflexion longue), raconte son adolescence à Harlem, son engagement fervent dans l’Église pentecôtiste (où il fut prédicateur), puis son rejet du christianisme, qu’il juge complice de l’oppression. Sa rencontre avec Elijah Muhammad (1897-1975), le chef charismatique des "Nation of Islam", mouvement nationaliste afro-américain dont le séparatisme et la haine des Blancs lui semblaient stériles (il était devenu en 1931 disciple de Wallace Fard Muhammad, fondateur mystérieux des Nation of Islam (NOI), et recrutera Malcolm X, qui deviendra son porte-parole avant de rompre en 1964, et Muhammad Ali (avant sa conversion à l’islam sunnite).
Dans un des passages les plus puissants de cet texte, Baldwin démonte le mythe de la supériorité blanche et appelle à une transformation radicale des consciences, tant du côté des oppresseurs que des opprimés. Comme les Blancs doivent renoncer à leur fiction raciale, les Noirs doivent refuser de se définir par le regard blanc : le racisme détruit aussi les Blancs, en les privant de leur humanité...
"Il faut beaucoup de force et beaucoup de ruse pour monter constamment à l’assaut de la puissante et hautaine forteresse de la primauté blanche, comme les Noirs de ce pays le font depuis si longtemps. Il faut beaucoup de souplesse spirituelle pour ne pas haïr celui qui vous hait et dont le pied écrase votre nuque, et ne pas apprendre à vos enfants à le haïr exige une sensibilité et une charité encore plus miraculeuses. Les petits garçons et les petites filles noirs qui aujourd’hui font face à ces foules hurlantes proviennent d’une longue lignée de paradoxaux aristocrates — les seuls véritables aristocrates que ce pays ait produits. Je dis ce pays parce que leur optique était absolument américaine. C’est de la montagne de la suprématie blanche qu’ils ont à coups de pic détaché la pierre de leur personnalité. J’ai le plus grand respect pour cette humble armée d’hommes et de femmes noirs qui piétinait devant d’innombrables portes de service, disant « oui, Monsieur » et « non, Madame » afin d’acquérir un nouveau toit pour l’école, de nouveaux livres, un nouveau laboratoire de chimie, d’autres lits pour les dortoirs, d’autres dortoirs. Cela ne leur plaisait guère de dire « oui, Monsieur » et « non, Madame », mais le pays ne manifestait aucune hâte à éduquer ses Noirs, et ces hommes et ces femmes savaient qu’il fallait que cette besogne-là soit faite et ils mirent leur amour-propre dans leur poche afin de l’accomplir. Il est bien difficile de croire qu’ils étaient en quoi que ce fût inférieurs aux Blancs qui ouvraient ces portes de service. Il est bien difficile de croire que ces hommes et ces femmes élevant leurs enfants, mangeant, jurant, pleurant, chantant, s’aimant du lever du soleil au coucher du soleil, valaient en aucune façon moins que ces Blancs qui se faufilaient jusqu’à eux pour partager ces splendeurs une fois la nuit tombée. Mais il importe que nous évitions de tomber dans l’erreur européenne. Il ne faut pas que nous nous imaginions que, parce que la condition, les mœurs, la sensibilité des gens de race noire étaient si radicalement différentes de celles des Blancs, ils leur étaient racialement supérieurs. Je suis fier de ces gens non pas à cause de leur couleur mais à cause de leur intelligence, de leur force spirituelle et de leur beauté. La nation devrait partager cette fierté mais, hélas, rares sont ceux dans cette nation qui savent même qu’ils existent. Et cette ignorance s’explique par le fait que connaître le rôle que ces gens ont joué et jouent dans la vie américaine en apprendrait plus aux Américains sur leur propre pays qu’ils ne souhaitent en savoir.
Le Noir américain a le grand avantage de n’avoir jamais ajouté foi en la collection de mythes auxquels se cramponnent les Américains blancs : que leurs ancêtres étaient tous des héros et des martyrs de la liberté, qu’ils sont nés dans le plus grand pays du monde, que les Américains sont invincibles en temps de guerre et infaillibles en temps de paix, qu’ils ont traité honorablement les Mexicains, les Indiens et tous leurs autres voisins ou inférieurs, que les hommes américains sont les plus virils et les plus droits du monde, que les femmes américaines sont pures. Les Noirs en savent bien plus long que ça sur les Américains blancs ; on pourrait presque dire, en fait, qu’ils savent des Blancs américains ce que les parents — les mères en tout cas — savent de leurs enfants et que très souvent c’est de ce point de vue qu’ils les voient. Et c’est peut-être ce point de vue, qu’ils conservent en dépit de tout ce qu’ils savent et ont supporté, qui aide à comprendre pourquoi les Noirs, en général et jusque récemment, ne se sont que si rarement laissé aller à haïr… La tendance a vraiment été de considérer les Blancs, dans toute la mesure du possible, comme les victimes un peu dérangées de leur propre lavage de cerveau. ..."
Dans "Between the World and Me", un essai épistolaire publié aux États-Unis en 2015, Ta-Nehisi Coates (1975) s'inspirera de "The Fire Next Time" de James Baldwin (1963) pour dénoncer le "Dream" (le rêve américain) comme un mythe construit sur l’oppression des corps noirs (esclavage, ségrégation, violences policières). S'interrogeant sur le sens d’être un homme noir en Amérique dans une lettre adressée à son fils Samori, alors adolescent, il évoque sa jeunesse à Baltimore, marquée par la violence des rues et la terreur policière, les meurtres de Michael Brown, Trayvon Martin, et célèbre les bibliothèques, l’histoire africaine, et l’écriture comme armes de survie. "We Were Eight Years in Power" (2017) se livre comme une réflexion sur l’ère Obama et l’illusion du "post-racialisme", "The Water Dancer" (2019), son premier roman, mêlant réalisme magique et histoire de l’esclavage. Coates inspirera à son tour des auteurs comme Keeanga-Yamahtta Taylor (Race for Profit) et Clint Smith (How the Word Is Passed)....

"Tell Me How Long the Train's Been Gone" (1968, James Baldwin)
Le titre anglais est infiniment plus poétique que sa traduction française, "L'homme qui meurt" ( (traduction Éd. Gallimard, Collection Folio, Paris, 2019) et peut être considéré comme un roman charnière. Il arrive à un moment crucial de la carrière de Baldwin, après la frénésie du mouvement des droits civiques : il évoque les thèmes de l'épuisement, de la célébrité, de l'identité sexuelle et de la radicalisation politique. Il est plus explicitement autobiographique dans sa structure (une rétrospective sur une vie) que ses premiers romans.
Le roman raconte l'histoire de Leo Proudhammer, une star de théâtre noire célèbre et adulée à New York. Le récit commence par un événement déclencheur : à 39 ans, Leo s'effondre en pleine scène, victime d'une crise cardiaque. Alors qu'il est entre la vie et la mort ("l'homme qui meurt"), sa vie défile devant ses yeux.
Le roman est structuré comme un long flashback qui alterne entre son lit d'hôpital et les souvenirs de sa vie. Il explore trois grandes périodes ...
- L'Enfance à Harlem : Leo se souvient de sa jeunesse pauvre, de sa famille, et de la violence omniprésente du racisme américain. Un épisode central est le passage où son frère aîné, Caleb, est injustement arrêté et brutalisé par la police, un événement traumatisant qui marque à jamais Leo et lui révèle la brutalité du monde.
- La Jeunesse et la Découverte de l'Amour : Le roman décrit ses premières relations, notamment avec une femme blanche, et ses luttes pour devenir acteur. Cette partie explore profondément ses questionnements sur l'identité sexuelle et l'amour interracial.
- La Célébrité et la Relation avec Black Christopher : Alors qu'il est une star adulée, Leo rencontre Black Christopher, un jeune militant noir radical et charismatique. Leur relation amoureuse intense devient le centre du roman. Christopher représente une nouvelle génération, plus en colère, plus radicale et moins patiente que celle de Leo. Il pousse Leo à confronter ses propres contradictions en tant qu'artiste célèbre évoluant dans un monde majoritairement blanc.
La crise cardiaque est une métaphore de l'épuisement physique et mental, du coût de la survie dans un monde hostile, de la tension constante entre son identité noire, sa sexualité, sa célébrité et son art. À travers ses relations, surtout avec Christopher, Leo cherche une forme de salut et de connexion authentique. Un tournant vers une lutte plus militante et moins pacifiste à la fin des années 1960?
" ... Maintenant, pour la première fois, je commençais à sentir mon cœur, le cœur lui-même ; et avec cette sensation me vint une terreur consciente. Je m’aperçus que je ne savais rien, absolument rien, de la manière dont nous sommes agencés, et je me rendis compte que cette chose, dont j’ignorais tout, était peut-être en train de me tuer. Mon cœur — si c’était de mon cœur qu’il s’agissait — semblait se soulever et s’abaisser en moi ; il ressemblait à un nageur trahi par un élément qui, sous l’effet d’une marée incontrôlable, l’emportait au loin et le tirait irrésistiblement vers le bas. Et pourtant, il se débattait pour essayer de monter, une fois encore. Mais la mer est plus forte que le nageur. Combien de fois encore pourrais-je l’entendre faire des efforts pour remonter — ces efforts qui soulevaient de tels grondements dans ma poitrine ? Et combien de fois encore pourrait-il tomber loin de moi, loin au-dessous de moi, me faisant respirer avec plus de mal que jamais, m’obligeant à le supplier, en proie à une horrible panique, pour qu’il se remette à battre ? Le bruit de ma respiration était la seule chose audible. Ma propre panique, à la fois étouffante comme un manteau et lointaine comme le vent, me fit voir à quel point Barbara avait peur et de quel courage elle faisait preuve. Je n’aurais pas voulu changer de place avec elle. Nous nous connaissions depuis tant d’années ; ensemble nous avions travaillé, ensemble nous avions crevé de faim, et nous nous étions aimés, et nous nous étions supportés, et nous avions fait l’amour. Et pourtant la plus terrifiante consommation de notre amour, c’était maintenant qu’elle s’opérait, alors que Barbara, patiemment, possédée par l’amour et par la terreur, me tenait la main.
Je me demandai à quoi elle pensait. Mais je crois qu’elle ne pensait à rien, absolument à rien. Elle était concentrée. Elle était décidée à m’empêcher de mourir.
— Barbara…
— Tais-toi, Leo. On aura le temps de parler plus tard. Pour le moment, n’essaie pas de parler.
— J’ai quelque chose à dire.
— Plus tard, mon chéri, plus tard.
Je sombrai de nouveau. Mon cœur et moi, nous nous enfonçâmes. Je sentais sur moi la main de Barbara. J’avais conscience que je respirais ; je ne pouvais plus le voir, mais je sentais que son visage était là.
— Barbara, Barbara chérie.
— Leo, mon amour, ne bouge pas, je t’en prie.
Elle a raison, me dis-je. Il n’y a rien d’autre à dire. La seule chose à faire, maintenant, c’est de tenir bon. C’est pour cela qu’elle avait pris ma main. Je reconnus en cela l’amour, je le reconnus avec le plus grand calme et, pour la première fois, sans frayeur. Ma vie, ce labyrinthe d’une traîtrise désespérée, sembla un moment s’ouvrir derrière moi ; une lumière parut tomber, là où il n’y avait pas eu de lumière auparavant. Je commençai à me voir dans les autres. Je commençai, l’espace d’un moment, à voir ce que Christopher avait dû éprouver parfois. Chacun souhaite être aimé, mais quand l’amour est là, personne, ou presque, ne peut supporter l’amour. Tout le monde désire l’amour, mais on ne parvient jamais à croire qu’on le mérite. Aussi graves que soient les catastrophes personnelles auxquelles l’amour peut mener, l’amour vrai est impersonnel — d’une impersonnalité frappante et mystérieuse ; c’est une réalité qui n’est altérée par rien de ce que l’on peut faire. C’est pourquoi on se démène tant. On tourne la clé dans la serrure, dans tous les sens, en espérant se retrouver enfermé dehors...."

"No Name in the Street" (1972)
Baldwin passe du récit intimiste à la dénonciation brûlante et anticipe les débats sur le suprémacisme blanc et la violence policière. Cet essai autobiographique et politique marque un tournant radical dans l’œuvre de James Baldwin. Écrit dans un contexte de violence politique (assassinats de Malcolm X, Martin Luther King Jr., Medgar Evers), il tente d'analyser l’échec du mouvement des droits civiques et la montée d’une conscience révolutionnaire noire. L’essai combine mémoires, reportage et manifeste, divisé en deux parties :
- Première Partie : Expériences Personnelles
L'enfance à Harlem, Baldwin décrit la peur et la colère accumulées face au racisme. Puis le Paris dans les années 1950, son exil, la rencontre avec la diaspora noire (Richard Wright, Chester Himes), et la prise de conscience que l’oppression est globale. Enfin, le retour aux États-Unis, son implication dans le mouvement des droits civiques, ses désillusions face aux compromis de la lutte non-violente.
- Deuxième Partie : Engagements et Témoignages
Le soutien à la lutte des Black Panthers : Baldwin défend Huey P. Newton et critique la répression étatique. L'assassinat de Martin Luther King Jr. : un tournant, révélateur de l’hypocrisie de l’Amérique. La violence est inévitable quand le dialogue est impossible.
La Trahison des Libéraux Blancs : Baldwin dénonce ceux qui soutiennent les Noirs en paroles mais refusent de partager le pouvoir.
L’Internationalisation de la Lutte : liens entre la condition noire américaine et les luttes anticoloniales (Algérie, Vietnam).
Contrairement à ses œuvres précédentes, Baldwin assume une colère froide et justifie la légitime défense. L'influence de Malcolm X : Personne ne peut me donner ma liberté, je dois la prendre ...
On notera que, contrairement à Angela Davis, Baldwin ignore largement les femmes noires dans la lutte ...

"If Beale Street Could Talk" (1974)
Le cinquième roman de James Baldwin, écrit durant son exil en France et qui marque un retour à la fiction après des années consacrées aux essais (The Fire Next Time, No Name in the Street). Inspiré par la musique (le titre fait référence au blues Beale Street de Memphis, symbole de la culture noire), le livre explore l’amour, l’injustice raciale et la résilience familiale dans le Harlem des années 1970. Tish Rivers, la narratrice, une jeune femme noire de 19 ans, raconte l’histoire de son amour pour Fonny Hunt (Alonzo), un sculpteur de 22 ans injustement accusé de viol. Fonny est emprisonné. Tish (qui incarne la force des femmes noires) découvre qu’elle est enceinte. La famille de Tish se bat pour prouver l’innocence de Fonny (Sharon, la mère de Tish,traverse les États-Unis pour le sauver), tandis que la victime blanche, traumatisée, se rétracte sous la pression policière. Baldwin dépeint un système où les Noirs sont présumés coupables (fausse accusation, identification forcée, complicité des policiers blancs). Fonny restera en prison, mais Tish garde espoir, symbolisé par la naissance imminente de leur enfant.
L'adaptation cinématographique de" If Beale Street Could Talk" par Barry Jenkins en 2018 a eu un impact significatif sur l'œuvre de Baldwin : Jenkins conserve la narration introspective de Tish (voix off de KiKi Layne), l’atmosphère lyrique du roman, entre amour et mélancolie, et le rôle central des familles (Regina King en Sharon, oscarisée pour son interprétation).

"The Devil Finds Work" (1976)
Le titre The Devil Finds Work (littéralement "Le Diable trouve à s’occuper") est une citation proverbiale anglaise qui signifie que l’oisiveté est dangereuse et que le malin profite des esprits inactifs pour les corrompre. Et le cinéma américain, nous explique Baldwin, au lieu d’éduquer ou de libérer, travaille pour le diable en propageant des stéréotypes racistes ("The Birth of a Nation" (1915) ne glorifie-t-il pas le Ku Klux Klan?). Et alors que les spectateurs blancs, oisifs intellectuellement, se laissent bercer par ces mensonges plutôt que de combattre le racisme, les Noirs, eux, sont forcés de "travailler" à décrypter ces images pour survivre....
Un essai cinématographique de James Baldwin, un texte hybride mêlant critique de films, mémoires personnelles et analyse raciale pour déconstruire la représentation des Noirs à Hollywood et son impact sur l’imaginaire américain. Baldwin raconte sa première visite au cinéma enfant (Dance, Fools, Dance avec Joan Crawford), où il perçoit instinctivement l’hypocrisie des récits blancs, sa rencontre avec Sidney Poitier, symbole des limites de la représentation noire à Hollywood : si Poitier a brisé des barrières (il fut le premier Noir oscarisé en 1964 pour "Lilies of the Field"), ses rôles étaient soumis à des règles implicites, désexualisation (jamais de romance interraciale explicite : "Guess Who’s Coming to Dinner" montre un homme noir "sans désir", fiancé à une Blanche sous contrôle parental), absence de toute colère (ses personnages (In the Heat of the Night) sont calmes, dignes, évitant toute menace pour le public blanc, et il devait incarner la "perfection noire" pour être toléré (contrairement aux rôles stéréotypés de serviteurs ou de criminels).
Le Cinéma comme Arme Idéologique ...
Hollywood fabrique des mythes qui légitiment l’oppression (le Noir "violent" ou "servile") et Baldwin célèbre des acteurs comme Dorothy Dandridge ou Ethel Waters, qui résistent à ces stéréotypes. Le fameux "regard blanc", des films qui enseignent aux Noirs à se voir comme les Blancs les voient (Je savais que je n’étais pas un monstre, mais le cinéma disait le contraire) et vont jusqu'à fétichiser la souffrance noire ...

"I Am Not Your Negro" (2017)
Un documentaire expérimental réalisé par Raoul Peck, sorti en 2016 (en salles en 2017). Il s’inspire d’un manuscrit inachevé de James Baldwin, "Remember This House", où l’écrivain explorait les vies et assassinats de ses trois amis militants Medgar Evers (1963, son assassinat montre la violence du Sud ségrégationniste), Malcolm X (1965, Baldwin critique sa diabolisation par les médias blancs) et Martin Luther King Jr. (1968, son rêve pacifique trahi par l’Amérique) Le film mêle archives, extraits de textes de Baldwin (lus par Samuel L. Jackson) et images contemporaines pour créer un pont entre les luttes des années 1960 et le mouvement Black Lives Matter ...
"Black people particularly disliked
Guess Who’s Coming to Dinner
because they felt that Sidney was,
in effect, being used against them.
Guess Who’s Coming to Dinner may prove,
in some bizarre way, to be a milestone,
because it is really quite impossible to go
any further in that particular direction."


".. That’s when I saw the photograph.
Facing us, on every newspaper kiosk
on that wide, tree-shaded boulevard in Paris
were photographs of fifteen-year-old Dorothy Counts
being reviled and spat upon by the mob
as she was making her way to school
in Charlotte, North Carolina.
There was unutterable pride, tension, and anguish
in that girl’s face
as she approached the halls of learning,
with history, jeering, at her back.
It made me furious,
it filled me with both hatred and pity.
And it made me ashamed..."

THE NEGRO AND THE AMERICAN PROMISE - 1963 -
"JAMES BALDWIN: I can’t be a pessimist, because I’m alive. To be a pessimist means you have agreed that human life is an academic matter, so I’m forced to be an optimist. I’m forced to believe that we can survive whatever we must survive. But the Negro in this country…the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. It is entirely up to the American people and our representatives—it is entirely up to the American people whether or not they are going to face and deal with and embrace this stranger who they have maligned so long. What white people have to do is try and find out in their own hearts why it was necessary to have a “nigger” in the first place, because I’m not a nigger, I’m a man. But if you think I’m a nigger, it means you need him. The question that you’ve got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, North and South because it’s one country and for a Negro there is no difference between the North and the South—it’s just a difference in the way they castrate you, but the fact of the castration is the American fact….If I’m not the nigger here and you invented him, you the white people invented him, then you’ve got to find out why. And the future of the country depends on that, whether or not it is able to ask that question."
Baldwin y apparaît comme Témoin et Prophète, avec des extraits de ses apparitions télévisées, dont le célèbre et mémorable débat de 1965 qui opposa l'écrivain à l’intellectuel conservateur William F. Buckley Jr à l’Université de Cambridge, devant 700 étudiants, majoritairement blancs, sur la question : "Le rêve américain est-il acquis aux dépens des Noirs américains ?"
Un débat, souvent considéré comme l’un des plus grands de l’histoire, qui résume les tensions raciales et idéologiques des années 1960 ...
Pour James Baldwin, "Le Rêve Américain Est un Cauchemar pour les Noirs", et il parle au nom de ceux qui ont été brûlés, violés, lynché. L’Amérique est un pays qui nie sa propre histoire. Les Noirs sont exclus du "rêve" par le logement ségrégué, les emplois sous-payés, la violence policière. Ce n’est pas nous qui sommes en colère. C’est vous qui refusez de voir la réalité ..
William F. Buckley répond par un motif qui sera repris dans bien des occasions ultérieures, la fameuse et proverbiale notion de "Mérite" : Les Noirs Doivent S’Intégrer par le Mérite. La pauvreté noire ne vient que d’un manque d’effort, et non du racisme. Le progrès prend du temps. Les Irlandais aussi ont souffert ...
Le discours passionné de Baldwin sur la peur blanche (Vous avez peur de perdre votre supériorité mythique) fait basculer l’audience, et lorsque Buckley minimise l’esclavage, et que Baldwin rétorque : Vous n’avez jamais eu à expliquer à votre enfant pourquoi il pourrait être lynché, le vote final s'impose : la salle vote 544 voix contre 164 en faveur de Baldwin, une humiliation pour Buckley ...
La confrontation entre deux visions de l’Amérique ...
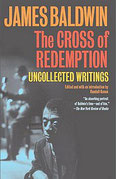
"The Cross of Redemption : Uncollected Writings" ( Baldwin, James; Kenan, Randall)
Pantheon Books, Penguin Random House LLC, New York, 2010
Publié de manière posthume et compilé par l'écrivain et universitaire Randall Kenan, ce recueil n'est pas une simple compilation de textes restants. Il offre une perspective unique et essentielle sur l'évolution de la pensée et de l'art de Baldwin.
Les œuvres majeures de Baldwin (Notes of a Native Son, The Fire Next Time, Go Tell It on the Mountain) sont des œuvres abouties, polies et structurées. The Cross of Redemption, en revanche, nous montre Baldwin "en train de penser". Ce sont des brouillons, des interventions spontanées, des critiques littéraires et des lettres qui révèlent les coulisses de son processus intellectuel. On y découvre sa voix sous une forme plus immédiate, parfois plus rageuse, parfois plus dubitative, mais toujours incroyablement lucide.
Le livre aborde tous les grands thèmes chers à Baldwin, mais à travers des prismes moins connus ...
- La question raciale en Amérique : Des textes comme son débat avec le conservateur noire William F. Buckley en 1965 ("The American Dream and the American Negro") sont d'une actualité frappante et montrent son talent de débatteur.
- Le recueil contient de nombreuses critiques littéraires où Baldwin discute des œuvres de ses contemporains (comme Norman Mailer, Richard Wright, Carson McCullers) ou de classiques. Cela permet de comprendre ses influences, ses affinités et ses désaccords, dessinant ainsi une carte de la scène littéraire de son point de vue.
- Des textes comme "To Crush the Serpent" abordent frontalement la question du puritanisme chrétien et de son impact sur l'amour et la sexualité, un sujet central mais souvent implicite dans son œuvre fictionnelle.
- Baldwin était profondément convaincu que l'écrivain avait une responsabilité morale et politique. De nombreux essais ici présents défendent cette idée et montrent comment il incarnait ce rôle.
Ces écrits, s'étalant des années 1940 aux années 1980, offrent un témoignage à chaud sur les bouleversements politiques et sociaux de l'Amérique : le mouvement des droits civiques, la guerre froide, l'assassinat des leaders comme Martin Luther King Jr. et Malcolm X. On peut voir comment certaines idées qui apparaissent de manière fulgurante dans The Fire Next Time ont germé dans des textes ou des discours antérieurs.
Même dans des textes "mineurs" ou inachevés, la qualité d'écriture de Baldwin est étincelante. Sa prose est à la fois lyrique, précise et dévastatrice. Lire ces textes, c'est simplement se confronter à l'une des plus grandes intelligences et l'une des plus belles plumes du siècle dernier. Et le choix de Randall Kenan (lui-même romancier et essayiste afro-américain disparu en 2020) n'est pas anodin. En tant qu'héritier littéraire de Baldwin, il a fait un travail éditorial remarquable ...
Un livre pour les passionnés de James Baldwin, un incontournable, indispensable pour avoir une compréhension complète de son œuvre et de sa personne. Pour les nouveaux lecteurs, ce n'est peut-être pas le meilleur point de départ. Il est préférable de commencer par un de ses grands essais ("The Fire Next Time") ou son roman "Go Tell It on the Mountain" pour apprécier pleinement la richesse de ce recueil...
