- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux
- Pirandello
- Svevo
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- Jouhandeau
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite

- Jean Paulhan (1884-1968), "Les Fleurs de Tarbes (La Terreur dans les lettres)"(1941) - Maurice Blanchot (1907-2003), "Thomas l'Obscur" (1941), "La Part du feu" (1949), "L'Espace littéraire" (1955) ...
Last update : 11/11/2016

"Les romans de Maurice Blanchot, écrivait Gaëtan Picon, comme ses essais de critique littéraire, traduisent une expérience-limite qui est celle de la mort", mais la mort est pour lui "ce qu'aucune image de la vie ne permet d'approcher", un mirage de néant dont la vie nous sépare irrémédiablement, l'expérience de la vie est celle d'une vie qui se vide d'elle-même et tous les récits que l'on peut concevoir vont se mouvoir "dans cette étrange zone d'échanges entre la vie et la mort, l'écriture y est dépouillée de toute passion, simple, neutre, une froide véhémence tout au plus, "éloquence sans éloquence".
A partir de là, ses romans ont pour unique objet cette expérience, tandis que les essais de critique vont se porter sur les ressorts secrets qui en découlent en terme de langage. Pour Picon, "la tentative narrative de Blanchot est importante", elle illustre, dit-il, "une nouvelle notion de roman". "Faux Pas" (1943) ne peut être défini par rapport à aucune réalité, il est "création du langage". C'est une critique qui se fonde pas sur telle ou telle oeuvre, mais qui naît "de la préoccupation profondément soucieuse que cause nécessairement à celui qui écrit et à celui qui lit ce fait étrange qu'il y ait des livres, des lecteurs, et des écrivains.." . Picon rapproche ainsi Maurice Blanchot de Georges Poulet (1902-1991), Etudes sur le Temps humain (1949), La Distance intérieure), pour le premier, "l'écrivain est un Orphée qui s'enfonce dans un abîme où se condensent parole et silence, vie et mort", pour le second, "le germe de l'oeuvre est le sentiment d'une distance intérieure où l'homme ne se heurte qu'à lui-même, où à la distance qui le sépare du monde, non au monde même..."
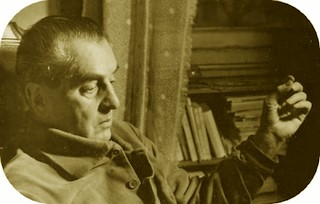
Jean Paulhan (1884-1968), "Les Fleurs de Tarbes (La Terreur dans les lettres)"(1941)
"Mettons en fait que je n'ai rien dit", c'est par cette phrase célèbre que Jean Paulhan termine ses "Fleurs de Tarbes", une oeuvre suscitée par le sentiment (et le ressentiment) d'une littérature en crise (1941), divorce entre littérature et public, contradictions de la critique, divergence des doctrines, incompréhension entre lecteur et auteur, une crise à laquelle il donne le nom de "Terreur" : l'écrivain ne croit plus au langage, il n'a plus confiance dans les mots, "parce que les mots trahissent sa vérité intérieure", pire il y a une inadéquation irrémédiable, les mots, les lieux communs, les "fleurs" de style, les expressions spontanées, tombent dans une suspicion généralisée relayée par critiques et lecteurs. La destruction de toute la littérature serait en marche. En fait, cette terreur ne repose semble-t-il que sur une illusion concernant le rapport de la pensée au langage, il nous faut accepter le langage en l'état....
La littérature à l'état sauvage ...
"Il n'arrive pas dans les Lettres beaucoup d'événements de nature à nous enchanter. Ce serait peu; il semble que par avance nous nous détendions d'être enchantés. La beauté ne nous est guère qu'une raison de défiance. Les ouvrages accomplis, dit l'un, sont indifférents. L'autre : le danger d'un sujet est dans sa beauté. Et le dernier : rien ne ressemble à la médiocrité comme la perfection. Je cite les critiques les plus sages.
"Pas de beaux vers", disait Hugo.
Restent le caractère, et la surprise. Or, cela même que la littérature teint de nous donner ainsi, c'est pour le reprendre aussitôt. Ce caractère, à peine répété, devient mécanique; cette surprise habituelle, et le contraire d'une surprise. Péguy tient qu'un écrivain forme un premier ouvrage authentique, et passe le reste de sa vie à s'imiter. Gourmont ajoute que l'œuvre personnelle ne tarde pas à devenir obscure si elle échoue, banale si elle réussit, et décourageante en tous cas.
Ainsi la beauté commence, et le caractère finit par nous décevoir. ll n'y a pas grande différence. Somme toute nous avons renoncé, peu s'en faut, à connaître ce que nous doit la littérature : jetés devant elle sans défense comme sans méthode, et tout désorientés.
Ce n'est pas faute d'espoir, ni de prétentions.
Victor Hugo se prenait pour un pape, Lamartine pour un homme d'État et Barrès pour un général. Paul Valéry attend des Lettres ce qu'un philosophe n'ose pas toujours espérer de la philosophie : il veut connaître ce que peut I 'homme. Et Gide, ce qu'il est.
Il suffirait à Claudel de reformer sur les débris d'une société laïque le monde sacral, tel que l'a connu le Moyen Age. Breton cependant exige le triomphe d'une éthique nouvelle, qui se fonde sur le crime et la merveille. "La poésie, dit-il, a pour cela ses moyens, dont les hommes sous-estiment l'efficacité." ll semble à Maurras suffisant, mais nécessaire, que l'écrivain maintienne au-dessus de l'eau toute une civilisation qui sombre. Je ne dis rien d'Alerte : la poésie lui semble chose si grave qu'il a pris le parti de se taire.
Je ne sais s'il est vrai que les hommes de lettres se soient contentés jadis de distraire d'honnêtes gens. (Ils le disaient du moins.) Les plus modestes de nous attendent une religion, une morale, et le sens de la vie enfin révélé. Il n'est pas une joie de I 'esprit que les Lettres ne leur doivent. Et qui pourrait tolérer, se demande un jeune homme, de n'être pas écrivain ?
Quoi! La littérature serait donc armée pour traiter de tels sujets ? -- Je n'ai pas dit qu'elle les traitait. - Alors pourquoi les pose-t-elle ? A quoi bon les agiter ? - Je n'en sais rien.
Il se peut que les hommes soient devenus plus exigeants. Il se peut aussi que les Lettres soient devenues moins donnantes.
Tout se passe comme s'il y avait à leur endroit je ne sais quoi de libre, de joyeux et peut-être d'insensé, dont nous aurions perdu jusqu'au souvenir et à l'idée. Ne sachant plus quel est exactement le bienfait qu'elles nous doivent, nous commencerions par tout exiger. (Ainsi l'on réclame en justice cent mille francs pour en obtenir cinquante.) - Ce serait le meilleur moyen d'être déçus. - Justement, nous sommes déçus. N'allez pas chercher trop loin ce qui retient Rimbaud de s'estimer. C'est le poème qu'il vient d'écrire. Paul Valéry n'a pas plus tôt porté sur le poète, ses moyens et son champ de forces, un jugement précis, qu'il s'excuse et paraît confus. Est-ce lui qui ose ainsi trancher - Non. ll ne veut empêcher personne. Ses fantaisies valent pour lui seul, qui écrit, dit-il, par faiblesse.
Claudel prononce et juge, non sans laisser intervenir Dieu, la nature, les astres. "Ce livre immonde... - Vos critiques, lui dit-on..., - Critiques! Me croyez-vous un valet d'écurie! - Votre œuvre cependant... - un homme de lettres, une fille de joie!"
Qui attendrait d'Aragon une idée juste ? ll enchante, il donne å rêver. Musset est gauche près de lui. Mais Aragon traite la littérature de machine à crétiniser, les littérateurs de crabes. S'il n'est pas crabe, on ne voit pas ce qui lui reste. Je parle des meilleurs. Comment leur faire entendre qu'ils écrivent ? "C'est du moins sans le faire exprès", répond Arland.
Cependant plus d'un romancier, de Balzac à Proust, s'excuse sur ses personnages qui le pressent, paraît-il, de leur donner la vie. Pour Apollinaire, il préférerait certes à ces mots déplaisants des parfums, des bruits ou des lignes. Il semble enfin que l'on ne puisse être honnête littérateur, si l'on n'éprouve pour les Lettres du dégoût. Comme il n'était pas de révélation que l'on n'attendît d'elles, il n'est pas de mépris qu'elles ne nous paraissent mériter. Et chaque jeune écrivain s'étonne que l'on puisse tolérer d'être écrivain. Nous ne parvenons guère à parler de roman, de style, de littérature ou d'art qu'à la faveur de ruses, et de mots nouveaux, qui n'aient pas encore l'air d'injures.
L'expérience heureuse, s'il en est une, se disperse et demeure sans chemins ni signes. Et rien ne se passe enfin qui ne se passe à l'envers dans nos Lettres, privées de mémoire et comme demeurées å l'état sauvage. Le malentendu prend des formes singulières.
LA MISERE ET LA FAIM
ll est probable que les Lettres ont de tout temps couru leurs dangers. Hölderlin devient fou, Nerval se pend, Homère a toujours été aveugle. ll semble qu'à l'instant d'une découverte
qui va changer la figure du monde, chaque poète se voie, comme Colomb, pendu à son mât et menacé de mort. Je ne sache pas de danger plus insidieux ni de malédiction plus
mesquine que ceux d'un temps où maîtrise et perfection désignent å peu près l'artifice et la convention vaine, où beauté, virtuosité et jusqu'å littérature slgnifient avant tout ce qu'il ne faut pas faire.
On voit, à l'entrée du jardin public de Tarbes, cet écriteau :
IL EST DÉFENDU D'ENTRER DANS LE JARDIN
AVEC DES FLEURS A LA MAIN
On le trouve aussi, de nos jours, à l'entrée de la Littérature.
Pourtant, il serait agréable de voir les filles de Tarbes (et les jeunes écrivains) porter une rose, un coquelicot, une gerbe de coquelicots.
(...)
Les rhétoriqueurs - du temps qu'il y avait des rhétoriques - expliquaient avec complaisance comment nous pouvons accéder à la poésie : par quels sons et par quels mots, quels artifices, quelle fleurs. Mais une rhétorique moderne - diffuse à vrai dire et mal avouée, d'autant plus violente et têtue - nous apprend d'abord quels artifices, sons et règles peuvent à jamais effaroucher la poésie. Nos arts littéraires sont faits de refus. ll y a eu un temps où il était poétique de dire onde, coursier et vespéral. Mais il est aujourd'hui poétique de ne pas dire onde, coursier et vespéral. Il vaut mieux éviter le ciel étoilé, et jusqu'aux pierres précieuses. N'écrivez pas lac tranquille (mais plutôt, disait Sainte-Beuve, lac bleu), ni doigts délicats (mais plutôt doigts fuselés). Il a pu être désirable, mais il est à présent interdit de prononcer de la volupté qu'elle est douce, efféminée ou folâtre; des yeux, qu'ils se montrent éblouissants, éloquents, fondus. (Et s'ils le sont pourtant ?) Qui veut définir les écrivains depuis cent cinquante ans, à travers mille aventures, par ce qu'ils n'ont cessé d'exiger, les trouve d'abord unanimes à refuser quelque chose : c'est la "vieillerie poétique" de Rimbaud; l' « éloquence » de Verlaine; la « rhétorique ›› de Victor Hugo. "J'ai eu, dit Whitman, beaucoup de mal à enlever de "Brins d'herbe" tous les traits poétiques, mais j'y suis parvenu à la fin." Et Laforgue : "La culture bénie de l'avenir est la déculture." L'art d'écrire aujourd'hui, note Jules Renard, est de se défier des mots usés.
Sans doute; et c'était jadis de se fier aux mots admis, éprouvés, exercés. Or, ce sont, peu s'en faut, les mêmes. La confiance passée, la défiance présente, qui semblent tenir même place et peser même poids, ont encore même objet - comme si tout le mystère des Lettres tenait à un problème unique, dont la solution seule pourrait, à notre gré, varier du tout au tout.
Du sinon leur mystère, du moins cette part en elles, qui est susceptible de rigueur, d'opérations, de métier. Car les règles et les genres suivent les clichés en exil. Qui veut tenter l'histoire de la poésie, du drame ou du roman depuis un siècle, trouve d'abord que la technique s'en est lentement effritée, et dissociée; puis, qu'elle a perdu ses moyens propres, et s'est vue envahie par les procédés des techniques voisines - le poème par la prose, le roman par le lyrisme, le drame par le roman.
Maupassant disait naïvement que le critique (et le romancier) devait « rechercher tout ce qui ressemble le moins aux romans déjà faits ». Ainsi des autres. De sorte qu'enfin le théâtre ne se trouve rien tant éviter que le théâtral, le roman le romanesque, la poésie le poétique. Et la littérature en général, le littéraire. « Cela tombe parfois dans le roman ››, disait Sainte-Beuve d'lndiana. « Théâtral ››, disait Jules Lemaître de La Dame aux camélias. Non sans dédain.
Je ne veux pas dire que roman ou littérature aient tort. Je n'en sais rien. Et même la privation me semble (comme à tout le monde) souhaitable, voire nécessaire, et j'éprouve assez bien la bassesse de toute œuvre qui prétend s'en passer. Mais je n'irai pas jusqu'à la trouver plaisante. Elle est sans doute le remède qu'exige la corruption de notre langue, ou de notre pensée. Mais c'est un remède qui a mauvais goût. Il est humiliant de se voir retirer, sans rien obtenir en échange, des mots qui nous ont longtemps enchantés; et les choses avec les mots - car il arrive enfin que les pierres soient précieuses; et les doigts, délicats. L'on ne voulait rompre qu'avec un langage trop convenu et voici que l'on est près de rompre avec tout le langage humain. Les anciens poètes recevaient de toutes parts proverbes, clichés et les sentiments communs. Ils accueillaient I'abondance et la rendaient autour d'eux. Mais nous, qui avons peu, nous risquons à tout instant de perdre ce peu. ll s'agit bien de fleurs! Horace disait des lieux qu'ils sont le pain et le sel des Lettres. A qui s'étonne que plus d'un écrivain glisse à la morale, aux affaires, à la politique, l'on doit répondre qu'il s'enfuit comme un émigrant, parce qu'il n'a rien à manger.
Et ce n'est pas sans de solides raisons que nous avons fait un saint de Rimbaud qui cessa d'écrire - et précisément émigra -à vingt ans."
(Les Fleurs de Tarbes)

Maurice Blanchot (1907-2003)
Natif de Quain, en Saône-et-Loire, Maurice Blanchot, après des études universitaires, commence une carrière de journaliste et tient La chronique littéraire du "Journal des débats", de 1941 à 1944. Bien que, dans sa jeunesse, il ait incliné vers la "jeune droite", Blanchot refusera pendant la guerre de collaborer avec le régime vichyste, et se retirera progressivement de toute vie publique pour se consacrer à son œuvre et à sa réflexion sur la littérature: l'homme s'interroge sur l'écriture et sur la littérature en tant que "scène" d'une expérience, s'interrogeant sur ce qu'est écrire, sur cette "force humaine" que constitue la "littérature", au travers d'auteurs contemporains, de Mallarmé à Artaud, de Kafka à Bataille. Ecrire, c'est "entrer dans l'affirmation de la solitude où menace la fascination", c'est comme le côté "négatif" de l'expérience diurne du monde. La littérature est par essence contestation, du monde et d'elle-même, elle est, pour reprendre Bataille, "la négativité sans emploi". Peu connue du grand public, son oeuvre, certes parfois difficile d'accès, bénéficie pourtant d'une autorité aussi importante que celle de Georges Bataille ou de Pierre Klossowski dans le monde intellectuel.
L'œuvre romanesque, moins connue que sa partie critique, comprend une série de romans et de récits proprement inclassables : "Thomas l'Obscur" (1941), "Amínadab" (1942), "Le Très-Haut" (1948), "Le Dernier" (1947), "L'Arrêt de mort" (1948), "Le Ressassement éternel" (1951), "Au moment voulu" (1951) , "Celui qui ne m'accompagnais pas" (1953), "Le Dernier homme" (1957), "L'Attente, l'oubli" (1962), "La Folie du jour" (1973), - "Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies. C'est trop peu dire : je vis, et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort ? Quand je mourrai (peut-être tout à l'heure), je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l'avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr : j'éprouve à vivre un plaisir sans limites et j'aurai à mourir une satisfaction sans limites" -, autant d'oeuvres qui s'attachent progressivement à se dépouiller de toutes les formes traditionnelles d'écriture, personnages ou intrigues, visant à produire un texte "neutre", "anonyme".
Cette volonté de dépouillement puise dans ses articles de critique littéraire, régulièrement rassemblés en "essais" et, chroniqueur de La NRF (Gallimard) à partir de 1953, ses dizaines de pages publiées chaque mois, vont inspiré des générations d'artistes et d'écrivains : "Faux pas" (1943), "Lautréamont et Sade" (1949), "La Part du feu" (1949), "L'Espace littéraire" (1955), "La Bête de Lascaux" (1959), "Le Livre à venir" (1959), "L'Entretien infini" (1969), "L'Amitié" (1971), "Le Pas au-delà" (1973). "Le langage en qui parle l'origine, est essentiellement prophétique. Cela ne signifie pas qu'il dicte les événements futurs, cela veut dire qu'il ne prend pas appui sur quelque chose qui soit déjà, ni sur une vérité en cours, ni sur le seul langage déjà dit ou vérifié. Il annonce, parce qu'il commence. Il indique l'avenir, parce qu'il ne parle pas encore, langage du futur, en cela qu'il est lui-même comme un langage futur, qui toujours se devance, n'ayant son sens et sa légitimité qu'en avant de soi, c'est-à-dire foncièrement injustifié. Et telle est la sagesse déraisonnable de la Sibylle, laquelle se fait entendre pendant mille ans, parce qu'elle n'est jamais entendue maintenant, et ce langage qui ouvre la durée, qui déchire et qui débute, est sans sourire, sans parure et sans fard, nudité de la parole première." (Une Voix venue d'ailleurs)...

"Thomas l'Obscur" (1941)
«Thomas demeura à lire dans sa chambre. Il était assis sur une chaise de velours, les mains jointes au-dessus de son front, les pouces appuyés contre la racine des cheveux, si absorbé qu'il ne faisait pas un mouvement lorsqu'on ouvrait la porte. Ceux qui entraient se penchaient sur son épaule et lisaient ces phrases : "Il descendit sur la plage : il voulait marcher. L'engourdissement gagnait après les parties superficielles les régions profondes du cœur. Encore quelques heures et il savait qu'il s'en irait doucement à un état incompréhensible sans jamais connaître le secret de sa métamorphose. Encore quelques instants et il éprouverait cette paix que donne la vie en se retirant, cette tranquillité de l'abandon au crime et à la mort. Il eut envie de s'étendre sur le sable : las et informe, il épiait le moment où allait paraître la première agonie de sa vie, un sentiment merveilleux qui doucement le délierait de ce qu'il y avait de raidi dans ses articulations et ses pensées. Il vit que tout en lui préparait le consentement : son corps commençait à se détendre ; ses mains ouvertes s'offraient au malheur ; ses yeux mi-fermés faisaient signe au destin." (Gallimard)
"Thomas l'obscur" est le premier livre publié par Blanchot, oeuvre mystérieuse qui fait du départ lui-même, du récit d'un départ, son thème initial : Thomas quitte le rivage, s'en éloigne à la nage, éprouve une série de métamorphoses et retourne à un autre point du rivage. Cet homme n'est en fait défini par aucun nom, il n'a pas d'histoire et l'espace qu'il contemple n'est pas géographique : c'est que Thomas n'est rien en dehors de l'acte littéraire qui le pose...
"I - Thomas s'assit et regarda la mer. Pendant quelque temps il resta immobile, comme s'il était venu là pour suivre les mouvements des autres nageurs et, bien que la brume l'empêchât de voir très loin, il demeura , avec obstination, les yeux fixés sur ces corps qui flottaient difficilement. Puis, une vague plus forte l'ayant touché, il descendit à son tour sur la pente de sable et glissa au milieu des remous qui le submergèrent aussitôt. La mer était tranquille et Thomas avait l'habitude de nager longtemps sans fatigue. Mais aujourd'hui il avait choisi un itinéraire nouveau. La brume cachait le rivage. Un nuage était descendu sur la mer et la surface se perdait dans une lueur qui semblait la seule chose vraiment réelle. Des remous le secouaient, sans pourtant lui donner le sentiment d'être au milieu des vagues et de rouler dans des éléments qu'il aurait connus. La certitude que l'eau manquait, imposait même à son effort pour nager le caractère d'un exercice frivole dont il ne retirait que du découragement. Peut-être lui eût-il suffi de se maîtriser pour chasser de telles pensées, mais ses regards ne pouvant s'accrocher à rien, il lui semblait qu'il contemplait le vide dans l'intention d'y trouver quelque secours. C'est alors que la mer, soulevée par le vent, se déchaîna. La tempête la troublait, la dispersait dans des régions inaccessibles, les rafales bouleversaient le ciel et, en même temps, il y avait un silence et un calme qui laissaient penser que tout déjà était détruit. Thomas chercha à se dégager du flot fade qui l'envahissait. Un froid très vif lui paralysait les bras. L'eau tournait en tourbillons.
Était-ce réellement de l'eau ? Tantôt l'écume voltigeait devant ses yeux comme des flocons blanchâtres, tantôt l'absence de l'eau prenait son corps et l'entraînait violemment. Il respira plus lentement, pendant quelques instants il garda dans la bouche le liquide que les rafales lui poussaient contre la tête : douceur tiède, breuvage étrange d'un homme privé de goût. Puis, soit à cause de la fatigue, soit pour une raison inconnue, ses membres lui donnèrent la même sensation d'étrangeté que l'eau dans laquelle ils roulaient. Cette sensation lui parut d'abord presque agréable. Il poursuivait, en nageant, une sorte de rêverie dans laquelle il se confondait avec la mer. L'ivresse de sortir de soi, de glisser dans le vide, de se disperser dans la pensée de l'eau, lui faisait oublier tout malaise.
Et même, lorsque cette mer idéale qu'il devenait toujours plus intimement fut devenue à son tour la vraie mer où il était comme noyé, il ne fut pas aussi ému qu'il aurait dû l'être : il y avait sans doute quelque chose d'insupportable à nager ainsi à l'aventure avec un corps qui lui servait uniquement à penser qu'il nageait, mais il éprouvait aussi un soulagement, comme s'il eût enfin découvert la clé de la situation et que tout se fût borné pour lui à continuer avec une absence d'organisme dans une absence de mer son voyage interminable. L'illusion ne dura pas. Il lui fallut rouler d'un bord sur l'autre, comme un bateau à la dérive, dans l'eau qui lui donnait un corps pour nager. Quelle issue ? Lutter pour ne pas être emporté par la vague qui était son bras ? Être submergé ? Se noyer amèrement en soi ? C'eût été certes le moment de s'arrêter, mais un espoir lui restait, il nagea encore comme si au sein de son intimité restaurée il eût découvert une possibilité nouvelle. Il nageait, monstre privé de nageoires. Sous le microscope géant, il se faisait amas entreprenant de cils et de vibrations. La tentation prit un caractère tout à fait insolite, lorsque de la goutte d'eau il chercha à se glisser dans une région vague et pourtant infiniment précise, quelque chose comme un lieu sacré, à lui-même si bien approprié qu'il lui suffisait d'être là, pour être ; c'était comme un creux imaginaire où il s'enfonçait parce qu'avant qu'il y fût, son empreinte y était déjà marquée. Il fit donc un dernier effort pour s'engager totalement. Cela fut facile, il ne rencontrait aucun obstacle, il se rejoignait, il se confondait avec soi en s'installant dans ce lieu où nul autre ne pouvait pénétrer.
Finalement il dut revenir. Il trouva aisément le chemin du retour et prit pied à un endroit qu'utilisaient quelques nageurs pour plonger. La fatigue avait disparu. Dans les oreilles il gardait une impression de bourdonnement et de brûlure dans les yeux, comme il fallait s'y attendre après un trop long séjour dans l'eau salée. Il s'en rendait compte lorsque, se tournant vers la nappe sans fin sur laquelle se reflétait le soleil, il essayait de reconnaître dans quelle direction il s'était éloigné. Il avait alors un véritable brouillard devant la vue et il distinguait n'importe quoi dans ce vide trouble que ses regards perçaient fiévreusement. A force d'épier, il découvrit un homme qui nageait très loin, à demi perdu sous l'horizon. A une pareille distance, le nageur lui échappait sans cesse. Il le voyait, ne le voyait plus et pourtant avait le sentiment de suivre toutes ses évolutions : non seulement de le percevoir toujours très bien, mais d'être rapproché de lui d'une manière tout à fait intime et comme il n'aurait pu l'être davantage par aucun autre contact. Il resta longtemps à regarder et à attendre. Il y avait dans cette contemplation quelque chose de douloureux qui était comme la manifestation d'une liberté trop grande, d'une liberté obtenue par la rupture de tous les liens. Son visage se troubla et prit une expression inusitée." (à lire et relire aux Editions Gallimard)
Il n’y a pas de véritable récit linéaire ni d’action suivie : Thomas l’Obscur est centré sur l’expérience intérieure d’un personnage, Thomas, dans son rapport au monde, à la lecture, au langage, à la mort. Les « événements » (la lecture, la rencontre avec Anne, la noyade, la marche, la disparition) sont des expériences existentielles, des états de conscience. Cette absence de trame romanesque fait du livre une anti-narration, qui déconcerte le lecteur habitué au roman réaliste ou psychologique...
"II - Il se décida pourtant à tourner le dos à la mer et s'engagea dans un petit bois où il s'étendit après avoir fait quelques pas. La journée allait se terminer ; il n'y avait presque plus de lumière, mais on continuait à voir assez distinctement certains détails du paysage et, en particulier, la colline qui bornait l'horizon et qui brillait, insouciante et libre. Ce qui inquiétait Thomas, c'est qu'il était couché là dans l'herbe avec le désir d'y demeurer longtemps, bien que cette position lui fût interdite. Comme la nuit tombait, il essaya de se redresser et, les deux mains appuyées sur le sol, il mit un genou à terre, tandis que son autre jambe se balançait ; puis, il fit un mouvement brusque et réussit à se tenir tout à fait droit. Il était donc debout. A la vérité, il y avait dans sa façon d'être une indécision qui laissait un doute sur ce qu'il faisait.
Ainsi, quoiqu'il eût les yeux fermés, il ne semblait pas qu'il eût renoncé à voir dans les ténèbres, c'était plutôt le contraire. De même, quand il se mit à marcher, l'on pouvait croire que ce n'étaient pas ses jambes, mais son désir de ne pas marcher qui le faisait avancer. Il descendit dans une sorte de cave qu'il avait d'abord crue assez vaste, mais qui très vite lui parut d'une exiguïté extrême : en avant, en arrière, au-dessus de lui, partout où il portait les mains, il se heurtait brutalement à une paroi aussi solide qu'un mur de maçonnerie ; de tous côtés la route lui était barrée, partout un mur infranchissable, et ce mur n'était pas le plus grand obstacle, il fallait aussi compter sur sa volonté qui était farouchement décidée à le laisser dormir là, dans une passivité pareille à la mort.
Folie donc ; dans cette incertitude, cherchant à tâtons les limites de la fosse voûtée, il plaça son corps tout contre la cloison et attendit. Ce qui le dominait, c'était le sentiment d'être poussé en avant par son refus d'avancer. Aussi ne fut-il pas très surpris, tant son anxiété lui montrait distinctement l'avenir, lorsqu'un peu plus tard il se vit porté plus loin de quelques pas. Quelques pas, c'était à n'y pas croire. Sans doute, son avance était-elle plus apparente que réelle, car, ce nouveau lieu ne se distinguant pas de l'ancien, il y rencontrait les mêmes difficultés, et c'était d'une certaine manière le même lieu d'où il s'éloignait par la terreur de s'en éloigner. A cet instant, Thomas commit l'imprudence de jeter un regard autour de lui. La nuit était plus sombre et plus pénible qu'il ne pouvait s'y attendre. L'obscurité submergeait tout, il n'y avait aucun espoir d'en traverser les ombres, mais on en atteignait la réalité dans une relation dont l'intimité était bouleversante.
Sa première observation fut qu'il pouvait encore se servir de son corps, en particulier de ses yeux ; ce n'était pas qu'il vît quelque chose, mais ce qu'il regardait, à la longue le mettait en rapport avec une masse nocturne qu'il percevait vaguement comme étant lui-même et dans laquelle il baignait. Naturellement, il ne formula cette remarque qu'à titre d'hypothèse, comme une vue qui était commode, mais à laquelle seule la nécessité de démêler des circonstances nouvelles l'obligeait à recourir. Comme il n'avait aucun moyen pour mesurer le temps, il attendit probablement des heures avant d'accepter cette façon de voir, mais, pour lui-même, ce fut comme si la crainte l'avait emporté tout de suite, et c'est avec un sentiment de honte qu'il leva la tête en accueillant l'idée qu'il avait caressée : en dehors de lui se trouvait quelque chose de semblable à sa propre pensée que son regard ou sa main pourrait toucher.
Rêverie répugnante. Bientôt, la nuit lui parut plus sombre, plus terrible que n'importe quelle nuit, comme si elle était réellement sortie d'une blessure de la pensée qui ne se pensait plus, de la pensée prise ironiquement comme objet par autre chose que la pensée. C'était la nuit même. Des images qui faisaient son obscurité l'inondaient. Il ne voyait rien et, loin d'en être accablé, il faisait de cette absence de vision le point culminant de son regard. Son œil, inutile pour voir, prenait des proportions extraordinaires, se développait d'une manière démesurée et, s'étendant sur l'horizon, laissait la nuit pénétrer en son centre pour en recevoir le jour. Par ce vide, c'était donc le regard et l'objet du regard qui se mêlaient. Non seulement cet œil qui ne voyait rien appréhendait quelque chose, mais il appréhendait la cause de sa vision. Il voyait comme objet ce qui faisait qu'il ne voyait pas.
En lui, son propre regard entrait sous la forme d'une image, au moment où ce regard était considéré comme la mort de toute image. Il en résulta pour Thomas des préoccupations nouvelles. Sa solitude ne lui sembla plus aussi complète, et il eut même le sentiment que quelque chose de réel l'avait heurté et cherchait à se glisser en lui. Peut-être aurait-il pu interpréter cette sensation autrement, mais il lui fallait toujours aller au pire. Son excuse, c'est que l'impression était si distincte et si pénible qu'il était presque impossible de n'y pas céder. Même s'il en avait contesté la vérité, il aurait eu le plus grand mal à ne pas croire à quelque chose d'extrême et de violent, car de toute évidence un corps étranger s'était logé dans sa pupille et s'efforçait d'aller plus loin. C'était insolite, parfaitement gênant, d'autant plus gênant qu'il ne s'agissait pas d'un petit objet, mais d'arbres entiers, de tout le bois frissonnant encore et plein de vie. Il ressentit cela comme une faiblesse qui le discréditait. Il ne fit même plus attention aux détails des événements.
Peut-être un homme se glissa-t-il par la même ouverture, il n'aurait pu l'affirmer ni le nier. Il lui sembla que les vagues envahissaient l'espèce d'abîme qu'il était. Tout cela ne le préoccupait que médiocrement. Il n'avait d'attention que pour ses mains, occupées à reconnaître les êtres mêlés à lui dont elles discernaient partiellement le caractère, chien représenté par une oreille, oiseau remplaçant l'arbre sur lequel il chantait. Grâce à ces êtres qui se livraient à des actes échappant à toute interprétation, des édifices, des villes entières se construisirent, villes réelles faites de vide et de milliers de pierres entassées, créatures roulant dans le sang et parfois déchirant les artères, qui jouaient le rôle de ce que Thomas appelait jadis des idées et des passions.
La peur ainsi s'empara de lui et elle ne se distinguait en rien de son cadavre. Le désir était ce même cadavre qui ouvrait les yeux et, se sachant mort, remontait maladroitement jusque dans la bouche comme un animal avalé vivant. Les sentiments l'habitèrent, puis le dévorèrent. Il était pressé, dans chaque partie de sa chair, par mille mains qui n'étaient que sa main. Une mortelle angoisse battait contre son cœur. Autour de son corps, il savait que sa pensée, confondue avec la nuit, veillait. Il savait, terrible certitude, qu'elle aussi cherchait une issue pour entrer en lui. Contre ses lèvres, dans sa bouche, elle s'efforçait à une union monstrueuse. Sous les paupières, elle créait un regard nécessaire. Et en même temps elle détruisait furieusement ce visage qu'elle embrassait. Villes prodigieuses, cités ruinées disparurent. Les pierres furent rejetées au-dehors. On transplanta les arbres. On emporta les mains et les cadavres. Seul, le corps de Thomas subsista privé de sens. Et la pensée, rentrée en lui, échangea des contacts avec le vide..." (à lire aux Editions Gallimard)
La prose de Blanchot est dense, répétitive, parfois hypnotique. Elle multiplie les paradoxes, les images contradictoires, les cercles logiques (phrases où l’on affirme et nie en même temps). Exemple typique : décrire l’acte de lire ou de voir en insistant sur le fait qu’en lisant, on ne lit pas, en voyant, on ne voit pas. Cela donne un texte où le langage ne représente pas le monde, mais produit une expérience : lire Thomas l’Obscur, c’est plonger dans une parole qui se défait et se refait sans cesse.
Et Thomas n’est pas un « héros » mais une présence, une figure, parfois même une voix impersonnelle. Sa dissolution progressive (il s’efface, devient presque un pur regard, une pure conscience) met en scène la disparition du sujet. Cette singularité marque une rupture avec la tradition du roman centré sur un individu psychologique (Balzac, Proust). Ici, le personnage se dissout dans l’écriture...
"III - Il revint à l'hôtel pour dîner. Sans doute aurait-il pu occuper sa place habituelle à la grande table, mais il y renonça et se tint à l'écart. Manger, en ce moment, n'était pas sans importance. D'un côté, c'était tentant, parce qu'il se montrait ainsi encore libre de revenir en arrière ; mais d'autre part, c'était mauvais, car il risquait de reconquérir sa liberté sur une base trop étroite. Il préféra donc adopter une attitude moins franche et avança de quelques pas pour voir comment les autres accepteraient sa nouvelle manière d'être.
D'abord il prêta l'oreille ; il y avait un bruit confus, grossier, qui tantôt s'élevait avec force, tantôt s'atténuait et devenait imperceptible. Assurément, il n'y avait pas à s'y tromper, c'était un bruit de conversation et, du reste, lorsque le langage devenait plus doux, il reconnaissait des mots très simples qu'on semblait choisir pour qu'il pût les comprendre plus facilement. Mais les mots ne l'ayant pas satisfait, il voulut interpeller les personnes qui lui faisaient face et se fraya un chemin vers la table : une fois là, il demeura sans rien dire, en regardant ces gens qui lui semblaient, tous, avoir une certaine importance. On lui fit signe de s'asseoir. Il négligea cette invitation. On l'appela plus fort et une femme, déjà âgée, se tourna vers lui en lui demandant s'il s'était baigné cet après-midi. Thomas répondit oui. Il y eut un silence ; un entretien était donc possible ? Pourtant ce qu'il avait dit ne devait pas être très satisfaisant, car la femme le regarda d'un air de reproche et se leva lentement, comme quelqu'un qui, n'ayant pu terminer sa tâche, en garde on ne sait quel regret, ce qui ne l'empêchait pas de donner par son départ l'impression qu'elle renonçait très volontiers à son rôle.
Sans réfléchir, Thomas prit la place libre et, une fois assis sur une chaise qui lui parut étonnamment basse mais confortable, il ne songea plus qu'à se faire servir le repas qu'il avait refusé tout à l'heure. N'était-ce pas trop tard ? Il aurait aimé consulter sur ce point les personnes présentes.
Évidemment, elles ne se montraient pas à son égard franchement hostiles, il pouvait même compter sur leur bienveillance, sans laquelle il n'aurait pas été capable de demeurer seulement une seconde dans la pièce ; mais il y avait aussi dans leur attitude quelque chose de sournois qui n'autorisait pas la confiance, ni même des relations quelconques. A observer sa voisine, Thomas en fut frappé : c'était une grande fille blonde, dont la beauté se réveillait à mesure qu'il la regardait. Elle semblait avoir éprouvé un plaisir très vif lorsqu'il était venu s'asseoir auprès d'elle, mais maintenant elle se tenait avec une sorte de raideur, avec la volonté puérile de demeurer à l'écart, d'autant plus étrangère qu'il se rapprochait pour obtenir d'elle un signe d'encouragement. Il continua cependant à la fixer, car toute sa personne, éclairée d'une lumière superbe, l'attirait. Ayant entendu quelqu'un l'appeler : Anne (d'une voix très aiguë), voyant qu'elle, aussitôt, levait la tête, prête à répondre, il se décida à agir et, de toutes ses forces, frappa sur la table.
Erreur de tactique, il n'en pouvait douter, geste peu heureux : le résultat ne s'en fit pas attendre. Chacun, comme indigné par une extravagance qu'on ne pouvait tolérer qu'en l'ignorant, s'enferma dans une réserve contre laquelle rien n'était plus possible. Des heures passeraient désormais sans faire renaître le moindre espoir, et les plus grandes preuves de docilité étaient vouées à l'échec comme toutes les tentatives de rébellion. La partie semblait donc perdue. C'est alors que Thomas, pour brusquer les choses, se mit à les dévisager tous, même ceux qui se détournaient, même ceux qui, lorsque leurs regards croisaient les siens, le fixaient à ce moment moins que jamais. Personne n'aurait été d'humeur à supporter longtemps ce regard vide, exigeant, qui réclamait on ne savait quoi et qui errait sans contrôle, mais sa voisine le prit particulièrement mal : elle se leva, arrangea ses cheveux, essuya son visage et prépara son départ en silence. Comme ses mouvements étaient fatigués !
Tout à l'heure, c'est la lumière baignant sa figure, le reflet éclairant sa robe, qui rendaient sa présence si réconfortante, et maintenant cet éclat s'évanouissait. Il n'y avait plus qu'un être dont la fragilité apparaissait dans la beauté fanée et qui perdait même toute réalité, comme si les contours du corps n'avaient pas été dessinés par la lumière, mais par une phosphorescence diffuse, émanée, croyait-on, des os. Nul encouragement n'était plus à attendre d'elle. En s'acharnant avec indécence dans sa contemplation, l'on ne pouvait que s'enfoncer dans un sentiment de solitude où , si loin qu'on voulût aller, l'on se perdrait et continuerait à se perdre. Pourtant, Thomas refusa de se laisser convaincre par de simples impressions. Il se retourna même intentionnellement vers la jeune fille, bien qu'il ne l'eût en somme pas quittée des yeux.
Autour de lui, chacun se levait dans un désordre et un brouhaha désagréables. Il se leva, lui aussi, et, dans la salle maintenant plongée dans la pénombre, mesura du regard la distance qu'il lui fallait franchir pour atteindre la porte. A cet instant, tout s'alluma, les lampes électriques brillèrent, éclairèrent le vestibule, rayonnèrent à l'extérieur où il semblait qu'on dût entrer comme dans une épaisseur chaude et moelleuse. Au même moment, la jeune fille l'appela du dehors d'une voix décidée, presque trop forte, qui résonnait d'une manière impérieuse, sans qu'on pût distinguer si cette force venait de l'ordre qui était transmis ou seulement de la voix qui le prenait trop au sérieux. Le premier mouvement de Thomas, très sensible à cette invitation, fut d'obéir en se précipitant dans l'espace vide.
Puis, lorsque le silence eut recouvert l'appel, il ne fut plus aussi sûr d'avoir réellement entendu son nom et il se contenta de prêter l'oreille en espérant qu'on l'appellerait à nouveau. Tout en écoutant, il songea à l'éloignement de tous ces gens, à leur mutisme absolu, à leur indifférence. C'était pur enfantillage que d'espérer voir toutes les distances supprimées par un simple appel. C'était même humiliant et dangereux. Là-dessus, il releva la tête et, ayant constaté que tout le monde était parti, à son tour il quitta la pièce."
Tout le livre explore des limites : la limite de la perception, du langage, de la pensée, de la mort. La scène de la lecture (Thomas qui lit un livre qui le lit, qui le dévore) ou la scène de la noyade (où il s’engloutit dans la mer et dans le langage) sont emblématiques. Blanchot cherche moins à raconter qu’à mettre le lecteur en expérience de cette limite. C’est un texte à vivre plus qu’à comprendre.
La première version (1941) est longue, foisonnante, baroque, pleine d’images oniriques. La seconde (1950) est beaucoup plus courte, épurée, ascétique. Cette réécriture radicale en fait une œuvre double : un roman qui s’est réécrit contre lui-même, comme si Blanchot cherchait à effacer son propre texte.
"IV - Thomas demeura à lire dans sa chambre. Il était assis, les mains jointes au-dessus de son front, les pouces appuyés contre la racine des cheveux, si absorbé qu'il ne faisait pas un mouvement lorsqu'on ouvrait la porte. Ceux qui entraient, voyant son livre toujours ouvert aux mêmes pages, pensaient qu'il feignait de lire. Il lisait. Il lisait avec une minutie et une attention insurpassables . Il était, auprès de chaque signe, dans la situation où se trouve le mâle quand la mante religieuse va le dévorer. L'un et l'autre se regardaient. Les mots, issus d'un livre qui prenait une puissance mortelle, exerçaient sur le regard qui les touchait un attrait doux et paisible. Chacun d'eux, comme un œil à demi fermé, laissait entrer le regard trop vif qu'en d'autres circonstances il n'eût pas souffert.
Thomas se glissa donc vers ces couloirs dont il s'approcha sans défense jusqu'à l'instant où il fut aperçu par l'intime du mot. Ce n'était pas encore effrayant, c'était au contraire un moment presque agréable qu'il aurait voulu prolonger. Le lecteur considérait joyeusement cette petite étincelle de vie qu'il ne doutait pas d'avoir éveillée. Il se voyait avec plaisir dans cet œil qui le voyait. Son plaisir même devint très grand. Il devint si grand, si impitoyable qu'il le subit avec une sorte d'effroi et que, s'étant dressé, moment insupportable, sans recevoir de son interlocuteur un signe complice, il aperçut toute l'étrangeté qu'il y avait à être observé par un mot comme par un être vivant, et non seulement par un mot, mais par tous les mots qui se trouvaient dans ce mot, par tous ceux qui l'accompagnaient et qui à leur tour contenaient en eux-mêmes d'autres mots, comme une suite d'anges s'ouvrant à l'infini jusqu'à l'œil de l'absolu.
D'un texte aussi bien défendu, loin de s'écarter, il mit toute sa force à vouloir se saisir, refusant obstinément de retirer son regard, croyant être encore un lecteur profond, quand déjà les mots s'emparaient de lui et commençaient de le lire. Il fut pris, pétri par des mains intelligibles, mordu par une dent pleine de sève ; il entra avec son corps vivant dans les formes anonymes des mots, leur donnant sa substance, formant leurs rapports, offrant au mot être son être. Pendant des heures, il se tint immobile, avec, à la place des yeux, de temps en temps le mot yeux : il était inerte, fasciné et dévoilé. Et même plus tard, lorsque, s'étant abandonné et regardant son livre, il se reconnut avec dégoût sous la forme du texte qu'il lisait, il garda la pensée qu'en sa personne déjà privée de sens, tandis que, juchés sur ses épaules, le mot Il et le mot Je commençaient leur carnage, demeuraient des paroles obscures, âmes désincarnées et anges des mots, qui profondément l'exploraient.
La première fois qu'il distingua cette présence, c'était la nuit. Par une lumière qui descendait le long des volets et partageait le lit en deux, il voyait la chambre tout à fait vide, si incapable de contenir un objet que la vue en souffrait. Le livre pourrissait sur la table. Personne ne marchait dans la pièce. Sa solitude était complète. Et cependant, autant il était sûr qu'il n'y avait personne dans la chambre et même dans le monde, autant il était sûr que quelqu'un était là, qui habitait son sommeil, l'approchait intimement, qui était autour de lui et en lui. Par un mouvement naïf, il se leva sur son séant et chercha à percer la nuit, essayant avec la main de se donner de la lumière. Mais il était comme un aveugle qui, entendant du bruit, allumerait précipitamment sa lampe : rien ne pouvait lui permettre de saisir sous une forme ou sous une autre cette présence. Il était aux prises avec quelque chose d'inaccessible, d'étranger, quelque chose dont il pouvait dire : cela n'existe pas, et qui néanmoins l'emplissait de terreur et qu'il sentait errer dans l'aire de sa solitude.
Toute la nuit, tout le jour ayant veillé avec cet être, comme il cherchait le repos, brusquement il fut averti qu'un autre avait remplacé le premier, aussi inaccessible, aussi obscur et pourtant différent. C'était une modulation dans ce qui n'existait pas, une manière différente d'être absent, un autre vide dans lequel il s'animait. Maintenant c'était sûr, quelqu'un s'approchait de lui, qui se tenait non pas nulle part et partout, mais à quelques pas, invisible et certain. Par un mouvement que rien n'arrêterait, que rien non plus ne précipiterait, venait à sa rencontre une puissance dont il ne pouvait accepter le contact. Il voulut fuir. Il se jeta dans le couloir. Haletant et presque hors de soi, il n'eut pas fait quelques pas qu'il reconnut le progrès inévitable de l'être qui venait à lui. Il retourna dans la chambre. Il barricada la porte. Il attendit, le dos appuyé au mur.
Mais ni les minutes ni les heures n'épuisèrent son attente. Il se sentait toujours plus proche d'une absence toujours plus monstrueuse dont la rencontre demandait l'infini du temps. Il la sentait à chaque instant plus près de lui et la devançait d'une portion, infime mais irréductible, de la durée. Il la voyait, être épouvantable qui dans l'espace se pressait déjà contre lui et, existant hors du temps, restait infiniment éloigné.
Attente et angoisse si insupportables qu'elles le détachèrent de lui-même. Une sorte de Thomas sortit de son corps et alla au-devant de la menace qui se dérobait. Ses yeux essayèrent de regarder non pas dans l'étendue, mais dans la durée et dans un point du temps qui n'existait pas encore. Ses mains cherchèrent à toucher un corps impalpable et irréel. C'était un effort si pénible que cette chose qui s'éloignait de lui et, en s'éloignant, tentait de l'attirer, lui parut la même que celle qui indiciblement se rapprochait. Il tomba à terre. Il avait le sentiment d'être couvert d'impuretés.
Chaque partie de son corps subissait une agonie. Sa tête était contrainte de toucher le mal, ses poumons de le respirer. Il était là sur le parquet, se tordant, puis rentrant en lui-même, puis sortant. Il rampait lourdement, à peine différent du serpent qu'il eût voulu devenir pour croire au venin qu'il sentait dans sa bouche. Il mettait sa tête sous le lit dans un coin plein de poussières, il se reposait dans les déjections comme dans un lieu de rafraîchissement où il se voyait plus au propre qu'en lui-même.
C'est dans cet état qu'il se sentit mordu ou frappé, il ne pouvait le savoir, par ce qui lui sembla être un mot, mais qui ressemblait plutôt à un rat gigantesque, aux yeux perçants, aux dents pures, et qui était une bête toute-puissante. En la voyant à quelques pouces de son visage, il ne put échapper au désir de la dévorer, de l'amener à l'intimité la plus profonde avec soi. Il se jeta sur elle et, lui enfonçant les ongles dans les entrailles, chercha à la faire sienne. La fin de la nuit vint. La lumière qui brillait à travers les volets s'éteignit. Mais la lutte avec l'affreuse bête qui s'était enfin révélée d'une dignité, d'une magnificence incomparables, dura un temps qu'on ne put mesurer.
Cette lutte était horrible pour l'être couché par terre qui grinçait des dents, se labourait le visage, s'arrachait les yeux pour y faire entrer la bête et qui eût ressemblé à un dément s'il avait ressemblé à un homme. Elle était presque belle pour cette sorte d'ange noir, couvert de poils roux, dont les yeux étincelaient. Tantôt l'un croyait avoir triomphé et il voyait descendre en lui avec une nausée incoercible le mot innocence qui le souillait. Tantôt l'autre le dévorait à son tour, l'entraînait par le trou d'où il était venu, puis le rejetait comme un corps dur et vide.
A chaque fois, Thomas était repoussé jusqu'au fond de son être par les mots mêmes qui l'avaient hanté et qu'il poursuivait comme son cauchemar et comme l'explication de son cauchemar. Il se retrouvait toujours plus vide et plus lourd, il ne remuait plus qu'avec une fatigue infinie. Son corps, après tant de luttes, devint entièrement opaque et, à ceux qui le regardaient, il donnait l'impression reposante du sommeil, bien qu'il n'eût cessé d'être éveillé...."
Thomas l’Obscur est souvent lu comme une méditation philosophique autant que comme une œuvre littéraire. C’est une expérience du néant, de la disparition, qui anticipe les questionnements de Blanchot critique et penseur (dans L’Espace littéraire ou L’Entretien infini). La singularité est donc de faire du roman un espace où se pense la littérature elle-même, plutôt qu’un simple objet narratif. C’est un roman unique qui fait vivre au lecteur l’expérience de l’« obscurité » comme essence même de la littérature...
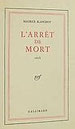
"L'Arrêt de mort" (1948)
Le détail de la lutte et du traitement médical d'une femme en phase terminale, nommée simplement J., elle meurt, ressuscite mystérieusement pour être tuée à nouveau par une overdose administrée par le narrateur, un narrateur qui lutte pour se remémorer les événements qu'il relate et qui a le sentiment que le monde revient toujours sur ses pas, et consume ainsi le protagoniste ainsi que la vérité qu'il essaie de transmettre, et voici un deuxième épisode, le narrateur en interactions avec trois autres femmes durant l'Occupation et les bombardements de Paris dans les années 1940. Face à l'incapacité totale des mots à refléter de façon adéquate un événement dans toute sa complexité, un narrateur envahi du désir insatiable de raconter, mais condamné à explorer les limites de ce qui peut se dire en recommençant encore et encore.
Les mots, en même temps qu'ils le profèrent, nient ce qu'ils disent : la vérité est toujours en deçà ou au-delà, et pourtant elle ne se mesure que par rapport à cette charnière : le mot qui la désignant l'écarte, le mot qui la révélant l'anéantit. Ce débat est toujours au centre des livres de Blanchot, où l'image (le récit) n'est qu'un signe derrière lequel la chose à dire demeure en creux par rapport à la chose dite. D`autre part, écrire est un malheur - malheur immobile et inexprimable et qui ne peut sécréter qu'un autre malheur : écrire, écrire encore, devenir cette parole qui, vertigineusement, annule l'être au moment même où elle désire l'exprimer. Ici, au milieu des phrases qui ne propagent d'abord que leur propre mise en doute, deux images : celle de la mort d'une femme longtemps agonisante, longtemps suspendue au bord de son arrêt de mort, ressuscitée peut-être une nuit par un retour du temps ou une parole enfin souveraine et léguant l'indicible dans un regard ; celle d'une autre femme offrant au cœur d'une nuit terrible, non pas son corps, mais son propre moulage : l'effroyable blancheur de sa forme telle qu'en son éternité. Autour de ces images, le mouvement d'une pensée comme malgré elle en quête de son exactitude et que sa mise en "forme" semble jeter dans un semblable effroi d'elle-même. "Qui fait que maintenant, chaque fois que ma tombe s'ouvre, j'y réveille une pensée assez forte pour me faire revivre ? Le propre ricanement de ma mort. Mais, sachez-le, là où je vais, il n'y a ni œuvre, ni sagesse, ni désir, ni lutte; là où j'entre, personne n'entre. C'est là le sens du dernier combat."
Dernier combat qui n'est pas lutte en effet, mais errance infinie : errance à la poursuite de rien...
"Ces événements me sont arrivés en 1938. J'éprouve à en parler la plus grande gêne. Plusieurs fois déjà, j'ai tenté de leur donner une forme écrite. Si j'ai écrit des livres, c'est que j'ai espéré par des livres mettre fin à tout cela. Si j'ai écrit des romans, les romans sont nés au moment où les mots ont commencé de reculer devant la vérité. Je n'ai pas peur de la vérité. Je ne crains pas de livrer un secret. Mais les mots, jusqu'à maintenant, ont été plus faibles et plus rusés que je n'aurais voulu. Cette ruse, je le sais, est un avertissement. Il serait plus noble de laisser la vérité en paix. Il serait extrêmement utile à la vérité de ne pas se découvrir. Mais, à présent, j'espère en finir bientôt. En finir, cela aussi est noble et important.
Cependant je dois le rappeler, une fois je réussis à donner une forme à ces événements. C'était en 1940, pendant les dernières semaines de juillet ou les premières d'août. Dans le désœuvrement que m'imposait la stupeur, j'écrivis cette histoire. Mais, quand elle fut écrite, je la relus. Aussitôt je détruisis le manuscrit. Il ne m'est même plus possible, aujourd'hui, de m'en rappeler l'étendue.
J'écrirai librement, sûr que ce récit ne concerne que moi. A la vérité, il pourrait tenir en dix mots. C'est ce qui le rend si effrayant. Il y a dix mots que je puis dire. A ces mots j'ai tenu tête pendant neuf années. Mais, ce matin qui est le 8 octobre (je viens de le constater à ma surprise) et qui, par conséquent, marque à peu près l'anniversaire de la première de ces journées, je suis presque sûr que les paroles, qui ne devraient pas être écrites, seront écrites. Depuis plusieurs mois, il me semble que j'y suis résolu.
De ces événements il y a plusieurs témoins, bien qu'un seul, mais le plus autorisé, ait entrevu la vérité. Il m'est arrivé – au début souvent, ensuite moins souvent – de téléphoner à l'appartement où ces choses se passèrent. J'ai moi-même habité cet appartement, qui est au 15, rue de... La sœur de la jeune femme demeura, je crois, encore quelque temps dans cet endroit. Qu'est-elle devenue ? Elle vivait, comme elle aimait à le dire, de galanterie. Je la suppose morte.
Toute la volonté, toute la puissance de vivre avaient été données à sa sœur. La famille, d'origine bourgeoise, avait sombré assez misérablement. Le père avait été tué en 1916 ; la mère, restée à la tête d'une usine de tannerie, s'était ruinée sans s'en apercevoir. Remariée à un éleveur, ils abandonnèrent un jour leurs deux entreprises et achetèrent un comptoir de vin dans une rue du XVe. Là, ils ont dû achever de se ruiner. En principe, une partie de l'usine appartenait aux deux filles. Les discussions d'argent furent souvent très vives. Il est juste de dire que, pendant des années, Mme B. avait dépensé de petites fortunes pour la santé de sa fille aînée, sommes qu'elle lui reprochait aussi avec une parfaite inconscience.
De ces événements, je garde une preuve « vivante ». Mais cette preuve, sans moi, ne peut rien prouver, et j'espère que de ma vie personne ne s'en approchera. Moi mort, elle ne représente que l'écorce d'une énigme. J'espère que ceux qui m'aiment, à ma mort auront le courage de la détruire sans la reconnaître. Je donnerai à ce sujet quelques détails plus tard. Si ces détails manquent, je les supplie de ne pas se jeter à l'improviste dans mes rares secrets, de ne pas lire mes lettres s'ils en trouvent, de ne pas regarder mes photographies si elles se montrent, et surtout de ne pas ouvrir ce qui est fermé : qu'ils détruisent tout, sans savoir ce qu'ils détruisent, dans l'ignorance et la spontanéité d'une affection vraie.
A la fin de 1940, quelqu'un, par ma faute, a eu un très vague pressentiment de cette « preuve ». Comme elle ne connaissait presque rien de l'histoire, elle n'a même pu en frôler la vérité. Elle a seulement deviné que quelque chose était enfermé dans l'armoire (j'habitais alors l'hôtel) ; cette armoire, elle l'a vue, elle a fait un geste pour l'ouvrir. Mais à cet instant, elle fut prise d'une crise étrange. Tombée sur le lit, elle ne cessait de trembler ; toute la nuit, elle trembla sans rien dire ; à l'aube, elle se mit à râler. Les râles durèrent environ une heure, puis vint le sommeil qui la laissa rétablie. (Cette personne, encore toute jeune, avait plus de tête que de nerfs. Elle se plaignait elle-même de son sang-froid. Mais, à cette minute, le sang-froid lui manqua. Sur cette crise, je dois cependant ajouter que, quoiqu'elle n'en eût jamais eu d'autre, on pouvait y voir les restes d'une tentative d'empoisonnement, manquée deux ou trois ans plus tôt ; le poison se réveille, se ranime quelquefois, comme un rêve, dans un corps fortement ébranlé.)
Les principales dates doivent se trouver indiquées dans un petit carnet, enfermé dans mon secrétaire. La seule date dont je sois sûr est celle du 13 octobre, mercredi 13 octobre. Cela est d'ailleurs de peu d'importance. Depuis le mois de septembre, je faisais un séjour à Arcachon. J'y étais seul. C'étaient les jours troubles de Munich. Je savais qu'elle était aussi malade qu'on peut l'être. Au début de septembre, revenant d'un voyage, je m'étais arrêté à Paris et j'avais vu son médecin. Celui-ci lui donnait encore trois semaines de vie. Cependant elle se levait toujours ; elle vivait sur un pied d'égalité avec une fièvre exténuante ; elle frissonnait des heures durant, mais à la fin elle maîtrisait la fièvre. Je crois que le 5 ou le 6 octobre elle se promena encore en voiture avec sa sœur le long des Champs-Élysées.
Bien que de quelques mois mon aînée, elle avait un visage très jeune que la maladie avait à peine touché. Il est vrai qu'elle se maquillait. Mais, non maquillée, elle paraissait encore plus jeune, elle l'était alors exagérément, de sorte que le principal effet de la maladie était de lui donner les traits d'une adolescente. Seuls, les yeux, plus noirs, plus brillants et plus larges qu'ils n'auraient dû l'être – et quelquefois un peu tirés de leur orbite par la fièvre – avaient une fixité anormale. Sur une photographie, prise au mois de septembre, ces yeux sont devenus si grands et si sérieux qu'il faut lutter contre leur expression pour apercevoir encore le sourire, pourtant très apparent.
Après avoir vu son médecin, je lui avais dit : « Il vous donne encore un mois. – Eh bien, je vais dire cela à la reine mère, elle qui ne me croit jamais malade. » Je ne sais si elle aurait voulu vivre ou mourir. Depuis quelques mois, la maladie contre laquelle elle luttait depuis dix ans, lui faisait une vie chaque jour plus étroite, et toute la violence dont elle était capable lui servait maintenant à maudire et la maladie et la vie. Quelque temps plus tôt, elle songea sérieusement à se donner la mort. Moi-même, un soir, je lui avais conseillé ce parti. Ce même soir, après m'avoir écouté, ne pouvant parler à cause de son peu de souffle, mais se tenant à sa table comme une personne bien portante, elle écrivit quelques lignes qu'elle voulut garder secrètes. Ces lignes, je finis par les obtenir d'elle et je les ai encore. Ce sont quelques mots de recommandation, par lesquels elle prie sa famille de simplifier le plus possible la cérémonie des obsèques et surtout interdit à qui que ce soit de venir jamais sur sa tombe ; elle fait aussi un petit legs à l'une de ses amies, A., belle-sœur d'une danseuse assez renommée...."

"Faux pas" (1949)
L'oeuvre critique de Maurice Blanchot tient en quatre ouvrages, "Faux pas", de forme classique, "la Part du feu" (1949), où transparaît un Blanchot qui assume plus de liberté, "L'Espace littéraire" (1955), qui montre un Blanchot dominant à la perfection sa "langue", et "Le Livre à venir" (1959) qui parachève un parcours où se rejoignent littérature et critique...
"Le Journal de Kierkegaard, comme toute son œuvre, est dominé par les deux figures que la méditation de cet extraordinaire esprit n'a jamais abandonnées, celle de son père, vieillard d'une profonde religion que poursuivait le souvenir d'une double faute, et celle de sa fiancée, Régine Olsen, avec laquelle il rompit mystérieusement après un an de promesse. Autour de ces deux images, sa pensée ne cesse de se chercher, et elle en tire un monde, réplique tragique du véritable univers inintelligible. Le Journal où se retrouvent, dans un mouvement d'une extrême souplesse, non seulement ses réflexions théoriques ou des thèmes d'articles et d'ouvrages, mais les pensées les plus proches de lui-même, les paroles qu'il était seul à entendre, cet étrange regard par lequel il se voyait dans sa complète énigme, mélange de la plus grande richesse (l'édition complète des Papiers, publiée à Copenhague, comprendra une vingtaine de volumes), combinaison profondément liée et apparemment fortuite de philosophie, de théologie, de poésie, de confidences, de rêveries, d'inventions diaIectiques, où ce qu'il pense de plus abstrait apparaît comme fondu avec sa personne, où l'idée, loin de subir les accidents de la vie, y trouve son essence et ses conditions et où les événements de l'existence la moins riche en bouleversements extérieurs se prolongent en développements intérieurs d”une extraordinaire fécondité, le journal, par cette variété essentielle, est le miroir de toute l'œuvre de Kierkegaard et même son symbole, s'il est vrai que ce qui est au fond de la méditation qu'il a poursuivie, c'est la recherche d'une idée qui fût en même temps existence, d'une idée qui, vérité pour lui, donnât un sens à tout ce qu'il était et faisait..."
- "Sur l'expérience de Proust on a pu lire les publications les plus différentes et, d'ailleurs, les plus précises. Les uns en ont souligné l'authenticité psychologique; les autres y ont vu au contraire une rencontre mystique. Cependant, malgré toutes les études, il reste un doute sur le caractère de cette expérience, et les explications de Proust, si longues, si complètes et si claires, n'ont pas suffi à en fixer la valeur. Une telle ambiguïté vient sans doute de la nature de l'expérience; elle vient aussi du besoin qu'a eu Marcel Proust, non seulement de l'interpréter, mais de la réduire à une interprétation qui fût utilisable pour la connaissance littéraire. Après avoir rencontré à plusieurs reprises cette sorte de présence qu'il subit au plus profond de lui sans parvenir à en trouver la signification, du jour où il réussit à s'en former pour lui-même une traduction vraisemblable, il lui donne un sens définitif et il construit pour l'exprimer une oeuvre qui en éternise la vérité. Ce n'est donc pas seulement l'art qu'il veut faire "entrer dans le royaume de la pensée", comme le dit Ramon Fernandez dans son livre A la gloire de Proust, mais il reconnaît encore qu'il n'y a pas d'art possible sans une révélation non rationnelle, et que le sens de l'art est de restituer à cette révélation une expression dont l'intelligence tire parti. Que la nature de Proust le préparât à une véritable expérience mystique, c'est ce qu'on aperçoit à presque toutes les pages de son œuvre. Il y a peu de livres qui fassent une plus grande part à l'angoisse. Angoisse de l'enfant perdu dans la foule; angoisse quand le défaut de sommeil émeut l'esprit; angoisse, le soir, lorsqu'il attend sa mère qui a refusé de l'embrasser. L'angoisse est l'âme de l'amour proustien. Elle est le tourment d'un désir qui ne se connaît que dans l'absence et à qui la présence ne peut rien apporter..."
- Le Silence de Mallarmé - "Les écrivains les plus purs ne sont pas tout entiers dans leurs œuvres, ils ont existé, ils ont même vécu : il faut s'y résigner. On aimerait qu'ils ne fussent rien en dehors de leur art sans lequel ils sont si souvent si peu de chose. Il serait naturel que ce qu'ils ont fait exprimât complètement ce qu'ils ont été. Entièrement consumés par leurs chefs-d'oeuvre, il suffirait d'ôter ce masque pour qu'ils redevinssent invisibles; hélas! ils sont logés dans l'évidence d'un théâtre et, dès leur vie même, aux prises avec un biographe futur contre lequel ils se défendent faiblement. Mallarmé a très bien résisté à cette tentation. Ses contemporains n'ont su que l'admirer ou le méconnaître. Même pour eux, il était un homme vivant dans un temps très éloigné, sur lequel on ne pouvait songer à recueillir de témoignages historiques. Que dire de lui? Qu'il était la modestie même et que cependant il nourrissait l'ambition poétique la plus orgueilleuse? Qu'il était affable, merveilleusement bien élevé et en même temps d'une intransigeance, d'une rigueur volontaire dont nulle exigence ne pouvait donner l'idée? Qu'il vivait modestement d'un métier où il n'excellait pas, et qu'il se savait prince, plus encore démiurge, puisqu'il n'allait à rien de moins qu'à diviniser la chose écrite? Ce sont là des traits qui attirent plus la légende que l'histoire, et la légende pour un écrivain consiste à supprimer l'homme en ne laissant subsister que l'auteur..."
- Le Roman de l'Etranger (Albert Camus) - ".. Si l'on regarde "L'Étranger" du dehors, il apparaît comme un livre d'où sont écartées toutes les explications psychologiques et où l'on entre dans l'âme des personnages en ignorant la nature de leurs sentiments et la qualité de leurs pensées. C'est un livre qui fait disparaître la notion de sujet. Tout ce qui s'y montre s'y laisse saisir sous la forme objective : nous tournons autour des événements, autour du héros central, comme si nous ne pouvions en prendre qu'une vue extérieure, comme si, pour les vraiment connaître, il fallait toujours les regarder en spectateur et, de plus, imaginer qu'il n'y a pas d'autre moyen de les atteindre que cette connaissance étrangère. Nulle analyse, nul commentaire sur les drames qui se forment et les passions qu'ils provoquent. Essayons de considérer le monde du dehors, de pénétrer les hommes sans rien saisir d'eux que leurs gestes et leur existence. Décrivons ce qu'íls font comme si ce qu'ils faisaient avait plus de valeur significative et même de pouvoir de suggestion que les plus riches évocations sentimentales. Et tentons de rendre la tragédie avec cette ambiguïté nécessaire qui fait que ce qui se passe au-dedans semble répondre à ce qui se manifeste au-dehors sans que pourtant l'on puisse jamais être sûr de cette fidélité de l'envers à l'endroit. C'est à cette conception dont les lois supposent une vue particulière du monde que tend de lui-même tout récit romanesque. Albert Camus a poussé plus loin le système qu'il a choisi. Non seulement son livre dépeint un homme tel qu'on pourrait le connaître si l'on ne distinguait ce qu'il pense et ce qu'il sent que par ses actes, par conséquent tel qu'un autre pourrait le voir, mais c'est le héros lui-même qui se dépeint et se raconte en nous livrant ses gestes, sa conduite, sa manière de faire et non sa manière d'être. Le récit à la première personne qui sert généralement aux confidences, aux monologues intérieurs, aux interminables descriptions par le dedans, sert à Albert Camus à écarter toute analyse des états d'âme et toute possibilité de rêverie, et il lui sert plus encore à créer une distance infranchissable entre la réalité humaine et les formes qu'en révèlent les événements et les faits. L'homme qui raconte en disant Je une histoire essentiellement dramatique, la plus dramatique qui puisse se concevoir, l'homme qui rapporte cette histoire sans paraître rien révéler de ses véritables transformations, ou plutôt en révélant des sentiments qui, à force de simplicité, le rejettent plus loin de nous, nous le rendent plus étranger que s'il ne disait rien, tend à une objectivité insurpassable. Il est par rapport à lui-même, comme si un autre le voyait et parlait de lui. Ses actes l'absorbent entièrement. Il est tout à fait en dehors. Il n'a d'autre vie intérieure que les mouvements les plus extérieurs de la sensibilité. Il est d'autant plus soi qu'il semble moins penser, moins sentir, être d'autant moins intime avec soi. L'art d'Albert Camus est d'avoir lié cette forme à un mode essentiel de l'être humain et d'en avoir tiré un récit qui nous offre une image de la fatalité. Le petit employé de bureau qui essaie d'entrer en contact avec nous, a perdu sa mère. Elle vivait à l'hospice et il n'allait plus guère la voir...."

"L'Espace littéraire" (1955)
Le livre se compose de sept essais d'inégale longueur et de quatre annexes qui reprennent, en une sorte de mise à l'épreuve immédiate de l'écriture, quelques-uns des principaux motifs développés dans le corps principal de l'ouvrage, la solitude, point de départ de la méditation, l'imaginaire, la nuit, approches de l'espace littéraire. Le livre de Maurice Blanchot n'est pas seulement un essai d'élucidation de la création littéraire et artistique, mais encore une recherche précise de ce qui est en jeu pour l`homme d'aujourd'hui, par le fait que “quelque chose comme l'art ou la littérature existe" : descente vers la profondeur, approche de I'obscurité, expérience de la solitude et de la mort. L'auteur interroge l'œuvre de Kafka, Hölderlin, Rilke, Mallarmé et de bien d'autres...
"Il semble que nous apprenions quelque chose sur l'art, quand nous éprouvons ce que voudrait désigner le mot solitude. De ce mot, on a fait un grand abus. Cependant, «être seul», qu'est-ce que cela signifie? Quand est-on seul? Se poser cette question ne doit pas seulement nous ramener à des opinions pathétiques. La solitude au niveau du monde est une blessure sur laquelle il n'y a pas ici à épiloguer. Nous ne visons pas davantage la solitude de l'artiste, celle qui, dit-on, lui serait nécessaire pour exercer son art. Quand Rilke écrit à la comtesse de Solms-Lauhach (le 3 août 1907) : «Depuis des semaines, sauf deux courtes interruptions, je n'ai pas prononcé une seule parole ; ma solitude se ferme enfin et je suis dans le travail comme le noyau dans le fruit », la solitude dont il parle n'est pas essentiellement solitude : elle est recueillement.
La solitude de l'œuvre - l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire - nous découvre une solitude plus essentielle. Elle exclut l'isolement complaisant de l'individualisme, elle ignore la recherche de la différence ; le fait de soutenir un rapport viril dans une tâche couvre l'étendue maîtrisée du jour ne la dissipe pas. Celui qui écrit l'œuvre est mis à part, celui qui l'a écrite est congédié. Celui qui est congédié, en outre, ne le sait pas. Cette ignorance le préserve, le divertit en l'autorisant à persévérer. L'écrivain ne sait jamais si l'œuvre est faite. Ce qu'il a terminé en un livre, il le recommence ou le détruit en un autre: Valéry, célébrant dans l'oeuvre ce privilège de l'infini, n'en voit encore que le côté le plus facile: que l'œuvre soit infinie, cela veut dire (pour lui) que l'artiste, n'étant pas capable d'y mettre fin, est cependant capable d'en faire le lieu fermé d'un travail sans fin dont l'inachèvement développe la maîtrise de l'esprit, exprime cette maîtrise, l'exprime en la développant nous forme de pouvoir. A un certain moment, les circonstances, c'est-à-dire l'histoire, sous la figure de l'éditeur, des exigences financières, des tâches sociales, prononcent cette fin qui manque, et l'artiste, rendu libre par un dénouement de pure contrainte, poursuit ailleurs l'inachevé. L'infini de l'œuvre, dans une telle vue, n'est que l'infini de l'esprit. L'esprit veut s'accomplir dans une seule œuvre, au lieu de se réaliser dans l'infini des œuvres et le mouvement de l'histoire. Mais Valéry ne fut nullement un héros. ll trouva bon de parler de tout, d'écrire sur tout : ainsi, le tout dispersé du monde le divertissait-il de la rigueur du tout unique de l'œuvre dont il s'était laissé détourner aimablement. L'etc. se dissimulait derrière la diversité des pensées, des sujets. Cependant, l'œuvre - l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire -- n'est ni achevée ni inachevée : elle est. Ce qu'elle dit, c'est exclusivement cela : qu'elle est - et rien de plus. En dehors de cela, elle n'est rien. Qui veut lui faire exprimer davantage; ne trouve rien, trouve qu'elle n'exprime rien. Celui qui vit dans la dépendance de l'œuvre, soit pour l'écrire, soit pour la lire, appartient à la solitude de ce qui n'exprime que le mot être : mot que le langage abrite en le dissimulant ou fait apparaître en disparaissant dans le vide silencieux de l'œuvre. La solitude de l'œuvre a pour premier cadre cette absence d'exigence qui ne permet jamais de la dire achevée ni inachevée. Elle est sans preuve, de même qu'elle est sans usage. Elle ne se vérifie pas, la vérité peut la saisir, la renommée l'écIaire : cette existence ne la concerne pas, cette évidence ne la rend ni sûre ni réelle, ne la rend pas manifeste. L'œuvre est solitaire : cela ne signifie pas qu'elle reste incommunicable, que le lecteur lui manque. Mais qui la lit entre dans cette affirmation de la solitude de l'œuvre, comme celui qui l'écrit appartient au risque de cette solitude.
L`œuvre, le livre. - Si l'on veut regarder de plus près à quoi nous invitent de telles affirmations, il faut peut-être chercher d'où elles prennent leur origine. L'écrivain écrit un livre, mais le livre n'est pas encore l'œuvre, l'œuvre n'est œuvre que lorsque se prononce par elle, dans la violence d'un commencement qui lui est propre, le mot être, événement qui s'accomplit quand l'œuvre est l'intimité de quelqu'un qui l'écrit et de quelqu'un qui la lit. On peut donc se demander : la solitude, si elle est le risque de l'écrivain, n'exprimerait-elle pas ce fait qu'il est tourné, orienté vers la violence ouverte de l'œuvre dont il ne saisit jamais que le substitut, l'approche et l'illusion sous la forme du livre? L'écrivain appartient à l'œuvre, mais ce qui lui appartient, c'est seulement un livre, un amas muet de mots stériles, ce qu'il y a de plus insignifiant au monde. L'écrivain qui éprouve ce vide, croit seulement que l'œuvre est inachevée, et il croit qu'un peu plus de travail, la chance d'instants favorables lui permettront, à lui seul, d'en finir. Il se remet donc à l'œuvre. Mais ce qu'il veut terminer à lui seul, reste l'interminable, l'associe à un travail illusoire. Et l'œuvre, à la fin, l'ignore, se referme sur son absence, dans l'affirmation impersonnelle, anonyme qu'elle est - et rien de plus. Ce que l'on traduit en remarquent que l'artiste, ne terminant son œuvre qu'au moment où il meurt, ne la connaît jamais. Remarque qu'il faut peut-être retourner, car l'écrivain ne serait-il pas mort dès que l'œuvre existe, comme il en a parfois lui-même le pressentiment dans l'impression d'un désœuvrement des plus étranges (1)?
(1). Cette situation n'est pas celle de l'homme qui travaille, qui accomplit sa tâche et à qui cette tâche échappe en se transformant dans le monde. Ce que I'homme fait se transforme, mais dans le monde, et l'homme le ressaisit à travers le monde, peut du moins le ressaisir, si l'aliénation ne s'immobilise pas, ne se détourne pas au profit de quelques-uns, mais se poursuit jusqu'à l'achèvement du monde. Au contraire, ce que l'écrivain a en vue, c'est l'œuvre, et ce qu'il écrit, c'est un livre. Le livre, comme tel, peut devenir un événement agissant du monde (action cependant toujours réservée et insuffisante), mais ce n'est pas l'action que l'artiste a en vue, c'est l'œuvre, et ce qui fait du livre le substitut de l'œuvre suffit à en faire une chose qui, comme l'œuvre, ne relève pas de la vérité du monde, chose presque vaine, si elle n'a ni la réalité de l'œuvre ni le sérieux du travail véritable dans le monde.
« Noli me legere ››. - La même situation peut encore se décrire ainsi : l'écrivain ne lit jamais son œuvre. Elle est, pour lui, l'illisible, un secret, en face de quoi il ne demeure pas. Un secret, parce qu'il en est séparé. Cette impossibilité de lire n'est pas cependant un mouvement purement négatif, elle est plutôt la seule approche réelle que l'auteur puisse avoir de ce que nous appelons œuvre. L'abrupt Noli me legere fait surgir, là où il n'y a encore qu'un livre, déjà l'horizon d'une puissance autre. Expérience fuyante, quoique immédiate. Ce n'est pas la force d'un interdit, c'est, à travers le jeu et le sens des mots, l'affirmation insistante, rude et poignante que ce qui est là, dans la présence globale d'un texte définitif, se refuse cependant, est le vide rude et mordant du refus, ou bien exclut, avec l'autorité de l'indifférence, celui qui, l'ayant écrit, veut encore le ressaisir à neuf par la lecture. L'impossibilité de lire est cette découverte que maintenant, dans l'espace ouvert par la création, il n'y a plus de place pour la création - et, pour l'écrivain, pas d'autre possibilité que d'écrire toujours cette œuvre. Nul qui a écrit l'œuvre, ne peut vivre, demeurer auprès d'elle. Celle-ci est la décision même qui le congédie, le retranche, qui fait de lui le survivant, le désœuvré, l'inoccupé, l'inerte dont l'art ne dépend pas. L'écrivain ne peut pas séjourner auprès de l'œuvre : il ne peut que l'écrire, il peut, lorsqu'elle est écrite, seulement en discerner l'approche dans l'abrupt Noli me legere qui l'éloigne lui-même, qui l'écarte ou qui l'oblige à faire retour à cet « écart ›› où il est entré d'abord pour devenir l'entente de ce qu'il lui fallait écrire..."
Un bref chapitre, "Le Regard d`Orphée" incarne le centre le plus secret de L'Espace littéraire, c'est ici que Blanchot va rattacher l'inspiration de l'écrivain au désir, qui est tout à la fois impatience et insouciance. On dépasse le commentaire ou la critique, on atteint la pensée réelle, Blanchot maîtrise désormais son langage, et surtout la relation infiniment osée de son langage à la pensée, il va bientôt se risquer à ce qu'il nomme lui-même des "Recherches", ce sera "Le Livre à venir", une oeuvre à la fois théorique et libre...
Que nous dit donc le mythe d'Orphée? Eurydice, pour reprendre les mots de Picon, est l'extrême qu'il s'agit d'atteindre, "le point profondément obscur vers lequel l'art, le désir, la mort, la nuit semble tendre". Mais "il ne faut pas regarder la nuit en face si l'on veut la ramener vers le jour: l'oeuvre qui vit de son mouvement vers la mort voit la mort, au dernier instant, se dérober"...
LE REGARD D'ORPHEE
"Quand Orphée descend vers Eurydlce, l'art est la puissance par laquelle s'ouvre la nuit. La nuit, par la force de l'art, l'accueille, devient l'intimité accueillante, l'entente et l'accord de la première nuit. Mais c'est vers Eurydice qu'Orphée est descendu : Eurydice est, pour lui, l'extrême que l'art puisse atteindre, elle est, sous un nom qui la dissimule et sous un voile qui la couvre, le point profondément obscur vers lequel I'art, le désir, la mort, la nuit semblent tendre. Elle est l'instant où l'essence de la nuit s'approche comme l'autre nuit.
Ce « point ››, l'œuvre d'Orphée ne consiste pas cependant à en assurer l'approche en descendant vers la profondeur. Son œuvre, c'est de le ramener au jour et de lui donner, dans le jour, forme, figure et réalité. Orphée peut tout, sauf regarder ce « point ›› en face, sauf regarder le centre de la nuit dans la nuit. Il peut descendre vers lui, il peut, pouvoir encore plus fort, l'attirer à soi et, avec soi, I'attirer vers le haut, mais en s'en détournant. Ce détour est le seul moyen de s'en approcher : tel est le sens de la dissimulation qui se révèle dans la nuit. Mais Orphée, dans le mouvement de sa migration, oublie l'œuvre qu'il doit accomplir, et il l'oubIie nécessairement, parce que l'exigence ultime de son mouvement, ce n'est pas qu'il y ait œuvre, mais que queIqu'un se tienne en face de ce "point", en saisisse I'essence, là où cette essence apparaît, où elle est essentielle et essentiellement apparence : au cœur de la nuit.
Le mythe grec dit : l'on ne peut faire œuvre que si l'expérience démesurée de la profondeur - expérience que les Grecs reconnaissent nécessaire à l'œuvre, expérience où l'œuvre est l'épreuve de sa démesure - n'est pas poursuivie pour elle-même. La profondeur ne se livre pas en face, elle ne se révèle qu'en se dissimulant dans l'œuvre. Réponse capitale, inexorable. Mais le mythe ne montre pas moins que le destin d'Orphée est aussi de ne pas se soumettre à cette loi dernière, - et, certes, en se tournant vers Eurydice, Orphée ruine l'œuvre, I'œuvre immédiatement se défait, et Eurydice se retourne en l'ombre; l'essence de la nuit, sous son regard, se révèle comme I'inessentiel. Ainsi trahit-il l'œuvre et Eurydice et la nuit. Mais ne pas se tourner vers Eurydice, ce ne serait pas moins trahir, être infidèle à la force sans mesure et sans prudence de son mouvement, qui ne veut pas Eurydice dans sa vérité diurne et dans son agrément quotidien, qui la veut dans son obscurité nocturne, dans son éloignement, avec son corps fermé et son visage scellé, qui veut la voir, non quand elle est visible, mais quand elle est invisible, et non comme l'intimité d'une vie familière, mais comme l'étrangeté de ce qui exclut toute intimité, non pas la faire vivre, mais avoir vivante en elle la plénitude de sa mort.
C'est cela seulement qu'il est venu chercher aux Enfers.
Toute la gloire de son œuvre, toute la puissance de son art et le désir même d'une vie heureuse sous la belle clarté du jour sont sacrifiés à cet unique souci : regarder dans la nuit ce que dissimule la nuit, l'autre nuit, la dissimulation qui apparaît.
Mouvement infiniment problématique, que le jour condamne comme une folie sans justification ou comme l'expiation de la démesure. Pour le iour, la descente aux Enfers, le mouvement vers la vaine profondeur, est déjà démesure. ll est inévitable qu'Orphée passe outre à la loi qui lui interdit de "se retourner", car il l'a violée dès ses premiers pas vers les ombres. Cette remarque nous fait pressentir que, en réalité, Orphée n'a pas cessé d'être tourné vers Eurydice : il l'a vue invisible, il l'a touchée intacte, dans son absence d'ombre, dans cette présence voilée qui ne dissimulait pas son absence, qui était présence de son absence infinie. S'il ne l'avait pas regardée, il ne l'eût pas attirée, et sans doute elle n'est pas là, mais lui-même, en ce regard, est absent, il n'est pas moins mort qu'elle, non pas
mort de cette tranquille mort du monde qui est repos, silence et fin, mais de cette autre mort qui est mort sans fin, épreuve de l'absence de fin.
Le jour, jugeant l'entreprise d'Orphée, lui reproche aussi d'avoir fait preuve d'impatience. L'erreur d'Orphée semble être alors dans le désir qui le porte à voir et à posséder Eurydice, lui dont le seul destin est de la chanter. Il n'est Orphée que dans le chant, il ne peut avoir de rapport avec Eurydice qu'au sein de l'hymne, il n'a de vie et de vérité qu'après le poème et par lui, et Eurydice ne représente rien d'autre que cette dépendance magique qui hors du chant fait de lui une ombre et ne le rend libre, vivant et souverain que dans l'espace de la mesure orphique. Oui, cela est vrai : dans le chant seulement, Orphée a pouvoir sur Eurydice, mais, dans le chant aussi, Eurydice est déjà perdue et Orphée lui-même est l'Orphée dispersé, l' "Infiniment mort" que la force du chant fait dès maintenant de lui.
ll perd Eurydice, parce qu'il la désire par-delà les limites mesurées du chant, et il se perd lui-même, mais ce désir et Eurydice perdue et Orphée dispersé sont nécessaires au chant, comme est nécessaire å l'œuvre l'épreuve du désœuvrement éternel. Orphée est coupable d'impatience. Son erreur est de vouloir épuiser l'infini, de mettre un terme à I'interminable, de ne pas soutenir sans fin le mouvement même de son erreur. L'impatience est la faute de qui veut se soustraire à l'absence de temps, la patience est la ruse qui cherche à maîtriser cette absence de temps en faisant d'eIIe un autre temps, autrement mesuré. Mais la vraie patience n'excIut pas l'impatience, elle en est l'intimité, elle est I'impatience soufferte et endurée sans fin. L'impatience d'0rphée est donc aussi un mouvement juste : en elle commence ce qui va devenir sa propre passion, sa plus haute patience, son séjour infini dans la mort." (L'Espace littéraire, Gallimard)
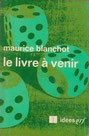
"Le Livre à venir" (1959)
Le secret de la littérature, l'exigence et le sens de la littérature, Blanchot a parlé avec passion mais non sans anxiété de Proust, d'Artaud, de Broch, de Musil, de Henry James, de Samuel Beckett, de Mallarmé, et de celui qui sera le dernier écrivain : mais au-delà, d'où viennent tous ces livres et le livre des livres commence par un texte énigmatique et d'un si grand poids de langage, "Le Chant des sirènes", pour se terminer par une méditation simple et presque familière sur le destin, aujourd'hui, de l'homme qui se veut écrivain....
"I - La rencontre de l'imaginaire
Les Sirènes : il semble bien qu'elles chantaient, mais d'une manière qui ne satisfaisait pas, qui laissait seulement entendre dans quelle direction s'ouvraient les vraies sources et le vrai bonheur du chant. Toutefois, par leurs chants imparfaits qui n'étaient qu'un chant encore à venir, elles conduisaient le navigateur vers cet espace où chanter commencerait vraiment. Elles ne le trompaient donc pas, elles menaient réellement au but. Mais, le lieu une fois atteint, qu'arrivait-il? Qu'était ce lieu? Celui où il n'y avait plus qu'à disparaître, parce que la musique, dans cette région de source et d'origine, avait elle-même disparu plus complètement qu'en aucun autre endroit du monde : mer où, les oreilles fermées, sombraient les vivants et où les Sirènes, preuve de leur bonne volonté, durent, elles aussi, un jour disparaître.
De quelle nature était le chant des Sirènes? en quoi consistait son défaut? pourquoi ce défaut le rendait-il si puissant? Les uns ont toujours répondu : c'était un chant inhumain, - un bruit naturel sans doute (y en a-t-il d'autres ?), mais en marge de la nature, de toutes
manières étranger à l'homme, très bas et éveillant en lui ce plaisir extrême de tomber qu'il ne peut satisfaire dans les conditions normales de la vie. Mais, disent les autres, plus étrange était l'enchantement : il ne faisait que reproduire le chant habituel des hommes, et parce que les Sirènes qui n'étaient que des bêtes, fort belles à cause du reflet de la beauté féminine, pouvaient chanter comme chantent les hommes, elles rendaient le chant si insolite qu'elles faisaient naître en celui qui l'entendait le soupçon de l'inhumanité de tout chant humain. C'est donc par désespoir qu'auraient péri les hommes passionnés de leur propre chant ? Par un désespoir très proche du ravissement. Il y avait quelque chose de merveilleux dans ce chant réel, chant commun, secret, chant simple et quotidien, qu'il leur
fallait tout à coup reconnaître, chanté irréellement par des puissances étrangères et, pour le dire, imaginaires, chant de l'abîme qui, une fois entendu, ouvrait dans chaque parole un abîme et invitait fortement à y disparaître.
Ce chant, il ne faut pas le négliger, s'adressait à des navigateurs, hommes du risque et du mouvement hardi, et il était lui aussi une navigation : il était une distance, et ce qu'il révélait, c'était la possibilité de parcourir cette distance, de faire du chant le mouvement vers le chant et de ce mouvement l'expression du plus grand désir. Étrange navigation, mais vers quel but? Il a toujours été possible de penser que tous ceux qui s'en étaient approches n'avaient fait que s'en approcher et avaient péri par impatience, pour avoir prématurément affirmé : c'est ici ; ici, je jetterai l'ancre.
Selon d'autres, c'était trop tard au contraire : le but avait toujours été dépassé; l'enchantement, par une promesse énigmatique, exposait les hommes à être infidèles à eux-mêmes, à leur chant humain et même à l'essence du chant, en éveillant l'espoir et le désir d'un au-delà merveilleux, et cet au-delà ne représentait qu'un désert, comme si la région-mère de la musique eût été le seul endroit tout à fait privé de musique, un lieu d'aridité et de sécheresse où le silence, comme le bruit, brûlait, en celui qui en avait eu la disposition,
toute voie d'accès au chant. Y avait-il donc un principe mauvais dans cette invitation des profondeurs? Est-ce que les Sirènes, comme la coutume a cherché à nous en persuader, étaient seulement les voix fausses qu'il ne fallait pas entendre, la tromperie de la séduction à laquelle seuls résistaient les êtres de déloyauté et de ruse?
Il y a toujours eu chez les hommes un effort peu noble pour discréditer les Sirènes en les accusant platement de mensonge : menteuses quand elles chantaient, trompeuses quand elles soupiraient, fictives quand on les touchait; en tout inexistantes, d'une inexistence
puérile que le bon sens d'Ulysse suffit à exterminer.
Il est vrai, Ulysse les a vaincues, mais de quelle manière? Ulysse, l'entêtement et la prudence d'Ulysse, sa perfidie qui l'a conduit à jouir du spectacle des Sirènes sans risques et sans en accepter les conséquences, cette lâche, médiocre et tranquille jouissance, mesurée, comme il convient à un Grec de la décadence qui ne mérita jamais d'être le héros de L'Iliade, cette lâcheté heureuse et sûre, du reste fondée sur un privilège qui le met hors de la condition commune, les autres n'ayant nullement droit au bonheur de l'élite, mais seulement droit au plaisir de voir leur chef se contorsionner ridiculement, avec des grimaces d'extases dans le vide, droit aussi à la satisfaction de maîtriser leur maître (c'est là sans doute la leçon qu'ils entendaient, le vrai chant des Sirènes pour eux) : l'attitude d'Ulysse, cette surdité étonnante de celui qui est sourd parce qu'il entend, suffit à communiquer aux Sirènes un désespoir jusqu'ici réservé aux hommes et à faire d'elles, par ce désespoir, de belles filles réelles, une seule fois réelles et dignes de leur promesse, capables donc de disparaître dans la vérité et la profondeur de leur chant.
Les Sirènes vaincues par le pouvoir de la technique qui toujours prétendre jouer sans péril avec les puissances irréelles (inspirées), Ulysse n'en fut cependant pas quitte. Elles l'attirèrent là où il ne voulait pas tomber et cachées au sein de L'Odyssée devenue leur tombeau, elles l'engagèrent, lui et bien d'autres, dans cette navigation heureuse, malheureuse, qui est celle du récit le chant non lus immédiat mais raconté par là en apparence rendu inoffensif, ode devenue épisode.
La loi secrète du récit.
Ce n'est pas là une allégorie. Il y a une lutte fort obscure engagée entre tout récit et la rencontre des Sirènes, ce chant énigmatique qui est puissant par son défaut. Lutte où la prudence d'Ulysse, ce qu'il y a en lui de vérité humaine, de mystification, d'aptitude
obstinée à ne pas jouer le jeu des dieux, a toujours été utilisé et perfectionné. Ce qu'on appelle le roman est né de cette lutte. Avec le roman, ce qui est au premier plan, c'est la navigation préalable, celle qui porte Ulysse jusqu'au point de la rencontre. Cette navigation
est une histoire tout humaine, elle intéresse le temps des hommes, est liée aux passions des hommes, elle a lieu réellement et elle est assez riche et assez variée pour absorber toutes les forces et toute l'attention des narrateurs. Le récit devenu roman, loin de paraître s'appauvrir, devient la richesse et l'ampleur d'une exploration qui tantôt embrasse l'immensité navigante, tantôt se borne à un petit carré d'espace sur le pont, parfois descend dans les profondeurs du navire où jamais on ne sut ce qu'est l`espoir de la mer. Le mot d'ordre qui s'impose aux navigateurs est celui-ci : que soit exclue toute allusion à un but et à une destination.
A bon droit, certainement. Personne ne peut se mettre en route avec l'intention délibérée d'atteindre l'île de Caprée, personne ne peut mettre le cap sur cette île, et qui l'aurait décidé n'irait cependant que par hasard, un hasard auquel il est lié par une entente difficile à
pénétrer. Le mot d'ordre est donc de silence, de discrétion, d'oubli.
Il faut reconnaître que la modestie prédestinée, le désir de ne prétendre à rien et de ne conduire à rien suffiraient à faire de beaucoup de romans des livres sans reproche et du genre romanesque le plus sympathique des genres, celui qui s'est donné pour tâche, à
force de discrétion et de joyeuse nullité, d'oublier ce que d'autres dégradent en l'appelant l'essentiel. Le divertissement est son chant profond. Changer sans cesse de direction, aller comme au hasard et pour fuir tout but, pat un mouvement d'inquiétude qui se transforme en distraction heureuse, telle a été sa première et sa plus sûre justification. Faire du temps humain un jeu et du jeu une occupation libre, dénuée de tout intérêt immédiat et de toute utilité, essentiellement superficielle et capable par ce mouvement de surface d'absorber cependant tout l'être, cela n'est pas peu de chose. Mais il est clair que le roman, s'il manque aujourd'hui à ce rôle, c'est que la technique a transformé le temps des hommes et leurs moyens d'en être divertis. Le récit commence où le roman ne va pas et toutefois conduit par ses refus et sa riche négligence. Le récit est héroïquement et prétentieusement le récit d'un seul épisode, celui de la rencontre d'Ulysse et du chant insuffisant et attirant des Sirènes. Apparemment, en dehors de cette grande et naïve prétention, rien n'est changé, et le récit semble, par sa forme, continuer de répondre à la vocation narrative ordinaire. Ainsi, Aurélia se donne pour la simple relation d'une rencontre, ainsi Une saison en Enfer, ainsi Nadja. Quelque chose a eu lieu, qu'on a vécu et qu'on raconte ensuite, de même qu'Ulysse a eu besoin de vivre l'événement et d'y survivre pour devenir Homère qui le raconte.
Il est vrai que le récit, en général, est récit d'un événement exceptionnel qui échappe aux formes du temps quotidien et au monde de la vérité habituelle, peut-être de toute vérité. C'est pourquoi, avec tant d'insistance, il rejette tout ce qui pourrait le rapprocher de la frivolité d'une fiction (le roman, au contraire, qui ne dit rien que de croyable et de familier, tient beaucoup à passer pour fictif). Platon, dans le Gorgias, dit : "Écoute un beau récit. Toi, tu penseras que c'est une fable, mais selon moi c'est un récit.. Je te dirai comme une vérité ce que je vais te dire." Or, ce qu'il raconte, c'est l'histoire du Jugement dernier.
Cependant, le caractère du récit n'est nullement pressenti, quand on voit en lui la relation vraie d'un événement exceptionnel, qui a eu lieu et qu'on essaierait de rapporter. Le récit n'est pas la relation de l'événement, mais cet événement même, l'approche de cet événement, le lieu où celui-ci est appelé à se produire, événement encore à venir et par la puissance attirante duquel le récit peut espérer, lui aussi, se réaliser.
C'est là un rapport très délicat, sans doute une sorte d'extravagance, mais elle est la loi secrète du récit. Le récit est mouvement vers un point, non seulement inconnu, ignoré, étranger, mais tel qu'il ne semble avoir, par avance et en dehors de ce mouvement, aucune sorte de réalité, si impérieux cependant que c'est de lui seul que le récit tire son attrait, de telle manière qu'il ne peut même "commencer" avant de l`avoir atteint, mais cependant c'est seulement le récit et le mouvement imprévisible du récit qui fournissent l'espace où le point devient réel, puissant et attirant.
Quand Ulysse devient Homère.
Qu'arriverait-il si Ulysse et Homère, au lieu d'être des personnes distinctes se partageant commodément les rôles, étaient une seule et même présence? si le récit d'Homère n'était rien d'autre que le mouvement accompli par Ulysse au sein de l'espace que lui ouvre le Chant des Sirènes? si Homère n'avait pouvoir de raconter que dans la mesure où, sous le nom d'Ulysse, un Ulysse libre d'entraves quoique fixé, il va vers ce lieu d'où le pouvoir de parler et de raconter semble lui être promis, à condition qu'il y disparaisse?
C'est là l'une des étrangetés, disons l'une des prétentions du récit. Il ne "relate" que lui-même, et cette relation, en même temps qu'elle se fait, produit ce qu'elle raconte, n'est possible comme relation que si elle réalise ce qui se passe en cette relation, car elle détient alors le point ou le plan où la réalité que le récit "décrit" peut sans cesse s'unir à sa réalité en tant que récit, la garantir et y trouver sa garantie.
Mais n'est-ce pas une naïve folie? En un sens. C'est pourquoi il n'y a pas de récit, c'est pourquoi il n'en manque pas...." (Le livre à venir, Gallimard)
A propos de chaque auteur, devant toute œuvre sur laquelle il se penche et entre en expérience, Blanchot s'étonne, comment s`organise la décision originale qui pousse un être humain à s'enfouir, pour mieux se reconnaître, dans la rumination des mots, comment peut-il le faire et persévérer à "faire" de la littérature qui est toujours à venir, qui ouvre sur un abîme que rien ne peut combler. Ce que Blanchot décèle ainsi à tout moment, c`est la façon dont l`écriture fait problème pour qui s`y abandonne, et la démarche de notre "chercheur" n'est pas sans risque, le risque de paraître parfois obscur ou parfois évident, le risque de ne pouvoir épuiser avec toutes la clarté voulue, attendue, espérée, toutes les contradictions qu'écrire introduit dans la conscience de l'être humain confronté à lui-même, tous les paradoxes de l'écrivain, de ce tisseur de mots, qui aspire à trouver en lui, et au-delà de tout langage, un secret que le seul langage pourtant parvient à désigner, et qui s`acharne en même temps à brouiller toute chose ...

VERS LA DISPARITION DE LA LITTERATURE
"Il arrive qu'on s'entende poser d'étranges questions, celle-ci par exemple : "Quelles sont les tendances de la littérature actuelle?" ou encore : "Où va la littérature?"
Oui, question étonnante, mais le plus étonnant, c'est que s'il y a une réponse, elle est facile : la littérature va vers elle-même, vers son essence qui est la disparition.
Ceux qui ont besoin d'affirmations aussi générales peuvent se tourner vers ce qu'on appelle l'histoire. Elle leur apprendra ce que signifie la célèbre parole de Hegel : "L'art est pour nous chose passée", parole prononcée audacieusement en face de Goethe, au moment de l'essor romantique et quand la musique, les arts plastiques, la poésie attendent des œuvres considérables. Hegel qui inaugure son cours sur l'esthétique par cette lourde parole, sait cela. Il sait que les oeuvres ne manqueront pas à l'art, il admire celles de ses contemporains et parfois il les préfère (il les méconnaît aussi), et pourtant "l'art est pour nous chose passée". L'art n'est plus capable de porter le besoin d'absolu. Ce qui compte absolument, c'est désormais l'accomplissement du monde, le sérieux de l'action et la tâche de la liberté
réelle. L'art n'est proche de l'absolu qu'au passé, et c'est au Musée seul qu'il a encore valeur et puissance. Ou bien, disgrâce plus grave, il tombe en nous jusqu'à devenir simple plaisir esthétique ou auxiliaire de la culture.
Cela est bien connu. C'est un avenir déjà présent.
Dans le monde de la technique, on peut continuer à louer les écrivains et à enrichir les peintres, on peut honorer les livres et étendre les bibliothèques ; on peut réserver à l'art une place parce qu'il est utile ou parce qu'il est inutile, le contraindre, le réduire ou le laisser
libre. Le sort, dans ce cas favorable, est peut-être le plus défavorable. Apparemment, l'art n'est rien s'il est souverain. D'où la gêne de l'artiste d'être encore quelque chose dans un monde où il se voit pourtant injustifié.
Une recherche obscure, tourmentée.
L'histoire parle grossièrement ainsi. Mais si l'on se tourne vers la littérature ou vers les arts eux-mêmes, ce qu'ils semblent dire est bien différent. Tout se passe comme si la création artistique, à mesure que les temps se ferment à son importance en obéissant à des mouvements qui lui sont étrangers, se rapprochait d'elle-même par une vue plus exigeante et plus profonde. Non pas plus orgueilleuse : c°est le Sturm und Drang qui croit exalter la poésie par les mythes de Prométhée et de Mahomet; ce qui est alors glorifié, ce n'est pas l'art, c'est l'artiste créateur, l'individualité puissante, et chaque fois que l'artiste est préféré à l'oeuvre, cette préférence, cette exaltation du génie signifie une dégradation de l'art, le recul devant sa puissance propre, la recherche de rêves compensateurs. Ces ambitions désordonnées quoique admirables, celles que Novalis exprime mystérieusement : "Klingsor, poète éternel, ne meurt pas, reste dans le monde", ou encore Eichendorff : "Le poète est le cœur du monde", ne sont nullement semblables à celles qu'après 1850, pour choisir cette date à partir de laquelle le monde moderne va avec plus de décision vers son destin, les noms de Mallarmé, de Cézanne annoncent, celles que tout l'art moderne soutient de son mouvement.
Ni Mallarmé, ni Cézanne ne font rêver de l'artiste comme d'un individu plus important et plus visible que les autres. Ils ne recherchent pas la gloire, ce vide brûlant et rayonnant dont une tête d'artiste, depuis la Renaissance, a toujours souhaité de s'auréoler. Ils sont l'un et l'autre modestes, non pas tournés vers eux-mêmes, mais vers une recherche obscure, vers un souci essentiel dont l'importance n'est pas liée à l'affirmation de leur personne, ni à l'essor de l'homme moderne, est incompréhensible à presque tous, et cependant ils s'y
attachent avec une obstination et une force méthodique dont leur modestie n'est que l'expression dissimulée.
Cézanne n'exalte pas le peintre, ni même, sinon par son oeuvre, la peinture, et Van Gogh dit : « Je ne suis pas un artiste - comme c'est grossier même de le penser de soi-même" et il ajoute : "Je dis cela pour montrer combien je trouve sot de parler d'artistes doués ou non
doués." Dans le poème, Mallarmé pressent une œuvre qui ne renvoie pas à quelqu'un qui l'aurait faite, presque une décision qui ne tient pas à l'initiative de tel individu privilégié. Et, contrairement à l'antique pensée selon laquelle le poète dit : ce n'est pas moi qui parle, c'est le dieu qui parle en moi, cette indépendance du poème ne désigne pas la transcendance orgueilleuse qui ferait de la création littéraire l'équivalent de la création d'un monde par quelque démiurge; elle ne signifie même pas l'éternité ou l'immuabilité de la sphère poétique, mais tout au contraire elle renverse les valeurs habituelles que nous attachons au mot faire et au mot être.
Cette transformation étonnante de l'art moderne qui se produit au moment où l'histoire propose à l'homme des tâches et des buts tout autres, pourrait apparaître comme une réaction contre ces tâches et ces buts, un effort vide d'affirmation et de justification. Cela n'est pas ou n'est vrai que superficiellement. Il arrive que les écrivains et les artistes répondent à l'appel de la communauté par un retranchement frivole, au puissant travail de leur siècle par une glorification naïve de leur secrets oisifs, ou encore par un désespoir qui les fait se reconnaître, comme Flaubert, dans la condition qu'ils refusent. Ou bien ils pensent sauver l'art en l'enfermant en eux-mêmes : l'art serait un état d'âme; poétique voudrait dire subjectif.
Mais précisément, avec Mallarmé et avec Cézanne, pour se servir symboliquement de ces deux noms, l'art ne recherche pas ces faibles refuges. Ce qui compte pour Cézanne, c'est "la réalisation", ce ne sont pas les états d'âme de Cézanne. L'art est puissamment tendu vers l'œuvre, et l'oeuvre d'art, l'œuvre qui a son origine dans l'art, se montre comme une affirmation tout à fait différente des oeuvres qui ont leur mesure dans le travail, les valeurs et les échanges, différente, mais non pas contraire : l'art ne nie pas le monde moderne, ni celui de la technique, ni l'effort de libération et de transformation qui prend appui sur cette technique, mais il exprime et peut-être accomplit des rapports qui précèdent tout accomplissement objectif et technique.
(..)
.. l'essence de la littérature, c'est d'échapper à toute détermination essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou même la réalise : elle n'est jamais déjà là, elle est toujours à retrouver ou à réinventer. Il n'est même jamais sûr que le mot littérature ou le mot art réponde à rien de réel, rien de possible ou rien d'important. Cela a été dit : être artiste, c'est ne jamais savoir qu'il y a déjà un art, ni non plus qu'il y a déjà un monde. Sans doute, le peintre va au musée et il a, par-là, une certaine conscience de la réalité de la peinture : il sait la peinture, mais son tableau ne le sait pas, sait plutôt que la peinture est impossible, irréelle, irréalisable. Qui affirme la littérature en elle-même, n'affirme rien. Qui la cherche, ne cherche que ce qui se dérobe; qui la trouve, ne trouve que ce qui est en deçà ou, chose pire, au-delà de la littérature.
C'est pourquoi, finalement, c'est la non-littérature que chaque livre poursuit comme l'essence de ce qu'il aime et voudrait passionnément découvrir.
Il ne faut donc pas dire que tout livre relève de la seule littérature, mais que chaque livre décide absolument d'elle. Il ne faut pas dire que toute œuvre tirerait sa réalité et sa valeur de son pouvoir de se conformer à l'essence de la littérature, ni même de son droit à dévoiler ou à affirmer cette essence. Car jamais une œuvre ne peut se donner pour objet la question qui la porte. Jamais un tableau ne pourrait seulement commencer, s'il se proposait de rendre visible la peinture. Il se peut que tout écrivain se sente comme appelé à répondre seul, à travers sa propre ignorance, de la littérature, de son avenir qui n'est pas seulement une question historique, mais, à travers l'histoire, est Ie mouvement par lequel, tout en en "allant" nécessairement hors d'elle-même, Ia littérature prétend cependant "en venir" à elle-même, à ce qu'elle est essentiellement.. Il se peut qu'être écrivain, ce soit la vocation de répondre à cette question que celui qui écrit a le devoir de soutenir avec passion, vérité et maîtrise et que cependant il ne peut jamais surprendre et moins encore lorsqu'il se propose d'y répondre, à laquelle il peut tout au plus, par l'oeuvre, donner une réponse indirecte, l'œuvre dont on n'est jamais maître, jamais sûr, qui ne veut répondre à rien qu'à elle-même et qui ne rend l'art présent que là où il se dissimule et disparaît. Pourquoi cela?" (Le Livre à venir, Gallimard).
