- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite

Heinrich Böll (1917-1985), "La Grimace" (Ansichten eines Clowns, 1963), "Portrait de groupe avec dame" (Gruppenbild mit Dame, 1971), "L'Honneur perdu de Katharina Blum" (Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder : wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann, 1974), "Protection encombrante" (Fürsorgliche Belagerung, 1979) - Günter Grass (1927-2015), "Le Tambour" (Die Blechtrommel, 1959), "Anesthésie locale" (Örtlich betäubt, 1971), "Journal d'un escargot" (Aus dem Tagebuch einer Schnecke, 1974) - Arno Schmidt (1914-1979), "Scènes de la vie d'un faune" (Aus dem Leben eines Fauns, 1953), "La république des savants" (Die Gelehrtenrepublik, 1957) - - Peter Härtling (1933-2017), "Niembsch ou l'Immobilité (Niembsch oder Der Stillstand, 1964), "Das Familienfest oder Das Ende der Geschichte" (1969) - ..
Last update: 12/31/2016
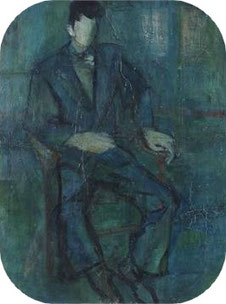
La littérature allemande des années Adenauer (1949-1963) est celle d'une période pour laquelle la nécessité historique qui s'impose est d'ancrer la République fédérale allemande dans l'Europe, dans la stabilité politique et dans la croissance économique. L'absorption de la RDA dans les années 1980 ne sera plus à la limite qu'un épiphénomène. Cette littérature est de part en part traversée d'interrogations auxquelles elle ne peut échapper, qui s'impose au détour d'une réflexion, parfois d'un silence, et l'écriture a cette fonction quasi mystique, cette liberté quasi absolue, un pouvoir d'incarnation. Globalement, en l'espace d'une vingtaine d'années, une à deux générations passent d'une Allemagne détruite de l'immédiat après-guerre à un pays redevenu prospère et tout entier préoccupé de jouissances matérielles, en se référant à un écrivain tel que Heinrich Böll, de "Der Zug war pünktlich" (Le train était à l'heure), 1947, à "Gruppenbild mit Dame" (Portrait de groupe avec dame), 1971 : ce redressement économique et social laisse en creux bien des interrogations, les philosophies de l'absurde taraudent sans cesse cette littérature de langue allemande qui ne soldera véritablement son compte politique que dans les années 1970 (L'Honneur perdu de Katharina Blum, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum", 1974)...
(Reinhard Drenkhahn (1926-1959)
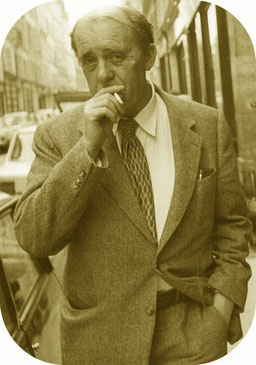
Après la défaite de 1945 et les découvertes autour des horreurs des camps de concentration nazis, il n'est guère surprenant que la littérature de l'après-guerre en Allemagne et en Autriche ait été dominée par les thèmes de la guerre, de la souffrance et de la culpabilité, alors que les écrivains tentaient de faire face à leur passé. En Allemagne, les deux plus éminents écrivains et prix Nobel (respectivement en 1972 et 1999) qui se confrontèrent à ces thèmes furent Heinrlch Böll (né en 1917) et Günther Grass (né en 1927). Böll, qui est né à Cologne, où il passa la majeure partie de sa vie, fut si affecté par la destruction quasi complète de la ville par les bombardements alliés pendant ta Seconde Guerre mondiale que l'on parle de son oeuvre comme de la "Trümmerliteratur" (littérature des ruines).
Dans ses ouvrages, de "Der Zug war punktlich (Le Train était à l'heure, 1947) à "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (L'Honneur perdu de Katharina Blum, 1974), en passant par "Ansichten eines Clowns" (1963), il s'en prend au statu quo et aux personnalités de l'autorité établie (des hommes politiques aux membres de l'Église) et reconnaît toute leur valeur aux actions des dépossédés et des victimes de discrimination.
Gunther Grass est né et a grandi à Danzig (l'actuel Gdansk, en Pologne) et utilise des éléments de fantaisie proche du réalisme magique - dans ses brillantes dissections de l'Allemagne du Troisième Reich. Ses ouvrages les plus célèbres se déroulent dans sa ville natale, avec "Die Blechtrommel" (Le Tambour, 1959, dont fut tiré un film remarquable, en 1979), "Katz und Maus" (Le Chat et la souris, 1961) et "Hundejahre" (Les Années de chien, 1963), qui étudie la montée de l'Allemagne nazie et le destin de Danzig et de ses habitants.
Böll et Grass étaient tous deux membres du Groupe 47, association littéraire fondée par Alfred Andersch et Hans Werner fondée en 1947 (d'où son nom), qui s'était fixée comme but de réinventer et encourager la nouvelle culture allemande confrontée aux séquelles de la Seconde Guerre mondiale. La poétesse autrichienne lngeborg Bachmann (1929-1973), aux œuvres d'une nature profondément philosophique, et l'écrivain juive viennoise Ilse Aichinger (née en 1921), dont l'oeuvre reflète son vécu pendant la persécution nazie, étaient des membres importants de ce groupe, au sein duquel elles participaient aux séminaires et discussions. L'écriture de Böll répondra aux exigences du Groupe 47 qui entendait réagir au fossé qui les séparait des intellectuels allemands ayant fui le régime nazi. Ils avaient l'intention de débarrasser leur langage des vestiges de la propagande nazie en préconisant un réalisme dépouillé....

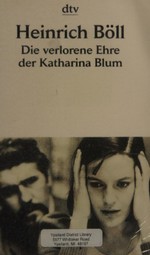

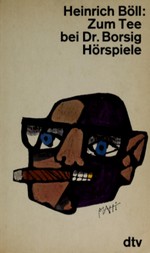
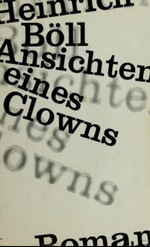

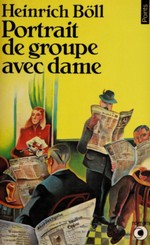
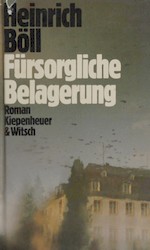
Heinrich Böll et Günter Grass, deux piliers de la littérature allemande d'après-guerre, tous deux ont été des vigies critiques de la société ouest-allemande (RFA), obsédés par le travail de mémoire (Vergangenheitsbewältigung), la dénonciation des continuités du nazisme, et les dangers du capitalisme, du militarisme et de l'autoritarisme. Figures intellectuelles très médiatisées, ils ont intervenu sans relâche dans le débat public (soutien au SPD, opposition à l'état d'urgence, défenseurs des dissidents, critiques de la guerre froide et du consumérisme). Leurs œuvres sont indissociables de cet engagement.
Prix Nobel de Littérature : Reconnus internationalement (Böll en 1972, Grass en 1999) pour leur contribution à la reconstruction morale et littéraire de l'Allemagne. L'insistance de Böll sur la conscience face à l'injustice reste un rempart contre la passivité et la compromission, sa dénonciation de la diffamation médiatique (Katharina Blum), de la violence d'État ou de la collusion économico-politique (Femmes devant un paysage fluvial) est terriblement actuelle. La capacité de Grass à démasquer l'absurde et l'horreur par le grotesque et le fantastique reste une arme puissante contre les idéologies et les discours lénifiants. Son travail colossal pour "démythifier" le XXe siècle allemand, du nazisme à la réunification (Toute une histoire), reste une référence incontournable ...

Heinrich Böll (1917-1985)
Soldat allemand ayant connu les garnisons de Pologne, les fronts de France et de Russie, la captivité puis la libération en 1945, Böll a construit sa
littérature dans les ruines de l'après-guerre (Trümmerliteratur), affrontant nombres d'interrogations, celle de l'inhumanité et de la responsabilité, celle du désarroi et de la réadaptation :
mais ce qui semble dominer ce catholique frappé par les philosophies de l'absurde, c'est le sentiment d'un rendez-vous manqué avec l'histoire, la société allemande est passé par trop
rapidement de l'ordre absurde et inhumain d'une société de guerre et de destruction totale à l'absurde système politico-social du "miracle économique" : le matérialisme dominant encourage
non seulement l'amnésie intellectuelle vis-à-vis d'un passé brutal et d'une sortie de guerre des plus douteuses, mais instaure une normativité sociale qui menace subrepticement l'intégrité de
l'existence. Les héros de Böll retrouvent une raison de vivre, mais avec la prospérité revenue, l'idéologie du profit et du rendement comme la normativité sociale menace leur dignité humaine
autant que l'avait fait la misère.
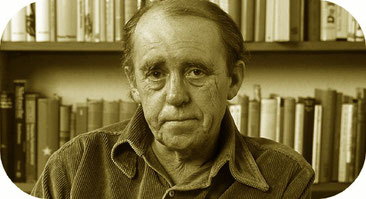
L'écriture de Böll a directement participé à son succès : avec un grand souci de clarté, il organise son récit en multipliant les points de vue, sans
sacrifier la cohésion globale, conférant tant une épaisseur à ses fictions qu'une distanciation qui lui permet d'assumer ces contradictions et cette subtile ironie, comme désenchantée, qui le
caractérise.
Ses récits abordent progressivement l'absurdité de la guerre, la souffrance et la mort ("Der Zug war pünktlich" (Le train était à l'heure), 1949,
"Wanderer, kommst du nach Spa..." (la Mort de Lohengrin), 1950 ; "Wo warst du, Adam ?" (Où étais-tu Adam?), 1951), la détresse de l'après-guerre ("Und sagte kein einziges Wort" (Rentrez
chez vous Bogner), 1952, "Haus ohne Hüter" (les Enfants des morts), 1954 ; "Das Brot der frühen Jahre" (le Pain des jeunes années), 1955), la critique morale face aux nouvelles menaces
politiques et sociales sur les libertés, telles que la guerre du Vietnam, les procès d'écrivains en Union soviétique, les lois d'exception, de l'affaire Baader-Meinhof ("Ende einer
Dienstfahrt" (Fin de mission), 1966), "Schwierigkeiten mit der Brüderlichkeit, politische Schriften" (De la difficulté de fraterniser, écrits politiques), 1973-1976, "Einmischung erwünscht"
(Engagement souhaitable), 1977, "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (l'Honneur perdu de Katharina Blum), 1974 ; "Fürsorgliche Belagerung'" (Protection encombrante), 1979), la méfiance
vis-à-vis des nazis reconvertis ("Billard um halbzehn" (Les Deux Sacrements), 1959,"Doktor Murkes gesammeltes Schweigen" (La Collection de silences du Dr Murke), 1958), la lutte contre
l'amnésie du passé dans une prospérité retrouvée ("Irisches Tagebuch" (Journal irlandais), 1957, "Ansichten eines Clowns" (La Grimace), 1963, Gruppenbild mit Dame" (Portrait de groupe
avec dame), 1971, "Frauen vor Flusslandschaft" (Femmes devant un paysage fluvial), 1985), sans doute en fin de parcours, une certaine résignation... Par delà ses prises de position, Heinrich Böll
entendait surtout promouvoir une conscience morale, une réflexion la plus équilibrée possible sur son temps, la société allemande, la persistance dans les mentalités d'un passé nazi jamais
véritablement affronté...
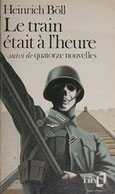
"Der Zug war pünktlich", 1949.
"Le Train était à l'heure" - Bien plus qu'un simple récit de guerre, un manifeste littéraire et éthique de Heinrich Böll. Publié en feuilleton dans Frankfurter Hefte ; première édition en livre en 1949 chez Friedrich Middelhauve Verlag - Les dernières heures d'Andreas, un jeune soldat allemand, pendant la Seconde Guerre mondiale. En permission, il monte dans un train censé le ramener au front de l'Est. Dès le départ, il est habité par une certitude terrifiante : ce voyage le conduira inexorablement à sa mort, prévue dans quatre jours à Lemberg (aujourd'hui Lviv). Durant le trajet, il fait la connaissance d'Olina, une prostituée polonaise, avec qui il partage une brève mais intense communion humaine, faite de peur, d'espoir étouffé et de recherche de rédemption. Leur rencontre offre un répit fragile face à l'absurdité et à la fatalité de la guerre. La fin du roman confirme les pressentiments d'Andreas dans une conclusion aussi abrupte que tragique.
Andreas est un anti-héros passif, écrasé par la peur et le pressentiment de sa mort, symbole de l'individu broyé par la machine de guerre. Dénonciation de la guerre : Le roman est une charge violente contre l'absurdité et l'horreur de la guerre. Il montre son coût humain insoutenable, non pas à travers les grandes batailles, mais dans l'angoisse existentielle d'un simple soldat. La rencontre avec Olina est un moment clé. Elle représente une lueur d'humanité, de compassion et d'amour possible, mais cette lueur est condamnée d'avance par le contexte de guerre et la fatalité qui pèse sur Andreas.
Ce premier roman (bien que court) est un jalon fondateur de la littérature allemande d'après-guerre. Böll, avec d'autres auteurs du "Groupe 47", donne une voix aux victimes, aux simples soldats et aux civils traumatisés, loin de toute rhétorique nationaliste ou héroïque.

"Loin de la troupe", satires et nouvelles
Textes "Dr Murkes gesammelte Schweigen" (1958), "Erzählungen, Hörspiele, Aufsätze" (1961), "Als der Krieg ausbrach" (1962), "Entfernung von der Truppe" (1964)
L'ELIMINATEUR - "Depuis quelques semaines je m'efforce d'éviter tout contact avec les gens susceptibles de me demander ma profession. S'il me fallait réellement désigner le métier que j'exerce, je serais contraint d'employer un terme qui ne manquerait pas d'effrayer mes contemporains. C'est pourquoi je préfère le procédé abstrait qui consiste à coucher ma confession sur le papier.
Il y a quelques semaines encore, un aveu verbal ne m'aurait nullement effrayé; pour un peu je l'aurais même recherché. Je me disais inventeur, savant, étudiant en cas de besoin et, dans les premières fumées de l'ivresse, génie méconnu. Je me chauffais joyeusement au soleil de la renommée qu'un col élimé peut dispenser et revendiquais avec suffisance, comme allant de soi, le crédit que des commerçants méfiants ne m'accordaient qu'à contrecœur en voyant dans les poches de mon pardessus disparaître margarine, ersatz de café et mauvais tabac. Baignant dans l'atmosphère du laisser-aller, buvant matin, midi et soir l'hydromel de la bohème, je goûtais le profond bonheur du non-conformisme.
Mais depuis quelques semaines, chaque matin vers sept heures trente je monte dans le tramway au coin de la Roonstrasse et, comme tous les autres voyageurs, tends humblement ma carte hebdomadaire au receveur. Je porte un complet gris croisé et une chemise verte avec cravate verdâtre; j'ai à la main une cassette d'aluminium plate contenant mon casse-croûte et, telle une légère massue, le journal du matin enroulé sur lui-même. J'offre toutes les apparences du citoyen parvenu à se soustraire à la méditation. Au troisième arrêt je me lève pour céder ma place à l'une des vieilles femmes de la cité ouvrière provisoire. Ayant ainsi sacrifié mon confort à mon sens du devoir social, je continue à parcourir mon journal debout, élevant parfois la voix pour me poser en conciliateur quand la mauvaise humeur matinale rend injustes mes contemporains. Je corrige les erreurs politiques ou historiques les plus grossières (en expliquant par exemple à mes compagnons de route qu'il existe une certaine différence entre S.A. et U.S.A.). Sitôt que quelqu'un se fourre une cigarette entre les lèvres, je lui mets discrètement mon briquet sous le nez pour qu'il l'allume à sa flamme minuscule mais fidèle. C'est ainsi que je parachève l'image d'un concitoyen soigné et encore assez jeune pour qu'on puisse le qualifier de «bien élevé».
J'ai manifestement réussi à prendre un masque qui proscrit toute question relative à mes occupations. je passe pour un homme instruit qui négocie des denrées odorantes bien empaquetées : café, thé et condiments, ou encore de précieux petits objets agréables à l'oeil : bijoux et montres; pour un homme qui exerce sa profession dans un bureau agréablement suranné dont les murs s'ornent des sombres portraits à l'huile d'ancêtres négociants; pour un homme qui vers dix heures du matin téléphone à son épouse et sait alors donner à sa voix apparemment exempte de passion l'intonation d'une tendresse baignée d'amour et de sollicitude. Comme je m'associe en outre aux plaisanteries habituelles, sans manquer jamais de rire lorsque à l'arrêt de la Schlieffenstrasse un certain employé de l'administration municipale hurle chaque matin en montant dans le tramway : "Appuyez sur l'aile gauche!" (ou n'est-ce pas plutôt la droite ?), comme enfin je ne suis pas avare de commentaires sur les événements du jour ou les bandes dessinées, je passe pour un homme, aisé sans doute (la qualité de l'étoffe de mon complet en fait foi), mais dont la conception de l'existence prend ses racines dans les principes mêmes de la démocratie. Un air de probité m'enveloppe comme Blanche-Neige son cercueil de verre.
Quand, dépassant le tramway, un camion obstrue un instant la fenêtre, j'en profite pour contrôler dans la vitre l'expression de mon visage : n'est-elle pas trop songeuse, voire même douloureuse? Je m'empresse d'en effacer ce qu'elle pourrait avoir de morose et m'efforce de la rendre telle qu'elle doit être : ni réservée ni familière, ni superficielle ni profonde. Je crois avoir réussi à me fabriquer le masque souhaité car, lorsque je descends à la Marienplatz pour me perdre dans le labyrinthe de la vieille ville où foisonnent les bureaux agréablement surannés - études de notaires et cabinets d'affaires discrets - personne ne se doute apparemment que je pénètre dans l'immeuble de l'Ubia par la porte de service. Laquelle Ubia peut se vanter d'assurer le gagne-pain de trois cents personnes non sans en assurer quatre cent mille autres sur la vie. Le concierge m'accueille en souriant à l'entrée des fournisseurs, je passe devant lui, descends au sous-sol et attaque aussitôt ma besogne qui doit être terminée à huit heures trente, au moment où le flot des employés se déversera dans les bureaux. Le métier que j'exerce le matin de huit heures à huit heures trente dans le sous-sol de cette honorable firme consiste exclusivement à faire œuvre de destruction : j'élimine.
J'ai passé des années à concevoir ma profession et à la rendre plausible sur le plan de la rentabilité. J'ai même écrit des traités sur la question. Des graphiques couvraient - et couvrent encore - les murs de mon logement. Des années durant j'ai longé des abscisses et escaladé des ordonnées. je me livrais à une orgie de théories et baignais dans l'ivresse glaciale que seules peuvent dispenser les formules. Mais depuis que j'exerce ma profession et mets mes théories en pratique, j'en ressens une profonde tristesse, comparable à celle que peut ressentir un général contraint de quitter les sommets de la stratégie pour les bas-fonds de la tactique.
Je pénètre dans la pièce qui me sert de bureau, troque mon veston contre une blouse grise et me mets immédiatement à l'œuvre. J'ouvre les sacs que le concierge est allé chercher de bon matin à la poste centrale et les vide dans deux baquets accrochés au mur de part et d'autre de ma table de travail et légèrement au-dessus de celle-ci, baquets fabriqués sur mes indications. Ainsi n'ai-je plus, à la façon d'un nageur en quelque sorte, qu'à tendre les bras pour saisir le courrier que j'entreprends aussitôt de trier. Je commence par séparer les imprimés des lettes, travail de routine car un simple coup d'oeil au timbre d'affranchissement suffit. Une parfaite connaissance des tarifs postaux m'évite, lors de ce travail, tout examen approfondi..."
(édition du Seuil, trad. S.et G.de Lalène, 1966)

"Billard um halb zehn" (Les Deux Sacrements, 1959)
Cette saga famiIiale, qui a pour personnages trois générations d'architectes dans une ville catholique de l'Allemagne de l'Ouest, se déroule sur une seule journée, le 6 septembre 1958. Plus de soixante ans d'histoire allemande sont révélés ici - depuis l'époque du Kaiser jusqu'au Troisième Reich et au miracle économique allemand des années 1950. "Les Deux Sacrements" traitent du refus d'oublier et de pardonner la complicité de l'EgIise catholique pendant la guerre devant la persécution et la torture, ainsi que l'échec de civilisation que cela a représenté. Lorsque le premier grand projet d'architecture de Heinrich Fähmel, un monastère érigé en 1907, s'écroule sous les charges explosives de Robert, son fils, expert de la Wehrmacht, c'est en réalité un acte de protestation contre la civilisation. Le petit-fils, Joseph, qui s'occupe de la restauration du monastère après la guerre, est troublé lorsqu'iI découvre cette histoire. Les tensions familiales et les contradictions nées d'une société trouvent une solution étrangement rédemptrice dans un acte de violence symbolique. On a souvent évoqué l'humanisme de ce roman qui appelle appelle les lecteurs à partager la répulsion morale des personnages et leur refus d'oublier.
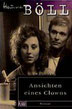
La Grimace (Ansichten eines Clowns, 1963)
Le mime Hans Schnier, réfugié seul dans sa chambre, à Bonn, récapitule en quelques heures l'échec de sa vie sentimentale et professionnelle, avant d'aller s`asseoir tel un mendiant sur les marches de la gare, pour attendre (en tout cas faire semblant) le retour de Marie, la femme qu'il aime mais qu'il a perdue, et qui doit revenir ce jour-là de son voyage de noces à Rome. C'est un long monologue fait de "considérations" (Ansichten) désabusées, nourries de souvenirs personnels, et entrecoupées seulement par quelques conversations téléphoniques et une brève visite du père. Une forme narrative caractéristique du dénuement du personnage, de son incapacité à assumer une "totalité" romanesque. A la différence de la majorité des personnages qui habitent les nouvelles d'après-guerre de Böll, Hans Schnier est issu d'une famille bourgeoise. Sa vocation de saltimbanque fait de lui un renégat au sein de la bonne société rhénane du miracle économique. Il appartient à la génération de ceux qui, bien que trop jeunes pour être enrôlés par les dernières conscriptions hitlériennes, n'en ont pas moins grandi au milieu des slogans nationaux-socialistes. La nouvelle société d`opulence qui s'est édifiée sur les ruines est à ses yeux irrévocablement suspecte, dans la mesure où ses acteurs, tous plus ou moins compromis, s'achètent aujourd'hui à peu de frais une bonne conscience : sa propre mère elle-même préside désormais un "comité pour le rapprochement des races". Dans ce climat de Restauration, le catholicisme dit "progressiste" qui s`affiche dans les milieux bourgeois de Bonn participe de l'hypocrisie générale. Et c'est sur lui que se concentre toute l'acrimonie de Hans Schnier. ll a d'ailleurs, pour cela, nombre de raisons personnelles : Marie, qui a été sa compagne pendant six ans, l'a quitté justement pour épouser l`un de ces "catholiques modernes et pleins d`avenir" qui occupent le devant de la scène. Face à l`hypocrisie sociale, Schnier prétend opposer le fard "sincère" du saltimbanque. Mais la grimace du clown, qui se conçoit comme une réponse esthétique et morale, et non pas idéologique, demeure dérisoire.
L'épilogue grotesque, où Hans Schnier met en scène avec complaisance sa propre faillite et dessine un portrait résigné de l'artiste; et pourtant, dit le dernier mot du roman, « il continua de chanter". A roman d'atmosphère mélancolique et pessimiste de la fin de l`ère Adenauer, répondra bientôt celui d'une certaine rébellion avec Katharina Blum....

"Portrait de groupe avec dame" (Gruppenbild mit Dame), 1971
Après plusieurs années de silence, Böll reprend la parole et, se retranchant derrière un rôle volontairement anonyme et administratif, reconstitue cinquante
années d'histoire allemande, du IIIe Reich aux années du fameux "miracle économique" d'après-guerre, à travers le portrait d'une femme, Léni Pfeiffer, née Gruyten en 1922, survivante d'un mode en
mutation dont on va suivre les différentes étapes d'une existence qui n'apparaît véritablement dans toute son authenticité qu'en toute fin du récit.
"...Il est bien évident que Léni n'a pas toujours eu quarante-huit ans, aussi devons-nous nécessairement jeter un regard en arrière. Sur ses photos de jeunesse, on n'hésiterait pas à la qualifier de fraîche et jolie. Même sous l'uniforme des jeunesses hitlériennes - à treize, quatorze et quinze ans - Léni a l'air charmante. Aucun observateur masculin n'aurait émis sur ses attraits physiques un jugement inférieur à « fichtre, elle n'est vraiment pas mal! ›› Le besoin humain d'accouplement va du coup de foudre causé par le désir spontané de commerce charnel (ne fût-ce qu'une fois et sans songer encore à un lien durable) avec une personne de l'autre sexe ou du sien propre, jusqu'à la passion la plus intense et la plus tumultueuse qui ne laisse en repos ni l'âme ni le corps et dont chacune des multiples formes aux manifestations aussi anarchiques qu'injustifiées - de la plus superficielle à la plus profonde - aurait pu être suscitée par Léni et l'a d'ailleurs été. A l'âge de dix-sept ans elle fit le bond décisif : de jolie elle devint belle, étape que les blondes aux yeux foncés franchissent plus facilement que les blondes aux yeux clairs. Aucun homme à ce stade n'aurait porté sur elle un jugement inférieur à « ravissante ››. Il convient encore de fournir quelques indications sur le déroulement des études de Léni. Elle allait sur ses dix-sept ans quand son père, qui n'avait pas manqué de remarquer comme de jolie elle devenait belle, la prit avec lui au bureau et, en raison surtout de l'effet qu'elle produisait sur les hommes (nous sommes en 1938), la fit assister à d'importantes réunions d'affaires où, bloc-notes sur les genoux et crayon en main, elle consignait quelques observations en style télégraphique. Elle ignorait la sténographie et n'aurait d'ailleurs au grand jamais voulu l'apprendre. Non que toute abstraction lui fût totalement étrangère, mais elle n'avait aucune envie d'apprendre "les hiéroglyphes" (ainsi qualifiait-elle la sténographie). Ses études ne se sont pas déroulées sans souffrances, celles de ses maîtres d'ailleurs plutôt que les siennes propres. Après avoir par deux fois non pas exactement redoublé sa classe mais "volontairement rétrograde dans la classe inférieure", elle terminale cycle primaire avec un livret scolaire passable aux abondantes interpolations. L'un des membres encore vivant de l'administration de son école, l'ancien directeur M. Schlocks, aujourd'hui âgé de soixante-cinq ans et que l'auteur a réussi à dénicher dans sa retraite campagnarde, a déclaré qu'il avait même été question d'envoyer Léni dans une classe de rattrapage, mais que deux circonstances l'en avaient préservée; primo, les moyens financiers de son père qui - Schlocks a expressément tenu à le souligner - ne jouèrent cependant qu'un rôle indirect, et secundo, le fait que Léni avait remporté deux années de suite, à onze et douze ans, le titre de "fille la plus allemande de l'école ››, distinction conférée par une commission d'experts ès pureté raciale qui faisait le tour de tous les établissements. Une fois même, sélectionnée pour disputer le titre de "fille la plus allemande de la ville", Léni fut tout juste coiffée sur le poteau par la fille d'un pasteur protestant aux yeux encore plus clairs que les siens qui avaient alors déjà sensiblement foncé. Pouvait-on décemment envoyer en classe de rattrapage la "fille la plus allemande de l'école" ?
A douze ans, Léni entra dans un établissement secondaire dirigé par des religieuses, dont à quatorze ans elle dut être retirée faute d'y avoir obtenu des résultats suffisants. En l'espace de deux ans, elle avait redoublé une fois et passé une fois dans la classe supérieure mais à la seule condition que ses parents promissent solennellement de ne jamais mentionner cette faveur. Promesse qui fut d'ailleurs tenue. Avant que ne naissent des malentendus, il convient de fournir ici, à titre d'information objective, l'explication des fâcheuses circonstances dont Léni fut victime au cours de ses études. Il n'est pas question en l'occurrence de faire état d'une quelconque culpabilité ni même - tant à l'école primaire que dans l'établissement secondaire que Léni fréquenta par la suite - de difficultés majeures, mais simplement de méprises. Léni était non seulement parfaitement éducable mais même à la fois affamée et assoiffée d'instruction. Or si tous les enseignants s'efforcèrent d'assouvir cette faim et d'étancher cette soif, les aliments et les boissons qu'ils lui offriront ne répondaient malheureusement ni a sa forme d'intelligence, ni à son optique, ni à ses dons..."
(traduction S. et G. De Lalène, Seuil)
Au centre de l`histoire, le personnage énigmatique de Léni Pfeiffer, née Gruyten, quarante-huit ans, qui, après une enfance relativement bourgeoise et un mariage éphémère - il dura trois jours, en 1941 - avec un sous-officier de carrière, vit aujourd'hui seule et presque sans ressources dans l'immeuble qui l`a vue naître. "L'auteur ne dispose d'aucun moyen d'investigation personnelle et directe sur la vie physiologique, psychique et amoureuse de Léni, mais il a tout, absolument tout entrepris pour obtenir à son sujet ce que l'on appelle une information objective (ses informateurs seront même nommément désignés en temps opportun !)". Une écriture donc pseudo-documentaire, qui ironise sur ses propres procédés. Les témoins qui seront cités seront, par définition, évidemment de faux témoins. Par leur intermédiaire s'exprime Böll lui-même, qui dessine à travers le personnage fascinant de Léni un certain idéal d'humanité, sur toile de fond de l'histoire de l'Allemagne contemporaine. A la fois réservée, presque taciturne, et sensuelle - une sensualité directe, prolétarienne, et presque géniale! -, Léni incarne une immédiateté, une authenticité qui la placent au-delà de toutes les conventions et hypocrisies sociales et lui donnent la force de traverser toutes les épreuves de la vie - "et l'on peut dire à coup sûr, pas seulement du point de vue financier, que Léni est plutôt mal lotie" - en restant fidèle à elle-même, sans amertume ni repentir. Telle une "belle âme" moderne, elle ne suit jamais que sa propre "nature", envers et contre tous, - dans sa relation avec Rachel, la nonne juive, ou encore avec Boris, le prisonnier de guerre russe qui reste le seul amour de sa vie, avec les travailleurs turcs, etc.. Et le narrateur, de se rendre compte "que le lecteur, jusqu'ici plus ou moins patient, commence à se demander : cette Léni serait-elle donc parfaite? Réponse : presque."
C'est un ensemble d'identités transitoires qu'a créé ici Böll. Le roman nous entraîne dans l'histoire allemande de 1890 à 1970. Les divers points de vue des personnages offrent des perspectives psychologiques différentes mais toutes convaincantes. On rencontre ainsi de jeunes intellectuels, une religieuse Juive, une résistante, un arriviste notoire, un opportuniste politique et des nazis abrutis. Un personnage cependant demeure absolument énigmatique: Leni Pfeiffer. C'est la "dame" autour de laquelle est organisé ce portrait de groupe brossé à travers une série d'entretiens, de lettres et d'histoires personnelles. On découvre Leni du point de vue du narrateur, qui a tendance à rendre perplexe la protagoniste blonde et supposée naïve. Cependant, son personnage résiste aux clichés; son obstination à dépasser les frontières sociales et raciales semble indiquer une personne intelligente et subversive.
Ici se déroule ce que Böll appelle l' "esthétique de l'humain" et va jusqu'au bout de son principe selon lequel l'individu est la mesure de l'Histoíre. Il est réservé au personnage de la femme d'incarner une forme de résistance, traduite éventuellement en des gestes minuscules - Léni offrant du café à un prisonnier russe sans se laisser intimider par la présence autour d'elle de nazis convaincus -, qui, bien que totalement apolitique, n'en prend pas moins une dimension quasi révolutionnaire.
Le roman fut adapté au cinéma dès 1977 par Alexander Petrovic, avec Romy Schneider....

"L'Honneur perdu de Katharina Blum" (Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder : wie Gewalt entstehen und wohin sie führen
kann), 1974
Accueilli comme un pamphlet, Böll s'attaque à l'une des grandes actualités politiques et sociales du début des années soixante-dix en Allemagne fédérale, la
manipulation de l'opinion publique par la presse et l'omniprésence du sexe dans les médias. Alors que l'Etat allemand réagit avec une imposante fermeté à la vague de terrorisme révolutionnaire
qu'entreprend la "Rote Armee Fraktion", avec enlèvements de personnalités et attentats, Böll réagit contre les excès des autorités et d'une certaine presse qui lui semblent dispoportionnés et
constituer une menace quant aux libertés individuelles. Böll qui a connu la dictature nazie, voit poindre à nouveau le spectre d'un Etat policier et fera lui-même à un moment donné l'objet d'une
surveillance renforcée. L'action, présentée sous forme d'un rapport d'enquête, se déroule sur quatre jours et porte sur un apparent fait divers, le meurtre d'un journaliste par une employée de
maison, Katharina Blum.
"..En ce même jeudi 21 février 1974, il était environ 15 h 30 lorsque dans la station de sports d'hiver où il comptait passer une dizaine de jours, Me Blorna chaussa pour la première fois ses skis dans 1'intention d'effectuer une assez longue randonnée. Dès cet instant pourtant, ses vacances dont il s'était fait une telle fête étaient fichues. La veille au soir peu après leur arrivée, Trude et lui avaient fait une belle promenade de deux heures dans la neige, puis avaient bu une bouteille de vin au coin du feu avant d'aller dormir d'un profond sommeil, fenêtre grande ouverte. Le matin, - après un petit déjeuner dont il avait fait durer le plaisir, il avait gagné la terrasse où, bien emmitouflé, il s'était installé dans un confortable fauteuil d'osier pour le reste de la matinée. Enfin l'après-midi, à l'instant précis où il chaussait ses skis pour effectuer sa randonnée, ce type du JOURNAL brusquement surgi devant lui l'avait attaqué de but en blanc sur Katharina : "La croyez-vous capable de commettre un crime ? - Comment cela ? Je suis avocat et sais donc bien quel genre d'individus sont capables d'en commettre un. Mais quel crime ? Katharina? Impensable ! D'où vous vient cette idée? Que savez-vous? " En apprenant enfin qu'un bandit recherché depuis longtemps avait indiscutablement passé la nuit chez Katharina et que depuis 11 h du matin environ elle subissait un interrogatoire serré, il songea à rentrer par le premier avion pour lui prêter assistance, mais le type du JOURNAL - lui avait-il alors vraiment trouvé l'air visqueux ou l'idée ne lui en était-elle venue que plus tard? - en lui assurant qu'il n'y avait pas péril en la demeure, le pria de bien vouloir lui indiquer quelques traits de caractère de la jeune femme. Lorsque Me Blorna s'y refusa, le type prétendit que c'était mauvais signe, un tel refus pouvant être mal interprété car dans pareil cas - il s'agissait d'une front-page-story - garder le silence sur son caractère, c'était en reconnaître implicitement la mauvaise nature. Sur ce, agacé et furieux Blorna déclara que Katharina était une jeune femme très intelligente et réservée. Mais il s'en voulut aussitôt car ça n'était pas tout à fait juste ni ne traduisait bien ce qu'il voulait et aurait dû dire. Il n'avait encore jamais eu affaire aux journaux, donc jamais au JOURNAL, mais quand il vit le type repartir au volant de sa Porsche, il déchaussa ses skis sachant ses vacances terminées. Il monta retrouver Trude qui douillettement enveloppée dans des couvertures somnolait étendue au soleil sur le balcon. Il lui raconta l'histoire. "Essaye donc de la joindre au téléphone", dit-elle. Il s'y efforça à trois, quatre, cinq reprises, mais pour s'entendre opposer chaque fois : "l'abonné ne répond pas". Il essaya une fois encore vers 11h du soir mais sans plus de succès. Il but alors beaucoup et dormit mal.
Lorsque d'humeur maussade il apparut le vendredi matin vers 9 h 30 au petit déjeuner, Trude lui tendit aussitôt LE JOURNAL. Katharina y figurait à la une. Photo gigantesque et caractères non moins gigantesques. "KATHARINA BLUM, LA BONNE AMIE D'UN GANGSTER, REFUSE DE DONNER LES NOMS DE SES VISITEURS. Ludwig Götten, le bandit et assassin recherché depuis un an et demi aurait pu être arrêté hier si sa bonne amie, une employée de maison nommée Katharina Blum, n'avait couvert sa fuite et effacé toute trace de son passage. La police présume que la femme Blum est depuis assez longtemps déjà mêlée à la conjuration. (suite page 2, colonnes 3 et 4)."
En deuxième page Blorna put voir à quel degré LE JOURNAL avait travesti ses propos..."
(traduction S. et G. De Lalène, Seuil)
"Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie fûhren kann", ou "Comment peut naître la violence et où elle peut conduire" : si l'action et les personnages de ce récit sont imaginaires, si certaines pratiques journalistiques décrites dans ces pages offrent des ressemblances avec celles du journal Bild, celles-ci ne sont ni intentionnelles ni fortuites, mais tout simplement inévitables, tel est l'avertissement qui signe le "réalisme polémique" de Böll.
L'histoire se passe en février 1974, pendant le carnaval de Cologne. Katharina Blum, une jeune femme divorcée de vingt-sept ans, fait la connaissance, au cours d'une soirée chez des amis, d`un certain Ludwig Götten, qui est recherché pour activités terroristes. Elle l`abrite chez elle durant la nuit ; quelques heures après, elle est arrêtée.
interrogée brutalement par la police, tandis que la presse à sensation (désignée à l'intérieur du récit sous l'étiquette lapidaire, globale et menaçante du "journal"), à travers la personne du journaliste Werner Tötges, s'empare de l`affaire et étale bientôt sa vie privée, jetant en pâture au public une image propre à nourrir l'hystérie collective entretenue autour du terrorisme. A peine remise en liberté, quatre jours plus tard, Katharina. dont la vie est irrémédiablement saccagée, va tuer le journaliste et se constituer prisonnière afin, dit-elle, de rejoindre "son cher Ludwig". Oui, Heinrich Böll, à travers ce récit, règle ses comptes avec une certaine presse qui s'était acharnée sur lui peu auparavant, à la suite de ses prises de position dans l`affaire d`Andreas Baader et Ulrike Meinhof (les fondateurs et les principaux membres les plus connus de la "Faction de l'Armée rouge" (RAF) ouest-allemande qui, tout au long de 1970 et 1971, a fait la une des journaux via de nombreux raids bancaires et batailles de rue avec la police qui ont coûté la vie aux deux camps), une affaire qui ébranla toute l'opinion publique ouest-allemande. Mais, au-delà du pamphlet et du plaidoyer en faveur du respect des droits de l'individu - conforme à l'idéal humaniste de Böll qui traverse toute son œuvre, ce récit pose, par sa manière de raconter, toute la question des conditions de possibilité d'une écriture "authentique", s'appliquant à démonter toute la rhétorique de la presse à sensation, à mettre à jour tous ses procédés d'insinuation, de falsification, de manipulation.
".. Avant d'amorcer les ultimes manœuvres de déviation, dérivation, diversion, qu'il nous soit permis d'ouvrir ici une parenthèse qu'on pourrait qualifier de technique. Il se passe trop de choses dans cette histoire. Trop d'événements s'y bousculent qui nuisent au déroulement de l'action. Il est certes affligeant qu'une gouvernante d'intérieur abatte un journaliste et c'est donc une affaire qu'il faut tirer au clair ou du moins tenter d'expliquer. Mais que faire d'un avocat réputé qui à cause d'une gouvernante d'intérieur interrompt brusquement des vacances d'híver pourtant bien méritées ? Que faire d'un industriel (par ailleurs professeur et tête pensante d'un parti politique) qui, témoignant d'une sentimentalité plutôt niaise, contraint cette même gouvernante d'intérieur à accepter la clef de sa résidence secondaire dans l'espoir d'y recevoir sa visite (espoir déçu comme l'on sait) et qui n'est pas ennemi d'une certaine publicité, quoique à sens unique ?
Toutes choses et gens impossibles à accorder entre eux et qui ne cessent de troubler le cours du fleuve (ou le déroulement linéaire de l'action) parce qu'ils jouissent en quelque sorte de l'immunité. Que faire d'un commissaire de police qui demande sans cesse des écoutes et les obtient d'ailleurs? Bref, pour un chroniqueur tout est trop transparent pour au moment décisif ne l'être pourtant plus assez, car s'il peut en effet apprendre ceci ou cela (disons du procureur Hach ou de certains membres masculins et féminins de la police), rien en revanche, absolument rien de ce que lui confient ces gens ne saurait constituer la moindre preuve, en cela qu'aucun de leurs propos ne serait jamais confirmé ni même énoncé devant quelque tribunal que ce soit. Leurs confidences ne peuvent donc avoir ni force de témoignage ni valeur officielle quelconque. Prenons par exemple cette affaire de table d'écoute. L'interception des conversations téléphoniques est bien sûr de nature à faciliter l'enquête, mais du seul fait qu'elle est opérée par une autorité autre que celle chargée de l'enquête, son résultat ne peut être utilisé ni même seulement mentionné dans une procédure officielle.
Mais surtout : que se passe-t-il dans ce qu'il est convenu d'appeler le psychisme du préposé à la table d'écoute? Que pense un fonctionnaire intègre qui ne fait que son devoir, qui le fait (alors qu'il y répugne peut-être) non pas tant par obligation d'obtempérer que par l'évidente nécessité de gagner son pain, que pense-t-il en entendant les propos qu'un individu habitant "La résidence du bord de l'eau" (pour simplifier, nous l'appellerons le satyre) tient au téléphone à une jeune femme aussi charmante et quasiment irréprochable que Katharina Blum? Ressent-il un trouble moral ou sexuel ou encore les deux? S'indigne-t-il, éprouve-t-il de la compassion ou à l'inverse un étrange plaisir à constater que des propositions murmurées d'une voix rauque et menaçante blessent jusqu'au fond de l'âme une jeune femme surnommée "la nonne" ? Bref, s'il se passe pas mal de choses sur le devant de la scène, il s'en passe bien davantage encore en coulisse. Que pense un inoffensif préposé à la table d'écoute -- qui y gagne péniblement son pain - quand, par exemple, un certain Lüding, dont le nom a déjà été incidemment mentionné ici, appelle la rédaction du JOURNAL et dicte : "P-as un mot sur S. mais feu vert pour B. " Oh, si l'on écoute les communications téléphoniques de Lüding, ce n'est certes pas pour le surveiller lui mais parce qu'il risque d'être la victime de maîtres chanteurs, de politiciens véreux ou autres. Et d'ailleurs comment un préposé intègre pourrait-il savoir que S. signifie Sträubleder et B. Blorna, donc que LE JOURNAL DU DIMANCHE ne publiera aucun commentaire sur S. mais s'étendra longuement sur le cas de B.?
Et pourtant -- mais qui pourrait le savoir ou même seulement le deviner? -- Lüding tient Blorna en très haute estime, car en d'innombrables occasions ce brillant avocat a prouvé son savoir-faire tant sur le plan national qu'international. Et c'est exactement ce qu'au début de ce récit nous voulions exprimer en faisant allusion à des "sources qui ne peuvent se rejoindre"... Or voici que Mme Lüding fait téléphoner par sa cuisinière à la secrétaire de son mari pour qu'elle demande à celui-ci ce qu'il aimerait avoir comme dessert dominical : crêpes aux pavots, fraises melba, glace à la fraise ou fraises à la crème ?
Sur quoi la secrétaire qui préférerait ne pas déranger son patron et prétend d'ailleurs connaître ses goûts, mais qui peut être aussi veut seulement faire des façons et enquiquiner la cuisinière, lui répond d'une voix pointue que M. Lüding préférerait certainement un pudding nappé de crème au caramel. La cuisinière qui bien entendu connaît aussi les goûts de son maître feint la surprise - la secrétaire ne serait-elle pas en train de confondre ses goûts personnels avec ceux de monsieur? Elle préfère qu'on le lui passe pour s'entendre directement avec lui sur le choix de son dessert dominical. Sur quoi, la secrétaire qui accompagne parfois M. Lüding en voyage d'affaires et prend alors ses repas avec lui dans quelque palace ou hôtel international, affirme que quand elle déjeune avec lui, son patron choisit toujours comme dessert du pudding nappé de crème au caramel. La cuisinière : mais dimanche M. Lüding ne sera justement pas en voyage avec elle, la secrétaire, et rien ne prouve d'ailleurs qu'il ne choisisse pas son dessert en fonction précisément de la compagnie en laquelle il se trouve. Et patati et patata! Les crêpes aux pavots font encore l'objet d'une longue discussion... et toute cette conversation est enregistrée sur bande magnétique aux frais du contribuable!
Peut-être le préposé à la table d'écoute qui doit naturellement s'appliquer à déceler s'il n'a pas affaire à des anarchistes employant un langage codé, autrement dit si crêpes aux pavots ne signifieraient pas par hasard grenades à main ou si la glace à la fraise ne serait pas une bombe au plastic, peut-être cet homme-là pense-t-il : ces gens ont vraiment bien des soucis, ou au contraire : si seulement j'avais ce genre de soucis ! (Car il se peut que sa fille vienne de déserter le toit paternel, que son fils fume du haschisch ou que son loyer ait encore augmenté.) Et tout ce bazar - l'enregistrement sur bande magnétique - uniquement parce qu'un jour Lüding a été menacé de plastiquage ! Et c'est ainsi qu'un fonctionnaire ou employé innocent apprend ce que sont les crêpes aux pavots, lui qui se contenterait d'en avoir une seule pour son repas principal.
Il se passe trop de choses sur le devant de la scène sans que nous sachions rien de ce qui se passe en coulisse. Si seulement nous pouvions écouter les bandes magnétiques pour apprendre enfin quelque chose! Par exemple le degré d'intimité - si intimité il y a - existant entre Mme Else Woltersheim et Konrad Beiters. Quel est en effet le sens du mot "ami" employé à propos de leurs relations? Comment Mme Woltersheim s'adresse-t-elle à Beiters, l'appelle-t-elle mon chéri, mon amour ou simplement Konrad ou Conny? Quelle sorte de tendresses verbales échangent-ils, si tant est qu'ils en échangent? Lui dont on sait qu'il possède une belle voix de baryton qui lui permettrait de faire une carrière sinon de soliste du moins de choriste, utilise-t-il le téléphone pour chanter des romances à Else Wîoltersheim? Des sérénades? Des ariettes? Des airs à la mode? Ou bien leur conversation téléphonique consiste-t-elle en une évocation plus ou moins obscène de privautés passées ou à venir?
On voudrait bien le savoir, d'autant que la plupart des gens, faute de pouvoir compter avec certitude sur une liaison télépathique, préfèrent user d'un moyen infiniment plus sûr : le téléphone. Les autorités supérieures n'ont-elles pas conscience de ce qu'elles exigent psychiquement de leurs fonctionnaires et employés? Supposons qu'un homme trivial, momentanément suspect et donc branché sur la table d'écoute, téléphone à sa maîtresse non moins triviale que lui. Comme nous vivons dans un pays libre où chacun peut converser librement et ouvertement, fût-ce au téléphone, il nous est facile d'imaginer tout ce qui peut alors siffler aux oreilles de la personne - peu importe son sexe - peut-être vertueuse ou même puritaine qui enregistre ou écoute la bande magnétique. Est-ce justifiable? Un traitement psychiatrique est-il ensuite garanti à la victime? Qu'en pense le syndicat des Postes et Télécommunications? On s'occupe des industriels, des anarchistes, des directeurs, employés et pilleurs de banque, mais qui se soucie de notre corps national de la bande magnétique? Les Eglises n'ont-elles rien à dire là-dessus? La conférence épiscopale de Fulda ou le comité central des catholiques allemands sont-ils désormais incapables de la moindre initiative ? Et pourquoi le pape garde-t-il le silence? Personne ne se doute-t-il donc de ce que des oreilles innocentes sont contraintes d'entendre, depuis le pudding au caramel jusqu'à la pornographie la plus éhontée ? Nos jeunes gens sont conviés à embrasser la carrière de fonctionnaire... et à qui les livre-t-on? A des dévoyés du téléphone.
Voilà enfin un domaine où Eglises et syndicats pourraient utilement collaborer. On devrait pour le moins prévoir en compensation une sorte de programme éducatif destiné aux préposés à la table d'écoute. Cours d'histoire enregistré sur bande magnétique par exemple. Ça ne coûterait pas bien cher...."
(éditions du Seuil, trad. S. et G. De Lalène, 1975)

"Protection encombrante" (Fürsorgliche Belagerung, 1979)
Comment peut-on vivre quand on ne se sent pas en sécurité ? Et comment peut-on vivre quand cette sécurité implique que le moindre de vos faits et gestes soit épié, la moindre de vos conversations écoutée ? Toute intimité avec votre femme, toute spontanéité avec vos amis abolies ? C`est précisément cette expérience que va faire, à ses dépens, le directeur de journal Fritz Tolm. Parce qu'il a été propulsé à la tête d`un puissant syndicat patronal, sa vie est désormais menacée. Aussi verra-t-il, en un jour, s`abattre sur lui et sur ses proches un dispositif complexe de sécurité chargé de veiller à leur protection. Mais quand donc la protection cesse-t-elle d`être protection pour devenir surveillance, voire inquisition ? C`est ce que Heinrich Böll nous dévoile avec une ironie inimitables dans ce tableau de la société ouest-allemande des années 70, qui s`est dégradée sous l'effet de la violence et de la peur.
"Kurz vor Ende der Tagung, vor der Wahl, noch während der letzten, entscheidenden Sitzung, war die Angst plötzlich weg. An ihre Stelle war Neugierde getreten. Die unvermeidlichen Interviews gab er schon in Heiterkeit, überrascht, wie leicht ihm das Vokabularium zuwuchs: Wachstum, Aufschwung, Versöhnung, Tarifautonomie, Harmonisierung der Interessen, Rückblick, Ausblick, Anknüpfung an die Gemeinsamkeiten des Starts, wobei er diskret Autobiographisches einstreuen konnte, seine Rolle beim Aufbau einer demokratischen Presse, die Vorteile und Gefahren der Konzentration, die unschätzbare Rolle der Arbeiterschaft, auch der Gewerkschaften andeuten konnte; Kampf nicht gegen-, sondern miteinander. Manches, was er sagte, hatte ihm selbst sogar ziemlich glaubwürdig geklungen, obwohl Rolfs messerscharfe Analysen und Kortschedes düstere Voraussagen, bei aller Gegensätzlichkeit der Ansatzpunkte, ihm immer wahrscheinlicher erschienen..."
"Peu avant la fin de la conférence, avant le vote, lors de la dernière séance décisive, la peur l'avait soudainement quitté. Elle avait été remplacée par la curiosité. Au moment où il affronta les inévitables interviews, il était de bonne humeur, surpris de la facilité avec laquelle il débitait les formules : croissance, expansion, conciliation, autonomie tarifaire, corrélation des intérêts, regard vers le passé, regard vers l'avenir, le terrain commun des débuts — ce qui lui permettait de parsemer quelques détails autobiographiques discrets, son rôle dans le développement d'une presse démocratique — les avantages et les dangers de la taille, le rôle inestimable tant de la main-d'œuvre que des syndicats, luttant non pas en confrontation mais côte à côte. Une grande partie de ce qu'il disait avait en fait paru assez convaincant même à ses propres oreilles, bien que les analyses incisives de Rolf et les prédictions pessimistes de Kortschede commencent à acquérir de plus en plus de crédibilité malgré les prémisses fondamentalement différentes sur lesquelles elles reposaient. Il avait pris plaisir à tisser des allusions à l'histoire, voire à l'art, aux cathédrales et à Menzel, à Bismarck et à Van Gogh, dont l'énergie sociale (ou peut-être même socialiste naissante) et le zèle missionnaire avaient trouvé leur exutoire dans l'art ; Bismarck et Van Gogh comme contemporains : de brèves observations réfléchies sur ce thème ajoutaient de la couleur aux déclarations purement économiques qu'on attendait de lui. Il avait pu retrouver une élégance apparemment improvisée qui, plus de quarante ans plus tôt, s'était avérée si utile dans le séminaire de Truckler et qu'il avait ensuite pu exploiter lors de nombreuses conférences de rédaction, mais qu'il n'avait jusqu'à présent jamais réussi à sortir en public.
Ce qu'il disait, en improvisant, sortait presque automatiquement, préfabriqué, lui permettant de penser à autre chose, de déterminer à quel moment sa peur l'avait soudain quitté : très probablement au moment où il avait pris conscience de l'inévitabilité de son élection. Cela le propulserait dans une position où sa peur aurait dû s'intensifier, et — c'est ce qu'il pensait tout en accordant encore une interview — l'instinct lui avait dit que la meilleure solution était de n'avoir aucune peur plutôt que davantage. Aucune peur, seulement de la curiosité ; la peur qui l'avait accablé pendant des mois, la peur pour sa vie, pour la vie de Käthe, pour celles de Sabine et de Kit, avait disparu. Bien sûr, ils l'auraient, probablement même le tueraient, et il ne restait plus que le suspense de se demander : qui, et comment ? Et ce qu'il ressentait pour Sabine s'était transformé de peur en inquiétude. Il avait des raisons de s'inquiéter pour l'enfant.
Ces derniers mois, sa peur s'était presque entièrement concentrée sur des questions techniques, des mesures de sécurité. L'inquiétude avait été supplantée ; ce n'était désormais plus la peur de quelque chose, mais la peur pour : pour Sabine, et pour Herbert, pour les folies de Käthe, et le moins de tous — ce qui le surprenait — pour Rolf. La dévotion religieuse extrême de Sabine l'avait toujours troublé, il avait aussi éprouvé de l'envie, et ce Fischer, son gendre, dont la puérilité les avait tous trompés — mais pas lui, même Käthe l'admettait, pas lui — n'était pas le bon partenaire pour elle. La rouerie avec laquelle il utilisait Sabine et leur enfant à ses propres fins aurait dû leur ouvrir les yeux à tous. Quant à Käthe, un administrateur aurait simplement dû être nommé pour s'occuper de son argent : elle donnait à tout le monde sans rien se refuser à elle-même, et un jour — bientôt, le craignait-il — elle allait se casser la figure de façon terrible.
Tout cela traversait son esprit tandis qu'on lui tendait des microphones comme des grenades à main, tandis que les projecteurs éblouissants étaient braqués sur lui. Amplanger avait coordonné et minuté les interviews avec une grande précision, veillé à ce qu'il y ait de l'eau minérale et du café à disposition, gardé de l'eau de Cologne prête — tout cela circulait dans son esprit sur une double voie, et même les questions gênantes concernant sa famille ne parvenaient pas à le déconcerter. Tandis que "sur la voie arrière de ses pensées" il continuait à ruminer les soucis derrière sa peur technique, au premier plan il se demandait s'il était possible de parler de "sérénité inquiète", alors qu'on l'interrogeait sans égard pour ses sentiments sur Rolf, Veronica, Holger, et même Heinrich Beverloh (ne savaient-ils pas encore qu'il avait maintenant un deuxième petit-fils prénommé Holger ?). Il affichait une détresse sincère et profonde face au chemin choisi par Veronica, ne se laissait pas piéger pour se distancer de Rolf (bien qu'ils aient tous plus ou moins essayé de lui mettre les mots dans la bouche), ne niait pas les fautes de son fils, soulignait le fait que celui-ci avait payé sa dette, et admettait aussi son inquiétude sérieuse, profonde pour Holger (l'aîné, ils ne savaient manifestement encore rien de Holger le cadet).
Cette fonction à double voie, qu'on aurait aussi pu appeler schizophrénie induite par les médias, commençait à l'amuser : il était possible de débiter des réponses même à des questions délicates tout en pensant à Sabine, qui avait manifestement été choquée — probablement par Kohlschröder, comment autrement ? — et poursuivait désormais son culte de la Madone avec plus de ferveur, plus d'intensité que jamais. Ce qu'il trouvait difficile, tout en ayant l'air d'improviser dans les micros d'un ton saccadé entrecoupé de petits raclements de gorge discrets, c'était d'abandonner le rêve qu'il chérissait depuis si longtemps : Kit, petite fille ou jeune femme, dans le manoir, dans le parc, dans les couloirs, nourrissant les canards, dans l'orangerie — et il ne pouvait se résoudre à couper définitivement ce film — ce rêve, ce jeu qui, selon la prédiction dévastatrice de Kortschede, ne serait désormais jamais joué ; jamais Kit — même à dix ans — ne se promènerait dans le manoir, n'y vivrait, jamais.
En arrière-plan, la conférence se dispersait, les gens prenaient leurs derniers verres, les chauffeurs transportaient les valises dans la cour, les membres du conseil sirotaient les restes froids de leur café, applaudissant quand, à leur avis, il venait de conclure avec succès une interview importante. Entre deux interviews, son prédécesseur Pliefger tenait absolument à se précipiter vers lui. Avec sa condescendance habituelle (l'acier condescendant envers l'édition, rien de personnel, juste une question de branches d'industrie différentes) et une expression de surprise si grande qu'elle en était presque insultante (comme s'ils l'avaient vraiment pris pour un demeuré sénile), il dit, en lui secouant énergiquement la main : « Première classe, mon cher Tolm, vraiment remarquable, nous avons toutes les raisons de nous féliciter de votre élection. » Et Kliehm, le partisan de Zummerling, afficha une telle stupéfaction devant l'éloquence de Tolm que cela frisait vraiment l'insulte..."
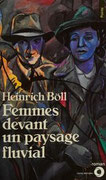
"Frauen vor Flusslandschaft" (Femmes devant un paysage fluvial : roman en forme de dialogues et de monologues)
1985 (dernier roman publié du vivant de Böll, quelques mois avant son décès le 16 juillet 1985),
un roman expérimental et puissant, souvent considéré comme le testament littéraire et politique de Böll, plonge au cœur de l'élite politique et économique ouest-allemande des années 1970-1980 (les "années de plomb"). Il se présente comme une série de dialogues et de monologues, presque exclusivement parlés par des femmes – épouses, maîtresses, secrétaires, filles – gravitant autour de trois hommes puissants et corrompus : un politicien (Jochen), un industriel (Robert) et un syndicaliste véreux (Willi). Le "paysage fluvial" (le Rhin) sert de toile de fond immobile et indifférente à leurs conversations, qui tournent autour des secrets, des scandales, des trahisons, des meurtres dissimulés, de l'argent sale et du poids écrasant du passé nazi que ces hommes cherchent à enterrer. L'action dramatique est absente, remplacée par la révélation progressive, à travers les paroles souvent triviales, allusives ou mensongères des femmes, de l'étendue de la corruption morale et matérielle qui ronge cette société.
C'est une charge violente contre la collusion entre le pouvoir politique (tous partis confondus), l'argent (l'industrie) et les syndicats gangrenés dans l'Allemagne d'après-guerre. Böll dénonce la continuité des élites malgré la défaite nazie, la corruption généralisée, la violence d'État (évoquée), et l'amnésie collective.
Le Rhin, paysage fluvial majestueux et éternel, contraste violemment avec la bassesse et la corruption des conversations. Il symbolise l'indifférence de la nature et de l'histoire face aux turpitudes humaines, mais aussi peut-être une forme d'espoir ténu ou de jugement muet.
Absence de héros, omniprésence du mal : Il n'y a pas de personnage positif. Tous sont compromis à des degrés divers. L'atmosphère est étouffante, marquée par la culpabilité refoulée (héritage nazi), la peur, la lâcheté et la déshumanisation engendrées par le pouvoir et l'argent.
Chapitre 1 - Terrasse couverte et spacieuse d’une villa de grands bourgeois du début du siècle entre Bonn et Bad Godesberg, par une matinée de fin d’été. Vue sur l'autre rive du fleuve où l'on aperçoit de grandes villas derrière cette végétation typique des bords du Rhin, faite de bosquets et de buissons. La table du petit déjeuner est dressée pour deux personnes. Erika Wubler en peignoir, le journal a portée de main, est en train de lire quelques feuilles manuscrites, quand Katharina fait son entrée avec le café. Elle pose la cafetière sur la table.
ERIKA WUBLER lève les yeux : Merci. Je ne prendrai pas d’oeuf. Que fait mon mari? Est-il levé?
KATHARINA RICHTER : Il est dans la baignoire et boit son café. Monsieur... votre mari m’a demandé de sortir votre tailleur gris et de lui donner un coup de fer... Il dit aussi que votre collier de corail irait très bien avec.
ERIKA WUBLER rit : Certes, il a du goût et ce n’est rien de le dire. Si jamais vous avez besoin d’un conseil, je veux dire, d’ordre vestimentaire... (Et, comme Katharina veut se retirer :) Un instant s’il vous plait. Ne sortez pas l’ensemble ; aujourd’hui, je ne m’habillerai pas.
KATHARINA RICHTER, d’une voix hésitante: La grand- messe à la cathédrale. Je veux dire, la cérémonie à la mémoire d’Erftler-Blum...
ERIKA replie les feuilles manuscrites : Je n'irai pas à la grand-messe. N’en parlez pas à mon mari. (Elle pose les feuilles :) Je viens de lire votre dossier. Je ne devrais pas l'avoir entre les mains, mais je me le suis procuré... J’aime à connaitre ceux qui m’entourent. Vous comprenez bien, j'espére, que, si vous travaillez chez nous, vous devrez subir les vérifications des gens de la Sûreté.
KATHARINA : Naturellement. Dans cette maison où...
(Elle s’interrompt.)
ERIKA : Où circulent tant de gens et où il se dit tant de choses. Savez-vous que les gens de la Sûreté nous ont déconseillé de vous engager ?
KATHARINA : Oui. Je m’en doute. Je... (Elle hésite.) Je voudrais vous remercier de m’avoir engagée malgré tout. Au nom de Karl aussi. D’ailleurs, c’est bien à lui que je dois d’être ici, non?
ERIKA la regarde de plus près : Oui, en effet. Mais grâce à d’autres aussi — à mon mari par exemple.
KATHARINA : Et vous ?
ERIKA opine du chef : Oui, un peu. Je ne peux pas penser un seul instant que Karl aurait vécu pendant des années avec quelqu’un à qui je ne pourrais pas me fier. Du reste, (elle lui montre le dossier) moi je n’ai rien trouvé là-dedans qui puisse me rendre méfiante. Vous êtes serveuse de profession, vous avez travaillé comme femme de chambre dans des hôtels... vous avez suivi des cours du soir, passé votre bac, puis vous avez fait des études, et vous avez un enfant... de Karl, n’est-ce pas?
KATHARINA : Oui, de Karl. Il a quatre ans, et nous lui avons donné le prénom du père de Karl.
ERIKA rit : Oui, je l'ai lu, la. C’est démodé. Qui, de nos jours, appelle encore son enfant Heinrich. (Elle tapote le dossier du doigt.) Il y a bien sûr ces quelques manifestations auxquelles vous avez pris part...
KATHARINA : Et le vol que j’ai commis.
ERIKA, indifférente : Oui, j’ai vu. Vous estimiez que cet argent vous était dû. C’est peut-être d’ailleurs la pure vérité.
KATHARINA : Oui, en effet. II s’agissait d’heures supplémentaires. Ils ont essayé de me gruger.
ERIKA : A une certaine époque, moi aussi j’ai volé. Et chaque fois que j’en avais l’occasion. C’était pendant la guerre. J’avais été incorporée dans la Wehrmacht et on m'avait placée à un poste qui correspondait à ma formation de vendeuse de chaussures. Alors j’ai dérobé des chaussures, des bottes, toutes sortes d’articles en cuir. Je ne me suis jamais fait pincer, heureusement car ça aurait pu mal tourner : sabotage, vol des biens de l’armée. J’avais faim, comme d’ailleurs mon mari quand il venait en permission. Lui aussi, il a volé. (A voix basse, souriante :) Seulement ne le répétez pas. Même après la guerre j’ai volé, chez les Ricains au casino. Moi aussi j’estimais que cela m’était dû - des cigarettes et du chocolat -, pour mon mari, il était étudiant, il avait faim et il manquait de cigarettes. Mais ce n’est pas vraiment de ¢a qu’il s’agit : est-ce que vous écoutez aux portes ?
KATHARINA : Non, mais j’ai des oreilles pour entendre.
ERIKA : Et vous êtes bavarde ?
KATHARINA hésite, très embarrassée : Je n’ai aucun secret pour Karl... (Katharina secoue la tête. Erika la regarde, effrayée.) Non, ne vous en faites pas, il ne s’agit pas de choses politiques. C’est seulement qu’il vous est très attaché, à vous et à M. Wubler, et il veut tout simplement savoir comment vous allez.
ERIKA soupire : Et comment allons-nous ?
KATHARINA Sourit : Bien, je pense. Et, (elle montre le journal) il lit bien entendu ce qu’il y a dans le journal et nous en parlons, tout naturellement...."
«Tout dans ce roman est fiction, hormis le lieu où se déroule l'action », nous avertit Heinrich Böll. « Que le lieu ne se sente pas visé, il est innocent. » Le lieu, c’est Bonn aujourd’hui. Non pas comme le centre où se décide la politique du jour, mais sous l’angle intime : le réseau des relations humaines et des intrigues, derrière les coulisses de la représentation officielle. Mais c’est aussi du malaise, de la révolte de femmes, épouses ou compagnes de politiciens allemands, qu’il s’agit ici. C’est à travers leur vision des choses, leur évocation du passé que l’auteur nous décrit la vie d’un des grands partis au pouvoir et de ceux qui sont les véritables maitres du jeu politique, les banquiers, dont la puissance et l’argent amassés de facon criminelle sous le nazisme dominent encore l’Allemagne d’aujourd’hui.
".. Erika Wubler a soixante-deux ans, Eva Kreyl-Plint trente-six. Elisabeth Blaukramer (surnommée la premiére à Blaukramer ») en a cinquante-cinq ; elle est assez grande, blonde, elle n’est pas mal soignée, mais on a toujours plus ou moins l'impression qu’elle n’est jamais tout à fait « habillée », et c’est plus que de la simple négligence, il y a tantôt un bouton, tantôt une tirette qu’elle a oublié de fermer. Elle est plus corpulente que sa démarche ne le laisse supposer. Il peut se faire qu’elle enfile la chaussure gauche d’une paire, la droite d’une autre. Mme Dumpler, médecin, a la trentaine bien sonnée et passe plutôt inaperçue. Adelheid Kapspeter, du même âge qu’Eva Kreyl-Plint, s’habille délibérément comme une petite-bourgeoise. Quant à Katharina Richter, trente ans, elle est employée de maison, mais elle ne porte pas de tablier pour autant, et il émane d’elle une élégance difficile à définir et qui l’apparente à Eva Kreyl-Plint. Toutes deux pourraient être speakerines à la télévision. Trude, « la deuxième à Blaukramer », appartient a cette catégorie de femmes qui se méprennent sur leur jeunesse (ou qui se laissent berner par les flatteries de leur entourage) : elle a quarante-deux ans, mais s’habille comme une femme qui en aurait à peine trente. Elle succombe à toutes les modes, sans en laisser passer une seule ; et cela lui donne en tout état de cause une sorte de vulgarité qui n’en est pas vraiment une. Elle n’a jamais compris la différence entre seins a l’air et décolleté, et sa poitrine est de fait tellement plantureuse que cette exhibition mérite d’être désignée comme étant « déplacée ». La plus jeune de ces dames, Lore Schmitz, a vingt ans, elle s’habille mode mais avec discernement, et nullement punk, pas même dans sa coiffure. On pourrait la prendre pour une étudiante, une employée de banque, une vendeuse. Elle ne paraîtrait déplacée dans aucun environnement social ou professionnel, ni même dans ces soirées où I’on reçoit des dignitaires ecclésiastiques."
Ces femmes, ainsi que quelques autres, se refusent à cautionner par leur silence les menées crapuleuses de leurs compagnons. Car, à force de calomnies, de limogeages, de scandales, l'Etat glisse vers un pouvoir de plus en plus autoritaire. Leurs efforts réussiront-ils?
Dans son dernier roman achevé juste avant sa mort en 1985, la vision de Heinrich Boll est extrêmement pessimiste. Il n’y a pas d’avenir pour l’Allemagne tant que ses dirigeants se dévoreront entre eux, tant qu’ils manipuleront le passé, tant que la religion ne servira qu’a conforter la bonne conscience et les intérêts d’une élite financière.
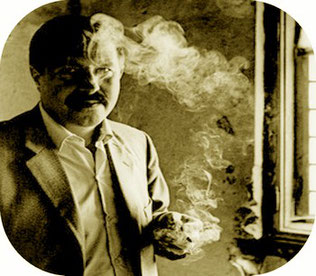
C’est en 1940 que Günter Grass tente son premier roman ; il a treize ans. À mesure qu’il mûrit après la Seconde Guerre mondiale, où il servit brièvement comme mitrailleur de char adolescent dans la Waffen-SS d’Hitler - un fait qu’il garderait secret pendant plus de six décennies -, il lutta pour composer de la poésie et des pièces de théâtre, mais fut intimidé par le critique Theodor Adorno qui disait que c’était « barbare d’écrire un poème après Auschwitz ». Comme d’autres jeunes écrivains politiquement actifs de sa génération, Grass pensait que la langue allemande elle-même avait été corrompue par le nazisme, et que l’écriture dans l’ombre de ses horreurs ne pouvait être rachetée que « en devenant mémoire et en empêchant le passé de prendre fin ». comme il l’expliquerait dans la conférence qu’il a donnée après avoir reçu le prix Nobel en 1999.
Puis Günter Grass fit une irruption fracassante sur la scène littéraire internationale avec la publication de "Die Blechtrommel" en 1959, traduit dans le monde entier, suivront plus de 18 autres romans, récits et essais. Il assume dans ce roman sa singulière responsabilité en faisant appel à la fantaisie et à l’invention sauvage pour prouver que le souvenir est un organisme insidieux à la fois familier et monstrueux, et beaucoup plus insaisissable que ne le suggèrent les faits réels de l’histoire...
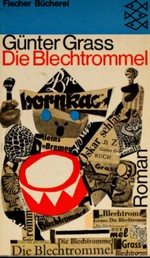
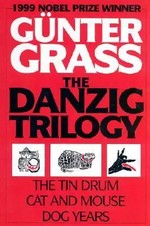
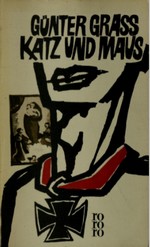
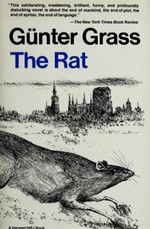
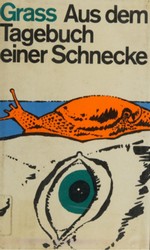
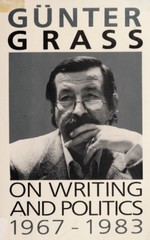
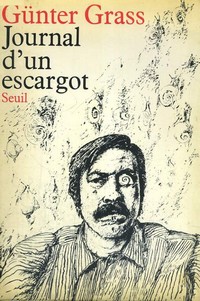
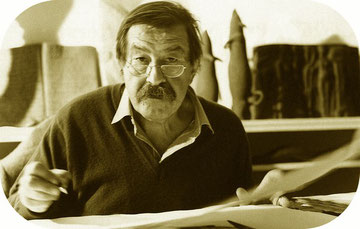
Günter Grass (1927-2015)
Günter Grass vient d’un endroit qui n’existe plus : la reconnaissance définitive de la frontière Oder-Neisse, qui implique pour moi la perte de mes racines, est l’un des tributs à payer pour les crimes que nous avons commis contre l’humanité, écrira-t-il en 1995. "De 10 à 14 ans, j'ai été enrôlé dans les Jeunesses hitlériennes à l'âge où l'on est très réceptif, très impressionnable. J'étais fasciné. J'ai marché, chanté, braillé... A 16 ans j'étais soldat, puis à 17, blessé et fait prisonnier par les Américains. C'était en 1945. Je fus épouvanté lorsque j'ai pris conscience de l'ampleur des crimes. Avec le recul du temps, en vieillissant, la honte de cette adolescence abusée s'accroît en moi, en même temps qu'augmente le sentiment d'incapacité à surmonter ce passé." Grand questionneur de l'histoire allemande, Günter Grass appartient à la génération sur laquelle pèse le poids du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale : se décrivant lui-même comme un Spätaufklärer ("un homme des Lumières attardé"), il entre prend, en intellectuel engagé, de mettre à jour cet enchevêtrement des racines du bien et du mal qui caractérise tant l'histoire allemande que son histoire personnelle. "L’homme qui vous parle n’est donc ni un antifasciste éprouvé ni un ancien national socialiste : plutôt le produit hasardeux d’une génération née à moitié trop tôt et infectée à moitié trop tard". Auteur d'une oeuvre prolifique, si ses thématiques peuvent sembler relativement réduites et son omniprésence médiatique souvent éructante quelque peu lassante, on lui reconnaît un style narratif d'une grande inventivité, dont un de ses traducteurs français, Bernard Lortholary, porte témoignage : "sa langue est d’une richesse et d’une virtuosité incroyables. Elle est charnue, débordante, baroque, absolument admirable. Tout en restant accessible au grand public, contrairement à celle d’un Arno Schmidt. S’il fallait le comparer à un Français, ce serait Céline..."
Né à Dantzig de parents germano-polonais, Grass, après avoir été mobilisé à l'âge de 17 ans (1944), fut fait aussitôt prisonnier par les Américains ; libéré deux ans plus tard, il survécut d'abord comme ouvrier agricole puis comme mineur, devint étudiant en arts plastiques à Düsseldorf chez Karl Hartung, et tenta de gagner sa vie comme sculpteur. Entré au Groupe 47 (1955), il débuta en littérature avec des poèmes et des pièces de théâtre. C'est son premier roman, "le Tambour" (1959), qui le révéla au grand public ; cette œuvre allégorique, picaresque, nourrie des souvenirs de sa ville natale, allait constituer le premier volet d'une trilogie poursuivie avec "le Chat et la Souris" (1961, et "les Années de chien" (1963). Cynique et provocante, son œuvre, écrite dans une langue exubérante, truffée de grossièretés lyriques et de métaphores, attaque avec efficacité les incohérences et les mensonges du monde moderne : "Une rencontre en Westphalie" (1979), invite les intellectuels allemands à redécouvrir leur identité dans le foisonnement culturel de l'époque baroque. Il poursuit avec des romans qui témoignent de son engagement dans les mouvements pacifistes et écologistes, "les Enfants par la tête" (1980), où il met en scène un couple d'enseignants contestataires obnubilés par la famine du tiers monde. En 2006, il crée la polémique en avouant dans "Pelures d'oignons" avoir été enrôlé dans une unité SS à la fin de la guerre.
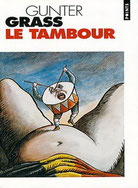
Le Tambour (Die Blechtrommel, 1959)
L’époque : 1900-1954 ; la nation : l’Allemagne des bords de la Baltique ; le héros : un nain, qui sous les apparences de l’enfance a la maturité d’un adulte. En tapant sur son tambour, Oscar Matzerath bat le rappel de ses souvenirs, ceux de sa famille et de son pays. Ainsi voit-on grouiller un univers grotesque et mystérieux dont la logique n’est pas de ce monde, mais qui éclaire le monde et les hommes mieux que le cerveau humain. Dans un registre torrentiel, Grass réussit un portrait de l’époque, à travers 50 ans d’histoire européenne que l’on peut considérer comme le document littéraire de la langue allemande à la fois le plus insolite et le plus audacieux depuis la guerre...
"La jupe en cloche
D’accord : je suis pensionnaire d’une maison de santé. Mon infirmier m’observe, me tient à l’œil ; car il y a dans la porte un judas, et l’œil de mon infirmier est de ce brun qui ne peut me radiographier car j’ai, moi, les yeux bleus.
Donc mon gardien ne saurait être mon ennemi. Je lui ai porté quelque affection ; quand l’espion embusqué derrière la porte entre dans ma chambre, je lui raconte des fragments de ma vie, pour qu’il me comprenne en dépit du judas. Le brave homme semble goûter mes récits, car à peine lui ai-je fait avaler une couleuvre que, pour se faire connaître à son tour, il me montre sa dernière création de ficelle nouée. Qu’il soit un artiste, c’est à voir. Une exposition de ses œuvres serait cependant bien accueillie de la presse : voire, elle attirerait quelques acheteurs. Il noue de vulgaires ficelles qu’il ramasse, après la visite, dans les chambres de ses patients et qu’il démêle ; il en fait des avortons cartilagineux complexes, les plonge dans le plâtre, les laisse se solidifier et les larde d’aiguilles à tricoter pour les fixer à de petits socles de bois.
Il caresse fréquemment l’idée de colorier ses œuvres. Je m’efforce de l’en dissuader ; je le renvoie pour comparaison à mon lit métallique laqué blanc et je le prie de s’imaginer ce lit tout repeinturluré. Horrifié, il joint au-dessus de sa tête ses mains d’infirmier, tente d’imposer à son visage inerte l’expression de toutes les épouvantes, puis il renonce à ses projets en couleurs.
Ainsi mon lit de métal est un terme de comparaison. Pour moi, il est même davantage : mon lit, c’est l’objectif enfin atteint, mon réconfort, et ce pourrait être ma religion si la direction de l’établissement y admettait quelques retouches : je voudrais en surélever la grille, pour fuir tout contact.
Une fois par semaine, le jour de visite trouble le calme où je vis derrière les barreaux de métal blanc. Alors viennent ceux qui veulent me sauver, ceux que ça amuse de m’aimer, qui ont besoin de moi pour s’estimer, s’honorer, se connaître eux-mêmes. Qu’ils sont aveugles, nerveux, rustres ! Ils grattent avec leurs ongles en pince la grille laquée de mon lit, gribouillent au stylo à bille ou au crayon d’aniline sur le vernis d’indécents bonshommes longilignes. Mon avocat trébuche à tout coup, lorsque son barrissement fait s’effondrer la chambre et qu’il coiffe de son chapeau de nylon le montant gauche du pied de mon lit. Tant qu’il reste là – et Dieu sait si les avocats sont verbeux – cet acte de violence m’ôte mon équilibre et ma sérénité.
Après avoir déposé leurs cadeaux sur le guéridon tendu de toile cirée blanche placé sous l’aquarelle aux anémones, et m’avoir détaillé les tentatives de sauvetage qu’ils sont en train ou sur le point d’exécuter, histoire de m’inculquer à moi, objet de leurs infatigables manœuvres, le niveau élevé de leur dévouement, ils reprennent goût à leur propre existence et me quittent. Vient alors mon infirmier ; il aère, puis il ramasse les ficelles des paquets. Souvent, après avoir aéré, il trouve encore le temps, assis près de mon lit, débrouillant les ficelles, de diffuser si longtemps du silence que je finis par identifier Bruno et le silence.
Bruno Münsterberg – trêve de plaisanterie : c’est le nom de mon infirmier – acheta pour mon compte cinq cents feuilles de papier à écrire. Bruno, qui est célibataire, sans enfants, originaire du Sauerland, se rendra une fois encore, si la provision était insuffisante, à la petite papeterie qui vend aussi des jouets, et me procurera la place nécessaire à l’exercice exact, je l’espère, de ma mémoire. Jamais je n’aurais pu demander ce service à mes visiteurs, à mon avocat par exemple, ou à Klepp. Une affection inquiète, attentive aurait à coup sûr interdit à mes amis d’apporter un objet aussi dangereux que du papier vierge et de l’abandonner aux sécrétions verbales de mon esprit.
Quand je dis à Bruno : « Ah ! Bruno, voudrais-tu m’acheter cinq cents feuilles de papier vierge ? » Bruno, regardant le plafond et y braquant un index, répondit : « Du papier blanc comme ça, monsieur Oscar ? »
Le mot vierge m’avait plu, et je priai Bruno de dire aussi comme ça dans le magasin. Quand il reparut avec le paquet en fin d’après-midi, je vis qu’il était sourdement agité par des pensées. Plusieurs fois, longuement, il regarda ce plafond où il allait chercher toutes ses inspirations et, un peu plus tard, il émit : « Vous m’avez recommandé le mot qu’il fallait. J’ai demandé du papier vierge, et la vendeuse a rougi violemment avant de m’apporter ma commande. »
La crainte d’une conversation prolongée roulant sur les vendeuses de papeterie me fit regretter d’avoir appelé vierge le papier ; j’observai donc le silence et attendis que Bruno ait quitté la chambre ; j’ouvris alors le paquet de cinq cents feuilles.
Quelque temps, pas trop longtemps, je soupesai et soulevai le paquet difficilement flexible. Je comptai dix feuillets, le reste fut logé dans la table de nuit ; je trouvai le stylo dans le tiroir à côté de l’album de photos : il est plein, j’ai de l’encre en réserve, je commence.
Comment ? On peut commencer une histoire par le milieu puis, d’une démarche hardie, embrouiller le début et la fin. On peut adopter le genre moderne, effacer les époques et les distances et proclamer ensuite, ou laisser proclamer qu’on a résolu enfin le problème espace-temps. On peut aussi déclarer d’emblée que de nos jours il est impossible d’écrire un roman puis, à son propre insu si j’ose dire, en pondre un bien épais afin de se donner l’air d’être le dernier des romanciers possibles. Je me suis également laissé dire qu’il est bon et décent de postuler d’abord : il n’y a plus de héros de roman parce qu’il n’y a plus d’individualistes, parce que l’individualité se perd, parce que l’homme est seul, que tout homme est pareillement seul, privé de la solitude individuelle, et forme une masse solitaire anonyme et sans héros. Après tout, ce n’est pas impossible. Mais en ce qui nous concerne, moi Oscar, et mon infirmier Bruno, je veux l’affirmer sans ambages : nous sommes tous deux des héros, des héros tout différents, lui derrière le judas, moi devant ; et quand il ouvre la porte, ça y est : malgré notre amitié et notre solitude, il ne reste plus de nous qu’une masse anonyme et sans héros.
Je commencerai longtemps avant moi ; car nul ne devrait décrire sa vie qu’il n’ait pris le temps, avant de dater sa propre existence, de commémorer une bonne moitié de ses grands-parents. Vous autres qui, loin de ma clinique psychiatrique, menez une vie confuse, vous tous, amis et visiteurs hebdomadaires qui ne soupçonnez pas le papier que je tiens en réserve, je vous présente la grand-mère maternelle d’Oscar.
Par un finissant après-midi d’octobre, ma grand-mère Anna Bronski était assise par terre dans ses jupes au bord d’un champ de pommes de terre. Si ç’avait été le matin, on aurait pu voir avec quelle adresse grand-mère, de son râteau, ramenait en jolis tas les fanes flétries. À midi, elle mangea une tartine de saindoux sucrée à la mélasse, puis elle donna au champ le dernier coup de pioche. Enfin voici qu’elle était assise par terre dans ses jupes entre deux paniers presque pleins. Devant les semelles de ses bottes, lesquelles épousaient un plan vertical et se rapprochaient à la pointe, brûlait avec des soubresauts asthmatiques un feu de fanes qui répandait sur le sol insensiblement déclive une fumée plate et circonspecte. On était en quatre-vingt-dix-neuf. Elle se trouvait en plein pays kachoube près de Bissau, mais plutôt du côté de la briqueterie. Elle était assise par terre non loin de Ramkau, derrière Viereck, en direction de la route de Brenntau, entre Dirschau et Karthaus, ayant derrière son dos la sombre forêt de Goldkrug et, armée d’une baguette de coudrier carbonisée à son extrémité pointue, elle poussait des pommes de terre sous la cendre chaude.
Si je viens de faire spécialement allusion à la jupe de ma grand-mère, si j’ai dit avec une clarté suffisante, j’espère : « Elle était assise par terre dans ses jupes » – si, ma foi, j’intitule ce chapitre « La jupe en cloche », c’est parce que je sais ce que je dois à ce vêtement. Ma grand-mère ne portait pas une seule jupe, elle en portait quatre l’une sur l’autre. Non qu’elle ait porté une jupe et trois jupons ; elle portait quatre jupes de dessus, chacune des jupes portant l’autre ; quant à elle, elle portait les jupes selon un système modifiant chaque jour la superposition des jupes. Celle qui était hier sur le dessus se trouvait aujourd’hui un étage en dessous ; la seconde jupe devenait la troisième. La ci-devant troisième jupe venait à même la peau. La jupe qui était hier au contact de ma grand-mère laissait aujourd’hui voir son motif, c’est-à-dire pas de motif du tout : les jupes de ma grand-mère Anna Bronski étaient vouées à une même et identique nuance pomme de terre. Il faut croire que cette nuance lui allait au teint.
Outre cette tonalité, les jupes de ma grand-mère se distinguaient par l’extravagante ampleur du tissu. Elles s’arrondissaient en cloche, se gonflaient au souffle du vent, retombaient quand il en avait assez, claquaient à son passage, et toutes quatre se déployaient à l’avant de ma grand-mère quand elle avait le vent en poupe. Pour s’asseoir, elle ramassait ses jupes autour d’elle..." (traduction Seuil)
Ce premier volet de la "trilogie de Dantzig", complété bientôt par "Le Chat et la Souris" (Katz und Maus, 1961) et "Les Années de chien" (1963). valut à son auteur d`acquérir, du jour au lendemain, une renommée internationale. Voici une autobiographie déjà dévoyée en ce sens où le héros-narrateur, au lieu de plaider sa cause, s'ingénie à afficher une singularité impudente et tapageuse : le nommé Oscar Matzerath retrace sa vie du jour de sa naissance jusqu`à son internement dans un asile d`aliénés. Deux niveaux narratifs à partir de cette situation, vont se chevaucher avant de coïncider finalement : le temps du récit, - Oscar feuillette son album de souvenirs -. et celui de l`écriture, sous forme de journal, correspondant au quotidien de l'internement entre 1952 et 1954, à la veille de ses trente ans. Günter Grass lui-même dit de son roman qu'il s`inscrit "dans une relation ironique et distanciée à l`égard de la tradition allemande du roman de formation". Oscar est bien une sorte d'anti-Wilhelm Meister : voici un prétendu héros qui non seulement, au terme de son itinéraire à travers le siècle, choisit de vivre retranché derrière les barreaux de son lit, mais encore qui, littéralement, n`a pas grandi - il a délibérément arrêté sa croissance à l'âge de trois ans en se précipitant dans un escalier; et, à l'envers de sa monstruosité physique, lui est prêtée la propriété fantastique d'avoir atteint dés le stade embryonnaire, une pleine maturité intellectuelle. Il sera ainsi le nabot lucide, celui qui va regarder les autres "par en dessous", sans rien apprendre du monde.
Sa relation aux autres tient tout entière dans le jeu de tambour "enfantin" dont il est virtuose, et qu`il accompagne parfois de la démonstration du pouvoir "vitricide" de son cri : c'est sa manière à lui de parler, d'accompagner, parfois de scander le bruit du monde, de rappeler, de se rappeler qu`il existe et, en définitive, d'écrire. C'est a travers cette autobiographie singulière que sont évoquées, sur le tambour de la mémoire, trente années de l'histoire de l'Allemagne : la montée du nazisme, l'installation de la dictature, la guerre, la débâcle. les débuts de la reconstruction.
".... Le logement était bien situé. Par toutes les lignes de tramway qui partent de la gare de Bilk vers Benrath et Wersten, on pouvait commodément atteindre les hôpitaux municipaux sans avoir à prendre une correspondance.
M. Matzerath resta là d’août quarante-cinq à mai quarante-six. Depuis plus d’une heure, il me parle de plusieurs infirmières à la fois. Elles s’appellent Monique, Helmtrude, Walburga, Ilse et Gertrude. Il se rappelle une masse de ragots d’hôpital et attribue une importance exagérée aux petits à-côtés de la profession et au costume d’infirmière. Il n’a pas un mot pour la nourriture d’hôpital, qui était misérable à cette époque, ni pour les salles mal chauffées. Ce ne sont qu’infirmières, histoires d’infirmières, milieu infirmières. On se disait, on se chuchotait, il paraissait que, sœur Ilse avait dit à l’infirmière-chef, alors l’infirmière-chef avait osé contrôler pendant le repas de midi les logements des élèves infirmières ; on avait volé quelque chose ; une infirmière de Dortmund – Gertrude, à ce qu’il dit – était soupçonnée à tort. Et les histoires avec les jeunes médecins ; tout ce qu’ils voulaient avoir des infirmières, c’étaient des tickets de cigarettes ; cela, il me le narre en détail. Il trouve digne de relation l’enquête provoquée par l’avortement d’une laborantine, pas d’une infirmière, laquelle s’y était prise seule ou bien avec l’aide d’un médecin assistant. Je ne comprends pas mon patient qui dilapide son esprit en des banalités pareilles.
M. Matzerath me prie maintenant de le décrire. Je suis bien content de déférer à ce désir et d’escamoter en partie les histoires qu’il traîne en longueur et drape de paroles sentencieuses sous prétexte qu’elles roulent sur des infirmières.
Mon patient mesure un mètre vingt et un centimètres. Il porte sa tête, qui serait trop grosse pour un homme normal, entre les épaules sur un cou littéralement rabougri. Le regard est luisant, intelligent, mobile ; souvent il se voile d’un rêve bleu. Ses cheveux châtain foncé, bien fournis, sont légèrement ondulés. Il aime à mettre en évidence ses bras qui sont robustes en comparaison de son corps, et ses mains qui, dit-il, sont belles.
Quand M. Oscar joue du tambour, ce que la direction de l’établissement lui permet chaque jour trois à quatre heures au plus, on dirait que ses doigts deviennent indépendants et appartiennent à un autre corps qui serait mieux proportionné. M. Matzerath s’est colossalement enrichi grâce aux disques, et il y gagne encore aujourd’hui. Des gens intéressants viennent le voir aux jours de visite. Avant son procès, c’est-à-dire avant qu’il ait été placé ici, je connaissais son nom, car M. Oscar Matzerath est un artiste en vue. Personnellement, je crois qu’il est innocent et je me demande s’il restera chez nous ou bien s’il sortira et se produira avec autant de succès qu’auparavant. Voilà que je dois le mesurer, bien que je l’aie déjà fait il y a deux jours…"
Chaque épisode repose sur l'imbrication grotesque du vilain gnome dans les "grands événements" : Oscar qui se pose en témoin, puis en acteur scatologique dans le ménage à trois que forme, dans la petite épicerie familiale de Dantzig, sa mère Agnès avec son mari Alfred Matzerath, originaire de Rhénanie, et son cousin polonais Jan Bronski; qui observe "derrière la tribune", et éventuellement perturbe de ses roulements de tambour intempestifs les premières manifestations nazies ; qui pousse perfidement à la mort "l'un de ses deux pères présomptifs", Bronski, lors du siège du bureau de poste de la ville; qui s`engage dans une troupe de lilliputiens pour une tournée sur le front de l`Atlantique; qui, revenu à Dantzig au moment de l'avancée des troupes russes, fait s'étouffer Matzerath en le contraignant à avaler son insigne nazi, etc. Et chaque épisode est charrié par le flot d'une verve truculent et gaillarde, haute en couleur...

"Le Chat et la souris" (Katz und Maus : eine Novelle, 1961)
Nous étions tous le chat, et la souris était en nous - En 150 pages, Grass résume les mécanismes qui firent de l’Allemagne un piège, fétichisation de la virilité, religion détournée au service de la mort, adolescence corrompue par l’idéologie. De la culpabilité comme héritage empoisonné ...
Avec "Le Chat et la souris", volume central de la trilogie de Dantzig (Le Tambour, Les Années de chien), Grass né dans cette ville, tente de saisir précisément son passé et de comprendre quel y avait été l'impact des nazis. Personnage central et insaisissable, Joachim Mahlke, qui rêve de devenir clown, se transforme en héros de guerre. Sa vie est une satire de l'obsession des nazis pour le culte du héros. Son désir de devenir clown naît de son envie de jouer devant les autres, d'être admiré, ce qui permet à Günter Grass d'explorer les contradictions que l'on trouve chez bon nombre de ceux qui ont été érigés en héros durant l'ère nazie.
"… et un jour que Mahlke savait déjà nager, nous étions couchés dans l’herbe à côté du terrain de thèque. J’aurais dû aller chez le dentiste, mais pas moyen, j’étais trop difficile à remplacer comme batteur. Ma dent me taraudait. Un chat traversa le terrain en diagonale et on ne lui lança pas de pierres. Quelques-uns mâchaient ou tortillaient des brins d’herbe. Le chat appartenait au gardien du stade et était noir. Hotten Sonntag frottait sa batte avec une chaussette de laine. Ma dent s’imposait. Le tournoi durait depuis deux heures. Nous avions encaissé et attendions le match-retour. Jeune, ce chat, mais pas un petit chat. Sur le stade, on se marquait des buts au handball pour les deux camps. Ma dent se répétait. Sur la piste de cendrée, des sprinters travaillaient leur départ ou étaient nerveux. Le chat faisait des détours. Devant le ciel, un trimoteur bruyant rampait avec lenteur, mais ma dent faisait encore plus de bruit. Le chat noir du gardien, derrière les brins d’herbe, montrait une bavette blanche. Mahlke dormait. Entre les Cimetières réunis et l’École technique, le crématoire fonctionnait par vent d’est. Mallenbrandt, le prof, siffla : changement d’atelier, balle au prisonnier. Le chat s’entraînait. Mahlke dormait ou s’en donnait l’air. À côté de lui, j’avais mal aux dents. Le chat se rapprochait en faisant son footing. La pomme d’Adam de Mahlke était remarquable ; grande, toujours en mouvement, jetant une ombre portée. Entre moi et Mahlke, le chat noir du gardien du stade se tassait pour bondir. Nous formions un triangle. Ma dent s’était tue, n’insistait pas : car la pomme d’Adam de Mahlke devint pour le chat une souris. Le chat était si jeune, la pomme si mobile… en tout cas le chat sauta à la gorge de Mahlke ; ou bien quelqu’un d’entre nous prit le chat et le mit au cou de Mahlke ; ou bien ce fut moi, mal aux dents ou pas, qui pris le chat, lui montrai la souris de Mahlke : et Joachim Mahlke cria, mais il n’en eut que des égratignures insignifiantes.
Quant à moi qui mis ta souris sous le nez du chat, et de tous les chats, il faut que j’écrive à présent. Même si nous étions tous deux imaginaires, il le faudrait. Le type qui, pour raisons professionnelles, nous a inventés, m’oblige à reprendre en main sans arrêt ta pomme d’Adam, histoire de la reconduire sur les lieux qui la virent vaincre ou mourir ; or, donc je laisse primo ton tournevis sautiller sur ta thyroïde, puis je jette au vent de nord-est, par-dessus la tête de Mahlke, un peuple de mouettes éparses. Le temps qu’il fait ? Disons estival et beau fixe ; je suppose que cette épave était un ci-devant bateau de la classe Czaika, je donne à la Baltique la nuance de ce verre épais dont on fait les siphons puis, attendu que le lieu de l’action est au sud-est de la balise marquant l’entrée du chenal de Neufahrwasser, je fais couler encore de l’eau en rigoles sur la peau de Mahlke, grenue ici et râpeuse là ; ce n’était pas la peur, mais le frisson habituel qui suit un bain trop long : sa peau en perdait son satin.
De plus, aucun d’entre nous – nous étions accroupis, maigres, avec des bras d’araignée, les genoux écartés, sur les restes de la passerelle – n’avait demandé à Mahlke de retourner une fois encore dans la proue du dragueur de mines échoué ni dans la chambre des machines contiguë, située au milieu du navire, pour y démonter à l’aide de son tournevis quoi ? Quelque chose, une vis, une roue dentée de rien du tout, ou bien un truc idiot, une plaque de cuivre jaune, écrite serré, portant les indications de service de telle ou telle machine, en polonais et en anglais. Car l’endroit où nous étions accroupis en brochette, c’étaient les superstructures d’un ancien dragueur de mines polonais de la classe Czaika, lancé à Modlin, achevé à Gdynia, lequel s’était échoué l’année précédente au sud-est de la balise d’atterrage, hors du chenal par conséquent et sans gêner le trafic.
Depuis, la fiente de mouette y séchait sur la rouille. Par tous les temps, luisantes comme vaseline, une perle de verre en guise d’œil sur le côté, elles passaient en rase-motte, à portée de la main, par-dessus l’habitacle du compas, puis montaient en flèche confusément et, selon un plan indéchiffrable, éjectaient au passage leur excrétion glaireuse ; jamais elles ne mettaient dans la mer, mais toujours sur la rouille des superstructures. Les excrétions persistaient, durcies, informes, crayeuses, en petits grumeaux côte à côte, en petits tas. Et, quand nous étions sur le bateau, il y avait toujours des ongles d’orteils, de doigts, pour essayer de détacher la fiente. C’est pourquoi nous avions tous les ongles cassés, et pas – sauf Schilling, qui se les rongeait toujours et n’aurait jamais pu se gratter – parce que nous nous rongions les ongles. Seul Mahlke avait des ongles longs, jaunâtres à force d’avoir plongé, et il les conservait à leur longueur en évitant de les ronger comme de gratter la fiente de mouette. Il était aussi le seul qui ne mangeât point de fiente détachée tandis que nous, comme ça se présentait, nous mâchions de petits grumeaux craquants comme une poudre de coquillages et les crachions ensuite, écume visqueuse, par-dessus bord. Ça n’avait pas de goût, ou bien un goût de plâtre, ou bien de farine de poisson, ou bien de tout ce qu’on s’imaginait : de bonheur, de filles, de Bon Dieu. Winter, qui avait une bonne voix, ramenait sa science : « Savez-vous que les ténors mangent de la crotte de mouette tous les jours ? » Souvent les mouettes happaient au vol nos crachats calcaires et ne s’apercevaient sûrement de rien.
Quand, peu après le début de la guerre, Joachim Mahlke eut quatorze ans, il ne savait ni nager ni aller à bicyclette, n’avait rien de remarquable, pas même trace de la pomme d’Adam qui plus tard devait attirer le chat. Il était dispensé de gymnastique et de natation, parce qu’il avait en produisant des certificats prouvé qu’il était déficient. Avant même que Mahlke ait appris à monter à bicyclette – tableau : les oreilles écartées, écarlates, les genoux tordus sur le côté, pistonnant de haut en bas en haut, grotesque – il s’inscrivit pendant la saison d’hiver à la piscine couverte de la Ville-Basse pour apprendre à nager ; mais il ne fut d’abord admis qu’à nager à sec avec les gamins de huit à dix ans. L’été suivant, il en était encore au petit bain. Le maître-nageur des bains de Brösen – une silhouette classique de maître-nageur, le corps en bouée, de maigres jambes sans un poil, sous le sémaphore garni de fanions – dut lui faire recommencer les mouvements dans le sable, puis le prendre à la corde. Mais, comme chaque après-midi nous lui filions sous le nez et racontions au retour les prodiges du dragueur de mines échoué, il fut pris d’un élan formidable et, en deux semaines, il sut nager.
Avec gravité et application, il évoluait entre l’estacade, le grand plongeoir et les bains, voulant acquérir quelque endurance à la nage ; puis il se mit à travailler la plongée sur le brise-lames de l’estacade ; d’abord il remonta de simples moules de la Baltique, puis alla chercher une bouteille de bière remplie de sable qu’il jetait assez loin au large. Mahlke réussit probablement vite à remonter la bouteille à tout coup ; en effet, lorsqu’il commença plus tard à plonger avec nous sur l’épave, il n’était plus un débutant.
Il mendia l’autorisation de venir avec nous à la nage. Nous allions justement, un groupe de six ou sept, mettre le cap sur notre objectif quotidien et nous procédions à des pré-ablutions circonstanciées dans le rectangle peu profond du bain des familles ; voilà Mahlke, sur la passerelle du bain Messieurs : « Emmenez-moi. J’y arriverai sûrement. »
Il avait pendu à son cou un tournevis ; ça faisait diversion à son gaviot saillant.
« Bon ! » Mahlke vint avec nous, prit la tête entre le premier et le second banc de sable et nous ne nous donnâmes pas mal de le rattraper : « Ça lui passera. »
Quand Mahlke nageait la brasse, le tournevis dansait nettement, car l’objet avait un manche de bois, entre ses omoplates. Quand Mahlke nageait sur le dos, le manche de bois bringuebalait sur sa poitrine, mais ne cachait jamais complètement le maudit cartilage qu’il avait entre la mâchoire inférieure et les clavicules, qui faisait saillie comme une nageoire dorsale et laissait derrière lui un sillage.
Et alors Mahlke nous montra ce qu’il savait faire..."
Cette novella (genre classique allemand) audacieuse, centrée sur le corps comme champ de bataille symbolique, fit scandale à sa parution (Grass fut défendu par Heinrich Böll) pour son traitement cru de l’adolescence (les jeux des adolescents, baignades, bizutages, sont déjà imprégnés de violence fascistes) et de la culpabilité allemande. Publié en pleine vague de procès contre d’anciens nazis (Eichmann en 1961), le livre explore la violence latente de l’Allemagne ordinaire sous le IIIe Reich. Grass y radicalise sa critique de l’héroïsme perverti, initiée dans "Le Tambour".
Dans le Dantzig des années 1940, des adolescents naviguent entre érotisme naissant et militarisation fascisante. Le récit, mené par Pilenz (narrateur complexe, mi-témoin mi-complice, et incarnant la lâcheté collective), suit Joachim Mahlke, lycéen marginalisé à cause de sa pomme d’Adam hypertrophiée ("la souris"). Obsédé par la rédemption et le désir d’être remarqué, Mahlke accumule les exploits (plongées périlleuses, vols de médailles religieuses) avant de s’engager dans la Wehrmacht pour gagner la Croix de fer – ultime tentative de faire taire la "souris" qui le désigne comme victime.
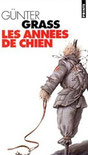
"Les Années de chien" (Hundejahre, 1965)
"Il était une fois... un chien. Il s'appelait Perkun et appartenait à un compagnon meunier de Lituanie qui avait trouvé du travail à l'embouchure de la Vistule. Perkun survécut et engendra Senta. Senta engendra Harras. Harras couvrit la chienne Thekla qui engendra Prinz. Et Prinz, offert pour son anniversaire au Führer et Chancelier du Reich, parut aux actualités. Quand trois hommes, deux femmes, et une lignée de chiens survivent à une avant-guerre, une guerre et une après-guerre, la chronique de leurs expériences prend une allure d'épopée. " - Considéré comme son roman le plus ambitieux et expérimental, il explore l’histoire allemande de 1917 aux années 1960 à travers une polyphonie déroutante et symbolique...
"... SIXIÈME ÉQUIPE DU MATIN
Il y a bien longtemps — Brauxel compte sur ses doigts — lorsque le monde était dans la troisième année de guerre, Paulo resté cadavre en Masurie, que Lorchen vagabondait avec le chien, mais que le meunier Matern continuait à coltiner légalement des sacs parce qu’il avait l’oreille dure des deux côtés, par un jour ensoleillé, comme on devait célébrer un baptême — le gamin lanceur de couteau des équipes précédentes reçut en guise d’avant-train le prénom de Walter — la grand-mère Matern était clouée dans son fauteuil, roulait des yeux, bredouillait et salivait et pourtant n’arrivait pas à émettre un mot cohérent.
Elle était dans la chambre du haut, et parcourue d’ombres frénétiques. Elle jetait un éclair, se fondait dans une demi- obscurité, se trouvait assise en pleine lumière, puis dans le noir.
De même des pièces d'ameublement, le dessus du bonheur-du-jour, le couvercle en ronde-bosse du bahut et le velours rouge, inutilisé depuis neuf ans, du prie-Dieu en bois sculpté s’effaçaient, montraient des profils, s’obscurcissaient, massifs : poussière clignotante, clair-obscur sans poussière sur la grand-mère et sur ses meubles. Sa coiffe et la coupe en verre bleu étaient sur le bonheur-du-jour. Les manches effrangées de la camisole, le bois du plancher, astiqué à mort, où la tortue mobile, grande comme la main, que lui avait donnée le valet Paul, passait d’un coin à l’autre, accrochait des lumières et salade le motif en demi-cercle de son petit bec. Et toutes les feuilles de salade éparses dans la chambre du haut, avec leurs ornements en bec de tortue, paraissaient frappées d'une vive lumière ; car dehors, derrière la maison, le moulin Matern travaillait par vent de huit mètres-seconde, moulait du blé en farine avec ses quatre ailes qui masquaient le soleil quatre fois toutes les trois secondes et demie.
Au même moment où les démons de la lumière et des ténèbres jouaient à cache-cache dans la chambre de la grand-mère, une voiture menait l'enfant sur la route, traversait Pasewark et Junkeracker, en direction de Steegen où avait lieu le baptême; les tournesols le long de la clôture limitant le potager Matern du côté de la route devenaient de plus en plus grands, s’adoraient l’un l’autre et se voyaient sans interruption magnifiés par le même soleil qu'éteignait quatre fois en trois secondes et demie la voilure du moulin à vent; car le moulin
n'avait pas pris place entre le soleil et les soleils, seulement — encore n'était-ce que le matin — entre la grand-mère immobile et un soleil qui, dans le Werder, ne luisait pas toujours, mais souvent.
Depuis combien de temps la la grand-mère était-elle immobilisée ?
Neuf ans dans la chambre du haut.
Depuis combien de temps derrière les asters, les fleurs de givre, les vesces ou les volubilis ?
Neuf ans durant ombre et lumière, ombre et lumière, à côté du moulin à vent.
Qui l'avait clouée à sa chaise de façon si durable ?
C'était sa belle-fille Ernestine, née Stange, qui lui avait infligé cela.
Comment cela put-il se passer ?
Cette protestante de Junkeracker avait commencé refouler de la cuisine Tilde Matern qui en ce temps-là n'était pas grand-mère, mais plutôt robuste et forte en gueule, puis elle s'était mise au large dans la salle et désormais ce fut elle qui frotta les vitres pour le jour du Saint-Sacrement. Quand Stine expulsa sa belle-mère des étables, pour la première fois on en vint aux mains parmi les poules qui y perdirent des plumes : les deux femmes se tapèrent dessus à coups d’auges à buvée.
Cela doit s'être passé, suppute Brauxel, en l'an 1905..."
Grass montre comment le nazisme s’enracine dans la banalité provinciale : jeux d’enfants, rivalités de classe, antisémitisme ordinaire. La métaphore des "années-chien" (1 année humaine c'est 7 années canines) souligne la déformation du temps historique sous la dictature.
Publié en pleine Vergangenheitsbewältigung (processus de "maîtrise du passé" nazi en RFA), le livre déconstruit les récits officiels de l’après-guerre. Grass y fusionne mythes germaniques, satire sociale et réflexion métaphysique sur le mal.
Le roman se déploie en trois parties racontées par trois narrateurs :
- La Perspective des Bourreaux : Eddi Amsel (artiste juif transformiste) et Walter Matern (son ami d’enfance devenu nazi), dans le Dantzig des années 1920-30.
- La Logique des Complices : Harry Liebenau (neveu d’un boucher nazi), témoin de la montée du IIIe Reich.
- L’Allemagne d’Après-Guerre : Matern, ancien SA rongé par la culpabilité, parcourt l’Allemagne de l’Ouest pour se venger… accompagné du chien Prince, héritier d’une lignée canine nazie.
Le fil conducteur est le destin croisé de deux hommes et d’un chien, métaphore de la dégénérescence morale.
Le duo Amsel/Matern incarne la déchirure de l’Allemagne : Amsel, survivant mutilé, crée des "épouvantails" grotesques à l’effigie des bourreaux (art comme exorcisme); et Matern, ancien tortionnaire, se croit justicier mais reste prisonnier de sa haine. . Aucun personnage n’est innocent, révélant la complicité collective...
Le chien Prince (descendant de Harras, chien d’un officier nazi dans Le Tambour) symbolise l’héritage empoisonné du IIIe Reich. Son pedigree "pur" parodie l’obsession raciale. Dans l’Allemagne des années 1950, les anciens nazis prospèrent ("dénazification de pacotille").
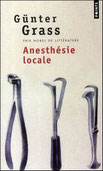
"Anesthésie locale" (Örtlich betäubt, 1971)
Publié en pleine crise des mouvements étudiants ouest-allemands (contestation de l’autorité, dénonciation du passé nazi, opposition à la guerre du Vietnam), le roman plonge dans l’effervescence politique des années 1970. Grass y interroge la violence révolutionnaire et les limites de l’engagement. Le narrateur, Eberhard Starusch (ancien personnage de "Les Années de chien"), professeur d’histoire désabusé, consulte son dentiste pour soigner une rage de dents. Sous anesthésie locale, il mêle monologue intérieur, souvenirs de guerre, et réflexions sur son élève Philipp Scherbaum – lycéen idéaliste qui projette d’immoler son chien en public pour protester contre l’indifférence face aux victimes de la guerre du Vietnam. Starusch tente de le dissuader, symbolisant le conflit entre radicalisme juvénile et réformisme adulte.
Grass dénonce autant l’extrémisme aveugle des jeunes que la lâcheté bourgeoise des adultes, refusant tant l’anesthésie politique que la fièvre révolutionnaire. Scherbaum incarne la pureté moralisatrice de la jeunesse, prête à la violence sacrificielle (immoler son chien). Starusch, ancien rebelle devenu sceptique, défend l’action réformiste, -"Le changement par les petites pas" -, un alter ego de Grass : engagé mais anti-dogmatique, tiraillé entre idéalisme et pragmatisme ...
Le mal de dents de Starusch symbolise la douleur refoulée de l’histoire allemande (guerre, culpabilité). Et l’anesthésie locale représente les moyens d’étouffer la conscience politique (conformisme, compromis). Nous avons des dents pourries, mais des plombages en or ... (allégorie de la corruption sous l’apparence de la prospérité).
Quadragénaire tourmenté, Eberhardt Starusch est professeur d'allemand et d'histoire dans un lycée berlinois. Souffrant des dents, il passe de Longues heures chez le dentiste: allongé face à l'écran de télévision, il invente ses propres émissions et un dialogue fictif avec le praticien. Il s'évade dans les souvenirs de l'après-guerre et dresse le bilan d'une génération désabusée ...
"J’ai raconté ça à mon dentiste. La bouche ouverte et face à l’écran dépoli qui, muet comme moi, faisait défiler de la réclame : Haarspray Wüstenrot, Lave plus blanc… Hélas, et le congélateur où, entre les rognons de veau et le lait, ma fiancée mise en dépôt lançait des bulles : « Ne t’en mêle pas. Ne t’en mêle pas… »
(Sainte Apollonie, priez pour moi !) À mes élèves des deux sexes, je dis : « Tâchez d’être indulgents. Je dois aller chez le dentiste. Ça peut traîner en longueur. Donc délai de grâce. »
Petits rires. Irrévérences moyennes. Scherbaum étala une érudition bouffonne : « Cher monsieur Starusch. Votre décision douloureuse nous rappelle, à nous qui sommes vos élèves compatissants, le martyre de sainte Apollonie. En l’an 250, sous le règne de l’empereur Decius, la bonne jeune fille fut brûlée à Alexandrie. Comme la plèbe lui avait préalablement arraché toutes les dents avec des pinces, elle est la sainte patronne de tous ceux qui ont mal aux dents et, par une entorse à la justice, des dentistes également Sur des fresques de Milan et de Spolète, sur les voûtes d’églises suédoises, mais aussi à Sterzing, à Gmünd et à Lubeck, on la voit figurée avec pince et molaire. Bien du plaisir et de la résignation. Nous autres, votre 12e a, nous invoquerons l’intercession de sainte Apollonie. »
La classe marmotta des bénédictions. Je dis merci pour ces insanités médiocrement spirituelles. Vero Lewand exigea sur le champ une compensation : mon vote en faveur du coin-fumoir réclamé depuis des mois à côté du hangar à vélos. « Vous n’êtes sûrement pas d’accord pour qu’on fume sans surveillance dans les cabinets. »
Je promis à la classe d’appuyer une autorisation limitée de fumer lors d’un prochain conseil des professeurs et face aux parents d’élèves si Scherbaum était disposé à assumer la rédaction en chef du journal scolaire, dans l’hypothèse où le comité lycéen de participation l’y inviterait : « Excusez la comparaison : mes dents et votre canard sont justiciables d’un traitement »
Mais Scherbaum déclina l’invitation : « Tant que la participation scolaire ne sera pas devenue une cogestion, j’f’rai rien. Une ineptie ne se réforme pas. Ou bien croyez-vous peut-être à l’ineptie réformée ? – Non, eh bien ! – Du reste, ce que j’ai dit de la sainte est exact. Vous pouvez vérifier au calendrier ecclésiastique. »
(Sainte Apollonie, priez pour moi !) Car avec les martyrs une invocation simple n’est pas enregistrée. Donc en fin d’après-midi je me mis en route, remettant à plus tard la troisième invocation, et c’est seulement sur le Hohenzollerndamm, quelques pas avant la plaque localisant le cabinet dentaire au second étage de l’immeuble locatif aux proportions bourgeoises, non, c’est seulement dans l’escalier, entre les ornements modern style aux formes vaginales qui, rangés en frise, gravissaient avec moi l’escalier, que faute de mieux je me résolus à lancer la troisième invocation : « Sainte Apollonie, priez pour moi… »
Irmgard Seifert me l’avait recommandé. Elle le disait réservé, précautionneux et cependant décidé. « Et rendez-vous compte, il a la télévision dans son cabinet. Au début, je ne voulais pas que ça marche pendant le traitement, mais maintenant je dois le reconnaître : en fait de diversion, c’est fabuleux. On est tout à fait ailleurs. Et même l’écran sans rien est suggestif, suggestif, je ne sais comment… »
Un dentiste a-t-il le droit de questionner un patient sur ses origines ?
« J’ai perdu mes dents de lait dans le faubourg portuaire de Neufahrwasser. Les gens de là-bas, dockers et ouvriers de Schichau, en tenaient pour le tabac à chiquer. Partout où ils allaient, ils mettaient leurs marques : des crachats goudronneux qui ne gelaient pas par temps froid.
— Oui, oui, dit-il en espadrilles de toile, mais c’est à peine si aujourd’hui nous avons encore affaire au tabac à chiquer. » Et déjà il en était ailleurs : à des troubles de l’articulation et à mon profil auquel, depuis la puberté, une mandibule prognathe attribue plus de force de volonté que n’aurait pu en empêcher un traitement dentaire précoce. (Mon ancienne fiancée comparait mon menton à une brouette ; à côté d’une caricature qu’avait fait circuler Vero Lewand, où mon menton se voyait attribuer une autre fonction : celle de plateau-chargeur.) Oui, oui. Je l’ai toujours su : j’ai une occlusion défectueuse, avec antépulsion mandibulaire. Je ne peux pas moudre. Le chien déchire. La vache moud. L’homme mâche en combinant les deux mouvements. Il me manque cette articulation normale. « Vous hachez », dit mon dentiste. Et j’étais déjà content qu’il ne dise pas : Vous déchirez comme un chien déchire. « C’est pourquoi nous ferons un bilan radiographique. Fermez tranquillement les yeux. Vous pouvez aussi regarder le téléviseur… »...
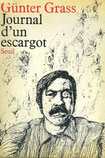
"Journal d'un escargot" (Aus dem Tagebuch einer Schnecke, 1974)
Publié après la défaite électorale de Willy Brandt (dont Grass était un ardent soutien), cette œuvre, moins célébrée que "Le Tambour", révèle l’essence de la pensée grassienne : un pessimisme actif qui croit au progrès par la résistance obstinée. Une clé pour comprendre son engagement d’écrivain-citoyen.
Grass relate son engagement politique pour le SPD (Parti social-démocrate) tout en racontant l’histoire de Hermann Ott, alias "Doubts" (Zweifel), un professeur juif qui se cache durant le nazisme dans une cave de Dantzig, nourri en secret par l’épicier Stomma. En parallèle, l’escargot, symbole de lenteur obstinée, commente la vanité des révolutions rapides et défend le progrès par la persévérance.
L’utopie ne doit pas être un rêve lointain, mais le ‘jour d’après’ que nous préparons pas à pas, la persévérance contre les fanatismes, la mémoire comme devoir fragmentaire (non monumentale), la littérature comme acte politique modeste mais tenace. Dans un contexte de radicalisation gauchiste (RAF), Grass légitime le réformisme pragmatique du SPD, - Le changement réel avance à la vitesse d’un escargot -, le livre devient un manifeste contre l’extrémisme, tant de droite que de gauche...
"Liebe Kinder, heute haben sie Gustav Heinemann zum Präsidenten gewählt. Zwar wollte ich auf Anhieb von Zweifel erzählen, der mit Vornamen Hermann und mit Nachnamen Ott hieß, aber Gustav Gustav geht vor. Es dauerte drei Wahlgänge lang, bis er gewählt war.
(Weil er zweimal Doktor ist, wird er von Hinterbänklern, die im Wirtshaus Rheinlust Wahlen gegen Bierrunden verwetten und sich Kanalarbeiter nennen, doppelt Gustav genannt.) Doch wenn ich genau rechne und jede Verzögerung - nicht nur die Panne beim ersten Auszählen - in mein Sudelbuch schreibe, dann wurde dieser Tag zwanzig Jahre lang vorbereitet, auch wenn er, Gustav Gustav, kaum ahnte, wofür man ihn garkochte und wie zäh in Deutschland nicht nur das Rindfleisch ist.
Der Ort: die Ostpreußenhalle am Funkturm. Draußen gestaffelte Absperrungen gegen Proteste der Außerparlamentarischen Opposition, APO genannt. Drinnen haben sich Christdemokraten und Neonazis zwinkernd als Kumpane erkannt: ihr Kandidat heißt Schröder. (Gustav Gustav, der die parlamentarische Hinterbank kennt und gerne mit juckendem Daumen Skat spielt, ging oft zu den Kanalarbeitern, ohne in ihrem Dunstkreis bierärschig zu werden.) Es riecht unbestimmt. Kugelschreiber in Lauerstellung. Gerüchte wollen wissen, wie viele Liberale käuflich seien. Gerüchte lesen die Stufenfolge der gegenwärtigen Berlinkrise aus blindlings geworfenen Salzstangen. In der Vorhalle fördert Zugluft Gerüchte um den Abgeordneten Gscheidle, den man mit Kopfverband zur Abstimmung rollt.
Das Fernsehen hält drauf. Vorahnungen schwellen scheu. Das nicht zu beeilende Aufrufen Abstimmen Auszählen: von Abelein bis Zoglmann… (La télévision braque ses caméras. Les pressentiments enflent timidement. L'appel des noms, le vote, le dépouillement – qu'on ne peut accélérer : d'Abelein à Zoglmann…)
Ich saß auf der Gästebank. (Nahbei zerknüllte Frau Heinemann ihr Taschentuch.) Als ich, wie immer, wenn was auf der Kippe steht, Sehschlitze machte, gelang es mir, die Halle zu räumen: auch die Bestuhlung zog ab ohne Murren.
Ich kann das, Kinder, mir deutlich was ausdenken.
Noch vor ihrem Auftritt, ihr Eigengeräusch: schaumiges Knistern. Dann sah ich sie unterwegs in der leeren Ostpreußenhalle. Ich versuchte, meinen Atem ihrer Eile anzupassen, mußte atemlos aufgeben.
Oder ähnliche Vorgänge auf Kriechsohlen: wenn sich Anna und ich unsere Ehe rückwirkend auszahlen.
Sie schob sich durchs Bild, war nie mit einem Blick zu fassen, blieb auch im Ausschnitt Teil eines Willens, der vor dem Willen zu weiterem Willen lag und durch Wille gedrängt, auf Breitwand den Raum dehnte.
Vier Kinder, selten alle auf einem Foto versammelt: gegensätzlich geratene Zwillinge, Franz und Raoul, elf - ein Mädchen, Laura in Hosen, acht - und Bruno, immer motorisiert, vier, der wider Erwarten als Dreijähriger nicht aufhören wollte zu wachsen.
Als die Schnecke, Fühler voraus, die Zielmarkierung ahnte, zögerte sie: sie wollte nicht ankommen, wollte unterwegs bleiben, wollte nicht siegen.
Ihr redet mit Anna Schweizerdeutsch - »Mer müend langsam prässiere« - und berlinert mit mir: »Was issen nu wieda los?«
Nur eine Nacktschnecke. (Nacktschnecke, métaphore centrale de Grass pour évoquer la lenteur obstinée du changement démocratique et sa propre approche politique)
Mein langwieriges Prinzip. Erst als ich ihr versprach, ein neues Ziel zu stecken, als ich ihr Zukunft als Fraß scheibenweis schnitt, schob sie sich über die gedachte Linie und verließ die Ostpreußenhalle, ohne den Beifall der sogleich wieder anwesenden Mehrheit, ohne das Schweigen der Minderheit abzuwarten. (Und das sind die Zahlen: Mit den 512 Stimmen der Sozialdemokraten und Freidemokraten gegen die 506 Stimmen der CDU CSU NPD hat am 5. März 1969, bei fünf Stimmenthaltungen, die Bundesversammlung Dr. Dr. Gustav W. Heinemann zum Bundespräsidenten gewählt.)
Seitdem rückt er unsere verrutschte Geschichte und deren Feiertage zurecht. (Als er am Vorabend zu uns in die Niedstraße kam, brachte er zwar Gelassenheit mit, zog aber trotzdem die Brieftasche, zeigte den Haß seiner Gegner: brüchig gewordene Zeitungsausschnitte: die alten Juckwunden.) Ohne Haus. Ich sagte es schon: Nur eine Nacktschnecke…
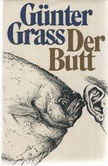
"Le Turbot" (Der Butt, 1977)
" Le lieu de l'action, c`est le présent ; le sujet est l`histoire de notre nourriture, de l`âge de pierre jusqu`à nos jours" : tel est. résumé par Grass lui-même, le projet de l'oeuvre. Divisé en "neuf mois" correspondant chacun à un chapitre. le temps de la narration est celui d'une gestation, très exactement compris entre la conception, au mois d'octobre 1973, et la naissance. à l'été suivant, d'Hélène, la propre fille de Grass, à laquelle est dédié le roman. A cet enfantement parallèle du livre et de l`enfant se mêle une généalogie culinaire, à travers neuf figures féminines venues chacune d`une certaine époque de l'histoire, de l'âge de pierre à nos jours en passant par les époques médiévale, baroque et révolutionnaire, industrielle, etc. Grass raconte à travers elles la "participation anonyme des femmes à l`histoire" : il s`agit pour lui "d`inventer des faits plus vrais que ceux qui sont soi-disant attestés par notre tradition", qui ne retient que les faits d'armes virils : l'introduction de la culture de la pomme de terre est plus importante que la guerre de Sept Ans!
"... Le turbot est répandu dans la Méditerranée, dans la mer du Nord jusqu'à la côte norvégienne et dans la Baltique, ma mer. Comme chez tous les poissons plats, son axe visuel est en biais par rapport à la bouche qu'il a oblique, ce qui lui donne ce regard philosophique et perfide à la fois, j'oserais dire ce regard radiographique : il louche pour gagner du temps. (Il paraît que le dieu attique Poséidon l'aurait utilisé comme agitateur dans sa lutte contre Héra, contre l'Athéna pélasge et autres enragées du matriarcat.)
Sa famille – tout ce qu'on appelle Butt – est appréciée des gourmets. Ava, au temps du néolithique tardif, faisait cuire doucement ses pareils dans des feuilles humides. Sur la fin de l'âge de bronze, Wigga le frottait de cendre blanche sur les deux faces et le posait du côté blanc aveugle sur de la cendre recouvrant un lit de braise. Après l'avoir retourné, elle passait le poisson au lait suivant la recette de l'âge de pierre en puisant à son sein toujours écumeux ou bien, à la nouvelle mode, à l'aide d'un lait de jument fermenté. Mestwina, qui déjà mettait à bouillir sur un gril de fer des marmites de terre à feu, faisait venir le poisson à petit feu avec de l'oseille ou de l'hydromel. Pour finir, elle saupoudrait de fenouil sauvage le poisson aux yeux blancs.
Lui, le seul et unique turbot parlant qui me travaillait depuis des siècles, connaissait toutes les recettes selon lesquelles les païens accommodaient ses semblables et, par la suite, les chrétiens devaient les servir comme poissons des jours maigres (pas seulement le vendredi). Comme par auto-distanciation, avec une ironie strabique, il savait célébrer son bon caractère gustatif : « Le monde est ainsi fait, mon fils, que le turbot est parmi les poissons nobles. Plus tard, quand vous autres hommes mineurs et abrutis depuis votre prime enfance vous détacherez enfin du sein maternel en battant monnaie, en datant l'histoire et en faisant prévaloir le patriarcat, je disais donc : quand après six mille années de tutelle féminine vous serez enfin émancipés, on cuira mes semblables, ainsi le turbot, de même la barbue, doucement au vin blanc avec des câpres, on les prendra en gelée, on les dépaysera délicieusement par des sauces avant de les servir sur une porcelaine de Saxe. On nous braisera, glacera, pochera, nappera, mettra en filets, ennoblira par la truffe, spiritualisera par le cognac et baptisera du nom de maréchaux, de ducs, de Princes de Galles, d'Hôtel Bristol. Campagnes, conquêtes, occupation ! L'Est fera du commerce avec l'Ouest. Le Sud enrichira le Nord. Je vous et me prédis les olives, une civilisation raffinée, la gastronomie, le citron ! » Mais on avait encore le temps, Ilsebill. (Tu vois combien il vous est difficile de faire revenir les hommes sur la tutelle absolue des pères.) Longtemps encore après Ava et ses cent onze fossettes et ses trois seins, les femmes régnèrent, mais plus difficilement. Nous autres hommes avions déjà léché le métal. Et le turbot nous tenait au courant. Il me suffisait d'appeler, voilà qu'arrivait la gazette nageuse. J'entendis parler de civilisations lointaines, des Sumériens et de la double hache minoenne labrys, de guerre où des hommes luttaient contre des hommes, parce que partout l'anhistorique gynécocratie était brisée et qu'enfin on avait le droit de mettre les dates.
Le Turbot m'assommait de conférences : De l'architecture mésopotamienne et du premier palais de Knossos. De la culture des céréales – escourgeon, orge, épeautre, mil – dans la région danubienne. De l'élevage en troupeaux d'animaux domestiques*– chèvre et mouton – dans l'Asie antérieure, et de la possibilité d'élever des troupeaux de rennes dans l'espace baltique. Du bâton à fouir et de la houe, de la charrue révolutionnaire.
Le Turbot concluait chacun de ses exposés par une conjuration : « Il est grand temps, mon fils ! Le néolithique, ainsi que nous appelons l'âge de pierre récent, est entré dans sa phase finale. Venue de Mésopotamie, par le delta du Nil et Hle de Crète, encouragée par la vigueur virile, la civilisation se répand. Là on voit des femmes travailler les champs et plus tard piler dans des mortiers le grain obtenu. Ainsi les famines ne sont plus irréparables. Non, porcs et bœufs se multiplient, élevés en troupeaux. Il y a toujours des provisions de réserve. On construit des habitats fixes. La horde et la grande famille s'articulent en tribus. Des rois-héros régnent. L'État jouxte l'État. Et les hommes sont en armes. Ils savent pourquoi ils se battent : pour leurs possessions héréditaires. Pourtant vous croupissez dans la promiscuité, ignorant ce qu'est engendrer. La mère s'accouple avec le fils. La sœur ignore que c'est son frère qui la transporte. Le père, sans se douter de rien, couvre la fille. Tout cela dans l'innocence ! Je sais ! Eh bien, vous restez pendus aux tétines. Vous n'avez jamais votre content. Enfants au sein à perpétuité. Mais ailleurs l'avenir a déjà planté ses drapeauxjalons. La nature ne veut plus être subie à la façon femelle mais virilement domptée. Tracer des canaux. Assécher les marais. Partager la terre, labourer, prendre possession. Engendrer son fils. Transmettre par héritage. Vous avez tété deux mille ans de trop, perdant deux mille ans à piétiner. Je vous conseille : Quittez le sein. Il faut vous sevrer. Mon fils, il faut enfin te sevrer ! »
C'était vite dit pour un turbot, trop simple. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il nous fallut encore un plein millénaire pour devenir virils au sens où l'entendait le flet. Mais alors nous devînmes des hommes comme dans les livres : capuchonnés de cuir, coiffés de casques, au regard corrosif. Des hommes dont l'œil mobile tâte l'horizon. Des hommes âpres à l'engendrement qui par la pensée érigeaient leurs zizis en arbres généalogiques, en torpilles, en fusées cosmiques. Des hommes à systèmes, rassemblés en confréries masculines. Des orateurs puissants, coupeurs de cheveux en quatre. Des découvreurs qui s'ignoraient. Des héros décidés à ne jamais, en aucun cas, mourir dans leur lit. Des hommes dont la bouche dure commande la liberté. Des hommes tenaces, vainqueurs d'eux-mêmes, constants, inflexibles, qui n'arrêtent pas de dire quand même, qui s'inventent des ennemis, se montent la tête, se guindent sur les grands machins, cherchent l'honneur pour l'honneur, des hommes de principe, qui en viennent au fait, se détachant d'eux-mêmes aux trumeaux de l'ironie, des hommes tragiques, K.O., montrant un au-delà pardessus leur objectif final.
Même le Turbot qui nous a conseillé cette évolution en concevait une frayeur croissante, et pour finir – c'était au temps de Napoléon – il se réfugia dans le conte de fées. Il ne donnait plus que de petits conseils. Puis il garda longuement le silence. Il y a peu de temps qu'on peut à nouveau lui parler ..."
Le fil conducteur du récit est la fable du turbot, d'après le conte romantique de Philipp Otto Runge, "Vom Fischer un syne Fru" (Le Pêcheur et sa femme), dont le romancier prétend reconstituer la version primitive : capturé à l`âge de pierre, le turbot promet au pêcheur, s'il le libère, de l'aider à s`évader de la tutelle du matriarcat; c`est lui qui est à l`origine de l` "hybris" virile qui a convaincu l'homme d'entrer de force dans I`histoire pour asseoir son pouvoir, plier le réel à un sens totalitaire, que ce soit en inventant Dieu, le progrès ou la révolution. Face à l'absurdité de la geste masculine, le livre de cuisine est le seul livre d'histoire authentique. Pour Grass, l'homme se définit moins comme un animal doué de raison que comme un "animal capable de cuisine".
La fin du roman reste ouverte : au début des années 1970 le turbot est de nouveau capturé mais cette fois par trois féministes qui, bien qu'il leur offre de défendre désormais la cause des femmes, ne le libèrent pas pour autant et réunissent un tribunal pour le juger. Est-ce-à-dire que s`ouvre une nouvelle ère qui ne répétera pas, au féminin cette fois, les mécomptes de l`hybris virile ? Avec "Le Turbot", commencé immédiatement après les élections de 1972 gagnées par les sociaux-démocrates avec un écart beaucoup trop flatteur "qui les a rendus négligents, fatigués et paresseux", Grass, qui ne leur a pas ménagé son soutien, retrouve enfin, "après tant d'années d`engagement politique, direct et quotidien",` le souffle épique et la verve rabelaisienne du "Tambour" et des "Années de chien". (Trad. Le Seuil).

"La Ratte" (Die Rättin, 1987)
Après "Le Turbot", Grass continue ici sa réflexion sur l'auto-destruction humaine, mais avec une tonalité encore plus sombre. La structure narrative de ce roman est un vrai casse-tête - entre le narrateur qui dialogue avec une ratte visionnaire, les contes déformés des frères Grimm, et les scènes post-apocalyptiques. En 1987, parler de la fin de l'humanité par sa propre faute était encore marginal ...
L’humanité congédiée, nous autres les rats prenons le relais - Le roman entrelace donc plusieurs récits autour d’une ratte mutante douée de parole, qui visite le narrateur (une version de Grass lui-même). Elle lui annonce la fin de l’humanité via une apocalypse nucléaire/écologique, et décrit un monde futur dominé par les rats. Parallèlement, Grass revisite des contes des frères Grimm (Blanche-Neige, le Joueur de flûte, etc.) dans un contexte post-apocalyptique, et intègre des réflexions sur l’histoire allemande, l’engagement politique et la menace environnementale.
En réécrivant les contes, Grass sape leur innocence. Blanche-Neige devient une exploiteuse capitaliste ; Hamelin (la ville du Joueur de flûte) sombre dans le militarisme. Cette critique culturelle révèle la permanence des travers humains : avidité, lâcheté, aveuglement. Le roman prolonge l’obsession de Grass pour la responsabilité allemande (notamment après la Shoah). La ratte, témoin cynique, rappelle que l’homme répète ses erreurs malgré les leçons de l’Histoire.
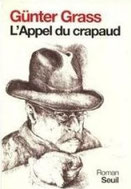
"L'Appel du crapaud" (Unkenrufe, 1992)
"Tout commence en 1989 à Danzig, le jour des Morts. Au marché aux fleurs l’Allemand croise la polonaise. Le veuf rencontre la veuve. Coup de foudre. Lui, Alexander, soixante-deux ans, historien de l’art, spécialiste des inscriptions funéraires, elle, Alexandra, cinquante-neuf ans, doreuse en restauration d’art baroque, s’aiment et conçoivent un généreux projet. Il s’agit de donner aux Allemands nés à Danzig et exilés depuis la guerre le droit au repos éternel en terre natale et de favoriser ainsi la réconciliation des deux nations. Une Société germano-polonaise des cimetières est fondée, un premier cimetière de la Réconciliation inauguré. Mais d’autres intérêts entrent en jeu. Aux cimetières s’ajoutent les hôtels, foyers d’anciens, centres de vacances, un hôpital, une maternité, et même un terrain de golf en pays kachoube. Tandis qu’un torrent de Deutschmarks se déverse sur la Pologne, nos amoureux consternés battent en retraite. Le crapaud sonneur, en été dans les bassées de la Vistule, lance un appel sur trois notes. Avertissement ? Prédiction d’une catastrophe ? Tout comme le crapaud sonneur, il se pourrait que Günter Grass, dans cette histoire d’amour mi-enjouée mi-mélancolique, nous mette en garde contre l’impérialisme économique de l’Allemagne réunifiée, à l’Est et ailleurs, avec cette ironie et cette verve satirique qui n’appartiennent qu’à lui." (Editions du Seuil)
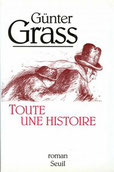
"Toute une histoire" (Ein weites Feld, 1997)
"Le narrateur, qui se présente comme un archiviste, relate les déambulations berlinoises et brandebourgeoises de Theo Wuttke avec son ami Hoftaller, ancien agent des services secrets de la Stasi, durant les évènements de l'unification allemande entre décembre 1989 et octobre 1991." Le roman se présentait comme celui de la "réunification" mais fut l'objet de très vives critiques, pour ses longueurs, pour sa complexité, et surtout pour sa condamnation implicite de l'arrogance de l'Allemagne de l'Ouest vis-à-vis d'une RDA fragilisée à l'excès.
"Berlin, de 1989 à 1991, au moment de la réunification, observée par un couple digne de Cervantès : le grand et maigre Fonty, le petit trapu Hoftaller. Le premier est né en 1919, a fait la guerre dans l’aviation de Goering comme journaliste correspondant de guerre, ensuite il a été instituteur, puis conférencier littéraire en RDA, enfin appariteur dans les ministères : un témoin. Mais il est aussi la réincarnation de Théodor Fontane, le grand romancier né un siècle plus tôt, dont il connaît par cœur les romans, les chroniques et la vie, et auquel il s’identifie jusque dans les détails de son existence privée. Hoftaller, son « vieux compagnon» qui l’espionne sans désemparer, est sans âge et aussi vieux que la police politique : il traquait déjà le jeune Marx, il a connu la révolution de 1848, l’unification de 1871, la république de Weimar, il a travaillé avec la Gestapo, avec la Stasi : toujours au service de l’ordre. Il « tient » Fonty-Fontane, dont le libéralisme gauchisant a été suspect à tous les régimes, et qui a quelques peccadilles à se reprocher. Ce vieux couple infernal de l’intellectuel et de l’espion permet une vision stéréoscopique de l’histoire, récente et moins récente ; tableau cocasse et effarant, mais aussi nuancé, poétique et profond. Avec sa verve prodigieuse, doublée d’une minutie acerbe, l’auteur du Tambour donne ici le livre monumental qu’on attendait sur le grand tournant de cette fin de siècle. Il a valu à Günter Grass un extraordinaire déchaînement de critiques haineuses. C’est qu’il ne s’agit pas seulement de la réunification allemande, mais de l’effondrement des « socialismes réels » et du triomphe mondial du capitalisme libéral. Toute une histoire ! Toute notre histoire évoquée par un romancier de génie." (Editions du Seuil)

"Mon siècle" (Mein Jahrhundert, 1999)
"Günter Grass revisite notre siècle finissant, en cent textes brefs évoquant chacun une année. Cette série de croquis ne prétend pas constituer une grande fresque ni retracer même sommairement l’Histoire, pourtant constamment présente. Grass choisit pour chaque année un événement petit ou grand, mais bien daté, et un narrateur différent qui, sur le moment ou longtemps après, l’évoque avec sa voix propre, dans sa perspective et son langage. Cette centaine de personnages des deux sexes, de tous âges et de toutes conditions sociales, constituent comme une petite « comédie humaine » où le romancier peut faire briller les innombrables facettes de son talent. Quelquefois, le narrateur n’est autre qu’un certain Günter Grass évoquant un souvenir personnel, mais il est seulement l’un des innombrables acteurs et spectateurs plus ou moins obscurs que ce siècle a brassés, secoués, écrasés. Tous ont un droit, de la part de l’auteur, au même chatoyant mélange de pitié et de hargne, d’humour et de satire, de truculence et de poésie, qui a fait de Grass l’un des écrivains du siècle.' (Editions du Seuil)

"D'une Allemagne à l'autre" (Unterwegs von Deutschland nach Deutschland, 2010)
"Le 1er janvier 1990, Günter Grass entreprend de tenir un journal, ce qu’il n’a pas fait depuis longtemps, et il le poursuit pendant treize mois : ceux au cours desquels s’opère la réunification des deux Allemagnes, qui est son principal souci, car les formes qu’elle prend l’inquiètent et le révoltent. Écrivant peu, cette année-là, l’auteur dessine, réfléchit, dialogue, jardine, cuisine, voyage d’une Allemagne à l’autre : entre RFA et RDA, mais aussi entre l’Allemagne d’hier et la nouvelle, avec des crochets vers son Gdansk natal et sa Cachoubie, vers le Danemark, le Portugal, vers Prague, et vers Paris où il a écrit jadis Le Tambour. Ce journal conserve tout son intérêt politique : la réunification allemande fut un petit laboratoire de la mondialisation. Mais c’est aussi un témoignage exceptionnel sur le travail de l’artiste graphiste, d’habitude éclipsé par l’écrivain, et sur la genèse de deux romans : L’Appel du crapaud, et surtout la grande fresque Toute une histoire, controversée en Allemagne mais souvent considérée comme un de ses chefs-d’œuvre." (Editions du Seuil)

"Pelures d'oignon" "Beim Häuten der Zwiebel, 2007)
"A quatre-vingts ans, Günter Grass se souvient. Métaphore du souvenir : l’oignon – notre passé, notre expérience, tout ce qui définit notre personnalité – dont on ôte les pelures une à une en cherchant en vain le cœur n’est autre que cette accumulation des strates plus ou moins denses, plus ou moins fiables. Le récité débute à Dantzig en 1939 avec l’entrée en guerre et la perte l’innocence. Il s’achève à Paris en 1959 avec la publication du Tambour et la consécration littéraire. Il décrit les épisodes les plus marquants d’une biographie et la genèse d’une œuvre : enfance dans un milieu étriqué, guerre d’un adolescent endoctriné, survie dans les ruines, affirmation d’une vocation, trois faims qui ponctuent ces années d’apprentissage : la nourriture, l’amour charnel, l’art." Et c'est dans cet ouvrage qu'il avoue avoir volontairement servi dans la Waffen-SS, secret qui «le hantait depuis toujours»: "Je m’étais porté volontaire, pas pour les Waffen-SS, mais pour les sous-marins, ce qui était tout aussi fou. Mais ils ne recrutaient plus. Les SS au contraire ont enrôlé tout ce qu’ils pouvaient durant ces mois de 1944-45"..." (Editions du Seuil)
"Les pelures sous la pelure
Que ce soit aujourd’hui ou il y a des années, la tentation reste grande de se déguiser en tierce personne : quand il avait à peu près douze ans, mais qu’il adorait encore s’asseoir sur les genoux de sa mère, quelque chose commença et finit. Mais est-il possible de préciser exactement ce qui commença, ce qui prit fin ? En ce qui me concerne, oui.
C’est mon enfance qui s’acheva dans un espace exigu quand la guerre, là où j’ai grandi, éclata en différents lieux à la fois. Elle commença, il n’était pas possible de ne pas l’entendre, avec le feu des batteries d’un bâtiment de ligne et le piqué d’avions de combat sur le faubourg portuaire de Neufahrwasser, auquel faisait face la Westerplatte, une base militaire polonaise, et aussi, plus loin, avec les tirs ciblés de deux blindés de reconnaissance dans la bataille qui se livrait à la Poste polonaise, dans la Vieille-Ville, annoncée tout près par notre poste de radio, le « Récepteur du Peuple », qui avait sa place sur le buffet du séjour : des mots d’airain proclamaient la fin de mes années d’enfance dans un logement du rez-de-chaussée qui faisait partie d’un immeuble de rapport à trois étages situé dans le Labesweg à Langfuhr.
Même l’heure voulut être inoubliable. De ce moment régna sur l’aérodrome de l’« État libre », près de la fabrique de chocolat Baltic, une activité qui n’était pas que civile. Vue par les lucarnes depuis le toit de l’immeuble de rapport, une fumée noirâtre montait du port franc, renouvelée par les assauts constants et un léger vent de nord-ouest.
Mais dès que je veux me souvenir du tonnerre lointain prodigué par l’artillerie du Schleswig-Holstein, qui avait été réformé en tant que vétéran de la bataille du Skagerrak1 et n’était plus capable que de servir de navire-école pour les cadets, me souvenir aussi des vagues du bruit d’avions que l’on appelait Stukas parce que, très haut au-dessus du champ de bataille, ils se renversaient latéralement et trouvaient leur cible en piqué (Sturzkampf) pour lâcher enfin leurs bombes, se forme la question : pourquoi donc faut-il rappeler l’enfance et sa fin si immuablement datée, alors que tout ce qui m’est advenu depuis mes premières dents et depuis les deuxièmes, en même temps que les débuts à l’école, les jeux de billes et les genoux égratignés, les tout premiers secrets de la confession et la détresse ultérieure de la foi, s’est depuis bien longtemps métamorphosé en une masse de feuillets accrochée depuis lors à un personnage qui, à peine couché sur le papier, ne voulut pas grandir, trucida de son chant le verre prévu pour tous les usages possibles, eut à portée de main deux baguettes de bois et grâce à son tambour de fer-blanc se fit un nom qui exista désormais, citable, entre les deux couvertures d’un livre et prétend être immortel dans je ne sais combien de langues ?
Pourquoi ? Parce qu’il faut ajouter une chose ou une autre. Parce que quelque chose pourrait manquer qui se signale trop bruyamment. Parce que quelqu’un à un moment quelconque est tombé dans le puits : mes trous qui ne trouvèrent que plus tard leur couvercle, ma croissance impossible à freiner, ma fréquentation, par la langue, d’objets perdus. Et cette raison encore qu’il faut donner : parce que je veux avoir le dernier mot.
Le souvenir aime le cache-cache des enfants. Il se planque. Il a un penchant pour les belles paroles et il enjolive, souvent sans nécessité. Il contredit la mémoire, qui fait la vétilleuse et se chamaille pour avoir raison.
Quand on le presse de questions, le souvenir ressemble à un oignon qui voudrait être pelé afin que soit dégagé ce qui, lettre après lettre, est là, lisible : rarement univoque, souvent dans une écriture à lire dans le miroir ou crypté d’une quelconque manière.
Sous la première peau, qui produit encore un crissement sec, se trouve la suivante, laquelle, à peine détachée, en libère une autre, humide, sous laquelle attendent et chuchotent la quatrième, la cinquième. Et chacune de celles qui viennent sur des mots trop longtemps évités, des signes tarabiscotés aussi, comme si quelque faiseur de mystères avait voulu depuis sa jeunesse, à l’époque où l’oignon ne faisait encore que germer, s’envelopper d’un chiffre.
Déjà une ambition s’éveille : il faut déchiffrer ces gribouillis, casser ce code. Déjà est réfuté ce qui, chaque fois, prétend s’en tenir à la vérité, car c’est souvent le mensonge ou sa petite sœur, la tricherie, qui fournit la part la plus solide du souvenir ; couché sur le papier, il a l’air crédible et se targue de détails qui doivent passer pour avoir la précision de la photographie : le toit de carton goudronné de la remise dans l’arrière-cour de notre immeuble de rapport, vibrant sous la chaleur de juillet, sentait, lorsqu’il n’y avait pas de vent, les bonbons au malt…
Le col lavable de mon institutrice, Mlle Spollenhauer, était en celluloïd et si serré que son cou en faisait des plis…
Le nœud dans les cheveux des filles le dimanche sur l’estacade de Zoppot, quand la clique de la police jouait des airs entraînants…
Mon premier cèpe…
Quand les élèves que nous étions avaient congé pour cause de grande chaleur…
Quand mes amygdales, une fois de plus, s’enflammaient…
Quand je ravalai des questions…
L’oignon a beaucoup de pelures. Il est au pluriel. À peine pelé, il se renouvelle. Haché, il fait pleurer. Ce n’est que quand on le pèle qu’il dit la vérité. Ce qui fut avant et après la fin de mon enfance, qui frappe à la porte avec des faits et s’est déroulé de manière plus funeste qu’on ne l’aurait voulu veut être raconté tantôt comme ceci, tantôt comme cela, et pousse à des histoires mensongères.
Au moment où, par un temps de fin d’été qui n’en finissait pas d’être beau, la guerre éclata à Dantzig et aux environs, je ramassai – à peine les défenseurs polonais de la Westerplatte eurent-ils capitulé, au bout de sept jours de résistance – dans le faubourg portuaire de Neufahrwasser, que l’on pouvait atteindre en peu de temps par le tramway en passant par Saspe et Brösen, une poignée d’éclats de bombes et d’obus que ce garçon qui apparemment était moi, pendant un laps de temps où la guerre ne semblait consister qu’en communiqués spéciaux à la TSF, échangea contre des timbres, des images colorées venues des paquets de cigarettes, des livres esquintés par la lecture aussi bien que tout neufs, parmi lesquels le voyage de Sven Hedin à travers le désert de Gobi, et je ne sais quoi encore.
Celui qui se souvient de manière imprécise s’approche cependant parfois plus de la vérité, d’une longueur d’allumette, même si ce doit être par des chemins détournés.
La plupart du temps, c’est à des objets que mon souvenir se frotte, s’écorche le genou, ou ce sont des objets qui me laissent dans la bouche le goût de la nausée : le poêle en faïence… Les tringles à battre les tapis dans les arrière-cours… Les cabinets à mi-étage… La valise au grenier… Un morceau d’ambre, gros comme un œuf de pigeon…
À celui qui a conservé tangibles l’épingle à cheveux de sa mère ou le mouchoir de son père noué aux quatre coins dans la chaleur de l’été, ou la valeur d’échange particulière d’éclats de bombes et d’obus aux dentelures différentes, viennent à l’esprit – ne fût-ce que comme échappatoire divertissante – des histoires où les choses se passent de façon plus réelle que dans la vie...."

Arno Schmidt (1914-1979)
Arno Schmidt est né à Hambourg et, en 1928, après le décès de son père, sa famille s’installe en Silésie. Il entame des études de commerce à Görlitz qui le mènent à travailler dans les bureaux d’une grande fabrique de vêtements, où il fait la rencontre d’Alice Murawski, avec qui il se mariera en 1937. En 1935, il fait parvenir des poèmes à Hermann Hesse et débute l'établissement d'une table de logarithmes de sept à dix chiffres d’une part, et l’écriture d’une biographie monumentale de Friedrich de La Motte-Fouqué d'autre part. Soldat en 1940, il se rend en 1945 aux troupes britanniques et devient interprète au camp de prisonniers de Munster. Il est libéré fin décembre et s'installe avec son épouse au Mühlenhof à Cordingen, une région de landes qui lui rappelle son enfance.
Il publie son premier texte en 1949, "Léviathan". Dès la publication au début des années cinquante de "Nobodaddy's Kinder", Ernst Jünger et Alfred Döblin se montrent enthousiastes. "Brand's Haide", "Schwarze Spiegel" et "Aus dem Leben eines Fauns" révèlent un écrivain de fort caractère à la recherche d'une expression nouvelle. En 1955, la parution de "Seelandschaft mit Pocahontas" avec Pocahontas lui vaut un procès pour blasphème et pornographie. L’année suivante il découvre les textes de James Joyce, qui seront une révélation pour lui. Schmidt souhaite trouver un mode narratif correspondant à la dispersion et à la discontinuité qui caractérisent selon lui la pensée de l'individu contemporain. Il se retire en 1958 dans un petit village pour se consacrer exclusivement à la littérature.
Totalement en marge, il a édifié une oeuvre démesurée, radicale et brillante, triviale et érudite dont l'aboutissement fut "Zettels Traum" en 1970, un livre énorme, chaotique, utilisant toutes les formes et techniques d'expression pour lequel il a élaboré pendant 10 ans un classement démentiel de 130000 fiches, met en scène quatre personnages qui discutent inlassablement de l'oeuvre d'Edgar Poë, revue et corrigée par celle de Freud.

Scènes de la vie d'un faune (Aus dem Leben eines Fauns, 1953)
"Être moi est une chose absolument insupportable !!", constate Heinrich Düring, personnage et narrateur des Scènes de la vie d'un faune, fonctionnaire à la sous-préfecture de Fallingbostel, dont nous suivons le destin de février 1939 jusqu'aux bombardements alliés de septembre 1944. Sa vie domestique est un désastre, ses enfants lui sont étrangers, sa femme l'a oublié. Il observe avec ironie et désespoir le triomphe éclatant de la bêtise nazie : "Je possède un vocabulaire plus vaste que celui de tous les membres du parti pris ensemble ; en outre, je possède two separate sides to my head, alors que les nazis n'ont qu'un hémisphère cérébral". Morceau d'anthologie, sa visite d'une exposition d'art officiel : "Les filles se tenaient droites dans l'urne de leurs costumes régionaux : autour du front épais de leur tête rustique, le barbouilleur leur avait enroulé l'anaconda blond d'une natte qui donnait envie de proposer de l'aspirine aux pauvres créatures (...) ; le fameux personnage populaire du dompteur de cheval emballé ne manquait pas à l'appel qui d'une seule main immobilise un cheval entier (moi qui ai servi dans l'hippomobile je sais exactement ce qu'il en est !)". Heureusement, il y a aussi Käthe dans la vie de Düring, nymphette plus plantureuse que l'idéal nabokovien, les "jupes pleines à bloc" et des "seins aux larges yeux". Ayant reçu mission de rassembler et d'inventorier les archives de la circonscription, Düring découvre l'histoire puis la cabane toujours debout, dissimulée dans la lande, d'un déserteur de l'armée napoléonienne, le faune du titre, qui, en 1813, vandalisa la contrée. Il en devient une sorte de double, moins violent mais tout aussi séditieux dans son rapport à l'Histoire qui se joue en ces années-là.

La république des savants (Die Gelehrtenrepublik, 1957)
Maître de l'ironie, Arno Schmidt, comme il avait stigmatisé la barbarie nazie dans "Scènes de la vie d'un faune", fustige la menace atomique dans "La République des savants". "Nous sommes en 2009. La vieille Europe a succombé sous les bombes atomiques. Elle avait eu auparavant la sagesse de mettre à l’abri sur une » île à hélices » ses savants, penseurs et artistes les plus notoires. Charles Henry Winer, un journaliste américain, est autorisé à visiter l’île. Mais il doit au préalable traverser une autre réserve, une zone dévastée par les radiations atomiques, où prolifèrent des êtres monstrueux, et isolée du monde par une gigantesque muraille. Grâce à une ravissante centauresse, Winer parvient jusqu’à la République des Savants. Il partagera les 50 heures qui lui sont allouées entre la zone neutre, la zone américaine et la zone russe. Ce qui nous vaut une cruelle galerie de portraits : vieilles gloires stériles, fonctionnaires de la culture réglementant la « création collective », agents secrets rivalisant de perfidie. Le visiteur découvre de prestigieux bâtiments : musées, salles de concert, bibliothèques… mais aussi cimetières, monuments aux morts et d'inquiétants laboratoires greffant des cerveaux d'artistes ou de savants reconnus sur des corps jeunes… Le climat de guerre froide est tourné en dérision et dans chaque partie de l'île, le guide touristique qui pilote Winer s'avère être un maître espion. La division de Berlin entre Est et Ouest a certainement influencé des passages de ce récit. Horrifié par les pratiques des uns et des autres (« métempsychose » des Russes, hibernation des Américains), Winer regagne avec soulagement le monde menacé et médiocre du commun des mortels."
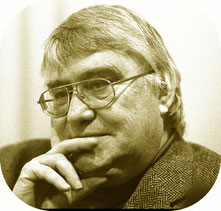
Peter Härtling (1933-2017)
Il s'est fait connaître par un triptyque romanesque centré sur une vision particulière de l'histoire et du temps (Niembsch ou l'Immobilité, 1964). Préoccupé par le problème de l'existence et de l'identité de l'homme au sein d'un monde collectiviste (Janek, portrait d'un souvenir, 1966), par son rôle au sein même de l'Histoire (Zwettl, 1973), auteur de biographies imaginaires (Hubert ou le Retour à Casablanca, 1978), Härtling soigne la composition et l'écriture, délaissant le maniérisme au profit de la précision. Poète, auteur dramatique, de romans et de livres pour la jeunesse (Grand-Mère, 1975), il s'est fait connaître par un triptyque romanesque centré sur une vision particulière de l'histoire et du temps : Niembsch ou l'Immobilité (1964), d'après la vie de Lenau, Ianek, portrait d'un souvenir (1966), la Fête de famille ou la Fin de l'histoire (1969). La biographie ne se constitue pas d'une addition de faits vérifiables, mais de souvenirs subjectifs, partiaux et divergents. Ce principe de récit sera repris, le plus récemment dans Hoffmann ou l'amour varié (2001).

Niembsch ou l'Immobilité (Niembsch oder Der Stillstand, 1964)
Ce second roman de Härtling contraste avec la production littéraire allemande de l`époque alors en pleine mode "documentaire" et qui traînait encore souvent sa mauvaise conscience face à l'Histoire. Il se conçoit non pas comme une biographie, mais ainsi que l'indique son sous-titre. comme "une suite musicale" portant sur le personnage du poète romantique Nikolaus Niembsch Edler von Strehlenau (1802-1850), dit Nikolaus Lenau. La composition musicale du livre (où chaque chapitre correspond à un mouvement précis, Prélude, Rondeau, Gigue, Sarabande, etc.) dessine un personnage aux prises avec le temps - obsession de toute l`œuvre de Härtling. L'intrigue est minimale : le récit commence au retour d'Amérique, en 1833, après l'échec de l`utopie d'une vie nouvelle, et développe, dans l`entrelacs des souvenirs, des ambitions créatrices et des aventures amoureuses du poète : le thème de la tentation de l'immobilité, nourrie finalement au prix de la raison. Pour sortir du vide et des déboires de l'histoire, Niembsch rêve l`instant comme "pure éternité", ce qui revient à le vivre comme répétition. selon l`exergue emprunté à Kierkegaard : "La répétition et le souvenir sont un même mouvement, mais dans des directions opposées. Car ce qui est appelé à la mémoire est du passé, est répétition dirigée vers le passé, tandis que la répétition proprement dite est un phénomène de mémoire dirigée vers l'avenir." Chaque situation n'a donc de sens pour Niembsch qu'en tant qu`elle actualise un souvenir et en prépare déjà un autre. Il abolit ainsi obstinément l'inédit, déréalise sa propre existence pour n'habiter que la conscience fragile, apaisante et douloureuse à la fois, du retour du même. C'est ici qu'intervient, pour lui, la figure de don Juan, héros et martyr de la répétition infinie, auquel il rêve de consacrer une œuvre et avec lequel il s`identifie dans ses relations érotiques avec Caroline von Zarg, les sœurs Winterhalter, Juliette Zegerlein, toutes prises dans le miroitement de l'image maternelle évanouie et toujours recomposée...
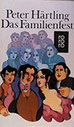
La Fête de famille ou la Fin de l'histoire (Das Familienfest oder Das Ende der Geschichte, 1969)
Ce livre apparaît bien comme le dernier volet du triptyque annoncé par Härtling. Le temps, qui, pour Niembsch s'était fait impassible et pour Ianek, insaisissable en son tourbillon se désagrège à présent, sous nos yeux et avec notre active complicité. De la vie du "héros", Georg Lauterbach, ce professeur de Tubingue dont les idées avancées avaient, en ce XIXe siècle allemand, mérité l'exil, que reste-t-il pour nous qui puisse valablement constituer l'Histoire? Tout ce qu'il a vécu, la rivalité enfantine presque criminelle avec son frère futur pasteur et thaumaturge, l'amour incestueux de sa sœur, les perfides faveurs de la comtesse Franziska, la conspiration républicaine, et jusqu'au tardif amour qu'il porte à cet enfant condamné, rien n'échappera à la subtile corrosion des subjectivités, à l'érosion du temps, à la perversion des perspectives. La mémoire de chacun ne garde que des bribes que le souvenir altère en les réinterprétant, au point que l'on peut dire: "La réalité du monde s'éteint avec chaque mort". Ainsi, à travers les multiples versions de la réalité, c'est l'Histoire et le roman possible de l'Histoire que met en question Härtling. Comme le mathématicien qui démontre "par l'absurde", le narrateur suppose les faits connus d'avance, si bien que chaque allusion s'éclaire des suivantes, pour retomber ensuite dans son épaisseur d'ombre que nul ne saura dissiper. Il en résulte une syntaxe originale dont le rôle n'est pas d'illuminer l'histoire, mais de jeter sur ce qu'on croit savoir la lueur du doute; syntaxe où se retrouvent, conjugués, le réalisme de Ianek et la musique de Niembsch.
"Les trois femmes l'avaient attendu, énervées depuis le matin et parlant de futilités, a quoi ressemblera-t-il après tant d'années, il aura changé c'est certain, sera plus viril, pourquoi d'ailleurs n'avait-il pas reparu pendant tout ce temps, sa mère ne lui manquait-elle pas, ni ses sœurs, elles venaient seulement de fermer les volets afin que le soleil de juillet ne chauffe pas trop les chambres du premier, on va étouffer là-dedans, elles avaient fait nettoyer la maison, harcelé les deux servantes, commandé à la cuisinière dès la veille toutes sortes de choses extravagantes, ce qui l'avait mise d'humeur bougonne, pourquoi donc tous ces tracas, c'est que le palais de M. Georg après ce séjour en France ne pourrait plus s'habituer à la grossière nourriture souabe; elle y mettait une telle mauvaise volonté qu'elles avaient toutes les trois quitté la cuisine et que, pour mettre un point final à la discussion, Mme Lauterbach avait dit : c'est bon; elles portèrent les chaises dans la "courette", un passage ombragé de deux châtaigniers entre l'école latine et le greffe, sur l'arrière des maisons, et terminé par des marches de pierre, c'était la qu'elles passaient leurs après-midi, recevaient les visites quotidiennes, percevaient les voix des voisines par-delà les jardins et les murs, et il y avait de l'ombre; voilà qu'il allait venir, était en train de venir, elles se l'affirmaient l'une à l'autre, à peine remarquaient-elles que le soir tombait, qu'il faisait plus frais, mais elles voyaient le crépuscule s'infiltrer entre les murs, il fait froid, ça fraîchit vite : leurs voix se mêlaient, elles se ressemblaient, sombres, toujours un peu enrouées, la mère dit à ses deux filles de rentrer, elle voulait attendre encore un moment; Bonjour, madame la Greffière, quelqu'un avait lanoé cette phrase dans le passage, elle eut peur, s'en irrita; Philine et Grete refusaient de partir, qu'elles se fassent au moins apporter des plaids. Il ne va plus tarder, dit-elle, le répète, dit : il devrait être là maintenant, le répète, dit : il aura été retenu à Tübingen; ou en chemin, ajoute-t-elle en hésitant; ça m'étonnerait qu'il se soit laissé refiler un mauvais cheval, elles se regardaient, ne souriaient plus, l'attente les avait surmenées, elles s'abandonnaient à la fatigue et à la mauvaise humeur qui s'emparait d'elles peu à peu : c'est que nous ne comptons plus pour lui, nous !, ce qui suscita chez les filles un éclat de rire : s'il entendait ça!, elles riaient toutes les trois, leurs voix sombres, réchauffées par une gaieté soudaine, se ressemblaient, et dans la pénombre leurs profils aussi, énergiques, mais le nez long, délicatement dessiné au-dessus des lèvres épaisses, personne, dit la femme, ne pourra dire à présent qu'il ne nous a pas fait honneur, et, si son père avait vécu cela, sur quoi les filles eurent un nouvel accès de rire : on s'y attendait; toutes trois, comme si elles voulaient, imitant Immanuel, frotter le bois pour conjurer les esprits, posèrent les mains sur la table, c'est ainsi qu'il les vit, un tableau qu'il attendait depuis si longtemps, qu'il avait contribué à faire surgir, auquel il avait réussi, avec une joie qui persistait en lui, à porter des retouches, minimes il est vrai, et la composition générale était restée la même, les couleurs aussi, qui contrastaient violemment à l'endroit des contours, malgré le glacis gris et moire qui s'était déposé sur l'ensemble et changeait sous l'insistance du regard, laissait le reste dans l'ombre pour cadrer sur les trois figures, davantage encore sur les mains. Elles ne le remarquaient pas, mais elles se taisaient aussi à présent, le rire s'était effacé sur les trois visages, remplacé par une grimace, exténuée, l'attente les avait rendues résignées. Il leur avait parlé maintes fois dans le souvenir, avec respect, sympathie, se moquant d'elles à l'occasion, mais n'avait jamais touché à cette mise en scène, elles étaient assises comme toujours, la mère au milieu, Philine a sa gauche, Grete à sa droite; il n'a permis à personne de se joindre à elles; à Immanuel, dont la voix intervenait malgré lui, il ne le permettait pas, rien qu'elles trois, l'élément le plus agréable, sans le frère, sans la sœur aînée qui l'avait plongé dans la terreur en l'envoyant au grenier entre les caisses délabrées, à la cave..." (traduction Jean-Claude Schneider, Seuil).
