- INTRO
- Lectures XVIIe-XVIIIe
- Lectures XIXe-XXe
- 1820-1840
- 1840-1860
- 1860-1880
- 1880-1900
- 1900-1910
- 1910-1920
- 1920-1930
- 1920s
- Breton
- Tanguy - Ernst
- Eluard
- Jacob - Cocteau
- Gramsci
- Lukacs
- Hesse
- Woolf
- Valéry
- Alain
- Mansfield
- Lawrence
- Bachelard
- Zweig
- Larbaud - Morand
- Döblin
- Musil
- Mann
- Colette
- Mauriac
- MartinDuGard
- Spengler
- Joyce
- Pabst
- S.Lewis
- Dreiser
- Pound
- Heisenberg
- TS Eliot
- Supervielle - Reverdy
- Sandburg
- Duhamel - Romains
- Giraudoux - Jouhandeau
- Svevo - Pirandello
- Harlem - Langston Hughes
- Cassirer
- Lovecraft
- Zamiatine
- W.Benjamin
- Chesterton
- Akutagawa
- Tanizaki
- 1930-1940
- 1930s
- Fitzgerald
- Hemingway
- Faulkner
- Koch
- Céline
- Bernanos
- Jouve
- DosPassos
- Kojève
- Miller-Nin
- Grosz - Dix
- Green
- Ortega y Gasset
- Wittgenstein
- Russell - Carnap
- Artaud
- Jaspers
- Sapir - Piaget
- Guillén
- Garcia Lorca
- Hammett
- A.Christie
- Heidegger
- Icaza
- Huxley
- Hubble
- Caldwell
- Steinbeck
- Waugh
- Blixen
- Rhys
- J.Roth - Doderer
- Aub
- Malraux-StExupéry
- DBarnes-NWest
- 1940-1950
- 1940s
- Chandler
- Sartre
- Beauvoir
- Mounier
- Borges
- McCullers
- Camus
- Horkheimer - Adorno
- Cela
- Wright
- Bellows - Hopper - duBois
- Gödel - Türing
- Bataille
- Char-Michaux
- Bogart
- Trevor
- Brecht
- Merleau-Ponty - Ponge
- Simenon
- Aragon
- Algren - Irish
- Bloch
- Mead - Benedict - Linton
- Vogt - Asimov
- Orwell
- Lewin - Mayo - Maslow
- Montherlant
- Buzzati - Pavese
- Vittorini
- Fallada
- Malaparte
- Canetti
- Lowry - Bowles
- Koestler
- Welty
- Boulgakov
- Tamiki - Yôkô
- Weil
- Gadda
- Broch
- Steeman
- Jouhandeau
- 1950-1960
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite
- 1960-1970
- 1960s
- Abe
- Ricoeur
- Roth - Elkin
- Lévi-Strauss
- Burgess
- U.Johnson - C.Wolf
- Heller - Toole
- Naipaul
- J.Rechy - H.Selby
- Antonioni
- T.Wolfe - N.Mailer
- Onetti - Sábato
- Capote
- Vonnegut
- Plath
- Burroughs
- Veneziano
- Godard
- McCarthy - Minsky
- Sillitoe
- Sagan
- Gadamer
- Martin Luther King
- Laing
- Lenz
- P.K.Dick - Le Guin
- Lefebvre
- Althusser
- Lacan
- Foucault
- Jankélévitch
- Goffman
- Barthes
- Dolls
- Ellis
- Cortázar
- Warhol
- Berne
- Grossman
- McLuhan
- Soljénitsyne
- Lessing
- Leary
- Kuhn
- HarperLee
- Fuentes
- 1970-1980
- 1970s
- Habermas
- Handke
- GarciaMarquez
- Deleuze
- Derrida
- Beck
- Satir
- Kundera
- Hrabal
- Didion
- Guinzbourg
- Lovelock
- Vietnam
- H.S.Thompson - Bukowski
- Pynchon
- E.T.Hall
- Bateson - Watzlawick
- Carver
- Irving
- Milgram
- VargasLlosa
- Puig - Donoso
- Lasch-Sennett
- Crozier - Touraine
- Friedan-Greer
- Jacob-Monod
- Dawkins
- Beattie - Phillips
- Gaddis
- Rawls
- Zinoviev
- H.Searles
- Ballard
- Jong
- Kôno
- Calvino
- Ballester-Delibes
- ASchmidt
- 1980-1990
- 1990-2000
- Lectures XXIe
- Promenades
- Paysages
- Contact
- 1950s
- Moravia
- Rossellini
- Nabokov
- Cioran
- Arendt
- Aron
- Marcuse
- Packard
- Wright Mills
- Vian - Queneau
- Quine - Austin
- Blanchot
- Sarraute - Butor - Duras
- Ionesco - Beckett
- Rogers
- Dürrenmatt
- Sutherland - Bacon
- Peake
- Durrell - Murdoch
- Graham Greene
- Kawabata
- Kerouac
- Bellow - Malamud
- Martin-Santos
- Fanon - Memmi
- Riesman
- Böll - Grass
- Ellison
- Bergman
- Baldwin
- Fromm
- Bradbury - A.C.Clarke
- Tennessee Williams
- Erikson
- Bachmann - Celan - Sachs
- Rulfo-Paz
- Achébé - Soyinka
- Pollock
- Carpentier
- Mishima
- Salinger - Styron
- Pasternak
- Asturias
- O'Connor
- Hoffer
- Matute - MartinGaite

Graham Greene (1904-1991), "A Gun for Sale" (1936), "Brighton Rock" (1938), "The Confidential Agent" (1939), "The Power and the Glory" (1940), "The Ministry of Fear" (1943), "The Third Man" (1949), "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "Travels with My Aunt" (1969) , "The Human Factor" (1978), "Monsignor Quixote" (1982) - ....
Last update: 12/29/2016
Il est bien difficile de décider lequel des six romans écrits par Graham Greene entre 1950 et sa mort est le meilleur, "The End of the Affair" (1951), "The Quiet American" (1955), "Our Man in Havana" (1958), "The Comedians" (1966), "The Honorary Consul" (1973) ou "The Human Factor". Il y a des moments dans chacun des livres qui sont superbes; et il y a des personnages dans chaque livre qui, dans leur solitude et lutte avec eux-mêmes, sont parmi les plus mémorables dans l’écriture contemporaine.
Ses romans nous rappellent quelque chose que nous soupçonnions déjà, mais que nous exprimions rarement, la conviction que la vie doit avoir des enjeux bien plus élevés que nous ne pouvions le supposer, jointe à cela sa singulière capacité à tisser les fils d'une intrigue qui entraîne nos âmes et laisse une emprise durable sur notre imagination...

Le manque d'estime que Graham Greene éprouvait pour sa propre existence n'e fut pas un simple trait de caractère, mais le moteur central, à la fois destructeur et fécond, de sa vie et de son œuvre.
Plusieurs facteurs, entremêlés, semblent expliquer ce rapport difficile à sa propre existence :
- La Dépression (ou "l'Ennui") congénitale : Greene lui-même parlait d'"ennui" (boredom), un terme qui sous-estime la profondeur de son mal. Il s'agissait en réalité d'une mélancolie profonde, quasi existentielle, qu'il disait avoir héritée de son père et qui l'a habité toute sa vie. C'était pour lui un état basal, une façon d'être au monde.
- La Tentative du Suicide et le "Jeu Russe" : À 20 ans, alors qu'il était étudiant à Oxford, Greene a joué à un "jeu" mortel : la roulette russe. Il a mis une cartouche dans le barillet de son frère, a tourné le cylindre, visé sa tempe et pressé la détente. Le cran a fait clic. Cette expérience limite, ce flirt avec le néant, l'a marqué à jamais. Il en a tiré une conviction : la vie qui lui avait été "rendue" était désormais un surplus, une existence qu'il méprisait et qu'il pouvait risquer sans compter.
- Le Catholicisme Tourmenté : Converti au catholicisme pour épouser sa femme, Greene n'a jamais été un croyant serein. Sa foi était celle du pécheur, de l'hérétique, de l'homme rongé par le doute. Il était obsédé par le concept de damnation et de grâce. Ce conflit intérieur perpétuel – croire en Dieu tout en étant attiré par le péché et le mal – nourrissait son malaise. Il se voyait comme un être fondamentalement imparfait, indigne de l'amour divin.
- Le Besoin d'Adrénaline et de Fuite : Pour échapper à cet "ennui" paralysant, Greene a constamment cherché le danger et l'aventure. Il est devenu un voyageur infatigable, se rendant dans les "points chauds" du globe (Mexique, Kenya, Vietnam, Cuba, Haïti durant la dictature des Duvalier). Ces voyages n'étaient pas seulement du journalisme ; c'étaient des thérapies par le choc, des moyens de se sentir vivant en frôlant la mort, d'échapper à la monotonie et au désespoir qui le guettaient en Angleterre.

Cette absence d'estime de soi a eu des répercussions profondes et paradoxales :
- Sur sa Vie Personnelle ...
Sa vie fut une succession de prises de risques : espionnage pour le MI6, voyages périlleux, addictions (notamment à l'alcool). Son mariage fut un échec. Ses nombreuses et tumultueuses aventures extraconjugales (dont sa longue liaison avec Catherine Walston) témoignent d'une quête perpétuelle et insatisfaite d'un amour absolu qui puisse le sauver de lui-même, et d'une incapacité à se contenter du bonheur simple. Enfin, il n'a jamais vraiment trouvé sa place, se définissant lui-même comme un "étranger partout", un exilé permanent, ce qui est la traduction géographique de son exil intérieur.
- Sur son Œuvre Littéraire ...
C'est dans son œuvre que les conséquences de ce malaise ont été les plus productives. Son mépris de l'existence est devenu la matière première de sa grandeur littéraire. Greene a ainsi inventé un univers moral unique, souvent appelé le "monde greenien" – un monde gris, corrompu, cynique et dangereux, peuplé de "pauvres types" (seedy characters), de traîtres, de saints ratés et de pécheurs pathétiques. Ses héros sont des anti-héros, des hommes usés, lâches, vaincus ou désillusionnés (comme Scobie dans Le Fond du problème ou le prêtre ivrogne dans La Puissance et la Gloire). C'est le reflet direct de sa vision désenchantée de la condition humaine.
Son œuvre explore avec une acuité rare les grands thèmes qui le hantaient :
- La Grâce dans la Damnation : Ses personnages les plus vils touchent parfois à la sainteté précisément parce qu'ils sont damnés et qu'ils le savent.
- La Trahison et la Lâcheté : Il n'y a pas de héros innocents chez Greene, seulement des hommes qui trahissent par faiblesse, par calcul ou par amour.
- La Pitié (Pity) : Une émotion récurrente et cruciale. La pitié qu'un personnage éprouve pour un autre est souvent le déclencheur de catastrophes, mais aussi le seul sentiment authentique dans un monde sans amour.
- Son expérience du danger et des zones de conflit a donné à ses romans une authenticité géopolitique et une atmosphère de tension incomparables. Les romans dits "catholiques" (Brighton Rock, La Puissance et la Gloire, Le Fond du problème) et les "entertainments" politiques (Notre agent à La Havane, Un Américain bien tranquille) sont ancrés dans une réalité qu'il a lui-même éprouvée.
- Parce qu'il ne s'aimait pas, Greene portait un regard d'une immense compassion sur les faillis, les marginaux et les vaincus. Il était du côté des âmes en perdition, qu'elles soient espions, meurtriers, adultères ou prêtres déchus. Cette capacité à donner de la grandeur aux êtres brisés est l'un des aspects les plus puissants et les plus durables de son œuvre.
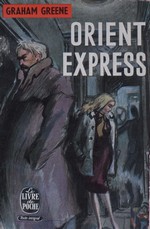
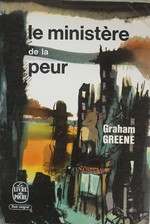
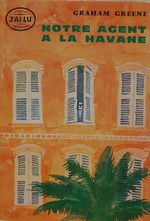


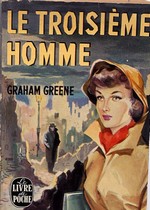
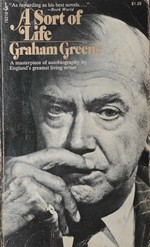
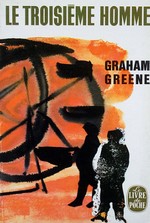
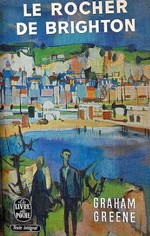
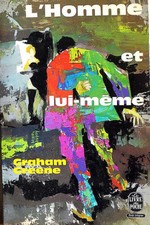
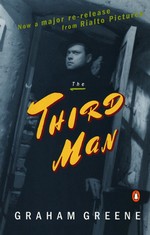
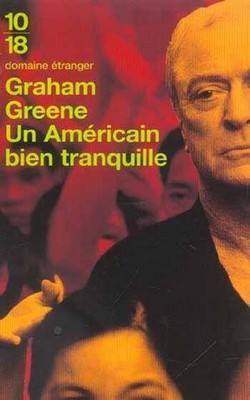

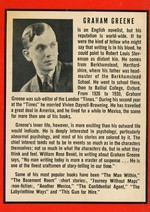
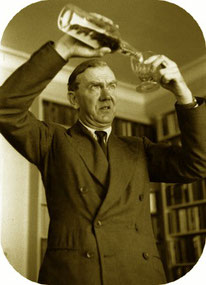
Graham Greene (1904-1991)
Né à Berkhamsted, près de Londres, fils du directeur de l'école, Graham Greene fait ses études à Oxford, mais connaît une enfance difficile qui lui laisse
un sentiment de vide qu'il comblera en parcourant le monde, la violence, la misère, et l'on retrouve dans ses romans nombre de héros ambigus luttant contre la corruption, le mal, tentant de
sauver autrui ou de se sauver eux-mêmes de la déchéance et de l'absurdité ... mais pour s'enliser, sans rémission apparemment possible. Greene se convertit au catholicisme (1926), épouse
Vivien-Dayrell-Browning (1927), tient des critiques littéraires, puis en 1935, voyage au Libéria et au Mexique : "A Gun for Sale" (1936, Tueur à gages), "Brighton Rock" (1938, Rocher de
Brighton), "The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret), "The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire). Recruté au MI6 par le célèbre agent double Kim Philby, il travaille pour
le Foreign Office entre 1941 et 1943 au Sierra Leone. Suivent : "The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur), "The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème), "The Third Man"
(1949, Le Troisième Homme), "The End of the Affair" (1951, La Fin d'une liaison), "The Quiet American" (1955, Un Américain bien tranquille), "Loser Takes All" (1955, Qui perd gagne), "Our Man in
Havana" (1958, Notre agent à La Havane). Aux quatre coins du monde, participant à nombre de polémiques et de protestations libertaires, Graham Greene publie vingt-six romans diffusés à plus de
vingt millions d'exemplaires et traduits en quarante langues. L'homme traqué de "The Confidential Agent" porte en lui quelques-unes des
obsessions de Graham Greene : l'horreur du contact physique, la solitude totale contre laquelle se brise tout effort des innocents (une petite servante d'hôtel qui veut l'aider est assassinée).
Derrière une banale chasse à l'homme que pourrait parfaitement dérouler un Peter Cheney, se dessine la figure menaçante du destin, masque de désespoir qui cache à la fois le simple abandon d'un
homme à la cruauté de ses adversaires et le délaissement de la créature oubliée de Dieu...
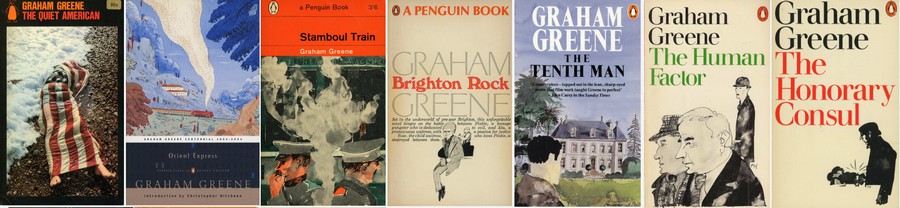
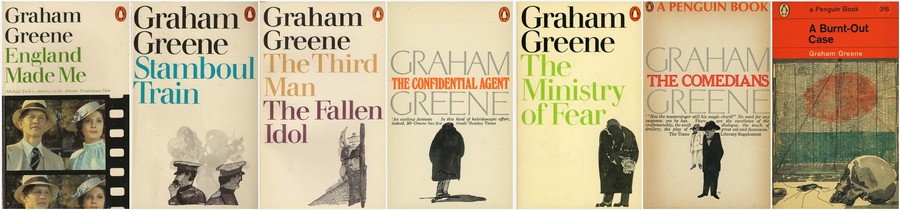
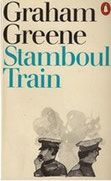
"Stambul Train" (1932)
Ce récit d'aventures fut l'un des premiers succès de Graham Greene qui avait débuté avec un recueil de poèmes et deux romans. "The Man Within" (1929) et "The Name of Action" (1930). Le roman se passe en trois jours, au rythme accéléré d`un express international. Des êtres réunis par le hasard du voyage créent et défont un monde en vase clos, cédant à la promiscuité établie par leur situation. Des destinées se nouent, des intrigues se défont, des solitudes se cherchent ou s'affrontent : Myatt, M. Opie, Cora, Musker, miss Warren, Peters... L'argent et la pauvreté, la force et la maladie, la mystique et le matérialisme, le conformisme et la révolte s`affrontent d'Ostende à Constantinople, en passant par Cologne, Vienne et Subotica. Si l'excès de métaphores alourdit le texte, on pressent l`évolution du romancier vers des techniques conradiennes ou vers les points de vue multiples à la Henry James. La sensibilité du peseur d'âmes se fait jour. La dimension sociale prendra plus d`importance dans "A Gun for Sale" (1936). Les machinations des marchands de canons à la veille de la guerre expliquent la destinée de cet assassin politique traqué par la police. La peur de la guerre n'est pas seulement un procédé, une émotion, elle suinte de la présentation même des décors, des foules anonymes. La guerre est le mal, un fait avec lequel on vit comme avec une maladie chronique mais non mortelle. Elle dépasse les obsessions personnelles du tueur, Raven, toujours hanté par la vision de son père pendu, sa mère gisant la gorge ouverte. Le mal fait ainsi son apparition dans l'univers de Greene à la fois par le truchement de la politique et celui de la psychanalyse. (Trad. Stock, 1946; Laffont, 1979).

"Brighton Rock" (1938, Le Rocher de Brighton)
A la fois "divertissement" et première œuvre capitale de Graham Greene ayant une tendance "catholique", le héros de ces aventures policières est un chef de bande de dix-sept ans, le vicieux Pinkie qui s'en prend à Ida Arnold, une femme généreuse débordant de franche sexualité, d'enthousiasme et de joie de vivre. Trahison, meurtre et vengeance se déchaînent dans les bas-fonds d`un Brighton bruyant et étincelant. Tandis qu'lda représente le bien, Pinkie tient le rôle du Malin, et par son ambition et sa cruauté démoniaque atteint à une sorte d'ascèse. L'usage continuel de la métaphore et les procédés narratifs contraignent le lecteur à ne percevoir la situation que par les yeux de Pinkie, ce qui gauchit ses réactions personnelles. L'attirant Pinkie est avant tout un gangster et un déséquilibré. Cet ancien enfant de chœur qui voulait être prêtre devient un criminel à cause du dégoût que lui inspirent la femme et l'amour - un souvenir de sa petite enfance, celui de ses parents vautrés sur un lit, le poursuit comme une malédiction. Mais la lutte implacable qui oppose Ida et le tueur dépasse le cadre de la psychanalyse. La vocation du mal, le manque total de pitié font de Pinkie un personnage très consciemment satanique, que le réalisme du cadre et des circonstances rend plus que plausible.
Paradoxalement, Greene semble voir en lui le pêcheur qui se trouve plus susceptible de recevoir la visitation de la grâce qu'un chrétien normal. Brighton, c'est l'enfer, mais les damnés seront peut-être un jour les seuls élus : la perversion spirituelle apparaît ainsi sous des dehors attrayants et la bonté va souvent de pair avec la faiblesse.
"Le Rocher de Brighton" traduit un équilibre précis entre une attitude morale et un certain milieu social, caractéristique de l'avant-guerre. Le message final, amené par des images de laideur et de répulsion, ne laisse au lecteur aucune illusion : la petite Rose, la veuve de Pinkie, écoute, le cœur battant d'amour, l'enregistrement au magnétophone qu'il a fait pour elle... et s'entend vouer à tous les diables. Cet univers cruel dont la grâce est absente, '”est le monde des hommes traqués, de la terreur et du désespoir, celui de "L'Agent secret" et du "Troisième Homme" (Trad. Robert Laffont, 1947).
"HALE knew they meant to murder him before he had been in Brighton three hours. With his inky fingers and his bitten nails, his manner cynical and nervous, anybody could tell he didn't belong belong to the early summer sun, the cool Whitsun wind off the sea, the holiday crowd. They came in by train from Victoria every five minutes, rocked down Queen's Road standing on the tops of the little local trams, stepped off in bewildered multitudes into fresh and glittering air: the new silver paint sparkled on the piers, the cream houses ran away into the west like a pale Victorian water-colour; a race in miniature motors, a band playing, flower gardens in bloom below the front, an aeroplane advertising something for the health in pale vanishing clouds across the sky...."
La phrase d’ouverture – « Hale knew… » – installe un compte à rebours qui donne au roman sa traction de thriller tout en déplaçant rapidement le centre d’intérêt vers Pinkie et Rose. Pinkie, c'est l'adolescent gangster, glaçant, que sa culture catholique oriente non vers l’espérance, mais vers l’obsession de l’enfer et de la damnation. Il est souvent lu comme une figure de nihilisme juvénile précoce dans la fiction britannique. Rose, c'est la croyante naïve qui projette sur Pinkie une possibilité de rédemption qu’il ne partage pas. Le roman s’ouvre sur la traque puis l’assassinat de Fred Hale à Brighton. À la tête d’un petit gang, Pinkie Brown, 17 ans, cherche à maquiller le crime. Pour verrouiller un témoin potentiellement gênant, la jeune serveuse Rose, il la séduit et projette de l’épouser. En face, Ida Arnold, chanteuse de pub à la morale instinctive, mène une enquête obstinée « par sens de la justice » plus que par foi dans la loi. Greene épouse tour à tour leurs points de vue, et fait monter la tension d’un polar qui déborde rapidement le cadre du genre pour devenir une allégorie morale.
CHAPITRE PREMIER
"HALE n’avait pas passé trois heures à Brighton qu’il savait que les autres avaient décidé de le tuer. Avec ses doigts tachés d’encre et ses ongles rongés, son air à la fois cynique et inquiet, il était facile de voir qu’il n’était pas à sa place à Brighton, pas à sa place dans ce soleil de début d’été, ce vent frais de la Pentecôte qui venait de la mer, pas chez lui au milieu de cette foule de gens en goguette. Toutes les cinq minutes, les trains les amenaient de la gare de Victoria. Ils descendaient Queen’s Road debout sur l’impériale brimbalante des petits tramways d’intérêt local que leurs multitudes ahuries quittaient pour se plonger dans l’air frais et éblouissant ; les jetées dont la peinture couleur argent était toute fraîche luisaient au soleil, les maisons d’un jaune crème s’estompaient à l’ouest comme une aquarelle délavée de l’époque victorienne : un manège d’autos de courses en miniature, les flonflons d’un orchestre, les jardins pleins de fleurs juste au-dessous du front de mer, l’avion traçant dans le ciel, en pâles nuages qui se fondaient, une réclame pour un produit pharmaceutique.
Hale avait cru qu’il était très facile de se perdre dans Brighton. En plus de lui-même, cinquante mille personnes étaient venues y passer le dimanche, et pendant un bon moment il se livra complètement à la douceur de cette journée ; il but de l’alcool ou des apéritifs partout où son itinéraire le lui permettait. Car il était forcé de s’en tenir strictement à son itinéraire : de 10 à 11, Queen’s Road et Castle Square ; de 11 heures à midi, l’Aquarium et Palace Pier ; de midi à une heure, la partie du front de mer entre le Vieux Navire et la West Pier (6), déjeuner entre 1 heure et 2 heures dans le restaurant qui lui plairait, pas loin de Castle Square, et après cela descendre à pied toute l’esplanade jusqu’à la West Pier et regagner la gare par les rues de Hove. Telles étaient les limites forcées de sa marche absurde de sentinelle dont chaque pas avait été annoncé au public.
Annoncé par tous les panneaux de publicité du Messager : « Kolley Kibber à Brighton aujourd’hui. » Dans sa poche, il avait un paquet de cartes à distribuer dans des cachettes, le long de sa route : ceux qui les trouveraient recevraient dix shillings du journal le Messager, mais le gros lot était réservé à celui qui aborderait Hale un numéro du Messager à la main, en disant la phrase convenue : « Vous êtes M. Kolley Kibber. Je réclame le prix du Messager. »
Le boulot de Hale, c’était ces allées et venues, jusqu’à ce que quelqu’un en revendiquant le prix, vînt le délivrer de sa faction, et ceci dans toutes les plages, l’une après l’autre, hier Southend, aujourd’hui Brighton, demain…
Il avala prestement son apéritif, car onze heures venaient de sonner à une horloge et il quitta la place du Château. Kolley Kibber jouait toujours franc jeu, portait toujours la même forme de chapeau que dans la photo publiée par le Messager et il était toujours à l’heure. Hier, à Southend, personne ne l’avait reconnu : le journal était bien content d’économiser ses guinées de temps en temps, mais pas trop souvent. Son devoir était de se faire repérer – et c’était aussi son désir. Il avait des raisons pour ne pas se sentir très en sécurité à Brighton, même dans la foule du jour de la Pentecôte.
Il s’appuya au parapet, près de Palace Pier, et montra son visage à la foule qui, devant lui, déroulait ses anneaux interminablement comme un fil de fer tordu, couple par couple, tous avec un air de gaieté froide et résolue. Ils avaient fait le voyage debout depuis Victoria dans des compartiments bondés, il leur faudrait faire la queue pour déjeuner et, à minuit, endormis à moitié, ils se feraient ballotter par des trains pour retrouver les rues étroites, les bistrots fermés, et puis ils rentreraient chez eux, n’en pouvant plus. Par un immense labeur, avec une immense patience, ils arrachaient à la longue journée leur moisson de plaisir : ce soleil, cette musique, le cliquetis des autos-miniatures, le train-fantôme qui plonge à travers le squelette grimaçant sous la promenade de l’Aquarium, les bâtons de Rocher de Brighton, les calots de marin en papier…
Personne ne faisait attention à Hale ; personne ne semblait porter à la main un seul Messager. Avec précaution, il déposa l’une de ses cartes sur le haut d’une petite corbeille et continua son chemin, avec ses ongles rongés et ses doigts tachés d’encre, tout seul. Il ne sentait sa solitude qu’après le troisième gin ; jusque-là, il méprisait la foule, mais après, il sentait combien il en était proche. Il était sorti des mêmes pavés, mais il était condamné par son salaire supérieur à prétendre qu’il aspirait à d’autres choses, et sans cesse les jetées promenades, les petites baraques lui tiraient sur le cœur. Il aurait voulu retourner en arrière, mais tout ce qu’il pouvait faire, c’était de promener le long de l’esplanade son sourire de mépris, insigne de solitude. Quelque part, une femme invisible chantait : « Quand je revenais à Brighton par le train », d’une voix alourdie par la bière, une voix chaude de bar public. En entrant dans le café, Hale put apercevoir deux comptoirs plus loin, par une cloison de verre, les charmes opulents de la chanteuse.
Elle n’était pas vieille, la fin de la trentaine ou le commencement de la quarantaine ; et elle n’était soûle qu’un peu, d’une façon accommodante, affectueuse. Elle vous faisait penser à des bébés qui tètent mais si jamais elle en avait porté, elle ne leur avait pas permis de la détériorer : elle se soignait bien. On voyait ça à son rouge à lèvres, à l’assurance de son grand corps.
Elle était rembourrée, mais ne se laissait pas aller. Elle conservait sa ligne, pour ceux qui aiment une ligne.
Par exemple Hale. Il n’était pas grand et il l’examinait avec convoitise, par-dessus les verres vides, empilés dans le bac de plomb, au-delà des robinets à bière, entre les épaules des deux garçons qui servaient dans le bar.
« Pousses-en encore une, Lily », dit quelqu’un, et elle recommença : « Un soir – dam une ruelle – Lord Rothschild me disait… »
Elle ne dépassa pas les premiers mots. Elle avait beaucoup trop envie de rire pour que sa voix pût sortir, mais sa mémoire était inépuisable pour les romances. Hale ne connaissait pas un seul de ces airs, mais son verre aux lèvres, il la regardait avec nostalgie : elle s’était lancée dans une chanson qui devait dater de la ruée vers l’or en Australie.
« Fred, dit une voix derrière lui, Fred. »
Le gin coula du verre de Hale jusque sur le comptoir. Du seuil du café, un jeune garçon d’environ dix-sept ans le regardait – costume bon marché, d’une élégance vulgaire, étoffe vite défraîchie, visage d’une intensité affamée, avec une espèce d’orgueil effrayant, monstrueux.
« Qui appelez-vous Fred ? dit Hale, je ne suis pas Fred.
— Cause toujours », dit le Gamin. Il se retourna vers la porte en surveillant Hale du coin de l’œil par-dessus son épaule.
« Où allez-vous ?
— Faut que j’avertisse les amis », répondit le Gamin.
Ils étaient seuls dans le bar, sauf un vieux commissionnaire qui dormait sur un grand verre de bière blonde.
« Attendez, dit Hale, venez donc boire quelque chose. Allons nous asseoir là-bas et prenons quelque chose.
— Faut que j’parte, dit le Gamin, tu sais bien que je ne bois pas, Fred, il me semble que tu oublies bien des choses, hein ?
— Ça ne changera rien de prendre un verre, quelque chose de doux.
— Faudra qu’il soit rapide », dit le Gamin. Il ne cessait pas de regarder Hale, de près et avec étonnement : on imagine qu’un chasseur poursuivant à travers la jungle une bête à demi fabuleuse doit examiner ainsi – avant de l’abattre – le lion moucheté ou l’éléphant pygmée.
« Un jus de pamplemousse, dit-il.
— Continue, Lily, imploraient les voix dans le bar public. Donne-nous-en une autre, Lily. » Et pour la première fois le Gamin détacha ses yeux du visage de Hale pour contempler, à travers la vitre, les gros seins et les charmes épanouis.
« Un double whisky et un jus de pamplemousse », dit Hale...."

"The Confidential Agent" (1939, L'Agent secret)
Composé en six semaines et inspiré par la guerre d'Espagne , l'aventure de D., agent secret traqué dans un monde hostile et incompréhensible dépasse le simple récit de suspense... Au terme d'un voyage qui ressemble à une poursuite, D. atteint la sinistre pension de famille de Gabitas Street, à Londres. Sa dangereuse propriétaire au visage tâché et aux mains énormes, la petite servante Else et son destin tragique, l'hindou à la robe de chambre bariolée, Lord Benditch et sa galerie de portraits de courtisanes, Fortesque et son air de vieil adolescent, Rose Cullen, indifférente et peut-être redoutable : tous ces personnages se croisent et disparaissent dans les brumes anglaise. Fidèle à la foi qu'il a en l'homme, Graham Greene termine cependant les tribulations de l'agent secret sur une note d'espoir.
"Les mouettes balayaient le ciel de Douvres. Elles se détachaient comme des flocons arrachés au brouillard et viraient pour retourner vers la ville cachée, tandis que la sirène se lamentait avec elles ; d'autres bateaux répondirent et tout un chœur de lamentations s'éleva (pour la veillée de quel mort ?). Le bateau avançait à demi-vitesse dans le soir d'automne aigre. D. se mit à penser à un corbillard qui roule lentement et discrètement vers le « champ de repos », et dont le conducteur prend grand soin de ne pas secouer le cercueil, comme si un ou plusieurs cahots allaient incommoder le corps. Des cris aigus de femme énervée traversaient les haubans. Le bar des troisièmes était plein à craquer : une équipe de rugby rentrait en Angleterre et les jeunes gens, arborant des cravates à rayures, se bousculaient bruyamment pour attraper leurs verres. D. ne comprenait pas toujours les mots qu'ils criaient : peut-être était-ce de l'argot, ou un dialecte ; il lui faudrait un peu de temps avant de retrouver complètement le souvenir de la langue anglaise; il l'avait très bien parlée autrefois mais maintenant ses connaissances étaient devenues un peu trop littéraires. Il essaya de s'isoler, cet homme entre deux âges, à la lourde moustache, avec une cicatrice au menton, et le souci plissant son front, comme un tic, mais l'on ne pouvait guère se tenir à l'écart dans ce bar - un coude lui entra dans les côtes et une bouche lui souffla au visage un relent de bière en bouteille. Ces gens le remplissaient d'un sentiment de stupéfaction; on n'aurait jamais pu se douter, à les voir si bons vivants dans la fumée de leurs cigarettes, qu'il y avait une guerre en ce moment - pas seulement dans le pays qu'il venait de quitter, mais la guerre ici, à un demi-mille de la jetée de Douvres. Il transportait la guerre avec lui. Partout où D. se trouvait, il y avait la guerre. Il n'avait jamais pu comprendre comment les gens ne le sentaient pas.
- Faites circuler, faites circuler! cria l'un des joueurs au barman.
Et quelqu'un s'empara de son verre de bière en hurlant :
- Hors jeu!
- Mêlée! répondirent-ils tous à tue-tête.
- Avec votre permission, dit D., avec votre permission.
Et il se faufila dehors; Il remonta le col de son imperméable et monta sur le pont du bateau plongé dans le brouillard glacé, où les mouettes qui filaient sur Douvres poussaient leurs cris lugubres au-dessus de sa tête. Il se mit à battre la semelle, de long en large, en suivant la rambarde pour se réchauffer, tête baissée vers les planches du pont sur lesquelles ses yeux voyaient une carte semée de tranchées, de positions intenables, de saillants, de morts; des bombardiers décollaient d'un point situé entre ses yeux et dans son cerveau les montagnes tremblaient sous les éclatements d'obus.
Aucune sécurité me lui venait à faire les cent pas le pont de ce bateau anglais qui d'un imperceptible glissement entrait dans le port de Douvres. Le danger faisait partie de lui-même. Ce n'était pas un pardessus qu'on peut laisser à la maison, c'était sa propre peau. L'on meurt avec cette peau : seule, la corruption vous en dépouille. L'unique personne à qui l'on puisse se fier, c'est soi-même. On trouvait sur le cadavre d'un ami, sous sa chemise, une médaille bénite; un autre ami appartenait à une organisation qui ne portait pas les initiales qu'il aurait fallu. De long en large, sur ce pont des troisièmes exposé à tous les vents, d'arrière en avant et d'avant en arrière, jusqu'à l'endroit où sa marche était interrompue par un écriteau : « Réservé aux Passagers de Première Classe. » Il fut un temps où la distinction de classes lui serait apparue comme une insulte, mais à présent les classes sociales étaient subdivisées trop de fois pour que la chose eût un sens quelconque. Il fixa des yeux le pont des premières; il n'y avait dans le froid qu'un seul homme comme lui-même : col remonté, il se dressait à l'avant du bateau et regardait vers Douvres.
D. tourna les talons et regagna l'arrière, et au rythme régulier de son pas, les avions de bombardement reprirent leur vol. Vous ne pouvez être sûr que de vous-même et par moments vous vous demandez si après tout vous n'avez pas tort d'en être sûr...."
C'est un roman d'espionnage, plein de suspense, d'enlèvements et de coups de feu. Mr. D. (l'initiale ne trahit pas une influence de Kafka. mais un souci de mystère), professeur de langues romanes devenu l'émissaire des républicains espagnols, vient en Angleterre commander du charbon que s'efforce aussi d'obtenir l'agent du parti adverse. Les événements qui se déroulent à un rythme effréné sont tous vus par les yeux de D. et l'optique du lecteur se limite à la sienne. Sa vision. et aussi sa philosophie, sont celles du romancier ; cette vision de l`homme traqué symbolise celle d'un univers catholique qui ne paraît compréhensible qu'au seul regard de Dieu. En proie à une perpétuelle méfiance, les êtres se corrompent mutuellement par le mensonge ou l`illusion, comme K. ou le Docteur Li. Bien que la mort de sa femme le hante et qu'il soit obsédé par le "complexe du chat" (il s'est trouvé enterré avec un chat dans un bombardement), le héros parvient à s`attacher à Rose Cullen, mais il s'agit de pitié plus que d'amour. Puis, auprès de la servante Else, il connaît le réconfort de la confiance partagée. Le meurtre d'Else le transforme : de poursuivi il devient justicier mais, champion d'une cause perdue, il échouera.
Dans ce roman, Greene évoque l'atmosphère de Londres, la ville heureuse au seuil de la guerre, toute colorée par le monologue intérieur des personnages. Mais le mal est partout présent, inhérent à la condition humaine et nulle idéologie ne saurait suffire à le combattre. Telle est la leçon de cette œuvre pessimiste - (Trad. Editions du Seuil, 1948 ; Robert Laffont, 1979).

"The Power and the Glory" (1940, La Puissance et la Gloire)
Un prêtre déchu et ivrogne assume jusqu'au martyre son ministère dans un Mexique révolutionnaire qui persécute l'Église. "La Puissance et la Gloire est le sommet
des romans catholiques de Graham Greene qui, pour la première fois. délaissait les thèmes policiers. Il lui fut inspiré par un séjour au Mexique en 1937. Le clergé mexicain persécuté par le
gouvernement révolutionnaire, il ne reste qu'un seul prêtre, dont la tête est mise à prix. Ce prêtre est un pauvre homme qui aime trop l'alcool et qui a fait un enfant à une de ses paroissiennes.
Il essaie de fuir mais revient chaque fois qu'un mourant a besoin de lui, « et même lorsqu'il croit que son secours sera vain, et même lorsqu'il n'ignore pas que c'est d'un guet-apens qu'il
s'agit et que celui qui l'appelle l'a déjà trahi, ce prêtre ivrogne, impur, et tremblant devant la mort, donne sa vie sans perdre à aucun moment le sentiment de sa bassesse et de sa honte » (
François Mauriac ). Extraordinaire roman, "La Puissance et la Gloire" connut dès sa parution un succès retentissant et reste l'oeuvre la plus forte du grand écrivain anglais." (Trad. Robert
Laffont, 1948).
Chapitre I - Le port
"Mr. Tench sortit de sa maison sous l’aveuglant soleil mexicain et dans la poussière qui blanchissait tout, pour aller chercher son cylindre d’éther. Du haut du toit, quelques vautours à l’aspect famélique le considérèrent d’un œil indifférent : il n’était pas encore devenu charogne. Un vague frisson de révolte monta au cœur de Mr. Tench qui arracha, en s’y cassant les ongles, deux ou trois cailloux de la route pour les lancer d’un geste mou contre les oiseaux. L’un d’eux s’envola dans un claquement d’ailes au-dessus de la ville ; il survola la minuscule plaza, le buste de l’ex-président, ex-général, ex-humain, survola les deux baraques où l’on vendait de l’eau minérale et fila droit vers le fleuve et la mer. Il n’y trouverait rien du tout : de ce côté-là, les requins se chargeaient des charognes. Mr. Tench traversa la placette.
Il salua d’un buenos dias un homme assis contre un mur au milieu d’une petite tache d’ombre et qui tenait un fusil. Mais ce n’était pas comme en Angleterre : l’homme ne répondit rien, il se contenta de fixer Mr. Tench d’un œil malveillant, comme s’il n’avait jamais eu le moindre rapport avec cet étranger, comme si Mr. Tench n’avait pas recouvert d’or ses deux prémolaires. Mr. Tench continua sa route en transpirant, dépassa l’ancienne église où était maintenant installée la Trésorerie, et s’en alla vers le port. À mi-chemin, il se demanda brusquement pourquoi il était sorti… Un verre d’eau minérale ? C’était tout ce qu’on trouvait à boire dans ce pays de prohibition, de la bière aussi, mais elle était monopole d’État, et coûtait trop cher ; on n’en buvait qu’aux grandes occasions. Une affreuse sensation de nausée tordit l’estomac de Mr. Tench. Non, il n’était pas sorti pour acheter de l’eau minérale. Ah ! oui, bien sûr, son cylindre d’éther… Le bateau était arrivé. Il avait entendu, après le déjeuner, ses coups de sifflet triomphants, pendant qu’il était allongé sur son lit. Il passa devant la boutique du barbier, la maison des deux dentistes, et laissant à droite la douane, à gauche un entrepôt, déboucha sur le quai du fleuve.
Entre les plantations de bananiers, le fleuve roulait lourdement vers la mer. Le Général-Obregon était amarré à quai et l’on déchargeait de la bière… Déjà, une centaine de caisses s’entassaient sur le port. Mr. Tench se réfugia à l’ombre du bureau de la douane et se demanda : « Qu’est-ce que je fais ici ? » Sous l’action de la chaleur, sa tête se vidait de tout souvenir. Il fit de sa bile un crachat qu’il projeta mélancoliquement dans le soleil. Puis il s’assit sur une caisse pour attendre. Rien à faire. Personne ne viendrait chez lui avant cinq heures...." (Traduction française : Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1948).
Le dernier chapitre est emblématique et il condense tout Greene : l’ironie tragique, la grâce à travers la déchéance, et la tension entre corruption humaine et salut. Le protagoniste, ce prêtre pécheur, lâche, alcoolique mais fidèle à son sacerdoce malgré tout, accepte de répondre à l’appel d’un mourant, sachant que c’est un piège. Ce choix incarne l’essence du roman : l’opposition entre faiblesse humaine et grâce divine. Greene y cristallise son idée de la sainteté paradoxale : un homme indigne à bien des égards, mais qui reste jusqu’au bout fidèle à sa mission sacerdotale. C’est précisément sa faiblesse qui rend sa grâce plus éclatante. La scène illustre le conflit central du roman : l’État (la "puissance") qui cherche à éradiquer la foi, et la persistance mystérieuse de la grâce et de la foi (la "gloire"), incarnée par ce prêtre déchu mais fidèle ....
"Chapitre IV
Le lieutenant attendit que la nuit fût tombée pour s’acquitter lui-même de la mission ; la confier à un autre serait dangereux : le bruit se répandrait aussitôt en ville que le Père José avait été autorisé à exercer une fonction religieuse à la prison. Il serait même sage de n’en pas informer le jefe ; on ne peut pas se fier à ses supérieurs lorsqu’on a réussi là où ils ont échoué. Il savait que le jefe était mécontent qu’il eût ramené le prêtre, à son point de vue une évasion aurait été bien préférable.
Dans le patio, il se sentit surveillé par une douzaine d’yeux : les enfants y étaient en groupe, prêts à crier des quolibets au Père José lorsqu’il se montrerait. L’officier regrettait d’avoir fait au prêtre cette promesse, mais il allait tenir parole… parce que ce serait un triomphe, pour ce vieux monde corrompu, par la tyrannie de Dieu, que de pouvoir montrer une supériorité quelconque, courage, loyauté, justice…
Il frappa, mais personne ne répondit : il attendit debout dans l’obscurité du patio comme un solliciteur. Puis il frappa de nouveau et une voix cria :
— On vient, on vient.
Le Père José, le visage collé aux barreaux de la fenêtre, demanda :
— Qui est là ?
Il avait l’air de fouiller à tâtons près du sol.
— Lieutenant de police.
— Oh ! s’écria le père, d’une voix de fausset, excusez-moi. C’est mon pantalon. Dans le noir…
Il fit le geste de soulever un fardeau avec ses épaules et l’on entendit un craquement sec comme si sa ceinture ou ses bretelles avaient cédé. De l’autre côté du patio, les enfants se mirent à pousser des cris aigus :
— Padre José, Padre José !
Mais lorsque le Père José vint ouvrir la porte, il feignit de ne pas les voir et se contenta de murmurer tendrement :
— Petits démons !
— Je veux que vous veniez jusqu’au poste de police, dit le lieutenant.
— Mais je n’ai rien fait. Rien du tout. On ne peut être plus prudent que moi.
— Padre José, piaillaient les enfants.
Il continua d’une voix suppliante :
— Si l’on vous a parlé d’un enterrement, on vous a mal informé. Je n’ai même pas voulu dire une prière.
— Padre José, Padre José !…
Le lieutenant se retourna et traversa le patio. Il cria d’une voix furieuse aux petits visages derrière la grille :
— Taisez-vous. Allez donc vous coucher. Tout de suite. Vous m’entendez.
Un à un, ils s’éclipsèrent, mais dès que le lieutenant eut le dos tourné, ils revinrent à leur poste d’observation.
Le Père José déclara :
— Personne ne peut venir à bout de ces enfants.
— Où es-tu, José ? s’enquit une voix de femme.
— Ici, ma bonne. C’est la police.
Une énorme femme en chemise de nuit blanche roula vers eux comme une vague de fond. Il n’était guère plus de sept heures du soir. « Peut-être, pensa le lieutenant, vivait-elle dans ce costume, peut-être vivait-elle au lit. »
— Votre mari, dit-il en appuyant sur le mot avec satisfaction, votre mari doit se rendre au poste de police.
— Qui l’a dit ?
— Moi.
— Il n’a rien fait.
— J’expliquais justement à l’officier, ma bonne…
— Tais-toi. Laisse-moi parler.
— Cessez tous les deux de jacasser, dit le lieutenant. On a besoin de vous là-bas pour voir un homme… un prêtre. Il veut se confesser.
— À moi ?
— Oui. Vous êtes le seul.
— Pauvre homme, dit le Père José, dont les petits yeux roses firent le tour du patio. Pauvre homme.
Il se trémoussa d’un air gêné et lança un bref et furtif regard vers le ciel où tournoyaient les constellations.
— Tu n’iras pas, dit la femme.
— C’est contraire aux lois pourtant dit le Père José.
— Ne vous occupez pas de cela.
— Oh ! il ne faut pas nous en occuper vraiment, dit la femme. Je vois bien ce que vous avez dans la tête. Vous ne voulez pas laisser mon mari en paix. Vous rusez pour le prendre en faute. Je connais vos méthodes. Vous envoyez des gens lui demander qu’il dise des prières… parce qu’il est bon. Mais rappelez-vous bien ceci : il est pensionnaire du gouvernement.
Le lieutenant parla, lentement :
— Ce prêtre… il y a des années qu’il travaille en secret… pour votre Église. Nous l’avons arrêté et, bien entendu, il sera fusillé demain. Ce n’est pas un mauvais homme. Je lui ai permis de vous voir parce qu’il semblait croire que cela lui ferait du bien.
— Je le connais, interrompit la femme. C’est un ivrogne et pas autre chose.
— Pauvre homme, dit le Père José. Un jour, il a essayé de se cacher ici…
— Je vous promets, dit le lieutenant, que personne ne le saura.
— Personne ne le saura ! caqueta la femme. Demain la ville entière l’aura appris. Regardez ces enfants. Ils ne laissent jamais José en paix. On n’en verra pas la fin, tout le monde va vouloir se confesser et le gouverneur l’apprendra et on nous supprimera la pension.
— Pourtant, ma bonne amie, dit le prêtre, si c’est mon devoir…
— Tu n’es plus prêtre, dit la femme, tu es mon mari. (Elle se servit d’un mot grossier.) C’est ça ton devoir maintenant.
Le lieutenant les écoutait avec une âpre satisfaction. C’était comme s’il redécouvrait une ancienne croyance.
— Je n’ai pas le temps d’attendre que vous ayez fini de vous chamailler, dit-il. M’accompagnez-vous, oui ou non ?
— Il ne peut pas t’y forcer, dit la femme.
— Ma bonne amie, tout de même, vois-tu… après tout, je suis prêtre…
— Prêtre ! s’écria la femme. Toi ? prêtre !
Elle éclata d’un rire bruyant que les enfants postés derrière la fenêtre imitèrent aussitôt. Le Padre José couvrit ses yeux roses de sa main comme s’il souffrait.
— Ma bonne… dit-il.
Mais le rire continua.
— Venez-vous ?
Le Père José fit un geste de désespoir, comme pour dire qu’une défaite de plus ou de moins ne comptait guère dans une vie comme la sienne.
— Je ne crois pas, dit-il, que ce soit possible.
— Très bien, répondit le lieutenant en tournant brusquement les talons.
Il avait déjà perdu assez de temps à l’exercice de la miséricorde. Il entendit derrière lui la voix suppliante du Père José :
— Dites-lui que je vais prier pour lui.
Les enfants s’étaient enhardis. L’un d’eux lança d’une voix stridente : « José, viens te coucher ! » ce qui fit rire le lieutenant. Son rire faible, peu convaincant, vint augmenter l’hilarité générale qui jaillissait autour du Père José et, le dépassant, montait vers les constellations disciplinées dont jadis il connaissait les noms.
Le lieutenant ouvrit la porte de la cellule : à l’intérieur, il faisait très sombre. Il referma soigneusement les verrous derrière lui, une main posée sur son revolver.
— Il ne veut pas venir, dit-il.
Dans le noir, un être humain était pelotonné : c’était le prêtre, accroupi sur le sol comme un enfant qui joue.
— Vous voulez dire : pas ce soir ?
— Je veux dire qu’il ne viendra pas du tout.
Il y eut un moment de silence si l’on peut appeler silence l’incessant ronron de foreuse que faisaient les moustiques, et les petites explosions des cancrelats contre le mur. À la fin, le prêtre parla :
— Je suppose qu’il a eu peur.
— Sa femme n’a pas voulu le laisser venir.
— Pauvre homme !
Il essaya de rire, mais aucun son n’aurait pu être plus navrant que ce simulacre de joie. Sa tête retomba entre ses genoux : il avait l’air d’avoir renoncé à tout et d’être complètement abandonné.
— Autant que vous sachiez la vérité tout entière, dit le lieutenant. Vous avez été jugé et reconnu coupable.
— N’aurais-je pu assister à mon propre procès ?
— Cela n’y aurait rien changé.
— Non.
Il se tut, cherchant quelle attitude il allait prendre. Enfin, il demanda avec une désinvolture affectée :
— Et puis-je me permettre de vous demander… quand ?
— Demain.
La promptitude et la brièveté de la réponse mirent fin à ses fanfaronnades. Sa tête retomba. Il semblait, autant qu’on pût en juger dans cette ombre, occupé à se ronger les ongles.
— C’est mauvais, dit le lieutenant, de passer une nuit comme celle-ci dans la solitude. Si vous le voulez, vous serez transféré à la cellule commune…
— Non, non. Je préfère être seul. J’ai beaucoup à faire. (Sa voix se brisa et siffla comme s’il avait un gros rhume.) Il faut que je réfléchisse à tant de choses.
— Je voudrais faire quelque chose pour vous, dit le lieutenant. Je vous ai apporté un peu de cognac.
— Au mépris de la loi ?
— Oui.
— C’est très gentil de votre part. (Il prit la petite gourde.) Sans doute n’en auriez-vous pas besoin à ma place, mais moi, j’ai toujours eu peur de souffrir.
— Nous mourrons tous un jour, dit le lieutenant. L’heure et le jour me paraissent sans importance.
— Vous êtes vertueux : vous n’avez rien à craindre.
— Comme vos idées sont bizarres ! se plaignit le lieutenant. Il me semble parfois que tout ce que vous en faites, c’est pour me persuader.
— Vous persuader de quoi ?
— Oh ! je ne sais pas… de vous rendre la liberté, ou de croire aux préceptes de la sainte Église catholique, à la communion des saints… qu’est-ce qu’on dit donc après ?…
— La rémission des péchés…
— Vous n’y croyez guère vous-même à ça ?
— Oh ! mais si, j’y crois, dit le petit homme avec entêtement.
— Alors, qu’est-ce qui vous inquiète ?
— Je vais vous dire : je ne suis pas ignorant. J’ai toujours su ce que je faisais. Et je ne puis me donner l’absolution.
— Si le Père José était venu jusqu’ici, cela aurait-il fait une si grande différence ?
Il attendit longtemps la réponse, et lorsqu’elle vint ne la comprit pas :
— Un autre homme… cela facilite…
— N’y a-t-il rien d’autre que je puisse faire pour vous ?
— Non, rien.
Le lieutenant rouvrit la porte, en reposant machinalement la main sur sa crosse de revolver. Il se sentait triste maintenant que le dernier prêtre était sous les verrous, il ne lui restait rien pour occuper son esprit. Les ressorts de son activité semblaient s’être brisés. Il pensait aux semaines de chasse comme à une époque heureuse qui venait de se terminer et ne reviendrait plus. Il se sentait sans but, comme si la vie s’était retirée de son univers. Il dit au prêtre avec une bienveillance amère (il ne pouvait pas arriver à haïr ce petit homme creux) :
— Essayez de dormir.
Au moment où il fermait la porte, une voix tremblante de peur l’arrêta :
— Mon lieutenant ?
— Oui ?
— Vous avez vu fusiller des gens. Des gens comme moi ?
— Oui.
— Est-ce que la douleur dure… longtemps ?
— Non, non, c’est l’affaire d’une seconde, répondit-il d’un ton bourru.
Il referma la porte et traversa sans y voir la cour aux murs blanchis à la chaux. Il entra dans le bureau. Les photographies du prêtre et du bandit restaient encore épinglées au mur ; il les en arracha, elles étaient devenues inutiles. Ensuite, il s’assit devant sa table et, posant la tête sur ses mains, s’endormit d’épuisement. Plus tard, de ce qu’il avait rêvé il ne put se rappeler qu’un rire, un rire incessant, et un long couloir dont il ne parvenait pas à trouver l’issue.
Le prêtre s’assit à terre, la gourde de cognac entre les mains. Sans attendre, il en dévissa le bouchon et colla ses lèvres au goulot. L’alcool ne lui fit aucun effet : pas plus que s’il buvait de l’eau. Il reposa la gourde et commença une sorte de confession générale. Il se murmura à lui-même :
— Je me suis livré à la fornication.
L’expression toute faite ne signifiait rien : on aurait dit une phrase de journal : impossible de se repentir d’une chose énoncée ainsi. Il recommença : « J’ai couché avec une femme », et essaya de s’imaginer l’autre prêtre lui demandant : « Combien de fois ? Était-elle mariée ? » — « Non. » Sans penser à ce qu’il faisait, il but une nouvelle rasade d’alcool.
Au moment où le liquide toucha sa langue, il se rappela son enfant, entrant dans la hutte, entourée de lumière aveuglante, avec son visage triste, obstiné, assombri d’une science précoce.
— Oh ! mon Dieu, protégez-la, pria-t-il, Damnez-moi, je l’ai mérité, mais donnez-lui la vie éternelle.
Cet amour était celui qu’il aurait dû ressentir pour les créatures humaines en général : toutes ses angoisses, tout son désir d’aider l’âme à se sauver, se concentraient injustement sur cette unique enfant. Il se mit à pleurer : comme s’il était condamné à rester sur la rive et à la voir se noyer lentement, parce qu’il avait oublié les gestes qu’on fait pour nager. « C’est le sentiment, pensa-t-il, que je devrais éprouver pour tous les êtres, à tout moment » ; et il essaya de détourner d’elle ses pensées pour les fixer sur le métis, le lieutenant, la fillette du dépôt de bananes, et même un dentiste avec qui il avait passé un jour quelques instants ; il fit surgir ainsi une longue parade de visages qui tentaient en vain de forcer son attention, aussi rétive qu’une lourde porte qu’on ne peut ébranler. Car tous ceux-là étaient eux aussi en danger. Il pria : « Que Dieu les aide », mais, au moment de la prière, l’image de son enfant près du tas d’immondices s’imposa à son esprit, et il comprit que c’était pour elle qu’il priait. Encore un échec !
Au bout d’un moment, il reprit sa confession :
— J’ai été ivre… je ne sais combien de fois. Il n’est pas un seul devoir que je n’aie négligé. Je suis coupable d’orgueil, de manque de charité…
Les mots redevenaient conventionnels, vides de sens. Il lui manquait un confesseur qui eût fait passer son esprit de la formule au fait.
Il but une nouvelle gorgée d’alcool, et se levant péniblement, à cause d’une crampe douloureuse, il alla jusqu’à la porte et à travers les barreaux contempla la cour carrée, chaude, baignée de lune. Il apercevait les gendarmes endormis dans leurs hamacs et parmi eux un homme qui ne pouvait pas dormir et se balançait paresseusement, de-ci, de-là. Un étrange silence régnait partout, même dans les autres cellules. On eût dit que le monde entier avait eu le tact de tourner le dos pour éviter de le voir mourir. Retrouvant son chemin à tâtons, il regagna le coin le plus éloigné et s’assit, la gourde d’alcool entre les genoux. « Si je n’avais pas été si inutile, pensait-il, si inutile… » Ces huit années dures et désespérées lui paraissaient n’être qu’une caricature de sacerdoce : quelques communions, quelques confessions, un mauvais exemple incessant. Il pensait : « Si seulement j’avais une âme à offrir, afin de pouvoir dire : voilà ce que j’ai fait… » Des gens étaient morts pour lui. Ils auraient mérité un saint ; un peu d’amertume lui vint au cœur à cause d’eux et parce que Dieu n’avait pas jugé bon de leur en envoyer un. « Le Père José et moi, pensait-il, le Père José et moi… » Il but encore une gorgée d’alcool, en pensant au froid visage des saints qui allaient le repousser.
La nuit s’écoulait plus lentement qu’à son dernier passage dans la prison parce qu’il était seul. Ce ne fut que l’alcool, dont il but les dernières gouttes vers deux heures du matin, qui parvint à le faire un peu dormir. La peur lui donnait la nausée, il avait mal à l’estomac et l’alcool lui desséchait la bouche. Il se parlait tout haut parce que tout à coup le silence lui était devenu insupportable. Il se plaignait, lamentablement : « Tout cela est très bien… pour les saints », et un moment après : « Comment sait-il que c’est l’affaire d’une seconde ? Combien de temps dure une seconde ? » Ensuite il se mit à pleurer, en se frappant doucement la tête contre le mur. Ils avaient donné au Père José une chance de s’en tirer, mais pas à lui. Peut-être n’avaient-ils rien compris du tout, du seul fait que, si longtemps, il leur avait échappé. Peut-être pensaient-ils sincèrement qu’il repousserait les conditions que le Père José avait acceptées, qu’il ne voudrait pas se marier, qu’il se montrerait fier. Peut-être, s’il le leur proposait lui-même, était-il encore temps d’échapper. L’espoir le calma pendant un moment, et il s’endormit la tête appuyée au mur.
Il fit un rêve curieux. Il rêva qu’il était assis à une table de café devant le maître-autel de la cathédrale. Une demi-douzaine de plats s’étalaient devant lui, et il mangeait de grand appétit. Une odeur d’encens flottait, dans une étrange atmosphère d’allégresse. Ces plats – comme toutes les nourritures de rêve – n’avaient pas grand goût, mais il avait le sentiment que lorsqu’il les aurait achevés on lui servirait le meilleur mets de tous. Un prêtre, en disant la messe, passait et repassait devant l’autel, mais lui n’y prenait pas garde : le service religieux ne l’intéressait plus du tout. Enfin, les six assiettes furent vides ; une personne invisible sonna la clochette du Sanctus, et l’officiant s’agenouilla avant de présenter l’hostie. Mais lui restait assis, sans bouger, et ne faisait pas attention au Dieu sur l’autel, comme si ce Dieu eût été là pour les autres, non pour lui. Puis le verre placé à côté de son assiette se remplit de vin et, levant les yeux, il vit, en train de le servir, la fillette du dépôt de bananes.
— Je l’ai pris dans la chambre de papa, dit-elle.
— Vous ne l’avez pas volé ?
— Pas exactement, répondit-elle de sa voix précise et appliquée.
— C’est bien gentil de votre part, lui dit-il. J’ai oublié le code… comment l’appelez-vous ?
— Morse.
— C’est cela. Morse. Trois coups longs et un court.
Et immédiatement, les coups se mirent à résonner : le prêtre à l’autel, toute une congrégation invisible dans la nef, frappaient trois coups longs et un court… toc, toc, toc… toc.
— Qu’est-ce que cela signifie ? demanda-t-il.
— Une nouvelle, répondit l’enfant qui le surveillait de son regard sévère, chargé de sympathie et du sentiment de sa responsabilité.
Lorsqu’il s’éveilla, l’aurore naissait. Il émergea du sommeil plein d’un immense espoir qui le quitta brusquement et complètement dès qu’il revit la cour de la prison. C’était le matin de sa mort. Accroupi sur le sol, la gourde d’alcool vide entre les mains, il essaya de se rappeler un acte de contriction : « Oh ! mon Dieu, je regrette tous mes péchés et je vous en demande pardon… crucifié… et j’ai mérité vos châtiments les plus terribles. » Il s’embrouillait, l’esprit ailleurs : ce n’était pas la bonne mort que nous demandons toujours dans nos prières. Il aperçut son ombre sur le mur de la cellule, elle avait un air de surprise et de grotesque futilité. Quelle sottise avait été la sienne de croire qu’il aurait la force de rester, alors que tous les autres avaient pris la fuite. « Quel être impossible je suis, pensa-t-il, et combien inutile. Je pourrais aussi bien n’avoir jamais vécu. » Ses parents étaient morts, lui-même bientôt ne serait pas même un souvenir. Après tout, était-il digne de l’enfer ? Des larmes roulèrent sur son visage ; à ce moment-là, il n’avait plus peur de la damnation, même la peur de la souffrance corporelle avait reculé au second plan. Il ne ressentait qu’une immense déception de devoir se présenter devant Dieu les mains vides, parce qu’il n’avait rien fait du tout. Il lui sembla alors qu’il eût été très facile d’être un saint. Il n’était besoin que d’un peu d’empire sur soi, d’un peu de courage. Il avait le même sentiment qu’un homme qui a laissé fuir le bonheur en arrivant quelques minutes trop tard à un endroit fixé. Il savait maintenant qu’en fin de compte une seule chose importe vraiment : être un saint...."

"The Ministry of Fear" (1943, Le Ministère de la peur)
"Londres durant le Blitz. Un homme devine le poids d'un gâteau dans une fête foraine, il devient malgré lui propriétaire du microfilm caché à l'intérieur...
L’aventure d’Artur Rowe aux prises avec les mystérieux fonctionnaires du Ministère de la Peur organisé par les Allemands au cœur de Londres pendant le « Blitz » relève du roman policier ou du
roman d’espionnage. Mais comme toujours avec Greene, le drame d’Artur Rowe, cet homme qui autrefois a tué pour mettre fin à la souffrance d’un être qu’il aimait, c’est le drame de l’homme à la
recherche de l’absolu. Il tombe dans les filets des magistrats du Ministère de la Peur. Parviendra-t-il à leur échapper ? Parviendra-t-il à trouver la paix et l’amour qu’il recherche ?" (Editions
Robert Laffont)
CHAPITRE PREMIER - LES MÈRES LIBRES - I
LES kermesses, avec leurs jeux d’adresse où l’on faisait dégringoler à grand bruit des noix de coco, avaient toujours exercé sur Arthur Rowe un attrait irrésistible.
Bien entendu, il n’y avait pas de noix de coco en cette année de guerre que l’on n’aurait su oublier rien qu’à voir les trous béants et irréguliers entre les maisons du quartier de Bloomsburry. En effet, de la rue, telle la cheminée peinte d’une maison de poupée, se voyait celle d’un appartement comme accrochée à mi-hauteur d’un pan de mur délabré ; de nombreux miroirs restés suspendus, du papier peint vert, tout déchiqueté, complétaient l’ensemble, et, d’une rue avoisinante, par cet après-midi ensoleillé, on percevait le bruit du verre brisé que l’on balayait, si semblable au son monotone de la mer déferlant sur une plage caillouteuse.
Malgré ses ruines, le quartier avait tenu à bien faire les choses, et les drapeaux des Nations-Unies, joints à de nombreux oriflammes datant manifestement du jubilé du roi George V, en témoignaient.
Arthur Rowe jeta un regard d’envie au-dessus de la grille du square qui avait échappé à la récupération ; la fête l’attirait par son charme innocent. Elle respirait la jeunesse que l’on associe au jardin des presbytères, aux toilettes légères et gracieuses des jeunes filles, au parfum des bordures fleuries… à l’insouciance, et aucune moquerie ne lui venait à l’esprit devant ces moyens ingénieux et naïfs, prix de laborieux efforts, tous destinés à enrichir les fonds de quelque cause charitable.
Ici, parmi l’assistance, l’on distinguait le traditionnel pasteur qui présidait à quelque petit jeu de hasard ; là, une vieille dame en toilette imprimée qui lui tombait aux chevilles, coiffée d’une capeline souple, organisait d’un air affairé une « chasse-au-trésor » (les prix étaient enfouis dans divers endroits du jardin grand comme un mouchoir de poche) et, comme le crépuscule approchait – l’obscurcissement des lumières obligeait à fermer de bonne heure –, on pouvait prévoir de laborieuses recherches à coups de pelles.
Dans un coin, sous un platane, se trouvait la baraque du diseur de bonne aventure, laquelle ressemblait fort à un urinoir de fortune. Par cet après-midi dominicale l’ensemble était parfait et les yeux d’Arthur Rowe s’emplirent de larmes lorsque la fanfare, probablement improvisée à grand-peine, attaqua un chant patriotique de l’autre guerre, et suivant la grille, il s’achemina doucement vers son destin : un jeu où des sous – pas bien nombreux – rebondissaient sur une planche inclinée pour atterrir sur un échiquier.
La kermesse était mal achalandée : il n’existait que trois baraques et l’assistance les évitait avec soin – s’il fallait dépenser quelque chose, il valait mieux courir sa chance et peut-être gagner… des sous au jeu du damier ou des bons de la Défense nationale à la chasse au trésor.
Hésitant, et suivant toujours la grille, Arthur Rowe s’avança, tel un intrus ou comme quelqu’un doutant de l’accueil qui lui sera fait en rentrant chez lui après une longue absence. C’était un grand garçon maigre au dos arrondi et aux cheveux noirs grisonnants. Sa physionomie vive était relevée par un visage étroit au nez légèrement tordu, à la bouche naïve et tendre à la fois. Ses vêtements étaient de bonne coupe mais négligés ; on l’aurait dit célibataire et pourtant il avait aussi quelque chose de conjugal.
« Le droit d’entrée est d’un shilling, dit la dame d’un certain âge qui vendait les billets ; mais si vous attendez encore cinq minutes vous pourrez bénéficier du tarif réduit. Je pense qu’il n’est que juste de prévenir ceux qui arrivent si tard.
— Vous êtes très aimable.
— Même lorsqu’il s’agit d’une si noble cause, nous ne voudrions pas que l’on puisse croire que nous en profitons.
— Je préfère ne pas attendre… quel est le but de cette fête ?
— Aider les Mères libres… je veux dire les mères de famille des Nations libres. »
Avec allégresse, Arthur Rowe se revit adolescent et même enfant ; à cette époque de l’année, il avait toujours connu une fête semblable donnée dans le jardin du pasteur, près de Trumpington Road, avec pour décor les champs du Cambridgeshire, au-delà de l’estrade de l’orchestre improvisé, les saules étêtés bordant le ruisseau poissonneux et la plâtrière située au flanc du talus que l’on nomme « colline » en Cambridgeshire.
Chaque fois qu’Arthur avait assisté à ces fêtes villageoises il en avait toujours ressenti une impression étrange, il lui semblait s’exposer à ce qu’il lui arrivât quelque chose d’imprévu, et que la vie familiale qu’il avait jusque-là connue, pût s’en trouver bouleversée à jamais. Le rythme de l’orchestre dans le soleil couchant, l’éclat des cuivres, le visage des jeunes filles inconnues, tout se brouillait et il reconnaissait à peine Mme Troup, la gérante de l’épicerie générale et de la poste auxiliaire, Mlle Savage, l’institutrice de l’école du dimanche, et la femme du pasteur et celle de l’aubergiste. Lorsqu’Arthur était enfant, il suivait sa mère aux baraques de layette, lainages roses, poterie d’art, éléphants blancs. Il semblait qu’à cet étalage qu’il chérissait, quelque anneau magique lui accorderait trois souhaits ou la réalisation de son plus cher désir, mais, chose étrange dont il ne s’étonnait plus, il rentrait invariablement avec un exemplaire d’occasion du « Petit Duc » de Charlotte Yonge ou un Atlas désuet recommandant l’usage du thé de Mazawattee. Qu’importe ! il emportait jalousement le souvenir de cette musique, se sentait imprégné de l’heureuse atmosphère de cette agitation joyeuse et savait que l’avenir lui appartenait.
Adolescent, il connut d’autres émois : il s’imaginait rencontrer à la cure quelque jeune fille inconnue à qui il oserait parler et avec laquelle, tard dans la soirée, il danserait sur le gazon en se grisant du parfum des bois. Mais, comme ces rêves ne s’étaient jamais réalisés, il lui en restait toujours l’espoir avec tout ce qu’il offre à l’imagination. Perdu dans ses pensées, il était maintenant entré dans l’enceinte et avait atteint les platanes, tout en se demandant si, maintenant, il lui arriverait quelque aventure. Il ne pensait plus, bien entendu, à une jeune fille ou à un anneau magique mais à quelque chose de tout différent, d’inconnu, qui viendrait remplir le vide des vingt dernières années de sa vie. Écoutant la fanfare, il sentait les pulsations désordonnées de son cœur, et, bien qu’il eût atteint l’âge d’un homme, ses pensées étaient celles d’un enfant.
« Venez donc courir votre chance, monsieur ! lui lança le pasteur de sa plus belle voix.
— Il me faudrait de la monnaie…
— Non pas douze, mais treize sous pour un shilling ! »
Les uns après les autres, Arthur Rowe laissa ses pennies dégringoler le long de la pente et les regarda s’immobiliser sur le damier.
« Pas de veine aujourd’hui ! Essayez donc encore une fois… pour la bonne cause.
— Merci, j’essaierai ailleurs », répondit Arthur.
Il se souvenait que sa mère n’insistait jamais et bien qu’elle laissât aux enfants les noix de coco, visitait toutes les baraques.
En temps de guerre, il eût été difficile – pour ne pas dire impossible – d’y trouver un objet utile ; mais, sous une petite tente, sur une sorte de socle, un gâteau était là, entouré d’admirateurs, à qui une dame expliquait : « Nous avons dû réunir nos rations de beurre, et M. Tatham a trouvé les raisins. » La dame se tourna vers Arthur Rowe, et l’invita :
« Prenez un billet, monsieur, et devinez combien il pèse ! »
Arthur le soupesa et lança à tout hasard :
« Un kilo cinq cents.
— Pas mal. C’est votre femme qui vous a donné des leçons ? »
Rowe tressaillit et murmura en s’éloignant : « Non, je ne suis pas marié. »
La guerre avait rendu très difficile la tâche des petits marchands ; des livres d’occasion occupaient la presque totalité d’une échoppe, tandis qu’une autre était habilement garnie d’un amoncellement hétéroclite de vêtements d’occasion : jupons à poches, cols baleinés en dentelle, corsets de coupe désuète, tous provenant d’un fond de tiroir, dont on se débarrassait enfin au profit des Mères libres.
La laine étant rationnée, les vêtements tricotés pour enfants étaient rares, même ceux d’occasion, parce qu’ils font toujours plaisir aux amis.
Pour que les traditions ne se perdent pas, la troisième baraque était celle de l’éléphant blanc que l’on aurait tout aussi bien pu appeler « éléphant noir » en justification de la profusion d’éléphants d’ébène qu’elle exposait – sans doute un don de quelque Anglais ayant séjourné aux Indes. Il y avait des livres en lambeaux et aussi des cendriers en cuivre, de vieux étuis brodés, deux albums de cartes postales, un jeu complet d’illustrations pour Dickens (primes pour fumeurs), une bouilloire nickelée, un long porte-cigarettes rose, de nombreux coffrets en bois de Bénarès, une carte postale autographe de Mme Winston Churchill, et enfin, une coupe contenant un assortiment varié de pièces de monnaie étrangère. Arthur Rowe feuilleta les livres et découvrit le cœur serré, un exemplaire délabré du « Petit Duc » qu’il paya six pence. Sans savoir pourquoi, il pressentait une menace dont l’appréhension était encore rendue plus vive par la douceur de cette fin de journée. Entre les platanes, il aperçut un coin bombardé du square surgissant à ses yeux comme pour lui mieux permettre encore de mesurer le gouffre qui le séparait à jamais de son enfance. Tous ces gens qu’il côtoyait n’étaient-ils pas des acteurs payés pour tenir leurs rôles dans une pièce dont la moralité lui était destinée ?
Il n’était pas question pour Arthur Rowe de se joindre à la chasse au trésor, bien qu’il fût mélancoliquement intrigué par le « trésor ». Donc il ne lui restait que le diseur de bonne aventure – car il s’agissait bien d’un clairvoyant, et la baraque en question n’était pas un urinoir.
Une tenture algérienne ramenée en Angleterre par quelque globe-trotter pendait à l’entrée de la cabine et une dame lui saisissant le bras lui confia : « Il faut y aller, il faut consulter Mme Bellairs… elle est surprenante… elle m’a dit que mon fils… » et, s’adressant à une dame qui passait, elle continua sans reprendre haleine : « J’entretenais justement ce monsieur de la surprenante Mme Bellairs et de mon fils.
— Le petit ?
— Oui, Jack ! » ...
Dans "Le Ministère de la peur" (The Ministry of Fear, 1943) de Graham Greene, plusieurs chapitres marquent par leur intensité, mais le plus emblématique est souvent considéré comme le premier chapitre, celui de la kermesse. C’est là que le protagoniste, Arthur Rowe, gagne par hasard un gâteau lors d’une tombola truquée. Ce moment en apparence anodin déclenche toute l’intrigue : un engrenage d’espionnage, de manipulations et de paranoïa.
Que noter?
- L'atmosphère greenienne : le mélange de banalité quotidienne (une fête foraine) et de menace sourde.
- Le hasard et la fatalité : un geste innocent plonge le héros dans un complot.
- Le ton du roman : dès le début, Greene installe ce climat de doute et de méfiance qui imprègne tout le récit.
Certains critiques soulignent aussi le chapitre de la séance de spiritisme, plus tard dans le roman, qui condense la tension entre illusion, manipulation psychologique et menace réelle. Mais la kermesse du premier chapitre reste le plus marquant, car elle condense en une scène symbolique tout ce qui va suivre : un monde où rien n’est ce qu’il paraît...

"The Heart of the Matter" (1948, Le Fond du problème)
Ce troisième roman fut écrit à l'issue du séjour de Graham Greene à Lagos comme attaché au Foreign Office. C`est le récit des derniers mois du major Scobie, sous-directeur de la Sûreté à Freetown, Sierra Leone. Le bruit court qu'il a des aventures avec des africaines et qu`il est à la solde des Syriens qui se livrent impunément au trafic des diamants. ll n`aime plus son épouse, Louise, sorte d`intellectuelle férue de poésie moderne, mais il se sait indispensable à son bonheur. Elle supporte mal l`Afrique, son climat, ainsi que le manque d`ambition de son mari et la tiédeur de sa foi. Yusef, le boutiquier louche que la police n`a jamais pris sur le fait, éprouve pour Scobie dont il apprécie l'incorruptibilité une amitié sincère : il lui prêtera l'argent nécessaire au voyage de Louise en Angleterre. Ses démarches auprès de la banque ayant échoué, Scobie accepte, mais subit les pressions du trafiquant, devient l`objet d`un soupçon général de la colonie blanche, s`enlise dans le mensonge et sombre dans le désarroi. Auprès d'Hélène Holt, dont le mari vient de périr dans un naufrage, cette âme tourmentée retrouve une certaine pureté et la confiance en soi. Mais, incapable d`être courageusement infidèle à sa femme, Scobie joue au retour de celle-ci la comédie de la tendresse, sans pouvoir quitter Hélène, tout au long du lent calvaire de son propre suicide. Dans l`univers religieux de Greene, ce roman est traduit comme la tragédie de la pitié, du sens de sa responsabilité envers autrui qui alourdissent jusqu`au naufrage le faible Scobie. Cette faiblesse le mène à l`agonie douloureuse d`un pêcheur mais d`un pêcheur exemplaire. ll vide la coupe de la pitié amère pour découvrir que la douleur de Dieu est insondable. En même temps un souci d`aller jusqu`au bout des passions les plus humaines donne au personnage une réelle grandeur. Dans un climat de moiteur exotique et de corruption généralisée, à travers des péripéties policières encore proches du "Rocher de Brighton", le romancier progresse ici vers un art plus subtil, substituant au thème de l`homme traqué celui de l`homme devenu la proie de son propre destin. (- Trad. Robert Laffont, 1948).
"En abordant James Street, Scobie passa devant la Légation. Avec ses longs balcons, cet édifice évoquait toujours à son esprit l’idée d’un hôpital. Depuis quinze ans, il y avait vu arriver toute une succession de malades : périodiquement, au bout de dix-huit mois, certains patients nerveux, le teint jaune, étaient renvoyés dans leurs foyers et d’autres prenaient leur place : attachés coloniaux, attachés pour l’agriculture, trésoriers et directeurs des travaux publics… Il avait surveillé une à une leurs feuilles de température : premier accès de colère déraisonnable, premier verre d’alcool en trop, brusque revendication de principe, après une année d’acceptation. Les employés noirs conservaient, en marchant le long des corridors, l’attitude qu’on prend au chevet d’un malade, à l’imitation des médecins. Ils supportaient toutes les insultes avec jovialité et respect. Le malade a toujours raison.
Au coin, devant le vieux cotonnier, à l’endroit où les premiers colons s’étaient réunis le jour de leur débarquement sur ce rivage hostile, s’élevaient le Palais de Justice et le Commissariat de Police, dans un grand édifice de pierre qui était comme une manifestation de forfanterie grandiloquente d’hommes faibles. Au milieu de cette carcasse massive, l’être humain était secoué dans le vide, comme l’amande sèche dans un noyau. On ne pouvait être que hors de proportion devant une construction aussi emphatique. Mais chaque idée, en tout cas, n’y dépassait pas la profondeur d’une chambre. Dans le couloir étroit et sombre, dans le poste de police et les cellules, Scobie retrouvait toujours l’odeur de la misère et de l’injustice humaines – mêmes relents que dans un Zoo : sciure, excréments, ammoniaque, privation de liberté. C’était nettoyé tous les jours, mais l’on ne pouvait faire disparaître cette odeur. Aussi tenace que la fumée des cigarettes, les prisonniers et les agents de police l’emportaient dans leurs vêtements.
Scobie gravit les larges marches et, tournant à droite, gagna son bureau par la galerie extérieure couverte : il retrouva sa table, deux chaises de cuisine, une petite armoire, une paire de menottes rouillées pendues à un clou comme un vieux chapeau, un fichier ; aux yeux d’un étranger, la pièce eût semblé nue et sans confort, mais Scobie s’y sentait chez lui. D’autres hommes créent lentement, par accumulation, cette atmosphère d’intimité : un tableau nouveau, un nombre de plus en plus grand de livres, un presse-papier de forme étrange, le cendrier acheté pour une raison oubliée au cours de vacances oubliées. Scobie avait échafaudé ce lieu de refuge par un procédé d’élimination. Quand il avait débuté, quinze ans auparavant, la pièce contenait beaucoup plus d’objets que cela. Il y avait une photographie de sa femme, des coussins de cuir aux couleurs vives achetés au marché indigène, un fauteuil, et, sur le mur, une grande carte en couleurs du port. La carte lui avait été empruntée par de jeunes collègues, elle ne lui servait plus à rien, les moindres détails de la côte étaient dessinés sur son cerveau : de Kufa-Bay à Medley, son secteur. Quant aux coussins et au fauteuil, il avait vite découvert que, dans cette ville sans air, les commodités de ce genre étaient synonymes de chaleur. Partout où le corps entrait en contact avec un objet, une surface, chaque fois qu’il était enfermé, il transpirait. Enfin, la photographie avait été rendue inutile par la présence de sa femme. Elle était venue le rejoindre, la première année de la « drôle de guerre » et n’avait jamais pu repartir ; les dangers d’attaques sous-marines avaient fait d’elle un objet aussi inamovible que les menottes pendues au clou. En outre, la photo était très vieille et Scobie ne tenait pas à se rappeler les traits encore informes, l’expression calme et douce à force d’ignorance, les lèvres docilement écartées par un sourire que le photographe avait exigé. Quinze années pétrissent un visage, peu à peu, la douceur cède devant l’expérience, et Scobie était hanté par l’idée de sa propre responsabilité. C’était lui qui avait montré le chemin : l’expérience acquise par sa femme avait été celle qu’il avait choisie. C’était lui qui avait formé ce visage...."
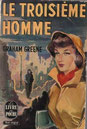
"The Third Man" (1949, Le Troisième Homme)
"The Third Man", the Classic Thriller of Post–World War II Vienna ....
Cette longue nouvelle de Graham Greene, publiée en 1950, a été rendue célèbre par le film de Carol Reed et d`Orson Welles, - avec Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, et Trevor Howard -, et par l`air de cithare lancinant du "Harry Lime Theme". 1949? Vienne est occupée par les quatre puissances victorieuses. Les carcasses calcinées des chars gisent au pied de la Grande Roue. C`est l'exposé d`un cas de conscience. Arrivant à Vienne où une situation lui a été proposée par un camarade d'enfance, le romancier Rollo Martins se trouve soudain propulsé en pleine aventure. Son ami Harry Lime vient de mourir de manière suspecte. A-t-il été assassiné ? La police anglaise d`Occupation refuse d'aider Martins, une enquête persévérante auprès du concierge de Lime, de ses amis autrichiens, de sa maîtresse Ida Schmidt, apporte des renseignements contradictoires. Malgré la police qui veut l`expulser, Martins reste, s`éprend à son tour d'lda et devient l`instrument du destin. Choisissant entre l`amitié et la justice, au terme d`une hallucinante poursuite dans les égouts, il tue son ami qui, en fait impliqué dans un trafic de pénicilline frelatée, s`était fait passer pour mort. L`ambiance trouble. romantique et sordide. de la ville impériale sous l`Occupation est savamment exploitée mais demeure accessoire dans l`étude des mobiles qui déterminent un homme à préférer le devoir à l'affection pour son ami et son propre bonheur.
Le "Troisième Homme" suivit la parution d`un recueil de nouvelles (Níneteen Stories, 1949), dont l'une des plus originales est "Première désillusion" (The Basement Room] : l`épouse d`un majordome est trouvée morte dans l`escalier. Le petit Philippe. convaincu de la culpabilité de son ami Baines, tente de le sauver par des mensonges maladroits. L`on assiste à la dégradation de l'idole et du monde magique de l`enfant que l'infidélité et la mesquinerie des grandes personnes détruisent. (Trad. Robert Laffont, 1950).

Avec "Le Troisième Homme" (1950, Carol Reed, avec Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, Bernard Lee, Wilfred Hyde-White), Graham GREENE a découvert un monde nouveau, un moyen d'expression à sa mesure : le cinéma.
C'est, en effet, pour l'écran que fut conçue cette œuvre. L'auteur de "La Puissance et la Gloire" ne pouvait, on le conçoit aisément, demeurer indifférent à cet art du Xxe siècle qui lui apportait, avec la force suggestive de l'image, le moyen de rendre plus sensibles encore son talent de psychologue et son sens inné du récit. Harry Lime, le héros à qui Orson Welles prêta sa troublante personnalité, nous conduira à travers le tragique décor d'une Vienne détruite et divisée en quatre zones internationales, celle-là même de l'immédiate après guerre, carrefour idéal pour tous les trafics, y compris les plus monstrueux.
Avant-propos de l'Auteur...
"Le Troisième Homme n'a pas été écrit pour être lu, mais pour être vu. Ainsi que dans beaucoup d'intrigues amoureuses, la chose commença autour d'une table de dîner, et se poursuivit (accompagnée de bien des migraines) en maints endroits : Vienne, Venise, Ravello, Londres, Santa Monica. Je suppose que la plupart des romanciers transportent, dans leur tête ou dans un calepin, les rudiments d'histoires qui ne seront jamais écrites. L'on y fouille parfois, au bout de longues années et l'on se dit avec regret que jadis, en un temps à jamais révolu, ces histoires auraient été bonnes. C'est ainsi que, voici dix ans, j'écrivis sur une vieille enveloppe ce paragraphe d'introduction : "J'avais fait mes derniers adieux à Harry la semaine précédente, à l'instant où l'on avait descendu son cercueil dans la terre gelée que durcissait le froid de février; aussi fut-ce avec un sentiment d'incrédulité que je le vis passer sur le Strand, sans m'adresser le moindre signe de connaissance, au milieu d'une foule d'étrangers". Pas plus que ne le fait mon héros, je n'avais poursuivi Harry; aussi, lorsque sir Alexander Korda me demanda d'écrire pour Carol Reed un film destiné à succéder à notre "Fallen Idol" (Première désillusion), je n'avais que ce paragraphe à lui offrir. Bien que Korda désirât un scénario sur la quadruple occupation de Vienne, il accepta l'idée de m'y laisser errer à la recherche de Harry. Il est, à mon avis, à peu près impossible d'écrire
un film sans avoir au préalable écrit une nouvelle. Même un film a besoin d'autre chose que d'une intrigue; il lui faut une certaine dose d'analyse psychologique, d'état d'âme, d'atmosphère, qu'il me paraît presque impossible de capter du premier coup dans l'ennuyeux réseau d'un scénario dactylographie. On peut reproduire un effet, enregistré, grâce a un autre moyen, mais l'acte de création ne saurait s'accomplir sous forme de script. Il est nécessaire de sentir qu'on possède plus de matériaux qu'on n'en peut utiliser. Par conséquent, "Le Troisième Homme", bien qu'il ne fut jamais destiné il paraître, dut commencer par être une nouvelle, avant de subir les transformations en apparence interminables qui le firent passer d'un état à l'autre.
Sur ces états successifs, nous travaillâmes, Carol Reed et moi, en très étroite collaboration, accomplissant chaque jour une tache déterminée, nous jouant certaines scènes l'un à l'autre. Personne ne fut jamais admis en tiers dans nos entretiens : ces discussions claires, ces assauts d'estoc et de taille, entre deux hommes, ont trop de prix. Le romancier, cela va de soi, considère toujours que son roman est ce qu'il a pu tirer de mieux d'un sujet particulier; il ne peut se défendre d'une certaine irritation chaque fois que le passage au film ou à la pièce de théâtre exige une modification; mais "Le Troisième Homme" ne fut jamais qu'une matière première destinée à devenir un film. Le lecteur remarquera bien des différences entre la nouvelle et le film; il ne faut pas qu'il pense que ces changements furent imposés à l'auteur à son corps défendant : il se peut même que cet auteur les ait suggérés. Le film est, en réalité, meilleur que la nouvelle, parce qu'il est, dans ce cas, le dernier "état" de l'histoire...."
On peut longuement explorer comment Greene a modifié son texte pour le film, et comment certains thèmes ont pris une alors dimension toute différente. Quant à la musique de Anton Karas; la cithare, omniprésente, crée un contraste entre légèreté de la mélodie et obscurité des thèmes abordés ...
"For an hour he waited, walking up and down to keep warm, inside the enclosure of the Great Wheel: the smashed Prater with its bones sticking crudely through the snow was nearly empty. One stall sold thin flat cakes like cartwheels, and the children queued with their coupons. A few courting couples would be packed together in a single car of the Wheel and revolve slowly above the city surrounded by empty cars. As the car reached the highest point of the Wheel, the revolutions would stop for a couple of minutes and far overhead the tiny faces would press against the glass. Martins wondered who would come for him. Was there enough friendship left in Harry for him to come alone, or would a squad of police arrive? It was obvious from the raid on Anna Schmidt's flat that he had a certain pull. And
then as his watch hand passed the hour, he wondered: was it all an invention of my mind? are they digging up Harry's body now in the Central Cemetery?
Somewhere behind the cake stall a man was whistling and Martins knew the tune. He turned and waited. Was it fear or excitement that made his heart beat—or just the memories that tune ushered in, for life had always quickened when Harry came, came just as he came now, as though nothing much had happened, nobody had been lowered into a grave or found with cut throat in a basement, came with his amused deprecating take-it-or-leave-it manner—and of course one always took it.
"Harry."
"Hullo, Rollo."
Don't picture Harry Lime as a smooth scoundrel. He wasn't that. The picture I have of him on my files is an excellent one: he is caught by a street photographer with his stocky legs apart, big shoulders a little hunched, a belly that has known too much good food too long, on his face a look of cheerful rascality, a geniality, a recognition that his happiness will make the world's day. Now he didn't make the mistake of putting out a hand—that might have
been rejected, but instead just patted Martins on the elbow and said, "How are things?"
"We've got to talk, Harry."
"Of course."
"Alone."
"We couldn't be more alone than here."
(...)
"Il attendit pendant une heure en faisant les cent pas pour se réchauffer, àl'intérieur de la clôture de la Grande-Roue. Le Prater écrasé, dont le squelette perçait de lignes brutales la couche de neige, était presque vide. Devant une baraque où l'on vendait un gâteau mince et plat, rond comme une roue de charrette, des enfants faisaient la queue, leurs tickets à la main. Quelques couples amoureux s'engouffraient ensemble dans le même Wagon de la Roue et tournaient lentement au-dessus de la ville, entourés de wagons vides. Quand le Wagon atteignait le sommet de la Roue, elle s'arrêtait de tourner pendant deux minutes et l'on voyait tout là-haut de minuscules visages se presser contre la vitre. Martins se demanda
qui allait venir. Harry avait-il encore en lui assez d'amitié pour venir seul, ou se ferait-il remplacer par un peloton de policiers? Il avait conservé une certaine influence, l'attentat contre Anna Schmidt en témoignait. Puis, au moment où l''aiguille de sa montre dépassait l'heure, Martins se demanda : mon imagination a-t-elle tout inventé? est-ce le corps de
Harry qu'ils sont en train de déterrer au Cimetière Central?
Derrière l'échoppe du marchand de gâteau, un homme se mit à siffler un air que Martins reconnut. Il se retourna et attendit. Etait-ce d'émotion ou de crainte que son coeur battait si fort...? ou n'était-ce qu'à cause des souvenirs que cet air faisait revivre? car tout s'était toujours mis à vivre plus vite quand Harry arrivait, arrivait comme maintenant, exactement... il ne s'était pas passé grand-chose, personne n'avait été mis au tombeau, ou n'avait été trouvé dans un sous-sol, la gorge tranchée... il arrivait avec son air amusé, qui allait au-devant des reproches, son air de dire : c'est à prendre ou à laisser... et naturellement on le prenait toujours!
- Harry!
- Rollo! bonjour.
Ne vous imaginez pas Harry sous les traits d'une cauteleuse canaille. Il était tout autre. Le portrait de lui que j'ai dans mon dossier est excellent; il a été surpris dans la rue par un photographe ambulant; ses jambes courtaudes sont écartées, ses grandes épaules un peu voûtées, son ventre a connu trop de bonne nourriture trop longtemps, et sur sa figure éclate une gredinerie franche, joyeuse, confiante avec la' certitude que sa chance lui vaudra partout la victoire.
Il ne commit pas l'erreur de tendre à Martins une main qui aurait pu être refusée. Il se contenta de lui toucher le coude en disant :
- Comment va?
- Nous avons. à parler, Harry.
- Bien sûr.
- Seul à seul.
- Impossible d'être plus seuls qu'ici.
(...)




La corruption et la complexité de l’âme humaine sont des thèmes au cœur du film et de l’œuvre de Greene., et le film "Le Troisième Homme" (1949, The Third Man), réalisé par Carol Reed et écrit par Graham Greene, est un chef-d'œuvre du cinéma noir qui se distingue par son atmosphère inquiétante et ses dialogues mémorables...
Le Monologue de la Grande Roue de Vienne (The Ferris Wheel Monologue) - L'une des scènes les plus iconiques du film. Dans une grande roue, Harry Lime, incarné par Orson Welles, confronté à son ami Holly Martins, justifie ses actes immoraux. Il décrit les gens en bas comme de simples points, toute sa vision cynique et amorale de l'humanité, des dialogues qui diffèrent suivant livre et film ...
"... Martins said, "Have you ever visited the children's hospital? Have you seen any of your victims?" - Harry took a look at the toy landscape below and came away from the door. "I never feel quite safe in these things," he said. He felt the back of the door with his hand, as though he were afraid that it might fly open and launch him into that iron-ribbed space. "Victims?" he asked. "Don't be melodramatic, Rollo, look down there," he went on, pointing through the window at the people moving like black flies at the base of the Wheel. "Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving—for ever? If I said you can have twenty thousand pounds for every dot that stops, would you really, old man, tell me to keep my money—without hesitation? or would you calculate how many dots you could afford to spare? Free of income tax, old man. Free of income tax." He gave his boyish conspiratorial smile, "It's the only way to save nowadays."
"Couldn't you have stuck to tyres?"
"Like Cooler? No, I've always been ambitious. "But they can't catch me, Rollo, you'll see. I'll pop up again. You can't keep a good man down." The car swung to a standstill at the highest point of the curve and Harry turned his back and gazed out of the window. Martins thought: one good shove and I could break the glass, and he pictured the body dropping among the flies. He said, "You know the police are planning to dig up your body: what will they find?"
"Harbin," Harry replied with simplicity. He turned away from the window and said, "Look at the sky."
" ... - Avez-vous jamais visité l'Hôpital des Enfants? demanda Martins; avez-vous jamais vu vos Victimes? - Harry jeta un coup d'œil sur le paysage de boîte à joujoux qui se déroulait au-dessous d'eux, puis il s'écarta de la porte. - Je ne me sens jamais en sécurité dans ces
machines-là, dit-il. Il passa sa main sur la porte comme s'il craignait de la voir s'ouvrir subitement et le précipiter dans cet espace encerclé de fer.
- Mes victimes? Ne faites pas de mélodrame, Rollo. Regardez un peu en bas.
Il lui désignait du doigt, par la vitre, les gens qui passaient comme des mouches noires au pied de la Roue.
_ Ressentiriez-vous une pitié réelle si l'une de ces petites taches cessait de bouger...pour toujours? Si je vous disais que je vais vous donner vingt mille livres pour chaque petite tache qui deviendra immobile, est-ce que vraiment, mon vieux, vous me diriez de garder mon argent... sans hésitation? ou bien calculeriez-vous combien de petites taches vous êtes prêt à sacrifier? Libre d'impôt sur le revenu, mon vieux, libre d'impôt.
Il sourit, de son enfantin sourire complice, pour ajouter :
- C`est la seule façon d'économiser, de nos jours.
- Pourquoi ne vous en êtes-vous pas tenu aux pneus?
- Comme Cooler? Ah! non, j'ai toujours eu de l'ambition. Mais ils ne pourront pas me prendre, Rollo, vous verrez ce que je vous dis. On ne peut empêcher un homme de montrer ce qu'il vaut.
Le wagonnet se balança avant de s'immobiliser au point le plus haut de la courbe; Harry se retourna et regarda par la portière. Martins pensait : je pourrais pousser un bon coup, la vitre se casse..., et il imaginait le corps tombant de cette hauteur parmi les mouches...."
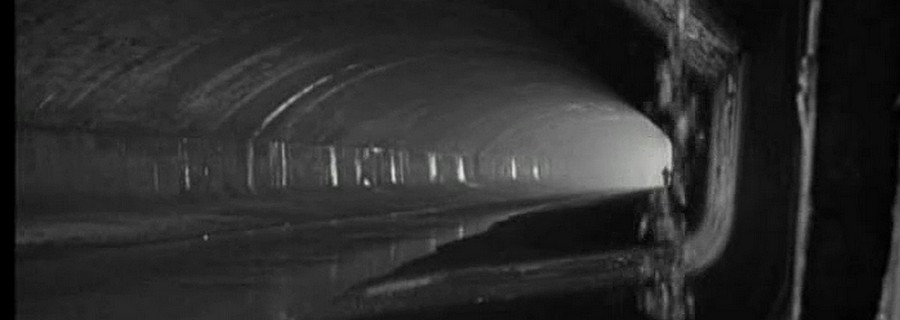
La Poursuite dans les Égouts (The Sewer Chase Scene) - La poursuite finale dans les égouts de Vienne est non seulement un moment de suspense intense, mais elle est aussi visuellement impressionnante. La lumière et l'ombre y sont magnifiquement travaillées pour créer une atmosphère oppressante. Ce moment, sans dialogue, met en scène la déchéance de Lime, qui devient une figure traquée, presque fantomatique...




La Réplique Finale de Holly Martins (Holly Martins’ Final Line) - À la fin du film, Holly attend Anna Schmidt, qui vient de passer devant lui, mais elle ne lui accorde pas un regard. Ce silence en dit long et résume l'isolement final de Holly, qui reste dans une certaine mesure fidèle à Harry Lime malgré tout. Cette fin ouverte est en parfaite opposition avec la tension des scènes précédentes et laisse au spectateur un sentiment d'ambiguïté morale.
L'Ironie et l'Absence de Rédemption (Irony and the Absence of Redemption) - Tout au long du film, Holly Martins est désillusionné par le cynisme de Harry Lime et confronté à sa propre naïveté. Cette relation ambiguë fait écho au thème de la déchéance morale, cher à Graham Greene. Les dialogues entre les deux hommes permettent une réflexion sur l'amitié et la trahison, et sur le choc entre l'idéalisme et le pragmatisme. Ainsi, la découverte de l’ampleur des actes de Lime, vont la fois choquer et fasciner Holly..

"The End of the Affair" (1951, La Fin d'une liaison)
Un des romans les plus autobiographiques de Graham Greene et histoire en trompe-l'oeil sur le tiraillement d'une femme entre son amour illégitime et Dieu: dans la passion, on finit toujours par tuer ou être tué. "Londres, janvier 1946. Maurice Bendrix, écrivain, rencontre par hasard son ami Henry Miles, diplomate, qu'il n'avait plus vu depuis un an et demi. Henry est marié à Sarah avec qui Bendrix a eu une liaison. Il avait rencontré le couple à l'été 1939 et Sarah l'avait tout de suite attiré par sa beauté et son air heureux. Après quelques années d'une passion intense, un obus frappa la maison ou ils se donnaient rendez-vous. Après avoir cru Bendrix mort, Sarah l'a vu réapparaître vivant mais, bouleversée, elle met brutalement fin à leur histoire sans un mot d'explication. Lors des retrouvailles des deux hommes, Henry confie à l'écrivain rempli de haine qu'il est inquiet. Il a le sentiment que son épouse le trompe. Rongé par la curiosité et la jalousie, Maurice tente de convaincre Henry d'engager un détective privé pour s'assurer de la fidélité de sa femme, mais Henry n'ose pas. Bendrix décide alors d'engager lui-même un détective. Au terme de son enquête, ce dernier lui remet le journal de Sarah. Il comprend enfin le revirement inexplicable de sa maîtresse le jour fatidique de leur rupture." (Editions Laffont, traduit par Marcelle Sibon). Edward Dmytryk, en 1955, avec Deborah Kerr et Van Johnson, puis Neil Jordan, en 1999, avec Julianne Moore et Ralph Fiennes, en réalisèrent une adaptation cinématographique.
"Une histoire n'a ni commencement, ni fin. Nous choisissons arbitrairement un point précis de notre expérience et, partant de ce point, nous regardons en arrière ou en avant. Je dis : « nous choisissons » avec cet orgueil erroné de l'écrivain de métier qui - dans les rares occasions où il fut vraiment pris au sérieux - se vit complimenter pour son habileté technique; mais, à vrai dire, est-ce bien de ma propre volonté que je "choisis" cette soirée sombre et mouillée de janvier 1946 et le moment où, sur les Allées, je vis Henry Miles traverser en biais le large fleuve de l'averse; et ces images ne m'ont-elles pas plutôt choisi? Il est commode, il est correct pour respecter les règles de mon métier, de commencer exactement là, mais si, à cette époque, j'avais cru en un Dieu, n'aurais-je pas pu croire aussi qu'une main m'avait touché le coude et qu'une voix avait murmuré à mon oreille : "Parle-lui. Il ne t'a pas encore aperçu".
Car, pourquoi lui aurais-je parlé? Si le mot haine n'est pas trop fort pour qu'on l'applique à un être humain, je haïssais Henry et je haïssais aussi sa femme, Sarah. Et lui, je suppose, se mit à me haïr peu de temps après les événements de ce soir-là, de même qu'il a dû par instants haïr sa femme, et l'autre, celui en qui nous avions alors la chance de ne pas croire. Aussi, ceci est-il un récit de haine bien plus que d'amour, et s'il m'arrive de dire du bien d'Henry ou de Sarah, l'on pourra me croire : je me défends d'avance contre toute accusation de parti pris, parce que mon orgueil professionnel me pousse à préférer l'expression de la vérité, fût-elle la "proche-vérité", à l'expression de ma "proche-haine".
C'était surprenant de voir Henry dans les rues par un temps pareil; il aimait son bien-être, et après tout - je le pensais du moins - il avait Sarah. Pour moi, le bien-être ressemble à un souvenir importun qui nous vient au mauvais endroit et au mauvais moment : lorsqu'on se sent très seul, mieux vaut l'inconfort. Il y avait trop de bien-être même dans la chambre à coucher-salon que j'occupais du côté sud, le mauvais côté, des Allées, au milieu de meubles sortis d'un passé qui n'était pas le mien. J'eus l'idée de me promener sous la pluie et d'aller boire un verre au café du coin. Le petit vestibule étroit était encombré de chapeaux et de pardessus inconnus - le locataire du second recevait des amis - et je pris par mégarde un parapluie qui ne m'appartenait pas. Puis, je tirai derrière moi la porte garnie de vitres de couleur et descendis avec précaution le perron démoli par une bombe en 1944 et qu'on n'avait jamais réparé. J'avais mes raisons pour me rappeler cet incident, et je savais que les affreux et épais vitraux de l'époque victorienne avaient supporté le choc de la même façon que nos grands-pères eux-mêmes l'auraient supporté.
Dès que j'abordai la traversée des Allées, je me rendis compte que je m'étais trompé de parapluie, car celui que je tenais prenait l'eau, laissant la pluie couler à l'intérieur du col de mon imperméable; c'est alors que j'aperçus Henry. J'aurais pu facilement l'éviter, il n'avait pas de parapluie et je pus voir à la lueur du réverbère que ses yeux étaient aveuglés par les gouttes d'eau. Les arbres noirs et sans feuilles n'offraient aucune protection; ils se dressaient autour des Allées comme des tuyaux de gouttières tronquées; la pluie ruisselait sur le bord du chapeau melon d'Henry et faisait des rigoles le long de son pardessus noir officiel de fonctionnaire civil. Si j'étais passé à côté de lui sans me retourner, il le m'aurait pas vu, et j'aurais pu, par surcroît, m'écarter un peu du trottoir; mais je parlai :
- Henry, lui dis-je, vous vous faites bien rare, et je vis son regard s'éclairer comme à la vue d'un vieil ami.
- Bendrix, dit-il affectueusement, et pourtant aux yeux du monde c'est lui qui, plus que moi, avait le droit de haïr.
- Que faites-vous là, sous la pluie, Henry?
Il y a des hommes qui nous inspirent l'irrésistible besoin de les taquiner : ceux dont les vertus ne sont pas les nôtres. ll répondit évasivement :
- Oh ! j'avais besoin de prendre l'air.
Nous fûmes balayés par une brusque bourrasque de vent et de pluie et il eut tout juste le temps de rattraper son chapeau qui fuyait en tourbillonnant vers les façades nord des Allées.
- Comment va Sarah? demandai-je parce qu'il eût paru étrange que je ne le fisse pas et pourtant rien ne m'aurait été plus agréable que d'apprendre qu'elle était malade, malheureuse, mourante. Je croyais à cette époque que toutes les souffrances qu'elle endurerait allégeraient les miennes, et que sa mort me rendrait la liberté, parce que je n'imaginerais plus toutes les choses qu'on imagine dans la situation humiliante où je me trouvais. Je pourrais même aimer ce pauvre serin d'Henry, pensai-je, si Sarah était morte.
- Oh ! elle passe la soirée je ne sais où, dit-il, réveillant par ces mots le démon qui s'agitait dans mon cerveau, au souvenir des jours où Henry avait dû faire cette même réponse à ceux qui l'interrogeaient alors que j'étais seul à savoir où se trouvait Sarah...."

"The Quiet American" (1955, Un Américain bien tranquille)
"Graham Greene n'est pas seulement le grand écrivain catholique consacré par le succès de son fameux roman La Puissance et la Gloire. Entré par effraction dans le royaume de la Grâce (selon le mot de François Mauriac), cet ancien membre du Foreign Office a su, au travers de divertissements tels que cet Américain bien tranquille, dénoncer la guerre, les dictatures et ce vice suprême : l'imbécillité. Il y met en scène la relation, au début des années 1950, entre un jeune Américain idéaliste et candide et un Anglais cynique, désabusé et rompu aux pratiques de la colonisation. Adapté par deux fois au cinéma, le tableau qu'il nous livre ici du conflit vietnamien, est à la fois bouleversant et inoubliable." (Editions Robert Laffont)
A la suite de son séjour en Malaisie et en lndochine, Graham Greene utilise ses observations de correspondant de guerre pour exprimer son anti-américanisme dans une satire qui s`apparente plus au "Troisième Homme" qu'à ses romans "métaphysiques". Avec un humour poli et une aisance brillante, il fait le procès de l`esprit américain. Trois personnages principaux : le journaliste anglais Fowler qui joue le rôle de l'observateur épicurien et détaché; Phuong. sa jolie maîtresse vietnamienne ni trop intellectuelle ni trop sensuelle ; Alden Pyle, le jeune Bostonien lancé sur le champ de bataille et qui croit que le salut du monde dépend du fait que soient adoptées ou non les merveilleuses institutions de la démocratie américaine. - "Jamais homme n`avait eu d`aussi bons motifs pour tous les dégâts qu'il a provoqués" - . ll essaie donc de "racheter" Phuong et l'arrache à Fowler pour la ramener en Nouvelle-Angleterre. Jouissant d`une grande autonomie dans sa mission d`aide technique, et influencé par le soi-disant expert Harding, Pyle n'hésite pas à sacrifier des enfants sous prétexte de sauvegarder le Vietnam. Fowler se voit contraint de s'opposer aux initiatives dangereuses de celui qui lui a sauvé la vie et d'aider à son élimination.
Au-delà de la dénonciation des manœuvres américaines, on débouche sur le problème de la responsabilité individuelle : Fowler doit faire la part de son ressentiment d`amant évincé, examiner ses mobiles, se départir de la neutralité dont il s'était fait une règle. Débutant par la découverte du cadavre de Pyle, le roman utilise largement le "flashback" mais demeure d'une grande simplicité linéaire, tandis que Fowler joue le rôle de narrateur. (Trad. Robert Laffont, 1957).
Joseph L. Mankiewicz, en 1958, avec Audie Murphy et Michael Redgrave, et Phillip Noyce, en 2002, avec Michael Caine, Brendan Fraser, en réalisèrent une adaptation cinématographique.
"Après le dîner, assis dans ma chambre de la rue Catinat, j'attendais Pyle. Il m'avait dit : "Je serai chez vous à dix heures au plus tard"; quand minuit eut sonné, je ne pus plus rester immobile et je descendis dans la rue. Un groupe de vieilles femmes en pantalon noir étaient accroupies sur le palier : on était en février et je suppose qu'elles avaient trop chaud pour regagner leur lit. Un conducteur de cyclo-pousse pédalait lentement en direction des quais du fleuve et j'apercevais des lampes allumées à l'endroit où l'on avait débarqué la dernière livraison d'avions américains. Pas le moindre signe de Pyle dans la longue rue. Bien entendu, me disais-je, il a pu être retenu à la Légation des Etats-Unis, pour une raison ou pour une autre, mais, dans ce cas, il n'aurait pas manqué de téléphoner au restaurant : il observait méticuleusement les petites courtoisies. J'allais rentrer chez moi quand je vis une jeune femme qui attendait sous l'entrée de la maison voisine. Je ne distinguais pas son visage, seuls étaient visibles le pantalon de soie blanche et la longue tunique fleurie, mais je la reconnus néanmoins. Elle avait si souvent attendu mon retour à ce même endroit et à cette même heure.
- Phuong, dis-je (ce nom signifie Phénix, mais rien n'est fabuleux à notre époque et rien ne renaît de ses cendres). Je savais, avant qu'elle ait eu le temps de me répondre, qu'elle attendait Pyle. "Il n'est pas ici."
- Je sais. Je t'ai vu seul à la fenêtre.
- Tu ferais mieux d'attendre en haut, dis-je. Il ne va pas tarder.
- Je peux l'attendre ici.
- Ce n'est pas prudent. Tu vas te faire ramasser par la police.
Elle me suivit jusque chez moi. Je pensai à plusieurs plaisanteries ironiques et désagréables que je pourrais faire, mais ni son anglais, ni son français n'étaient assez bons pour qu'elle pût en saisir l'ironie et, chose étrange, je n'avais aucun désir de la faire souffrir, ni même de me faire souffrir. Quand nous atteignîmes le palier, toutes les vieilles femmes tournèrent la tête et dès que nous fûmes passés, leurs voix s'élevèrent et sombrèrent, comme si elles chantaient en chœur.
- Que racontent-elles ?
- Elles se figurent que je reviens.
Dans ma chambre l'arbre que j'avais installé plusieurs semaines auparavant, pour le Nouvel An chinois, avait perdu presque toutes ses fleurs jaunes. Elles étaient tombées entre les touches de ma machine à écrire. Je les en extirpai.
- Tu es troublé, dit Phuong.
- Cela m'étonne de lui. Il est toujours si ponctuel.
J'ôtai ma cravate et mes chaussures et je m'allongeai sur le lit. Phuong alluma le poêle à gaz et mit l'eau à bouillir pour le thé. Cela aurait pu se passer six mois auparavant.
- Il a dit que tu allais partir bientôt, dit-elle.
- Peut-être.
- Il t'aime beaucoup.
- Je l'en dispense, dis-je.
Je vis qu'elle avait changé de coiffure, ses cheveux noirs et raides rejetés simplement sur les épaules. Je me rappelai qu'un jour Pyle avait critiqué sa façon compliquée de se coiffer qui - pensait-elle - convenait à la fille d'un mandarin. Je fermai les yeux et la retrouvai semblable à ce qu'elle était autrefois : elle était le sifflement de la vapeur, le cliquetis des tasses, elle était une certaine heure de la nuit, une promesse de repos.
- Il ne va pas tarder, dit-elle, comme si j'avais besoin d'être rassuré sur l'absence de Pyle. Je me demandai de quoi ils parlaient ensemble: Pyle prenait tout très au sérieux et il m'avait infligé ses conférences sur cet Extrême-Orient qu'il connaissait depuis autant de mois que moi d'années. La démocratie était un de ses autres dadas, et il avait des notions précises et exaspérantes sur ce que les Etats-Unis avaient fait et faisaient encore pour le monde. Phuong, d'autre part, était merveilleusement ignorante; si le nom de Hitler avait été cité dans une conversation, elle l'aurait interrompue pour demander qui il était. L'explication eût été d'autant plus difficile qu'elle n'avait jamais vu d'Allemands, ni de Polonais, et ne possédait qu'une connaissance très vague de la géographie de l'Europe; mais il va sans dire qu'elle était mieux renseignée que moi sur la princesse Margaret. Je l'entendis poser un tableau au pied du lit.
- Est-il toujours amoureux de toi, Phuong?
Lorsqu'on couche avec une Annamite, on a l'impression d'avoir un oiseau dans son lit : elles gazouillent et pépient sur l'oreiller. Je me rappelle avoir longtemps pensé que nulle de leurs voix ne chantait comme celle de Phuong. J'avançai la main et lui touchai le bras. Leurs os, en outre, sont aussi frêles que des os d'oiseaux.
- Réponds, Phuong.
Elle rit et j'entendis qu'elle frottait une allumette.
- Amoureux?
Peut-être était-ce une expression qu'elle ne comprenait pas.
- Veux-tu que je te fasse une pipe ? demanda-t-elle.
Quand je rouvris les yeux, elle avait allumé la lampe et le plateau était déjà préparé. La lueur de la lampe mettait sur sa peau des reflets d'ambre sombre, tandis qu'elle penchait sur la flamme un front que fronçait l'attention, pour chauffer la petite boule d'opium en faisant tourner son aiguille.
- Pyle ne fume toujours pas ? lui demandai-je.
- Non.
- Tu devrais le faire fumer, sinon il ne reviendra pas.
C'est une superstition chez elles qu'un amant fumeur d'opium revient toujours, fût-ce de France. Il se peut que la puissance virile soit diminuée par l'opium, mais elles préfèrent toutes un amant fidèle à un amant puissant. Elle malaxait la petite boule de pâte brûlante sur le bord convexe du fourneau de la pipe et je humais l'odeur de la drogue. Aucune autre odeur ne lui ressemble. A côté du lit, mon réveil marquait minuit vingt, mais déjà mon angoisse cédait. Pyle commençait à disparaître..."

"Our Man in Havana" (1958, Notre agent à La Havane)
Le roman se déroule à Cuba, sous la dictature de Batista, avant l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Le personnage principal est un anglais, Jim Wormold,
qui vend des aspirateurs à La Havane, et incapable de refuser quoique ce soit, se laisse enrôler comme agent des services secrets britanniques. Abandonné par sa femme, il élève seul Milly, une
jolie adolescente aux goûts dispendieux. Wormold n'aura aucune activité d'espionnage, et se contentant, pour amasser un petit pécule, d'inventer des missions et des recrutements d'agents
imaginaires. Cette aventure tragique et burlesque à la fois, cruelle aussi dans son dénouement, inspira à Carol Reed un classique du cinéma avec Alec Guinness dans le rôle de l'agent et
Maureen O'Hara (Our Man in Havana, 1966)...
".. Wormold sortit du Consulat, emportant un câblogramme dans la poche intérieure de son veston. On avait poussé l’enveloppe vers lui sans aménité, et lorsqu’il avait essayé de parler, on l’avait fait taire.
— Nous ne voulons rien savoir. C’est un arrangement provisoire. Plus tôt ce sera fini, mieux cela nous conviendra.
— Mr. Hawthorne m’a dit…
— Nous ne connaissons personne de ce nom. Veuillez ne pas l’oublier. Personne, dans ce Consulat, ne s’appelle Hawthorne. Bonjour.
Il rentra chez lui à pied : la cité s’étirait en longueur au bord de la haute mer ; les vagues de l’Atlantique venaient se briser sur l’Avenida de Maceo et couvraient d’embrun le pare-brise des voitures. Les colonnades roses, grises et jaunes, de ce qui était jadis le quartier aristocratique, étaient rongées comme des rochers érodés ; d’antiques armoiries, dont le dessin disparaissait sous la suie, dominaient l’entrée d’un hôtel sordide, et l’on avait peint au vernis, en couleurs criardes, les volets d’une boîte de nuit pour les protéger contre l’humidité et le sel marins. À l’ouest, les gratte-ciel d’acier de la ville neuve s’élevaient plus haut que des phares dans le ciel clair de février. C’était une ville à visiter ; pas à habiter, mais c’était la ville où Wormold était tombé amoureux pour la première fois, et il y restait attaché par la fascination qu’exercent les lieux d’un sinistre. Le temps revêt de poésie les champs de bataille, et peut-être Milly était-elle comme la fleur qui s’épanouit sur un vieux rempart où maintes années auparavant un assaut fut repoussé avec de lourdes pertes. Dans la rue, il croisa des femmes dont le front était couvert de poudre grise comme si elles avaient surgi de dessous la terre au grand soleil. Wormold se rappela que c’était le mercredi des Cendres.
Bien que ce fût un congé scolaire, Milly n’était pas à la maison lorsqu’il y arriva. Peut-être était-elle encore à la messe ou montait-elle à cheval, au Country Club. Lopez faisait une démonstration avec le Turbo-Réac, devant la gouvernante d’un curé qui venait de refuser l’Atomic. Les pires craintes de Wormold au sujet de ce nouveau modèle s’étaient révélées bien fondées : il n’avait pas réussi à en vendre un seul. Il monta et ouvrit le télégramme qui était adressé à un certain service du Consulat britannique ; les numéros qui le composaient avaient un vilain aspect, comme ceux des billets de loterie qui restaient invendus le jour du tirage. Il y avait 2674 suivi d’une ribambelle de nombres à cinq chiffres : 42811 79145 72312 59200 80947 62533 10605 et ainsi de suite. C’était son premier télégramme et il remarqua qu’il lui était adressé de Londres. Il n’était même pas sûr (la leçon qu’il avait prise lui paraissait si lointaine) de savoir le décoder, mais il reconnut un certain groupe 59200 dont l’air sec et menaçant lui fit le même effet que si Hawthorne, à ce moment même, montait l’escalier pour lui faire des reproches. Triste et sombre, il prit sur l’étagère les Contes d’après Shakespeare de Lamb. Le premier groupe de chiffres, se rappelait-il, indiquait la page, la ligne et le mot d’où parfait le code. « Dyonisia, la méchante femme de Cléon, lut-il, trouva une mort appropriée à ses mérites. » Wormold se mit à déchiffrer à partir du mot « mérites ». À sa grande surprise, quelque chose prit forme. C’était un peu comme s’il avait hérité d’un perroquet inconnu qui se serait mis brusquement à parler. « No°1 du 24 janvier. Suite 59200, début paragraphe A. »
Après avoir passé trois quarts d’heure à ajouter et à soustraire, il avait déchiffré tout le message, sauf le paragraphe final où quelque chose avait dû se détraquer, soit de son fait, de celui de 59200 ou peut-être de Charles Lamb. « Suite 59200 début paragraphe A. Près d’un mois depuis adhésion Country Club approuvée et pas je répète pas d’information concernant proposition sous-agents reçue stop, espérons n’avez pas je répète pas recruté sous-agents sans avoir pris renseignements indispensables stop, début paragraphe B rapport économique et politique sur articles questionnaire entre vos mains devrait être transmis immédiatement à 59200 stop début paragraphe C foutu galon expédier Kingston primo tuberculeux terminé. »
Ce dernier paragraphe avait une allure d’incohérence hargneuse qui inquiétait Wormold. Pour la première fois, l’idée lui vint qu’à leur opinion – qui qu’ils fussent ! – il avait pris de l’argent sans rien donner en échange. Cela le troublait. Jusque-là, il avait l’impression de bénéficier d’une générosité excentrique qui avait permis à Milly de faire du cheval au Country Club, et à lui-même de faire venir d’Angleterre quelques livres qu’il convoitait. Le reste de l’argent était déposé à la banque : il s’imaginait à moitié qu’un jour il pourrait arriver à le rendre à Hawthorne.
Il faut faire quelque chose, pensa-t-il, leur fournir des noms afin qu’ils prennent des renseignements, recruter un agent, pour leur faire plaisir. Il se rappela Milly jouant à la marchande et lui donnant son argent de poche contre d’imaginaires emplettes. Il devait respecter les règles du jeu, mais tôt ou tard Milly réclamait toujours son argent.
Il se demandait comment l’on recrute un agent. Il n’arrivait pas à se rappeler exactement comment Hawthorne l’avait recruté, lui, sauf que toute l’histoire avait commencé dans les water-closets, mais cela ne devait pas être une condition essentielle. Il décida de commencer par un racolage relativement facile.
— Je désire vous parler, Lopez.
— Si, señor Vormell.
— Vous travaillez chez moi depuis un grand nombre d’années. Nous avons confiance l’un en l’autre.
Lopez exprima la plénitude de sa confiance par un geste dirigé vers son cœur.
— Aimeriez-vous gagner un peu plus d’argent tous les mois ?
— Mais, naturellement… Je m’apprêtais à vous en parler moi-même, señor Ommel… J’attends un enfant. Peut-être vingt pesos ?
— Il ne s’agit pas du tout du magasin. Les affaires marchent trop mal, Lopez. Ce serait le salaire d’un travail confidentiel, me concernant personnellement, vous comprenez ?
— Ah oui, señor. Des services personnels, je comprends. Vous pouvez vous fier à moi. Je suis discret. Naturellement, je n’en dirai pas un mot à la señorita.
— Je crois que vous ne comprenez pas très bien.
— Quand un homme arrive à un certain âge, dit Lopez, il n’a plus le goût de se chercher une femme lui-même, il veut s’en épargner le souci. Il souhaite ordonner : ce soir oui, demain soir non. Dire ce qu’il lui faut à quelqu’un de confiance…
— Ce n’est pas cela, pas du tout. Ce que j’essayais de dire… euh… n’a pas le moindre rapport…
— Il ne faut pas être gêné pour m’en parler, señor Vormole. Il y a tant d’années que je travaille à côté de vous…
— Vous faites une erreur, dit Wormold, je n’avais aucune intention…
— Je comprends qu’un Anglais dans votre situation soit déplacé à un endroit comme le San Francisco. Même le Mamba Club…
Wormold savait que rien de ce qu’il pourrait dire n’endiguerait l’éloquence de son employé, maintenant qu’il était lancé sur le grand thème de La Havane où les rapports sexuels ne constituent pas seulement le commerce principal de la ville, mais toute la raison d’être[2] des hommes. Cela se vend ou s’achète, peu importe lequel des deux, mais cela ne se donne jamais gratuitement.
— Un jeune homme a besoin de variété, dit Lopez, mais un homme d’un certain âge aussi. Chez les jeunes, c’est la curiosité de l’ignorance ; chez les vieux, c’est l’appétit qui a besoin d’être réveillé. Personne ne peut vous aider mieux que moi, parce que je vous ai bien étudié, señor Venell. Vous n’êtes pas cubain. Pour vous, la forme des fesses d’une fille est moins importante qu’une certaine douceur dans ses manières…
— Vous m’avez compris tout à fait de travers, dit Wormold.
— Ce soir, la señorita va au concert…
— Comment le savez-vous ?
Lopez fit celui qui n’entendait pas.
— Pendant qu’elle sera partie, je vous amènerai une jeune dame pour que vous l’examiniez. Si elle ne vous plaît pas, je vous en trouverai une autre.
— Vous ne ferez rien de semblable. Ce n’est pas ce genre de service dont j’ai besoin, Lopez. Je veux… eh bien, je veux que vous ouvriez les yeux et les oreilles et que vous me rendiez compte…
— Sur la señorita ?
— Grands dieux, non !
— Que je vous rende compte de quoi, señor Vommold ?
— Mais de choses comme…, dit Wormold, qui n’avait aucune idée des sujets sur lesquels Lopez serait capable de fournir un rapport.
Il ne se souvenait que de quelques articles du long questionnaire dont pas un seul ne semblait convenir : « Infiltration communiste possible dans les forces armées » ; « Chiffres exacts de production café et tabac pour l’année écoulée ». Restait naturellement le contenu des corbeilles à papier dans les bureaux où Lopez assurait l’entretien des aspirateurs, mais même Hawthorne avait plaisanté en rappelant l’affaire Dreyfus – à supposer qu’un tel homme fût capable de plaisanter.
— Comme quoi, señor ?
— Je vous expliquerai cela plus tard, dit Wormold. Retournez au magasin...."
Le chapitre qui cristallise le plus la satire de Greene est sans doute celui où Wormold, le modeste vendeur d’aspirateurs à La Havane, envoie à Londres de faux plans d’armes secrètes.
Wormold, recruté comme agent secret malgré lui par les services britanniques, doit fournir des renseignements… mais il n’a rien.Il se met alors à inventer de toutes pièces des rapports. Le sommet de l’ironie est atteint lorsqu’il envoie des plans d’« installations militaires » qui sont en réalité des schémas de pièces détachées de ses aspirateurs. À Londres, ces dessins seront pris très au sérieux, et le service secret croira à l’existence d’une menace technologique cubaine. Greene a lui-même travaillé pour le MI6 pendant la Seconde Guerre mondiale (notamment en Sierra Leone). Il connaissait donc très bien la bureaucratie de l’espionnage et l’absurdité des rapports qui circulaient. Cette connaissance nourrit toute la veine satirique du roman.
Greene expliquera que l’idée lui était venue d’une suggestion faite en 1941 par son collègue et supérieur au MI6, Kim Philby (qui sera plus tard démasqué comme agent double au service de l’URSS). Philby lui aurait raconté qu’un agent pouvait très bien envoyer n’importe quel plan technique à Londres — par exemple une pièce de machine banale — et que les services, dans leur crédulité, l’interpréteraient comme une arme secrète. Greene a gardé l’anecdote et l’a réutilisée, presque vingt ans plus tard, dans Our Man in Havana.
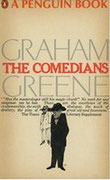
"The Comedians" (1966)
Ç'est sur un paquebot hollandais, entre les Etats-Unis et Haïti, que se rencontrent les trois protagonistes de cette histoire. Trois noms interchangeables : Brown, le narrateur, est un Anglais cosmopolite dont la vie a été guidée par le hasard, un homme sans attaches, "l'homme seul par excellence"; à Haïti il vient rendre visite à l'amour, - une liaison avec une femme mariée -, et à la fortune, -un vieil hôtel sans clientèle qu'il possède. Smith est un Américain, idéaliste et végétarien, qui va en vacances à Haïti parce qu'il "aime les gens de couleur"; il est très différent du héros d' "Un Américain bien tranquille" et plus sympathique que Pyle. Jones est un quadragénaire un peu louche, qui se livre peu et semble fuir la police. Le navire débarque dans un univers de terreur et de misère; le royaume du président Duvallier dont Greene, après la Sierra Leone, Cuba et le Congo belge, dresse un tableau inoubliable. La peur règne partout, l'horreur est partout et l`auteur explique dans sa préface, "Je n`ai pas eu à noircir le président pour accroître l'effet dramatique. ll est impossible de rendre cette noirceur plus intense". Torture dans les prisons, sadisme des Tontons Macoutes, communications coupées, cette situation n'est pas anormale, la cruauté fait partie de la vie, se déplaçant comme le faisceau d'un projecteur d'une nation à l'autre. Non sans dignité d`ailleurs, les comédiens occidentaux devront avoir recours à la fuite. ll s'en faut de peu qu'ils ne soient tués, et - à part Brown qui est condamné à cause de son indifférence - ils en sortent purifiés et ennoblis par l'épreuve. Smith se révèle d`un héroïsme un peu ridicule. Jones, devenu humain et sympathique, parvient, sous la pression des circonstances, à affronter les dangers dont il se vantait d'avoir su triompher pendant la guerre. Mais les véritables héros sont du côté des Haïtiens : le terrible Concasseur, le poète devenu révolutionnaire, la maîtresse de Brown et son mari, l`ambassadeur désabusé. Le personnage qui a la plus grande envergure symbolique est le docteur Magiot. Ce grand spécialiste du cœur est le seul à oser sortir après le couvre-feu pour porter secours aux malades. Sage, noble, il croit à l`avenir du communisme, "la seule solution possible, semble-t-il, avec la religion". L'atmosphère est celle d'un roman policier, plein de violence, de scènes de vaudou, d'éléments burlesques et de mystère. Greene semble quant à lui désespéré. La foi pour la foi, qu'il s'agisse de religion, de communisme ou même des théories végétariennes de Mr. Smith qui veut éliminer la violence en réduisant le taux d'acidité du corps humain. (Trad. Robert Laffont, 1966).

"Travels with My Aunt" (1969, Voyage avec ma tante)
« Je rencontrai ma tante Augusta pour la première fois en plus d'un demi-siècle aux obsèques de ma mère. Ma mère avait près de quatre-vingt-six ans à sa mort ; ma tante était sa cadette de quelque onze ou douze ans. Deux ans plus tôt j'avais quitté la banque avec une retraite suffisante et une agréable "enveloppe". La Westminster nous avait absorbés et ma succursale faisait double emploi. De l'avis général, j'avais de la chance. Pour ma part, je trouvais le temps long. Je n'ai jamais pris femme ; j'ai toujours mené une existence paisible ; sauf un penchant pour les dahlias je n'ai pas de violon d'Ingres. Autant de raisons qui ajoutaient aux obsèques de ma mère un brin de piquant nullement déplaisant. » L'Orient-Express, Paris, Venise, Milan, Istanbul... Lorsque Tante Augusta fait irruption, tel un tourbillon, dans la vie d'Henry, celui-ci se laisse entraîner dans une folle poursuite à travers le monde....
L`intrigue s`ouvre sur une scène où le héros, Henry Pulling, assiste à l'incinération de sa mère. Lors de la cérémonie, il rencontre sa tante? Augusta Bertram? qui fait chanceler son sens de la réalité en l'assurant que la défunte n'est pas sa "vraie" mère. Tante Augusta, alerte septuagénaire, jouit d`une vitalité exubérante et contagieuse. Voyageuse infatigable, elle se fait escorter dans ses pérégrinations par un compagnon noir nommé Wordsworth. Henry, au contraire, est un terne retraité de la banque qui se consacre à la culture des dahlias dans un jardinet méticuleusement entretenu. Ainsi est obtenu cet effet de juxtaposition incongrue typique des meilleurs roman d'Evelyn Waugh par exemple. Quand sa tante lui suggère "une ou deux escapades", son neveu entend qu'il s`agit de simples excursions et se trouve soudainement entraîné dans une série de voyages mouvementés où il fera l'expérience du "monde de l`événement inattendu et imprévu" que la chère Augusta semble attirer. Après bien des aventures, il acceptera de "traverser la frontière pour entrer dans le monde de [sa] tante" dans lequel il n`avait fait que passer jusqu'ici en touriste. L`incinération, le voyage et le rêve ont leur fonction dans ce roman qui rassemble des lieux (Brighton, Istanbul, etc.) et des thèmes (la fuite, la mort) chers à Greene mais qui, pour une fois, baigne dans le rire et la comédie. Ce sont toujours le catholicisme, l'enfance, la mort qui fournissent à l`écrivain ses thèmes de prédilection. Ainsi la tante Augusta se voit comme une "catholique à demi croyante" qui "ne croit pas à toutes ces choses auxquelles croient les catholiques". Au cours de leurs tribulations, Henry s'enfonce dans un monde de contrebandiers loufoques, de dames buveuses de whisky, de policiers caricaturaux. Il s'apparente malgré tout à d`autres héros greeniens en quête de leur vérité, mais vu cette fois sous un éclairage moins noir, et même franchement comique, quand il passe de nouvelles frontières tant physiques que spirituelles. Il en fut tiré, en 1972, un film attrayant mais peu fidèle sous la direction de George Cukor. (- Trad. Robert Laffont, 1970).
"JE rencontrai ma tante Augusta pour la première fois en plus d'un demi-siècle aux obsèques de ma mère. Ma mère avait près de quatre-vingt-six ans à sa mort; ma tante était sa cadette de quelque onze ou douze ans. Deux ans plus tôt j'avais quitté la banque avec une retraite suffisante et une agréable "enveloppe". La Westminster nous avait absorbés et ma succursale faisait double emploi. De l'avis général j'avais de la chance. Pour ma part je trouvais le temps long. Je n'ai jamais pris femme ; j'ai toujours mené une existence paisible; sauf un penchant pour les dahlias je n'ai pas de violon d'lngres. Autant de raisons qui ajoutaient aux obsèques de ma mère un brin de piquant nullement déplaisant.
Mon père était mort depuis plus de quarante ans. Entrepreneur en bâtiment. d'un naturel somnolent. il avait coutume de faire de petites siestes, l'après-midi. en toute sorte de lieux surprenants. Et ce, à l'irritation de ma mère, femme énergique et qui aimait à le débusquer pour troubler son repos. Enfant, pénétrant dans la salle de bain (nous demeurions alors à Highgate). je me souviens d'y avoir trouvé mon père dormant tout habillé dans la baignoire. Je suis assez myope et crus d'abord à un pardessus nettoyé par ma mère, puis j'entendis mon père chuchoter : "Pousse le verrou intérieur avant de sortir." Il était trop paresseux pour s'arracher à la baignoire, et trop endormi, j'imagine, pour mesurer le caractère totalement irréalisable de son ordre. Il y eut aussi l'époque où, ayant à construire un groupe d'appartements à Lewisham, il s'offrait ses petits sommes dans la cabine de la grue géante, et jusqu'à son réveil, le bâtiment n'allait plus. Ma mère, à qui l`altitude ne faisait pas peur, grimpait aux échelles jusqu'en haut des échafaudages dans l'espoir de l'y découvrir, alors qu'il y avait autant de chances de le retrouver au fond des excavations du futur garage souterrain. J 'avais toujours cru leur couple normalement heureux : leurs rôles jumeaux - la chasseresse et la proie - leur convenaient, je pense; car ma mère. dans les premières images que je pus me former d'elle, avait pris à la longue un port de tête constamment en alerte et une façon méfiante de trotter que je comparais à ceux d'un chien de chasse. Qu'on me pardonne ces évocations du passé : rien ne leur est favorable comme des obsèques, à cause de toute cette vague attente qui n`en finit pas. Le service avait lieu dans un crématorium fort connu. L'assistance était assez maigre, mais on la sentait aux aguets, parcourue de ce léger frémissement d'expectative que l'on n'éprouve jamais au bord d'une tombe. Et si les portes du four allaient refuser de s'ouvrir? le cercueil, se coincer sur le chemin de la fournaise? Derrière moi, j'entendis une voix. distinctement claire et vieille, dire : "Une fois, j'ai assisté à une incinération prématurée". C'était - non sans peine j'établis la ressemblance avec une image de l'album de famille - ma tante Augusta, arrivée en retard et vêtue assez comme notre chère et regrettée reine Mary se fût peut-être habillée si elle eût été encore de ce monde et eût tant soit peu sacrifié à la mode actuelle. Je fus surpris parle rouge éclatant de ses cheveux monumentalement échafaudés, et par ses deux dents de devant, très grandes, dont la vitalité semblait l'apparenter à l'homme de Néanderthal. Quelqu'un fit : «Chutl» et un clergyman entama une prière qui devait être de son cru; je ne l'avais jamais entendu réciter à aucun autre service funèbre, et Dieu sait si j'en ai subi en mon temps. On s'attend qu'un directeur de banque rende les derniers devoirs à n'importe quel vieux client qui n'est pas, comme nous disons, « en rouge »; et de toute manière. j'ai un faible pour les obsèques. C'est l'occasion pour les gens de se montrer généralement sous leur meilleur jour, sérieux et sobres, et optimistes quant à leur immortalité personnelle.
Les obsèques de ma mère se déroulèrent sans la moindre anicroche. En bonne économie, on récupéra les fleurs répandues sur le cercueil. lequel, sur la simple pression d'un bouton, nous quitta et glissa hors de notre vue. Après quoi, dehors. dans la lumière inquiète. je serrai la main à bon nombre de neveux, nièces et cousins que je n'avais pas vus depuis des années et que j'étais incapable d'identifier. Il était convenu que je devais attendre les cendres; ce que je fis en conséquence, tandis que la cheminée du crématorium fumait doucement au-dessus des têtes.
- "C`est sûrement toi Henry, dit Tante Augusta. en me considérant d'un air pensif et de ses yeux d'un bleu de mer profond.
- Oui, dis-je. et c'est sûrement vous Tante Augusta.
- Cela fait bien longtemps que je n'avais eu signe de vie de ta mère. me dit-elle. J'espère qu'elle a eu une mort facile.
- Mon Dieu, oui, vous savez. à cet âge... le cœur s'arrête. C`ést tout. Elle est morte de vieillesse.
- De vieillesse ? Elle n'avait que douze ans de plus que moi!" se récria Tante Augusta d'un ton accusateur."

Graham Greene n'a jamais eu une estime particulière pour sa propre existence et c'est aux confins de la condition humaine, en défiant ses frontières, qu'il a trouvé l'inspiration littéraire qui l'a conduit à écrire ses meilleures œuvres.
Son autobiographie "A Sort of Life" montre bien qu’il se pensait comme quelqu’un toujours en décalage, jamais vraiment satisfait de vivre. Greene n’écrivait jamais mieux que lorsqu’il décrivait des situations extrêmes : la peur, la culpabilité, le doute religieux, la trahison, la violence politique. Il se nourrissait de ce qu’il appelait lui-même son « goût du danger » (a taste for danger). Ses plus grands romans (The Power and the Glory, The Quiet American, The Heart of the Matter, The End of the Affair) mettent en scène des personnages déchirés, pris entre la foi et le désespoir, entre l’amour et la trahison, dans des contextes souvent dangereux. Sa fuite de lui-même le conduisait à fréquenter les bordels d'Afrique, d'Asie et d'Europe – il tenait une liste de ses quarante-sept prostituées préférées de Londres – et les fumeries d'opium en Orient. Sa consommation d'opium (jusqu'à huit pipes par jour lors de ses séjours en Asie, notamment au Vietnam pour "The Quiet American") était autant une recherche de plaisir et d'évasion qu'un matériau pour son œuvre (l'atmosphère des fumeries imprègne"The Quiet American"). Il buvait quotidiennement (notamment du whisky) et a expérimenté de nombreuses substances, comme la cocaïne en Amérique du Sud ou la marijuana, qu'il fumait même dans les jardins du Vatican. Son but déclaré était de fuir ce "moi intérieur tourmenté" – l'ennui profond, la dépression et l'angoisse existentielle qui le poursuivaient toute sa vie.
Le point le plus fascinant chez Greene réside dans le contraste entre sa vie personnelle et ses préoccupations spirituelles. Greene s'était converti au catholicisme pour épouser sa femme, Vivien, mais sa foi est devenue un élément central de son identité et de son œuvre. Il était obsédé par les concepts de péché, de grâce, de miséricorde divine et de rédemption.,Il incarnait la figure de l'homme qui croit mais qui succombe continuellement à la tentation. Ses excès pouvaient être vus comme une quête désespérée pour trouver Dieu dans les bas-fonds, aux marges de la moralité conventionnelle. Ses personnages sont souvent des saints ratés ou des pécheurs cherchant une lueur de grâce. Beaucoup y ont vu une hypocrisie monumentale, notamment dans ses critiques très dures de figures comme le Pape Pie XII (Le Pope de l'autre Europe) alors qu'il menait une vie si éloignée de la doctrine de l'Église. D'autres y voient une quête authentique, bien que désordonnée, d'un sens au-delà des règles établies.
En 1976, Graham Greene a quitté le tumulte de sa bien-aimée Saïgon pour l'Espagne et le monastère d'Oseira ...
Ce monastère de Galice est une immense et austère abbaye cistercienne souvent appelée "l'Escorial de Galice". C'était exactement le genre de lieu qui attirait Greene. Il y a séjourné quelques jours en visiteur. Les biographes rapportent qu'il était accompagné de son amie et traductrice espagnole, María del Carmen Rodríguez, et de Leopoldo Durán, un prêtre catholique et professeur espagnol, un ami proche, mais aussi le confident privilégié des luttes spirituelles de Greene. Durán a passé énormément de temps avec Greene durant ses dernières années. Son livre, "Graham Greene: Amigo y hermano" (1990), offre un portrait intime et détaillé de l'écrivain, basé sur des conversations enregistrées et des journaux personnels.
Greene passa les dernières années de sa vie dans un modeste appartement à Antibes, sur la Méditerranée française, à écrire cinq cents mots par jour. Ni plus. Ni moins. Après avoir laissé derrière lui ses jours d'aventure et de frénésie, il se consacra à l'écriture du second tome de son autobiographie, où il résuma sa vie dans la première phrase : « Quel long chemin cela a été ».
Le 3 avril 1991, sur son lit de mort, il reçut la visite de son inséparable Leopoldo Durán, qui lui donna l'extrême-onction. Greene fit ainsi ses adieux entouré de la paix que, de son vivant, il n'avait trouvée sans doute qu'au monastère d'Oseira...

"The Human Factor" (1978)
Avec ce roman publié en 1978, Graham Greene va s`aventurer sur des territoires que hante John Le Carré. C'est un retour au genre qui l'a rendu célèbre : l'espionnage. Mais c'est un espionnage très "greenien", loin des aventures de James Bond. C'est un roman froid, mélancolique et profondément désillusionné. Greene y démonte les mécanismes du MI6 (qu'il connaissait bien pour y avoir travaillé) non comme une galerie de héros, mais comme une bureaucratie absurde et trahie de l'intérieur. Le protagoniste, Maurice Castle, est motivé non par l'idéologie mais par une dette personnelle et humaine – le "facteur humain" qui vient toujours tout compliquer. C'est une réflexion ultime sur la trahison, la loyauté, l'amour et la solitude. L'atmosphère est étouffante, et le livre est considéré comme l'un de ses chefs-d'œuvre, couronnant sa carrière dans le genre du "thriller littéraire"...
CHAPITRE PREMIER
"Depuis l’époque où, jeune recrue, il était entré dans la « Boîte », il y avait de cela plus de trente ans, Castle prenait son déjeuner dans un pub situé derrière Saint James’s Street, non loin du bureau. Si on lui avait demandé pourquoi, il eût répondu que c’était à cause de l’excellence des saucisses ; peut-être aurait-il préféré à la Watney une autre marque de bière amère, mais la qualité des saucisses l’emportait sur la bière. Il était toujours prêt à rendre compte de ses actes, même les plus innocents ; il était toujours aussi d’une stricte ponctualité.
À 13 heures tapantes, chaque jour, il était donc prêt à quitter le bureau. Son adjoint, Arthur Davis, avec qui il partageait les lieux, allait déjeuner à midi juste, pour revenir, du moins en théorie, une heure plus tard. Il était entendu que, en cas de télégramme urgent, l’un d’eux devait être obligatoirement présent pour le décodage. Mais l’un et l’autre savaient pertinemment que, dans cette subdivision du département auquel ils appartenaient, il n’y avait jamais de vraie urgence. La différence d’heure entre l’Angleterre et les diverses régions d’Afrique Orientale et d’Afrique du Sud qui étaient de leur ressort suffisait d’ordinaire – même si, comme pour Johannesburg, il s’agissait d’un petit peu plus d’une heure – pour que personne, hors du service, ne se souciât d’un retard dans la délivrance d’un message : le sort du monde, aimait à dire Davis, ne se jouerait jamais sur leur continent, quel que fût le nombre d’ambassades que pussent ouvrir la Chine et la Russie entre Addis-Abeba et Conakry, ou le nombre de Cubains qui pussent débarquer.
Castle griffonna un mémo à l’intention de Davis : « Si le Zaïre répond au n° 172, envoyez copies au Trésor et aux Affaires étrangères. » Il regarda sa montre : Davis avait dix minutes de retard.
Castle entreprit de préparer son attaché-case – il y plaça la liste de ce qu’il devait acheter pour sa femme, à la fromagerie de Jermyn Street, et pour son fils, à qui il voulait faire un cadeau pour racheter sa mauvaise humeur du matin (deux paquets de Maltais), ainsi qu’un livre, Clarissa Harlowe, dont il n’avait jamais dépassé le premier tome ni le chapitre LXXIX. Dès qu’il entendit se fermer la porte de l’ascenseur et résonner le pas de Davis dans le couloir, il sortit de la pièce. Le temps prévu pour son déjeuner de saucisses était abrégé de onze minutes. À la différence de Davis, il revenait toujours ponctuellement à l’heure. C’est une des vertus de l’âge.
Dans ce cadre sage, Arthur Davis se singularisait par ses excentricités. À cet instant, on pouvait le voir s’avancer à l’autre bout du long couloir blanc, vêtu comme s’il venait de débarquer d’un week-end équestre à la campagne, à moins que ce ne fût de la pelouse d’un champ de courses. Il portait une veste de sport en tweed, d’un vert passe-partout, et il arborait un mouchoir écarlate à pois qui bouffait à sa poche de poitrine : il aurait pu être un employé du Pari Mutuel. En fait, il ressemblait à un acteur mal distribué : quand il s’efforçait de vivre à la hauteur de sa mise, en général il cafouillait le rôle. À Londres, il avait l’air d’arriver tout droit de la campagne, et, lorsqu’il rendait visite à Castle dans sa banlieue champêtre, il était à l’évidence un citadin jouant les campagnards.
— À l’heure pile, comme d’ordinaire, dit Davis avec son habituel sourire coupable.
— Ma montre avance toujours un peu, répondit Castle, s’excusant de la critique qu’il n’avait pas exprimée. Je dois faire un complexe d’anxiété.
— Alors, on sort encore des secrets d’État ? demanda Davis en feignant par jeu de s’emparer de l’attaché-case de Castle.
Son haleine avait une odeur douceâtre : il était grand amateur de porto.
— Oh, je vous en ai laissé tout un paquet à vendre ! Vous en tirerez un bien meilleur prix, avec vos contacts mystérieux.
— Très aimable à vous, vraiment dit Davis.
— Et puis vous êtes célibataire. Vous avez besoin de beaucoup plus d’argent qu’un homme marié. Je m’en tire pour deux fois moins cher que vous.
— Ah, oui, mais rien que les restes, quelle horreur ! Le talon de rôti cuit et recuit en hachis parmentier, les boulettes de viande suspectes… Est-ce que cela vaut vraiment le coup ? L’homme marié ne peut même pas s’offrir un bon porto.
Il pénétra dans le bureau qu’ils partageaient et appela Cynthia au téléphone. Il y avait maintenant deux ans que Davis essayait de se faire Cynthia ; mais, en bonne fille de général de brigade, elle entendait chasser de plus gros gibier. Tout de même, Davis continuait à espérer ; il est toujours plus sûr, expliquait-il, de mener ses amours à l’intérieur du service – cela ne peut représenter qu’une garantie de sécurité. Mais Castle savait à quel point Davis était en réalité profondément attaché à Cynthia : il avait un ardent désir de monogamie, en même temps que l’humour défensif du solitaire.
Un jour, Castle lui avait rendu visite à l’appartement qu’il partageait avec deux fonctionnaires du ministère de l’Environnement, au-dessus d’une boutique d’antiquités, non loin du Claridges – très central, très West End.
— Vous devriez vous rapprocher un peu du bureau, avait conseillé Davis à Castle dans le salon encombré, où des magazines pour tous les goûts – du New Statesman à Penthouse et à Nature – jonchaient le canapé, et où les verres sales, vestiges d’un « pot » donné par un autre, avaient été refoulés dans les coins en attendant la femme de ménage.
— Vous savez très bien ce qu’on nous paie, avait répondu Castle. Et je suis marié.
— Grave erreur de jugement.
— Pas pour ce qui me concerne, avait répliqué Castle. J’aime bien ma femme.
— Sans compter le petit corniaud, bien sûr, avait poursuivi Davis. Moi, il me faudrait choisir entre les enfants et le porto.
— Il se trouve que j’aime bien aussi le petit corniaud.
Castle était sur le point de descendre les quatre marches de pierre et de poser le pied sur le trottoir de Piccadilly, quand le concierge lui dit :
— Le général Tomlinson voudrait vous voir, monsieur.
— Le général Tomlinson ?
— Oui, bureau A.3.
Castle n’avait rencontré qu’une seule fois le général de brigade Tomlinson, il y avait de cela des années. (Combien ? il n’avait aucune envie de les compter.) C’était le jour de sa nomination – celui où il avait apposé son nom au bas du serment sur les secrets d’État. Le général n’était encore qu’un très modeste officier, si même il avait déjà du galon. Le seul souvenir qu’il gardât de lui était celui d’une petite moustache noire, planant comme un objet non identifié au-dessus d’une étendue de papier buvard, parfaitement blanche et vide, peut-être pour des raisons de sécurité. La tache de sa signature, après qu’il l’eut griffonnée au bas du serment, était devenue l’unique flétrissure sur cette surface, et la feuille avait presque certainement été arrachée et envoyée à l’incinérateur. L’Affaire Dreyfus avait assez souligné les dangers de la corbeille à papier, il y avait de cela près d’un siècle.
— À gauche au bout du corridor, monsieur, lui rappela le concierge, comme il allait se tromper de direction.
— Entrez, entrez, Castle, dit la voix forte du général Tomlinson.
Sa moustache était maintenant aussi blanche que le buvard et, avec les années, il lui était poussé une petite bedaine sous son gilet croisé – seul, subsistait le doute sur son grade. Nul ne savait à quel régiment il avait appartenu autrefois, à supposer que ce régiment eût jamais existé, car tous les grades militaires portés dans ce bâtiment avaient quelque chose de suspect. Le grade faisait peut-être tout simplement partie de la couverture générale.
— Je ne crois pas que vous connaissiez le colonel Daintry, reprit Tomlinson...."
"Tout homme amoureux est un espion en puissance", fait-il dire à l'un de ses personnages. Ici un agent double nommé Castle cherche à aider des Noirs sud-africains amis de sa femme de couleur. ll devient une "taupe" et transmet des renseignements aux Soviétiques. Les fuites sont découvertes, l`adjoint de Castle est assassiné par méprise à la place de celui-ci qui se réfugie, avec l'aide des Russes, à Moscou où, tel Robinson Crusoe,
il fera l'expérience de la solitude. Castle, être solitaire, aspire à prendre sa retraite des Services secrets mais doit continuer à cautionner ce qu`il appelle "le système" afin de rembourser les dettes contractées à l'occasion de la fuite de sa femme en Angleterre. Espion, agent double par choix délibéré, il n'a point d'ami et ne croit plus en rien. Ayant pris conscience de la corruption et de la cruauté sadique de l'univers des renseignements (qui l`ont contaminé), il contribue à son tour par ses propres actions à contaminer ses semblables. Ainsi son collègue Davis, être veule qu'un romantisme de jeunesse a fait fourvoyer dans la carrière, est-il soupçonné de trahison et assassiné par erreur à sa place.
Partie I – La routine et le cadre
Maurice Castle, agent au MI6, est présenté dans son quotidien tranquille : bureau sans éclat, banlieue résidentielle, vie familiale avec Sarah (sud-africaine, exilée grâce à l’aide de communistes) et leur fils adoptif Sam. Castle travaille avec Davis dans la section Afrique, sous une hiérarchie discrète mais oppressante.
Greene choisit d’ouvrir son roman par l’anti-spectaculaire. Il déconstruit le mythe du “glamour” de l’espionnage (contrairement à Ian Fleming, par exemple). Tout est routine, attente, petits rituels de bureau. L’ennui devient un ressort dramatique, créant une atmosphère de claustrophobie morale. → Déjà, le « facteur humain » est suggéré : l’agent n’est pas un héros, mais un employé enfermé dans ses contradictions.
Partie II – Soupçons et enquête
Une fuite d’informations sur l’Afrique du Sud et les alliances stratégiques est détectée. Les supérieurs (notamment Daintry, responsable de la sécurité) ouvrent une enquête interne. Les regards se tournent vers Davis, collègue de Castle : ses habitudes douteuses (alcool, désinvolture, sorties de documents) nourrissent la suspicion.
Cette partie illustre l’univers paranoïaque des services secrets. Greene dénonce une logique de suspicion permanente où la loyauté ne compte pas, remplacée par la surveillance bureaucratique. C’est aussi une critique sociale : le racisme implicite de la politique britannique vis-à-vis de l’Afrique du Sud est effleuré, montrant que la “sécurité nationale” justifie tout.
Partie III – Le faux coupable
Davis devient officiellement suspect. Les réunions internes décrivent froidement comment gérer son cas. Dr Percival, figure inquiétante, met en place une élimination « propre ». Davis est empoisonné à son insu et meurt. L’affaire est discrètement classée.
Ici, Greene déploie une critique frontale du cynisme institutionnel. Davis, collègue faillible mais sans danger réel, est sacrifié pour préserver l’image du Service. Le ton clinique de ces scènes (réunions, procédures, décision d’un meurtre administratif) rappelle la froideur des bureaucraties totalitaires — mais c’est ici l’Angleterre démocratique qui agit ainsi. On bascule du roman policier à la tragédie politique.
Partie IV – Castle en tension
La mort de Davis bouleverse Castle. En parallèle, l’enquête continue en arrière-plan. Mais Castle reste hors de cause. Ses doutes et ses inquiétudes croissent, notamment vis-à-vis de sa famille. On découvre progressivement qu’il mène une double vie, transmettant des informations aux Soviétiques.
La tension dramatique repose sur le décalage entre l’apparente innocence de Castle et sa culpabilité réelle. Greene révèle peu à peu la complexité morale de son personnage : Castle n’est pas motivé par idéologie, mais par dette personnelle et fidélité à ceux qui ont sauvé Sarah. Le “facteur humain” devient central : la trahison ici n’est pas trahison politique, mais fidélité privée.
Partie V – La révélation
Castle est démasqué. Ses motivations apparaissent clairement : gratitude envers un communiste qui a sauvé sa femme de l’apartheid ; refus de fermer les yeux sur la politique britannique vis-à-vis de l’Afrique du Sud ; attachement viscéral à sa famille. Sa double vie s’éclaire à la lumière de ses valeurs humaines.
Le roman prend ici toute sa force morale. Greene inverse les codes : le “traître” est le personnage le plus loyal, et les services “patriotiques” apparaissent comme les plus corrompus. Castle illustre la thématique chère à Greene : l’individu déchiré entre institutions oppressives et conscience morale. Cette partie est aussi un plaidoyer contre le cynisme géopolitique de la Guerre froide.
Partie VI – Isolement et chute
Castle est exfiltré à Moscou, coupé de Sarah et Sam. Loin d’être accueilli en héros, il devient un pion parmi d’autres dans un monde austère et glacé. Sa vie se réduit à l’exil, la solitude et le désenchantement.
La fin est profondément tragique. Castle perd tout : sa patrie, sa famille, ses illusions. Greene montre que le “facteur humain” — ce qui donne sens à la vie — est broyé à la fois par l’Ouest et par l’Est. Ni Londres ni Moscou ne laissent de place à la fidélité intime. C’est une condamnation universelle du cynisme politique. On retrouve ici le pessimisme classique de Greene : l’individu, même noble, est voué à l’échec face aux appareils de pouvoir.
III - "Le temps semblait long. Castle essaya de lire ; mais aucun livre ne parvenait à soulager la tension de ses nerfs. Entre deux paragraphes, il était hanté par la crainte d’avoir laissé traîner dans la maison un motif d’accusation. Il avait exploré toutes ses étagères de livres : plus un seul ouvrage qui lui eût servi à coder un message à un moment quelconque. Guerre et Paix avait été détruit, et bien. Il avait ramassé dans son bureau toutes les feuilles de papier carbone offrant trace d’utilisation – si innocente fût-elle – pour les brûler. Sur sa table de travail, la liste de numéros de téléphone présentait un ordre de secret qui s’arrêtait au médecin et au dentiste. Et pourtant, il avait la sensation d’un indice certain oublié quelque part. Il revoyait les deux hommes de la Special Branch fouillant l’appartement de Davis ; il se rappelait les vers marqués d’un c par son collègue mort, dans le recueil de Browning légué par M. Davis père. Il n’y aurait pas trace d’amour dans la maison de King’s Road. Sarah et lui ne s’étaient jamais adressé de lettres enflammées : en Afrique du Sud, elles eussent prouvé un crime.
Jamais il n’avait passé de journée si longue et si solitaire. Il n’avait pas faim, bien que Sam fût le seul à avoir pris un petit déjeuner ; mais il se disait qu’on ne pouvait prévoir les événements possibles avant la nuit, ni le lieu où on lui servirait son prochain repas. Il s’assit à la cuisine devant une assiette de jambon. À peine avait-il avalé un morceau qu’il se rappela : 13 heures, journal parlé. Il écouta jusqu’au bout – y compris la moindre nouvelle sportive. On n’est jamais sûr – il pouvait très bien y avoir une nouvelle de dernière minute.
Naturellement, il n’y avait rien qui le concernât le moins du monde. Même pas une allusion au jeune Halliday. Le contraire eût été étonnant. Désormais, Castle vivait entièrement à huis clos. Pour quelqu’un qui, pendant tant d’années, s’était occupé de renseignement secret, comme on dit, il se sentait bizarrement hors du coup. La tentation était de lancer de nouveau le S.O.S. d’urgence ; mais il avait déjà commis une imprudence, surtout la seconde fois, en utilisant le signal de chez lui. Il ignorait complètement où résonnait la sonnerie ; en revanche, ceux qui surveillaient sa ligne étaient parfaitement capables de remonter à la source. La conviction qu’il avait eue, la veille, d’être abandonné, toute communication coupée, grandissait d’heure en heure.
Il donna le reste de jambon à Buller, qui l’en remercia en déposant une traînée de bave sur son pantalon. Il aurait dû sortir le chien depuis longtemps ; mais il répugnait à quitter les quatre murs de sa maison, même pour descendre au jardin. Si la police venait, il voulait être arrêté chez lui, et non dehors, avec les ménagères du voisinage qui épieraient derrière les fenêtres. En haut, dans un tiroir à côté du lit, il gardait un revolver. Il n’avait jamais avoué à Davis la possession de cette arme, qui était parfaitement légale et datait de son séjour en Afrique du Sud. Tous les Blancs, ou presque, étaient armés, là-bas. À l’époque où il l’avait acheté, il n’avait chargé qu’une seule chambre, la seconde, pour éviter de tirer à la première impulsion, et la cartouche n’avait pas bougé de là depuis sept ans. Il songea : « Je pourrai toujours m’en servir contre moi-même, si jamais la police vient à faire irruption. » Mais il savait parfaitement que le suicide était pour lui hors de question. Il avait promis à Sarah que, un jour, ils seraient de nouveau ensemble.
Il prit un livre, alluma la télévision, reprit le livre. Une idée folle lui vint : sauter dans un train pour Londres, aller aux nouvelles chez le père du jeune Halliday. Mais, peut-être, déjà surveillait-on la maison et la gare.
À 4 heures et demie, entre chien et loup, comme le soir rassemblait sa grisaille, le téléphone sonna pour la seconde fois et, contre toute logique, il répondit. Il espérait à demi que ce serait la voix de Boris, tout en sachant suffisamment que Boris ne courrait jamais le risque de lui téléphoner chez lui.
La voix sévère de sa mère résonna à son oreille, comme si elle avait été dans la pièce.
— C’est toi. Maurice !
— Oui.
— Je suis bien contente de te trouver là. Sarah semblait croire que tu serais peut-être parti en voyage.
— Non, je n’ai pas bougé.
— Que signifie cette histoire stupide entre vous ?
— Ce n’est pas une histoire stupide, maman.
— J’ai dit à Sarah qu’elle devrait me laisser Sam et retourner immédiatement auprès de toi.
— Elle ne vient pas, j’espère ? demanda-t-il, saisi de peur.
L’idée d’une seconde séparation lui semblait absolument insupportable.
— Non, elle refuse. Elle prétend que tu ne la laisserais pas entrer. Ce qui est absurde, naturellement.
— Ce n’est pas du tout absurde. Dans la minute où elle vient, je pars.
— Que s’est-il donc passé entre vous ?
— Tu le sauras un jour.
— Songerais-tu au divorce ? Ce serait un désastre pour Sam.
— Pour l’instant, il n’est question que d’une séparation. Laissons aux choses le temps de se décanter un peu, maman, c’est tout.
— Je ne comprends pas. J’ai horreur de tout ce que je ne comprends pas. Sam veut savoir si tu as donné à manger à Buller.
— Réponds-lui que oui.
Elle raccrocha. Il se demanda si, quelque part, un enregistreur déroulait à nouveau leur conversation. Il avait besoin d’un whisky – la bouteille était vide. Il descendit à ce qui avait été jadis une cave à charbon, et qui était devenu sa réserve pour le vin et les alcools. La glissière servant aux livraisons de charbon avait été transformée en une sorte de soupirail à tabatière. Levant les yeux, il vit sur le macadam la flaque de lumière d’un réverbère et les jambes d’un homme qui semblait s’être posté au pied de celui-ci.
Ces jambes n’étaient pas revêtues d’un pantalon d’uniforme ; mais rien ne les empêchait d’appartenir peut-être à un officier en civil de la Special Branch. L’homme, quel qu’il fût, s’était placé tout bonnement juste devant la porte ; cela dit, le but d’une telle surveillance pouvait fort bien être d’effrayer Castle, pour le pousser à commettre une imprudence. Buller l’avait suivi en bas de l’escalier ; lui aussi, il avait remarqué cette paire de jambes là-haut, et il se mit à aboyer. Il avait l’air redoutable, assis sur l’arrière-train, le museau levé ; pourtant, si les jambes avaient été à portée de ses crocs, loin de les mordre, il les eût couvertes de bave.
Tandis qu’ils la contemplaient tous deux, la paire de jambes s’éloigna et disparut, et Buller grogna de déception : il avait perdu l’occasion de se faire un nouvel ami. Castle trouva une bouteille de J. & B. (il lui vint à l’esprit que la teinte du whisky n’avait plus la moindre importance) et il remonta en songeant : « Si je ne m’étais pas débarrassé de Guerre et Paix, peut-être aurais-je maintenant le temps d’en lire quelques chapitres pour le plaisir. »
La bougeotte le reprit et le conduisit à la chambre à coucher où il se mit à fourrager parmi les affaires de Sarah, à la recherche de vieilles lettres, bien qu’il ne pût s’imaginer en avoir jamais écrit une seule susceptible de l’incriminer. Mais, entre les mains des gens de la Special Branch, même l’allusion la plus innocente risquait d’être retournée contre Sarah comme une preuve de complicité coupable. Il leur faisait confiance pour avoir cette idée – il faut toujours compter en pareil cas avec la laideur méchante d’un désir de vengeance. Il ne trouva rien : quand on s’aime et que l’on est réuni, les vieilles lettres ont plutôt tendance à perdre toute valeur. On sonna à la porte d’entrée. Immobile, l’oreille tendue, il écouta. On sonna une deuxième, puis une troisième fois. Il se dit que ce n’était pas le genre de visiteur à se laisser arrêter par le silence et qu’il était idiot de ne pas lui ouvrir la porte. Si, après tout, la ligne n’était pas coupée, il se pouvait que ce fût un message, ou des instructions… Sans savoir pourquoi, il prit, dans le tiroir de sa table de chevet, le revolver chargé de son unique balle et le fourra dans la poche de sa veste.
Dans le vestibule, il hésita encore. Le vitrail au-dessus de la porte projetait des losanges jaunes, verts, bleus sur le sol. L’idée lui vint que, s’il ouvrait la porte, le revolver à la main, la police aurait le droit de l’abattre en excipant de la légitime défense. Solution de facilité par excellence : jamais on ne brandirait publiquement des preuves contre un homme mort. Puis il se gourmanda, en se disant qu’aucun de ses actes ne devait être dicté par le désespoir, non plus que par l’espoir. Il laissa l’arme dans sa poche et ouvrit.
— Daintry ! s’exclama-t-il.
Il ne s’était pas attendu à un visage connu.
— Puis-je entrer ? demanda Daintry, d’une voix empreinte de timidité.
— Mais bien sûr.
Buller surgit soudain de sa retraite.
— Il n’est pas méchant, dit Castle en voyant Daintry reculer.
Il saisit Buller par le collier, et le chien répandit sa bave entre eux, tel un jeune marié maladroit qui lâche l’alliance.
— Que faites-vous ici, Daintry ?
— Oh ! comme je passais par là en voiture, j’ai pensé que je pourrais venir vous dire un petit bonjour.
Le prétexte était si manifestement faux que Castle en eut pitié pour Daintry. Le colonel n’avait rien de ces inquisiteurs suaves, pleins d’une amabilité meurtrière, comme en engendre le MI-5. Il n’était qu’un simple fonctionnaire de la Sécurité, à qui l’on pouvait se fier pour veiller à la stricte observance du règlement et à la fouille des attaché-cases.
— Vous prendrez bien un verre ?
— Avec plaisir.
La voix de Daintry était rauque. Il reprit – comme s’il s’était senti contraint de trouver une excuse à tout :
— Il fait horriblement froid et humide, ce soir.
— Je n’ai pas mis le nez dehors de toute la journée.
— Vraiment ?
Castle songea : « Aïe, c’est la gaffe ! Si le coup de téléphone de ce matin venait du bureau… » Il ajouta :
— Sauf pour sortir le chien dans le jardin.
Daintry prit le verre de whisky et le contempla longuement ; puis son regard parcourut le salon, à petits coups brefs qui faisaient penser à la manière d’opérer d'un un photographe de presse. Tout juste si l’on n’entendait pas cliqueter les paupières.
— J’espère vraiment que je ne vous dérange pas, dit-il. Votre femme…
— Elle n’est pas là. Je suis tout seul. À part Buller, bien entendu.
— Buller ?
— Le chien.
Le silence profond de la maison était décuplé par les deux voix. Elles le rompaient alternativement, à coups de banalités.
— Je n’ai pas trop noyé votre whisky, j’espère ? dit Castle. (Daintry n’avait encore rien bu.) Je pensais à autre chose.
— Mais non, mais non. Il est juste comme je l’aime.
Le silence retomba, comme le pesant rideau de fer d’un théâtre. Castle ouvrit le feu avec une confidence :
— Le fait, est que je suis un peu dans l’ennui.
Le moment semblait propice pour bien établir l’innocence de Sarah.
— Dans l’ennui ?
— Ma femme m’a quitté. Avec mon fils. Elle est partie chez ma mère.
— Vous voulez dire que vous vous êtes disputés ?
— Oui.
— Vous m’en voyez très désolé, dit Daintry. C’est un genre de chose toujours pénible quand il vous arrive.
Il avait l’air de décrire une situation aussi inéluctable que la mort. Il poursuivit :
— Vous savez, la dernière fois que nous nous sommes vus… au mariage de ma fille… c’était rudement gentil à vous de m’accompagner à la réception chez ma femme, ensuite. J’étais très heureux de vous avoir avec moi. Dire qu’il a fallu que je lui casse une de ses chouettes !
— Oui. Je m’en souviens.
— Je crains de ne vous avoir même pas remercié comme je l’aurais dû. Et par-dessus le marché c’était un samedi ! Comme aujourd’hui. Elle était folle furieuse de cette histoire de chouette… ma femme, veux-je dire.
— Nous avons dû partir brusquement, à cause de Davis.
— Oui. Pauvre diable !
Cette fois encore, le rideau de fer descendit comme sur une fin de scène d’une pièce démodée. Le dernier acte ne tarderait pas à commencer. Il était temps d’aller au bar. Ils burent tous deux en même temps.
— Que pensez-vous de cette mort ? demanda Castle.
— Je ne sais qu’en penser. À dire vrai, je m’efforce de ne pas penser.
— Ils sont convaincus que c’était lui le responsable d’une fuite dans mon département, n’est-ce pas ?
— Ils sont avares de confidences avec un fonctionnaire de la Sécurité. D’où vous vient cette idée ?
— Il n’est pas dans les routines normales de recourir aux hommes de la Special Branch pour perquisitionner, quand l’un d’entre nous vient de mourir.
— Non, sans doute pas.
— Cette mort vous a paru bizarre à vous aussi ? ..."
Le découpage en six parties n’est pas arbitraire : il suit une progression policier, bureaucratique, tragédie morale, isolement existentiel. Comme dans tous les romans de Greene, le héros est racheté, son cynisme adouci par l'amour qu'il porte à sa femme Sarah et au fils de celle-ci, Sam. Auprès d`elle il redevient Maurice. Tous ses actes sont accomplis pour eux, tous tendent à préserver le fragile sanctuaire qu`ils se sont ménagé. Castle a trahi son pays pour l'empêcher de participer aux agissements de l'Afrique du Sud et des Etats-Unis, dit-il. Et Sarah de lui répondre : "Nous avons notre propre patrie. Toi et moi et Sam. Celle-là tu ne l`as jamais tra ie, Maurice". Castles'efforce de se raccrocher à cette certitude tout en sachant que son amour lui fait courir tousles risques car un homme amoureux est un "anarchiste qui porte sur lui une bombe à retardement". L'amour qu'il voue à sa femme est sacré ; mais elle est ce "facteur humain" qui le rend imprudent. En lui donnant trop, il met sa sécurité en péril et sera contraint, pour la préserver, d'être séparé d`elle. Ce sacrifice, seule faiblesse du protagoniste. l'exile pour toujours dans les froides solitudes moscovites. Devenu citoyen soviétique, il reste seul, ayant renoncé à tout pour rien; jamais il n`atteindra la cité de ses rêves, celle de la "paix de l'esprit". Dans un monde dominé par les stratégies d’État, l’humain subsiste — fragile, contradictoire, voué à être broyé ...
Roman désespéré où Greene suggère qu'aucune issue n'est possible, ni dans le rêve, ni dans la religion, ni dans une amélioration quelconque de la condition humaine. On a souvent remarqué les ressemblances existant entre la destinée tragique de Maurice Castle et celle de Kim Philby, ami du romancier et agent double qui, démasqué, dut se réfugier à Moscou en 1963. (Trad. Robert Laffont, 1979).
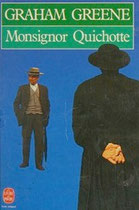
"Monsieur Quichotte" (1982, Monsignor Quixote)
L'œuvre testamentaire : Si "The Human Factor" est son dernier grand roman "réaliste", "Monsieur Quichotte" est son testament spirituel et littéraire. C'est une fable tendre, drôle et profondément émouvante. Greene y réécrit le mythe de Don Quichotte à travers l'histoire d'un petit prêtre espagnol, nommé par hasard "monsignor", qui part sur les routes avec son ami communiste, "Sancho" Zancas. Le livre est le point d'orgue de ses interrogations sur la foi, le doute, le communisme, l'amitié et la grâce. Les dialogues entre le prêtre et le maire communiste sont parmi les plus beaux qu'ait écrits Greene : pleins d'humanité, d'humour et de respect pour les croyances de l'autre. C'est une œuvre de paix et de réconciliation, tant avec lui-même qu'avec le monde.
- Père Quichotte : Curé d'un petit village espagnol, El Toboso, descendant autoproclamé du Don Quichotte de Cervantes. Homme simple, d'une foi profonde mais pleine de doutes, il est accidentellement promu « Monseigneur » (« Monsignor ») par un évêque de passage qu'il a aidé.
- Sancho Zancas : Ancien maire communiste du village, vendant des articles d'occasion. C'est un matérialiste, rationaliste et plein de bon sens, mais aussi un ami loyal.
- Rocinante : La vieille voiture du père Quichotte, une SEAT 600 délabrée, du nom du cheval de Don Quichotte.
Le passage de six parties (dans l’original) à quatre parties (dans certaines traductions françaises) tient à des choix éditoriaux et de réception plutôt qu’à un véritable changement du texte...
"I - COMMENT LE PÈRE QUICHOTTE DEVINT UN MONSIGNOR
ÇA s’est passé comme ça. Le père Quichotte avait commandé son déjeuner solitaire à sa gouvernante et s’était mis en route afin de se procurer du vin à une coopérative locale, à huit kilomètres d’El Toboso, sur la route de Valence. C’était un jour de chaleur immobile où l’air tremblait au-dessus des champs secs, et sa petite Seat 500, achetée d’occasion huit ans auparavant, ne possédait pas de climatiseur. Tout en conduisant, il songeait avec tristesse au jour où il lui faudrait changer de voiture. L’homme vit sept fois plus longtemps qu’un chien : à ce compte, sa voiture n’était pas entrée depuis trop longtemps dans l’âge mûr, mais il avait remarqué que ses paroissiens jugeaient déjà la petite Seat presque sénile. Ils lui prodiguaient des avertissements. « Impossible de s’y fier, don Quichotte », et il ne pouvait que répondre : « Nous avons traversé ensemble bien des mauvais jours, et je prie le Seigneur qu’elle me survive. » Tant de ses prières étaient demeurées sans réponse qu’il nourrissait quelque espoir que celle-ci fût demeurée logée tout ce temps, tel un bouchon de cérumen, dans l’Oreille éternelle.
Il pouvait deviner la grand-route aux petits nuages de poussière que les voitures soulevaient au passage. Tout en conduisant, il s’inquiétait du sort de sa Seat, qu’il nommait, en souvenir de son ancêtre, « ma Rossinante ». Il ne pouvait souffrir l’idée de la voir finir à la ferraille. Il avait parfois songé à acheter un bout de terrain qu’il laisserait en héritage à l’un de ses paroissiens, à condition qu’un coin abrité fût réservé pour le repos de son véhicule, mais il ne pouvait faire confiance à aucun de ses paroissiens – d’ailleurs une mort lente par la rouille était inévitable, et le broyeur constituerait peut-être une fin plus clémente. Il ruminait ces pensées pour la centième fois lorsqu’il faillit emboutir une Mercedes noire arrêtée à l’angle de la grand-route. Il supposa que la silhouette vêtue de sombre, derrière le volant, s’accordait un peu de repos avant de reprendre le long trajet de Valence à Madrid, et il continua sans s’arrêter jusqu’à la coopérative enfin d’acheter sa bonbonne de vin. C’est seulement au retour qu’il distingua le col romain blanc, tel un mouchoir agité en signal de détresse. Comment l’un de ses collègues avait-il pu s’offrir le luxe d’une Mercedes ? Ce n’est qu’en s’arrêtant qu’il remarqua le rabat violet qui annonçait au moins un monsignor, peut-être un évêque.
Le père Quichotte avait quelque raison de craindre les évêques ; il n’ignorait pas que celui de son diocèse le détestait et, malgré son illustre ascendance, le considérait à peu près comme un vulgaire paysan. « Comment pourrait-il être descendu d’un personnage imaginaire ? » avait-il un jour demandé, lors d’un entretien privé qu’on s’empressa de rapporter au père Quichotte.
L’interlocuteur de l’évêque s’était étonné.
« Un personnage imaginaire ?
— Le héros d’un roman dû à un écrivain surestimé, nommé Cervantes – un roman qui, de plus, comporte de nombreux passages répugnants que le censeur, du temps du generalissimo, n’aurait jamais admis.
— Mais, Votre Excellence, on peut voir la maison de Dulcinée à El Toboso. C’est écrit là, sur une plaque : maison de Dulcinée. »
— Piège pour les touristes. Rendez-vous compte, poursuivit sèchement l’évêque, Quichotte n’est même pas un nom espagnol. Cervantes lui-même dit que son nom était probablement Quixada ou Quesada, voire Quejana, et sur son lit de mort Quichotte se donne le nom de Quijano.
— Je constate que Votre Excellence a lu l’ouvrage.
— Je n’ai jamais dépassé le premier chapitre. Bien que j’aie naturellement jeté un coup d’œil sur le dernier, ce qui est ma manière habituelle avec les romans.
— Peut-être quelque ancêtre du père se nommait-il Quixada ou Quesana ?
— Les hommes de son espèce n’ont pas d’ancêtres. »
Ce ne fut donc pas sans quelque émoi que le père Quichotte se présenta à la haute silhouette ecclésiastique installée dans l’élégante Mercedes. « Je suis le père Quichotte, monsignor. Puis-je vous être utile ?
— Certes oui, mon ami. Je suis l’évêque de Motopo. »
Le monsignor parlait avec un fort accent italien.
« L’évêque de Motopo ?
— In partibus infidelium, mon ami. Y a-t-il un garage près d’ici ? Ma voiture refuse d’aller plus loin, et s’il se trouvait aussi un restaurant – ...."
Partie I – Le prêtre de village et son improbable promotion
Le père Quixote, humble curé de village à El Toboso (Castille), est nommé monsignor par le pape après un concours de circonstances (une rencontre fortuite avec un prélat influent). Lui-même se considère comme un descendant du fameux Don Quichotte, mais personne ne le prend au sérieux.
Greene commence par un ton comique et tendre. Le parallèle avec Cervantès est explicite : le curé naïf devient une sorte de chevalier de Dieu. Mais sous l’humour, il y a une réflexion sur la fragilité des institutions religieuses : la promotion ecclésiastique est arbitraire, fruit de la politique interne de l’Église, non de la sainteté.
Partie II – La rencontre avec Sancho
Quixote se lie d’amitié avec l’ancien maire communiste de la ville, surnommé Sancho (comme l’écuyer du Quichotte original). Tous deux décident de voyager ensemble à travers l’Espagne dans la vieille voiture du curé, baptisée « Rossinante ».
Le duo improbable incarne le cœur du roman : un prêtre catholique naïf et un ex-maire communiste désabusé. Greene reprend le modèle du couple dialogique (foi vs idéologie, croyance vs matérialisme). Mais ce n’est pas un combat : c’est une amitié qui ouvre un espace de dialogue respectueux, où l’un nourrit la pensée de l’autre.
Partie III – Voyage, dialogues et aventures
Le voyage en Castille et Galice est ponctué de discussions sur Dieu, la foi, le marxisme, la politique espagnole post-franquiste. Des rencontres cocasses ou tendres jalonnent leur route : auberges, paysans, prêtres, fonctionnaires. À chaque étape, Quixote et Sancho confrontent leurs visions du monde.
Greene joue sur l’humour et la satire, mais surtout sur l’idée que le dialogue sincère est plus fécond que la confrontation idéologique. L’Espagne de l’après-Franco sert de toile de fond : un pays encore déchiré entre Église, communisme, monarchie et démocratie. Greene fait de ses personnages des figures allégoriques mais profondément humaines.
Partie IV – Les tensions et la surveillance
Leur périple commence à attirer l’attention. Les autorités ecclésiastiques et politiques voient d’un mauvais œil ces deux « marginaux » qui discutent librement de religion et de politique. Des surveillances, menaces et oppositions apparaissent.
Ici, le roman prend un tour plus grave. Greene montre que ni l’Église hiérarchique ni l’État n’aiment les voix indépendantes. Le voyage devient une sorte de fuite ou d’exil intérieur. Comme chez Cervantès, le ridicule apparent cache une quête profonde.
Partie V – Crises spirituelles et amicales
Les discussions entre Quixote et Sancho se font plus intimes, plus conflictuelles aussi. Chacun est ébranlé par la sincérité de l’autre : le prêtre par le doute, le communiste par l’ouverture à une dimension spirituelle. Leur amitié est testée par la fatigue, la maladie et la pression extérieure.
Greene atteint ici la profondeur de son propos : l’important n’est pas la victoire d’une idéologie, mais la rencontre entre deux êtres qui reconnaissent leur fragilité. La dialectique entre foi et matérialisme devient une méditation sur l’incertitude. Quixote est touché par le doute, Sancho par le mystère de la foi.
Partie VI – Fin tragico-comique
Quixote, affaibli, connaît une sorte de passion mystique. Dans un moment d’extase et de délire religieux, il célèbre une messe en prison ou à l’hôpital (selon les éditions). Il meurt dans les bras de Sancho, fidèle jusqu’au bout. Sancho est bouleversé par cette mort et laisse transparaître une ouverture spirituelle.
La fin mêle comédie et tragédie, comme chez Cervantès. Quixote meurt ridicule aux yeux du monde, mais lumineux pour son ami. Greene met en scène une sainteté naïve, non reconnue par l’institution. L’ultime ironie est que la vérité et l’humanité se trouvent dans la faiblesse et l’amitié, pas dans les dogmes.
"IV - COMME QUOI MONSIGNOR QUICHOTTE REJOIGNIT SON ANCÊTRE
1 - LE grand bâtiment gris du monastère d’Osera étire sa silhouette dans une solitude presque totale au creux d’une cuvette des monts de Galice. Une petite boutique et une buvette à l’entrée même du domaine constituent tout le village d’Osera. La façade sculptée qui date du XVIe siècle dissimule un intérieur du XIIe siècle – un escalier imposant, large de vingt mètres peut-être, et que tout un peloton pourrait gravir au coude à coude, mène aux longs couloirs où s’alignent les chambres d’hôte qui dominent la grande cour et les cloîtres. L’unique son, ou presque, qu’on entende de la journée est le tintement des marteaux maniés par la demi-douzaine de travailleurs qui s’efforcent de réparer les dommages de sept siècles. On voit parfois filer une silhouette en surplis blanc qui se hâte d’accomplir une mission qu’on peut penser sérieuse. Dans les coins d’ombre se dessinent les figures de bois des papes et celles des chevaliers dont l’ordre fonda le monastère. Ces silhouettes se donnent une apparence de vie, à la manière des souvenirs tristes qui s’animent après la nuit tombée. Le visiteur se croit sur une île délaissée qu’un poignée d’aventuriers vient seulement de coloniser, s’efforçant de bâtir un foyer sur les ruines d’une civilisation éteinte.
Les portes de l’église, qui donnent sur un petit parvis devant le monastère, ne s’ouvrent qu’aux heures des visites et des messes dominicales, mais les moines disposent d’un escalier privé par où ils descendent du couloir où sont les chambres d’hôte jusqu’à la nef, aussi imposante que celle de bien des cathédrales. C’est seulement aux heures de visite, ou lorsqu’il y a des hôtes, qu’on entend des voix humaines résonner parmi les vieilles pierres, un peu comme si un bateau de plaisance avait débarqué une poignée de touristes sur l’île.
2. Le père Leopoldo n’était que trop conscient d’avoir cuisiné un piètre déjeuner pour l’hôte du monastère. Il ne se faisait aucune illusion sur ses talents culinaires, mais ses frères de la Trappe étaient habitués à une nourriture encore plus déplorable et ne pouvaient guère se plaindre : chacun d’entre eux, son tour venu, devait s’illustrer aux fourneaux, pour le meilleur ou pour le pire. En revanche, la plupart des hôtes trouvaient sans doute le régime un peu rude, et le père Leopoldo était d’autant plus malheureux à la pensée du repas de ce midi que l’unique pensionnaire du moment avait droit à toute sa vénération : il s’agissait du titulaire de la chaire d’Études hispaniques à l’université Notre-Dame, aux États-Unis. À en juger par son assiette, le professeur Pilbeam n’avait pas pris plus d’une ou deux cuillerées de soupe, et il avait à peine touché au poisson. Le frère convers qui assistait le père Leopoldo aux cuisines s’était permis un froncement de sourcils appuyé, accompagné d’un clin d’œil, en voyant revenir la vaisselle du déjeuner. Quand on fait vœu de silence, un clin d’œil peut transmettre autant qu’un mot, et nul entre ces murs n’avait juré de s’interdire la communication non verbale.
Le père Leopoldo fut heureux de pouvoir enfin quitter la cuisine pour se rendre à la bibliothèque. Il espérait y trouver le professeur, afin de pouvoir exprimer de vive voix tous ses regrets au sujet du repas. Il n’était pas défendu de parler à un hôte, et le père ne doutait pas que le professeur Pilbeam comprendrait sa distraction à propos du sel. Au moment crucial, il songeait, comme souvent, à Descartes. La présence du professeur Pilbeam, dont c’était la deuxième visite à Osera, l’avait enlevé à la paix d’une existence de routine pour le replonger dans un monde plus confus, celui de la spéculation intellectuelle. Le professeur Pilbeam était peut-être la plus grande autorité contemporaine sur la vie et l’œuvre d’Ignace de Loyola, et tout débat intellectuel, fût-ce sur un sujet aussi peu attrayant pour le père Leopoldo qu’un saint jésuite, revenait à présenter de la nourriture à un affamé. La chose pouvait présenter des dangers. Si souvent, les hôtes du monastère étaient des jeunes gens très pieux qui s’imaginaient avoir vocation à mener la vie d’un trappiste ; ils ne manquaient jamais de l’irriter par leur ignorance, leur respect exagéré pour ce qu’ils croyaient être son grand sacrifice. Ils désiraient, dans un élan romantique, donner leur propre vie. Lui n’était venu que pour trouver une paix précaire.
Le professeur ne se trouvait pas dans la bibliothèque. Le père Leopoldo s’assit et se remit à penser à Descartes. Descartes l’avait tiré du scepticisme pour le mener vers l’Église, tout comme il l’avait fait pour la reine de Suède. Descartes n’aurait certainement pas mis trop de sel dans la soupe, il n’aurait pas trop fait griller le poisson. Descartes était un homme doté de sens pratique, il avait poursuivi des recherches concernant des lunettes destinées à remédier à la cécité et des sièges roulants pour les infirmes. Jeune homme, le père Leopoldo ne songeait pas à prendre l’habit. Il s’était attaché à Descartes sans savoir où cela risquait de le mener. Il voulait tout remettre en question, à la manière de Descartes, quêtant une vérité absolue, et, pour finir, il avait, comme Descartes, accepté ce qui lui semblait être le plus proche de la vérité. Mais, parvenu à ce stade, il avait fait un plus grand bond que son maître – un bond qui l’avait projeté dans le monde silencieux d’Osera. Il n’était pas malheureux – si l’on oublie la soupe et le poisson – mais il n’en accueillait pas moins avec joie l’occasion de parler à un homme intelligent, même s’il fallait s’entretenir de saint Ignace plutôt que de Descartes.
Au bout d’un moment, ne voyant aucun signe du professeur Pilbeam, il gagna le couloir des chambres d’hôte et descendit jusqu’à la grande église, qui serait probablement vide à cette heure, alors que le portail était fermé. À l’exception des touristes, qui avaient leurs horaires, peu de gens venaient à l’église – même le dimanche –, de telle sorte qu’il s’y sentait un peu comme dans l’intimité d’un foyer, à l’abri des intrus. Là, il pouvait prier à sa manière : il priait souvent pour Descartes, et parfois même il adressait des prières à Descartes. L’église était mal éclairée ; en y pénétrant par le passage privé, il ne reconnut pas tout de suite la silhouette figée devant un tableau assez ridicule qui représentait un homme nu pris dans un buisson d’épines. Mais le visiteur parla avec son accent américain – c’était le professeur Pilbeam.
« Je sais que vous n’aimez pas beaucoup saint Ignace, dit-il, mais au moins c’était un bon soldat, et un bon soldat saurait souffrir d’une manière plus utile qu’en se jetant dans les épines. »
Le père Leopoldo renonça à son idée de prière solitaire ; de toute façon, cette occasion de discuter constituait, par sa rareté, un plus grand privilège. « Je ne suis pas du tout certain, répondit-il, que saint Ignace ait été à ce point préoccupé par les choses utiles. Un soldat peut être un grand romantique. Tous les Espagnols sont romantiques, au point parfois de prendre les moulins à vent pour des géants.
— Les moulins à vent ?
— Vous savez qu’un de nos grands philosophes modernes a comparé saint Ignace avec don Quichotte. Ils avaient beaucoup en commun.
— Je n’ai pas lu Cervantes depuis mon adolescence. Trop fantaisiste à mon goût. La fiction a vite fait d’user ma patience. Les faits, voilà ce que j’aime. Si je pouvais exhumer un seul document inédit à propos de saint Ignace, je mourrais heureux.
— Les faits et la fiction – ils ne sont pas toujours faciles à distinguer. Vous, en tant que catholique…
— Catholique de nom, mon père, j’en ai bien peur. Je ne me suis pas donné la peine de changer l’étiquette que je portais à ma naissance. Et, bien sûr, le fait d’être catholique m’aide dans mes recherches – ça ouvre des portes. Mais vous, mon père, vous étudiez Descartes. Ça ne doit guère vous ouvrir de portes, j’imagine. Qu’est-ce qui vous a amené ici ? ..."
Là où Castle (Le Facteur humain) était broyé par la politique, Quixote est sauvé (dans la mémoire de Sancho) par l’amitié et la fidélité. Deux romans tardifs de Greene, deux faces d’une même méditation sur l’homme face aux systèmes.
La relation entre le prêtre et le communiste est le pilier du livre. Greene montre que l'affection et le respect humains dépassent toutes les barrières politiques et religieuses. Le père Quichotte n'est pas un fanatique. C'est un homme qui doute constamment, qui pose des questions, mais dont la foi simple et aimante finit par être plus forte que les certitudes dogmatiques de l'Église. Greene réactualise le mythe de Don Quichotte en remplaçant les chevaliers et les géants par les évêques, la Garde Civile et les débats idéologiques du XXe siècle. Rocinante est une voiture, Sancho est un marxiste, mais l'essence du rêve, de l'idéalisme et de la folie humaine reste intacte...
